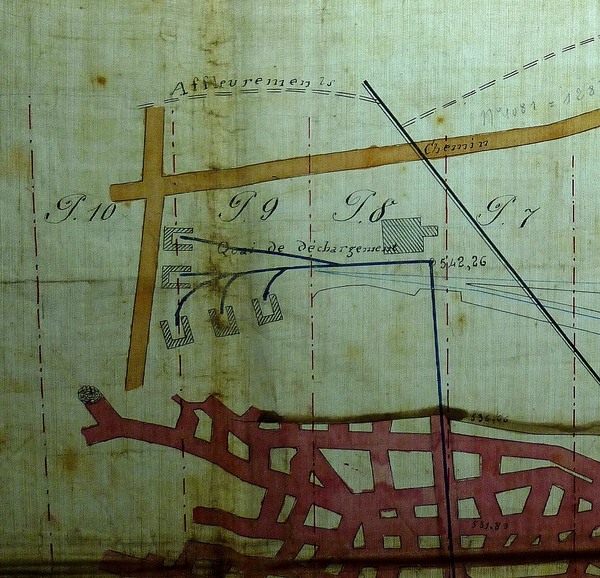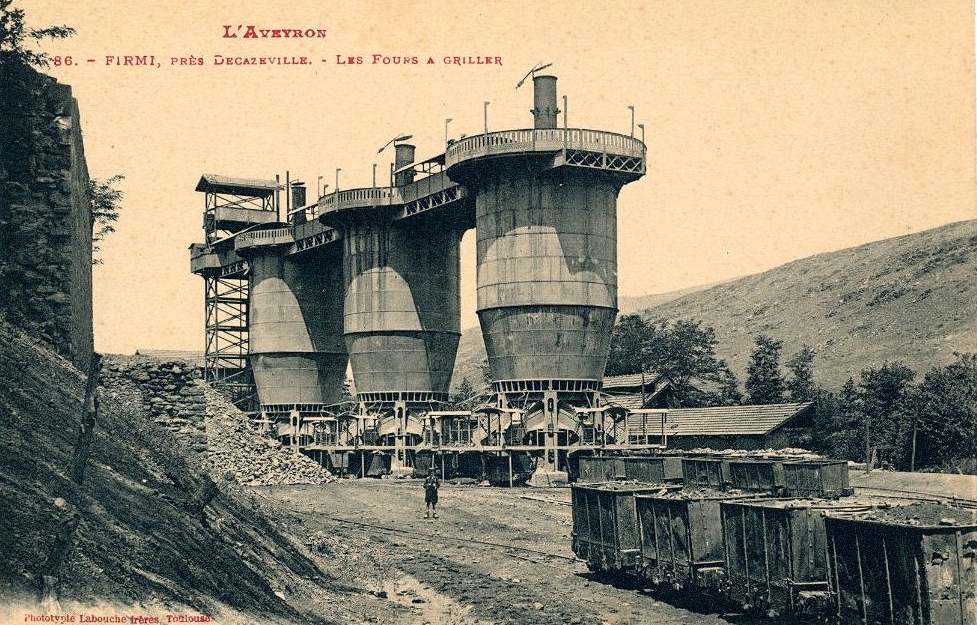La voie ferrée de la
discorde :
vignes du Cruou
et minerai, une réelle opposition
Jean Rudelle, 2018
texte, infographies et illustrations
de l’auteur
sauf mentions contraires
Remerciements
à Anne-Marie Jaudon-Merino pour la communication d’archives familiales
(documents ici cotés AMJM)
à Sophie Fraissine
pour la découverte de ces pépites.
Dans
les extraits et autres citations, nous avons conservé l’orthographe
d’origine.
Pour
la plupart des images, un clic et une meilleure résolution s'affichera.
▼Les cartes
faisant mention de la voie minière du Cruou sont rarissimes. Celle-ci,
de 1929, mérite notre attention.
Publiée pour un livret de tourisme,
le graphisme de la voie minière depuis Decazeville semble différent
pour la section
Marcillac Les Espeyroux, malgré un écartement identique de 0,66
m.
voir aussi dans le menu, chapitre 8,
page cartes, carte 93
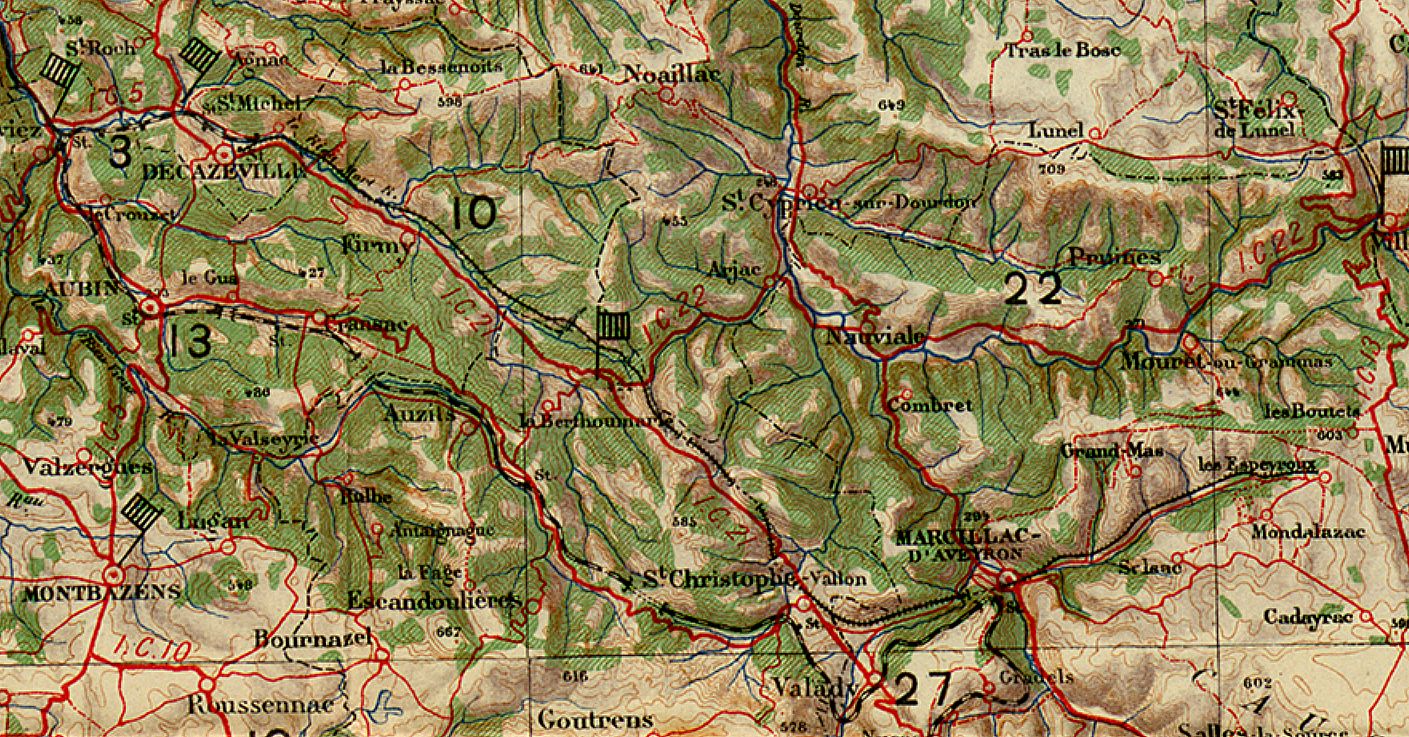

▲
sur les versants, les vignes du Cruou
▼ 1905,
les rails toujours d'actualité...

1891,
1904 : une bonne douzaine d’années de conflits ! A la fin du XIXe
siècle, la belle vallée du Cruou se remet d’une visite du phylloxera.
Cet insecte piqueur ne fait pas beaucoup de bruit, mais ses ravages
sont bien réels. Et un autre imprévu s’annonce, visite non souhaitée,
un chemin de fer ! Une voie ferrée ? Oui, une vraie avec ses trains,
ses rails, son bruit, ses trépidations, bref tout ce que le vigneron du
Cruou ne veut pas voir au bas de ses vignes !
mur
d'images
DR,
col ANJM
clic
pour afficher
▼
▼
▼

Champêtre,
préservée, tranquille…
La vallée du Cruou n’est pas longue,
7 à 8 km tout au plus, mais très
encaissée et relativement rectiligne. Taillée dans les cailloux du
causse comtal, sur sa bordure nord, elle donne passage au Cruou,
modeste ruisseau, né vers 500 m d’altitude, et qui rejoint le Créneau à
Marcillac. Ici l’altitude n’est plus que de 280 m. On a donc compris
que la pente est raide ! Les flancs de la vallée se dressent au sud et
au nord et les profils en long ou en travers ne militent pas
particulièrement pour établir une voie ferrée. Le versant exposé au sud
est évidemment le terrain de jeu préféré des propriétaires, abandonnant
le versant exposé au nord à la forêt. De tout temps, le versant
ensoleillé connaît une activité soutenue. Les vignes sont là depuis des
siècles, les cartes peuvent témoigner s’il le fallait, et un train ne
peut pas remettre en cause ce patrimoine, pense-t-on.
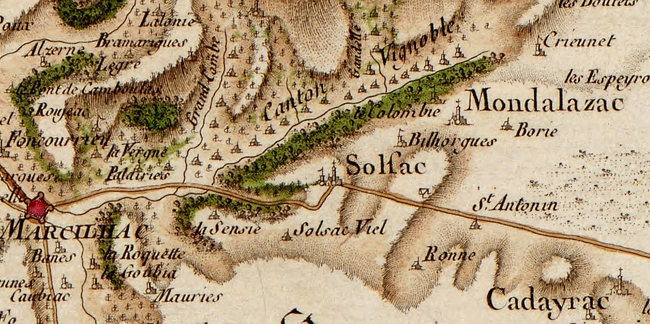
▲
Carte de Cassini, extrait : exemplaire dit
Hauslab-Liechtenstein, Library of Congress, Rodez feuille 16.
Le
travail original des Cassini n'était pas coloré et celle-ci est donc
une version colorisée de ce travail fameux. Il existe d'autres versions
couleurs de cette même carte. La feuille est celle de Rodez, n° 16,
levée entre 1766 et 1768, et publiée vers 1781..
Avec les vignes, le Cruou héberge
des propriétés bâties remarquables :
importantes pour certaines fermes, ou très cossues pour d’autres. La
bourgeoisie de Rodez fréquente la vallée et tient à se montrer. Que ce
soit donc pour l’exploitation des ressources ou pour une villégiature
estivale, le Cruou ne souhaite pas trop connaître un passage intensif.
Et d’ailleurs cette vallée est un bout du monde. La route, c'est à dire
le chemin,
qui y conduit depuis Marcillac ne va pas très loin, vers Cruou haut.
Seuls quelques mauvais chemins étroits permettent ensuite de rejoindre
le causse. Et c’est toute cette vie champêtre que le minerai de fer
veut remettre en cause ?

▲
Atlas paroissial Mgr Bourret, vers 1880, paroisse de Mondalazac.
Archives diocésaines, Rodez
Ferals, le hameau au départ de la
vallée, sur l’extrême limite du
causse est le siège depuis plusieurs décennies de la mine de minerai de
fer. Cette exploitation, la plus importante du causse, appartient
depuis 1892 à Commentry-Fourchambault. La société en place à
Decazeville
active les hauts-fourneaux, ayant repris les actifs et passifs de la
Société nouvelle des houillères et fonderies. Cette dernière, en 1865,
prenait la place de la toute première société, celle du duc Decazes,
née en 1826, et en état de faillite. Commentry-Fourchambault ajoutera
Decazeville à sa raison sociale. Si Commentry va donc être un acteur de
la discorde, la société ne fait que poursuivre ici un projet précédent
qui n’est pas de son initiative, la voie du Cruou étant déjà dans les
classeurs.
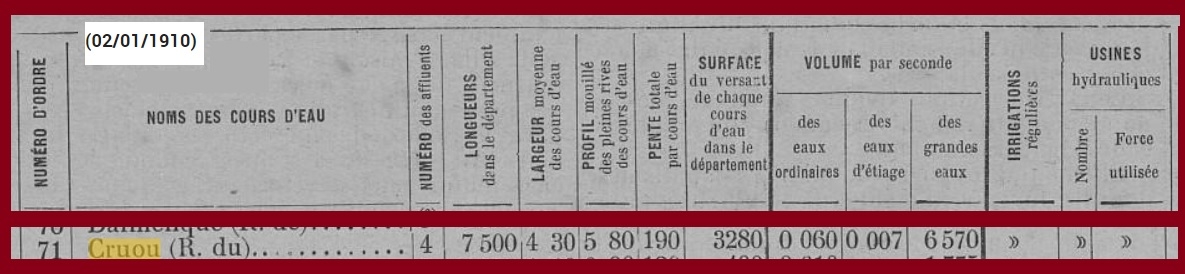
▲le
Cruou modeste ruisseau, mais ses crues peuvent être importantes !
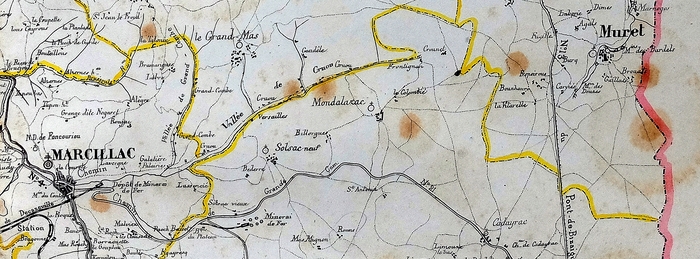
▲Atlas
cantonal, Lacaze Clergue, vers 1860
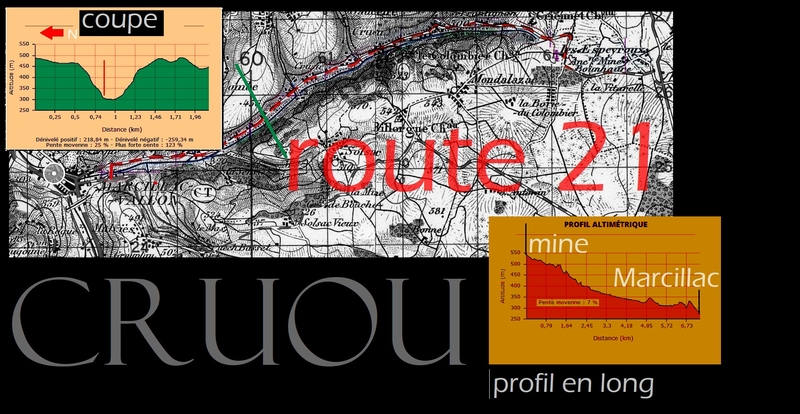
▲
Coupe et profil en long difficiles pour une voie
ferrée, surtout dans la partie haute de la vallée
Pourquoi
une voie ferrée ?
L’analyse de la situation est simple
: le minerai de fer est extrait
sur le causse, à Ferals. Il doit rejoindre, 7 ou 8 km plus loin et 250
m plus bas, la gare minière de Marcillac, avant un départ par voie
ferrée minière vers Decazeville. Cette voie minière privée existe
depuis 1856. C’est celle qui emprunte les deux ouvrages remarquables du
parcours, le Pont Rouge à Marcillac et le fameux pont Malakoff, dans la
vallée de l’Ady. Mais faire descendre 100 à 200 tonnes de minerai
quotidiennement est un exercice très délicat : les chemins du causse ne
permettent que difficilement le passage des charrois, surtout en hiver.
Les conflits sont nombreux entre transporteurs, administration et la
Compagnie. Les besoins de minerai en 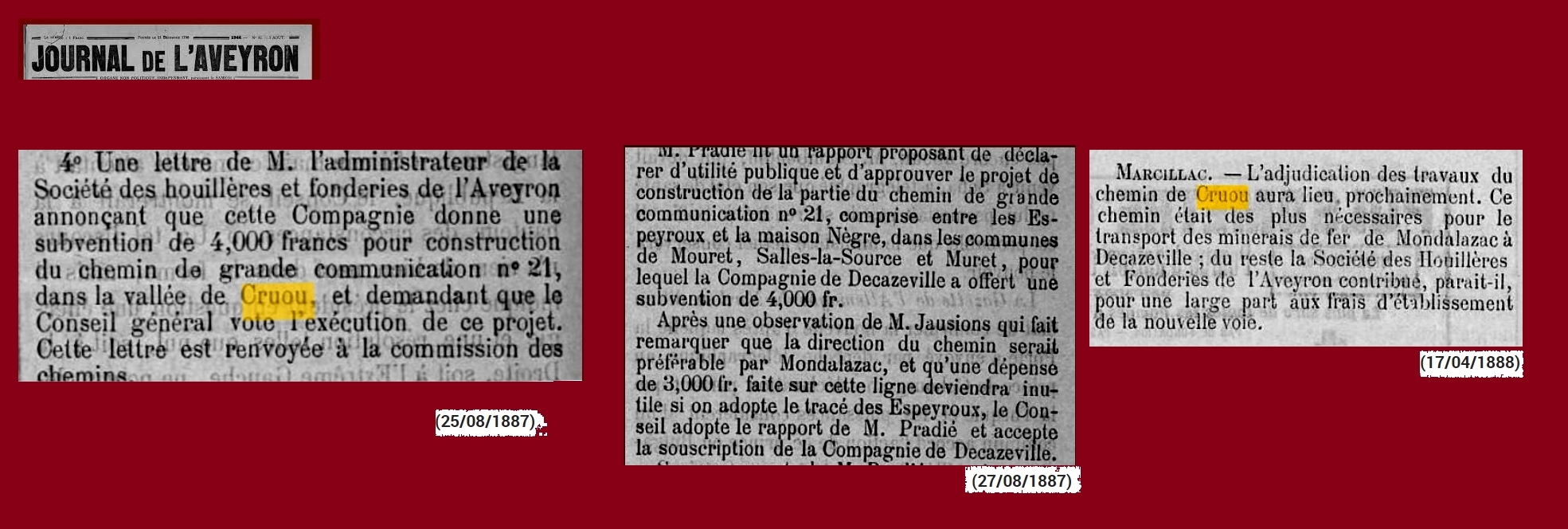 augmentation vers 1890 nécessitent
un tout autre moyen de transport. Et ce moyen ce sera donc une voie
ferrée.
augmentation vers 1890 nécessitent
un tout autre moyen de transport. Et ce moyen ce sera donc une voie
ferrée.
◄ Journal de l’Aveyron
1891, le projet
La vallée existe, tracée presque
pour cela, de Ferals à
Marcillac. Il suffit de viabiliser correctement la partie haute pour
permettre la liaison. Le projet fait donc très naturellement son
apparition en 1891. Mais plusieurs années auparavant, Decazeville avait
insisté pour que la route 21 débouche à Ferals, en 1887 par
exemple. Le Journal de l’Aveyron
s’était fait l’écho de ces demandes.
Mais on notera que nulle voie ferrée n’était alors annoncée… (par
prudence ?)
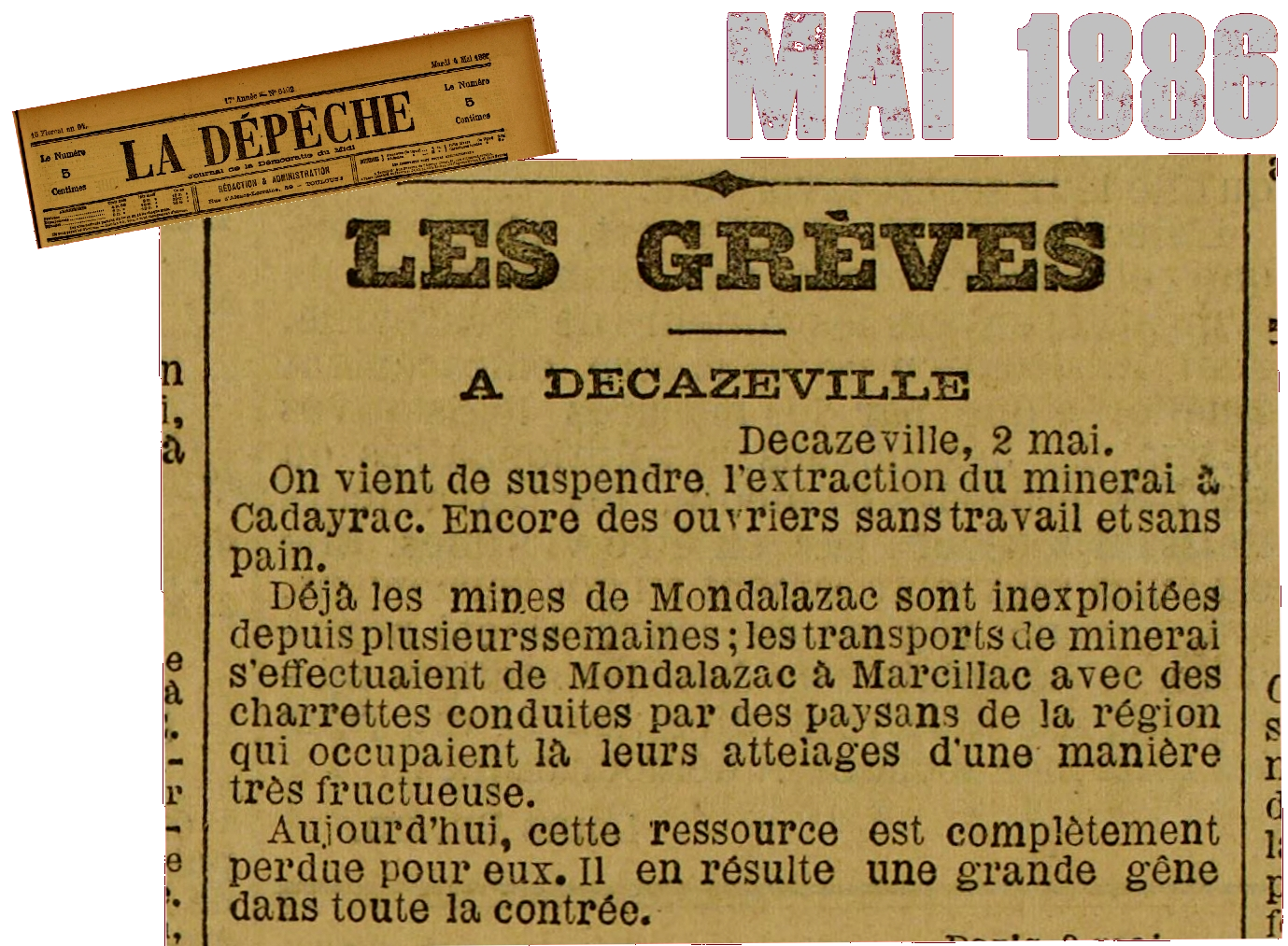
Le 15 juillet 1891 une demande
d’établissement de voie ferrée en
accotement est présentée au préfet par M. Gastambide, administrateur de
la Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron. Six mois plus
tard, le 17 décembre 1891, l’agent-voyer d’arrondissement, Monsieur
Albrespy, présente son rapport, 7 pages, qui sera proposé après visa au
préfet le 18 décembre par l’agent-voyer en chef de Rodez. Son intitulé
mentionne « l’autorisation d’établir sur
l’accotement du chemin de
grande communication N° 21 (embranchement) une petite voie ferrée de
0m,66, pour y faire circuler des wagonnets pour le transport des
minerais de fer… ». M. Gastambide « a fait connaître son intention de
s’entendre avec le service vicinal pour l’exécution des travaux
d’élargissement nécessaires dans les parties du chemin où la largeur
actuelle est insuffisante … ».
Dans son rapport l’agent-voyer
évoque la somme de 2000 francs,
subvention spéciale payée par Decazeville pour l’entretien suite à
dégradations – « ornières profondes » - subvention qui s’ajoute à la
subvention industrielle et qui sont insuffisantes pour un entretien
normal. « En supprimant ce transport par
voitures on rentrerait ainsi
dans les conditions d’un entretien ordinaire ».
Le projet « présente les travaux à
exécuter, sur une longueur de
4.299m,34, pour régulariser le profil longitudinal du chemin et donner
à celui-ci une largeur uniforme de 6 mètres entre fossés ». Après un
rapide bilan financier, favorable « pour le département, l’Etat et les
deux communes de Mouret et Marcillac », le rapport précise « que
l’établissement et l’exploitation dans les conditions indiquées
ci-après de cette petite voie ferrée…ne présentera aucun danger ni
aucun inconvénient pour la circulation ». Suivent les vingt articles
proposés au préfet pour son arrêté.
Le dernier paragraphe du rapport
ajoute enfin la mention suivante : «
nous ne voyons aucun inconvénient à ce que l’autorisation demandée soit
accordée sans attendre l’approbation de ce projet » (par la Compagnie).
En faisant dès 1892 ces travaux, la Compagnie se « libèrerait de la
subvention industrielle de 1890 ». Il faut donc bien comprendre que si
Decazeville a contribué au financement des travaux, ce n’était aussi
que par l’utilisation des subventions industrielles que la Compagnie
devait en tout état de cause verser.
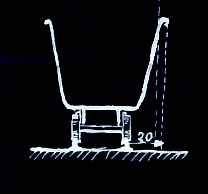 ◄ Wagonnet du
Cruou. Son gabarit est semblable à celui des wagons
miniers qui circulent entre Marcillac et Decazeville.
◄ Wagonnet du
Cruou. Son gabarit est semblable à celui des wagons
miniers qui circulent entre Marcillac et Decazeville.
Un
wagon porte 4800 kg de minerai et 115 tonnes arrivent ainsi
chaque jour à Marcillac.
Plan,
col ANMJ
Sans entrer ici dans trop de
détails, le projet s’étend sur une
longueur de 7.310 m. La voie de 66 cm entre rails, posée à gauche -en
remontant la vallée- du
chemin 21, a son axe distant de 2,62 m de l’axe du chemin. Cette
disposition fait que l’axe du rail extérieur est exactement à 2,975 m
de l’axe du chemin, donc au plus près du bord, avant le fossé. On verra
par la suite les conséquences de cette disposition. « Posée sans
saillie ni dépression, la voie n’altèrera en rien le profil
longitudinal du chemin ». Au droit des portes et autres passages, « les
rails seront compris dans un pavage… ».
▲pavage entre rails au droit des
issues.
Cette disposition, assez logique et utile, sera pourtant source
de difficultés car un réel obstacle à l’écoulement normal des eaux.
Plan, col ANMJ
Pour son exploitation, « le nombre
de wagons composant un train sera de
douze au maximum (paragraphe 10), et tous les wagons, sans exception,
seront munis de freins (paragraphe 13) …Les chevaux seront toujours
dans la voie et au-devant du train, tant à la descente qu’à la montée »
(14). D’autres dispositions règlent le
stationnement et l’éclairage des
trains.
Le rapport de M. Albrespy, motivé et
précis, est donc visé par
l’agent-voyer en chef et transmis au préfet. Et, assez étrangement, il
va être absent de l’actualité pour près d’un an et demi. Il est vrai
que quelques formalités sont nécessaires avant tout travail de terrain
: accord de la Compagnie et transmission aux élus et administration.
Lors de la réunion du Conseil Général d’avril 1893, le conseiller
Pradié du canton de 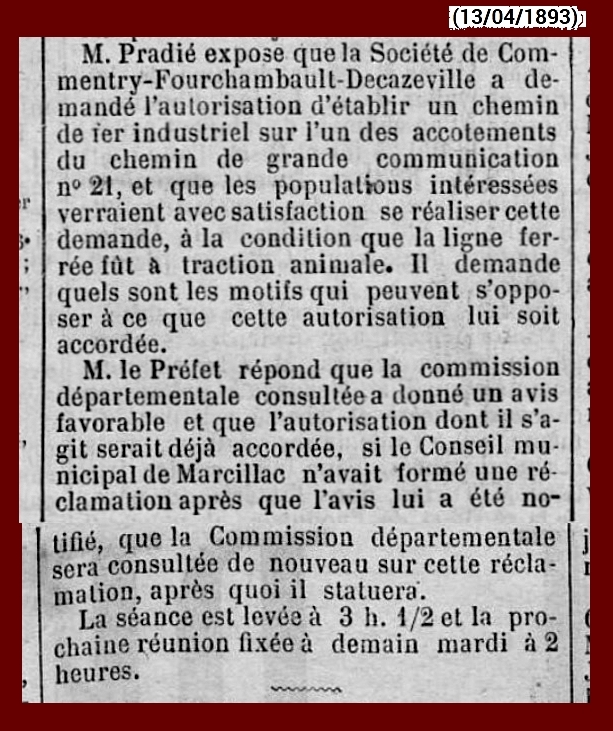 Marcillac – le maire est alors M. Frédéric
Mérican* - interroge le préfet sur cette lenteur qui déclare
attendre les suites d’une réclamation de la commune de Marcillac. Il
est aussi expressément dit que la traction sera animale. Ce point
particulier est important. Un courrier de l’ingénieur en chef des ponts
et chaussées, Arthur Labbaye, avant une visite des travaux, le confirme
à Henry Jaudon, propriétaire au Cruou.
*
Monsieur Mérican est le beau-frère de M. Perrot, agent-comptable de la
compagnie de Decazeville, un détail mentionné par H. Jaudon dans une
note de
travail. Ce détail peut être une explication du soutien (très modéré)
du
maire à la cause des vignerons du Cruou d'où une lenteur
administrative pour ne pas froisser
Commentry…
Dès les semaines suivantes les
travaux sont en cours, ou se
poursuivent. Et jusqu’à présent nulle discorde importante ne vient
contrarier l’avancement du projet.
Le 2 juin 1893 le préfet de
l’Aveyron signe l’arrêté (n° 3983)
autorisant l’établissement de la « petite voie ferrée ». Le texte
précise l’engagement de Commentry de prendre en charge « tous les frais
nécessaires », engagement pris le 30 décembre 1892. La déclaration
d’utilité publique est prononcée, à condition que « la traction n’y
serait faite que par des animaux ». Le cahier des charges compris dans
le texte reprend les dispositions du rapport de 1892, comme
l’obligation de ballast dans l’entre-voie, la durée maximale de
stationnement d’un train sur la voie, une heure, ou l’entretien voie et
fossés à charge de la Compagnie, « à perpétuité », est-il écrit.
Marcillac – le maire est alors M. Frédéric
Mérican* - interroge le préfet sur cette lenteur qui déclare
attendre les suites d’une réclamation de la commune de Marcillac. Il
est aussi expressément dit que la traction sera animale. Ce point
particulier est important. Un courrier de l’ingénieur en chef des ponts
et chaussées, Arthur Labbaye, avant une visite des travaux, le confirme
à Henry Jaudon, propriétaire au Cruou.
*
Monsieur Mérican est le beau-frère de M. Perrot, agent-comptable de la
compagnie de Decazeville, un détail mentionné par H. Jaudon dans une
note de
travail. Ce détail peut être une explication du soutien (très modéré)
du
maire à la cause des vignerons du Cruou d'où une lenteur
administrative pour ne pas froisser
Commentry…
Dès les semaines suivantes les
travaux sont en cours, ou se
poursuivent. Et jusqu’à présent nulle discorde importante ne vient
contrarier l’avancement du projet.
Le 2 juin 1893 le préfet de
l’Aveyron signe l’arrêté (n° 3983)
autorisant l’établissement de la « petite voie ferrée ». Le texte
précise l’engagement de Commentry de prendre en charge « tous les frais
nécessaires », engagement pris le 30 décembre 1892. La déclaration
d’utilité publique est prononcée, à condition que « la traction n’y
serait faite que par des animaux ». Le cahier des charges compris dans
le texte reprend les dispositions du rapport de 1892, comme
l’obligation de ballast dans l’entre-voie, la durée maximale de
stationnement d’un train sur la voie, une heure, ou l’entretien voie et
fossés à charge de la Compagnie, « à perpétuité », est-il écrit.
Modifications, contestations
L’apparition très concrète des rails
dans la vallée va évidemment
permettre à des contestations de se faire jour. Le 25 août 1893
l’agent-voyer inspecteur Delpous propose au préfet une modification de
son arrêté. La commune de Marcillac a demandé le 20 août que sur sa
commune, la voie soit établie sur l’accotement droit, et non gauche, «
afin de permettre aux propriétaires riverains de continuer à adosser
leurs chars aux talus des vignes et de traiter amiablement avec un ou
plusieurs d’entre eux qui font de cette modification la condition
absolue de la cession volontaire de leurs terrains ». La présence de
gros noyers à droite, en surplomb du chemin, peut également être source
de difficultés, mais la proposition n’en fait pas une clause
suspensive. Aucune modification n’est proposée sur les communes de
Mouret et Salles-la-Source.
Le 26 août 1893 l’arrêté 7087
modifie comme demandé les articles 1 et 8
du texte du 2 juin 1893.
L’année 1894 débute mal pour la
tranquille vallée du Cruou. La voie
ferrée pose quelques problèmes aux riverains. Un rapport de quatre
pages de M. Delpous, daté du 3 janvier, fait un constat : ses démarches
pour concilier les points de vue du conseiller général Pradié et de
Commentry n’ont pas réussi. Le conseiller avait écrit au préfet le 7
novembre précédent et la Compagnie répondait le 24 novembre suivant. Le
changement de sens, avec circulation à droite est un danger. La
manœuvre des freins des wagonnets s’avère délicate* et la sûreté des «
freinteurs » (sic) est en cause. Après exposé de
plusieurs motifs il
écrit : « la voie ferrée placée sur la
rive droite du chemin
présenterait pour la circulation plus d’embarras et de dangers que
placée sur la rive gauche » …Le problème n’était pas identifiable
auparavant car les dispositions techniques des wagonnets n’étaient pas
connues. Il propose donc de rapporter les modifications du 26 août et
de revenir au texte initial du 2 juin.
*
Il semble bien que la raison principale de circuler
partout à gauche était un motif d’économie, « pour
ne pas changer les wagons munis de freins fonctionnant à gauche ».
Remarque
portée par H. Jaudon dans une note.
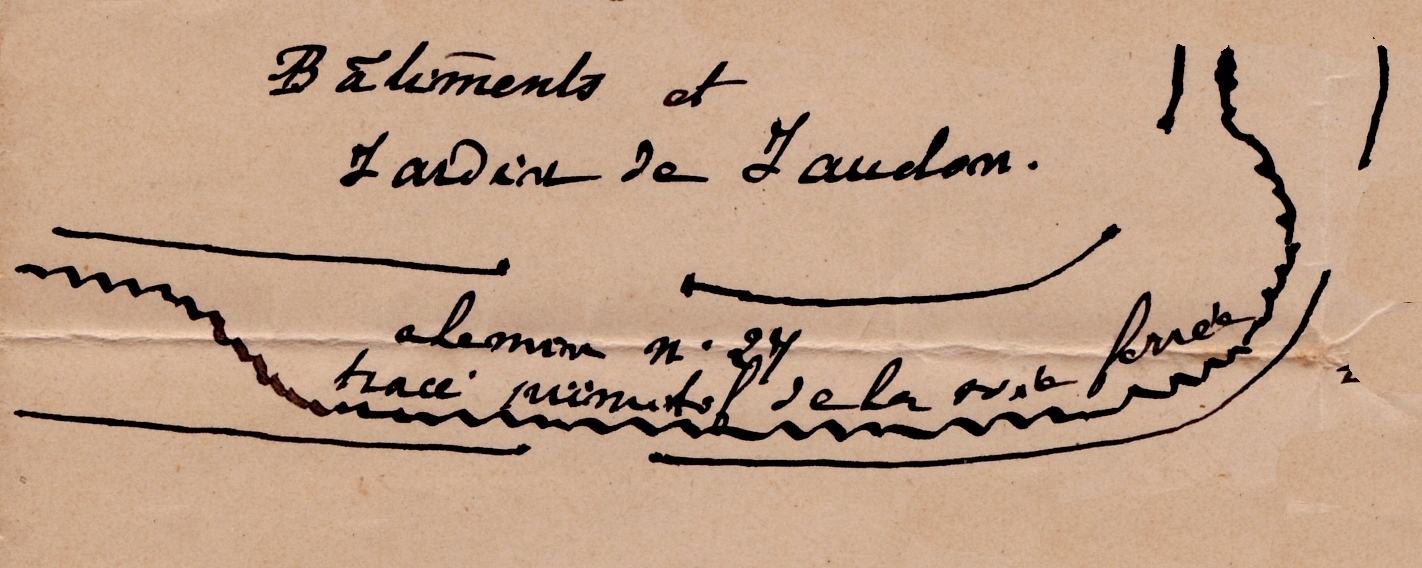
▲
à droite ou à gauche ?
Ces modifications et annulations
successives ont peut-être eu un air de
désordre. Et pour ajouter une difficulté à une autre, pour la première
fois, un tout autre sujet apparaît. « Nous ne discuterons pas non plus
si le passage des convois contre les caves des habitants de la vallée
du Cruou sera une cause de trouble pour le vin qu’elles pourront
contenir et le feront tourner à l’aigre. Cette allégation est étrangère
à nos attributions …Nous ne nous opposons pas cependant à ce qu’en
regard du château de M. Jaudon, la petite voie ferrée soit transportée
sur la rive droite du chemin…puisque dans cette partie, il ne sera pas
nécessaire de manœuvrer les freins. »
Le 6 janvier, reconnaissant le
bienfondé des réclamations de Commentry,
le préfet donne suite en rapportant, arrêté 8018, son arrêté du 26 août
1893. La voie passera -reviendra- donc à gauche ! « Toutefois la
voie ferrée pourra
être transportée sur le coté droit du chemin lorsqu’elle gênera trop
l’accès des habitations riveraines placées sur le coté gauche. En ce
cas des autorisations spéciales seront délivrées à la Compagnie ». Ce
paragraphe de l’arrêté répond évidemment à la demande de M. Jaudon,
mais la généralise éventuellement à d’autres demandeurs. On
notera aussi que Monsieur le préfet, bien évidemment, ne prend
nullement position sur la question du trouble des vins ! La question
n’entre pas officiellement dans ses compétences administratives …
Fin janvier, on ne peut encore
évoquer une discorde, mais les
difficultés se précisent. Le 31 janvier, M. Jaudon reçoit une lettre de
dix propriétaires qui lui proposent de rédiger une pétition contre la
Compagnie, « à transmettre à sa connaissance…
». Ils font état « des
grands préjudices qu’elle occasionne ». Et les détails ne manquent pas
: « en novembre et décembre il a échappé des caisses pleines à quatre
reprises, dont deux…ont déraillé et sont venues se briser devant notre
portail… ». « Le 24 janvier il en est descendu une autre pleine lancée
à toute vitesse qui une seconde de plus tuait le petit Hot, âgé de 7
ans…
Le convoi qui descend quatre fois par jour lourdement chargé de
quatre, six à huit caisses, grande vitesse et sans chevaux ; on prétend
que les conducteurs font cela de par eux-mêmes depuis environ un mois.
Cela donne une telle secousse que les maisons tremblent et dans les
caves on croirait à un tremblement de terre ; de telle sorte que dans
les meilleures caves le vin est tourné et trouble… La route n’est plus
entretenue vu qu’il n’y a plus de cantonnier… ».
La situation semble donc échapper
totalement à la Compagnie. Evoquer
des convois sans chevaux est parfaitement effrayant ! La missive se
termine par les noms des propriétaires, « connaissant votre généreuse
bonté, nous venons à vous en toute confiance… ».
Pour résumer : il y a danger, le vin
tourne, les accidents nombreux et
l’entretien est inexistant !
On aura compris que dorénavant les
motifs
de discorde et d’opposition sont parfaitement établis. Il y a en sus
des roues de char cassées dans la voie, mais aussi des situations plus
graves.
« Un wagon a échappé chargé de
débris de terre et de pierres d’environ
un kilomètre à grande vitesse… (17 septembre 1893)
Un autre wagon chargé de charbon a
échappé à la gare le 9 décembre…est
venu se briser sur le portail…a manqué à tuer mes bestiaux, moi et ma
famille, venant de la foire de Marcillac
Le 24 janvier 1894…trois
échappements...
Le 29 décembre 1893 un porc a engagé
une jambe dans le rail et la cassé
(la bête a due être égorgée sur place)
Ma maison se trouve la plus
rapprochée de la voie et que cest hiver je
suis été malade, qu’il a été reconnu que ma maladie s’est prolongée par
suite du grand bruit vu que je tremble fort dans mon lit quand le
convoi passe.
Un grand préjudice pour rentrer ou
sortir mes fourrages. Un char est
obligé de se placer sur la voie et quand le convoi passe il est obligé
de se retirer à moitié chargé…
Echappement de trois wagonnets à 2
reprises chargés partant de la
carrière à Frontignan sur le parcours de 1 kilomètre se sont déraillé…
».
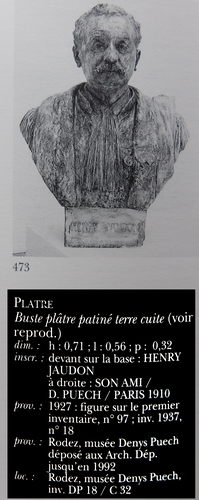
Dès ses débuts d’exploitation, la
voie ferrée du Cruou va donc créer
beaucoup de difficultés pour les riverains et bien évidemment pour
Commentry. Le choix des plaignants de faire appel à Henry Jaudon est
assez naturel : propriétaire dans la vallée, il connaît parfaitement ce
pays. Ses compétences juridiques en font, de plus, un parfait
faire-valoir auprès de Commentry.
◄
Henry
Jaudon, Buste
par Denys Puech
In
Denys PUECH, 1854-1942, Musée Denys Puech, Rodez, 1993
Monsieur
Jaudon va répondre à la
demande et son implication sera forte !
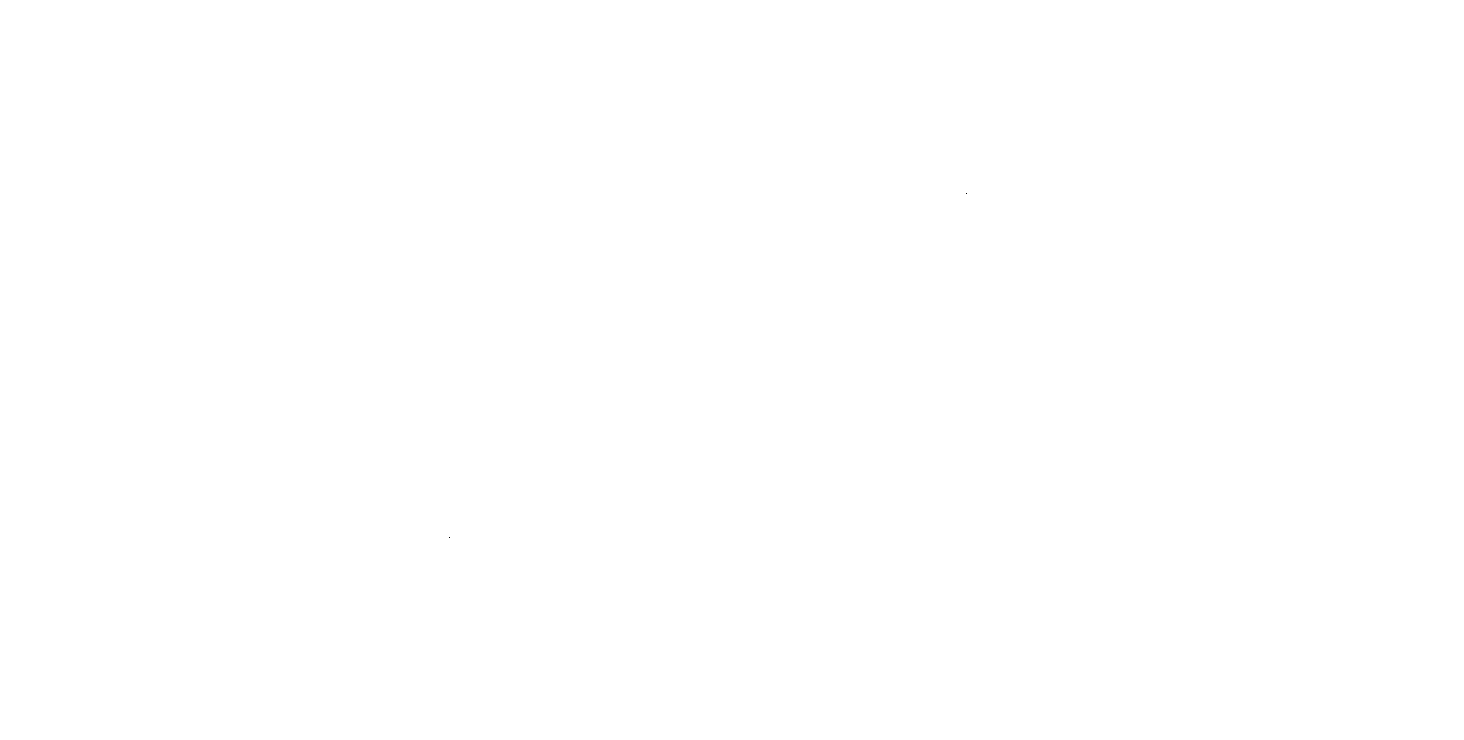 Henry Jaudon n’est pas inconnu sur
la Route du fer.
Henry Jaudon n’est pas inconnu sur
la Route du fer.
Le 16 septembre
1897, alors conseiller général du canton de Marcillac, il est l’un des
invités d’Elie Cabrol pour la pose de la plaque de fonte sur le viaduc
qui devait abandonner son nom de Malakoff pour François Cabrol. Il a,
comme les autres présents, signé le parchemin .

Nous n’allons pas ici reprendre le parcours de ce brillant avocat. On
pourra par exemple retrouver* son itinéraire jusqu’à la Cour de
cassation où il est nommé conseiller en 1914 dans cette
biographie. Entré dans la magistrature en février 1880, il a
alors 27 ans, il est en 1892 avocat général à la Cour d’appel de
Toulouse. En 1901, à 48 ans, il sera procureur de la République,
toujours à Toulouse, jusqu’en 1908.
Lorsque les propriétaires du Cruou
se tournent vers lui, ils font
donc appel à un magistrat expérimenté et reconnu. Pendant une dizaine
d’années, Henry Jaudon sera un adversaire redouté pour Commentry. Il va
considérablement argumenter sur des points très divers pour faire
aboutir ses demandes, touchant autant à la compétence du préfet qu’à la
conservation et le murissement des vins. Une rue de Rodez porte son nom.
*
www.courdecassation.fr/institution_1/occasion_audiences_59/debut_annee_60/discours_prononces_10745.html
▼
Henry Jaudon, col. ANJM - (24 septembre 1894)
Le groupe
pose. Les rails prouvent que nous sommes bien en vallée du
Cruou.
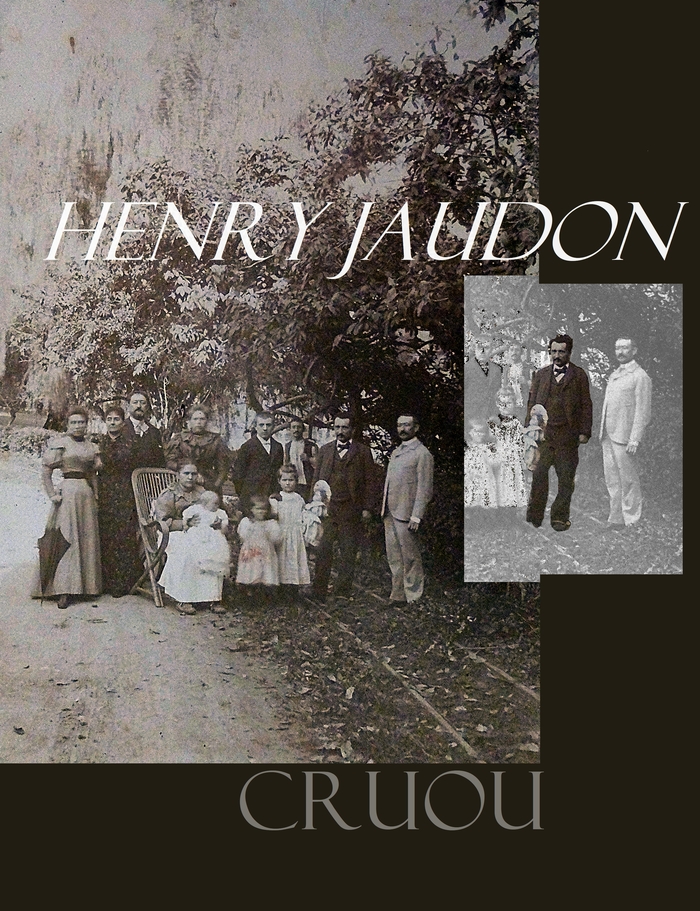
Le
temps de la discorde
Quelques mois, août 1893- janvier
1894, auront donc prouvé aux
propriétaires du Cruou que le progrès peut ne pas en être un. Les
sceptiques doivent en être convaincus en se garant pour laisser dévaler
les convois chargés... Si les arguments de la Compagnie, relayés par
l’administration, ne peuvent que difficilement être contestés, et ils
ne le furent pas*, l’exécution du projet laisse apparaître pour le
moins de nombreux dysfonctionnements.
*Nous
n’avons pas trouvé mention d’oppositions
-nombreuses- préalables à l’établissement de la voie, contrairement à
ce que précise
H.
Jaudon dans plusieurs de ses notes…Le cas échéant, elles se sont donc
manifestées
discrètement…
Ces approximations dans la
conduite des trains sont assez curieuses, car la Compagnie n’est pas
particulièrement novice en la matière. Elle exploite des centaines de
kilomètres de voie minière à Decazeville, sur ses sites miniers. Depuis
1856 des trains de wagons relient Marcillac à Decazeville et nous
n’avons que rarement trouvé l’écho d’une circulation aussi calamiteuse
que celle du Cruou. L’éloignement de la mine de fer du causse des
bureaux de la Compagnie est peut-être un élément d’explication, plus
que la pente ? Loin des yeux, et donc des sanctions, on se laisse aller
à certaines facilités, malgré le handicap de la pente, au risque on l’a
vu de connaître des déraillements bien trop fréquents. Nul ne
pouvait penser qu’il serait donc vraiment très dangereux pour quiconque
de s’aventurer vallée du Cruou en 1894 ! Le risque de très mauvaise
rencontre est bien réel. On peut aussi en déduire que cet embranchement
de la Route du fer par la route 21 porte en lui, dès ses débuts, les
raisons de sa suppression. Une autre page s’écrira en 1910 avec le
transporteur aérien, un réel progrès celui-ci. Mais n’anticipons pas !
Le temps est venu de plaider puisque toute conciliation semble bien
écartée.
Acte
1 : Conseil de Préfecture
Aujourd’hui
disparue, et lointain ancêtre des tribunaux
administratifs, cette juridiction était compétente pour les litiges
touchant
aux travaux publics. Mais Henry Jaudon fera ici erreur : la voie
n’est en
rien publique. Ce n’est donc pas ici un tramway.
L’avocat général Jaudon va préciser
son argumentation tout au long de
l’année 1894. Le 21 février 1895 il dépose un mémoire au greffe du
Conseil de Préfecture à effet de condamner la Société Commentry «
par suite des dommages causés à sa propriété par l’établissement d’une
voie ferrée sur l’accotement gauche du chemin n° 21 ». Dans son
mémoire, l’exposant fait état des trépidations et ébranlements causés
par les convois, qui provoquent des dommages aux meubles et font
tourner le vin dans les caves. L’exhaussement du profil en long est
aussi contraire au cahier des charges, comme la distance de 0,30 m
entre la paroi du wagon et l’extrémité de la plateforme (1,10 m est
règlementaire). Sont aussi en cause le nombre des trains, leur longueur
et la fréquence des arrêts devant la propriété. Il évoque les accidents
et déraillements, à la descente ou la montée des trains, les saillies
des rails et fait part des témoignages reçus. « Une dernière cause de
dommages est la diminution de jouissance ou d’agrément occasionnée par
la voie ferrée et le passage des convois. Les vignobles de la vallée du
Cruou ont toujours été et depuis l’invasion phylloxérique sont
exclusivement devenus des propriétés de pur agrément ». Il demande une
indemnité de 10000 francs ou à fixer par expert.
Le Conseil de Préfecture va statuer
sur le mémoire dans ses séances du
31 juillet et 3 août 1895. M. Jaudon a été entendu, ainsi que M. Alaux
avocat de Commentry. La société avait déposé le 11 mars un mémoire en
réponse. Le Conseil constate « que le chemin de fer dont il
s’agit…est
non un tramway mais un chemin de fer industriel…construit en
prolongement du chemin de fer industriel à traction par vapeur
s’arrêtant à Marcillac ». Constatant que les lois attribuent
dans ce
cas aux tribunaux civils la compétence pour leurs dommages, il « se
déclare incompétent et renvoie M. Jaudon Henri à se pourvoir devant qui
de droit ». M. Jaudon avait développé la thèse
du tramway. Des dizaines
de pages, brouillons et copies de textes, documents présents dans les
archives, montrent le travail précis, méticuleux de M. Jaudon. Chaque
argument est accompagné de nombreuses notes juridiques. Cette première
phase juridique se solde donc par un échec des plaignants. Mais aucun
jugement n’a été porté.
Acte
2 : tribunal civil de Villefranche
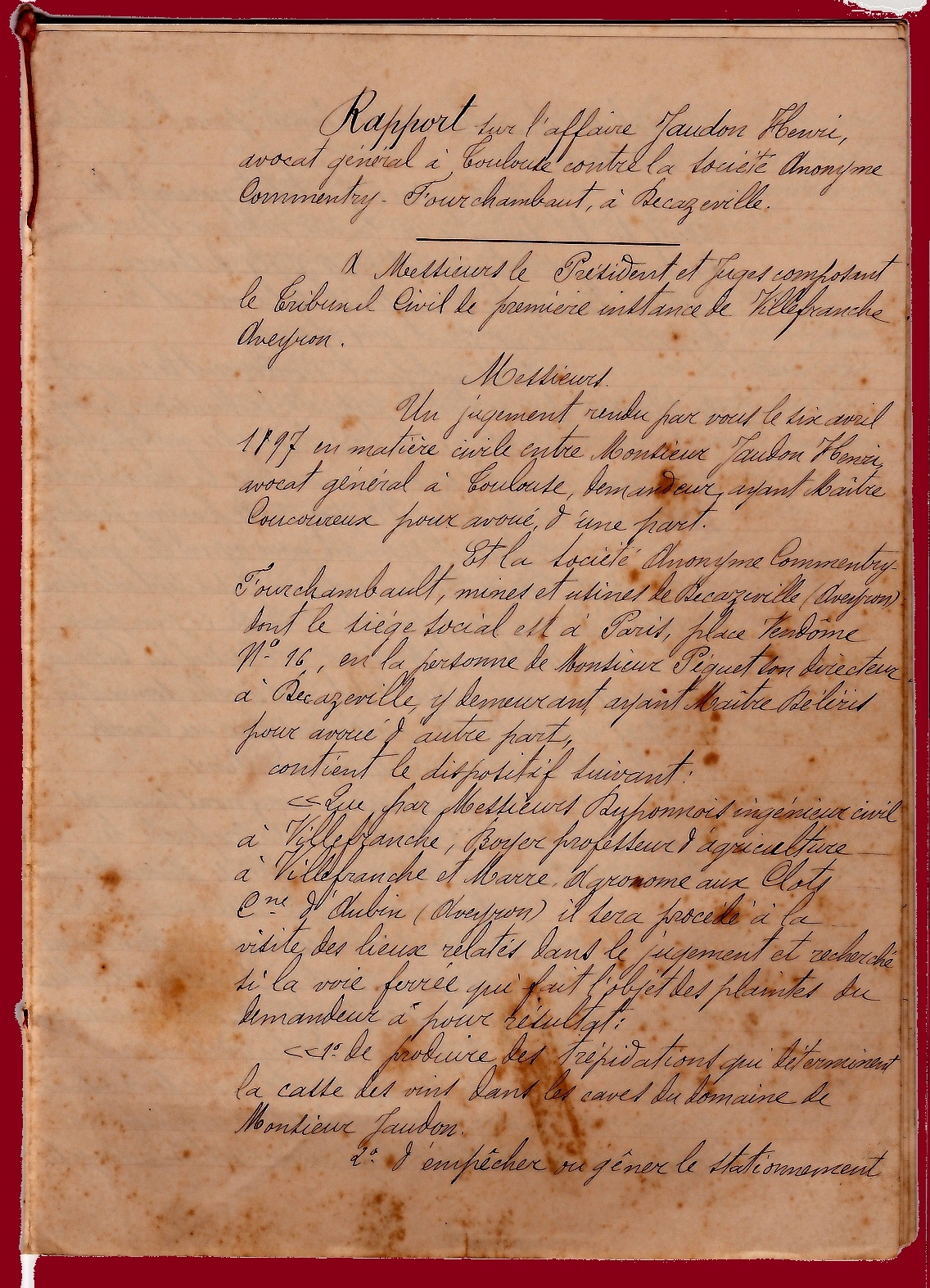 Un an plus tard, en août 1896, après
avoir admis
l’incompétence du
Conseil, confirmée par un de ses amis, Henry Jaudon s’adresse au
Président du tribunal civil de Villefranche. M. Coucoureux, son avoué,
dépose sa requête datée du 30 septembre 1896. Le dossier a désormais
une vie propre sous le numéro 6926.
La demande reprend les griefs
exposés devant le Conseil de
Préfecture : dommages causés par les passages et trépidations, dommages
aux récoltes, difficultés d’accès aux propriétés, exhaussement abusif
du chemin, circulation des eaux, implantation trop proche des limites,
accidents divers, position des rails et enfin « incommodité énorme ».
Tout est dit en trois pages de
requête. H. Jaudon constate également
l’absence de conciliation, mentionne l’urgence, et demande au tribunal
une condamnation à 20.000 francs de dommages intérêts.
Le tribunal juge l’affaire le 6 juin
1897. Après exposé des attendus
qui reprennent les remarques du plaignant, il demande une expertise
pour vérifier « l’existence du préjudice » et
fixer « l’indemnité qui
peut être due ». Trois experts interviennent, un
ingénieur, un
professeur d’agriculture et un agronome. Le rapport de ces experts, 36
pages, est enregistré à Villefranche le 12 janvier 1898.
Un an plus tard, en août 1896, après
avoir admis
l’incompétence du
Conseil, confirmée par un de ses amis, Henry Jaudon s’adresse au
Président du tribunal civil de Villefranche. M. Coucoureux, son avoué,
dépose sa requête datée du 30 septembre 1896. Le dossier a désormais
une vie propre sous le numéro 6926.
La demande reprend les griefs
exposés devant le Conseil de
Préfecture : dommages causés par les passages et trépidations, dommages
aux récoltes, difficultés d’accès aux propriétés, exhaussement abusif
du chemin, circulation des eaux, implantation trop proche des limites,
accidents divers, position des rails et enfin « incommodité énorme ».
Tout est dit en trois pages de
requête. H. Jaudon constate également
l’absence de conciliation, mentionne l’urgence, et demande au tribunal
une condamnation à 20.000 francs de dommages intérêts.
Le tribunal juge l’affaire le 6 juin
1897. Après exposé des attendus
qui reprennent les remarques du plaignant, il demande une expertise
pour vérifier « l’existence du préjudice » et
fixer « l’indemnité qui
peut être due ». Trois experts interviennent, un
ingénieur, un
professeur d’agriculture et un agronome. Le rapport de ces experts, 36
pages, est enregistré à Villefranche le 12 janvier 1898.
1897,
11 août. Un huissier, à la demande de la société Commentry, se
présente au domicile toulousain de M. Jaudon. Il mentionne le jugement
interlocutoire du 6 avril 1897 rendu par le tribunal de Villefranche,
signifié aux requérants (Commentry) le 18 juin 1897. Convaincus que les
demandes de M. Jaudon étaient sans fondements les administrateurs de
Decazeville n’ont pas fait appel. Mais ils tiennent par huissier à
notifier à M. Jaudon qu’ils pourront, s’ils le jugent utile, relever
appel du dit jugement. En effet, à la suite de ce jugement, les
expertises du Cruou avaient donné à M. Jaudon la possibilité
d’insinuer que le jugement était définitif, ce que conteste Commentry.
Rapport
d’experts, 1897-1898
Rechercher si la voie ferrée a pour
résultat :
- de produire des trépidations qui
déterminent la casse des vins
- d’empêcher ou de gêner le
stationnement normal des charrettes
- de gêner l’utilité normale des
issues et vérifier la distance entre
le matériel de la voie et la
propriété privée
- de modifier l’écoulement des eaux
-de créer sur le chemin des
modifications de niveau gênantes ou
dangereuses
Le jugement est signifié aux experts
le 17 juin ; ceux-ci seront sur
place au Cruou les 3 juillet (audition des témoins), 17 juillet (sans
avertir), 14 octobre et 4 novembre.
Lors de leur première visite, ils
entendent 9 témoins (un seul propriétaire ne s'était pas
associé à l'opposition générale) cités par M.
Jaudon. Ces propriétaires relatent les trépidations, les dangers
pour les animaux, les brisures de roues de char, les difficultés pour
le déchargement du fourrage, le danger pour les enfants, la
conservation du vin impossible depuis 4 ans, - « avant 1893 le vin se
conservait bien » -, les wagons chargés détachés des
convois et les
déraillements, la gêne dans la conduite des fermes, l’écrasement d’un
pied de mouton par un wagon… L’ensemble de ces témoignages figure dans
le rapport.
Ce 3 juillet, les experts ont pu
également assister à un déraillement,
évidemment non programmé (!), devant la propriété de M. Jaudon ! Dans
une
note ultérieure celui-ci pointera en conséquence « les dangers, qui
sont tels que les enfants de M. Jaudon (10 ans-6 ans-4 ans) ne
peuvent plus aller du jardin à la prairie sans être accompagnés et
qu’il faut tenir la porte du jardin constamment fermée… ».
Les experts définissent ensuite deux
maladies du vin, la casse et la
tourne, et concluent pour le Cruou à la présence de la maladie de la
tourne. « Nous pouvons donc affirmer en
toute certitude que les
trépidations, quelle que soit leur violence, fussent-elles
équivalentes, comme intensité, à une agitation énergique de la
futaille, ne sauraient en aucune façon déterminer (souligné dans le
rapport) dans un vin la maladie de la
tourne… ». L’origine de la
maladie ne peut en effet se trouver dans les trépidations. Mais
celles-ci peuvent-elle l’aggraver ?
Pour vérifier si les trépidations
peuvent favoriser le développement de
la maladie, des expériences sont menées. A la distance de 42 m pour la
cave de M. Jaudon, les trépidations sont insensibles. « Il n’est pas
permis d’attribuer aux trépidations l’influence fâcheuse que leur prête
le demandeur ».
Pour éliminer toute incertitude, il
y a prise d’échantillons de vin
malade, et les deux échantillons de M. Jaudon sont analysés à Bordeaux.
Tous les spécialistes confirment que le ferment de la maladie ne peut
être dû aux trépidations. Il doit préexister.
Les trépidations ne sont donc en
rien responsables. Le phylloxéra
présent en 1893, comme la nature des nouveaux plans peuvent expliquer
la mauvaise tenue des vins. La déposition d’un témoin dont le vin
tourne et dont la cave est à 100 m de la voie montre d’ailleurs bien
que les trépidations ne sont en rien responsables de la maladie. Une
bonne pratique des vignerons serait nécessaire pour contrer la maladie,
précise le rapport…
Le second point est abordé. Il
concerne la gêne aux charrettes. Il y a
chaque jour quatre convois pleins descendant et quatre convois vides.
Les charrettes doivent stationner à droite et cela occasionne un
surplus de transport et de temps pour rejoindre les vignes à gauche du
chemin. Un très laborieux et minutieux calcul conduit l’expert à
chiffrer le dommage à 54 f.
Le troisième sujet concerne le
blocage des issues de la propriété de M.
Jaudon.
Les deux issues de M. Jaudon sont
distantes de 30 m. Les convois sont
formés de six wagons , pour une longueur de 18 m, plus les 12 m
d’espace occupé par la file des quatre chevaux, soit 30 m au total. Les
issues sont donc fermées au passage du convoi pour 20 secondes ou ½
minute au maximum. « L’inconvénient* serait encore plus
grand si au lieu
des huit convois journaliers le chemin du Cruou à Marcillac était
encombré à chaque instant du jour, par les tombereaux nécessaires au
transport du minerai de Montdalazac. Les quatre convois descendants,
soit 24 wagons, transportent en effet à raison de 4800 kg par wagon 116
tonnes de minerai par jour. En supposant qu’on puisse transporter 3500
kg de minerai par tombereau, ce tonnage correspondrait à 33 tombereaux
descendant chargés et 33 tombereaux remontant vides qui passeraient
chaque jour devant les issues…La gêne est moins grande avec les 8
convois qu’avec les 66 tombereaux passant presque constamment et à
toute heure… »
*
Il est curieux et amusant de voir l'expert proposer un argument tout à
fait virtuel, aucun tombereau n'était passé par la vallée et cela
n'était en rien envisagé par la Compagnie. L'argument de mauvaise foi
sera évidemment pointé et rejeté par H. Jaudon devant le tribunal...
La question de l’emplacement de la
voie, trop proche pour M. Jaudon de
sa propriété est ensuite discutée. Un plan est dressé avec mention des
distances du rail extérieur à la propriété. Comme le wagon surplombe la
voie de 0,20 m, il faut aussi diminuer d’autant les valeurs. «
L’intervalle libre de 1,10 m -art. 30 de la loi du 17 juin 1880- n’a
été observé sur aucun des points de la voie ferrée faisant face à la
propriété Jaudon…La société de Decazeville soutient qu’elle s’est
conformée à l’article deux de l’arrêté préfectoral du 2 juin 1893 »
prescrivant une distance de l’axe du chemin de fer à 2,62 m de l’axe du
chemin 21.
Les experts constatent enfin qu’un
noyer a subi des frottements, il
sera abattu, et un mur est éraillé. Pour cela l’expert estime les frais
à 6 fr pour manque de récolte de noix et 3 fr pour remise en état du
mur.
Le point 4 concerne les
modifications à l’écoulement des eaux.
La voie n’est pas ballastée comme
prescrit. Les eaux entraînent entre
les rails, dans la gorge créée par le piétinement des chevaux, les
terres ravinées qui sont ensuite bloquées par le pavage au droit de
l’issue et la boue pénètre alors dans la propriété…
Une solution serait la mise en place
d’une buse par la compagnie et un
curage des boues apportées aux frais de la compagnie.
Dernier point du rapport, la
sécurité des personnes. L’entre rail est
effectivement profond, non ballasté et constitue une gêne. La compagnie
le reconnaît et propose d’indemniser les dégâts éventuels comme brisure
d’essieu ou de roues…
Pour les personnes, le danger est
moindre, mentionne le rapport, avec
la voie ferrée : le nombre de passages plus faible comparé à celui de
tombereaux éventuels diminue ce risque. Mais pour autant il faut être «
vigilant avec les enfants… ». Pour la question de la poussière, le
rapport précise qu’avec la voie ferrée il y a moins de passage de
chevaux qu’avec des tombereaux, donc moins de poussières…
Les
conclusions des experts seront les suivantes :
pas
d’indemnité pour le premier chef de réclamation, la tourne du vin
étant due à d’autres causes que la voie
pour
la gêne, 54 fr pour les quatre années 1894 à 1897
100
fr pour le noyer et la perte de récolte, 3fr pour le mur, 5 fr pour
le manque de foin
Le
total se chiffre à 162 fr.
Les
experts étaient M. Duponnois, ingénieur civil des mines à
Villefranche, M. Boyer, ingénieur agronome, professeur d’agriculture à
Villefranche et M. Marre, agronome, propriétaire agriculteur aux Clots
(commune d’Aubin).
Nous sommes évidemment bien loin des
demandes de M. Jaudon. Elles se
montaient à 20.000 francs ! Le montant en était doublé depuis la
première demande en dommages au Conseil de préfecture.
Ce rapport permet à Commentry de
déposer ses « conclusions sur rapport
d’experts ». Sans surprise, en huit pages, la
société demande au
tribunal de « rejeter toutes les demandes de
l’adversaire ».
Les conclusions de M. Jaudon donnent
lieu à un rapport imprimé de 8
pages. Elles vont évidemment dans une toute autre direction. Le
plaignant confirme l’influence des trépidations sur la tourne du vin,
et réfute les expériences mal conduites des experts. Selon lui les
experts n’ont pas connaissance des pratiques locales en matière de
vigne. Il conteste les chiffres relatifs à la gêne et produit les
siens. Concernant l’évocation de tombereaux, qui seraient plus
dommageables, M. Jaudon remarque qu’il ne serait absolument pas
possible de les voir circuler dans la vallée , la pente ne le
permettant pas, ce qui rend illégitime toute comparaison et appel à cet
argument. Les arguments déjà présentés sont tous repris et justifiés
par de nombreuses références juridiques. Un important travail a
été fait par M. Jaudon pour appuyer ses dires, travail visiblement
beaucoup plus fouillé que celui de Commentry. Il précise dans une note
une date de photographie, le 24 septembre 1894 : sur ce cliché la
voie de la compagnie était posée à droite, situation qui dura 18 mois,
de juin 1893 à décembre 1894. Cette photographie est, sauf erreur,
celle présentant le groupe : la courbure de la voie, l’éclairement,
l’absence du haut mur côté gauche bien visible sur les autres
photographies, peuvent confirmer notre analyse. Cette date permet donc
de conclure également à une date postérieure* pour les autres clichés,
la voie étant alors reportée à gauche du chemin.
*
probablement 1898 d'après A.M. Jaudon-Merino
▼▼Plan
des experts, et extrait, col ANJM
Plan
au 1/1000 réalisé en 1897 pour le travail d’expertise : on
constatera que sur ce plan la voie est (définitivement) revenue sur
l’accotement gauche du chemin. Les chiffres sont relatifs à la distance
rail extérieur propriété.
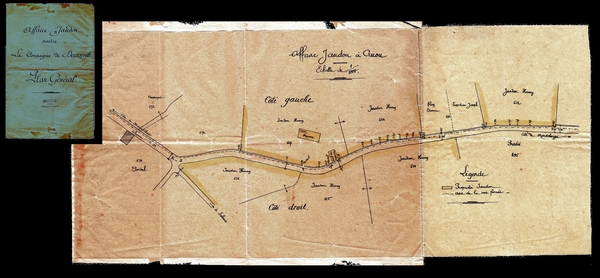
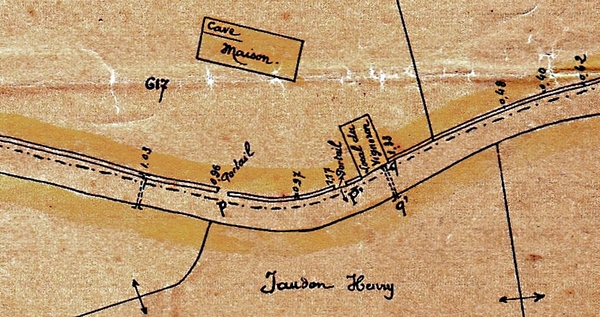
▼
Rapport d’experts, plan de détails, 1897, col ANJM
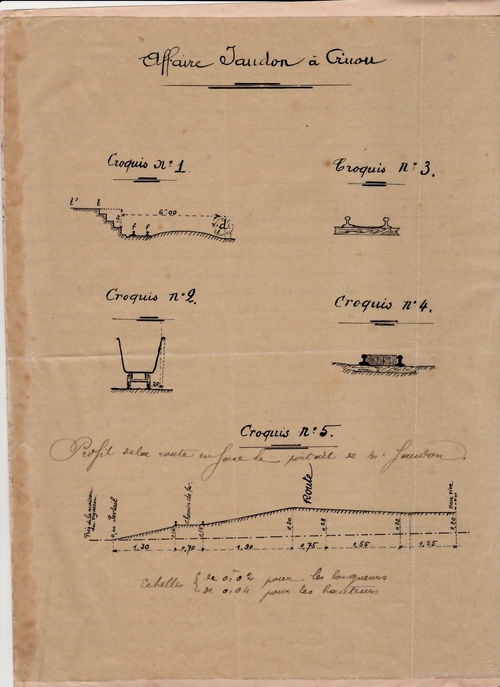
Le croquis 1 montre une charrette
(d) stationnée à droite et la
difficulté de chargement ou de déchargement sur le talus gauche. Le
dessin 3 présente la voie, manifestement en saillie. Le pavage du
dessin 4, présent au droit des entrées, sera un réel obstacle à
l’écoulement des eaux. Le profil en travers du dessin 5 situe bien la
cour, en contre-bas du chemin et de la voie. L’échelle verticale est
double de son homologue horizontale.
Déposé le 12 janvier 1898, ce
rapport est donc un élément essentiel.
L’affaire sera appelée et plaidée à Villefranche aux audiences des 29
décembre 1898 et 5 janvier 1899. Henry Jaudon plaide lui-même sa propre
cause. L’avocat général était évidemment tout désigné pour cela ! La
société Commentry est défendue par Me Dubruel. Sur la première
question, la tourne des vins causée par les trépidations, le tribunal
constate avec les experts, l’absence de trépidations et rejette de ce
fait toute demande de dommages. La tourne trouve pour les juges son
origine « dans des vignes épuisées par le
phylloxéra…ou un nouvel état
du vignoble qui remonte à une époque contemporaine de la pose de la
voie… ». Un élément important du dossier est
donc rejeté.
La gêne pour l’exploitation,
par suite de la voie présente coté
gauche est retenue et « il y a lieu d’homologuer les
dires du rapport
d’expert » à ce sujet.
Le troisième point, l’obstruction
des issues de la propriété est bien
réelle, et la distance de 1,10 m ici réduite à 23 ou 27 cm empêche
effectivement un usage normal de ces issues. A la question suivante,
l’obstruction à la circulation des eaux, les juges pensent « que
Monsieur Jaudon ne saurait être assujetti à implorer à chaque orage,
nombreux parait-il au vallon de Marcillac, la bienveillance de la
compagnie » pour demander le passage d’un
cantonnier aux frais de
Commentry venant retirer de sa cour les boues.
Les juges estiment enfin que si le
risque d’accidents est avéré, il ne
saurait être indemnisé avant qu’il ne se produise, et refusent donc de
ce fait toute indemnité. La poussière soulevée par les chevaux ne leur
parait pas non plus devoir être prise en compte pour une perte
d’agrément.
La
décision finale est la suivante :
« …Par ces motifs, le
Tribunal…vidant son jugement interlocutoire du six avril mil huit cent
quatre-vingt-dix-sept…condamne la Compagnie Commentry-Fourchambault à
payer à Monsieur Jaudon, à titre de dommages :
La somme de cinquante-quatre francs pour gêne…
La somme de cent trois francs pour le noyer et les
dommages au mur…
Quinze francs par an « tant pour le passé que pour
l’avenir » … pour l’utilité normale des issues…
Dix francs par an dans les mêmes conditions pour les
boues…
Un franc vingt-cinq centimes annuellement, dommage
causé au pré, pour les quatre ans, soit cinq francs… ».
Le jugement é été enregistré à
Villefranche le 30 janvier 1899.
Sauf erreur, le montant total des
indemnités accordées par le tribunal
s’élève à 187 francs. Aucune comparaison n’est donc possible avec les
20.000 fr évoqués en début de procédure. On peut d’ailleurs à ce sujet
penser que l’avocat général savait très bien que le montant demandé
était très surestimé…
Les dépens, à la charge de
Commentry, se montent à 404,10 fr pour
l’expert Marre, 430,00 fr pour Boyer et 409,25 fr pour Duponnois, soit
un total de 1243,35 fr. Il n’est pas interdit de rapprocher la longueur
de la procédure, les énergies mobilisées, en Aveyron et ailleurs, le
travail d’analyse et de rédaction, le montant des dépens au montant des
indemnités accordées au plaignant…
▼Jugement,
1899, col. ANJM
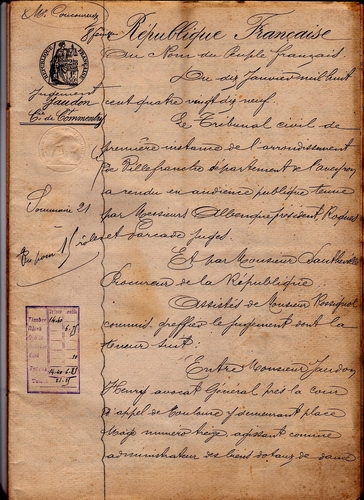
Avant le prononcé du jugement, Henry
Jaudon n’était pas resté inactif.
Il sollicite un huissier, en juillet 1898, pour constater la réalité
des trépidations. Il avance comme motivation le fait que la compagnie,
prévenue du passage des experts, avait volontairement fait ralentir les
convois. L’huissier et plusieurs autres témoins vont donc, les 20 et 21
mai, cachés pendant le
passage des convois descendants, constater très
distinctement les trépidations causées aux murs et meubles du premier
étage. « Lorsque les wagons passaient
vides, les mêmes phénomènes se
produisaient mais avec moins de force… ». Le constat est facturé 7,25
fr à M. Jaudon. En cours d’année, M. Jaudon demande également
communication du détail des sommes payées par Commentry au titre de
l’entretien des chemins. Ces chiffres devaient avoir une certaine
importance car l’agent-voyer en chef attendra l’autorisation du préfet
pour les communiquer, le 3 janvier 1899.
Cette lettre, adressée au Conseiller
Général de l’Aveyron, Avocat
Général à Toulouse, fait le point sur les subventions
industrielles
demandées à Commentry.
▼
tableau des subventions dues au titre des détériorations des chemins
Le total des subventions en francs « demandées et payées » précise la
lettre est de 14433,5 fr. Pour l’année 1892, il est dit que « la
Compagnie, pour l’acquit de la subvention applicable exécuta des
travaux d’élargissement dans la vallée du Cruou, pour une somme assez
considérable* et enleva des dépôts de graviers très importants amenés
sur le chemin par l’orage du 19 juillet 1891 d’une violence
exceptionnelle... L’emploi a eu lieu sur la ligne principale », le
chemin 27 , ancien chemin 21.
Henry Jaudon écrira en marge : « aucun transport n’a donc eu lieu
par
la vallée du Cruou ». Il constate aussi que « la Cie, depuis
l’établissement de la voie ferrée a augmenté dans des proportions
énormes le minerai transporté ».
*
non indiquée...
Dans une note particulière, Note complémentaire dans l’affaire
Jaudon-Decazeville, Henry Jaudon reprend quelques points
de l’affaire :
« Avec la voie ferrée, sans payer aucun charretier ni aucune indemnité
au Département et en supposant qu’elle se contente de 4 convois par
jour, elle transporte 72.000 X 4 = 288.000 k par jour ou 288 X
300 =86.400 c.a.d. 86 mille tonnes par an !! C’est là le secret de sa
prospérité actuelle et de grand développement qu’elle a donné à sa
métallurgie. Il est juste qu’elle paie une partie de ces avantages au
moins par la réparation des dommages causés aux riverains de la voie
ferrée ».
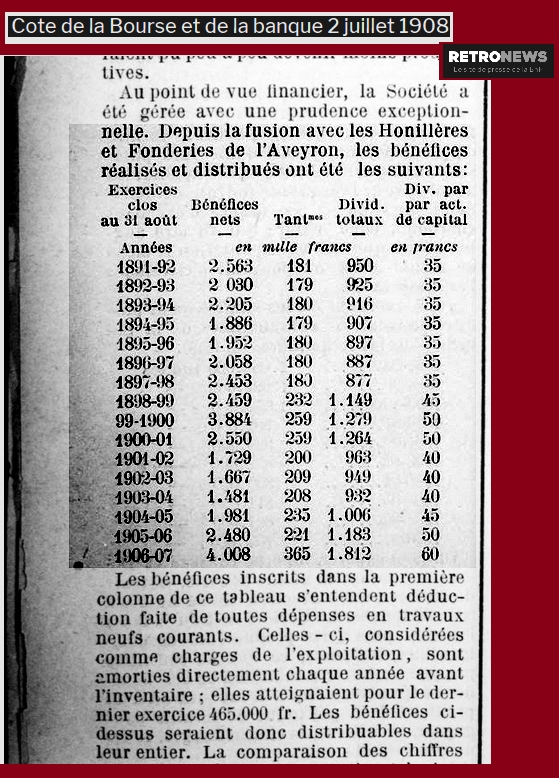
◄ Bilans financiers
A
l'époque de ce conflit, la Compagnie ne connaît que la prospérité,
augmentation des productions et des bénéfices...Le dividende par action
va presque doubler en quinze ans.
Henri Jaudon avait donc à la lecture de ces bilans d'assemblées
générales un argument bien réel à présenter aux juges.
Acte
3, un nouveau procès
Les protagonistes sont les mêmes,
mais Henry Jaudon sera maintenant le
conseiller des propriétaires contre Commentry. N’étant pas une des
parties, nous n’avons pas dans ses archives des documents précis comme
requête ou rapport.
Mais une copie du jugement figure !
Nous n’avons pas non plus
d’informations précises sur le ressenti de
Commentry au vu du jugement de 1899, assez favorable - très ? - pour la
société. Pour le plaignant de la vallée, qui doit être assez déçu, les
trains vont continuer à passer, voire dévaler la pente. Et les embarras
perdurent, les mêmes causes produisant les mêmes effets ! Monsieur
Jaudon et les propriétaires, après 7 ou huit ans de procédures vont
donc continuer à subir les aléas du progrès industriel.
En septembre 1900, en réponse à une
lettre du 8 septembre de M. Jaudon,
le directeur Péguet confirme le jour même la venue d’un agent au Cruou
« pour examiner les réclamations
qu’elle contient ». Il s’agit à
nouveau de boues déversées suite à orages devant les entrées,
totalement obstruées. Si une solution immédiate avait demandé M. Jaudon
n’est pas mise en œuvre, « il saisira à nouveau la justice ». Il faut
croire que l’éventuelle saisie est bien d’actualité, puisqu’un constat
d’huissier sera fait le 9 septembre. L’aqueduc qui longe la propriété
est complètement engorgé par les sables. Des épaisseurs de graviers,
sables et boues de 50 cm sont constatées à l’intérieur de la propriété.
Une planche est même nécessaire et indispensable pour permettre
d’entrer et sortir, planche bien visible sur les photographies.
Les archives consultées sont muettes
sur les deux années suivantes…mais
on peut penser que des difficultés diverses, ne serait-ce que pour
l’agrément, ont bien dû se manifester…Et le progrès s’annonce donc avec
le projet de Commentry de substituer la vapeur à la traction animale.
Evidemment l’opposition est totale au Cruou.
Cette
éventualité qui se fait jour en 1904 était en fait une intention de
Commentry, dès la pose de la voie, 10 ans plus tôt. Le texte qui suit
ne laisse aucun doute sur ce point.
Le 10 juillet 1904 le maire de
Mouret confirme à M. Jaudon que « le
Conseil municipal s’oppose énergiquement au changement du mode de
traction vu les graves inquiétudes que provoquera le bruit et la fumée
des trains et de la machine pour les habitants riverains et les
nombreux accidents qui pourraient survenir pour les voitures attelées
et pour les passants ». Une enquête a eu lieu en Mairie du
1 au 20
juin. « La réclamation des habitants du
Cruou est couverte par 61
signatures ».
Le 15 août 1904, l’Ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées informe
courtoisement Monsieur Jaudon, Procureur
de la République à Toulouse,
Vice-Président du Conseil général de l’Aveyron, de sa visite au
Cruou
de la petite ligne de la Cie de Decazeville.
Dans une note de sept pages, non
datée, mais rédigée en ou après 1904,
M. Jaudon fait le point sur les observations formulées par les
propriétaires sur le projet de substitution. Il commence par rappeler
les procédures passées qui n’ont « pas duré moins de dix ans » :
Conseil de Préfecture et arrêté
d’incompétence, puis demandes en
dommages devant le tribunal de Villefranche, provoquant l’expertise
Duponnois-Marre-Boyer.
Une autre expertise,
Colombier-Goudal et Murat est évoquée dans cette
note. Elle fait suite à une nouvelle demande en dommages faite par
plusieurs propriétaires : dommages aux immeubles et aux vins par les
trépidations, gêne dans l’accès, saillies des rails, et difficultés
pour l’exploitation des propriétés. Ce dernier jugement, troisième acte
de procédure, avait été rendu le 31 décembre 1903.
Le montant des frais est d’environ
dix-mille francs. Dans ses
jugements, « le tribunal a accordé à onze
riverains des redevances
annuelles variant de 40 à 15 francs. Le tribunal n’a écarté que deux
causes : les trépidations dont l’intensité ne lui a pas paru suffisante
et les accidents…qui ne peuvent pas donner lieu à des indemnités fixées
d’avance ».
Dans sa note qui sert de base aux plaignants, Henry
Jaudon constate :
« La mesure de substitution
envisagée aurait pour résultats :
- d’aggraver tous
les dommages déjà causés et
constatés…
- d’en occasionner
de nouveaux : trépidations plus
intenses, arrêt des convois impossible ou très difficile, circulation
avec des animaux dangereuse…la locomotive effrayant les animaux, La
fumée, loin de se dissiper dans une vallée étroite bordée d’arbres
fruitiers s’y concentrerait…Elle est nocive pour les récoltes… »
En conclusion de cette note, « les soussignés déclarent
s’opposer
énergiquement à la substitution proposée de la traction à vapeur à la
traction animale et demandent à M le Préfet le retrait de
l’autorisation accordée… »
Cette importante note de 1904 révèle
donc le procès de 1903.
Dans son jugement du 31 décembre
1903, le tribunal de VIllefranche :
- ne se
prononce
pas sur la légalité des arrêtés du
préfet, hors de sa compétence
- précise, au sujet de
la saillie des rails, que la
Compagnie semble avoir oublié
(sic !) plusieurs des
obligations
auxquelles elle s’était astreinte…
- constate que les
trépidations sont
insuffisantes pour provoquer les
effets allégués
- constate que les
poussières soulevées par les
trains ne sont pas aggravées de ce fait
- constate que la
voie ferrée est une gêne évidente
pour tous les demandeurs
- rejette la
responsabilité des trains dans la
maladie de la tourne
Le jugement analyse enfin les cas
particuliers des demandeurs. Il nous
apprend au passage que le rapport des experts est daté du 6 mars 1902.
Dans ses conclusions, il condamne la Compagnie à payer aux différents
demandeurs, pour réparation du préjudice, des dommages. Suit la liste
des plaignants, dans lesquels ne figure donc pas M. Jaudon, et le
détail des sommes dues.
Le montant total des
indemnités est de 1964,04 francs. Les dépens
seront supportés pour un quart par les demandeurs.
Maître Colombié était l’avocat des
demandeurs. En souhaitant la bonne
année à son Cher ami Jaudon, Colombié écrit : « Ce n’est pas tout
ce
que nous aurions désiré, mais le résultat n’en est pas moins
appréciable… »
Cruou,
le 11 janvier 1904
Monsieur
Jaudon,
Je vous remercie
bien des communications des lettres
dont vous avez bien voulu nous faire part. Tous les intéressés en ont
pris connaissance et ont l’honneur de vous remercier des peines que
l’on vous a données en attendant de pouvoir le faire de vive voix et
vous satisfaire.
à
la première fois que l’on
ira à Rodez on remerciera M. Pons et
on le satisfera aussi…
signé
Combes Bernard
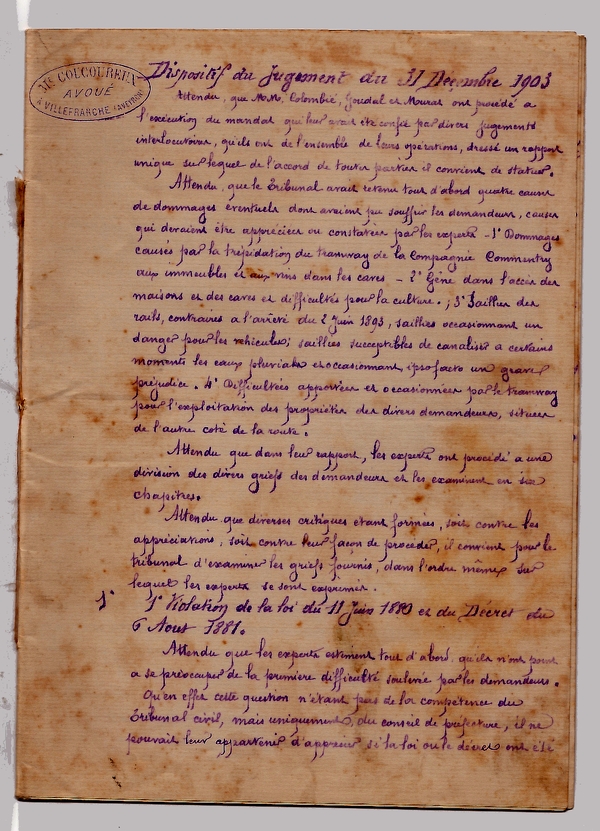
Les
locomotives ne passeront
pas dans la vallée. Mais les chevaux
vont continuer de tirer les trains de minerai, sur ce chemin 21,
jusqu’à l’hiver 1910, remplacés alors par un véritable progrès, un
chemin de
fer, mais aérien celui-là, mis en place sur le causse.
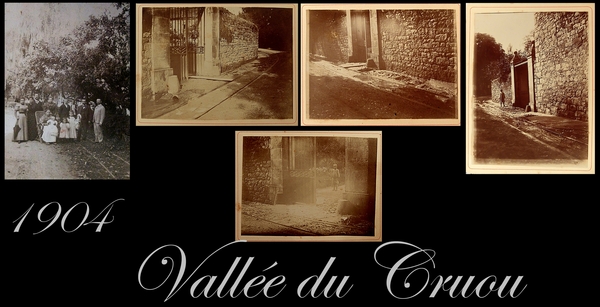
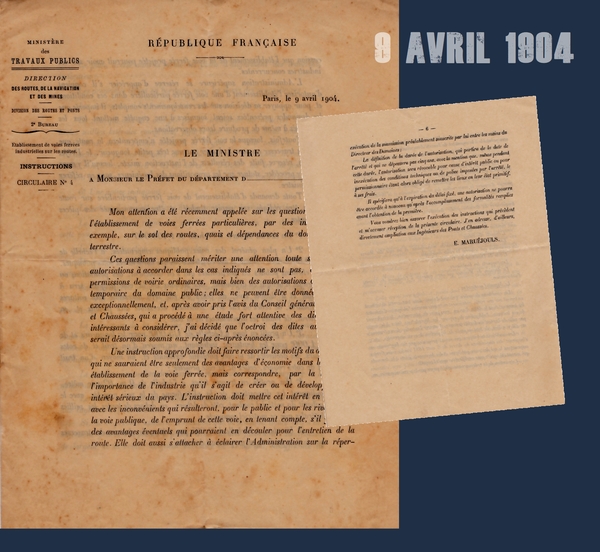
Le
9 avril 1904, le Ministre des Travaux Publics, Emile Maruejouls,
adresse aux Préfets une circulaire pour définir la position
administrative pour l'établissement
des voies ferrées industrielles sur les routes. Une coïncidence
? Absolument pas ! Henry Jaudon, avocat, conseiller général en 1895,
connaissait très bien son confrère
avocat, Président du Conseil Général de 1896 à 1906 et ministre ! La
circulaire, manifestement inspirée par H. Jaudon,
reprend dans ses six pages la quasi-totalité des griefs du Cruou ! La
(petite) vallée a donc eu une importance administrative nationale !
Qu'on se le dise...
" Mon attention a été très récemment appelée sur les
questions que soulève l'établissement de voies ferrées particulières,
par des industriels par exemple, sur le sol des routes, quais et
dépendances du domaine public terrestre..."
(►
un clic ICI pour
lire la circulaire dans son intégralité)
Epilogue
▲
Les soubresauts qui ont agité
depuis plus de dix ans la vallée du
Cruou vont s’atténuer. Journal de l'Aveyron

Les procès ne sont plus qu’un
souvenir lorsque en 1909 s’annonce la
construction de l’aérien. Enfin !
Plus de trépidations, moins de
poussières…Mais n’a-t-on pas, un peu,
déplacé les problèmes et échangé tout cela contre chute de minerai
depuis les airs ou bruit incessant de ferraille ?
Une
autre histoire va
s’écrire, à découvrir sur www.ferrobase...
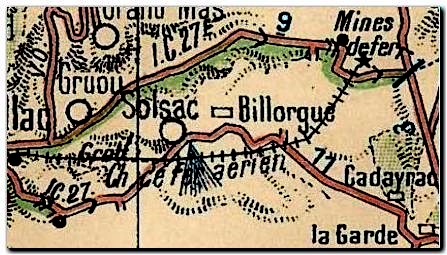

▲ 20
février 1917
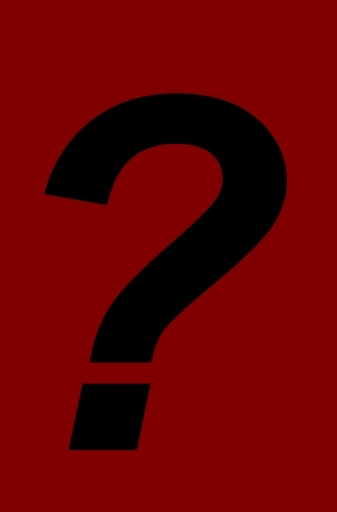 en
savoir beaucoup plus ?
Postérieurement au dépouillement de
ces archives et après la rédaction
de notre note, nous avons retrouvé* un texte qui complète
parfaitement cette connaissance du Cruou. M. Matheron, pour le compte
de la Compagnie Commentry rédige un volumineux rapport sur les mines de
Mondalazac. C'est un état zéro
de ces mines que Commentry vient d'acquérir. Les mines, car il présente toutes les
ressources du causse.
Dans une première partie historique il rappelle ainsi qu’avant 1840, la
Route du fer passait par Rodez, Rignac, Montbazens. Il en coûtait 27
francs à la tonne pour ce voyage ! Vers 1840, le passage direct par
Solsac, Marcillac, St-Christophe permet de rejoindre plus directement
Firmi et Decazeville.
*
texte
recopié in
Fonds Daudibertières, 10-29, Société des Lettres
sciences et arts de l’Aveyron
en
savoir beaucoup plus ?
Postérieurement au dépouillement de
ces archives et après la rédaction
de notre note, nous avons retrouvé* un texte qui complète
parfaitement cette connaissance du Cruou. M. Matheron, pour le compte
de la Compagnie Commentry rédige un volumineux rapport sur les mines de
Mondalazac. C'est un état zéro
de ces mines que Commentry vient d'acquérir. Les mines, car il présente toutes les
ressources du causse.
Dans une première partie historique il rappelle ainsi qu’avant 1840, la
Route du fer passait par Rodez, Rignac, Montbazens. Il en coûtait 27
francs à la tonne pour ce voyage ! Vers 1840, le passage direct par
Solsac, Marcillac, St-Christophe permet de rejoindre plus directement
Firmi et Decazeville.
*
texte
recopié in
Fonds Daudibertières, 10-29, Société des Lettres
sciences et arts de l’Aveyron
 ▲
Carte Atlas Forestier, département de l'Aveyron, extrait, 1889
Toute
la difficulté du transport :
1,
par une route via Rodez et Rignac, avant 1840
2,
par un (mauvais) chemin, via Marcillac et St-Christophe, 1840-1856
3,
par la voie ferrée minière, 1856, et un chemin du causse
4,
par la vallée du Cruou, 1893 et
la voie minière
5,
avec le chemin de fer aérien, 1911, et la voie minière
▲
Carte Atlas Forestier, département de l'Aveyron, extrait, 1889
Toute
la difficulté du transport :
1,
par une route via Rodez et Rignac, avant 1840
2,
par un (mauvais) chemin, via Marcillac et St-Christophe, 1840-1856
3,
par la voie ferrée minière, 1856, et un chemin du causse
4,
par la vallée du Cruou, 1893 et
la voie minière
5,
avec le chemin de fer aérien, 1911, et la voie minière
Une circulation difficile sur des
chemins très abimés par cette même
circulation -on tourne en rond ! – amène les administrateurs à penser à
une voie ferrée minière, privée, leur appartenant en propre. Les
besoins accrus de minerai pourront être mieux satisfaits. Les premiers
travaux de cette voie débutent en 1849, pour un premier tronçon de
Firmi à Riou Nègre, sur 9 km. En 1853, ce sera jusqu’à la Cabrière,
entrée ouest de la vallée de l'Ady, et
la longueur de la voie est alors de 13 km. Fin 1855, le terminus est
enfin Marcillac, après réalisation des grands travaux d’ouvrages, le
pont Malakoff en vallée de l’Ady, le Pont Rouge sur le Créneau à
Marcillac et les longs tunnels d’Hymes et de l’Ady.
En 1853 le court tronçon de la mine
de Solsac est également en place,
menant sur une très courte distance le minerai au dépôt en haut de la
côte de Marcillac.
Nous
vous proposons ici le texte du
paragraphe Transport. Il complète
remarquablement bien l’étude précédente menée sur archives. Ce texte de
Matheron a de plus été écrit en 1892. Il est donc contemporain des
préoccupations des riverains de la vallée et présente de ce fait un
incontestable intérêt documentaire. Il complète des éléments évoqués,
écarte toute information sur les litiges en cours, et détaille avec
beaucoup de soins la circulation en vallée du Cruou. Elle semblait, au
vu de l’expert de la Compagnie Commentry, plus risquée que ne pouvait
le penser M. Jaudon ! Celui-ci n’a manifestement pas eu connaissance de
ce rapport aux administrateurs. Il aurait dans ce cas trouvé sûrement
matière à critiques…
En
fin de texte, nous donnons le
paragraphe relatif au grillage du
minerai. Le site des Espeyroux était fortement impliqué.
Etude
sur les mines de fer de Mondalazac, M. Matheron, 1892
Cette étude a fait l’objet d’un
rapport à la direction de Commentry en
1902 .
Transport-Historique, Espeyroux à Marcillac
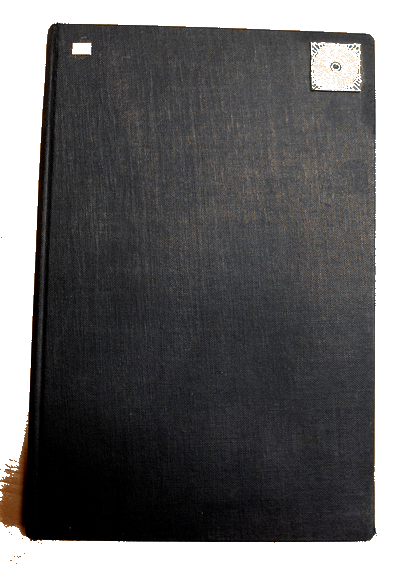 Le
prix élevé des transports sur
essieu entre la mine et Marcillac a
préoccupé tous les Directeurs et Administrateurs qui se sont succédés à
Decazeville avant 1892. Plusieurs projets furent étudiés pour prolonger
jusqu’à Mondalazac la voie ferrée de Decazeville à Marcillac.
En 1863 on avait dressé un
avant-projet qui ne différait pas
essentiellement du projet qui a été exécuté par la Compagnie Commentry,
la situation mauvaise de la Compagnie ne permit pas à ce moment de lui
donner suite.
De 1879 à 1881, Mr Petitjean
administrateur délégué a fait étudier
divers projets tendant à relier la mine de Marcillac par une voie
ferrée. On avait conclu au projet n°8 (chemin de fer sur l’accotement
de la route du Cruou, raccordement avec le plan incliné et chemin de
fer supérieur) comportant le minimum de frais d’établissement et qui
paraissait seul pratique pour un chemin de fer à faible trafic. Il
aurait été exécuté avant 1892 si la situation précaire de la Société
des Houillères de l’Aveyron n’avait pas été un obstacle sérieux.
Néanmoins pour améliorer les conditions de transport par voiture, en
attendant qu’on put établir la voie ferrée, la Société des Houillères
et Fonderies de l’Aveyron avait étudié un projet par la route du Cruou
avec raccordement au Plateau de Marcillac au moyen d’un pont sur le
Cruou. L’économie du projet consistait dans la réduction de la longueur
des transports à 7 K500 au lieu de 11 Km par le chemin de Solsac. On
pouvait économiser ainsi 0 fr 70 par tonne. Si la fusion avec Commentry
n’avait pas eu lieu, ce projet aurait été exécuté en 1892, car le
Conseil d’administration avait voté à cet effet un crédit de 15000,00
fr. A cette époque le transport par voiture entre la mine et Marcillac
coutait 2,35 fr se décomposant comme suit :
Prix du transport (11 Km) =1,75
fr-Déchargement à Marcillac
0,10-Entretien de la route de Solsac 0,50-Total 2,35 fr.
Ce projet fut étudié à nouveau en
1892 par la Compagnie Commentry après
la fusion. Toutefois l’exécution de ce projet de raccordement fut
retardée dans l’espoir que l’administration accorderait bientôt
l’autorisation de poser une voie ferrée sur l’accotement du chemin du
Cruou. En juillet 1891, la Société des Houillères et Fonderies avait en
effet adressé une pétition pour obtenir l’autorisation de cette pose.
L’exécution simultanée du projet de voie ferrée et du raccordement de
la route au plateau de Marcillac permettait de réduire de 4000 fr
environ les frais de raccordement en employant comme remblais au point
de raccordement les déblais fournis par la construction de la voie.
L’attente de la Compagnie était donc bien justifiée. Pendant ce temps
la Compagnie raccordait la route du Cruou à la mine après avoir obtenu
l’approbation de l’Administration. A la suite de la pétition d e1891,
les agents voyers furent chargés d’étudier le projet de la voie ferré.
L’agent voyer d’arrondissement dresse un projet qui comprenait
l’élargissement du chemin à grande communication du Cruou, sur tous les
points nécessaires. L’administration devait faire les expropriations et
surveiller l’exécution du travail de la Société de Decazeville
consentant à faire tous les travaux indiqués et prendre en charge
toutes les dépenses qui en résulteraient. Le devis de l’agent voyer
comportait une dépense de 12581,75 fr. La Compagnie de Commentry
étudiera ce projet dont les dispositions étaient imposées par la
situation des lieux et par la nécessité d’utiliser autant que possible
les travaux d’élargissement exécutés par le Département (côte de
Frontignan). La Compagnie ayant accepté les propositions de
l’Administration, l’autorisation de poser la voie ferrée sur
l’accotement Nord fut accordée par un arrêté préfectoral du 2 juin 1893.
Le 26 août, parut un nouvel arrêté
préfectoral pour faire déplacer sur
l’accotement sud une partie de la voie ferrée. Cet arrêté fut pris sur
la proposition du Conseil Municipal de Marcillac à la requête de Mr
Jaudon, mais un 3 ème arrêté, du 6 janvier 1894 rapportera celui du 26
août.
Le
prix élevé des transports sur
essieu entre la mine et Marcillac a
préoccupé tous les Directeurs et Administrateurs qui se sont succédés à
Decazeville avant 1892. Plusieurs projets furent étudiés pour prolonger
jusqu’à Mondalazac la voie ferrée de Decazeville à Marcillac.
En 1863 on avait dressé un
avant-projet qui ne différait pas
essentiellement du projet qui a été exécuté par la Compagnie Commentry,
la situation mauvaise de la Compagnie ne permit pas à ce moment de lui
donner suite.
De 1879 à 1881, Mr Petitjean
administrateur délégué a fait étudier
divers projets tendant à relier la mine de Marcillac par une voie
ferrée. On avait conclu au projet n°8 (chemin de fer sur l’accotement
de la route du Cruou, raccordement avec le plan incliné et chemin de
fer supérieur) comportant le minimum de frais d’établissement et qui
paraissait seul pratique pour un chemin de fer à faible trafic. Il
aurait été exécuté avant 1892 si la situation précaire de la Société
des Houillères de l’Aveyron n’avait pas été un obstacle sérieux.
Néanmoins pour améliorer les conditions de transport par voiture, en
attendant qu’on put établir la voie ferrée, la Société des Houillères
et Fonderies de l’Aveyron avait étudié un projet par la route du Cruou
avec raccordement au Plateau de Marcillac au moyen d’un pont sur le
Cruou. L’économie du projet consistait dans la réduction de la longueur
des transports à 7 K500 au lieu de 11 Km par le chemin de Solsac. On
pouvait économiser ainsi 0 fr 70 par tonne. Si la fusion avec Commentry
n’avait pas eu lieu, ce projet aurait été exécuté en 1892, car le
Conseil d’administration avait voté à cet effet un crédit de 15000,00
fr. A cette époque le transport par voiture entre la mine et Marcillac
coutait 2,35 fr se décomposant comme suit :
Prix du transport (11 Km) =1,75
fr-Déchargement à Marcillac
0,10-Entretien de la route de Solsac 0,50-Total 2,35 fr.
Ce projet fut étudié à nouveau en
1892 par la Compagnie Commentry après
la fusion. Toutefois l’exécution de ce projet de raccordement fut
retardée dans l’espoir que l’administration accorderait bientôt
l’autorisation de poser une voie ferrée sur l’accotement du chemin du
Cruou. En juillet 1891, la Société des Houillères et Fonderies avait en
effet adressé une pétition pour obtenir l’autorisation de cette pose.
L’exécution simultanée du projet de voie ferrée et du raccordement de
la route au plateau de Marcillac permettait de réduire de 4000 fr
environ les frais de raccordement en employant comme remblais au point
de raccordement les déblais fournis par la construction de la voie.
L’attente de la Compagnie était donc bien justifiée. Pendant ce temps
la Compagnie raccordait la route du Cruou à la mine après avoir obtenu
l’approbation de l’Administration. A la suite de la pétition d e1891,
les agents voyers furent chargés d’étudier le projet de la voie ferré.
L’agent voyer d’arrondissement dresse un projet qui comprenait
l’élargissement du chemin à grande communication du Cruou, sur tous les
points nécessaires. L’administration devait faire les expropriations et
surveiller l’exécution du travail de la Société de Decazeville
consentant à faire tous les travaux indiqués et prendre en charge
toutes les dépenses qui en résulteraient. Le devis de l’agent voyer
comportait une dépense de 12581,75 fr. La Compagnie de Commentry
étudiera ce projet dont les dispositions étaient imposées par la
situation des lieux et par la nécessité d’utiliser autant que possible
les travaux d’élargissement exécutés par le Département (côte de
Frontignan). La Compagnie ayant accepté les propositions de
l’Administration, l’autorisation de poser la voie ferrée sur
l’accotement Nord fut accordée par un arrêté préfectoral du 2 juin 1893.
Le 26 août, parut un nouvel arrêté
préfectoral pour faire déplacer sur
l’accotement sud une partie de la voie ferrée. Cet arrêté fut pris sur
la proposition du Conseil Municipal de Marcillac à la requête de Mr
Jaudon, mais un 3 ème arrêté, du 6 janvier 1894 rapportera celui du 26
août.
▲
le mur des trémies à Ferals :
la partie centrale ferme l’espace
entre les deux quais dont on
distingue bien
les extrémités. Voir l’extrait sur la
carte.
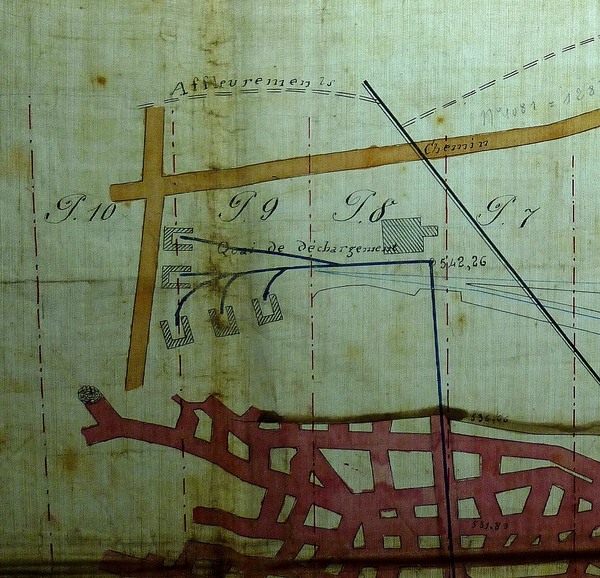
▲
Plan de la mine de Ferals ; extrait, 1897
Détail
de la voie ferrée
Bien qu’il ne fût question à ce
moment que d’un transport par chevaux
on choisit des rails suffisamment résistants pour permettre l’emploi
ultérieur de locomotives, si cette situation était reconnue avantageuse.
Eléments de la voie
Rail Vignole au Cruou de 8 m de
long, hauteur 92 mm, épaisseur du
champignon 49 largeur du patin 80 poids par mètre 22K5.
Le devis pour un kilomètre de voie
s’élevait à 11321,80.
Conditions
de transport sur la voie
ferrée Marcillac Espeyroux
Pour charger facilement les caisses
du wagon de minerai aux Espeyroux,
un quai de chargement ayant 3,35 m de hauteur et comprenant 5 trémies
avec culbuteurs fixes a été construit en 1893 et agrandit en 1898 par
l’adjonction de 5 nouvelles trémies. Les chars de minerai sortant de la
mine sont roulés à bras jusqu’aux trémies (distance moyenne 55 m et
culbutes dans les caisses). Un ouvrier peut rouler aux trémies et
charger en wagons 70 tonnes par jour.
Roulage
des wagons pleins de
Marcillac
Les caisses sont roulées à Marcillac
par convoi de 4 jusqu’au bas de la
cote de Frontignan ou est établie une gare de relai (gare du Cruou) :
par convoi de 6 entre ce relai et Marcillac. Chaque convoi est conduit
par 4 chevaux avec un conducteur. La gare intermédiaire divise le
parcours total en 2 tronçons, l’un de 3800 m en cote et l’autre de 4500
m dans la vallée, avec plusieurs ondulations de terrain. Des équipes
distinctes font le roulage sur chaque tronçon.
Section
Espeyroux – Gare du Cruou
La descente des wagons jusqu’à la
gare de Cruou est délicate à cause de
la pente notable de la voie. Voici les précautions employées. La
descente est modérée :
1e par le freinage du convoi, chaque
essieu est muni d’un frein à vis
actionné par une manette. Il y a deux serre-freins par convoi de quatre
caisses.
2e par un traineau placé en queue,
contenant environ 1700 kg de minerai
cru. Il est monté sur deux patins de 0,16 de largeur glissant sur les
rails. Ce traineau est attelé au dernier wagon au moyen de 2 chaines,
au premier par un câble en dessous.
Un dispositif spécial est installé à
la gare d’Espeyroux pour faciliter
le départ du convoi en supprimant le glissement des traineaux sur le
palier de la gare. A cet effet celui-ci est monté sur un truck qui
roule sur une petite voie encaissée dans l’entre rails de la voie
normale. Lorsque le convoi arrivé à l’extrémité de la gare s’engage sur
la pente, le truck se décroche progressivement à cause de l’inclinaison
de sa voie pour que le traineau vienne reposer sur la voie normale. Au
relai de Cruou, le traineau est déchargé à la pelle. Il est ensuite
remonté aux Espeyroux dans une caisse vide. Une sablière amovible, dont
le registre est actionné par une poignée, est placée à l’avant de la
première caisse du convoi. On ne s’en sert que lorsque le temps est
humide. Il peut arriver que les dispositifs ci-dessus se trouvent
accidentellement insuffisants (cas de rupture d’un frein ou freinage
insuffisant). Il faut donc pouvoir retenir néanmoins le convoi quitte à
le faire dérailler. A cet effet une fourche de retenue est placée en
avant des 2 ème et 3 ème caisses. Relevées en temps normal, chacune
peut être facilement déclenchée au moyen d’un levier. Enfin quatre
embranchements dérailleurs convenablement espacés sur le parcours sont
normalement disposés pour faire dérailler le convoi ou une caisse
isolée qu’on laisserait échapper par inadvertance ou par insuffisance
accidentelle des dispositifs ci-dessus. Disons pour terminer qu’une
visite très minutieuse des caisses est faite tant à Mondalazac qu’à
Decazeville à l’arrivée de chaque convoi.
2
ème secteur Gare du Cruou-Marcillac
Ici le traineau n’est plus
nécessaire mais les autres dispositifs sont
maintenus. Chaque convoi de six caisses est conduit par un conducteur
assisté d’un freinteur.
Monter
des wagons vides aux Espeyroux
Dans chaque secteur les convois
vides remontés comprennent le même
nombre de caisses et de chevaux que les convois pleins descendus.
Prix
de revient du transport des
Espeyroux à Marcillac
Le revient du transport a diminué
régulièrement jusqu’en 1898-1899
grâce à la substitution du transport sur rails au transport par
voiture. Cette substitution a été achevée fin 1894.
Marcillac-Decazeville
Jusqu’en
1898 on a employé des locomotives de 12 tonnes qui étaient
insuffisantes pour un transport économique sur un aussi long parcours
23 km. La voie a en effet des pentes et des rampes qui atteignent 30 mm
par mètre. Dans la marche Marcillac Decazeville, il y a une rampe de 10
mm de Marcillac à St-Christophe (longueur 5 km) qui nécessite le
doublement des convois et leur reconstitution au sommet de la rampe.
Aussi en 1892, a-t-on préconisé l’emploi de locomotives de 20 tonnes.
Notes
sur le grillage
Utilité du grillage
Le grillage a pour but d’enlever
l’eau et surtout l’acide carbonique du
minerai. Il enlève aussi quelques impuretés (soufre). Voici les
analyses comparées du minerai cru des Espeyroux et du minerai grillé à
la mine.

Le grillage augmente donc la teneur
du fer 5% environ. L’enrichissement
réel est de 20%. Il devrait être théorique de 1/3, car le minerai cru
rend 75% de grillé. Des essais faits en 1893 au Haut-Fourneau ont
démontré l’avantage d’emploi du minerai grillé malgré son prix élevé :
9,75 au gueulard alors que le cru ne coûtait que 5,00 fr.
Avantage
du four de grillage
Si l’on ne fait pas de grillage hors
des hauts Fourneaux, il s’effectue
dans cet appareil aux régions supérieures. En abaissant la température
des gaz, il en résulte donc un refroidissement d’allure si l’on
n’ajoute pas une certaine quantité de coke supplémentaire. Le grillage
dans le Haut Fourneau est anti économique pour deux raisons principales
1 er le grillage s’effectue par la
combustion du charbon passant à
l’état d’oxyde carbone
2e le combustible (coke) est
d’ailleurs d’un prix élevé
Le grillage dans un four spécial se
fait par la combustion de
combustibles inférieurs, ou, dans tous les cas, moins chers que le
coke. De plus, le carbone passe à l’état d’acide carbonique,
c’est-à-dire qu’il dégage le maximum de chaleur.
Le grillage dans le haut fourneau
dilue les gaz combustibles (oxyde de
carbone, etc). L’utilisation de ces gaz comme combustibles devient
presque nulle. On perd donc une quantité considérable de calories que
l’on utilise si le grillage se fait en dehors du Haut Fourneau. Mais le
grillage dans un four spécial occasionne un supplément de main d’œuvre
important.
Le grillage a été effectué aux
Espeyroux jusqu’en 1902. L’augmentation
des besoins de la métallurgie en 1899-1900-1901 a nécessité pendant
cette période la marche à 2 postes avec les 8 fours. Mais le prix de
revient élevé de cette opération avec l’emploi de petits fours
utilisant mal le combustible et la main d’œuvre décida la Compagnie à
mettre en exécution le projet d’un grand four en cuve de 150 tonnes.
Avantage
des grands fours projetés
sur les petits fours des Espeyroux
Dans un grand four, le chauffage est
plus méthodique et, par suite, le
rendement calorifique de l’appareil plus élevé. Le combustible est
d’autant mieux utilisé que la hauteur du four est plus considérable.
Pour que l’utilisation fut parfaite, il faudrait que les gaz et le
minerai grillé sortissent froids du four ; mais cette condition est
pratiquement irréalisable, car il faudrait un four trop élevé et trop
couteux à construire. D’autre part le tirage naturel nécessite
forcément une certaine température des gaz au gueulard, température qui
ne doit pas descendre pratiquement au-dessous de 150°. La hauteur du
four a été fixée à 14,37 m. La hauteur des petits fours des Espeyroux
est de 6 m.
On commença l’étude du projet du
grand four en 1900. On eut d’abord
l’idée de construire ce four aux Espeyroux à l’est du massif des petits
fours ; mais après examen approfondi de la question on reconnut
préférable de le construire à Decazeville. Toutefois l’emplacement
faisant défaut à Decazeville, on choisit définitivement la Forézie où
l’emplacement était bien convenable à proximité du stock de minerai
cru. Cette position permettait d’utiliser l’ancien crassier pour
l’établissement de la rampe d’accès aux estacades de déchargement du
cru. On avait aussi à proximité l’eau nécessaire à l’alimentation des
chaudières du monte-charge. La construction du four commencée en 1901
fut achevée en mars 1902. La mise en feu eut lieu en mai.
▼
fours à griller, Firmi, vers 1910
pour nous écrire :
jrudelle@ferrobase.fr


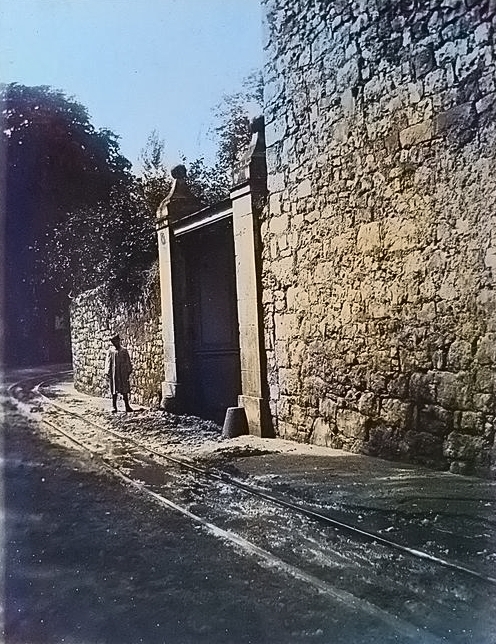
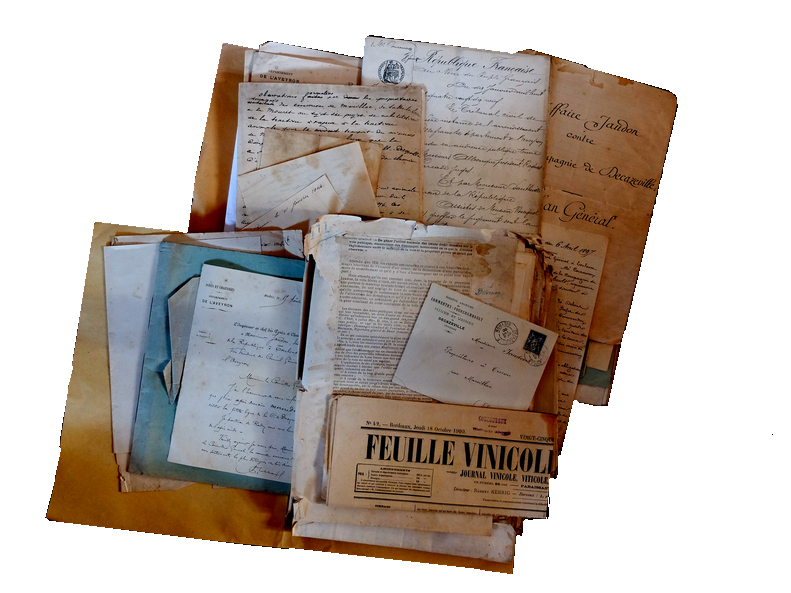

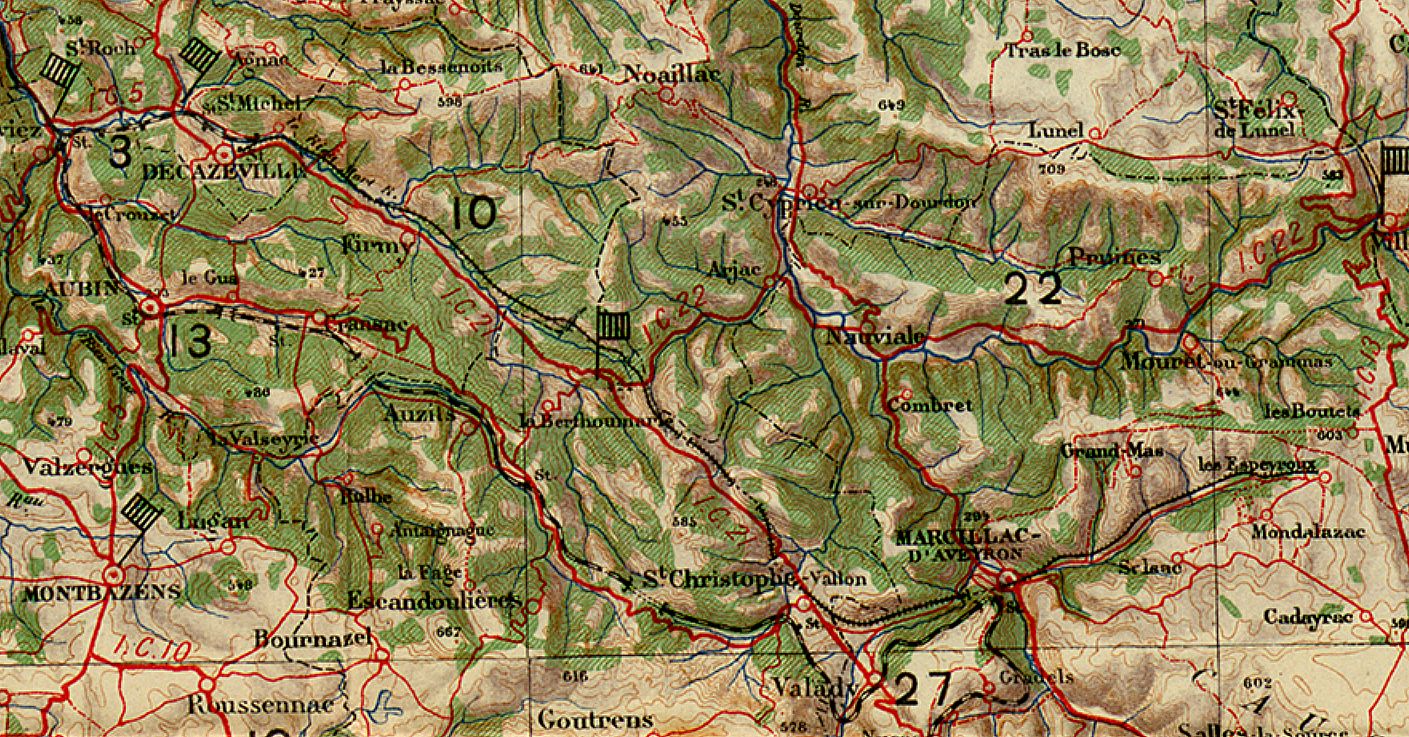



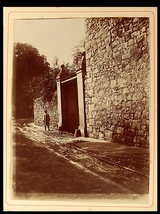


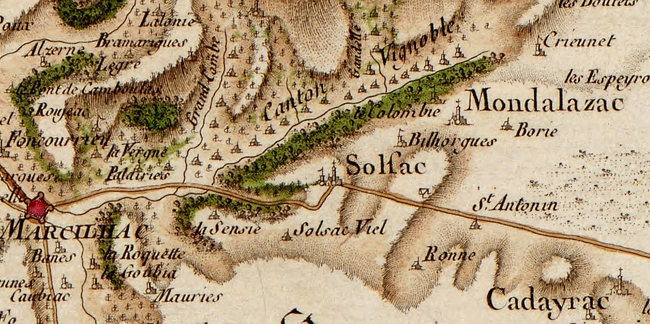

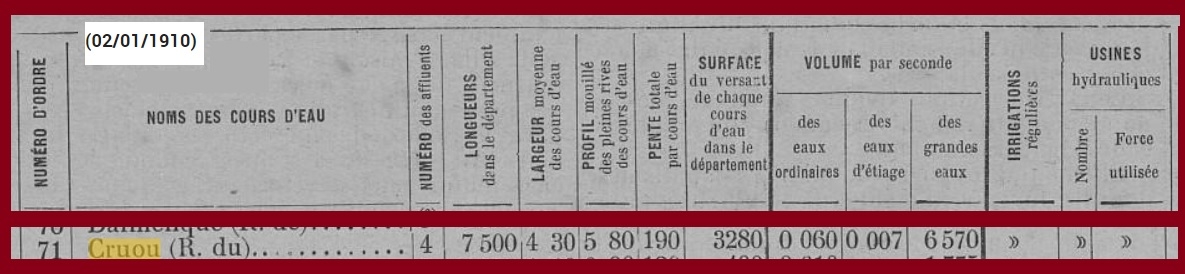
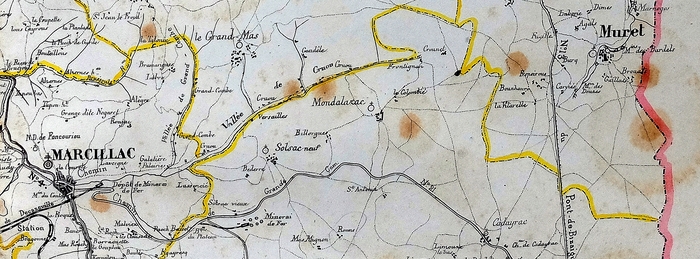
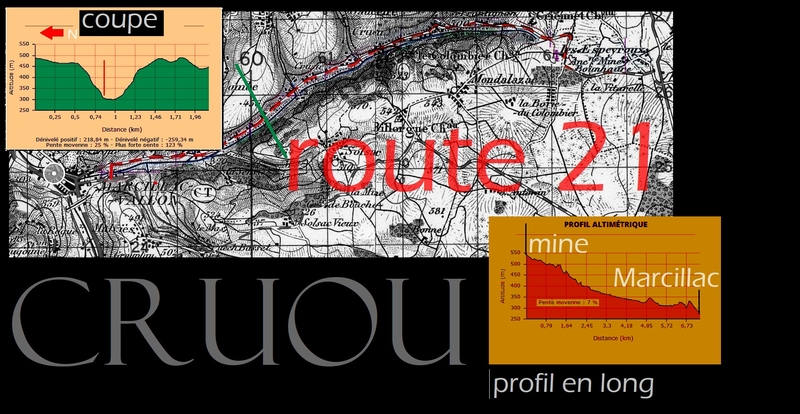
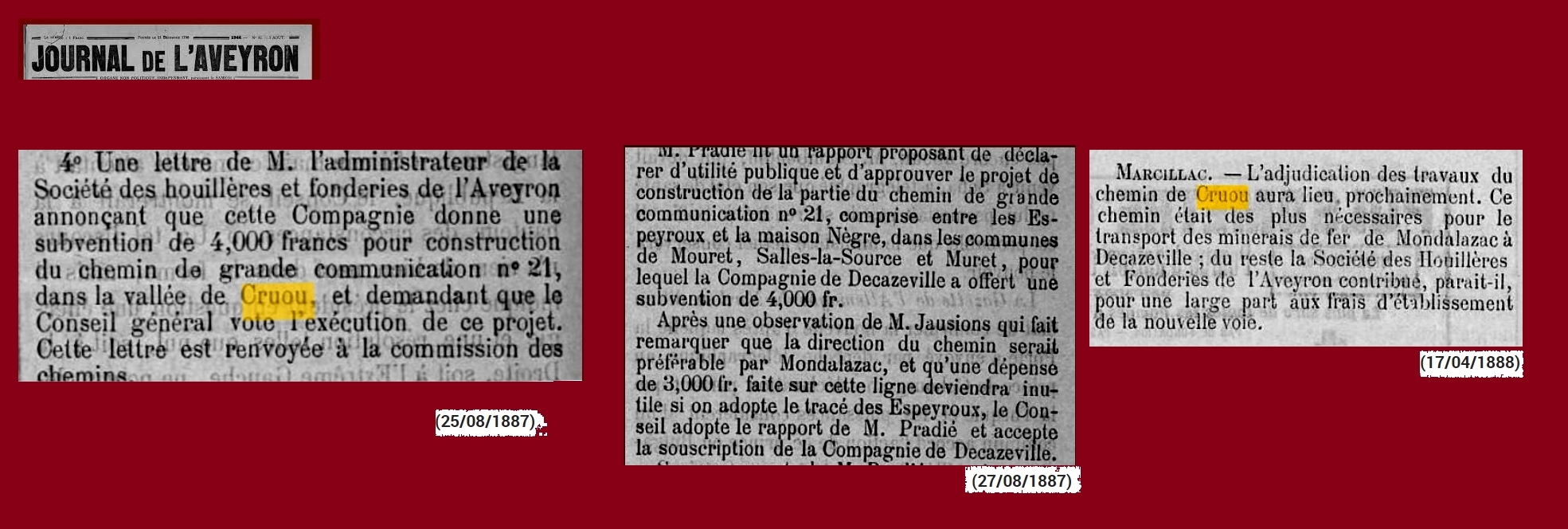 augmentation vers 1890 nécessitent
un tout autre moyen de transport. Et ce moyen ce sera donc une voie
ferrée.
augmentation vers 1890 nécessitent
un tout autre moyen de transport. Et ce moyen ce sera donc une voie
ferrée. 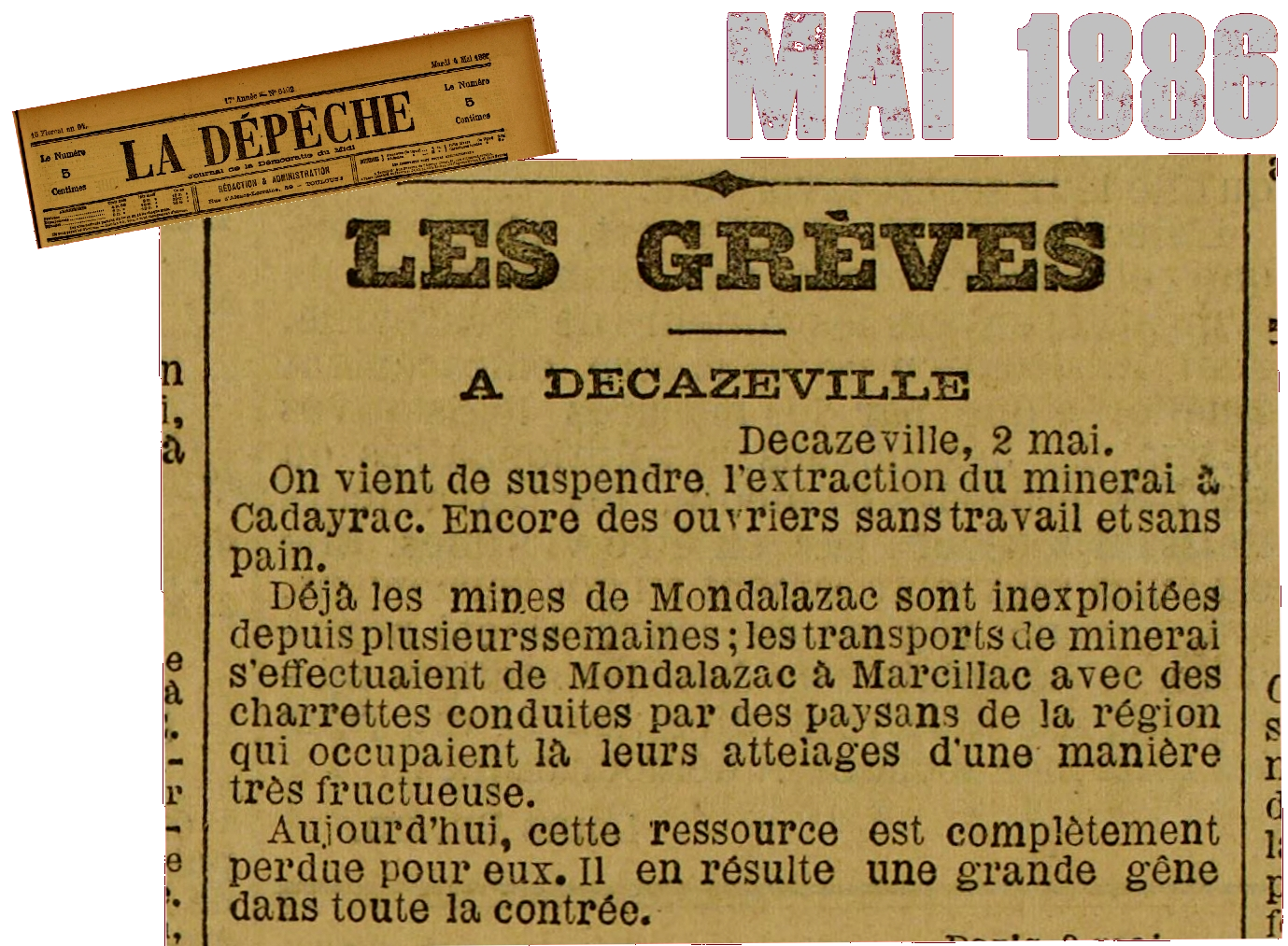
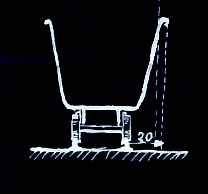 ◄ Wagonnet du
Cruou. Son gabarit est semblable à celui des wagons
miniers qui circulent entre Marcillac et Decazeville.
◄ Wagonnet du
Cruou. Son gabarit est semblable à celui des wagons
miniers qui circulent entre Marcillac et Decazeville.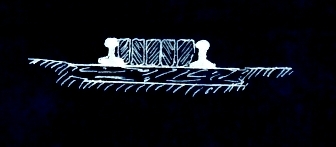
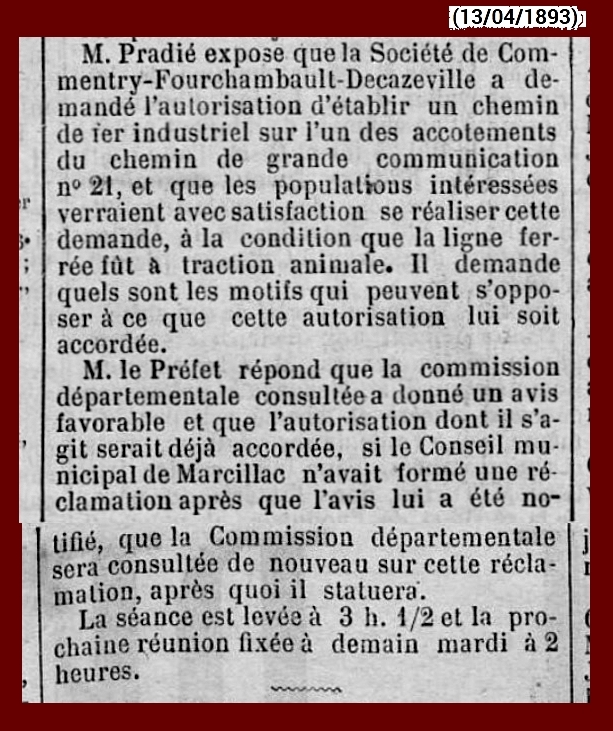 Marcillac – le maire est alors M. Frédéric
Mérican* - interroge le préfet sur cette lenteur qui déclare
attendre les suites d’une réclamation de la commune de Marcillac. Il
est aussi expressément dit que la traction sera animale. Ce point
particulier est important. Un courrier de l’ingénieur en chef des ponts
et chaussées, Arthur Labbaye, avant une visite des travaux, le confirme
à Henry Jaudon, propriétaire au Cruou.
Marcillac – le maire est alors M. Frédéric
Mérican* - interroge le préfet sur cette lenteur qui déclare
attendre les suites d’une réclamation de la commune de Marcillac. Il
est aussi expressément dit que la traction sera animale. Ce point
particulier est important. Un courrier de l’ingénieur en chef des ponts
et chaussées, Arthur Labbaye, avant une visite des travaux, le confirme
à Henry Jaudon, propriétaire au Cruou.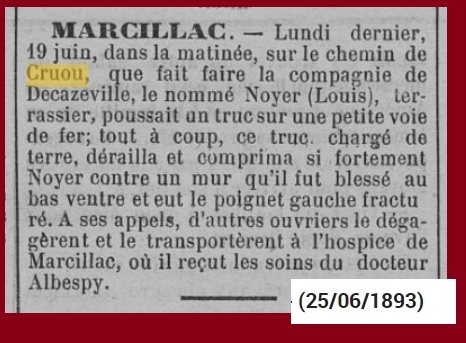
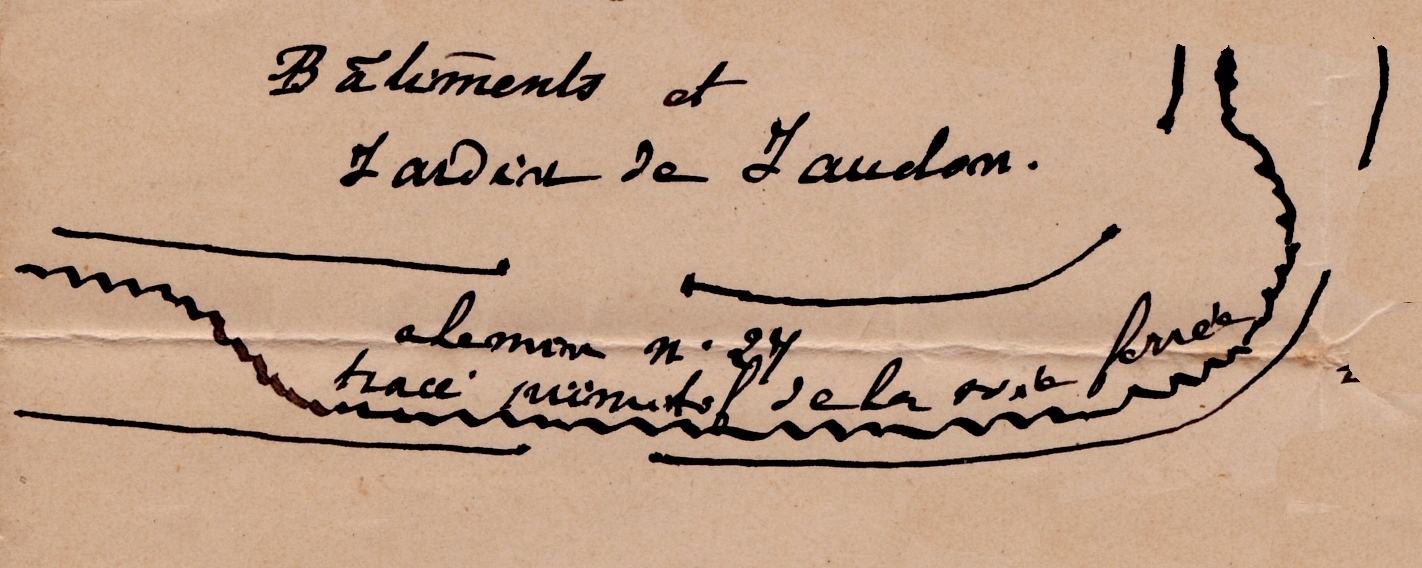
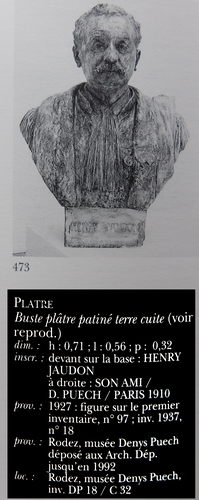
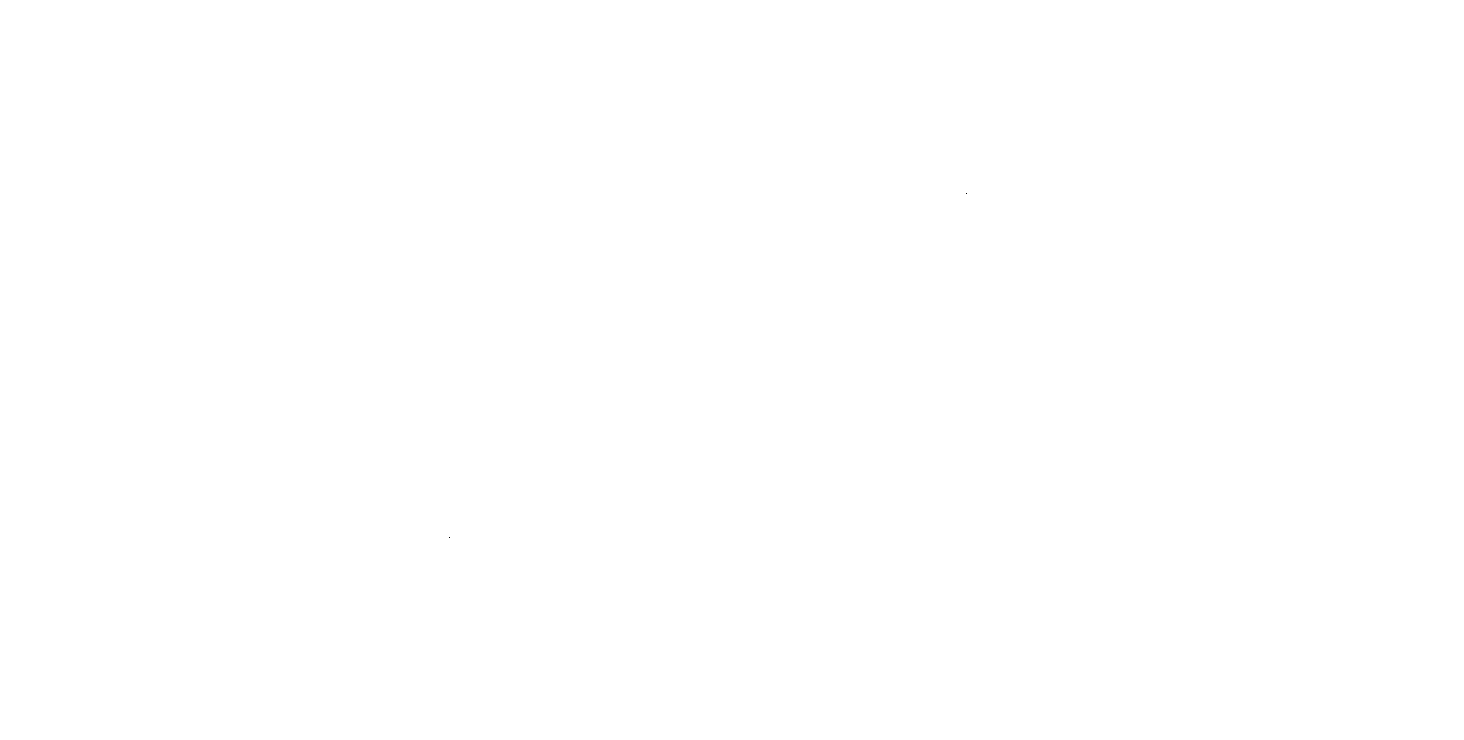

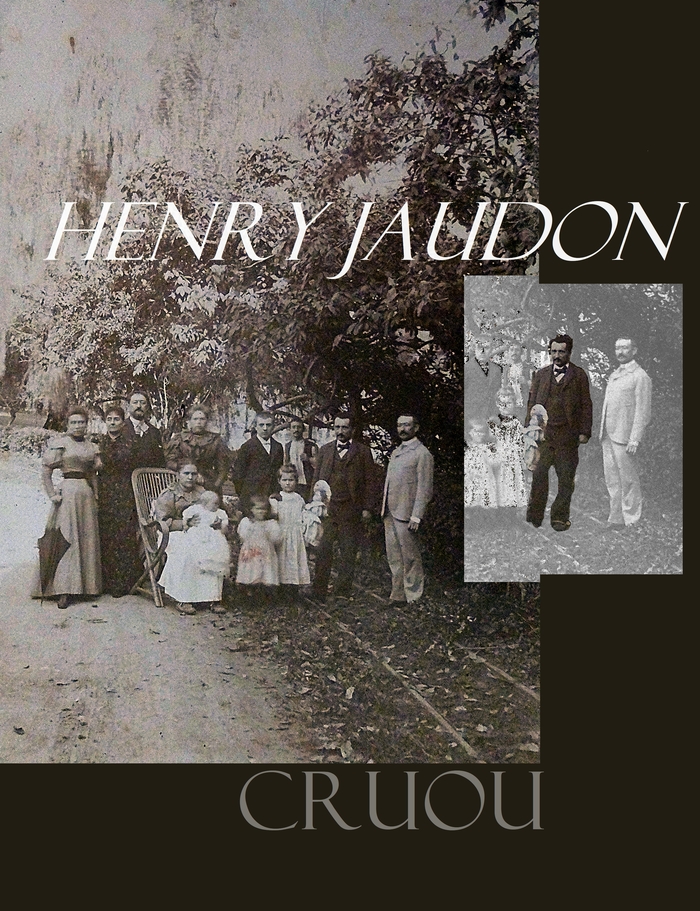
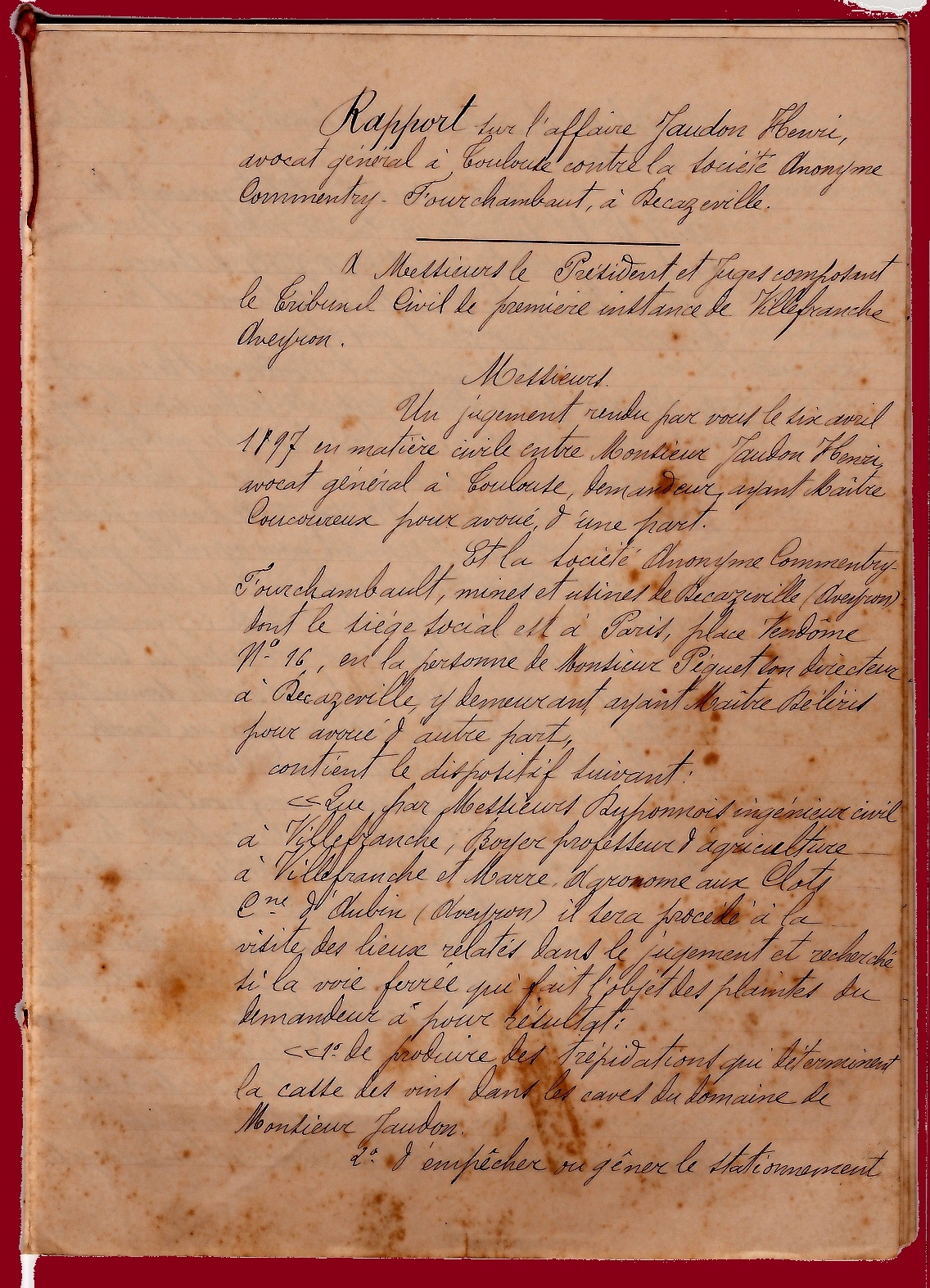 Un an plus tard, en août 1896, après
avoir admis
l’incompétence du
Conseil, confirmée par un de ses amis, Henry Jaudon s’adresse au
Président du tribunal civil de Villefranche. M. Coucoureux, son avoué,
dépose sa requête datée du 30 septembre 1896. Le dossier a désormais
une vie propre sous le numéro 6926.
Un an plus tard, en août 1896, après
avoir admis
l’incompétence du
Conseil, confirmée par un de ses amis, Henry Jaudon s’adresse au
Président du tribunal civil de Villefranche. M. Coucoureux, son avoué,
dépose sa requête datée du 30 septembre 1896. Le dossier a désormais
une vie propre sous le numéro 6926.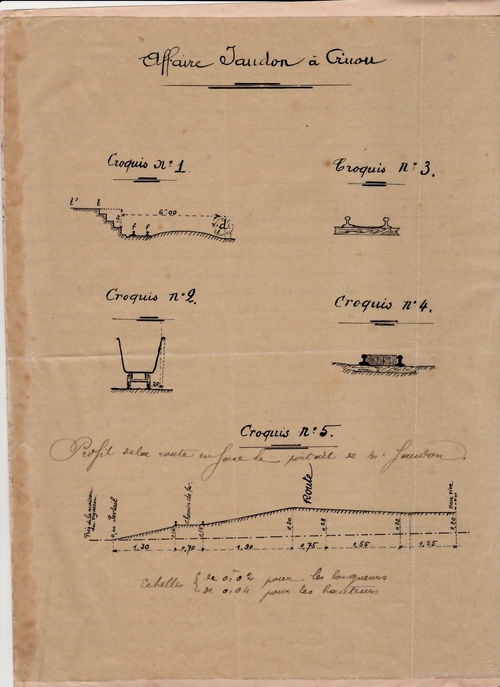
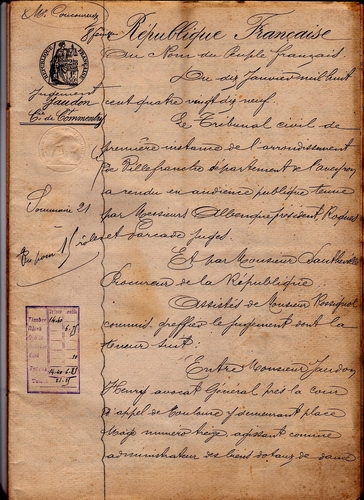
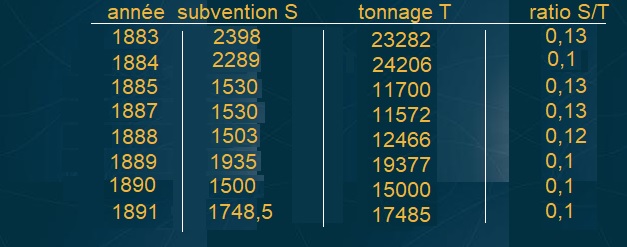
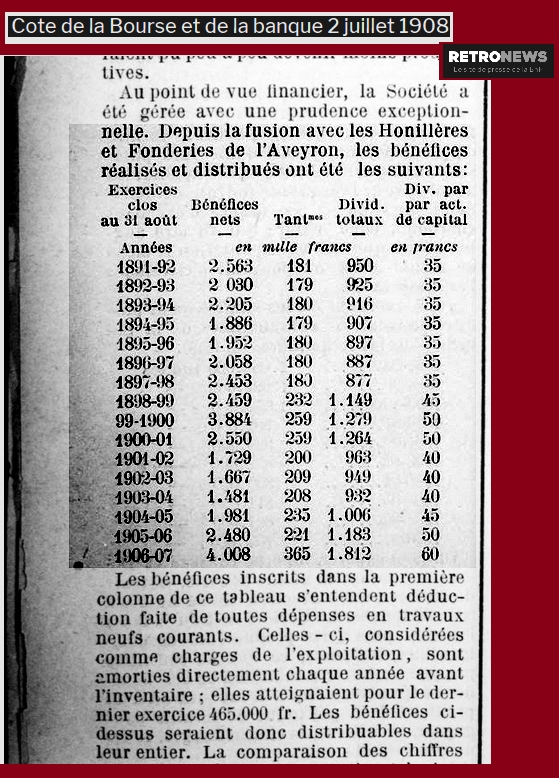
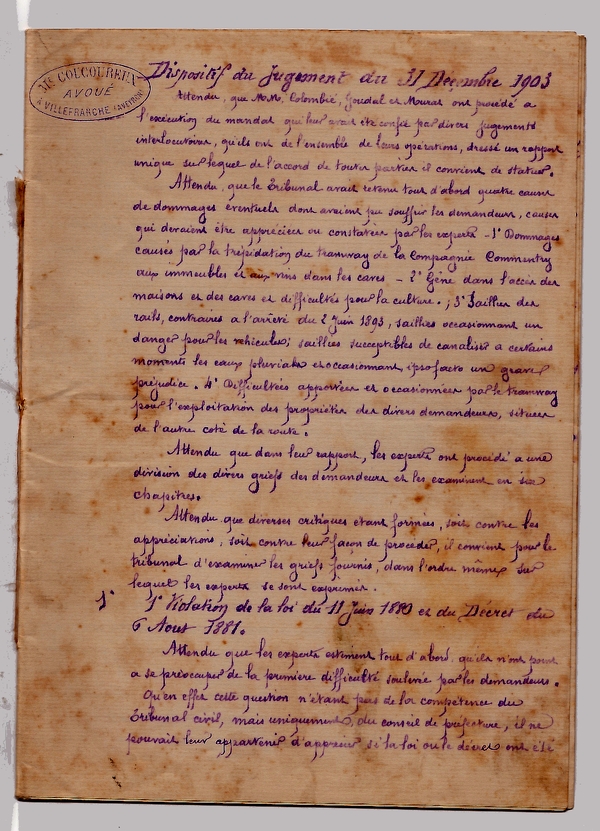
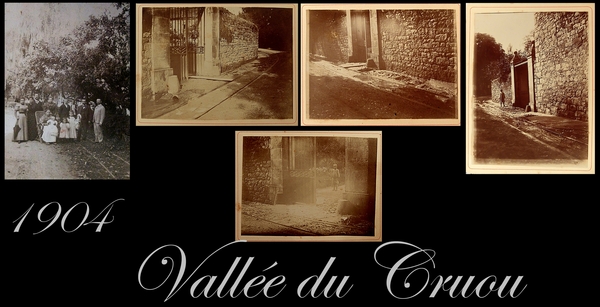
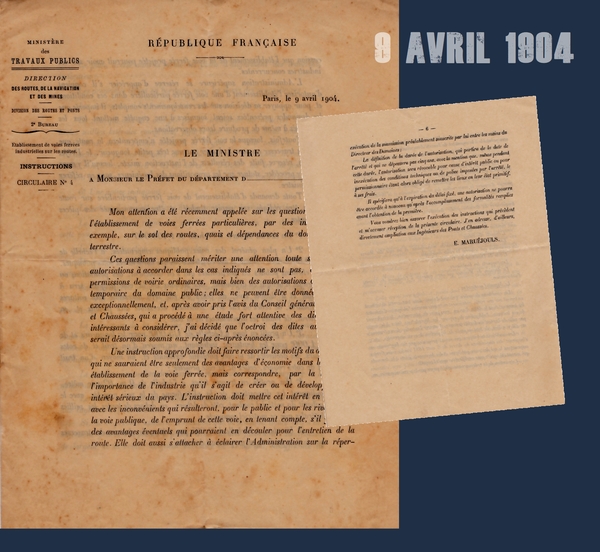
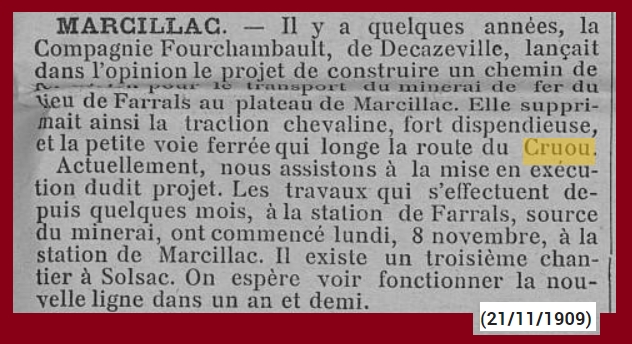

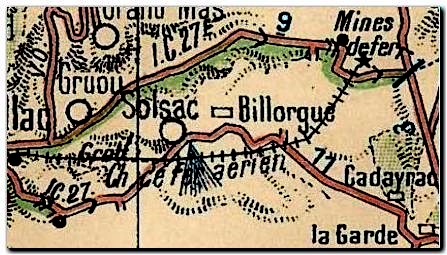

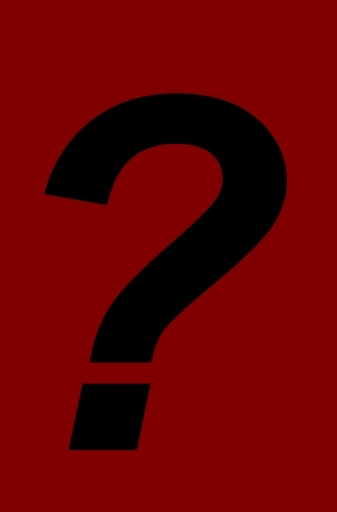 en
savoir beaucoup plus ?
en
savoir beaucoup plus ?
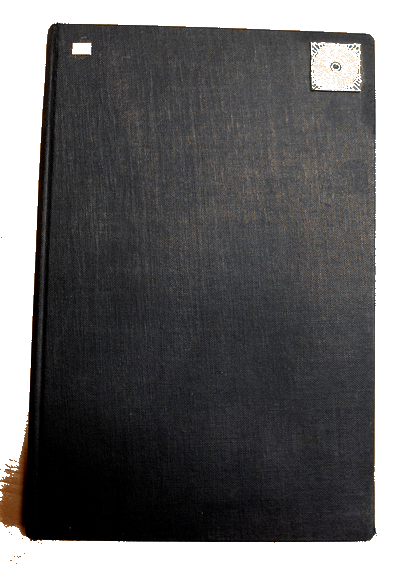 Le
prix élevé des transports sur
essieu entre la mine et Marcillac a
préoccupé tous les Directeurs et Administrateurs qui se sont succédés à
Decazeville avant 1892. Plusieurs projets furent étudiés pour prolonger
jusqu’à Mondalazac la voie ferrée de Decazeville à Marcillac.
Le
prix élevé des transports sur
essieu entre la mine et Marcillac a
préoccupé tous les Directeurs et Administrateurs qui se sont succédés à
Decazeville avant 1892. Plusieurs projets furent étudiés pour prolonger
jusqu’à Mondalazac la voie ferrée de Decazeville à Marcillac.