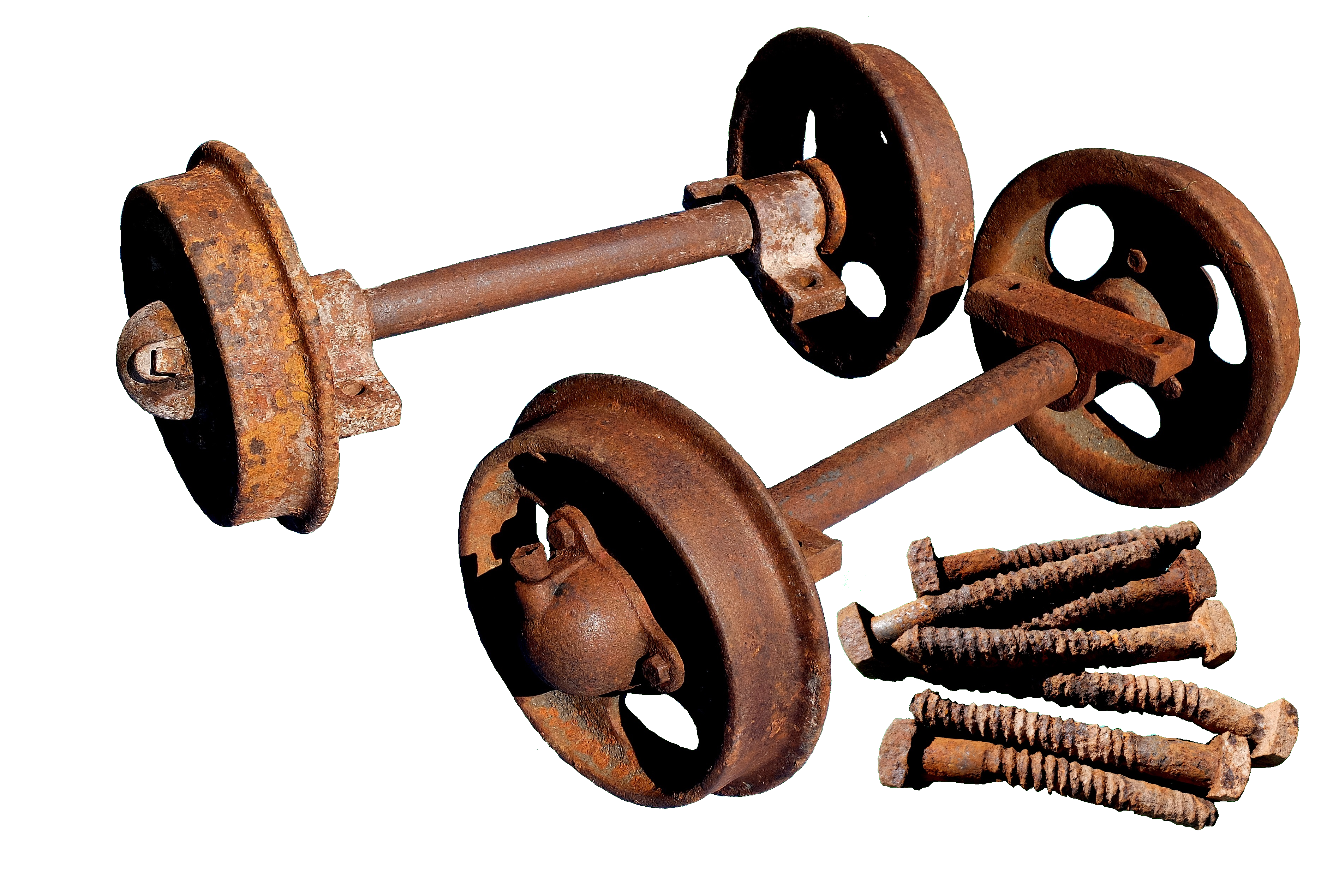
retour
page
menu
▲
ces deux essieux, pour voie de 66 cm, ont roulé à Cadayrac, vers 1870
Il y avait deux écartements de voie, 66 et 110 cm, le premier à
usage local à la mine
▲
Evidemment
le Chef de Station n'est plus à son poste ! Mais la gare est bien en
place. Qui, en 2018, se souvient-on qu'ici, vers 1860, un trafic fret
de
minerai de
fer occupait le Chef ? Le transbordement de ce minerai, propriété
de la compagnie d'Orléans, fut même la raison d'être de la gare :
extrait à la mine de Cadayrac, il change ici de wagons et part pour les
usines d'Aubin, une belle Route du fer...
▲
seul "ouvrage" de la ligne, la tranchée des Vésinies, vue depuis le
ciel (DR, col B. Olivié)
LE
CHEMIN DE
FER (de Cadayrac)
à VOIE DE 1,10 mètre
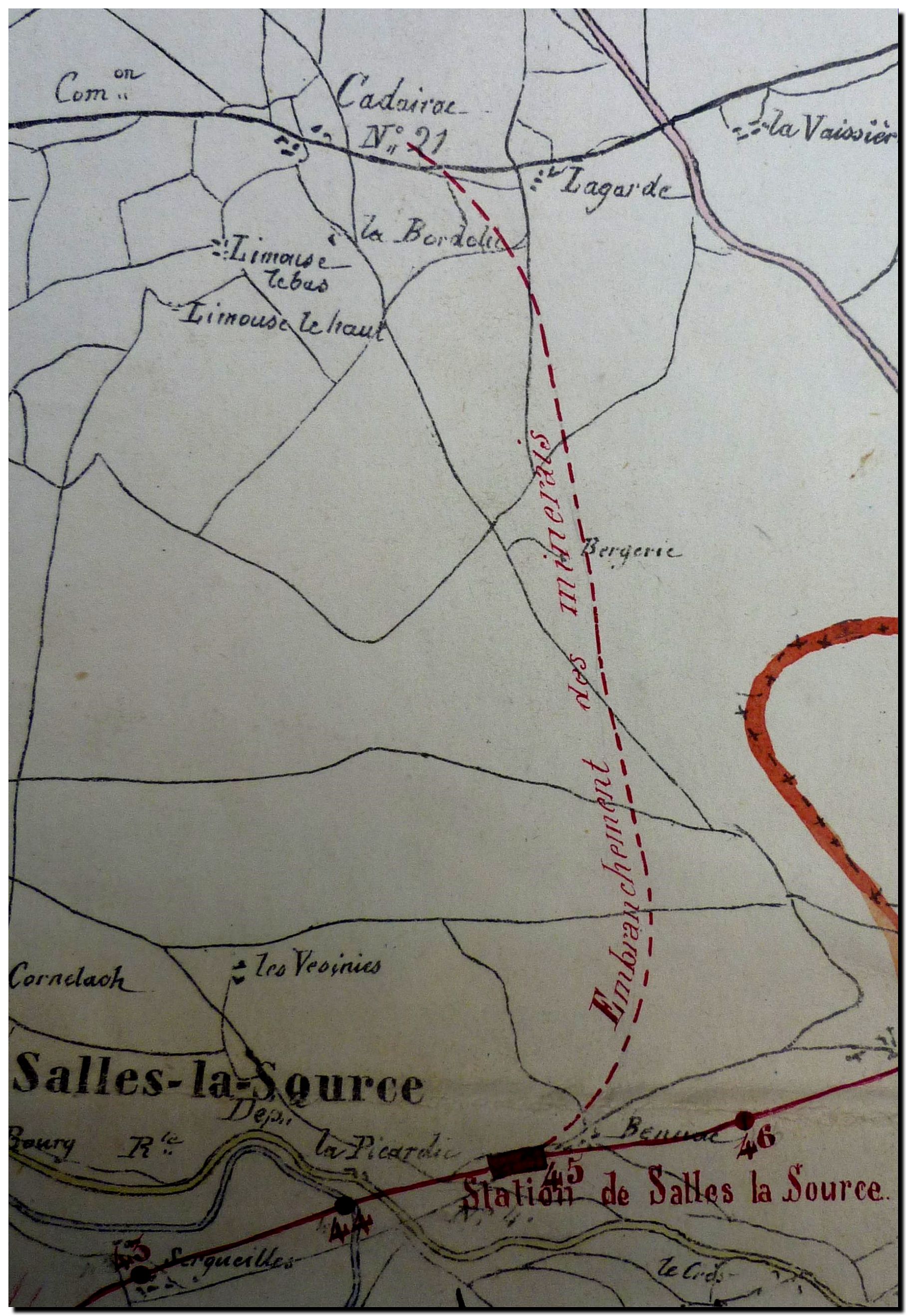
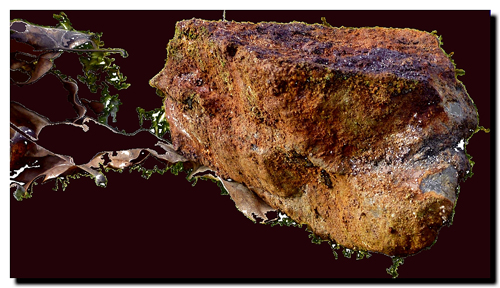
▲Minerai de fer du causse
Le cadre géographique est ici rapidement évoqué, car de faible importance, et quelques éléments géologiques sont donnés. Nous développons ensuite les éléments historiques relatifs à la construction des chemins de fer à voie étroite, avant et après la loi Migneret de 1865. C’est cette loi ou plus exactement son rapport de présentation, qui risquait d’interdire à jamais les voies étroites. La compagnie du PO qui venait de construire le chemin de Lagarde va mener un combat médiatique pour mettre en évidence les avantages de ces chemins à voie étroite, et celui de Mondalazac fut l’exemple partout évoqué. On note que Mondalazac, comme mentionné par la Compagnie d'Orléans a remplacé Lagarde, dans ces discours et rapports. On évoquera ainsi par la suite, reprenant l'approximation faite par Orléans, le chemin de fer de Mondalazac au lieu de Cadayrac. Le rapport du PO, retrouvé, sera analysé et le texte de la loi Migneret donné. Les dessins de matériels de la ligne ne manquent pas de charme, tout comme les trois cartes du tracé qui seront décrites par la suite. En annexe du texte, l’inventaire de quelques archives est repris, permettant de mieux situer l’histoire de cet écartement vraiment atypique dans les préoccupations minières du bassin de Decazeville.
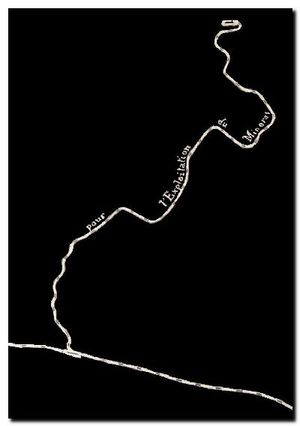
Cadre
géographique
Le cadre géographique est celui de la partie sud des concessions du causse de Mondalazac .
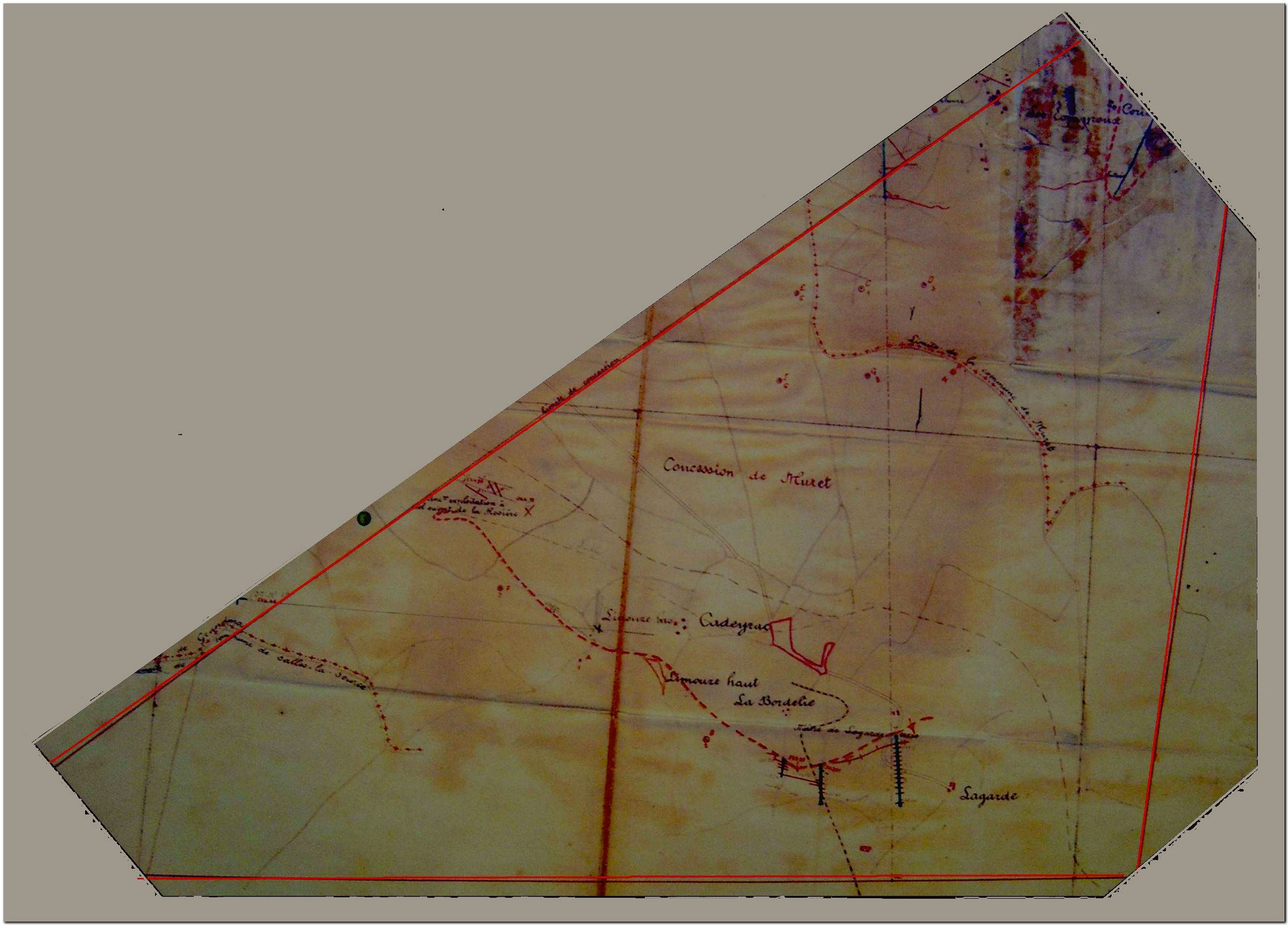
Cette concession dite de Muret est essentiellement constituée des exploitations de Lagarde, au sud de Cadayrac. La carte de 1912 fait également apparaître les anciennes exploitations à ciel ouvert de la Rosière, sans indications de sondages, situées sur l’affleurement indiqué en traits pointillés rouges, à proximité de la limite avec la concession de Mondalazac. (les limites de la concession sont surlignées en rouge sur le cliché ci dessus, doc ASPIBD)
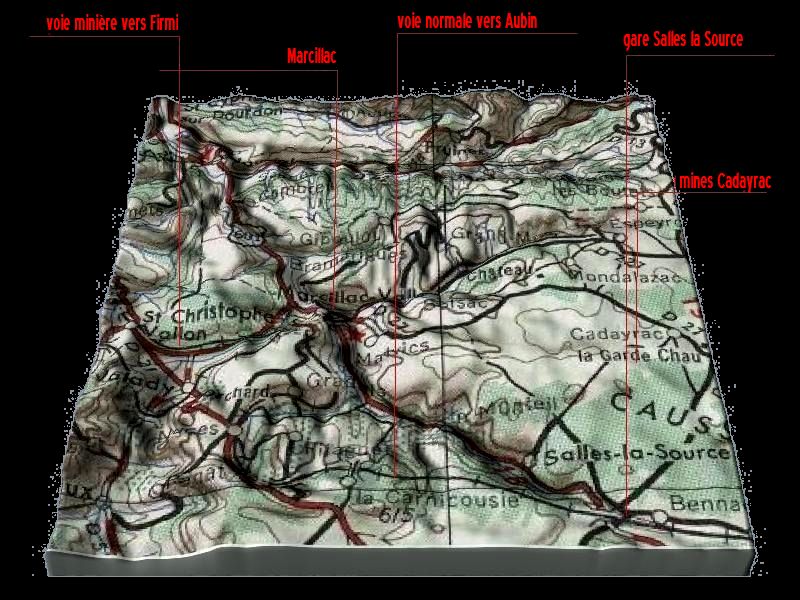
Un peu de géologie,
 L'exposition universelle de Paris en 1867 avait mis l'accent
sur les ressources minérales, et plus particulièrement le fer. Le corps
des ingénieurs des Mines s'était mobilisé pour l'occasion et
avait exposé cartes, documents et échantillons divers. Un rapport
général présentait et analysait ces différents éléments. C'est
ainsi que nous vous proposons la lecture des quelques pages consacrées
au département de l'Aveyron. C'est court, concis, mais l'essentiel
est dit.
L'exposition universelle de Paris en 1867 avait mis l'accent
sur les ressources minérales, et plus particulièrement le fer. Le corps
des ingénieurs des Mines s'était mobilisé pour l'occasion et
avait exposé cartes, documents et échantillons divers. Un rapport
général présentait et analysait ces différents éléments. C'est
ainsi que nous vous proposons la lecture des quelques pages consacrées
au département de l'Aveyron. C'est court, concis, mais l'essentiel
est dit.

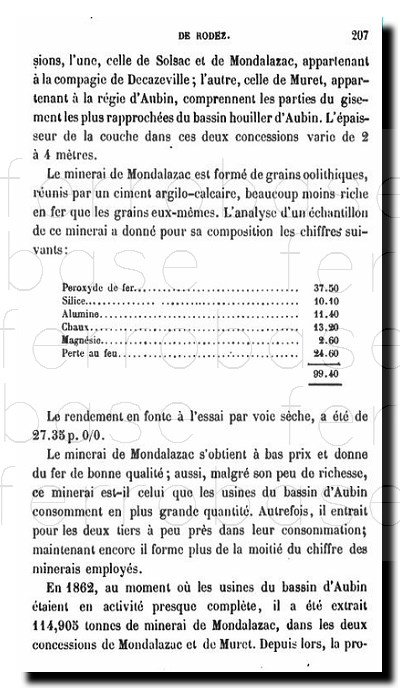
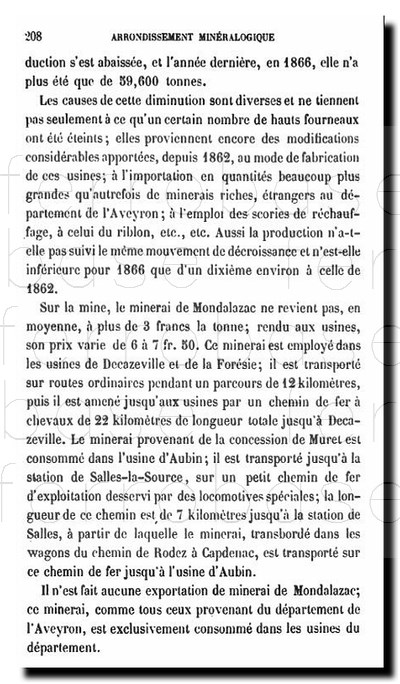
Cadre
historique
Le centre des archives du Monde du travail, archives nationales, présente comme suit le fonds de documents 111 AQ, relatif à Aubin ( Inventaire par I. Brot )
Notice biographique :
La Société minière et métallurgique du bassin d'Aubin, fondée en 1853 par le comte de Morny et le comte Charles de Séraincourt, réunit les apports de plusieurs sociétés minières et métallurgiques en liquidation et a pour objectif principal la fabrication de rails pour les compagnies de chemins de fer, et notamment pour la Compagnie des chemins de fer du Centre. Ces établissements sont ensuite pris en charge par la Compagnie du Grand-Central de France, puis, après le démembrement de cette société, en 1857, par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. Ils sont acquis, en 1882, par la Société des aciéries de France, qui est elle-même absorbée, en 1929, par la Société de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons. Les mines d'Aubin sont nationalisées en 1946, et réunies à celles de Decazeville pour former, à l'intérieur des Houillères du bassin d'Aquitaine, le groupe de l'Aveyron.
Dans un ouvrage très polémique sur la spéculation en bourse - Google books, Proudhon, 1857- on trouve l'inventaire de tous les biens du Grand Central, enfin les locaux :
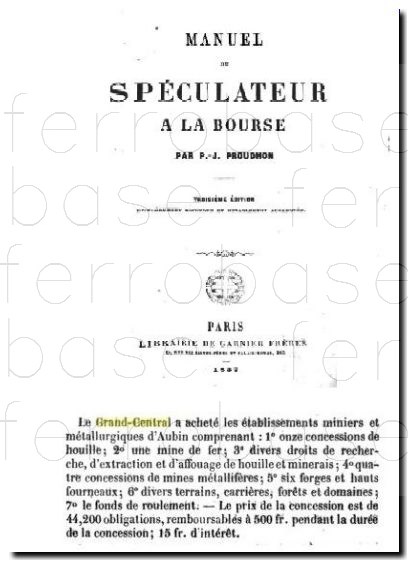
En 1868, la compagnie du Paris Orléans avait voulu prendre la direction des houillères de Decazeville, alors en vente. Le prix atteint aux enchères avait dépassé les limites fixées par les administrateurs. Dans le rapport fait à l'assemblée générale extraordinaire de 1868, le PO regrette que la fusion Aubin Decazeville n'ait pu se faire, et précise que la nouvelle société de Decazeville aura tout intérèt à se rapprocher du PO pour écouler sa production.
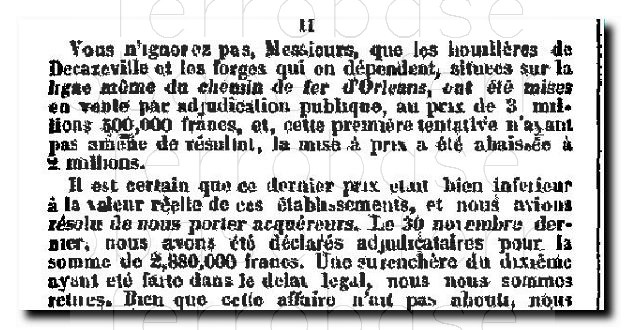
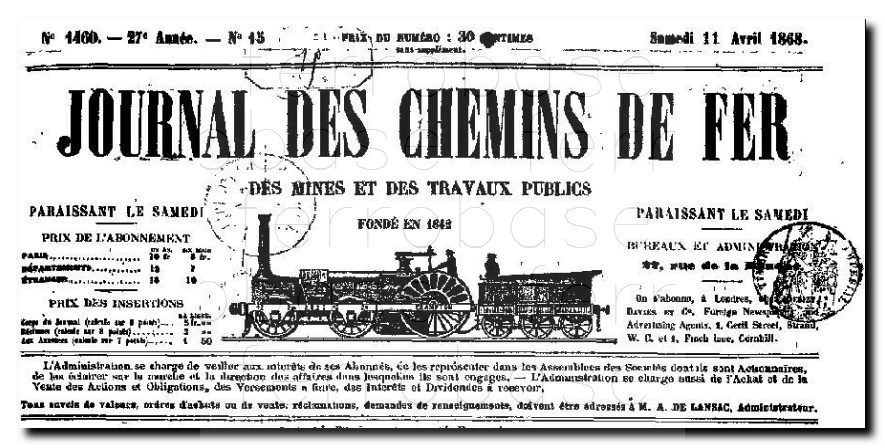
Dans le texte suivant,
un résumé de la situation, le terme Mondalazac doit
quelquefois être
compris comme Lagarde.
" Sous le Second Empire, le P.O, Compagnie Paris Orléans, était propriétaire en régie des usines d'Aubin, dans le bassin de Decazeville, et était concessionnaire d'une mine de fer à Mondalazac, dans l'Aveyron, à une quinzaine de kilomètres au Nord-Ouest de Rodez. Pour faciliter le transport du minerai de la mine à l'usine, le PO construisit en 1861 une très courte ligne de 7 km, allant de Mondalazac à Salles- la-Source, avant-dernière gare précédant Rodez sur la ligne venant de Capdenac. Cette petite ligne était à l'écartement de 1,100 m pour une raison restée inconnue. Tout au plus peut-on supposer qu'il s'agissait de l'adaptation aux normes françaises du fameux écartement anglais de 3 pieds 6 pouces, car 1,067 m (exactement 1,0668) est plus près de 1,10 m que de 1 mètre! Après un début d'exploitation par chevaux, le P.O commanda en 1863 aux Etablissements Gouin deux locomotives du type 020T qui entrèrent en service en 1864. Ce fut un grand succès, dont le retentissement dépassa largement l'Aveyron. La ligne resta minière, bien qu'il ait été un moment envisagé de l'ouvrir au transport de voyageurs en portant son écartement à 1, 200 m. Non seulement ce projet ne fut jamais réalisé, mais en 1882 le PO se déchargea de ses intérêts, tant à Aubin qu'à Mondalazac, et la ligne fut alors définitivement fermée. Or, à partir de 1860, tout le monde en France se préoccupe de compléter le réseau ferré national par des lignes secondaires qui seront dites successivement économiques puis vicinales. Mais les avis des experts divergent. Pour beaucoup, il faut suivre l'exemple de la compagnie de l'Est qui a créé en Alsace un certain nombre de lignes secondaires à voie normale, lignes qui lui donnent toute satisfaction. En revanche, pour d'autres, s'appuyant sur l’expérience du PO à Mondalazac, c'est la voie métrique qu'il faut retenir. La loi du 12 juillet 1865 tranche en faveur des premiers, puisqu'elle impose la voie normale. Malgré les réductions de coût en faveur de la voie métrique, ce sont les problèmes de transbordement de la voie métrique à la voie normale qui ont fait pencher la balance. Après la guerre de 1870, un changement d'esprit va se faire progressivement et, à partir de 1875, les réalisations de lignes à voie métrique, donc à voie de 1 mètre vont se multiplier en France métropolitaine."
Remarque méthodologique
Le contexte général et l’intérêt historique de cette ligne sont donc liés au problème apparemment essentiel de l’époque, vers 1850, 1860 : les voies étroites. Elles ont d’ailleurs pu donner lieu à diverses appellations, comme chemins départementaux, locaux, voire vicinaux, ou chemins de fer économiques, métriques ou secondaires. Tous ces qualificatifs peuvent être justifiés et ne doivent pas être confondus ; ils ne désignent pas obligatoirement les mêmes projets.
Pour introduire le débat, on peut se demander
pourquoi et comment l’écartement dit normal est devenu le standard des
chemins
de fer, 4 pieds, et 8 pouces ½, ce n’est
pas forcément évident ! Tout comme il n’est pas
évident de donner
en quelques lignes les
réponses au
problème : il faut remonter très loin, aux cotés de Stephenson
et des
premiers projets anglais en la matière. Nous n’irons pas plus en avant sur cette question et
préférons aborder le
débat voie normale, voie étroite, dont la ligne de Lagarde fut un
acteur très
médiatisé à cette époque. Vers 1860, le système français des chemins de
fer est
en pleine évolution : les concessions se multiplient, les
projets sont
innombrables, mais pas obligatoirement en Aveyron …la création de la
Compagnie
du Grand Central répond à des volontés financières, Pereire contre
Rothschild,
pour résumer, au risque d’être trop schématique et inexact. Cette
création
permet de résoudre également une difficulté politique et
économique :
donner à quelques départements du centre de la France, dont l’Aveyron,
un accès
aux voies ferrées : ces régions sont en
1850 très défavorisées, pas de grandes lignes en projet,
et aucun
intérêt ou presque de la
part des
grandes ou futures grandes, compagnies : Midi, PO, PLM …Les
résultats à
attendre en termes
de trafic et
transport de marchandises ne sont pas suffisamment attractifs pour
élaborer des
projets. Le Grand Central aura donc reçu mission de
résoudre une équation impossible. On sait que le parcours
de la
compagnie fut bref, très bref même, et les dépouilles
attribuées au PO et au PLM pour l’essentiel. Parmi ces
dépouilles, il y avait Aubin et les mines de Lagarde, donc notre voie
ferrée.
Les voies dites donc locales, devaient -elles donc être à voie normale
ou à
voie étroite ? Un
anglais, Alexander
McDonnell, résume ainsi la situation en France vers 1866.
(http://webird.tcd.ie/bitstream/2262/7059/1/jssisiVolXXXII_319323.pdf
)
traduction:
…L’an passé (c'est-à-dire en 1865), une loi a été adoptée pour développer ce que les français appellent chemins de fer locaux. (il s’agit de la loi Migneret, nous y reviendrons plus loin)…En 1838, il était proposé de réaliser plusieurs lignes dans le département du Bas Rhin, les terrassements et ouvrages étant réalisés en accord avec la loi de 1836, par le Département et les communes . .. L’exploitation serait confiée soit à une compagnie existante, soit à un nouveau concessionnaire. .. Il y a eu un grand délai de réalisation dû au refus de la Compagnie de l’Est de financer la totalité du projet …En 1864 les lignes sont entièrement terminées…La loi de 1865 est ensuite résumée : un chemin de fer d’intérêt local est déclaré d’utilité publique par un décret en Conseil d’Etat, sur rapport du Ministre des Travaux Publics. Les fonds peuvent ensuite être accordés en partie par les départements, en partie par les communes. L’Etat peut fournir une subvention du quart à la moitié des montants accordés par les départements et communes, et la compagnie qui reçoit la concession. L’Etat ne peut donner plus de 6,000,000 de francs par an. Il existe à coté de ce système de chemins de fer locaux, un autre système de chemins de fer à voie étroite, et il n’est pas impossible qu’ils connaissent un important développement. Un rapport sur ces chemins de fer a été publié par MM. Thirion et Bertera dans le Moniteur du 2 juillet 1865. (On verra également plus bas l’importance pour nous de ce rapport, tout comme l’importance de cette date, sachant que la loi Migneret est datée du 12 juillet 1865…) . La première expérimentation en a été faite par la Compagnie du Paris Orléans sur une ligne de 7 kms de longueur, qui relie la ligne principale du PO à Salles la Source, et est utilisée pour un transport de minerai. La largeur de la ligne est de 3 pieds 7 pouces 1/3, et est réalisée avec un rail de 3 livres par yard, les traverses étant placées tous les deux pieds six pouces. Les wagons contiennent environ 4 tonnes, et la ligne est exploitée par des locomotives de neuf tonnes.
L’auteur poursuit ensuite sur les indications financières de coût d’établissement de la ligne, coût de fonctionnement et rapport. Ces chiffres sont repris du rapport Thirion . Il reprend l’une des conclusions du rapport : ce type de ligne peut être réalisé en France, le terme en étant italique dans le texte. Cela veut-il dire que l’expert anglais n’est pas totalement convaincu ? Il conclut son exposé : dans ce bref aperçu des systèmes français de chemins de fer, je n’ai pu faire de comparaison, bien que cela puisse être très intéressant. Il n’y a pas de doute, on peut apprendre beaucoup de la France. (Venant d’un anglais, en 1866, et concernant les chemins de fer, la remarque ne manque pas d’intérêt ! ). Les populations ne sont généralement pas denses, les haltes non fréquentes, et les prix plus faibles que dans notre pays (l’Angleterre) …Cette remarque est également due à l'impossibilité légale à cette époque de réaliser des voies étroites voyageurs en Angleterre, la loi ayant seulement retenue la voie dite normale pour ce trafic.
On retiendra principalement de ce témoignage anglais, que l’expérience comme il est dit du chemin de fer de Lagarde a bien été comprise. Les efforts du PO en ce sens seront soulignés plus loin. Notre chemin a donc été sans doute un des premiers exemples français à suivre par des anglais …
Sur ce sujet des voies
étroites, si l’écartement 4 pieds 8 pouces 1-2 est la norme, la norme
anglaise
étroite fut de 3 pieds 6 pouces, soit 1,067 m. Les réalisations dans
cet
écartement sont très nombreuses (http://www.trains.com/trn/default.aspx?c=a&id=23,
A history of
track gauge ). Les réalisations en voie étroite ont connu un
grand
développement de 13 ans, de 1872 à 1885, avant de chuter.
Un inventaire de voies 3 pieds
6 pouces se trouve sur http://parovoz.com/spravka/gauges-en.php.
Le
bilan est
vraiment
impressionnant ! Vous pouvez également faire une recherche avec
narrow gauge: la variété des écartements dits étroits est grande !
Il y a aussi le cas de la Russie (http://sbchf.narod.ru/voieetr.html ), extraits traduits.
En Russie, la première voie ferrée à traction hippomobile pour le
transport des
minerais fut construite en 1809 dans la région d'Altaï (Sibérie). Elle
eut la
longueur de 1867 mètres et l'écartement de 1067 millimètres. Tout au
long du
XIX-ème siècle, il y avait beaucoup de petites lignes industrielles à
voie
étroite de types divers.
La traction vapeur est apparue
dans
notre pays lors de la quatrième décennie du XIX siècle. Le premier
chemin de
fer à voie étroite, destiné au service commun, a été ouvert en 1871
entre les
gares de Verkhovié et Livny dans la région d'Oriol, au sud de Moscou.
Il eut la
longueur de 62 kilomètres et son écartement fut aussi 1067 mm (3 pieds
6 pouces
anglais). A partir de cette époque, les lignes secondaires à voie
étroite
deviennent assez répandues dans la totalité du pays - en Extrême-Orient
et en Asie Centrale. Certains réseaux avaient une longueur qui comptait
plusieurs centaines de kilomètres. Les plus grands parmi eux furent
ceux qui,
étant séparés du reste du réseau ferré national par le fleuve
Volga,
jouèrent un rôle important pour le développement des territoires
éloignés:
Yaroslavl - Vologda - Arkhangelsk, d'une longueur de 795 km, écartement
de
1067mm, avec la période de construction 1872 - 1898. Elle était
reconstruite
pour la voie large (1520 mm ou 5 pieds, c'est-à-dire le standard russe)
en
1916. Et encore, un réseau même plus vaste, de Pokrovsk (une petite
ville près
de Saratov, au-delà de la Volga) vers Ouralsk avec des embranchements
(la longueur
totale de ces lignes était supérieure a un millier de kilomètres,
écartement de
1067mm).
Un réseau de 1,067 m existe
également sur
l’île
de Sakhaline. On
peut également citer le cas du cable railway de Los Angeles dans cet
écartement, du Japon où c’est quasiment la norme, hors la grande
vitesse, et son importance en
Afrique
du Sud. Pour compléter cette genèse des voies 3 pieds 6 pouces, il est
possible de lire un remarquable article sur
http://www.jrtr.net/jrtr31/f33_sai.html : un expert japonais
explique le choix de son pays pour cet écartement. Pour résumer les
six pages de son texte, c'est l'expérience industrielle du
Festiniog Railway - mais avec un autre écartement de deux pieds- pour
ses transports miniers et sa réussite qui fut le modèle à suivre. Il
est intéressant de noter que c'est ce même Festiniog Railway qui fut à
l'origine, dit-on, du choix de la voie de 66 cm pour Firmi
Marcillac, écartement qui n'était pas en usage sur le
Festiniog Railway. Robert Stephenson avait fait des essais de machines
en 3 pieds 6 pouces, et son emprise sur les chemins de fer était
donc telle qu'il était plus sécurisant pour un constructeur de
lignes de suivre ses préconisations. Accessoirement, une autre
raison que purement économique avait été avancée par les dirigeants du
Festiniog pour le choix d'une voie étroite : une voie normale
existait à proximité des mines. Une mise en place de voies minières à
l'écartement normal aurait pu amener une jonction, et la
disparition du Festiniog au profit de la compagnie des voies
normales...Une variante prudente du chacun chez soi !
La ligne de Lagarde aurait donc bien mérité de
survivre ! Alors
pourquoi cet
écartement, et non un écartement plus rationnel de 1 mètre, le
métrique ? Disons
tout de suite
que la réponse n’est pas immédiate ! Dans les années
1830-1840, en Europe
de l’ouest et donc en France, on utilisait essentiellement des
locomotives
anglaises, ou construites sur des plans anglais. Ce peut être une
raison. Ou
alors, le métrique n’était pas encore traditionnel pour les voies
étroites, ou
Gouin, de culture ferroviaire anglaise,
fournisseur des locomotives, était-il intervenu pour cet
écartement ? Ou l’auteur du projet était-il anglais ? La question reste pour
nous sans réponses …
Il y a aussi le cas de l’Algérie, où quelques centaines de
kilomètres en voie étroite (1, 055) étaient réalisées. L’extension de
ce
réseau avait mobilisé, sur les demandes des militaires, les partisans
du oui à
la voie étroite ; on peut lire dans les Mémoires de la Société
des
Ingénieurs civils, vol 39,1883, 1 er semestre, pages 50 à 85, une
discussion
sur ce problème.
Un
autre rapport très
volumineux, figure en 1882 dans les mémoires (accessibles sur le site
du CNUM,
Cnam), de M. Rousset : l’Algérie et les chemins de fer à
voie étroite. Auguste
Moreau,
très connu dans le
monde ferroviaire de l’époque était contre, et très
fermement ! Les
explications qui justifient cet écartement, apparemment exotique pour
un
français, sont des plus diverses ! On donne par exemple une
moyenne entre
1,45 m et la voie de 0,75 m, pour arriver à 1,10 m ! Pas très
scientifique…Ou il est préconisé de suivre l’exemple de l’Inde et de
l’Angleterre … Au pays du système dit métrique,
en 1882, cela laisse
quelque peu rêveur. Mais en 1882, notre voie
de Lagarde venait
de disparaître des
tablettes.
A défaut
de
comprendre les raisons exactes, si ce n'est donc que parce que
c'était tout simplement dans l'air du temps, qui nous ont amené cette
voie de 1,067 m
ou 1,10
m,suivant la mesure entre axes, ou faces internes des
rails, (le rapport Thirion Berteara, montre des dessins avec un
écartement de 1,10 m face
interne
des rails...) il est important de souligner
l’importance de ce débat voie normale – voie étroite dans le
développement
économique supposé et à venir.
Ernest Chabrier a publié un
argumentaire à destination des agriculteurs de France
en 1877. Il reprend la loi de 1865, pour souligner qu’en
1877, le
monde agricole n’avait tiré aucun avantage particulier de cette loi. Il préconise
l’implantation de voies
étroites, métriques, en
accotements de
routes, et la création de chemins de fer vicinaux. Il cite à l’appui de
ses
conclusions le cas de Mondalazac.
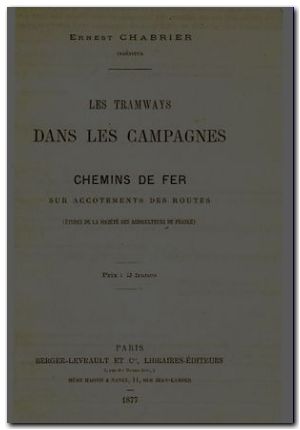
Dans
son traité des chemins de
fer économiques, Opperman en 1873, ne manque pas de donner
également l’exemple de Mondalazac .
Son
traité est disponible sur archive.org. Il reprend le texte de
Thirion pour l’essentiel. Revenons
donc à ces sources, le texte des
ingénieurs du PO eux-mêmes, MM. Thirion et Bertera . Publié en 1865,
début
juillet, et juste avant le vote de la loi, le 12, qui sera ensuite
connue sous
le vocable loi Migneret, ce texte n’est pas autre
chose
qu’un travail de
lobby de la part du PO. Il souhaite pouvoir
monter des projets à voies étroites, ce que la loi en
gestation ne va
pas obligatoirement lui permettre et même lui interdire.
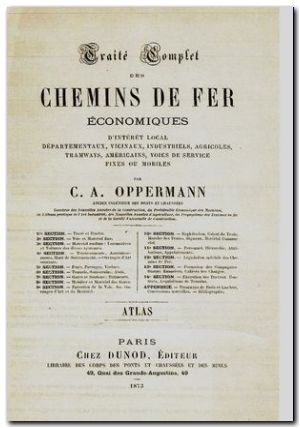
Ce rapport a été
publié chez
Dunod et présente
en 32 pages le cas de
Mondalazac. Des planches de dessins de matériels complètent le texte.
Ce texte
est divisé en deux grands chapitres. Le premier présente les
observations du PO
sur le projet de loi Migneret. Il
est
signé Thirion, Directeur du réseau central de la Compagnie
d’Orléans. Le second
développe le cas de Mondalazac, réseau construit en 1861
par le PO, et
exploité par locomotives dès 1864. Il est signé Bertera, ingénieur en
Chef des
Mines. Il n’y a
pas, hélas, de
plans de situation. Mais ne boudons pas
notre plaisir de parcourir ce rapport, seul
et premier document à notre connaissance présentant la
voie de Salles la
Source à Lagarde. Extraits
choisis.
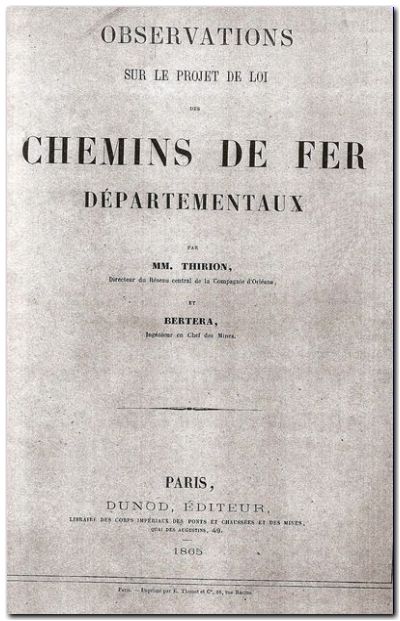
OBSERVATIONS sur
le Projet de Loi des
CHEMINS
DE FER DEPARTEMENTAUX
Le conseil d'Etat est saisi d'un
projet de loi sur les chemins de fer départementaux dont le but est de
favoriser la création d’un ensemble de lignes secondaires destinées à
rattacher
successivement aux grandes artères les divers centres de population
placés
aujourd'hui en dehors du réseau principal.
Le rapport pose en
principe que le réseau des grandes voies touche à son terme, que les
lignes
principales restant à construire pour en combler les dernières lacunes
sont en
petit nombre, et que le complément,de l'œuvre doit être accompli par
des
embranchements généralement établis en plaine sans traverser soit les
grandes
vallées, soit les chaînes de montagnes de manière à éviter les
occasions de
dépenses considérables. La création de ces embranchements économiques
serait
dévolue aux départements et aux communes, et pourrait être facilitée
par des
subventions du trésor public. Construits et exploités, dans les mêmes
conditions que les lignes du réseau principal, ils seraient soumis aux
mêmes
règlements de police et à la même juridiction.
Le rapport constate
que l'expérience de ce système a été faite dans les départements
alsaciens avec
un plein succès. Trois chemins de fer d'embranchement, ayant ensemble
79
kilomètres d'étendue, ont été établis de Strasbourg à Barr et
Vasselonne, de
Haguenau à Niederbronn, et de Schlestadt à Sainte-Marie-aux-Mines. La
dépense
par kilomètre s'est élevée à 40522 francs pour l'assiette ou
infrastructure du
chemin de fer, et à 76 778 francs pour la pose de la voie, ses
accessoires et
le matériel roulant.
La Compagnie de
l'Est, qui s'est chargée de l'exploitation, pense que la recette brute s'élèvera à 10000
francs par
kilomètre. Quant aux frais d'exploitation, on estime qu'ils ne seront
pas
inférieurs à 6000 francs par kilomètre.
Ces dispositions ont
été reçues avec une approbation unanime, et le succès obtenu en Alsace
est un
gage des heureux résultats qu'elles sont appelées à produire. Seulement
il est
permis de se demander si la loi projetée aura toute la portée qu'on en
attend,
en d'autres termes si l'on parviendra à créer, dans les conditions
indiquées,
une étendue de lignes secondaires suffisante pour
répondre aux besoins du pays.
Si la voie et le
matériel doivent coûter 76 000 francs, et si les frais d’exploitation s'élèvent à 6 000 francs
par kilomètre, il
est clair qu'il faudra un produit brut de
10 000 francs au moins par kilomètre pour payer les frais
et couvrir les
intérêts de la
portion du capital
d'établissement qui doit être avancée par un concessionnaire.
Reste-t-il
aujourd'hui beaucoup de directions non desservies
qui soient on état de produire 10 000 francs par
kilomètre ?
On en trouvera sans doute encore en Alsace, en Normandie, dans les
départements
du Nord, dans la sphère immédiate d’attraction des grands
centres ; mais
dans la majorité des départements et notamment dans tout l'espace
occupé par ce
qu’on appelle aujourd'hui
le Réseau Central de la
Compagnie d'Orléans,
il ne faut pas
l’espérer. L’exploitation successive des tronçons
de ce réseau nous a donné sur ce point des
enseignements irrécusables, et si nous prenons ces résultats pour base,
nous
sommes portés à croire qu’en faisant l’inventaire des lignes
secondaires
réclamées et attendues dans les départements, on en trouvera un très grand nombre dont le
produit n’atteindra
pas, ou du moins ne dépassera pas 6 à 7 000 francs par kilomètre,
Quant à la partie des dépenses
d’établissement qui, dans le système du projet, doit être à la charge
des
départements avec le
concours
facultatif de l’Etat, il est également important de ne pas se faire
d’illusions. Pour
les trois chemins exécutés en Alsace,
elle a été en moyenne de 40500 francs par kilomètre. C’est
un prix
exceptionnellement bas. Le rapport dit bien qu'on se
tiendra soit dans
les vallées, soir sur les plateaux;
mais il faut bien savoir que toutes les vallées ne sont pas droites et
ouvertes, et tous les plateaux d'un parcours facile. En s'astreignant à employer le matériel du
grand réseau, on
contracte des obligations incompatibles avec le bon marché
absolu. Le rayon des
courbes, par exemple,
peut bien être abaissé dans certains cas particuliers jusqu'à 200 et
même
jusqu'à 180 mètres, mais généralement on ne descendra pas sans
inconvénient
au-dessous de 300 mètres, et alors pour peu que le tracé ait à suivre
un défilé
ou à se développer sur des flancs de coteau quelque peu accidentés, les
travaux
prendront une importance considérable. Le poids et les dimensions du
matériel
roulant des grandes lignes imposeront, en outre, des sujétions
onéreuses pour
la construction des ouvrages d'art. Nous croyons être dans le vrai en
affirmant
que la dépense d'établissement de l'assiette du chemin de fer sera
rarement
inférieure à 60 000 francs par kilomètre et qu'elle ira souvent, même
dans les
conditions indiquées par le rapport, au-delà de 100 000 francs.
Il y a encore une
circonstance favorable qui a contribué puissamment au succès des trois
tronçons
exécutés en Alsace: c'est que tous trois ont pour point de départ une
station
principale, Strasbourg, Hagueneau, Schlesladt. On a trouvé là des
dépôts de
machines et des voies de service toutes préparées. Quand, au contraire,
les
embranchements devront partir des stations intermédiaires, il arrivera
de deux
choses l'une, ou que l'on sera obligé de créer un dépôt et des voies de
service
spéciales, ou que les trains partiront d'une station éloignée du point
de
bifurcation et auront à parcourir en pure perte un espace plus ou moins
considérable. Les dépenses d'établissement dans le premier cas, et les
frais
d'exploitation dans le second, se trouveront augmentés dans une
proportion
notable.
Ces considérations
nous paraissent établir assez clairement que s'il faut pour arriver à
la
création des chemins de fer départementaux réunir les conditions qui
l'ont
rendue possible en Alsace, c'est-à-dire un terrain assez facile pour
que l'assiette
du chemin de fer ne coûte pas plus de 40 à 50 000 francs par kilomètre,
et un
trafic assez important pour donner un produit brut de 10 000 francs
par
kilomètre, les occasions seront en petit nombre et les effets de la loi
plus
bornés qu'on ne le pense. Il est probable que plus de la moitié des
départements se trouveraient à peu près exclus du bénéfice de la
nouvelle loi.
Doit-on, s'il en est
ainsi, renoncer à donner plus d'extension au réseau des chemins de
fer ? Sur
les points où ne se trouveront pas réunies les difficiles conditions
qui
viennent d'être énumérées, se contentera-t-on définitivement des
chemins
ordinaires et renoncera-t-on à jamais à l’emploi de la vapeur? A notre
avis ce
serait une faute. Il existe certainement un grand nombre de centres de
population, surtout de centres secondaires d'industrie, tels que
forges, mines
de houille et de fer, ardoisières, etc., qui, sans pouvoir donner un
trafic
correspondant à 10000 francs de produit annuel ont cependant besoin
d'un moyen
de transport plus sûr, plus exact et plus puissant que le roulage, et
il n'est
pas douteux qu'il importe à la richesse publique de le leur procurer le
plus
tôt possible. Ce moyen, c'est l'établissement de chemins de fer à
dimensions
réduites, coûtant infiniment moins et pourvus d'un matériel plus léger
qui,
sans mécanisme compliqué, se prête à circuler dans des courbes de 100
et au
besoin de 60 mètres de rayon. De cette manière, les dépenses de voie et
de
matériel seront infiniment diminuées et la portion des dépenses
tombant à la
charge des départements et des communes s'éloignera à peine de ce
qu'elle est
aujourd'hui pour l'établissement soit des routes départementales, soit
des
chemins vicinaux de grande communication.
La question envisagée à ce point de vue,
soulève immédiatement deux objections considérables. On dit que
l’adoption
d’une voie réduite romprait l’unité du réseau, que le transbordement forcé au point de
rencontre avec les grandes
lignes en paralyserait l’usage. On se demande en même temps comment,
sur des
lignes isolées et d’une étendue restreinte, on parviendrait à
entretenir le
matériel et à organiser l’exploitation.
Il n’est pas douteux, lorsqu’il s’agit
de lignes composant un réseau et se faisant suite les unes aux autres,
que la
sujétion du transbordement ne soit inadmissible. Lorsque le chemin de
fer
badois avait une voie différente de celle
du reste de l’Europe, c’était un contre sens. Mais
lorsqu’on en vient à
de simples embranchements ou à des lignes sans prolongements prévus, la
question
perd son caractère absolu. Ce n’est plus qu’une affaire de
chiffres ; il
ne s’agit plus que de se rendre compte des frais et des retards réels
résultant
de l’opération de transbordement et de savoir si les uns et les autres
ne sont
pas largement compensés par les avantages résultant d’un établissement
moins
dispendieux et d’une exploitation plus économique.
La Compagnie d’Orléans s’est trouvée en
situation de faire à ce sujet une expérience intéressante. Comme
propriétaire
des établissements d’Aubin, elle est concessionnaire d’une exploitation
de
minerai de fer sur le territoire de la commune de Mondalazac. Le
transport par
voiture des produits de cette exploitation, sans compte l’inconvénient
d’un
prix de revient très élevé, était une source d’embarras continuels.
C’est un
fait qui n’étonnera aucun de ceux qui ont l’expérience de ces sortes
d’affaires. La
minière principale se
trouvant à 7 kilomètres de la station de Salles la Source, il
s’agissait de
décider si l’on construirait un embranchement avec la grande voie et
les rails
ordinaires de manière à pouvoir se servir du matériel du grand réseau,
ou bien
si l’on adopterait une voie réduite et un matériel spécial. Le conseil
inclinait pour le premier moyen. Cependant des calculs très simples
démontrèrent
tout de suite que l’établissement des voies de garage nécessaires au
point
d’embranchement d’une part, et d’un autre coté les frais d’entretien
d’une
machine en permanence dans une petite station éloignée du dépôt
principal
conduiraient à des résultats très peu économiques. On se décida pour un
chemin
de fer à section réduite,avec rails de 16 à 17 kilogr. Et matériel
spécial. Ce
chemin a été exploité pendant trois ans avec des chevaux. Il l’est
depuis un
peu plus d’un an avec des locomotives. Les résultats de ces deux modes
d’exploitation sont consignés dans un rapport de M. L’Ingénieur en Chef Bertera que nous avons
fait transcrire à la
suite de cette note. Il répond directement aux deux objections
principales que
nous venons de signaler.
Cette petite ligne a 7 kilomètres de
longueur. Les rayons de courbure varient de 40 à 100 mètres.
L’inclinaison
maxima est de 12 millimètres. La voie a 1,10 m de largeur. Elle est
formée de
rails Vignoles éclissés pesant 16 kilos ½ par mètre courant et posés
sur traverses
en chêne espacées de 75 centimètres. Le matériel roulant se compose de
70
wagons à minerai, portant chacun 3800 kilogrammes, et de 2 locomotives
à 4
roues couplées, pesant un peu plus de 9 tonnes. L'écartement des
essieux est de
1 m40. Le matériel circule sans difficulté dans les courbes de 60 et 75
mètres,
et même au départ dans une courbe de 40 mètres de rayon. La voie
s'entretient
avec facilité. Elle n'est protégée par des clôtures que dans l'étendue
correspondant à une tranchée profonde à parois verticales. Il n'y a pas
de
barrières à la rencontre des chemins qui, à la vérité, sont peu
fréquentés.
L'établissement de
l'infrastructure, y compris le ballast, a coûté 21 500 francs par
kilomètre; le
matériel de la voie et l'installation des embarcadères, 12 000 francs;
le
matériel roulant, 16 850 francs.
Le
matériel roulant
était calculé pour un transport annuel de 80,000 tonnes. Par le fait de
circonstances imprévues, le mouvement effectif a été réduit à une
moyenne de 40
à 50 000 tonnes. Malgré cette circonstance défavorable, le prix du
transport,
qui était de 0f,20 au moins par tonne et par kilomètre, est descendu à
0f,075
pendant la période d'exploitation à traction de chevaux. L'emploi des
locomotives a produit immédiatement une nouvelle économie. Dans les six
derniers mois de l'année 1864, période à partir de laquelle la marche
peut être
considérée comme régulière, le prix du transport est descendu à
0f,042,entretien de la voie compris ; et si l'on considère seulement le
mois
de
décembre pendant lequel le mouvement s'est élevé à 4000 tonnes, ce prix
s'est
abaissé jusqu'à 0f,033.
Le transbordement du
minerai à la station de Salles-la-Source, c'est-à-dire le déchargement
sur le
quai, 1a reprise et le chargement dans les wagons du grand réseau, est
payé à
forfait 17 centimes par tonne. Comme le chemin ne transporte pas quant
à
présent d'autres marchandises, ce résultat ne saurait être généralisé;
mais
l'extrême bon marché du transbordement dans le cas particulier des
minerais,
autorise à conclure que l'opération, en définitive, ne saurait être
bien
coûteuse quelle que soit la nature de la marchandise.
L’entretien des
locomotives et des wagons se fait jusqu'à présent sur place sans
difficulté.
Lorsqu'il y aura des réparations majeures à faire aux locomotives, il
est
évident qu'on les mettra sur un truck et qu'on les expédiera soit au
constructeur, soit au plus prochain atelier du grand réseau.
La dépense totale
d'exploitation s'est élevée pour six mois à 5 334f,26, ce qui
représente pour
l'année entière 10 670 francs, soit 2 124 francs par kilomètre. Cette
somme eût
été à peine augmentée si la masse des transports, au lieu d'être
restreinte,
par suite de circonstances imprévues, à 3 000 tonnes par mois, avait
été
doublée
conformément aux prévisions. Il en résulte que si le chemin de
Mondalazac
était une entreprise industrielle indépendante, il suffirait d’un
tarif de 8
centimes par tonne et kilomètre pour couvrir les frais d'exploitation
et les
intérêts à 5 p. 100 de la totalité du capital engagé.
Tels sont les faits
qui ressortent directement de l'expérience faite par la Compagnie
d'Orléans.
Cette expérience n'est pas complète puisque le chemin de fer exploité en ce moment ne transporte
ni marchandises
variées ni voyageurs; mais il est possible,
jusqu'à un certain point, de prévoir par induction les
résultats
probables d’une exploitation qui
serait
faite avec des moyens analogues, mais dans des conditions plus
générales. C'est
ce que M. Bertera a fait avec autant de précision qu’il est possible
d’en apporter
dans une étude de ce genre.
Il a pris pour
premier exemple une ligne de 35 kilomètres d'étendue destinée à
desservir un
groupe d'usines et de carrières de pierre, existant aujourd'hui dans un
des
départements de l'Est et sollicitant vainement depuis plusieurs années
le
secours indispensable
d'une voie de
transport perfectionnée. Le tonnage actuel correspond à 20 150 tonnes,
sur un
parcours moyen de 21 kilomètres dans un sens, et 138 500 tonnes sur 13 kilomètres dans l'autre
sens. Afin de
pouvoir transporter les plus grosses
pièces fabriquées
dans les usines et
les plus forts échantillons des carrières, il conviendrait
de porter la largeur de la
voie à 1 m,20, le
poids des rails à 20 ou 2 1 kilogrammes et
celui des machines à 12 tonnes 1 /2. Le rayon minimum des
courbes ne
devrait pas, sauf des cas tout à fait exceptionnels, être inférieur à
80
mètres. Quant aux pentes, elles ont de 10 à 12 millimètres dans un sens
et de 5
millimètres seulement dans l’autre.
Dans ces
conditions,M. Bertera trouve que l’infrastructure du chemin de fer peut
être
évaluée à 32 000 francs, le matériel fixe à 19 000 francs et le
matériel
roulant
à 15 000 francs, soit ensemble 66 000 francs par kilomètre. En
supposant
un tarif
de 10 à 12 centimes par tonne, suivant la nature des marchandises, la
recette
brute s’élèverait à 5 583 francs et la dépense d’exploitation et
d’entretien à
2 600 francs, laissant ainsi un bénéfice net de près de 3 000 francs
par
kilomètre.
Pour peu que
l’établissement du chemin de fer développât le trafic, on voit que le
produit
net couvrirait l’intérêt de tout le capital engagé.
M. Bertera a examiné
enfin, mais cette fois d’une manière abstraite, le cas le plus général,
celui
d'un chemin destiné, non seulement au transport des marchandises mais encore à celui des
voyageurs par trains
réguliers.
Matériellement, le
problème ne présente pas de difficulté. Nous avons fait établir pour la
voie de
1,20 m un projet complet de voitures à voyageurs à 3 compartiments,
contenant
30 places des dimensions réglementaires. Ces voitures montées sur
essieux
écartés de 1 m, 60, circuleraient sans obstacle dans les courbes de 80
mètres
de rayon. Leur prix s'élèverait à 4 400 francs environ pour 3
compartiments de 3
ème classe, et 4 800 francs pour 2 compartiments de 3 ème et 1
compartiment de 2
ème classe.
M. Bertera suppose
une ligne de 25 kilomètres devant satisfaire aux besoins d'une
circulation
moyenne de 120 voyageurs par jour et de 40 000 tonnes de marchandise
par
année,
susceptible conséquemment de donner, à raison de 7 centimes par
voyageur et 10
centimes par tonne de marchandise, un produit brut total de 7 000
francs
par
kilomètre. En admettant 6 trains réguliers dans chaque sens, M. Bertera
trouve
que le matériel devrait être composé de 6 locomotives, 25 voitures à
voyageurs,
40 wagons couverts et 60 wagons découverts, coûtant ensemble 51 0000
francs,
soit 20 400 francs par kilomètre. Le matériel de la voie restant, comme
dans
l'exemple précédent, évalué à 19 000 francs, la dépense totale à la
charge des
concessionnaires, dans le système de la loi, s'élèverait à 40 000
francs
en
nombre rond. Les frais d'exploitation sont évalués à 4 620 par
kilomètre, en
supposant que la vitesse en marche n'excède pas 30 kilomètres à
l'heure, qu'il
n'y ait pas de service de nuit et que la recette des voyageurs soit
faite
généralement par les conducteurs des trains. Il resterait, en
conséquence, un
produit net de 2 380 francs, soit l'intérêt à 6 P 100 du capital à
fournir par
les concessionnaires.
Cet ensemble de
faits et de calculs démontre, d'une manière incontestable, que les
chemins de
fer à petite section sont appelés à rendre des services dans un certain
nombre
de cas où l'établissement de la grande voie n'est pas possible. Il
semble, dès
lors, qu'il serait contraire à l'intérêt public de ne pas les admettre
au
partage des dispositions libérales de la nouvelle loi. Le texte même
du projet
ne dit pas d'une manière formelle que les chemins de fer départementaux
auront
nécessairement la grande voie et le matériel semblable à celui du
réseau
principal, mais le rapport est tout à fait explicite sur ce point, en
sorte que
l'intention n'est pas douteuse. C'est cette condition exclusive qu'il
importe
de faire disparaître. Si le transbordement et les autres inconvénients
qu'on
peut opposer à la petite voie sont regrettables, la privation absolue
l'est
encore bien davantage. Il convient donc de laisser le choix aux
intéressés,
l'administration conservant d'ailleurs, son droit absolu d'accorder ou
de
refuser les autorisations. Lorsque les conditions locales seront
suffisantes
pour l'adoption de la grande voie, ainsi que cela s'est présenté en
Alsace,
elle obtiendra la préférence. Ce sera le fait des départements riches
et des
terrains faciles. Au contraire, lorsque les revenus probables
atteindront à
peine la moitié de ce que les embranchements d'Alsace paraissent
appelés à
produire, ou lorsque les tracés avec courbes de 300 ou 200 mètres de
rayon ne
pourront pas être établis économiquement, il restera la ressource d'une
voie
moins puissante, sans doute, mais,incomparablement supérieure, quoi
qu'on
puisse dire, aux voies ordinaires. Les départements pauvres ne seront
pas
entièrement déshérités.
La modification à
faire subir au projet de loi est extrêmement simple. Il suffit d'un
paragraphe
additionnel déclarant applicable aux chemins de fer à petite section
les
dispositions des articles 2, 3,4, 5 (1) et 7, c'est-à-dire de ceux qui
sont
relatifs à la déclaration d'utilité publique, aux expropriations, et
enfin au
concours financier des départements, des communes et de l'Etat.
Quant à
l’article 6 qui
soumet les chemins de
fer départementaux aux dispositions de la
loi du 15 juillet 1845, il y a une distinction à faire.
Les embranchements à
grande voie, comme ceux d'Alsace, se trouveront liés
d’une manière si intime au réseau principal qu'il est
difficile
de croire que leur exploitation puisse être soustraite à la loi
commune, Sauf
les modifications indiquées dans l’article
précité, il est probable que ces embranchements suivront
le sort des
lignes principales sous le double rapport des mesures
de police et des tarifs.
Les chemins à voie
étroite ne sont pas dans le même cas. Deux circonstances essentielles
les
distinguent: l'isolement résultant du transbordement forcé au point de
contact
avec le réseau, et la lenteur relative de la marche des trains. La
première, en
séparant nettement les deux exploitations, permet d'admettre pour les
embranchements des conditions de tarifs et d'organisation entièrement
indépendantes. La seconde autorise la suppression de la majeure partie
des
précautions imposées aux lignes principales dans l'intérêt de la
sécurité
publique.
Il faut donc, à
notre avis, deux règlements différents : l'un pour les embranchements à grande voie qui se rapprochera
plus ou moins
de l’ordonnance du
15 novembre 1846 ; l’autre qui s’en éloignera le plus possible. L’exploitation des
embranchements de voie
étroite doit en effet ressembler aux services de messageries plus qu’à
celui
des grandes lignes de chemin de fer. Une limite supérieure pour le
tarifs,
l’obligation de ralentir la marche au passage des chemins, celle
d’entretenir
convenablement le matériel, tels sont à peu près les seuls points où
l’intervention administrative semble nécessaire. En dehors de ces
conditions
nous voudrions une liberté entière,
et
pour la construction et pour l’organisation du service et pour
l’exploitation
commerciale.
Nous émettons, en conséquence, un double
vœu. Nous demandons premièrement que la voie étroite ne soit pas exclue
du
bénéfice de la nouvelle loi, et en second lieu, que le règlement à
intervenir
pour l’exécution de cette loi établisse une distinction entre les
embranchements à grande et petite voie et laisse à ceux-ci la plus
grande
liberté sous tous les rapports.
(1) L'article 5 du
projet était ainsi conçu:
« Lorsque, pour la
construction desdits chemins, il y aura lieu de recourir à
l'expropriation, il
sera procédé conformément aux dispositions de l'art. 16 de la loi
précitée du
21mai 1836, sauf les modifications ci-après:
« Les membres du
jury spécial ne pourront pas être choisis
parmi les jurés domiciliés dans le canton où
sont situés les terrains à
exproprier.
Le tribunal
d'arrondissement, en prononçant
l'expropriation, désignera l'un de ses
membres pour présider et diriger
le jury.
Ce
magistrat aura voix délibérative. »
Le corps législatif
a repoussé ce
système, en sorte que les
expropriations ne pourront être suivies
que dans la forme prescrite par la loi du 3mai 1841. Nous
regrettons que
la proposition n'ait pas été adoptée au moins pour les embranchements à
petite
voie.
La loi de juillet 1865, dite Migneret, n’est pas longue, nous la donnons ci-dessous in-extenso. Lorsque le projet de loi fut envoyé au Conseil d’Etat, le rapport concluait à l’adoption exclusive de la grande voie. Le conseil de la Compagnie pensa qu’il était intéressant de faire connaître à l’administration les résultats de l’exploitation du petit chemin de fer de Mondalazac, résultats qui lui paraissaient établir assez clairement que, dans un certain nombre de cas, la voie étroite pouvait être employée avec avantage. Une note fut adressée dans cette intention à S.E.M. le Ministre des travaux publics et, avec son autorisation, communiquée à M. le comte Dubois, rapporteur de la loi au conseil d’Etat.
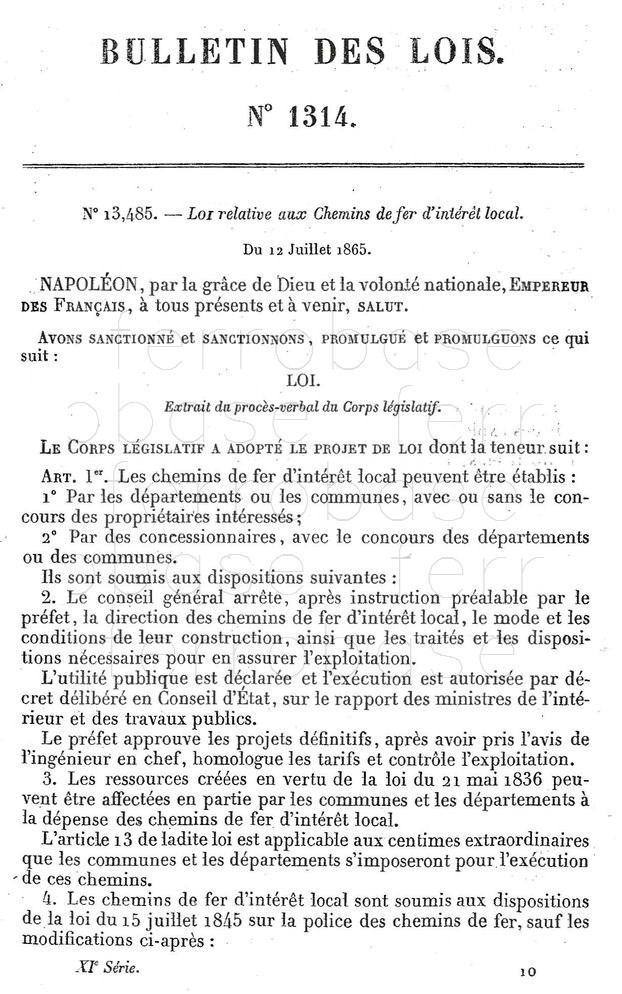
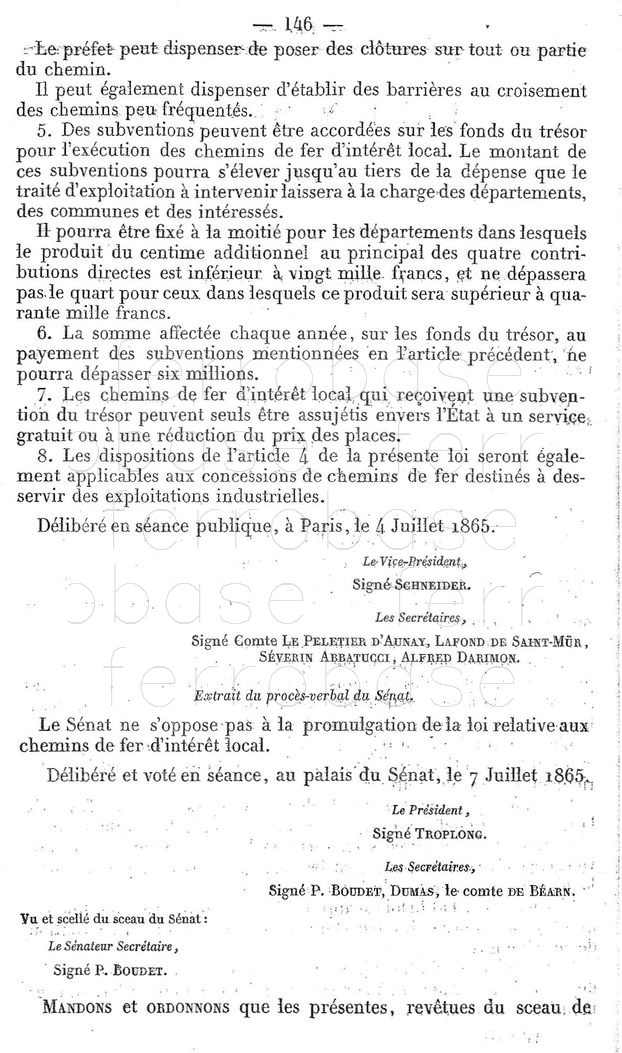
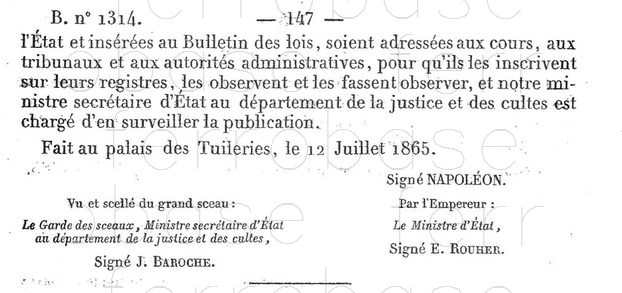
Ce rapport du PO
est donc le document de
référence pour ce sujet. On apprend d’ailleurs qu’un projet complet,
voie et
matériels, exploitation …, pour un écartement de 1,20 m a été
étudié,
écartement apparemment
plus viable pour
un transport mixte, marchandises et voyageurs. Cette étude ne
concernait
évidemment pas seulement notre chemin de Lagarde, et même peut-être pas
du
tout. Mais il en fut l’élément justificatif du PO. Mais la même
question se pose
alors : pourquoi
donc 1,20 m, aussi atypique que 3 pieds 6 pouces ? Les
motivations de ces
écartements semblent bien étranges…
Le rapport Thirion Bertera présente
également de magnifiques planches de matériels.
Nous en reprenons
certaines, utiles pour nos cheminements. Mentionnons auparavant que Vauquesal Papin, bien
connu des
anciens ou
actuels
lecteurs de La Vie
du Rail a publié un article sur le chemin de fer de Mondalazac. Cet
article
reprend en fait le texte de Thirion, et donne quelques vues de
matériels. Il
n’ajoute pas d’informations sur le sujet, mais peut-être une
imprécision sur le constructeur, imprécision reprise par la
suite...

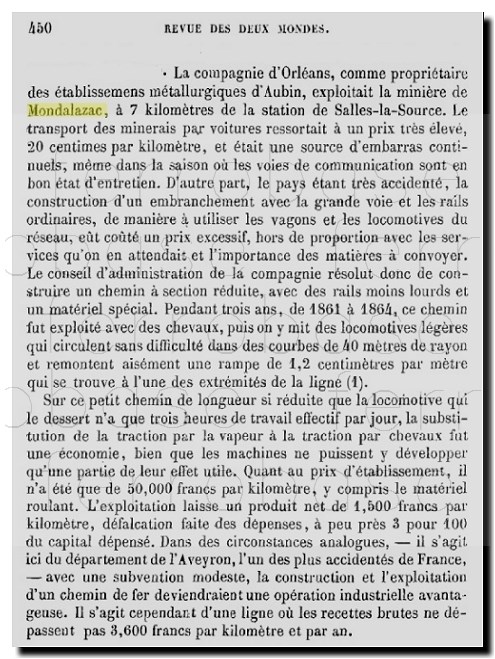
Planches
Thirion
Bertera
La
voie.
Profil type en travers, en tranchée et en remblai. Sur le profil en tranchée, fig 1, on notera la sur largeur destinée au passage du conducteur lorsque la traction était faite par chevaux : la ligne fut en effet exploitée ainsi de 1861 à 1864.
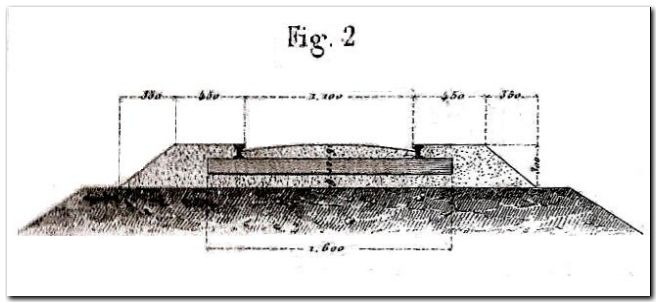
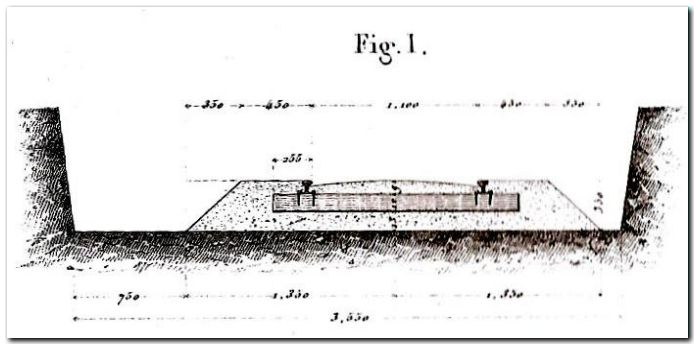
▲ Voie de Cadayrac,
planches in Thirion,
Bertera, Observations sur le projet de loi des Chemins de fer
départementaux, Dunod, Paris, 1865
On retient de ces schémas une largeur d’emprise égale à 1,10 m + 2 * (0,35 + 0,45 m), soit 2, 70 m, largeur apparemment minimale, et 3,55 m en déblais. On reviendra sur ce détail dans l’analyse du parcours. On peut également donner pour la voie ce schéma de fixation des traverses.
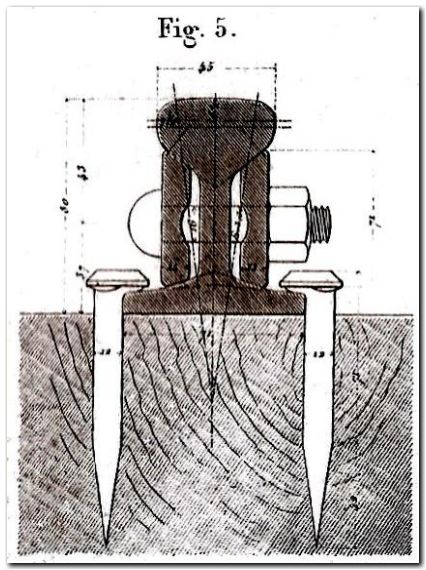
Le matériel roulant est également présent sur ces planches. La locomotive, dont le constructeur n'est pas indiqué sur les explications hors texte, y figure. A écartement de 1,10 m, deux figures sont présentées, dont une coupe transversale montrant la disposition des ressorts de suspension. La description suivante en est donnée, et nous conservons intégralement l’orthographe…
Locomotive du chemin de Mondalazac pour voie de 1,10 m (à l’intérieur des rails).
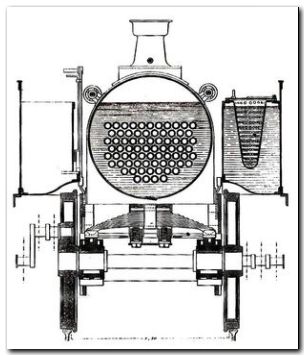
Le poids de cette machine vide est de 9500 kil. ; chargée, elle pèse environ 12 000 kil.
La surface de chauffe directe est de 3 mq, celle des tubes de 23 mq,500 ; soit 26mq,500 pour la surface totale. Le diamètre des cylindres est de 0m,240 ; la course des pistons est de 0m,400. la machine est timbrée à 8 atmosphères. Sa puissance de traction est de 1000 à 1100 kil. L’écartement des essieux étant de 1m,400, cette machine circule facilement dans les courbes de 75 mètres de rayon, et peut passer dans les courbes de 40 mètres. Après les chiffres, voici le dessin, une vraie rareté à savourer !
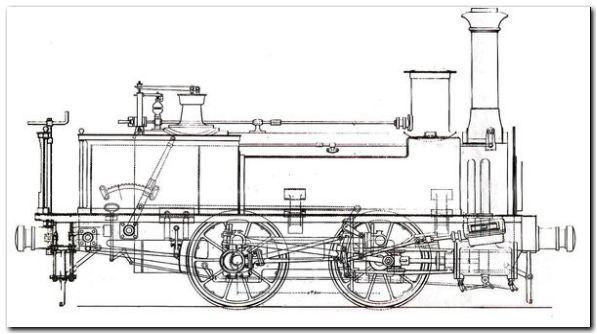
▲ Voie de Cadayrac,
planches in Thirion, Bertera, Observations sur le projet de loi des Chemins de fer départementaux, Dunod, Paris, 1865
Des recherches ultérieures nous permettent (enfin ! ) de proposer avec quelques certitudes le nom du constructeur. Il s'agit de A. Poynot et Cie, du coté d'Anzin, près de Valenciennes. Ce mécanicien avait également ouvert des ateliers à Montluçon.
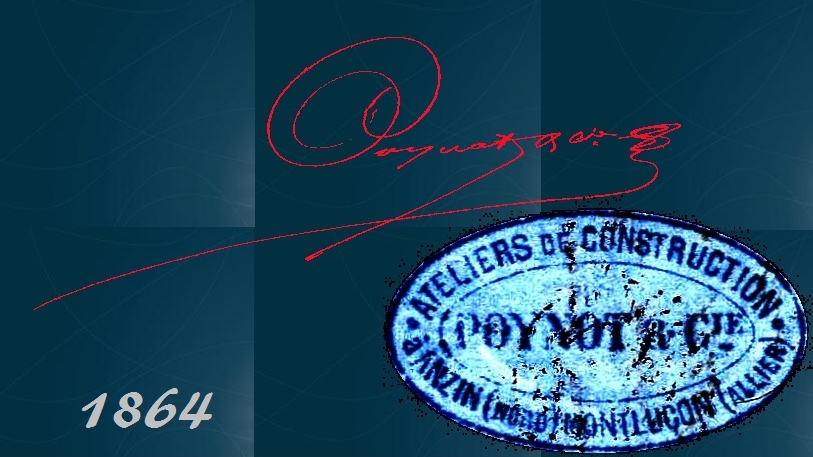
Le 22 mai 1864, le Préfet de l'Aveyron autorisait la circulation de ces machines. MM. Thirion et Bertera précisent mars 1864 comme date de début d'utilisation. Le Directeur de la régie d'Aubin avait demandé cette autorisation le 30 janvier 1864, pour deux machines tender. L'autorisation préfectorale, sous la forme d'un permis de circulation, nous apporte les compléments techniques suivants :
- capacité de la chaudière cylindrique, dôme de vapeur compris : 0,804 m3; timbre de 8 atmosphères.
- machines à cylindres extérieurs
-diamètre cy lindres 0, 24 m, course des pistons 0,40m
- charge de chaque train : 30 à 60 T
-
vitesse ordinaire : 12 à 13 km/h, 5 km/h aux passages à niveau (nombre
7)
-conduite par un mécanicien, un chauffeur et un serre frein
- les wagons à minerai seront freinés
- de nuit, marche à vue, 10 km/h maximum, et présence de falots et réflecteurs puissants
- composition de chaque train: 24 wagons au plus
- poids moyen locomotive à vide 9T, et 12 T chargée
Le constructeur Poynot, à Anzin, est - très - rarement cité dans la littérature, et les informations sur le matériel construit sont elles, rarissimes! La bibliothèque de l'Université Pierre Marie Curie, Jussieu, propose un texte, Mémoire sur les mines de Ronchamp, 1881, par Mathet. Ce texte évoque Poynot, et la description des caractéristiques d'une locomotive de 1865. Les données sont très proches des locomotives de Cadayrac, mais pas absolument identiques. Voici ces données, à titre d 'information.
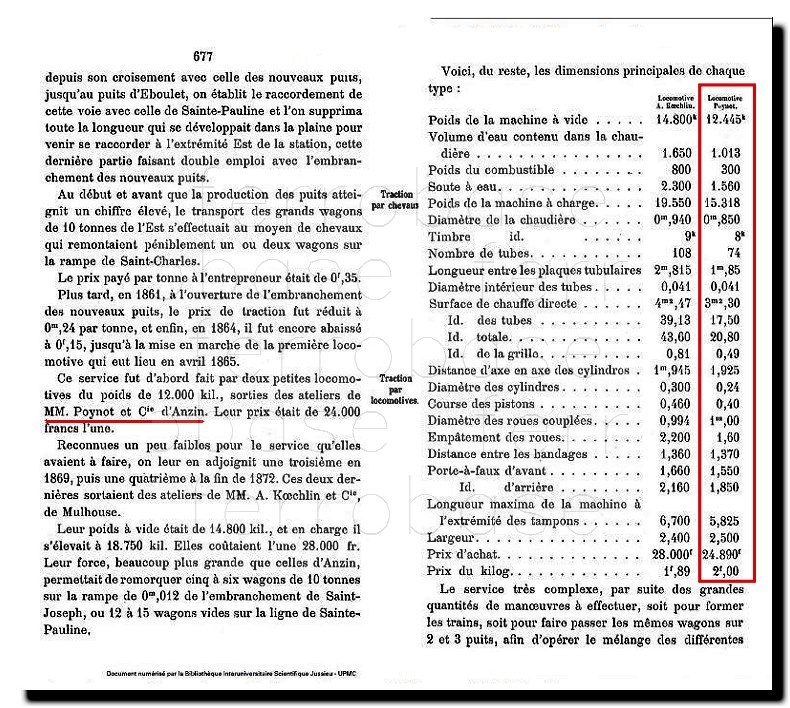
Une dernière précision : A. Poynot et Cie installé à Anzin, le
fut également nous l'avons dit à Montluçon, en 1866. En 1869 le
constructeur mécanique fut repris par la société J. Dubois et Cie... En
1868, lors de la construction du tunnel ferroviaire du Lioran,
Poynot sera concerné pour "fourniture
et installation de machines" (123 345 fr.) (Nouvelles annales de la construction,
C.A.. Oppermann, 17 ème année, janvier 1871).
Le rapport Thirion présente des planches de matériel pour voie de 1,20 m. Nous les donnons sans leurs explications qui figurent dans le texte originel, mais en se souvenant qu’elles auraient bien pu parcourir le causse …
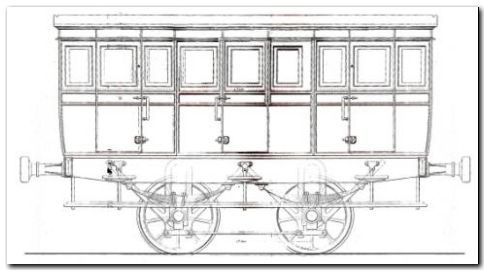
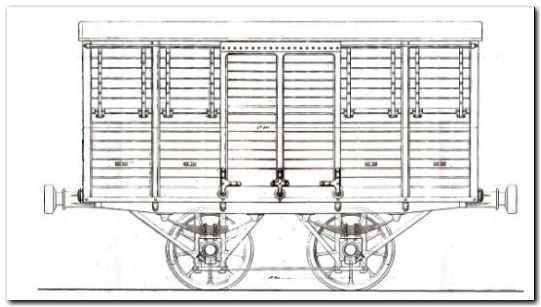
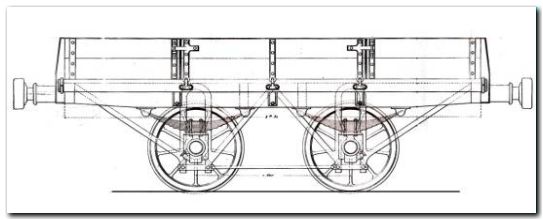

▲ projet pour voie de 120,
planches in Thirion, Bertera, Observations sur le projet de loi des Chemins de fer départementaux, Dunod, Paris, 1865
On retiendra des explications de texte, que pour ce qui concerne le bon roulement des wagons sur une voie aux rayons faibles, une roue peut être rendue folle sur son essieu, disposition très originale et peu courante dans les chemins de fer qui avait été appliquée avec succès sur le matériel de 1,10 m de Mondalazac .
Le site Hathi Trust Digital Library (www.hathitrust.org) est, comme son nom l'indique, une bibliothèque ; une bibliothèque numérique, et plus précisément une base de données à laquelle participent 25 universités américaines. Parmi les 4.463.271 volumes répertoriés qui représentent 3 626 tonnes de papier en octobre 2009 (curieuse idée que de donner l'information dans cette unité !), vous trouverez le rapport Thirion Bertera. Cadayrac est une référence sérieuse ! Malheureusement les planches n'ont pas bénéficié d'une numérisation correcte...Mais à découvrir si vous souhaitez lire le rapport dans son intégralité.
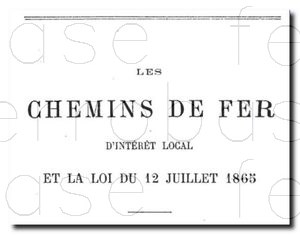 De
nombreuses autres sources évoquent le train de Cadayrac. La Revue
Contemporaine a publié en 1866 un travail important sous la signature
de Emile Level, qui sera plus tard à la tête de la société des chemins
de fers économiques. Travail important, en deux parties, pages 308-347
et 509-542. Important par le volume, et remarquable à notre sens dans
l'exposé. La première partie présente la genèse de la loi de 1865, avec
l'action du préfet Migneret en Alsace, en analyse les termes, et
articles, et dégage des pistes d'application dans le futur. Dans
le deuxième volet, Level présente une analyse très technique de
la construction des chemins à voie étroite. On retrouvera bien sûr le
rapport Bertera et Thirion, mais pas seulement. A lire donc sans
tarder : sur Google Books, (clés de recherche, pas très évidente
( ! ) : mondalazac, puis cliquer sur l'ouvrage: revue
contemporaine
p 525). Il n'y a pas d'images, mais l'effort sera récompensé ! On
pardonnera à l'auteur d'avoir un peu rapidement lu le rapport
Bertera, en citant la ligne à voie étroite d'Aubin
à Salles la Source...
De
nombreuses autres sources évoquent le train de Cadayrac. La Revue
Contemporaine a publié en 1866 un travail important sous la signature
de Emile Level, qui sera plus tard à la tête de la société des chemins
de fers économiques. Travail important, en deux parties, pages 308-347
et 509-542. Important par le volume, et remarquable à notre sens dans
l'exposé. La première partie présente la genèse de la loi de 1865, avec
l'action du préfet Migneret en Alsace, en analyse les termes, et
articles, et dégage des pistes d'application dans le futur. Dans
le deuxième volet, Level présente une analyse très technique de
la construction des chemins à voie étroite. On retrouvera bien sûr le
rapport Bertera et Thirion, mais pas seulement. A lire donc sans
tarder : sur Google Books, (clés de recherche, pas très évidente
( ! ) : mondalazac, puis cliquer sur l'ouvrage: revue
contemporaine
p 525). Il n'y a pas d'images, mais l'effort sera récompensé ! On
pardonnera à l'auteur d'avoir un peu rapidement lu le rapport
Bertera, en citant la ligne à voie étroite d'Aubin
à Salles la Source...
Un dernier exemple de citation de la voie de Cadayrac. L'exposition universelle de Paris de 1867 donnait bien sûr aux chemins de fer la place qu'ils méritaient. Dans le rapport officiel, lors de l'évocation des chemins à voie étroite, nous retrouvons notre ligne, citée en bonne position, entre la Norvège et le Mont Cenis ! On pardonnera également ici à l'auteur, Flachat, une grande signature dans ce domaine, d'avoir confondu Mondalazac et Cadayrac, le PO et Decazeville...
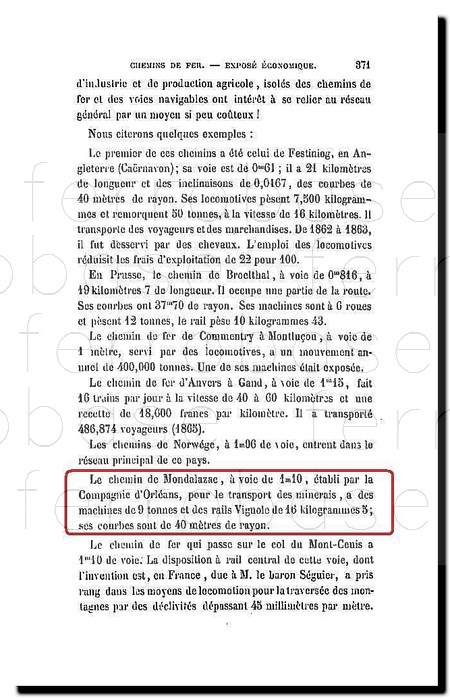
Le tracé de la ligne
Pour mémoire, est-il utile de
préciser que rien ne figure sur la carte IGN, si on excepte
un court
passage en tranchée :
difficilement repérable sur la carte, il
ne permet pas au premier abord de découvrir un ancien
tracé de
voie pour qui consulte la carte à des fins de promenade…et pourtant …
Le
tracé de cette courte ligne, Cadayrac – Salles la
Source figure sur l’Atlas Cantonnal
(sic) de l’Aveyron, dressé par MM. 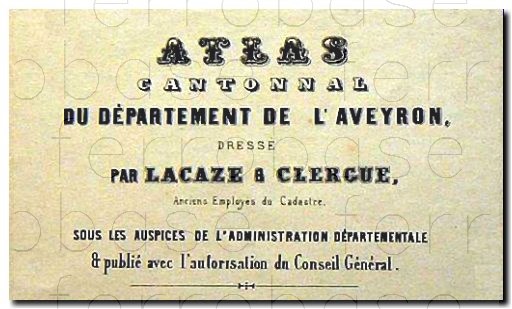 Lacaze et
Clergue, et publié en
1858, donc
juste avant le début d’exploitation de la ligne. Il s’agit peut-être
alors du
projet de ligne et ce tracé a pu être modifié par la suite ;
le
remplacement des
chevaux par les
locomotives 020 T peut en être la raison. Mais il n’y a pas de
certitudes
sur la modification après la tranchée des Vézinies, le profil des
remblais,
actuellement inadapté à une voie de 1,10 m et leur non-achèvement
posent
quelques questions…certaines sans réponses. C’est à première vue le
constat qui
peut être fait. Cette carte a été publiée, mais dans un format très
réduit,
dans le volume Marcillac de la collection Al Canton, mais là aussi,
c’est un
travail d’archéologue pour découvrir le tracé ! Nous vous
l'offrons donc, à partir d'un atlas original, à une échelle plus
adaptée: elle le mérite !
Lacaze et
Clergue, et publié en
1858, donc
juste avant le début d’exploitation de la ligne. Il s’agit peut-être
alors du
projet de ligne et ce tracé a pu être modifié par la suite ;
le
remplacement des
chevaux par les
locomotives 020 T peut en être la raison. Mais il n’y a pas de
certitudes
sur la modification après la tranchée des Vézinies, le profil des
remblais,
actuellement inadapté à une voie de 1,10 m et leur non-achèvement
posent
quelques questions…certaines sans réponses. C’est à première vue le
constat qui
peut être fait. Cette carte a été publiée, mais dans un format très
réduit,
dans le volume Marcillac de la collection Al Canton, mais là aussi,
c’est un
travail d’archéologue pour découvrir le tracé ! Nous vous
l'offrons donc, à partir d'un atlas original, à une échelle plus
adaptée: elle le mérite !
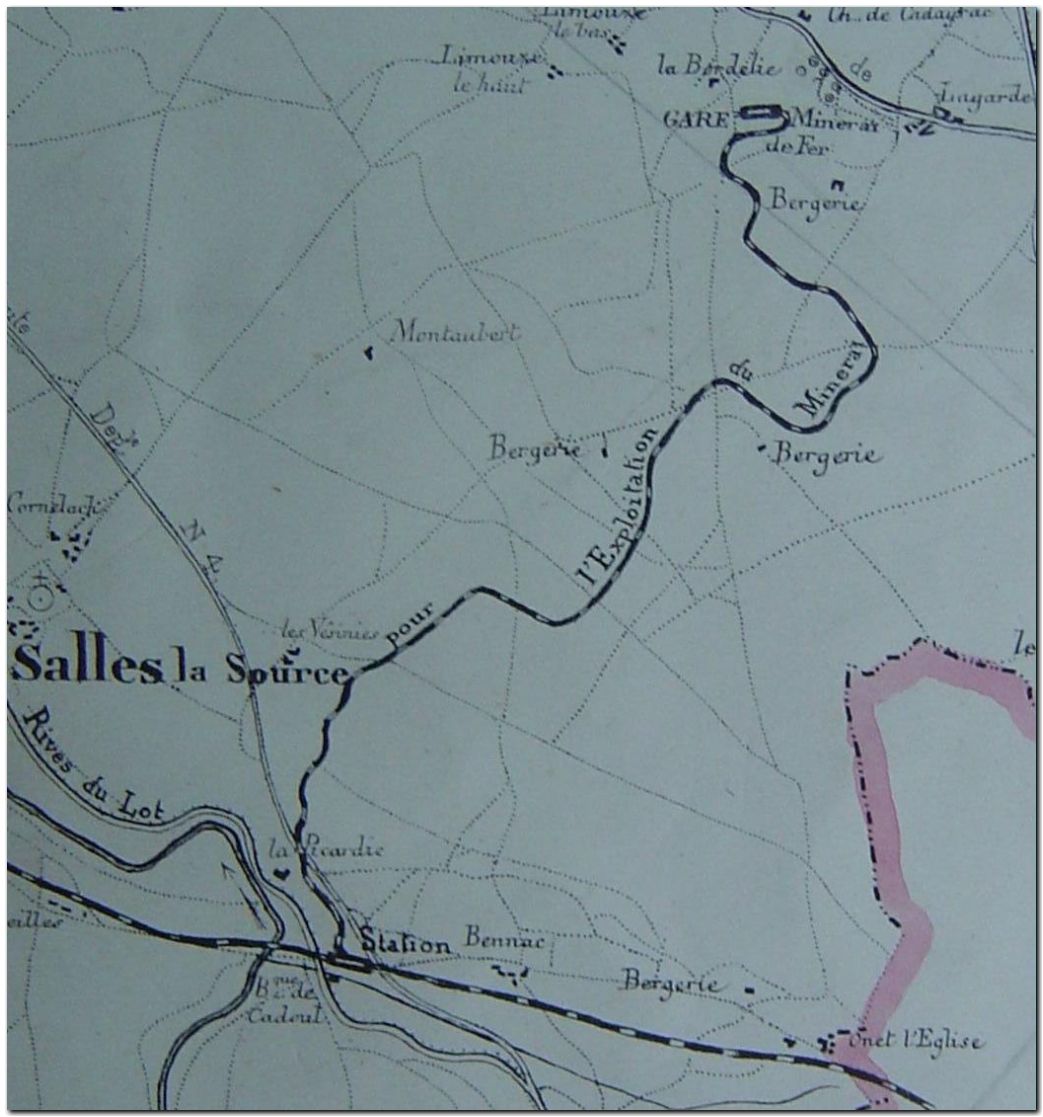
Telle quelle cette carte peut déjà permettre une reconnaissance de terrain efficace ! L’ « Atlas cantonnal » peut être consulté par exemple aux Archives Départementales de l’Aveyron à Rodez. Il ne prétend pas à une précision particulière, mais c’est bien une rareté que cette carte mentionnant ce tracé. Le départ se situe près du lieu dit La Picardie, point de transbordement avec la ligne à voie normale Aubin Rodez. Point positif sur la carte, le tracé des chemins. A l’aide des cartes et photos aériennes actuelles, il est parfaitement possible de reporter ce tracé. Il est important également de noter la date, 1858, de parution de l’Atlas. Le PO précise pour sa part que le projet a vu le jour en 1861. Il s’agit donc probablement sur cette carte du projet de voie, très certainement repris des projets du Grand Central, qui avait la main sur la concession et les installations d’Aubin. Il est également possible que ce soit un tracé réel, repris et modifié par le PO quelques années plus tard. Ces remarques étant faites, l’essentiel du tracé nous est donc maintenant connu.
Pour information, la destination finale du minerai est donc vers Aubin . Un embranchement existait à cette époque sur la voie du PO de Rodez à Montauban, via Aubin.
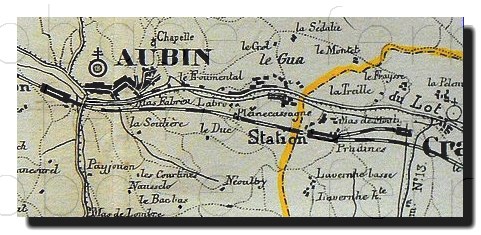
La
carte de la paroisse de Cadayrac
* On trouvera ailleurs sur ce site (ici ► atlas-paroissial.html ) la présentation d'un autre exemplaire de
cette carte de l'Atlas paroissial de Mgr Bourret.
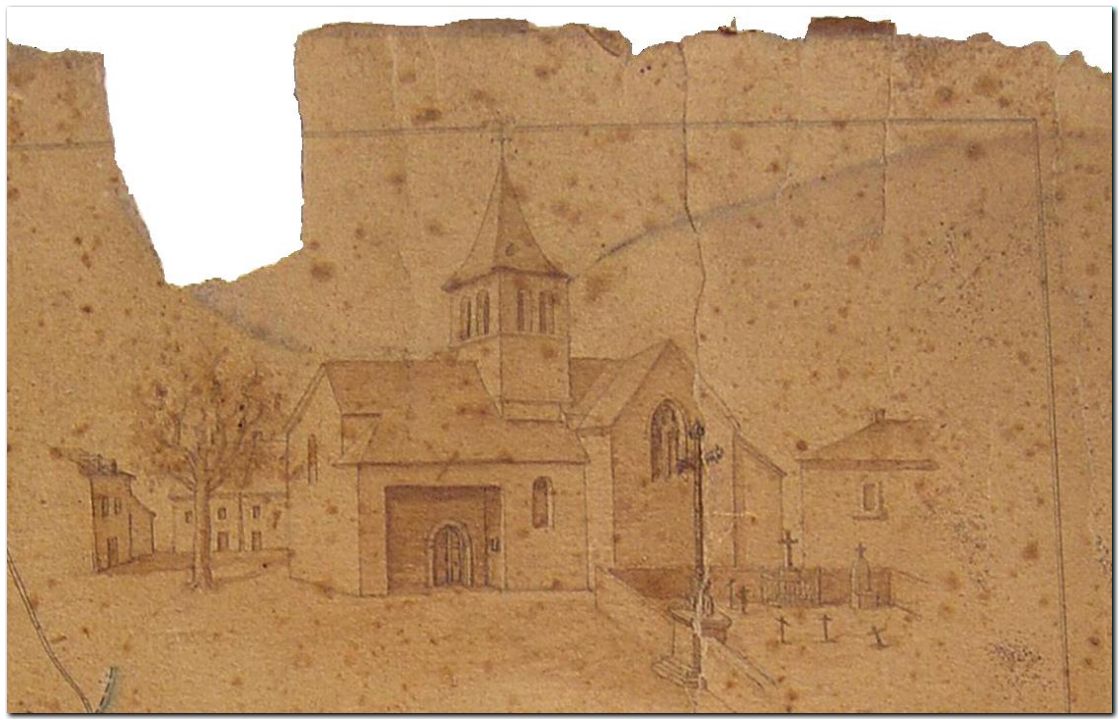
Le tracé de la ligne y figure, et il est permis de penser que ce tracé est, lui, absolument réel, 17 ans donc après l’ouverture de la ligne. La carte donne également une échelle, en bas de la planche. Un texte de présentation figure à droite du tracé.
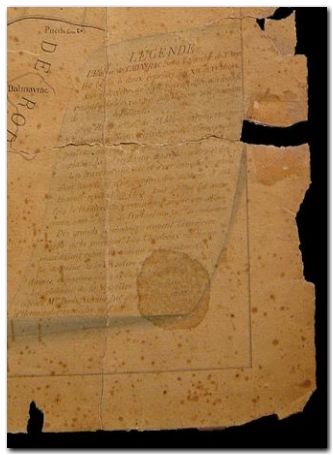
Texte
L’église de CADAYRAC sous le vocable de St Ama (ns) fut bâtie à deux reprises au XIV et XV siècles.
Son intérieur de style ogival offre des motifs remarquables ; sa nef suffit pour une paroisse de … (non indiqué)…. habitants.
Son étendue est de 24 kilom carrés : c’est un causse magnifique occupé par des champs, des prairies, des bosquets qui … (déchiré)………. des plus agréables. Le sol renferme de riches mines de fer.
Les traces d’une voie et d’un camp romain, d’un temple et d’un cirque, des dolmens et des tumuli révèlent les faits dont ce lieu fut autrefois le théâtre.
On y remarque encore un abîme connu sous le nom de Tindoul de 45 m de profondeur.
Des grands domaines occupent la majeure partie de la paroisse. Les Chartreux de Rodez possédaient celui du château de Cadayrac, 1717. Le domaine de la Veyssière et ses vastes dépendances appartenait aux Cisterciens.
Le château de la Veyssière a un portrait du célèbre Monseigneur Denis Antoine Luc Frayssinous évêque d’Hermopolis ministre de Charles X.
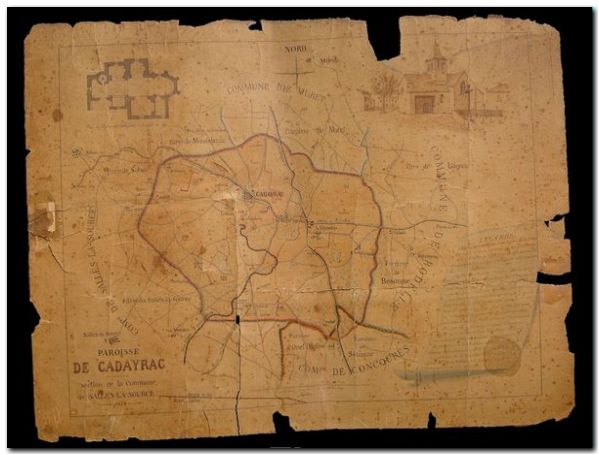
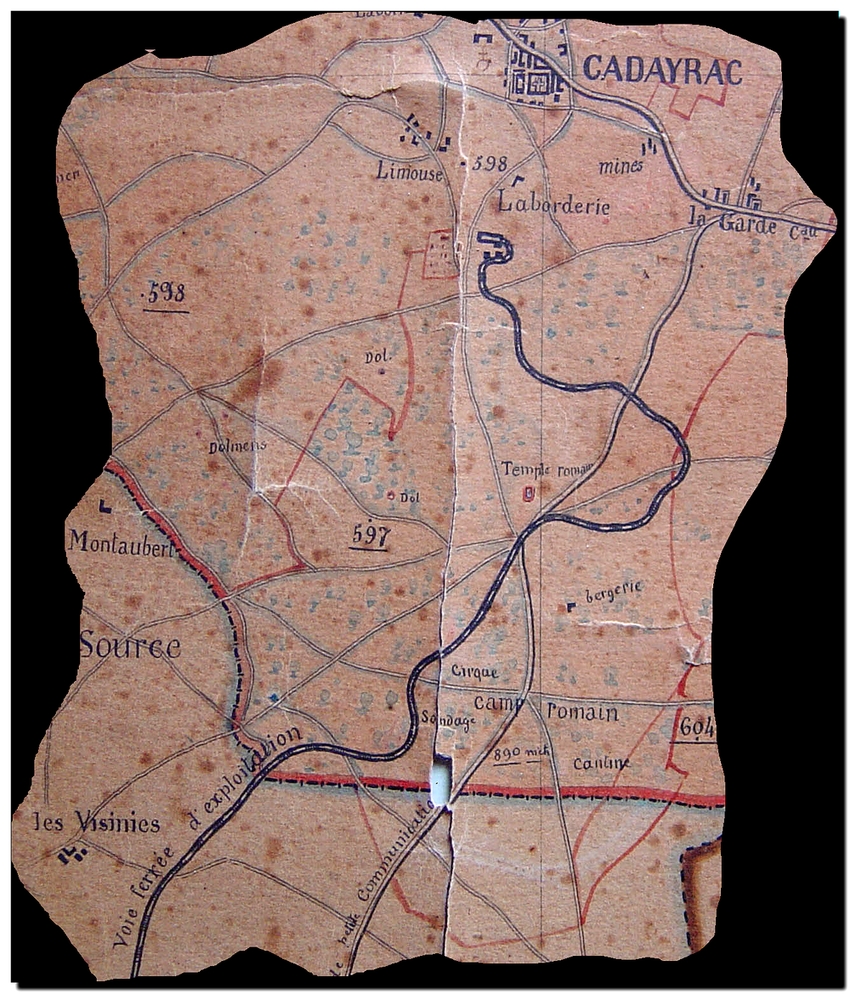
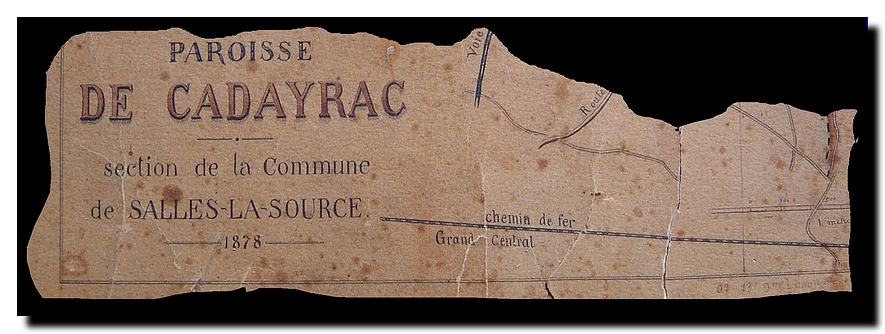
On peut donc penser à comparer les deux tracés ; les difficultés apparaissent, car, si le tracé cantonal est superposable à la carte IGN, après mise à l’échelle, ce travail n’est pas possible pour la carte paroisse ; la carte ci-dessous présente une superposition en rouge du tracé cantonal sur la carte IGN actuelle. Ce document permet un repérage correct sur le terrain. Parmi les interrogations, on remarque qu’à la sortie de la tranchée, et en arrivant à Puech Hiver, le tracé ne se prolonge pas vers les remblais que l’on peut retrouver sur le terrain et de toute évidence destinés à la voie. Ce tracé semble donc être soit un projet, modifié par la suite, soit une première version du tracé destiné entre 1861 et 1864 à la traction animale.
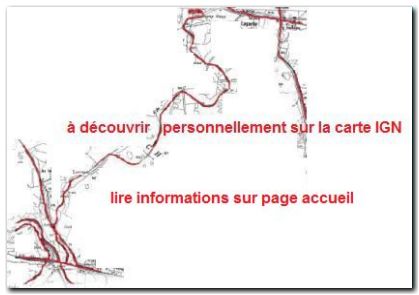
La carte paroissiale par contre n’est pas superposable dans son ensemble à la carte actuelle, et semble plus approximative. En décomposant le tracé en deux tronçons, un sud, et un nord, on constate que le tronçon nord reprend à très peu de choses près le tracé de 1858.
Par contre le tronçon sud semble bien mettre en évidence un passage par les remblais de Puech Hiver, et les tranchées de part et d’autre. Est-il possible d’être absolument affirmatif ? Un calcul rapide des volumes de la tranchée et des remblais rend ce passage plausible…Un détail, amusant : sur cette carte de 1878, la ligne de Rodez est indiquée comme Grand Central ; cette compagnie était déjà, à cette date, digérée par le PO et le PLM…Quelle hypothèse faire sur cette permanence du Grand Central en 1878 ? Près de 20 ans après sa disparition ? Pour essayer d'être complet, on peut préciser que l'axe Brest Toulon portait également le nom de Grand Central, ainsi que la partie intéressée du réseau du PO. Autre question, sans réponse très évidente. Le profil en travers de la voie montre une largeur à minima de 2,60 m, et beaucoup plus avec les banquettes d’appui du ballast. Or le haut des remblais de Puech Hiver est très loin de fournir, en 2008, cette largeur …On peut en déduire un certain nombre de conclusions. Ces remblais n’existaient pas à l’origine de l’exploitation : comment faire passer la voie, le cheval et le conducteur ? Un exercice sûrement périlleux et très difficile ; à exclure donc. Mais la voie elle-même ne pouvait être établie avec toute la sécurité voulue dans le profil actuel : le remblai a-t-il été l’objet depuis 1880, fin de service de l’exploitation, d’emprunts divers ? Difficile à admettre, car la trace de ceux-ci, obligatoirement localisés, serait visible…Il faut admettre alors le passage des convois sur une crête de talus très étroite, à peine plus large que les 1,10 m de la voie. On peut imaginer le pittoresque des circulations, à 7 ou 8 m au-dessus du terrain naturel ! Ou est-ce l’effet de l’érosion ? Pas avec cette régularité, et dans ce cas la largeur de l'emprise supérieure serait supérieure à celle des débuts, et non l'inverse...
Au fil de ces recherches, c’est le hasard qui nous a permis de construire le dernier acte, permettant de lever tous les doutes et de terminer ce cheminement dans les certitudes, suivies ensuite de l’inévitable sortie sur le terrain…
Nous avons pu en effet consulter l’acte de vente d’une partie de l’assiette de la voie ferrée, la partie nord, de Cadayrac à Puech Hiver. Les vingt pages de l’acte donnent les informations habituelles en pareille circonstance et un plan. Parmi ces pages, il est intéressant de citer les origines de propriété, qui vont nous ramener aux toutes premières acquisitions de 1856, suivies de trois autres, jusqu’en 1874. A la lecture de cet acte, il est aussi assez patent que l’état des installations en 1926 est à l’état de ruines. Près d’un siècle plus tard, il n’en sera que plus difficile de lire le passage de la voie dans le paysage. Extraits.
«
L’an 1926,
Le 3 avril,
(….) Par-devant (…) en vertu des pouvoirs à lui donnés par le Conseil d’administration de la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville, Société Anonyme dont le siège social est à Paris, rue de Lille, n° 84, suivant délibération en date du 6 avril mil neuf cent vingt deux (…) déclare par le présent vendre purement et simplement sous toutes garanties (…)
DESIGNATION DES IMMEUBLES VENDUS
1° le sol de l’ancien siège de la mine de Cadayrac (…) ;ensemble les constructions pour la plus grande partie en ruines édifiées sur ce sol
2° le sol de l’ancien plateau de la même mine (…) ; ensemble les constructions en ruines édifiées sur cette parcelle
3° une pièce de terre dite La Rougière (…)
4° la partie englobée (…) du sol de la voie ferrée reliant autrefois le plateau de la mine de Cadayrac, à la station du chemin de fer de Salles la Source (…)
L’ensemble de la surface ainsi vendue était de « sept hectares, huit ares quarante quatre centiares ». Rappelons qu’il ne s’agit que d’une partie de l’assiette de la voie, la partie plus au sud, de Puech Hiver à la voie normale n’est pas concernée.
Le même acte de vente précise l’origine de propriété :
« la Société Commentry- Fourchambault et Decazeville entend du reste ne comprendre dans la présente vente que les immeubles acquis par elle de la Société des Aciéries de France aux termes de l’acte ci-après relaté et tels qu’ils ont été ainsi acquis.
ETABLISSEMENT DE L’ORIGINE DE PROPRIETE
Les immeubles vendus sont une dépendance de la concession de Muret qui a été cédée par la Société des Aciéries de France à la société de Commentry-Fourchambault et Decazeville par acte reçu par (…). La Société des Aciéries de France était elle-même propriétaire de la même concession au moyen de l’acquisition qu’elle en avait faite de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, suivant acte reçu par (…).
La Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans était elle-même propriétaire des mêmes immeubles ; la plus grande partie au moyen de l’acquisition qu’elle en avait faite de M. le Comte César Armand Anatole de Lapanouse, aux termes de quatre actes (…) :
l’un le six août 1861
le second le 14 mai 1864
le troisième le 26 novembre 1874
le quatrième, le 30 septembre 1856 »
Suivent dans le contrat de vente les conditions particulières relatives à l’état des propriétés, les clauses d’exonération de garanties….
Le prix de vente était de 8 246,70 francs.
Une remarque avant de poursuivre l’examen des pièces du contrat. La chronologie des actes d’achat relatée par le notaire semble pour le moins imprécise ; mais elle a sans aucun doute ses justifications. Par contre la date d’achat par le PO en 1856, ne semble pas en accord avec les autres données historiques, qui mentionnent le Grand Central, et non le PO, comme acteur à Aubin et Lagarde à cette époque …
Le plan annexé à cet acte est très instructif. Il donne ce qui nous manquait au vu de la carte de 1858. En effet, on peut maintenant être assuré (en faisant confiance au notaire) de l’assiette exacte de la voie : pour la partie sud, il n’y a aucune difficulté pour la retrouver et la suivre ; pour la partie nord, il devient, avec certitude, patent que le tracé ne suit pas le projet de 1858. La carte de 1876 le laissait présager, et le document de 1926 atteste et confirme donc le passage de la voie sur les remblais de Puech Hiver, pastille rouge, puis la tranchée légère vers Cadayrac, au-dessus de la parcelle allongée 141, tout en en bas et à gauche du plan. Le tracé retrouve ensuite celui de 1858 au droit de l’indication section B, pastille orange. On note également un peu plus au nord, que le passage de la route par une courbe prononcée est quelque peu différent du document de 1858, qui faisait figurer à ce passage une réelle épingle… Ce plan annexé est fourni ci-après. Il est d’ailleurs possible qu’une modification de tracé soit intervenue dans cette zone : on peut parfaitement, enfin dans les broussailles !, suivre un tracé beaucoup plus direct, attesté par la présence des mêmes bornes de délimitation rencontrées par ailleurs. Un raccourci à suivre sur quelques centaines de mètres en forêt (pastille bleue). La pastille verte enfin marque la position probable des voies de stockage des wagons chargés, avant assemblage du convoi vers la gare de transbordement de Salles la Source.
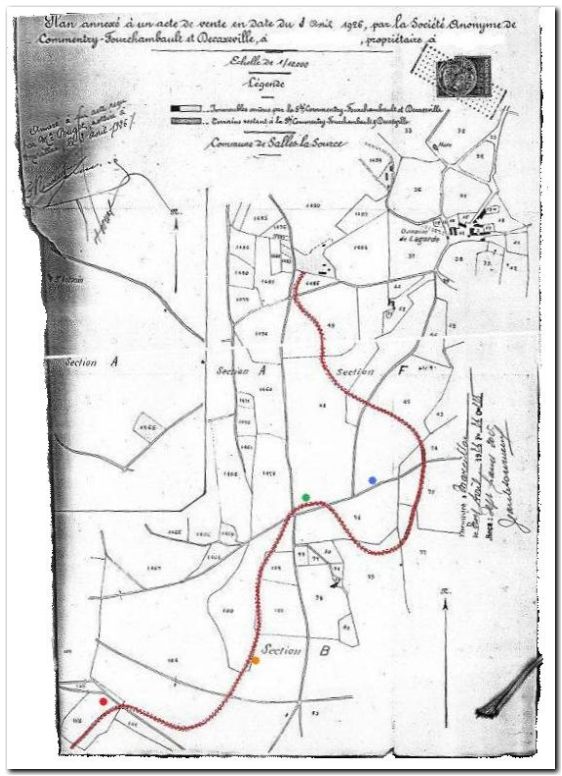


Voici la variante, raccourci à suivre sur quelques centaines de mètres en forêt, indiqué en bleu sur ce schéma :
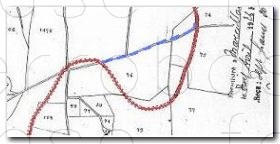
Le dessin ci-après permet enfin de préciser le tracé dans sa zone la plus tourmentée.
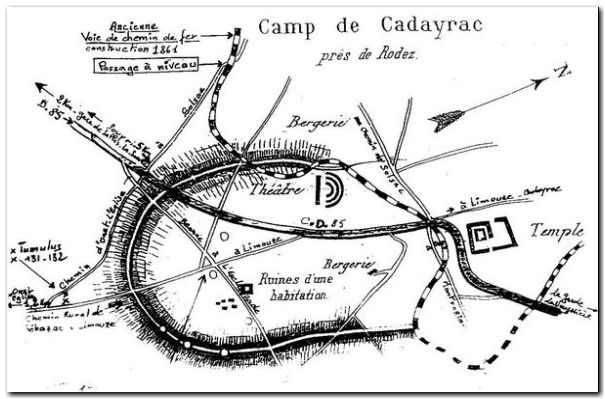

Le dessin ci-dessus et la carte suivante ont été réalisés par M. Arribat, agent voyer en chef d'arrondissement pour le compte de l'abbé Cérès. Celui-ci a publié, par exemple dans les Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, tome 10, 1868-1873 (Gallica Bnf), pages 179-197, un rapport sur les fouilles archéologiques faites à Cadayrac, article daté de 1865. On peut faire parfaitement confiance au dessinateur pour l'exactitude du tracé. La carte montre le tracé du Petit Chemin de fer de Cadayrac dans son intégralité : on ne remerciera jamais assez les archéologues ! Le tracé recoupe à plusieurs reprises l'enceinte du camp romain ; on notera également les précisions du dessin à la gare de Salles la Source, avec deux courbes très prononcées, le point quelque peu anguleux au droit du théâtre, et la position repérée G du bâtiment aux mines de fer. Sur une copie annotée de ce plan, (mais quand ?) il est porté diverses indications manuscritesf, dont celle " en ruines " pour cette "gare"...
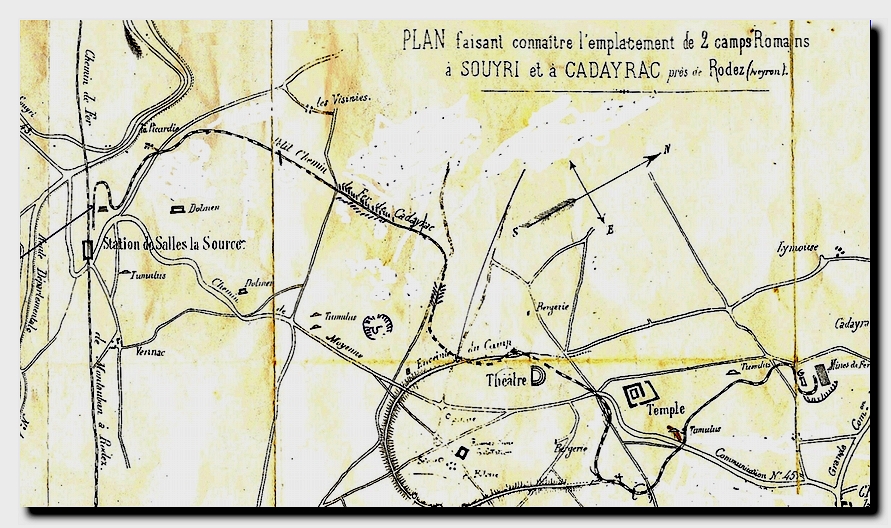
Et pour terminer (provisoirement ? ) l'évocation du tracé, un oeil sur la carte d'état major : rien ne figure ! Etonnant, car sur la coupure voisine, on pouvait trouver l'indication de la voie du Cruou, au dessus de Marcillac. Alors, pour réhabiliter ce tracé qui ne mérite historiquement pas de disparaître, voici d'abord l'extrait de la carte (version 1889, révisée 1907), et notre ajout du tracé avec une précision acceptable. Le départ se fait depuis la Picardie, la petite, pas celle des cieux turquoises de la baie de Somme, et le trajet se termine aux mines, dont la situation figure bien sur la carte, tout en haut de l'image.
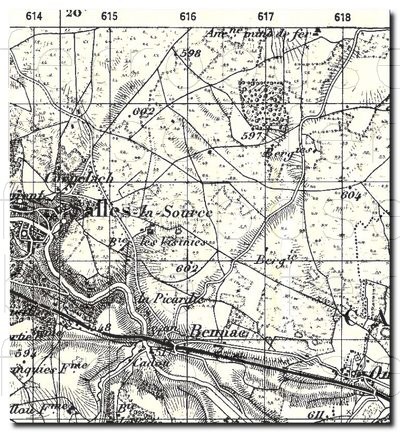
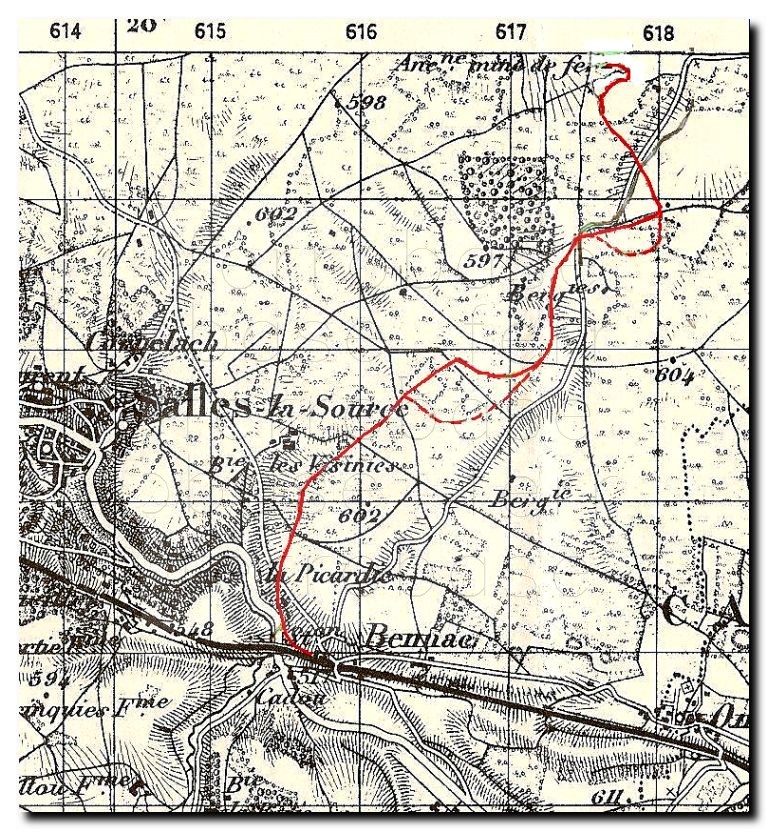
Le texte de Vauquesal Papin (les origines documentaires de ce texte ont été déjà précisées) qui figure ci-après évoque une zone où un évitement permettait de garer des wagons : cette zone devait se situer peu avant ou aux environs du croisement avec la route, en venant de Cadayrac ; il y a là en effet une zone plus plane propice à cet aménagement.
La concession de Muret à Cadayrac, sur les communes de Muret et de Salles-la-Source s’étend sur 1 432 hectares. Le décret de concession de Muret et le cahier des charges sont datés du 18 août 1853 ; une demande d'extension de la concession est faite avec plans de 1858 et 1866. Des achats de parcelles du domaine de Lagarde et de terrains nécessaires à la construction d'un chemin de fer à chevaux ( !! ) reliant le plateau de Cadayrac à Salles-la-Source sont effectués.
Dans les archives du CAMT, aux Archives Nationales, figure une copie du contrat passé entre la Société des aciéries de France et la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville, au sujet de la vente, à cette dernière société, avec condition suspensive et moyennant 350 000 francs, de la concession de Muret (28 septembre 1907).
L’installation d'une aciérie Thomas à Decazeville, est réalisée de 1907 à 1911 ; on connaît les prévisions de dépenses et rapports mensuels sur l'avancement des travaux. De plus, et c’est particulièrement important pour nos chemins de traverses, cette installation a rendu nécessaire, notamment, la construction d'une batterie de 37 fours Otto, l'aménagement de la mine des Espeyroux, et la construction d'un chemin de fer aérien des Espeyroux à Marcillac, ainsi que la création de logements ouvriers à la Forézie et à Decazeville. C’est bien sûr ce chemin de fer aérien qui sera l’un de nos autres chemins de découvertes.
On peut noter enfin que des études sur la transformation de la voie de Decazeville à Marcillac et à Mondalazac, de 0m66 à 1 m d'écartement, ont été réalisées afin d'utiliser le matériel du chemin de fer des mines de Commentry et de Montvicq, après l'arrêt de la mine de Commentry en 1899. Il ne semble pas que ces études aient été concrétisées sur le terrain.
Historique de la ligne de Cadayrac a été publié par Vauquesal-Papin en 1963. Extraits.
Ce qui suit se passait dans
l'Aveyron, en mai 1861.
Cette année là, la
Compagnie d’Orléans avait fait construire entre les mines de Mondalazac
et la station de
Salles-la-Source, située sur
la ligne de Capdenac à Rodez, un chemin de fer à voie étroite à
écartement de
1,10 m, disposition unique en France. Cette ligne minuscule qui n'avait
que 7
km de long était en quelque sorte une
pupille du
P.O.
La Compagnie
d'Orléans, propriétaire en Régie des usines d'Aubin était aussi
concessionnaire
d'une mine de fer à Lagarde, près de Mondalazac. Tout naturellement,
elle
songea a réunir la mine et les usines par une voie ferrée.
Après
avoir fait
étudier les avantages comparés de la voie normale et de la voie
étroite, elle
adopta cette dernière. Aux yeux de la Compagnie d'Orléans, ce choix
devait en
quelque sorte donner lieu à une expérience qui d'ailleurs, n'aurait pu
être
faite quelques mois plus tard, car le vote, en 1865, de la loi sur
l'exécution
des chemins de fer d'intérêt local, dite
loi Migneret, concluait à l'adoption exclusive de la voie
normale.
Ce premier essai
d'exploitation en voie étroite allait donc permettre une confrontation
avec
celle des chemins de fer du Bas Rhin, équipés en voie normale et
pendant
quelques années, ce petit chemin de 7 km sera le point de mire des
adversaires
de la voie étroite et de tout transbordement. Leur opinion était
fondée, et
avec raison, sur le succès obtenu sur les trois embranchements alsaciens Strasbourg à Barr
et à Wasselonne,
Hagueneau à Niederbronn et Schlesdtadt à
Saintes-Marie-aux-Mines
exploités par la Compagnie de l'Est. De leur coté, les partisans de la
voie
étroite estimaient que la ligne n'aboutissant pas à une station
principale où
l'on trouverait un dépôt et des voies de garage, il faudrait créer le
tout,
mesure qui entraînerait des frais d'établissement considérables et un
coût
kilométrique d'exploitation excessif.
Ces raisons étaient
également valables.
DESCRIPTION DU CHEMIN
II s’élevait par une
rampe de 12 °/°° au départ de la mine sur 2 500 m. Au sommet, on
trouvait un
palier de 500 m comportant une voie de garage ou de croisement. Ce
palier était
suivi d'une deuxième rampe de 1 °/°° sur 1 900 m; aux deux extrémités
de
la
ligne on trouvait deux courts paliers non comptés dans la distance, et
qui
servaient de points de chargement et de déchargement.
On rencontrait sur
ce petit parcours: une courbe de 60 m de rayon, trois de 75 m et un
certain
nombre de 100 m. En outre, le point de chargement à Mondalazac était
atteint
par une courbe de 40 m. Les courbes à petit rayon étaient situées sur
la rampe
de 12 °/°° particulièrement.
On traversait librement
la voie à niveau des chemins. Seule la tranchée de Vezences (des
Vézinies ? ) était clôturée.
LA VOIE
Elle était posée sur
des traverses en chêne espacées de 0.75 m; largeur 0,15 m; longueur
1,50 m;
épaisseur 0,12 m et payées 1,50 F l'une.
Les rails étaient du
type Vignole, d'un poids de 16,5 kg au mètre, réunis par des éclisses
avec
quatre écrous.
MATERIEL ROULANT
TRACTION -
EXPLOITATION
Le parc comprenait
55 wagons à minerai montés sur roues en fonte de O,75 m de diamètre et
un
écartement d'essieux de 1,50 m. L'une des deux roues d'un même essieu
tournait
librement autour de son axe, disposition déjà appliquée sur la petite
ligne de
Montluçon a Commentry (1).
La capacité des
wagons était de 1,85 m3, attelages par chaînes avec tampon central muni
d’un
ressort en caoutchouc, frein à levier sur le coté,
poids a vide 1,40 t, chargés 5,20 t, soit 3,80 t de
chargement.
Prix unitaire 900 francs.
Par suite de l'usure
rapide des surfaces de roulement, on appliqua très tôt des bandages en
fer.
Jusqu'en 1864, on
eut recours à la traction animale, avec une écurie de 9 à 10 chevaux.
En 1863,
après quelque hésitation due aux objections sur le faible poids des
rails, le
rayon des courbes et le franchissement de la rampe de 12 °/°°, la
société
passait commande aux Etablissements Gouin de deux locomotives-tender du
type
020 T. dont le poids à vide devait être inférieur à 10 t, et pouvant
porter un
approvisionnement, eau et charbon de 2,5 t (2).
Le mouvement avait
été organisé de la manière suivante: départ de Mondalazac, avec un
train de 7
wagons chargés de 27 t de minerai. La rampe de 12 °/°° était gravie à
15 km/h.
On garait alors les wagons sur la voie de débord, en palier située au
sommet de
la rampe. Puis on dételait la machine qui redescendait pour remorquer
sept
autres wagons au même point. Entre le sommet et Salles-la-Source, la
machine
remorquait de 21 à 35 wagons. Donc, trois à cinq voyages sur la rampe,
selon
les besoins, correspondaient à un voyage sur le reste de la ligne;
soit, à
pleine utilisation, 133 tonnes journalières transportées. Pratiquement,
et en
fonction des besoins de l'usine d'Aubin, la moyenne des wagons chargés
était de
21 à 28. La vitesse était limitée à 15 km/h sur toute la ligne. Le
parcours moyen par
jour pour une
machine s’élevait à 40 km. La consommation de houille
ressortait à 9 kg
par kilomètre.
Arrivé à
Salles-la-Source, le minerai était transbordé dans des wagons de la
ligne de
Rodez et transporté jusqu'à Aubin. La manutention et le transbordement
étalent
confiés à un entrepreneur et payés 0,17 francs
la tonne.
A Salles-la-Source,
trois voies avaient été posées pour permettre les manœuvres, le train
de wagons
chargés était amené sur l'une des voies, et sur l'autre stationnait le
train de
matériel vide; on ramenait ensemble les deux convois vides à Mondalazac.
En juin 1865,
I'ingénieur Thirion avait envisagé la création d'un transport de
voyageurs en
révisant tout d'abord la plate-forme de la voie, et en procédant à son
renforcement par modification de son écartement, qui serait porté à
1,20 m.
Le programme d'exploitation
envisageait la circulation de 5 à 6 trains par jour à une vitesse fixée
a 25/30
km/h. L'hiver, on ajouterait simplement une voiture à certains convois
mixtes.
La recette en serait basée sur une fréquentation de 10 voyageurs par
train, et
8 tonnes de marchandises, chaque train ne pouvant être formé de plus de
6
véhicules.
Ces projets ne
furent pas réalisés, car le chemin de Mondalazac ne transporta jamais
que du
minerai. Créé, en quelque sorte, en fonction des besoins des usines
d'Aubin
pour la fabrication des rails en fer, il en suivit le sort. Après 1870,
la
concurrence industrielle se fit plus vive et c'est alors qu'apparurent
les
rails longs en acier. Aubin n'était équipé que pour fabriquer du rail
en fer
long de 5,50 m. De fortes sommes auraient été nécessaires pour refondre
l'outillage et prendre pied sur le marché. Déjà, au temps du Second
Empire, une
partie de la régie d'Aubin avait été cédée à l'industrie privée. En
1881, le
Conseil d'administration
décidait de
vendre la mine de Lagarde et l'usine
d'Aubin aux Aciéries de France.
Le petit chemin de
fer n'avait plus de raison d'exister, alors, en 1882... à peine
majeur... il
disparu
VAUQUESAL-PAPIN .
1 dérivé du système
Arnoux pour la ligne de Sceaux
2 les dimensions de
ces machines ont été données dans la brochure éditée en 1885.
Remarques : malgré tout le soin que l'auteur met à rédiger son texte, on peut regretter la confusion entre Mondalazac et Cadayrac : elle va prospérer et croître dans les nombreuses reprises de ce texte... Il est donc important de souligner à nouveau qu'en cette moitié du siècle, les concessions de Muret et Mondalazac sont parfaitement étrangères l'une à l'autre, tout comme les exploitants. La voie de 110 ne concerne absolument pas les exploitations que Decazeville maintenait sur le Causse.
La fin de la voie.....ce sera en 1882.
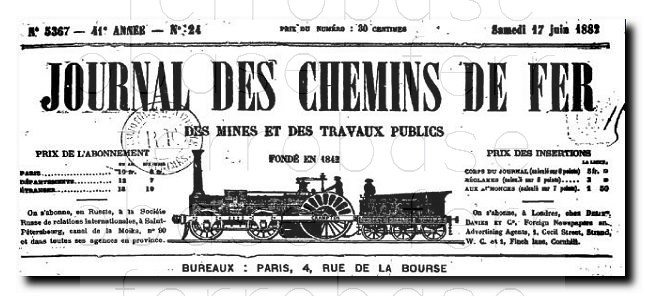
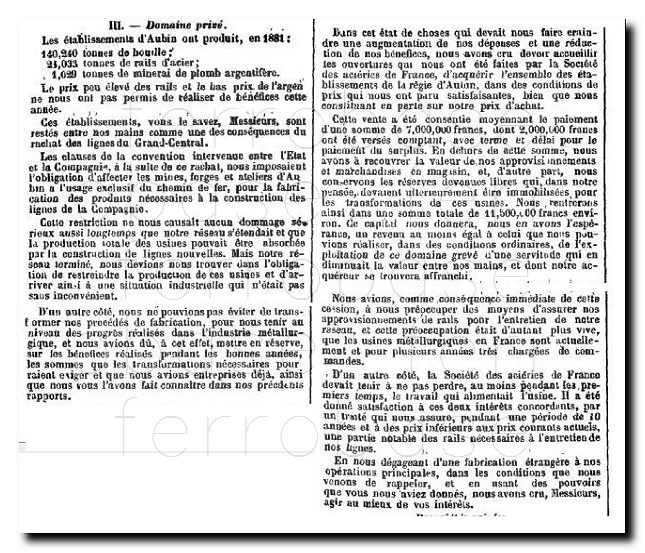
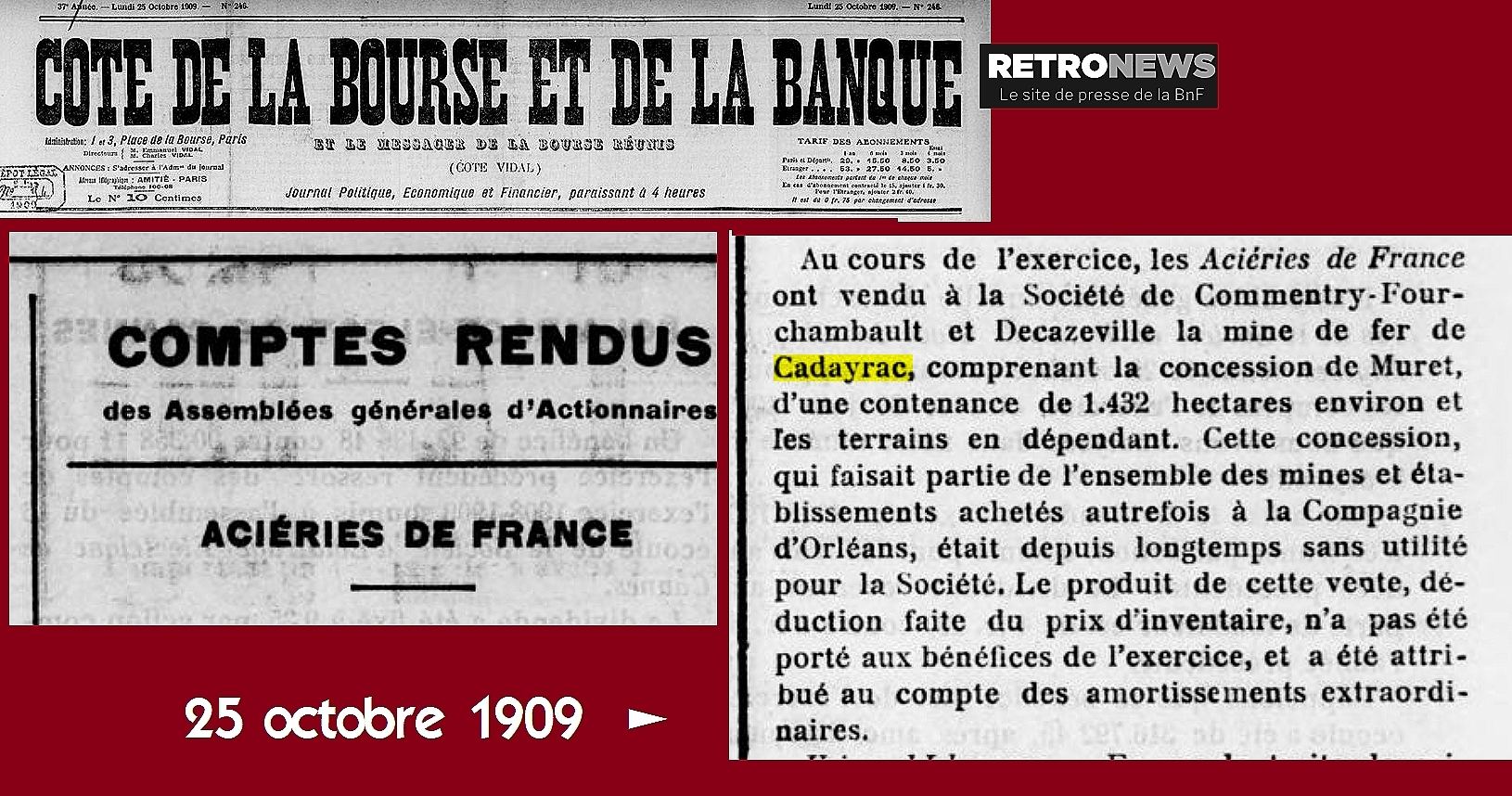
Sur
le terrain il ne reste, à très peu de choses près, que
les bornes de délimitation de l’assiette de la voie ; mais
elles sont très
nombreuses de part et d’autre de la voie…A ne pas toucher ni déplacer,
sous aucun prétexte !
Sur ces chemins, à découvrir, admirer, mais ne pas cueillir ! Je suis protégée...

Toute aussi belle, en
robe bleue....

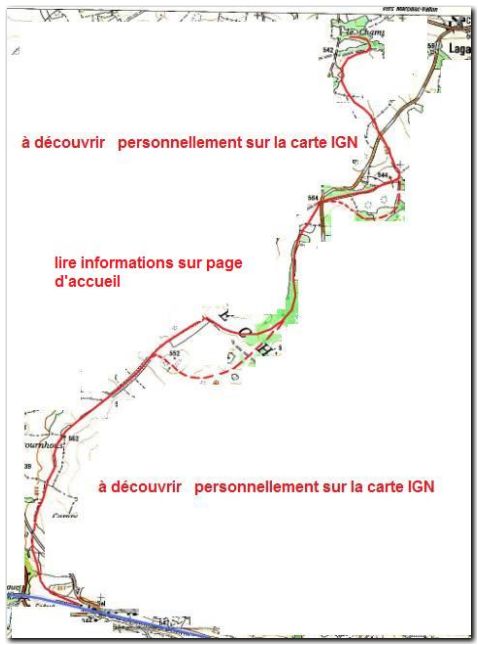
En utilisant des ressources diverses, voici le profil en long de cette ligne, de la gare à gauche, aux mines à droite. Le fond d'écran est de Google Earth, et la photographie noir et blanc un document (libre) IGN de 1948 . Le profil montre bien les trois tronçons, de droite à gauche : rampe continue depuis les mines, parcours de niveau, puis descente vers la gare de transbordement. Nous avons mis un curseur au point haut de la ligne. C'est à cet endroit précis que se situe la tranchée des Vésinies, permettant de traverser l'obstacle que constitue la butte.
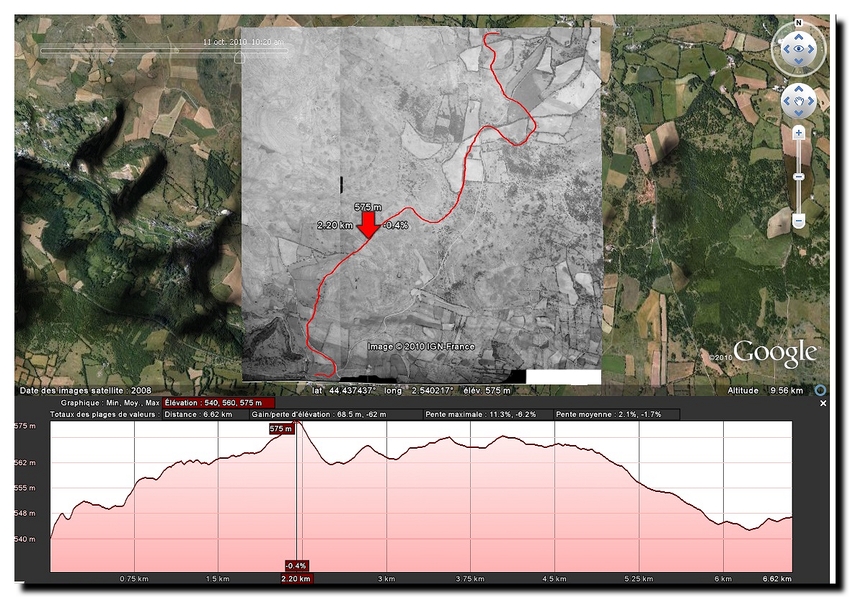
L'histoire du chemin de fer, et des mines de Cadayrac se terminera après la vente de l'ensemble de la concession de Muret par les Aciéries de France à la Société de Commentry : Decazeville aura ainsi la main sur la totalité des mines de fer du causse, fin 1909. ( Echo des Mines, 8 novembre 1909 )
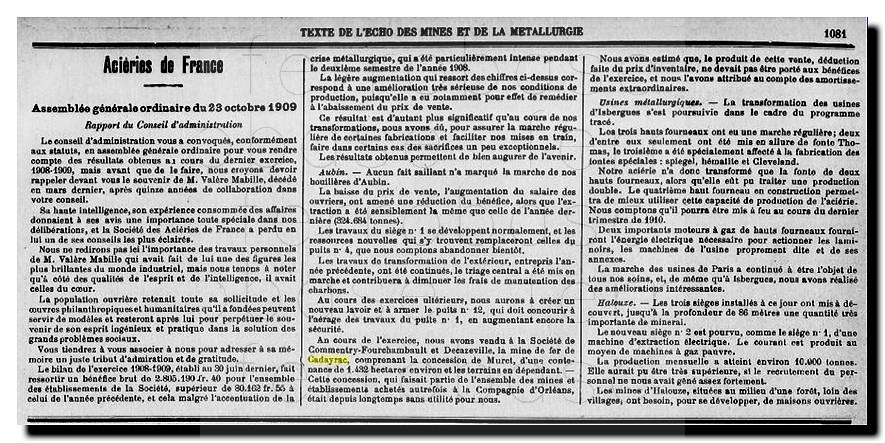
A l'occasion de cette revue de presse, mentionnons, le 27 juin 1860, un accident à Mondalazac : deux mineurs sont " emportés par un torrent dans une galerie de la mine à ciel ouvert " : une victime est à déplorer. Le Journal, dans un long historique et dans plusieurs numéros, mentionnera également l'action du général Tarayre en Aveyron : bien connu des ruthénois, il avait envisagé avec un ingénieur, M. Baude, préfet de son état, de développer les mines d'Aubin ; ce fut sans succès, et le couple Decazes Cabrol prendra la suite. Fin octobre et début novembre, le Journal se fera l'écho de la disparition du duc Decazes : nous avons mentionné ces nouvelles dans les pages du chapitre 7.
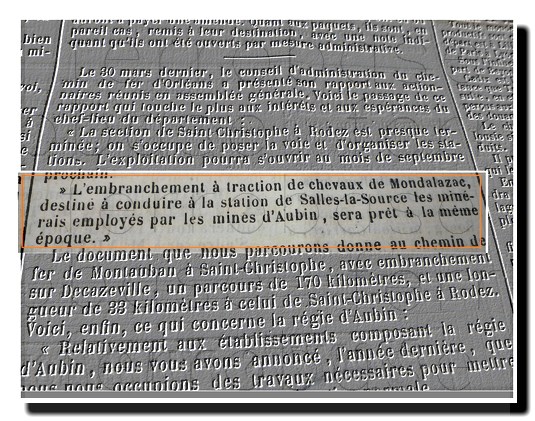

L'information ci-dessus, contenue dans le compte rendu de l'Assemblée Générale des actionnaires, sera également publiée dans la Gazette de l'Industrie et du Commerce du 16 avril 1860 (Gallica Bnf), une nouvelle d'ordre national donc :
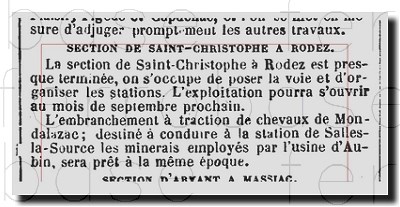



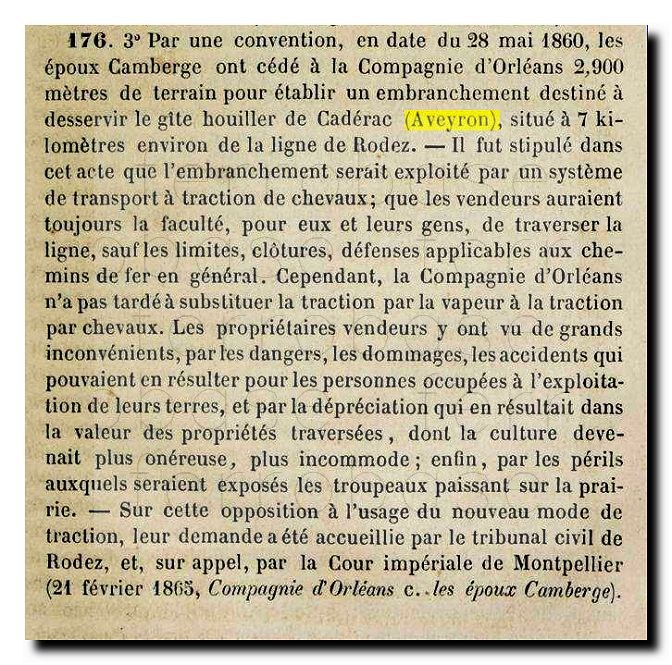
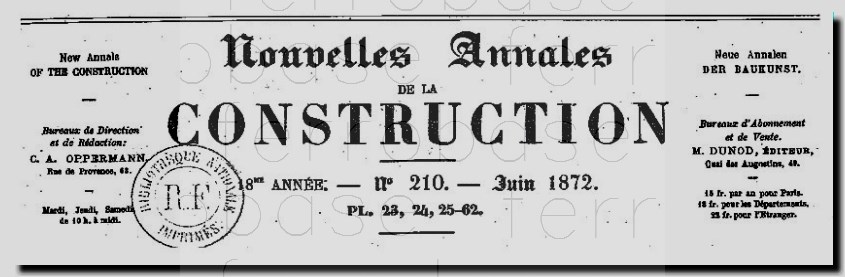
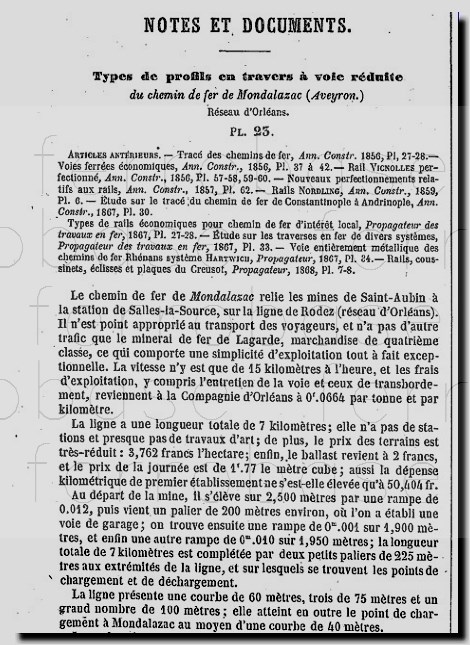
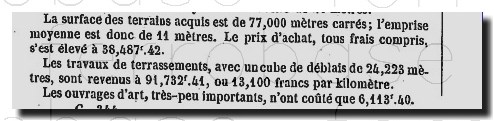
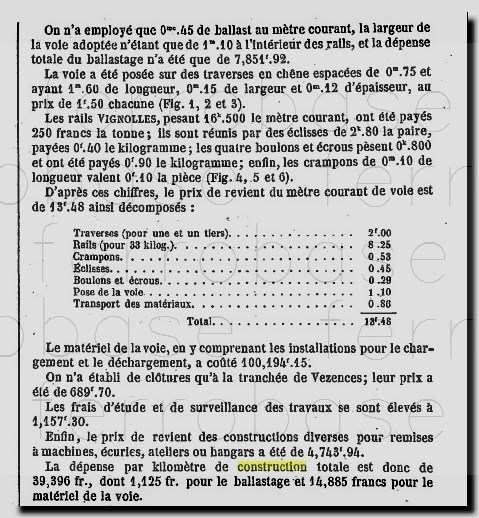
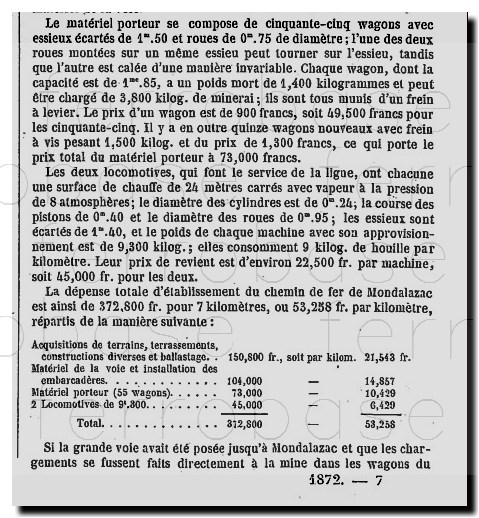
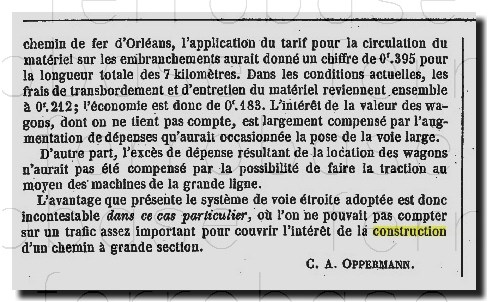
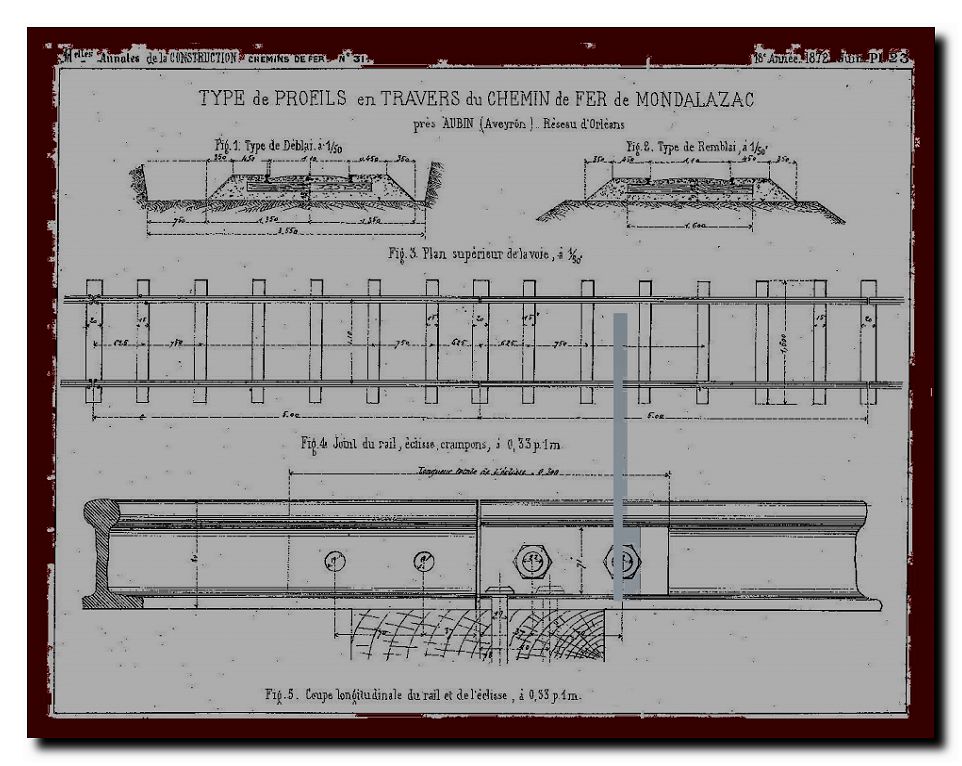
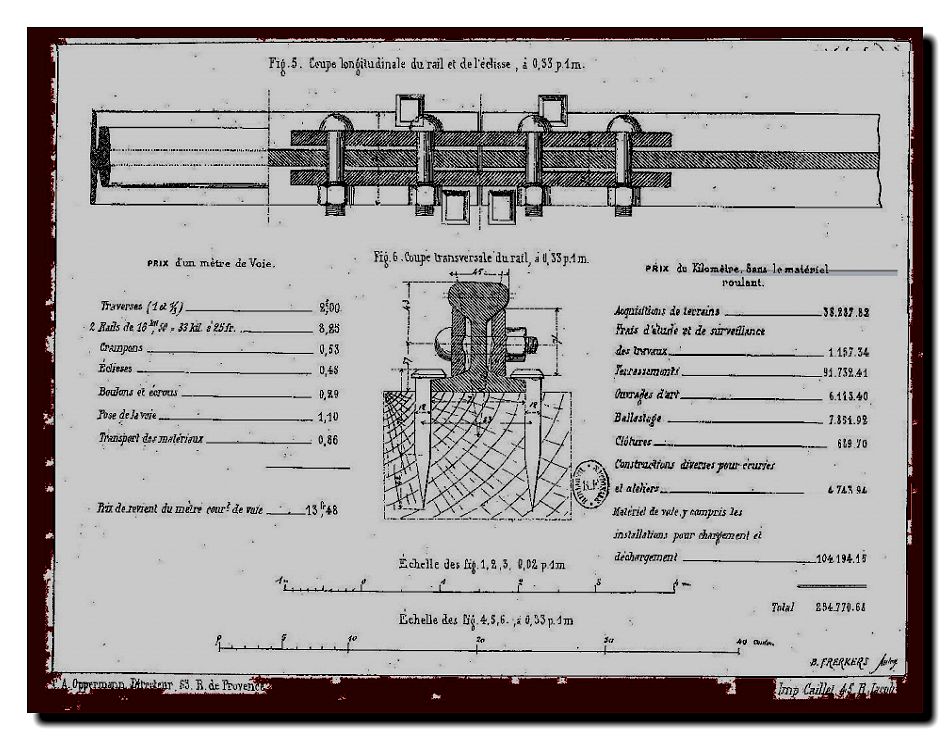
▲ En italien, la voie de Cadayrac et ses machines passent à la postérité !
planche in Giornale del Genio Civile, n°2, mars avril
1867
En 1875, la voie de Cadayrac, toujours baptisée à tort Mondalazac, vient au secours des chemins de fer algériens. Alors en gestation, une campagne de presse met en avant les avantages des voies étroites pour généraliser cet usage en Algérie. Parmi les exemples, Cadayrac est à nouveau à la une, et figure dans un tableau publié par les Nouvelles Annales. Même si la date est fausse, 1869 au lieu de 1860, on peut constater au vu des chiffres le très bon rendement de cette voie. Elle était bien en 1860 la première réalisée à cet écartement en France.
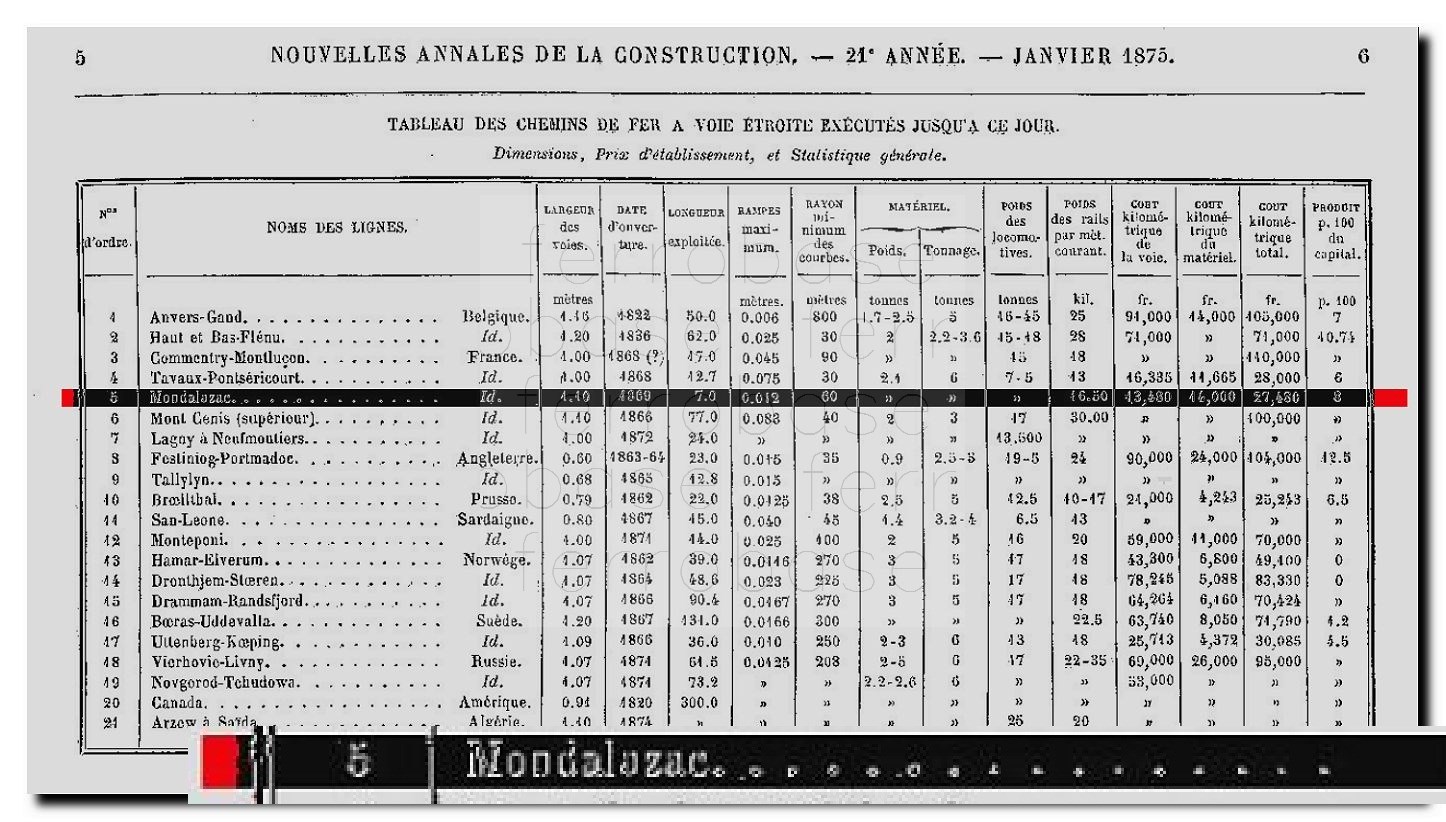
1919, projets, dolomie
"La
mise en exploitation des carrières dolomitiques de Salles-la-Source n'a
pu être
commencée que dans le deuxième semestre en raison des nombreuses
difficultés
rencontrées.
Un four de 10 mètres de hauteur, pouvant produire 15 tonnes d'engrais
magnésien
par 24 heures, a été construit et mis en route avant la fin de l'année.
Les premières
livraisons d’engrais magnésien produit par ce four, et l’installation
mécanique adjacente
donnaient entière satisfaction à une clientèle d'agriculteurs répartis
sur tout le territoire
français, lorsqu’un acte de sabotage (cartouche de dynamite dans le
four) vint
interrompre la fabrication. Les travaux de réfection du four endommagé,
et de
construction de deux autres fours semblables sont en exécution. En
attendant, un petit
four temporaire permet de produire 400 kilos d'engrais par jour, au
lieu des 50 tonnes
que pourront produire les trois fours.
L'organisation mécanique est en voie d'installation et la force motrice
sera obtenue à
l’aide de deux moteurs à gaz pauvre".
(in La Journée industrielle, 24 juillet 1920)
"Cette
société, qui possède de vastes carrières dolomitiques à
Salles-la-Source, vient
de remettre en état le four qui avait été détérioré il y a quelques
mois. Elle a également,
terminé la construction de deux autres fours semblables au précédent et
qui pourront
produire, à partir du mois prochain, 100 tonnes d'engrais magnésie par
mois. Dans
cette région, la production de dolomies crues est considérable et la
Société Feuillette en
fournit à de nombreuses sociétés métallurgiques et particulièrement aux
Établissements
Schneider et Cie, au Creusot. Sa production, malgré les nombreuses
difficultés
rencontrées, surtout dans les transports, est environ 200 tonnes par
mois."
(in La Journée industrielle, 28 août 1920)
Le 30 juillet 1924, le même journal évoquait pour la dernière fois l'usine : "l’exploitation de Salles-la-Source, constamment déficitaire, a été cédée dans des conditions à peu près acceptables."
En 1919, l'optimisme d'un spécialiste aveyronnais n'était pas
d'actualité !
ADA, 145 W 145
▲
▼ ▼clic
Le
Cultivateur aveyronnais, 1 mars 1922
Eléments
de bibliographie
Ces données sont partielles, d’autres sont indiquées dans les pages relatives à la voie aérienne de Marcillac à Mondalazac .
Ce ne sont qu’une partie des sources consultées ; sur un pareil sujet, il serait abusif de prétendre à l’exhaustivité. Il y a des documents écrits, récents ou beaucoup plus anciens. Nous donnons également des voies de recherche sur internet : à utiliser pour certaines avec beaucoup de prudence ; il est difficile de vérifier ces sources. Pour les adresses relatives à des sites institutionnels, on peut penser à une fiabilité plus importante. Il faut aussi penser à la volatilité de ces adresses : certaines ne seront peut-être plus disponibles prochainement ou dans….des années ! Et pour certains ouvrages, totalement introuvables en bibliothèques, il reste la possibilité de consultation électronique ; il ne faut pas passer à coté de cette opportunité, sur des sites en France ou ailleurs, c'est-à-dire pour la plupart dans des universités américaines, y compris bien sûr pour des ouvrages en français . Les références sont enfin données sans ordre précis ou chronologique, et quelques compléments précisent leur intérêt.
COQUAND (H.).—Note
sur les
minerais de fer des
départements de l'Aveyron, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Tarn, de
Tarn-et-
Garonnc et de la Charente-Inférieure, etc. (PI. III). . . . 338,
Bulletin
Société de géologie,1848
R.
MIGNON,
Géologie et terroirs, la géologie du Rouergue et l’Homme, CNDP, 2001
VAUQUESAL-PAPIN,
un curieux petit chemin de fer…qui allait de Mondalazac à Salles la
Source, Vie du Rail, VDR
899, juin 1963
VAUQUESAL-PAPIN,
position actuelle des chemins de fer, Rouergue, historique, VDR 1233,
1970
Al canton,
Marcillac, Conseil Général,
Aveyron, 2005
« Historique des forges de
Decazeville 1826-1914 », Louis LEVEQUE,
1916 réédité en 2001 par
l’ASPIBD
« Terre de Mine, Bassin
d’Aubin-Decazeville » Lucien MAZARS,
Fil d’Ariane éditeur, 1999
http://pagesperso-orange.fr/genealuc.boudet/guerre%20napoleonienne.html
histoire locale
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203536
pont de Malakoff notice
http://www.pangeaminerals.com/
Mines
et Minéraux de l'Aveyron
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/inventairesaq/110aq-3.html
http://www.annales.org/archives/x/souhart.html
http://www.piednoir.net/guelma/histoire/cfanov06.html
Archives nationales, et Centre des Archives du Monde du travail, CAMT, site internet
Ce site fournit par exemple le détail des fonds documentaires remis par les Houillères. La seule lecture de l’inventaire est par elle-même instructive…voir plus bas.
Google books : recherche avec comme mot clé mondalazac
sources diverses, avec dans certains cas, le texte complet
Mémoires de la Société des ingénieurs civils
de
France
Voir site CNUM : rapport sur les chemins de fer à voie étroite 58 pages par Moreau (recherche sur la page d’accueil )
Alfred Picard, 1887, Traité des chemins de fer, consultable sur google books
http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/fiche.xsp?id=DAFANCAMT00AP_110AQ441&n=5&q=sdx_q0&x=rsimple.xsp
http://www.cc-caussevallonmarcillac.fr/spip.php?article73
http://www.fossiliraptor.be/fluorite.htm
bulletin municipal Nuces n°23 juin 2007
http://www.tourisme-vallonmarcillac.fr/IMG/pdf/Circuit_decouverte_Valady_definitif.pdf
Annexes
A l’occasion de ces parcours sur les chemins de traverses, nous avons évoqué à plusieurs reprises les sources des archives nationales, et plus particulièrement celles du CAMT à Roubaix. Nous vous renvoyons aux notices de présentation, remarquablement rédigées. Leur simple lecture permet quelquefois de retrouver notre histoire : 110 AQ 23 à 47, sans être bien sûr exhaustif.
Liste
des archives nationales, CAMT,
remises par les houillères : le lien internet,
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/inventairesaq/110aq-4.html

retour page menu
© 2026 Jean RUDELLE