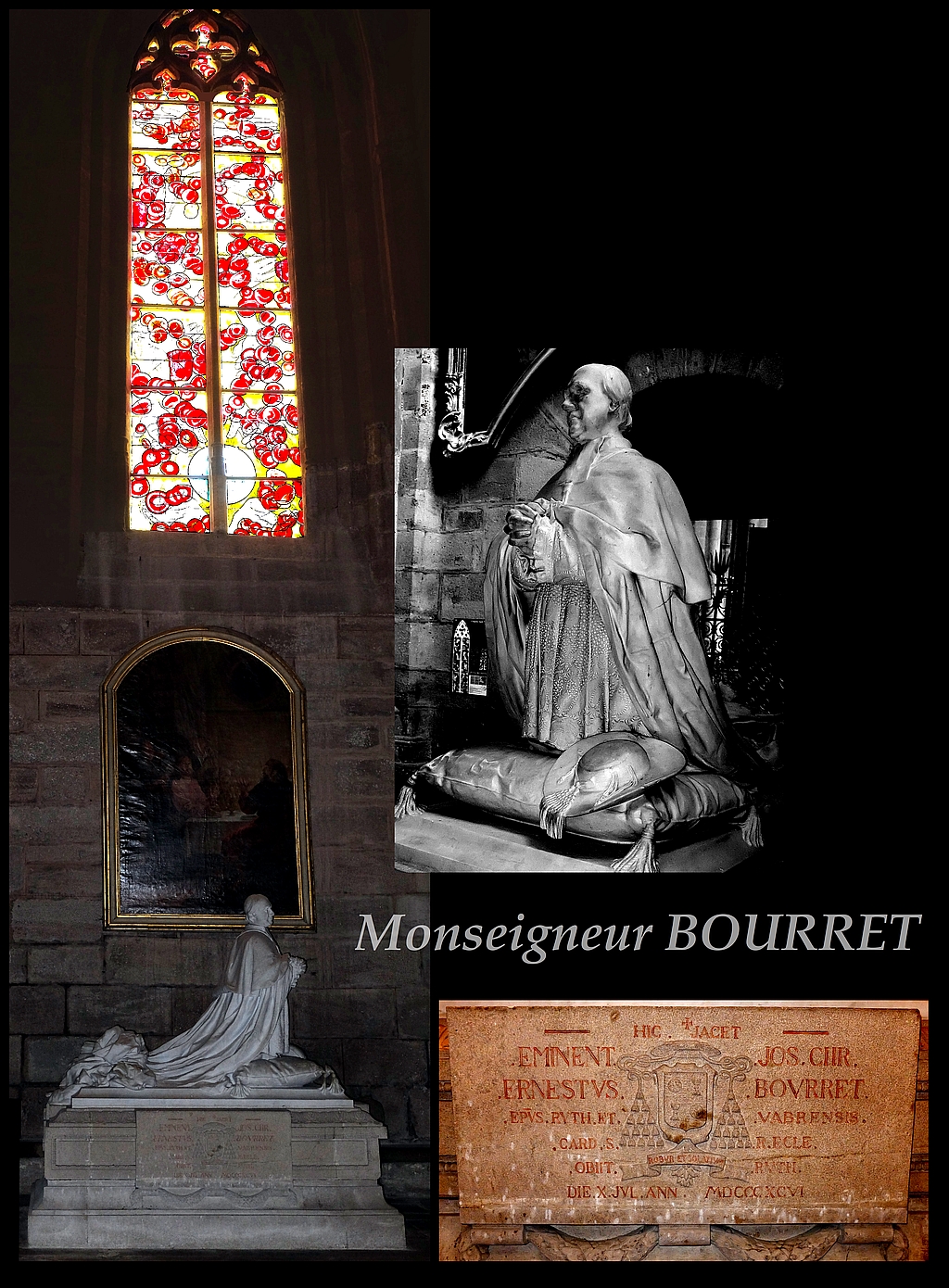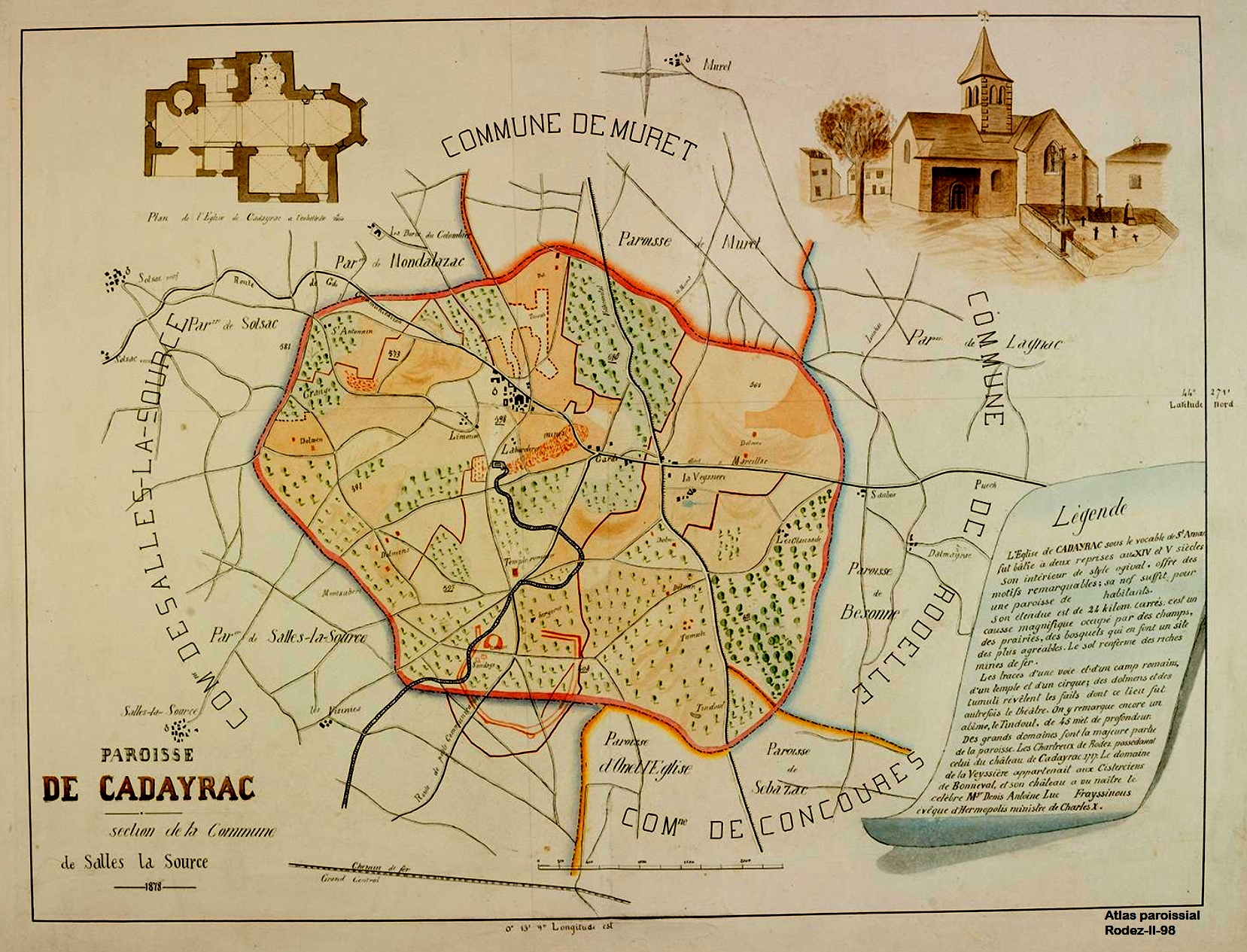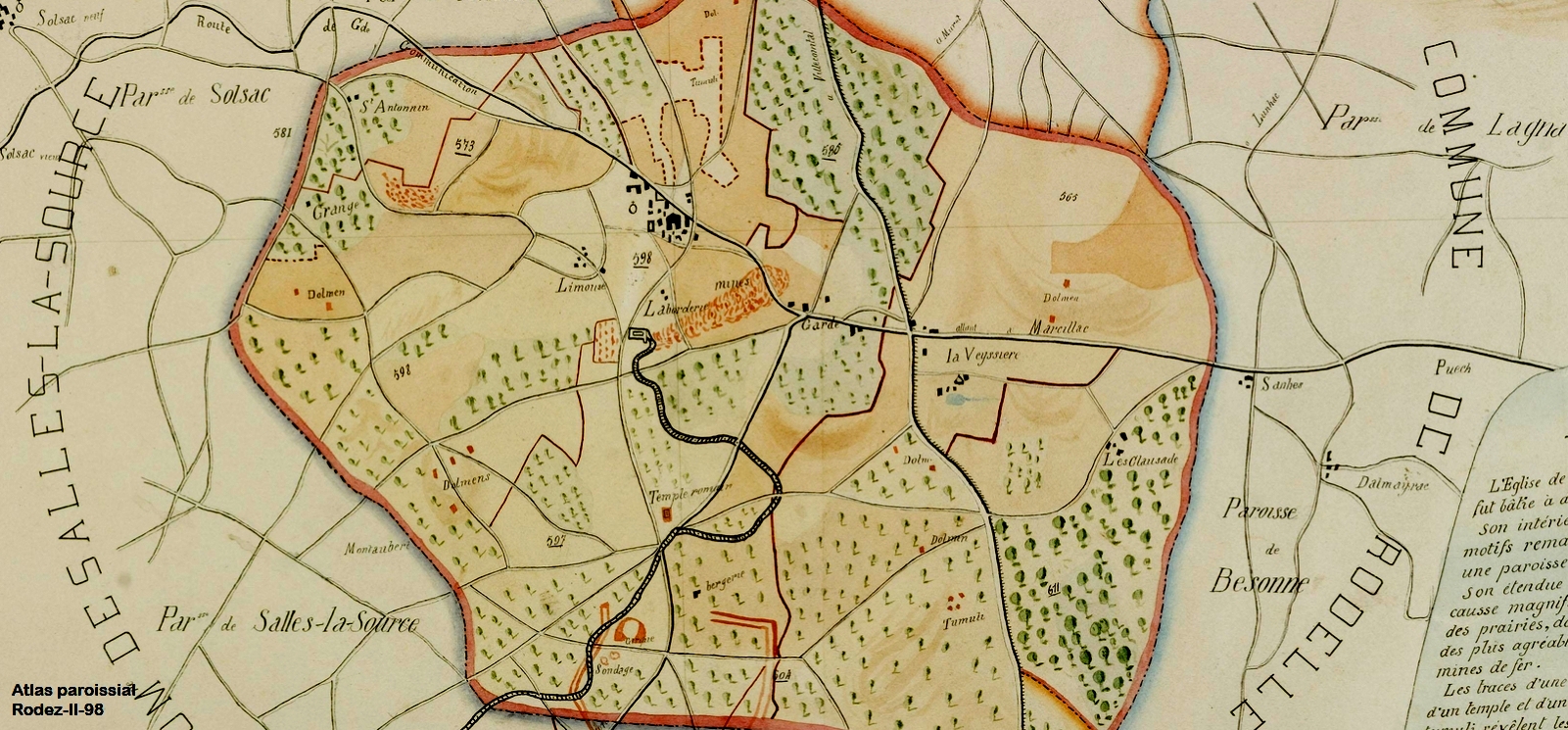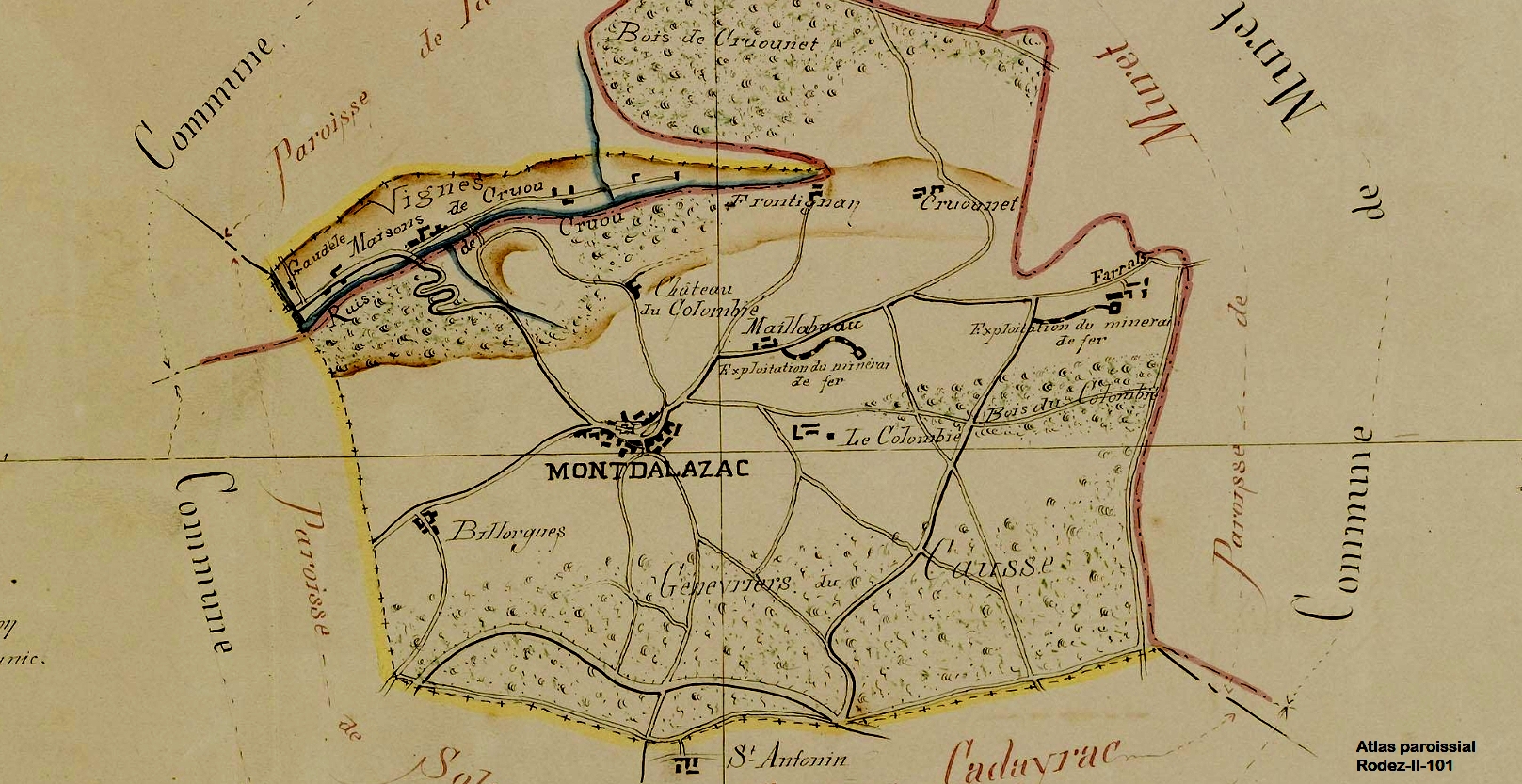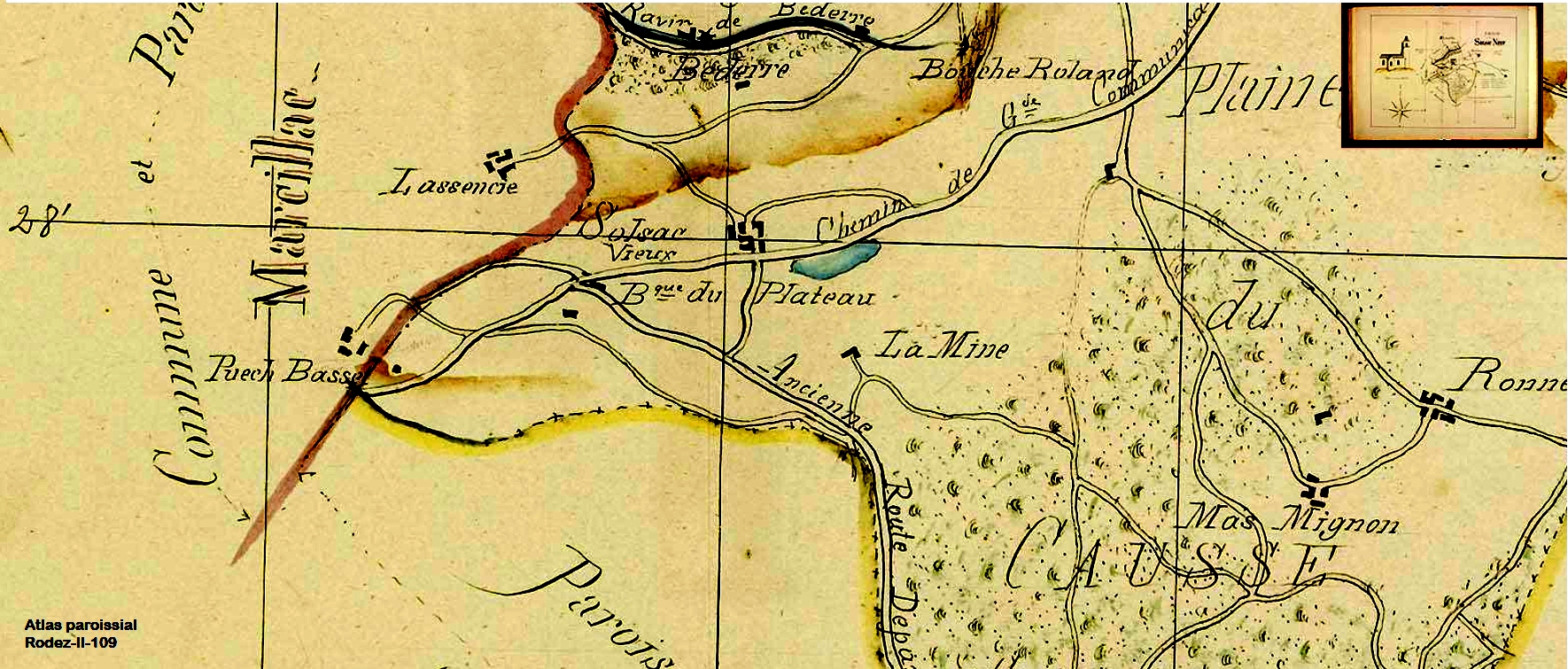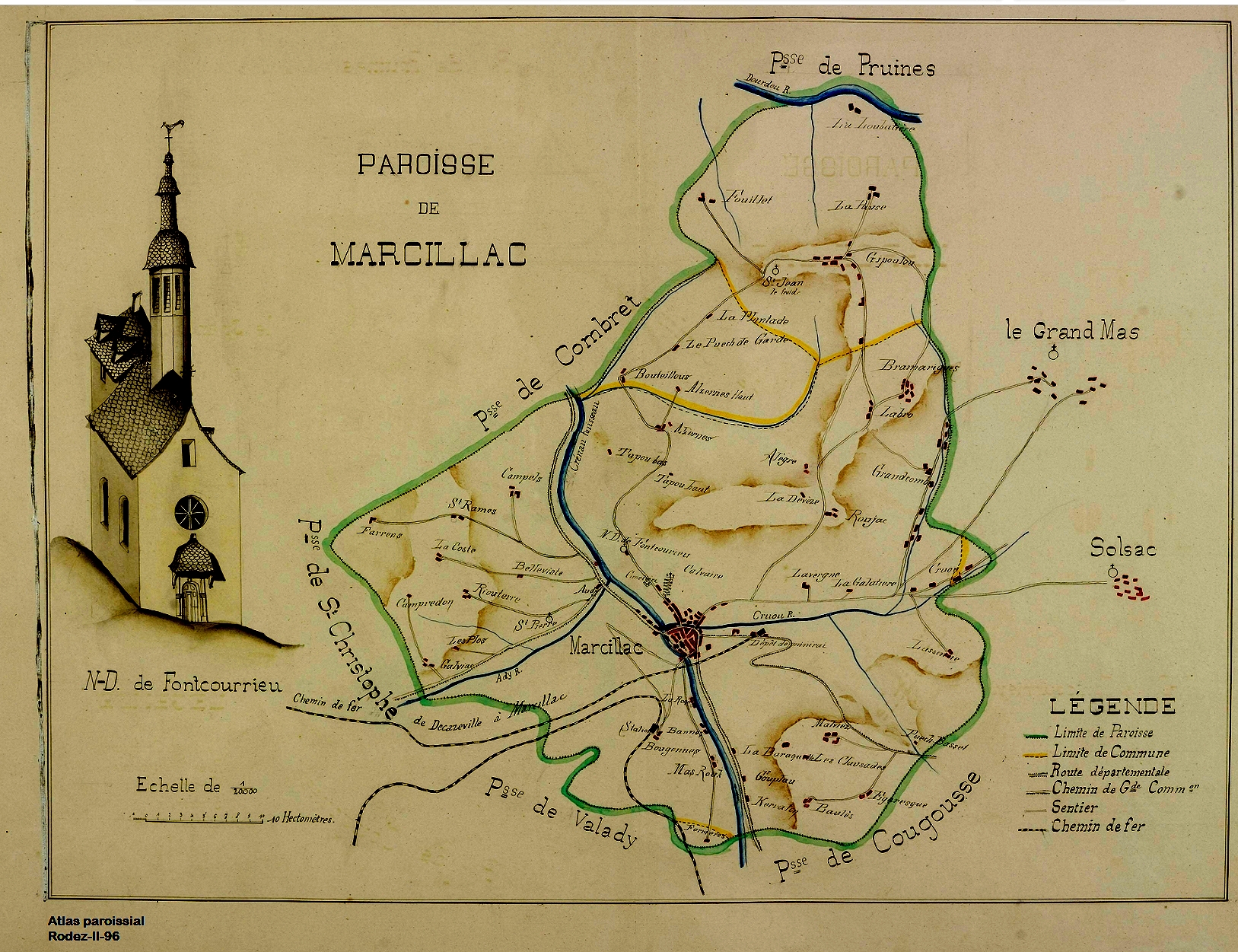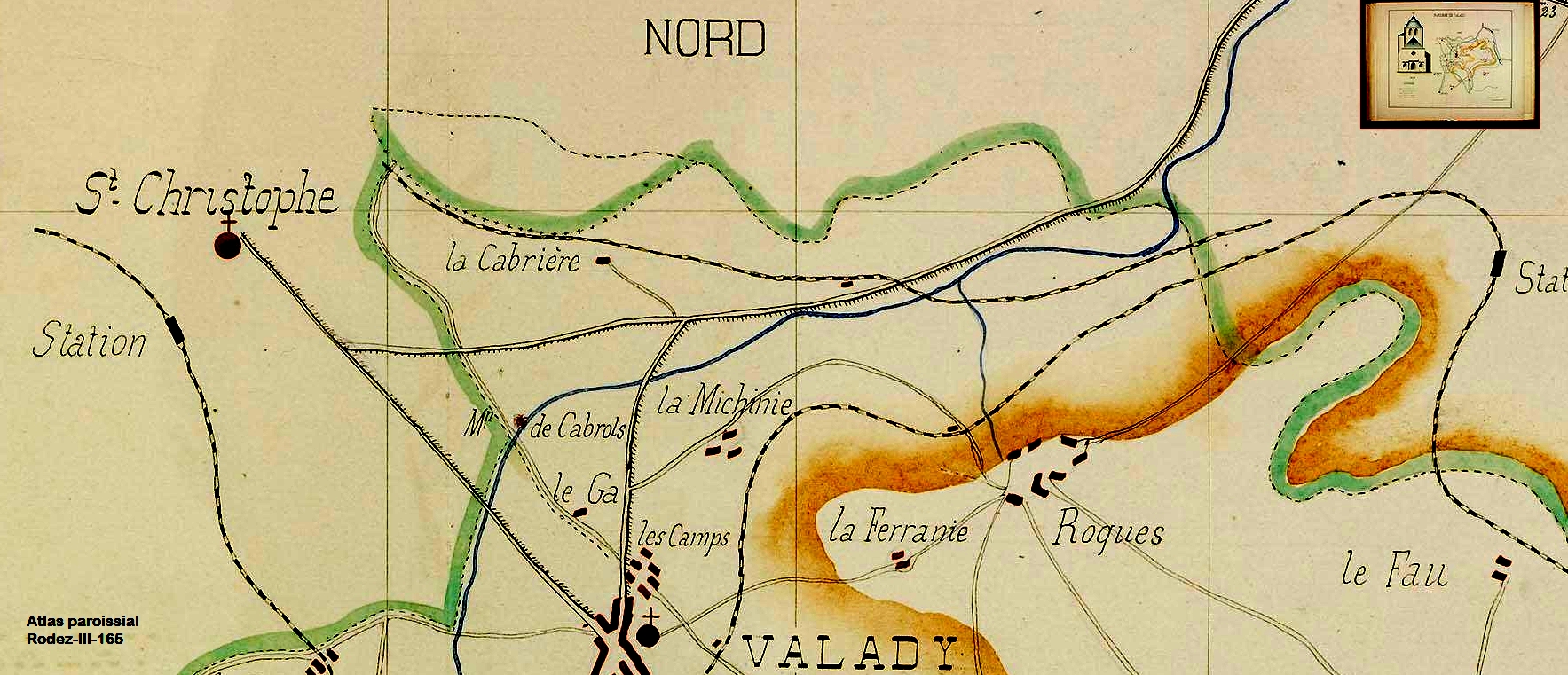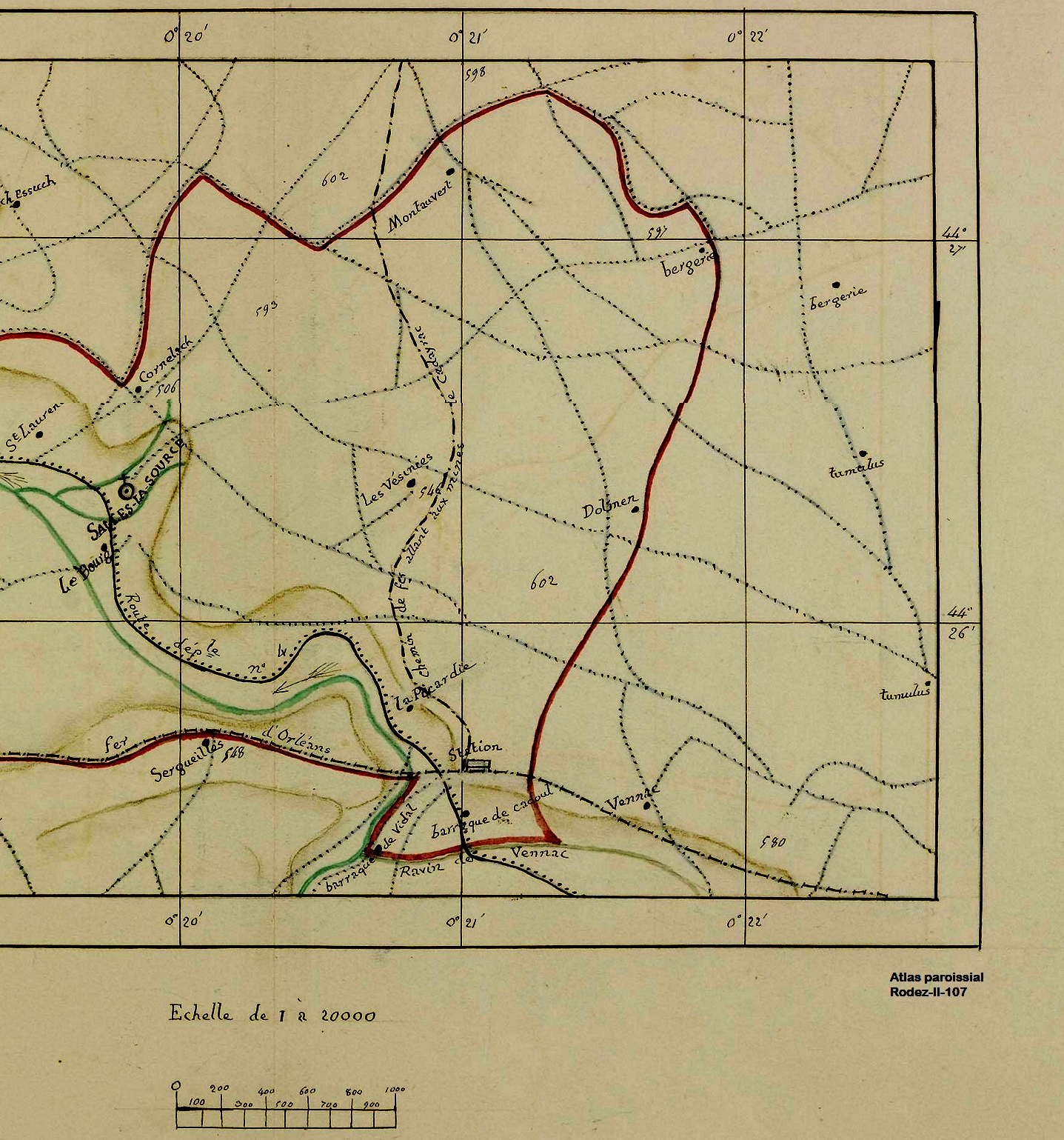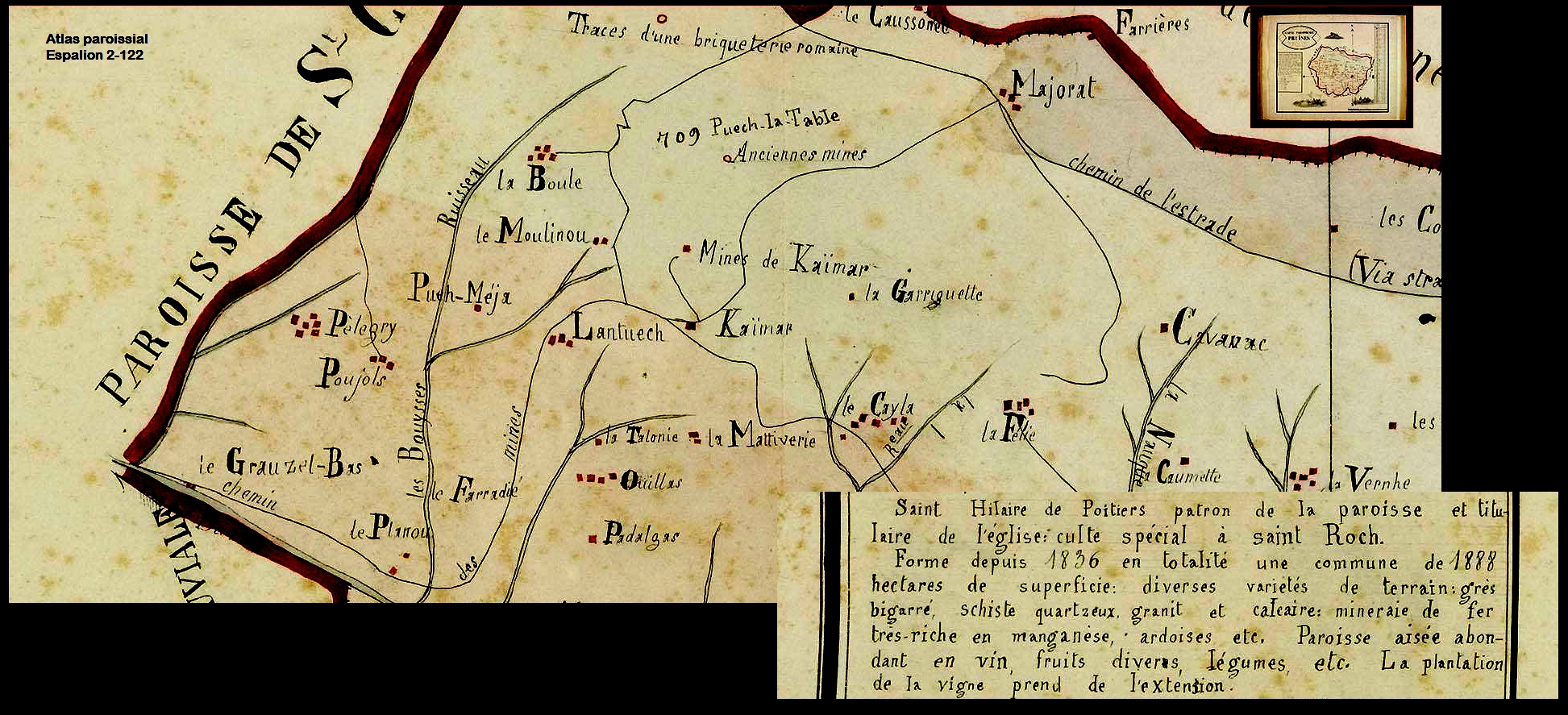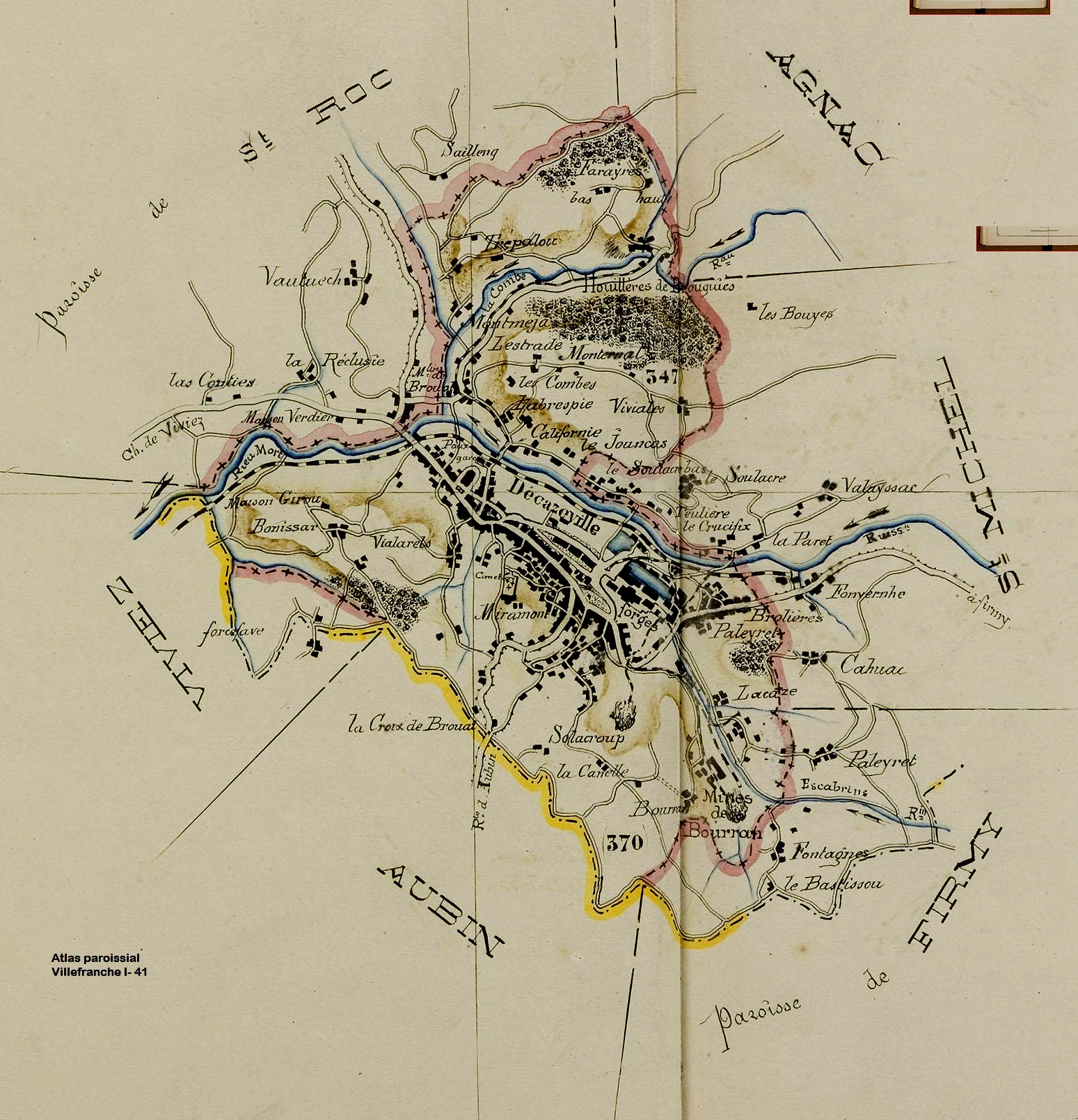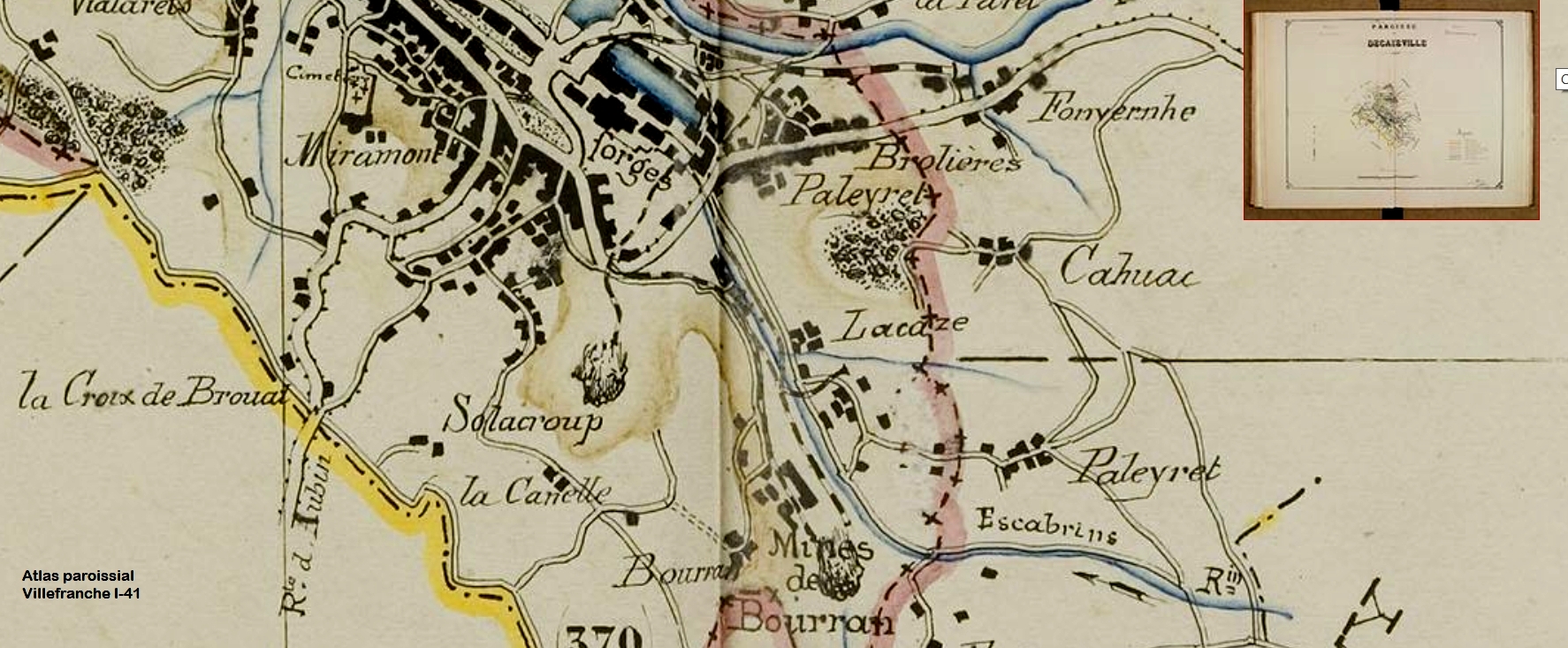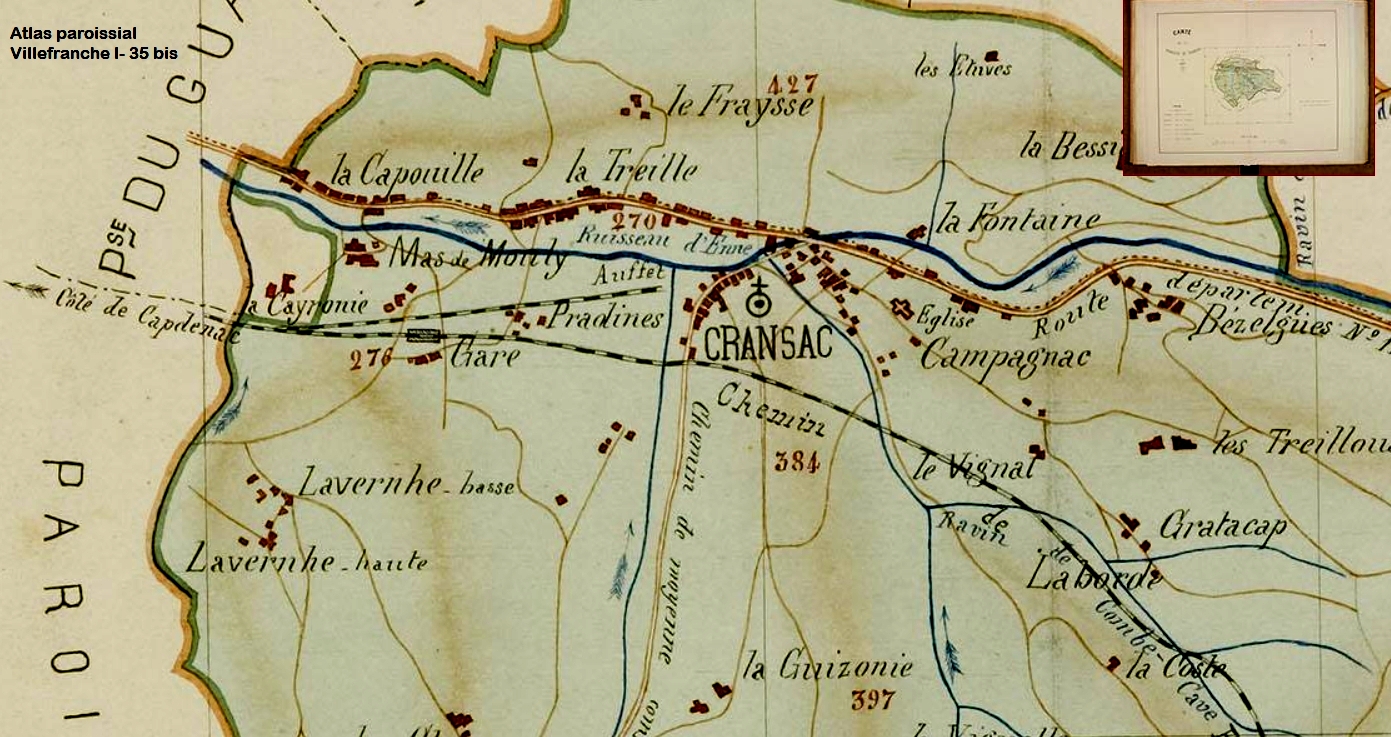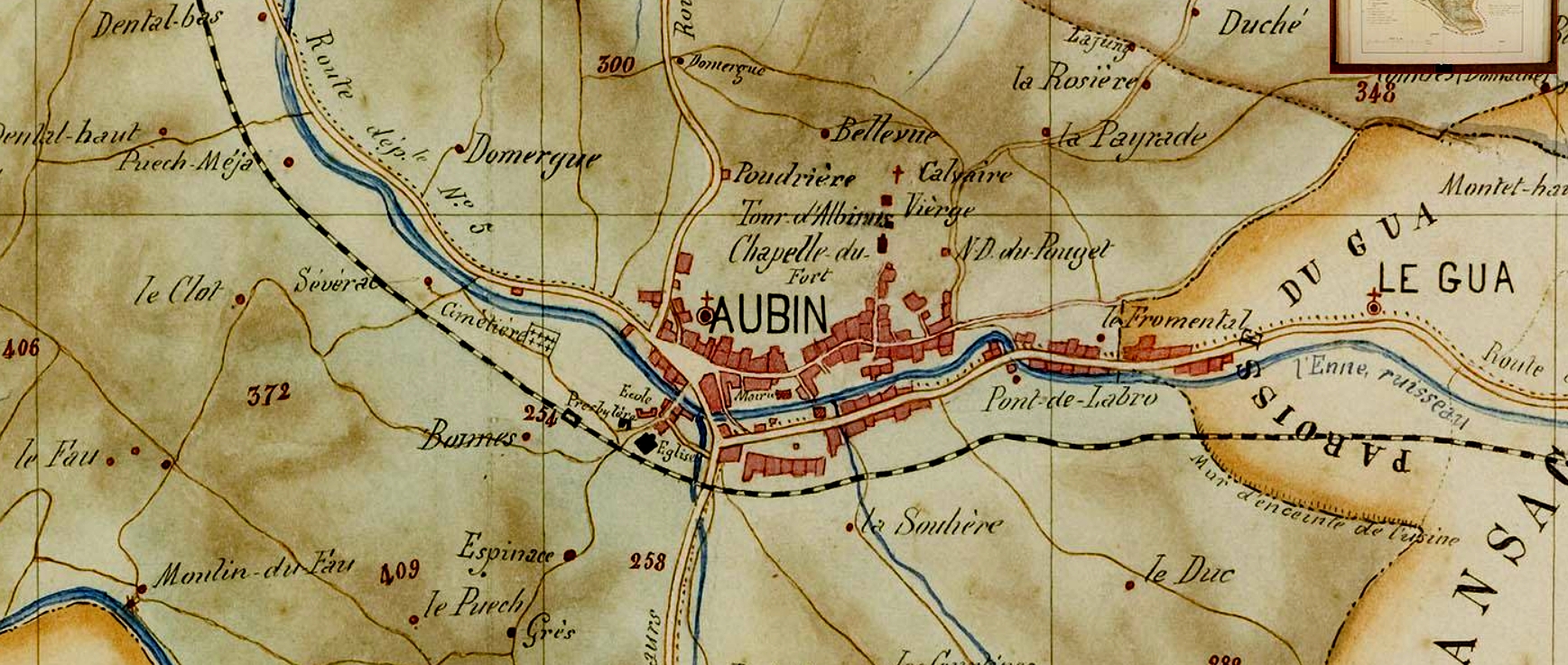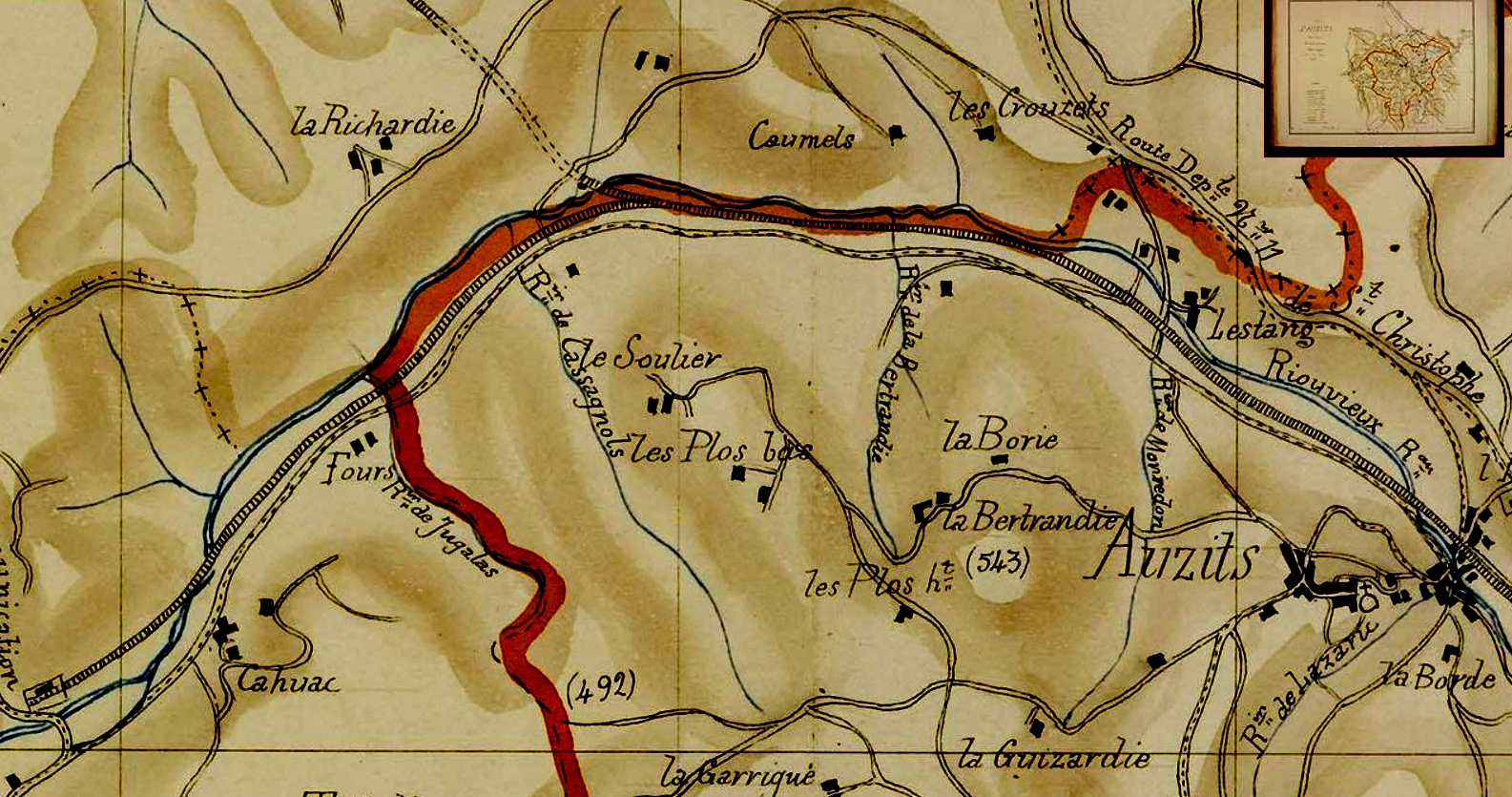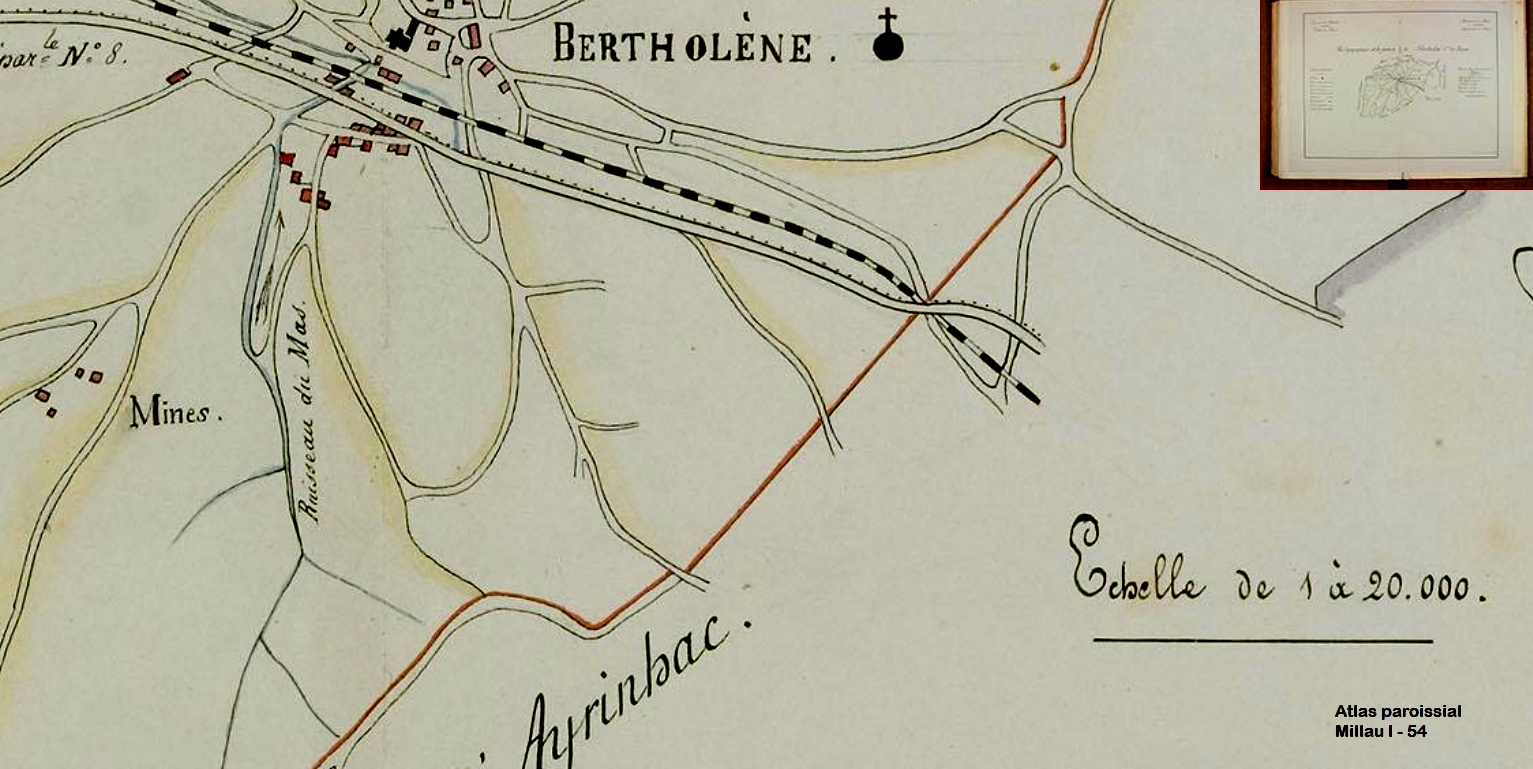Monseigneur Bourret, 1875
La Route du fer, pourpre…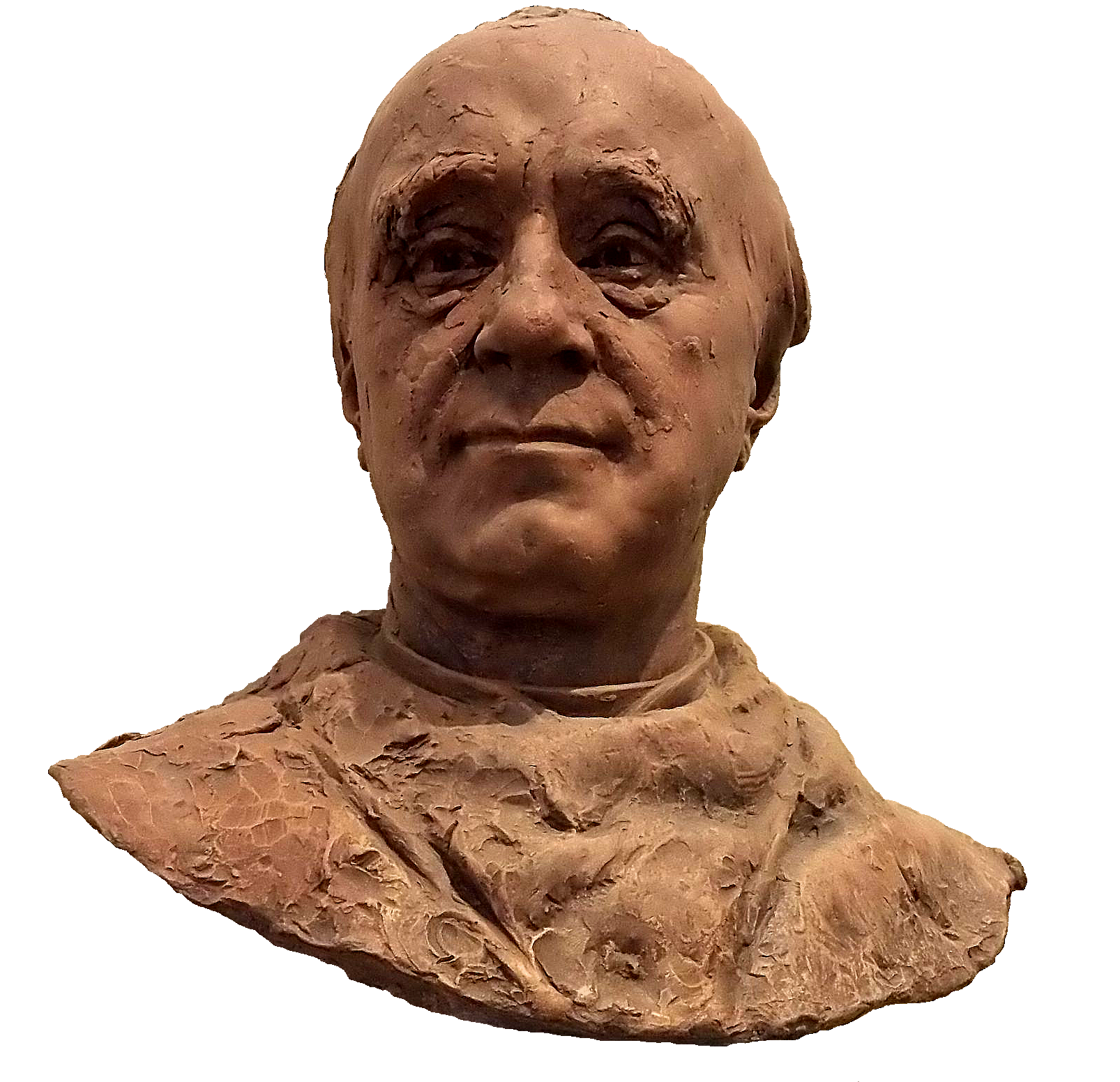
Cardinal Bourret, buste terre cuite Denys Puech, musée Denys Puech Rodez
Pourpre, comme la couleur du minerai ? Nous venons de rencontrer un cardinal sur la Route ! Avec quelques pépites dans ses poches ! Lorsqu’il est nommé évêque du diocèse de Rodez le 19 juillet 1871, l’ardéchois Ernest Bourret doit certainement chercher quelques informations précises peut-être difficiles à réunir sur ce diocèse, sans doute mal connu. Monseigneur sera effectivement ruthénois et aveyronnais en novembre (ou décembre) 1871. Monseigneur Bourret est à l’évidence un constructeur.
Si vous
souhaitez connaître un
peu mieux le futur cardinal, voir Jean-Clause
FAU, Le
Cardinal Ernest Bourret, évêque de Rodez
et de Vabres, 1871-1896, in Etudes
aveyronnaises 2017, p. 355-382, Société
des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, Rodez. Fait cardinal
en
1893, il
décède trois ans plus tard. Denys Puech, le sculpteur de François
Cabrol,
réalisera son tombeau, dans la cathédrale de Rodez.
◄ Photographie
P. Lançon, in Robert Taussat, Sept
siècles autour de la cathédrale de Rodez, Rouergue,
1992. Armoiries par J.
Poulet, même op.
◄ clic
Pour construire son ministère, il lui faut
connaître ce
diocèse, plus rural qu’industriel. En 1872 il parcourt son vaste
domaine et
c’est sans doute sur ces chemins plus ou moins défoncés qu’il imagine
alors son
Atlas, un atlas des paroisses, qui lui
donnerait pour chacune d’elles une
carte précise de son identité : routes, chemins,
habitations,
villages,
hameaux, usines…Bref, l'essentiel pour une bonne gestion. L’Atlas
cantonnal
(sic) de Baptiste Lacaze est bien connu de Monseigneur
Bourret, mais il
ne
trouvera pas exactement dans ses cartes cantonales une description fine
des
paroisses, le but de Lacaze n’était pas dans cette description du
territoire.
Alors puisque cet Atlas
paroissial n’existe pas, il faut le
réaliser !
C’est ce qu’il prescrira le 2 février 1875, un peu plus de trois ans
après son
arrivée. L’évêque rédige en ce sens une lettre circulaire.
Lettre circulaire du 2 février 1875
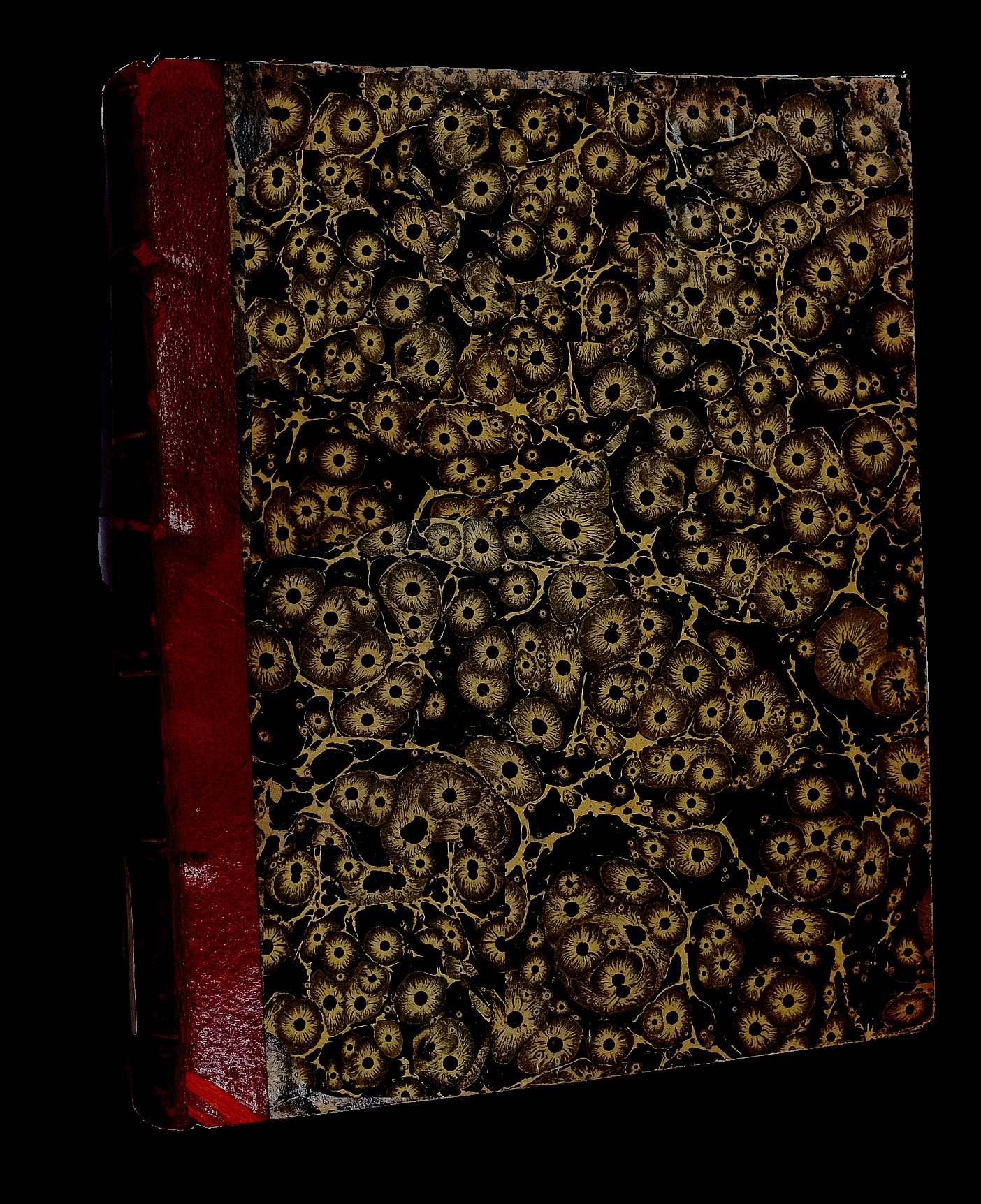 Le
Concordat de 1801 s'était limité à une énumération des
villages et hameaux compris dans une limite de paroisse. Cette
description
n'était plus suffisante en 1875 et des incertitudes apparaissaient lors
de
nouvelles constructions. C'est par cette première remarque que débute
la lettre
de Monseigneur Bourret*. Adressée au clergé de toutes les paroisses, il
y en a
plus de 600, et datée du 2 février 1875
elle prescrit donc la confection de la carte territoriale de toutes les
paroisses du diocèse. Une seconde évidence pour établir cet atlas tient
dans la
disparité des contours entre communes et paroisses. Pour
cela, Messieurs, je viens vous prescrire de faire dresser chacun
la carte territoriale de vos paroisses, annexes ou chapelles vicariales.
Et
Mgr Bourret se montre très directif : dimensions des feuilles, 52 cm de
haut et
64 cm de largeur, un papier fort, une marge de 4 cm…L'exemple des
feuilles de
l'Atlas cantonal Lacaze est donné. Pour cette élaboration, il propose
de mettre
à contribution des hommes compétents,
tels que les experts-géomètres, les agents-voyers, les géographes de
profession, les instituteurs capables…L'échelle est imposée, le
1/20.000,
soit 1 cm pour 200 mètres. Voilà pour la forme. Pour le contenu, il faut avoir soin de faire bien marquer
tous les accidents de terrain, rivières, ruisseaux, forêts, ravins,
collines,
montagnes, chemins vicinaux, sentiers, routes de diverses classes,
chemins de
fer, canaux, tout ce qui peut donner le plus de lumières sur le pays.
Il
continue par une énumération très précise des modalités graphiques et
couleurs
à employer. Les contours des paroisses seront évidemment un point
essentiel, la vraie difficulté. Près d'une page
propose une façon de faire pour résoudre cette difficulté.
Le
Concordat de 1801 s'était limité à une énumération des
villages et hameaux compris dans une limite de paroisse. Cette
description
n'était plus suffisante en 1875 et des incertitudes apparaissaient lors
de
nouvelles constructions. C'est par cette première remarque que débute
la lettre
de Monseigneur Bourret*. Adressée au clergé de toutes les paroisses, il
y en a
plus de 600, et datée du 2 février 1875
elle prescrit donc la confection de la carte territoriale de toutes les
paroisses du diocèse. Une seconde évidence pour établir cet atlas tient
dans la
disparité des contours entre communes et paroisses. Pour
cela, Messieurs, je viens vous prescrire de faire dresser chacun
la carte territoriale de vos paroisses, annexes ou chapelles vicariales.
Et
Mgr Bourret se montre très directif : dimensions des feuilles, 52 cm de
haut et
64 cm de largeur, un papier fort, une marge de 4 cm…L'exemple des
feuilles de
l'Atlas cantonal Lacaze est donné. Pour cette élaboration, il propose
de mettre
à contribution des hommes compétents,
tels que les experts-géomètres, les agents-voyers, les géographes de
profession, les instituteurs capables…L'échelle est imposée, le
1/20.000,
soit 1 cm pour 200 mètres. Voilà pour la forme. Pour le contenu, il faut avoir soin de faire bien marquer
tous les accidents de terrain, rivières, ruisseaux, forêts, ravins,
collines,
montagnes, chemins vicinaux, sentiers, routes de diverses classes,
chemins de
fer, canaux, tout ce qui peut donner le plus de lumières sur le pays.
Il
continue par une énumération très précise des modalités graphiques et
couleurs
à employer. Les contours des paroisses seront évidemment un point
essentiel, la vraie difficulté. Près d'une page
propose une façon de faire pour résoudre cette difficulté.
Cette carte paroissiale que nous vous demandons, Messieurs, doit être faite en double exemplaire, l'un pour la Fabrique et l'autre pour les archives de l'Evêché. Les frais qu'elles pourront entraîner seront à la charge des fabriques que nous imposons à cet effet d'office, si par hasard, ce que nous ne pouvons pas soupçonner, quelque fabrique montrait peu de bonne volonté pour cette œuvre qui est de première importance pour elle.
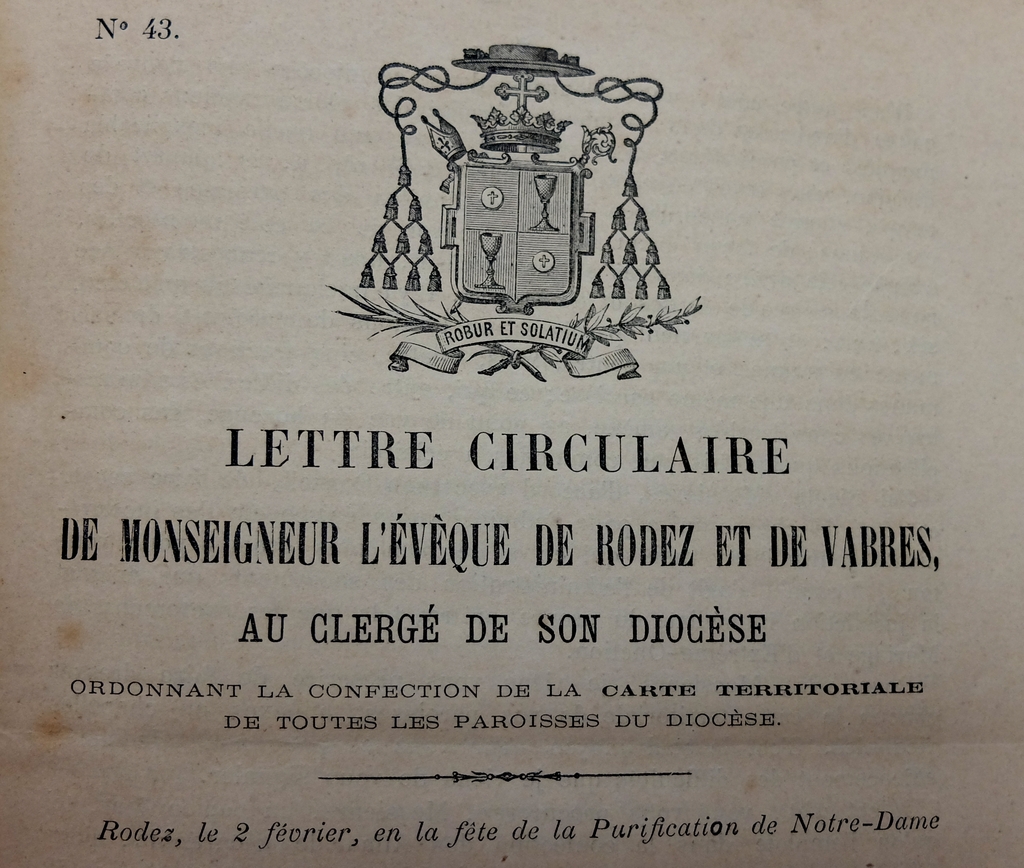
Il y a dans cette lettre tout ce qui est nécessaire dans un cahier des charges bien compris. On aurait pu penser à priori à une autre solution : reporter sur les cartes de l'Atlas départemental les contours des paroisses. Cette possibilité avait plusieurs inconvénients : l'échelle de l'Atlas Lacaze ne permet pas une description fine des contours paroissiaux, et, surtout, la non concordance entre ces contours et ceux des communes rend cette utilisation du Lacaze quasi impossible. Pour information, il y a en 1881 exactement 300 communes dans le département, et plus de 600 paroisses...(Géographie du Département de l'Aveyron, A. Joanne, Hachette, Paris, 1881). Il faudra donc faire du neuf, ce que propose Mgr Bourret en 1875. Nous n'avons pas retrouvé de dossier faisant un point d'avancement précis du projet. On peut raisonnablement penser que les cartes, 678, ont ainsi été réalisées dans les années 1876-1880. Dans le courrier de l'Evêque, un avis divers, à la suite d'une lettre circulaire du 6 août 1876, demande de hâter le plus possible l'exécution des cartes. Cet avis demande également de faire figurer les degrés, ou plutôt les minutes et les secondes des degrés de latitude et de longitude.
------------------
*Archives diocésaines Rodez, 1C11, Monseigneur BOURRET, Lettres et mandements, 42-78, 1876-1881, imprimé par Carrère, Rodez, lettre circulaire n° 43, 2 février 1875.
Le Répertoire des lettres (8H9) ne fait pas mention de cette lettre. Elle n'a pas été publiée ni mentionnée dans la Revue Religieuse de Rodez et de Mende (2 APer 1(11)) pour l'année 1875.

La forme
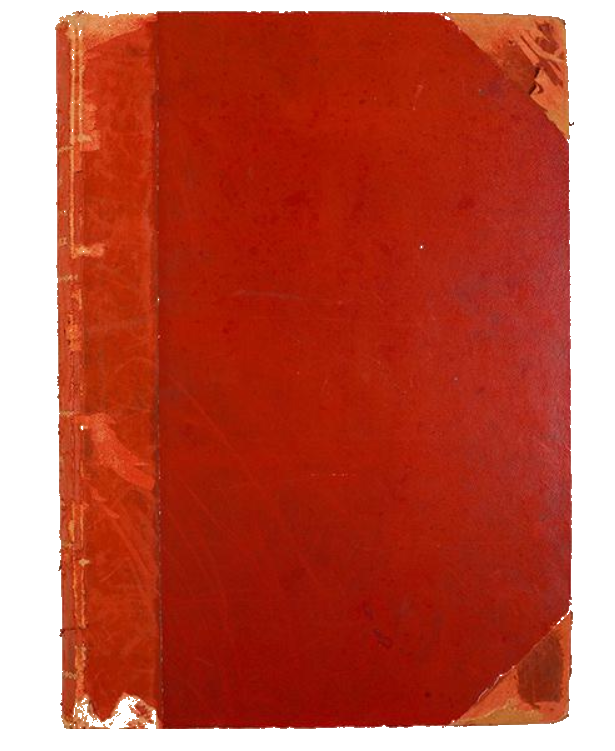
L’Atlas cantonal
Lacaze avec ses 42 cartes au 1/50.000 est un bel ouvrage. Mais l’Atlas paroissial est bien plus imposant ! Il va réunir
678 cartes
de paroisses -21 paroisses ne sont pas pourvues- en 11 volumes, avec
reliures rouges
évidemment : deux pour
chacun des doyennés d’Espalion, Millau, Saint-Affrique et
Villefranche-de-Rouergue, et trois volumes pour Rodez. L’échelle est
généralement le 1/20.000, même si quelquefois on rencontre le 1/10.000,
ou
1/12.500. Les auteurs des cartes sont divers, et leur formation bien
évidemment
différente. On peut trouver un curé, un instituteur, ou un architecte.
Certains
de ces auteurs ont aussi réalisé plusieurs cartes. Le graphisme peut
être
dépouillé, très dépouillé même pour quelques-unes, à très fouillé et
soigné. La
carte de Colombiès est ainsi un véritable tableau, aquarellé. Très
souvent
un dessin de l’église figure, accompagné quelquefois de plans, coupes,
et
dessins d’autres ouvrages. Les auteurs ont aussi tenu parfois à
compléter leur
travail cartographique avec une courte notice de présentation de la
paroisse.
C’est le cas de Cadayrac, carte présentée plus avant. La couleur n’est
pas
systématique, les légendes non uniformes, et la plupart des cartes ne
sont pas
datées. La lettre de Monseigneur Bourret étant datée de février 1875,
on peut raisonnablement dater l'Atlas
vers 1878-1880 pour les débuts. Elles ne sont enfin généralement pas
signées de leur auteur.
 L’Atlas
paroissial du
cardinal Bourret est évidemment une œuvre unique*, à destination de
l'évêque et de ses services. Sa fragilité et son
caractère
exemplaire lui ont valu - une
excellente initiative des archives diocésaines- d’être
numérisé. Le résultat, tables et les 11
volumes
de cartes sont disponibles sur le site** http://bvmm.irht.cnrs.fr/ de la BVMM, Bibliothèque
virtuelle des manuscrits
médiévaux. Un volume séparé de l’Atlas, les tables,
présente une liste des paroisses et permet de retrouver rapidement le
volume
concerné.
L’Atlas
paroissial du
cardinal Bourret est évidemment une œuvre unique*, à destination de
l'évêque et de ses services. Sa fragilité et son
caractère
exemplaire lui ont valu - une
excellente initiative des archives diocésaines- d’être
numérisé. Le résultat, tables et les 11
volumes
de cartes sont disponibles sur le site** http://bvmm.irht.cnrs.fr/ de la BVMM, Bibliothèque
virtuelle des manuscrits
médiévaux. Un volume séparé de l’Atlas, les tables,
présente une liste des paroisses et permet de retrouver rapidement le
volume
concerné.
* Exemplaire unique ? Nous avons rappelé ci-dessus que Mgr Bourret avait prescrit l'établissement de deux cartes par paroisse. Il devrait donc être possible de retrouver dans les fabriques le second exemplaire...sauf pertes, disparition...
**
sur le site BVMM, https://bvmm.irht.cnrs.fr/
onglet Recherche, puis Rodez, puis Archives
diocésaines. Les Atlas et tables sont en fin de liste.
Avant de sortir la loupe, il faut enfin
souligner la
confiance que
nous pouvons avoir dans ces documents. Leurs auteurs sont en effet au
plus près
du terrain, et ont de plus consciencieusement parcouru ou (re)parcouru
leurs
domaines avant de répondre aux injonctions de Monseigneur Bourret. Une
curiosité : la paroisse de Conques n’est pas pourvue de carte,
alors que
la visite détaillée préalable avait été conduite…(voir Mémoires Société des lettres,
sciences et arts de l'Aveyron, tome 11, 1874-1878, p. 195 sqq)
A la loupe
Paroisse de Cadayrac-Rodez II-98-1878
Cette carte est déjà présente sur notre site,
mais dans une
autre présentation, et avec quelques différences. Au-delà de sa
présentation
très
soignée, on notera :
►
la voie ferrée de Cadayrac appartenant à la compagnie d’Orléans
(Aubin).
A l’écartement de 110 cm, elle conduit le minerai à la station de
Souyri, gare
de transbordement construite pour cet usage.
►
les
mines : ici, l’étendue est suggérée par un joli graphisme rouge.
L’affleurement de Rosières, un peu à l’ouest est dessiné.
►
temple
romain, enceinte romaine et amphithéâtre sont présents, et témoignent
de la
richesse archéologique des lieux. Au passage, les constructeurs miniers
n’ont
pas hésité à « franchir » par trois fois l’enceinte…
►
l’indication
Grand Central pour la voie ferrée de Rodez à Aubin, mais le Grand
Central est
dissous depuis plus de 10 ans.
Paroisse de Mondalazac-Rodez II-101-1/20.000
Remarquable carte ! Elle apporte des
nouveautés.
► au nord-est de Mondalazac, deux sites
d’extraction sont portés. Et le dessinateur a tenu à faire figurer les
deux
courts chemins de fer miniers permettant alors le transport du minerai
à la
route voisine. Belles pépites ! C’est la seule carte -de
nous
connue-
faisant figurer ces deux voies. L’exploitation de Maillabuau en
surface, puis
légèrement en galeries, fut rapidement abandonnée devant les risques
courus par
les habitations voisines.
► Avec un certain respect, Maisons de Cruou,
pour quelques riches
demeures d’exploitants de vignes. La route du Cruou n’est pas encore
prolongée
vers l’est pour rejoindre Frontignan et Ferals, orthographié Farrals.
Paroisse de
Solsac-Rodez II-109-1/20.000
► La Mine. Ici un affleurement de
minerai fut exploité, en galeries. Une voie minière, que n’indique pas
la
carte, existait pour rejoindre la Baraque du Plateau. A la date de
confection,
la mine n’est plus exploitée.
Paroisse
de
Marcillac-Rodez II-96-1/20.000
► La voie minière de la compagnie de
Decazeville, réalisée en 1856 est évidemment indiquée. Elle se termine
tout
près de la route, qui permet aux charrois d’approvisionner la gare
minière.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, rejoindre Solsac et le causse
par la
vallée du Cruou n’est absolument pas aussi linéaire…
Paroisse
de
Valady-Rodez III-165 -1/20.000
► Même non légendées, on repère sans
difficultés les deux voies ferrées : voie « normale » au
bas du
dessin, et voie minière tout en haut. Le fameux viaduc de l’Ady n’a pas
eu
droit à une quelconque mention, mais la construction voisine est
présente. Elle
servait d’écuries aux premiers temps d’exploitation, et éventuellement
de dépôt pour une machine.
Paroisse
de
St-Christophe-Rodez III-173 1/20.000
► la voie pour l’exploitation du minerai de
Décazeville (sic) est portée sur
cette carte. Tout en bas, à gauche, la voie vers Aubin figure, avec la
station
(la gare) de St-Christophe. Les deux graphismes sont regrettablement
très
voisins, malgré la différence d’écartement. A St-Christophe il y a une
-vraie- curiosité :
la voie présente une forte courbe, un S, en allant vers La
Cayrède et
Decazeville. Une
erreur de tracé ? Sans doute pas, au vu de la précision qui la
fait passer
à proximité de deux constructions. La topographie permettrait
effectivement ce détour. Mais nous n’avons pas d’explications
assurées sur
l’existence ou non de cette boucle qui n’apparaît pas dans la carte de
l’Atlas
Lacaze, carte plus ancienne...La carte Romain,
contemporaine de Lacaze, vers 1860, ne fait pas mention non plus de
cette
boucle.
Alors ? Une déviation, faite donc après construction ? Une seconde
voie, l'autre permettant l'arrêt de wagons et machines ? Une
énigme ! La carte de l'atlas napoléonien, établie ici vers 1830,
ne permet non plus d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce
soit...
Paroisse
de
Salles-la-Source-Rodez II-107 -1/20.000
Avant
de
quitter le causse pour rejoindre les usines, une vue de
Salles-la-Source.
► Ici
aussi, le graphisme ne permet pas de différencier les écartements des
deux
voies ferrées : les wagons de l’une ne peuvent aller sur l’autre
et
réciproquement ! Le chemin de fer allant aux mines de Cadayrac
passe à
l’est des Vésinies. Son tracé est (assez) approximatif...Malgré des
indications d’altitude, on ne peut
deviner
l’imposante tranchée présente, permettant ici à la voie de traverser la
butte.
De nombreux chemins facilitent les circulations.
Paroisse
de
Pruines-Espalion II-122
La compagnie de Decazeville possédait ici une concession, au Kaymar. Le chemin des mines, les mines elles-mêmes près de Kaïmar, et des anciennes mines ont retenu l’attention du dessinateur. L’absence d’indications nombreuses d’altitude ne permet pas d’imaginer les difficultés des convois sur le chemin des mines. Aux mines nous sommes à près de 709 m : la descente va être rude ! Dans le cartouche qui accompagne la carte, une indication assez amusante : mineraie (sic) de fer très riche en manganèse…
Paroisse
de
Testet- Rodez III-174
► Depuis le Riou Negre, la voie
minière rejoint le Plateau d’Himes, avant la longue descente vers
Firmi. On notera
qu’auparavant un long tunnel, de l’ordre du kilomètre est présent avant
les
Hermets. Le tunnel n’est jamais mentionné sur les cartes, tout comme
son
homologue en longueur à Marcillac qui n’a pas eu droit à une quelconque
mention. Evidemment tous les autres tunnels de la ligne sont
superbement
ignorés.
Paroisse
de
St-Julien-de-Malmont-Rodez II-106
On
quitte ici
le district diocésain de Marcillac.
Paroisse
de
Firmy-Villefranche I-36
Les
paroissiens
de Firmy sont-ils fâchés avec la Compagnie ? Ils le furent
souvent !
►
Aucune trace de voies ferrées minières sur la carte ! Par contre
on note
les usines, les écuries et autres barraques de la mine. La Forésie,
lieu
emblématique n’est pas particulièrement mis en valeur. Le plan d’eau,
nécessaire pour les usines est bien présent.
Paroisse
de
Decazeville-Villefranche I-41-1/20.000
Contrairement
à
Lacaze, qui est inexplicablement assez muet sur les installations
industrielles, la carte paroissiale est riche dans ce domaine. Vous
retrouverez
les forges, mines, voies ferrées, minières peu présentes, et normale…
Paroisse
St-Michel-Villefranche I-46
Entre
les
paroisses de Firmy et Decazeville, St-Michel. Rien de particulier pour
cette
carte minimaliste. On notera la gare, Fonvergnes, et le plan incliné,
une
curiosité à montrer à l’évêque…La maison Mercadié a droit à une mention
spéciale !
Paroisse
de
Cransac-Villefranche I-35 bis -1877
Nous
changeons
de vallée, pour celle de l’Enne, et de compagnie pour celle d’Orléans.
L’embranchement ferré se remarque près de la gare. Tout en haut, les Etuves.
Paroisse
d’Aubin-Villefranche I-34
Le
Calvaire, la
Vierge, la Chapelle…Une seule mention pour les usines, mur
d’enceinte de l’usine…On semble aussi discret ici qu’à Cransac :
l’imbrication industrielle est telle qu’il est difficile de la
mentionner ?
Paroisse du
Gua-Villefranche I-37-1/20.000
Entre
Aubin et
Cransac, Le Gua.
► on note les forges, les crassiers, le mur d'enceinte de la
forge et
les vieilles Casernes. Sous ce terme on désigne
des habitations ouvrières.
La voie ferrée de la compagnie d’Orléans traverse un ensemble
industriel
imposant.
Paroisse
d’Auzits-Villefranche I-35
Une
carte
agréable pour son rendu du relief. La voie ferrée d’Aubin suit un temps
le
Riouvieux, ruisseau bien nommé, avant un tunnel à l’ouest. Et juste
avant, un
embranchement conduit aux mines d’Auzits, vers Cahuac. Cet
embranchement est
généralement non mentionné sur les documents cartographiques.
Paroisse
de
Gages- Millau I-58
La
concession
de Gages fut importante historiquement. Près d’ici, le charbon de
Sensac allait
à Muret rejoindre le minerai. C’était en 1804, et la métallurgie
(industrielle)
apparaissait ainsi en Rouergue. A Gages, c’est à Alboy que
l’exploitation se
faisait.
Paroisse
de
Bertholène-Millau I-54
Les mines de Bertholène. La concession court toujours, en 2018…A l’est de ces mines de houille, un affleurement de minerai de fer existe, vers Ayrinhac. Les deux compagnies rivales, celle de François Cabrol, et celle d’Aubin, avec Cadiat, avaient déposé des demandes de concession sur ces flancs des Palanges. Aucune suite ne fut donnée.
Une conclusion ?
Réussir en quelques
années à réunir plus de 600 cartes est une
véritable réussite. Cet ensemble, pour ce qui concerne le thème de la
Route du Fer, permet une compréhension correcte de la réalité. La
lacune la plus importante concerne peut-être les paroisses d'Aubin et
de Cransac. Mais que regretter réellement ? Un dessin, très difficile à
cette échelle, et finalement assez peu explicite ? L'Atlas paroissial
complète parfaitement l'Atlas cantonal
et les cartes
Romain.
Si vos pas vous amènent
à croiser Monseigneur Bourret, dites lui merci !