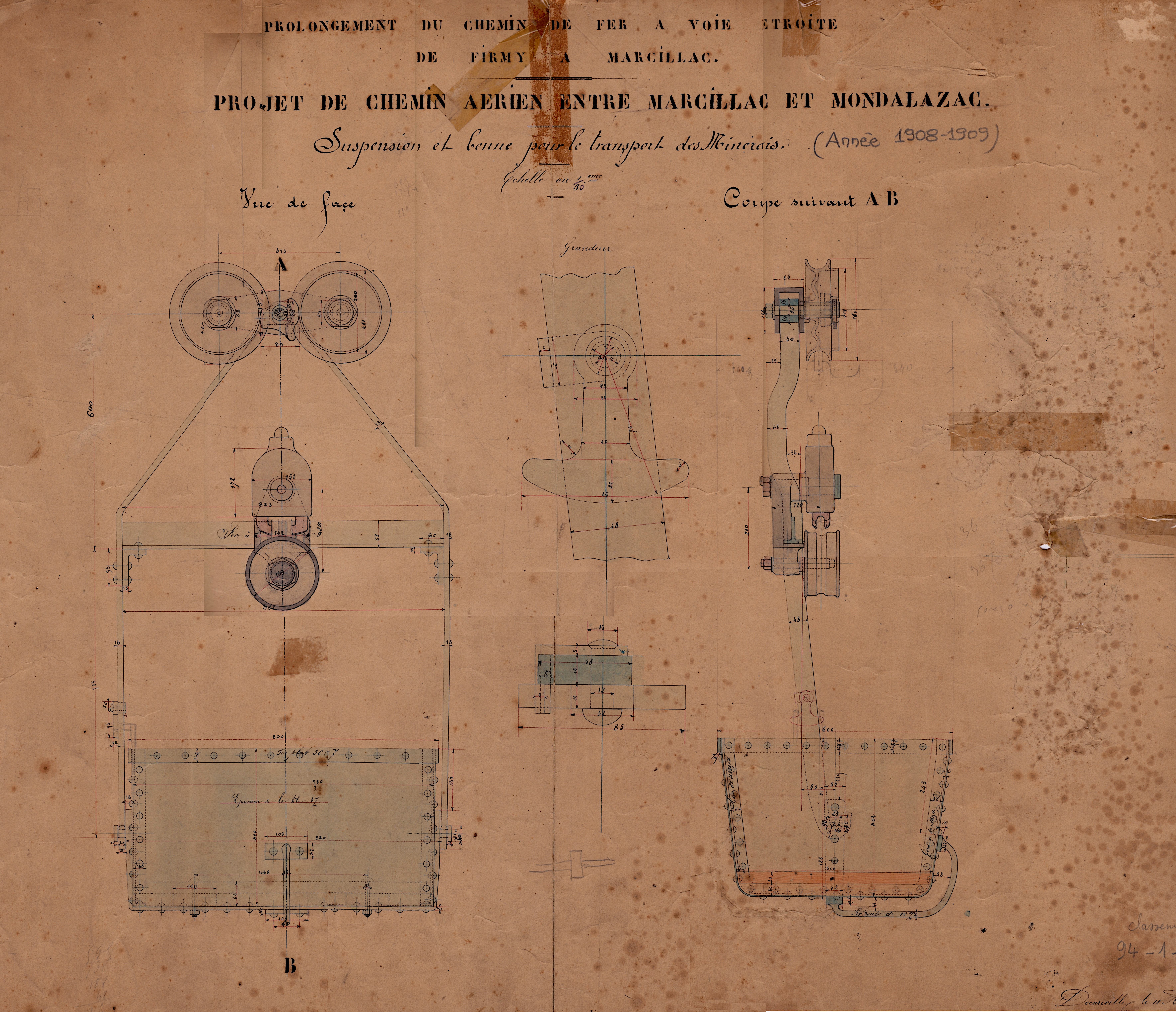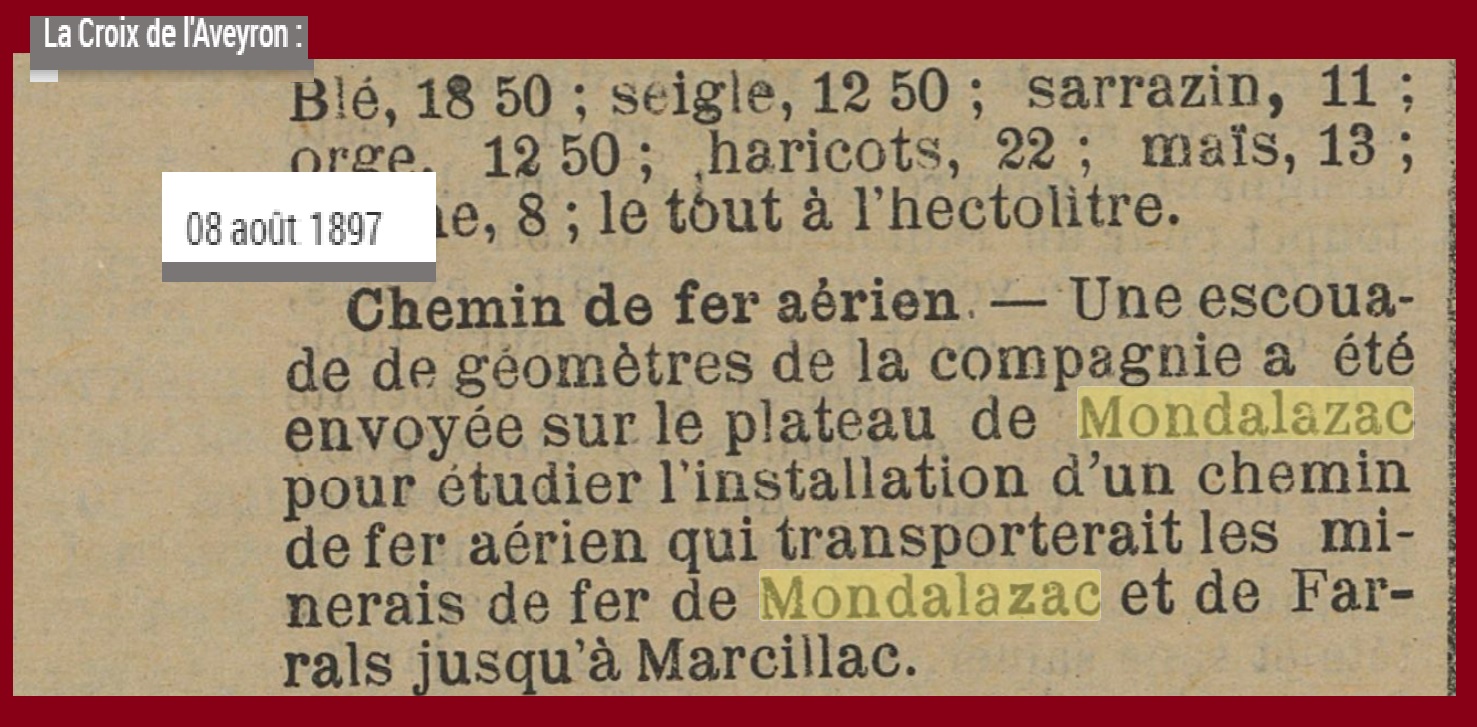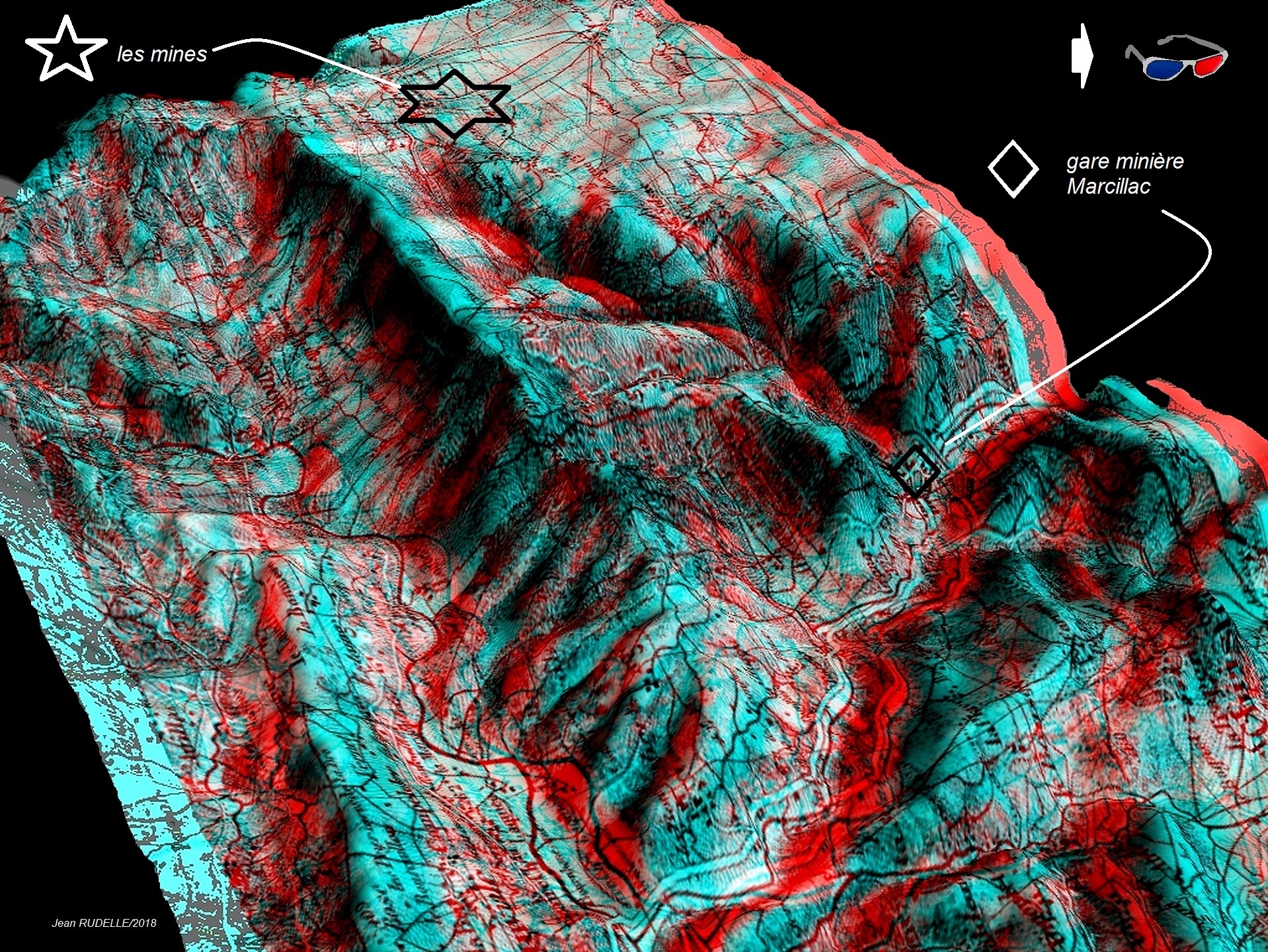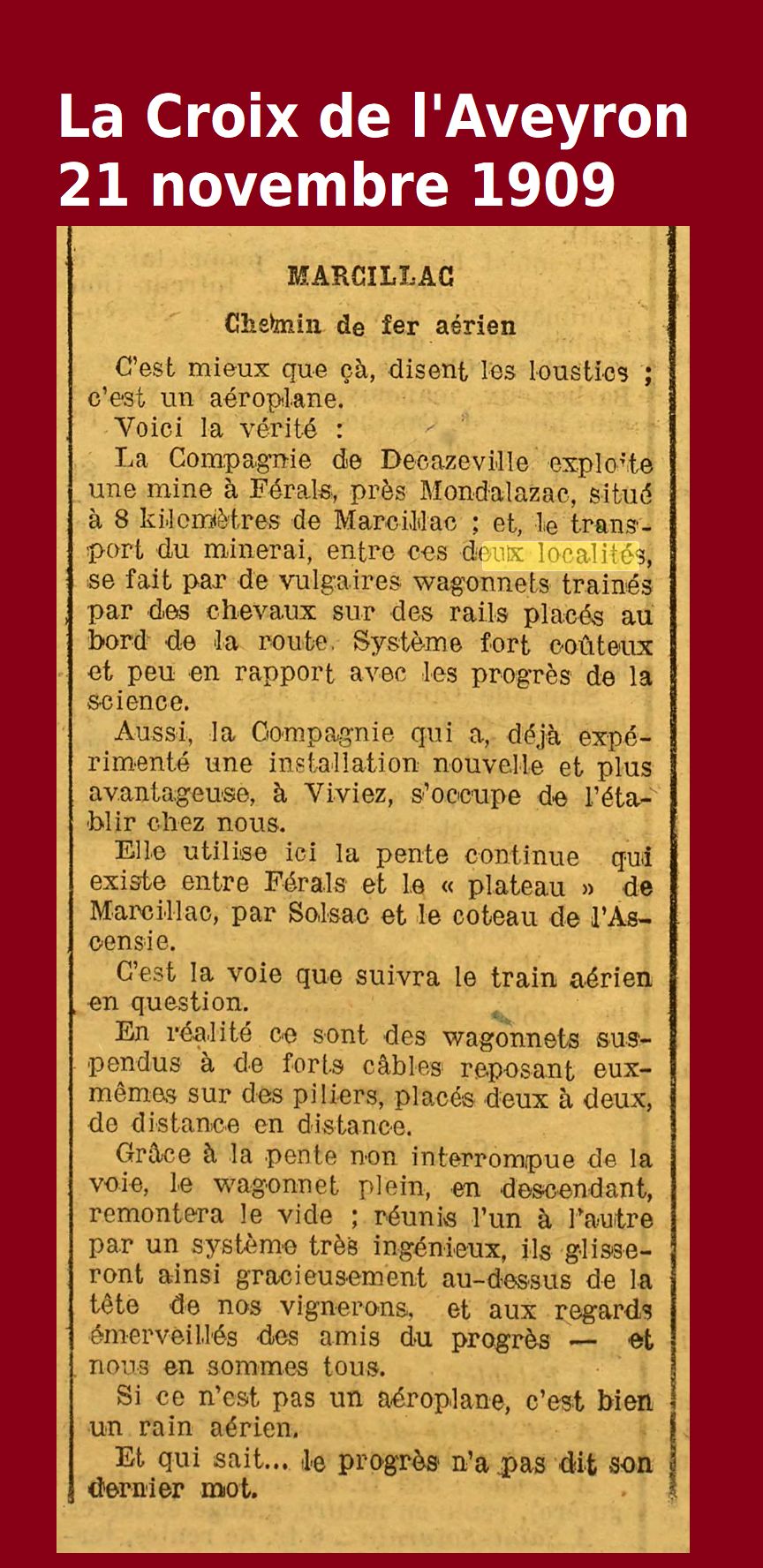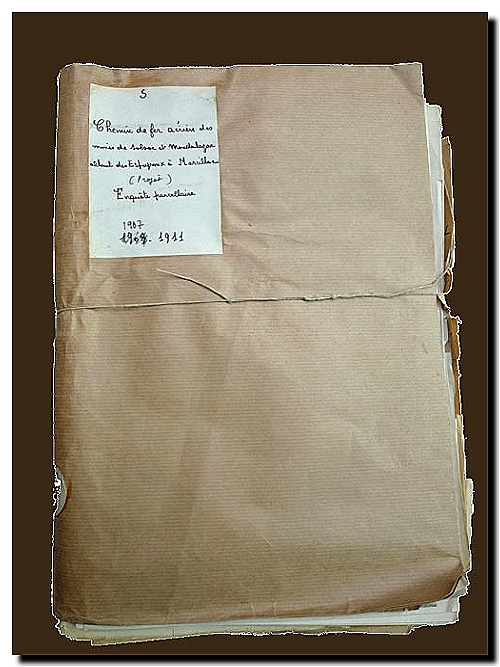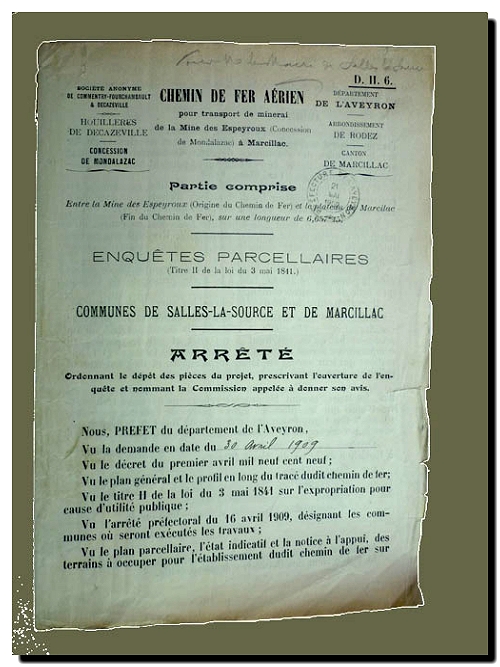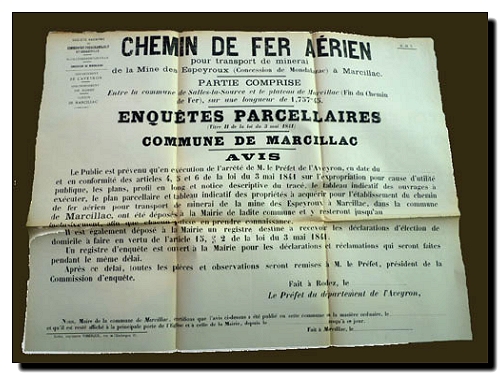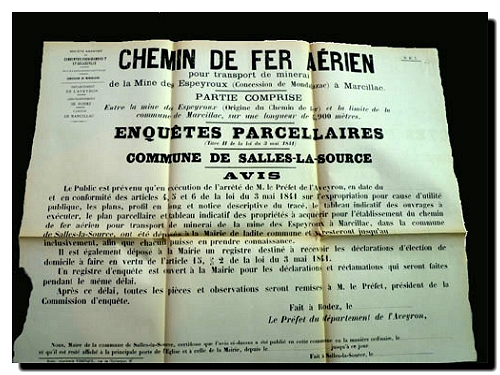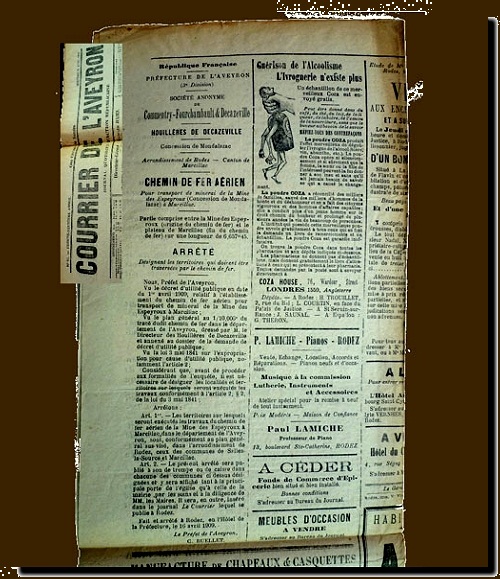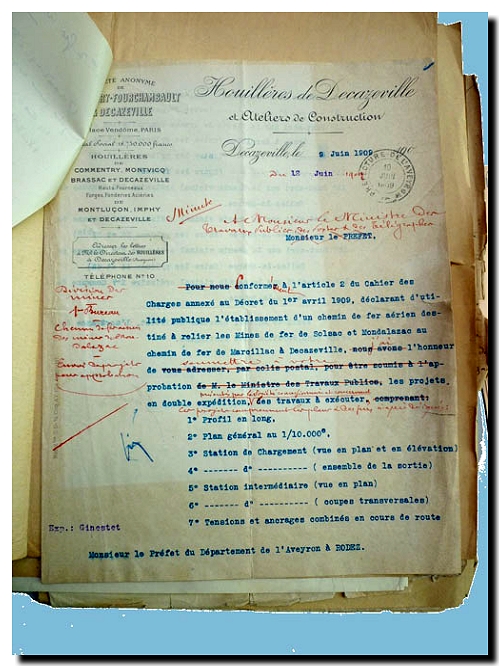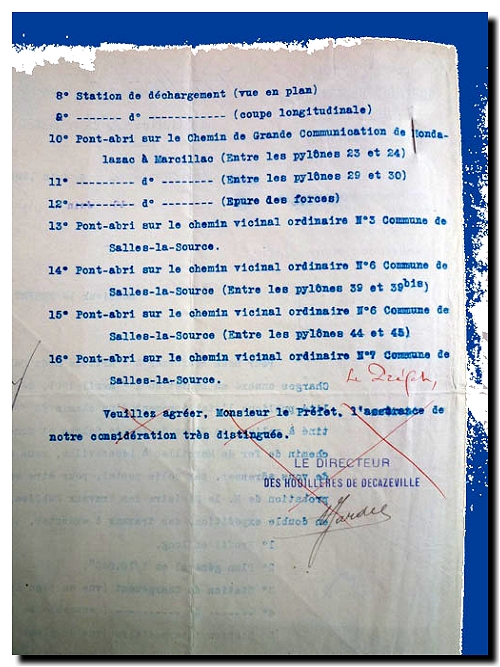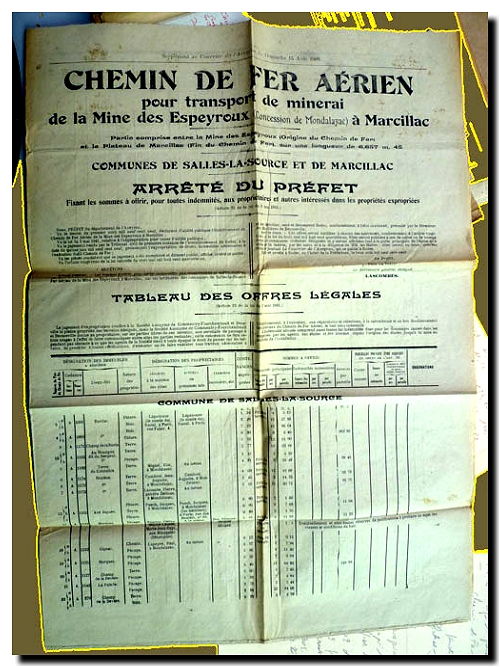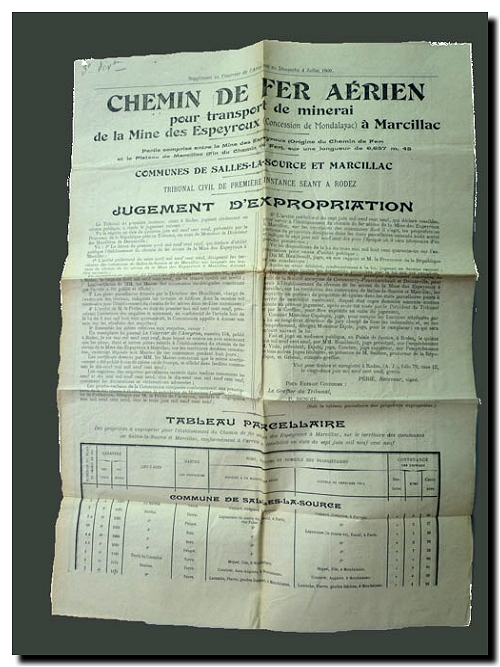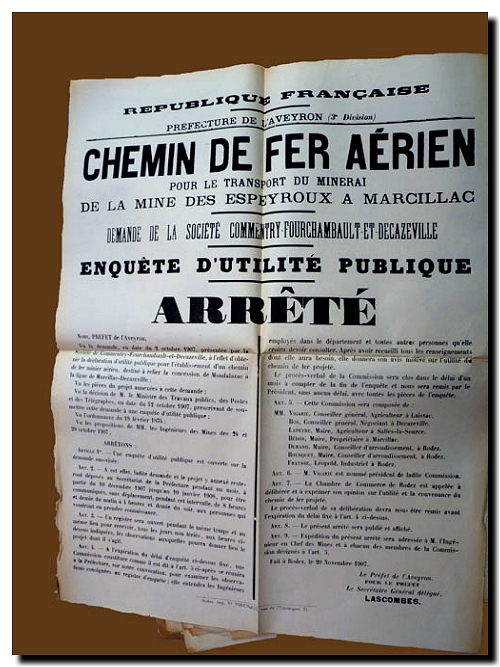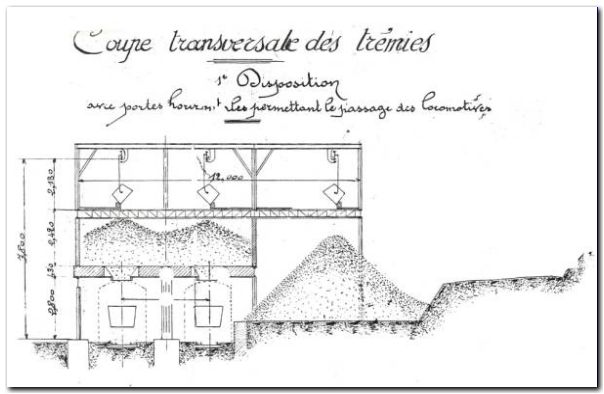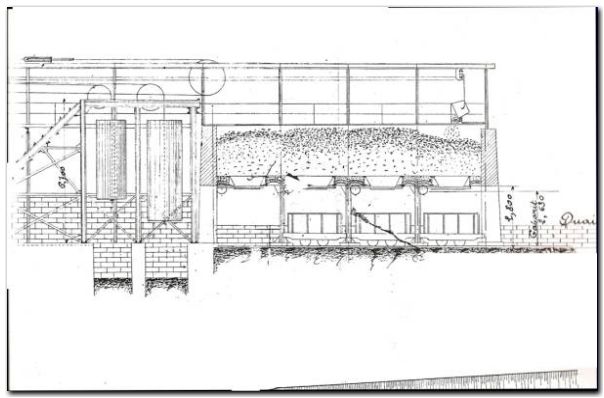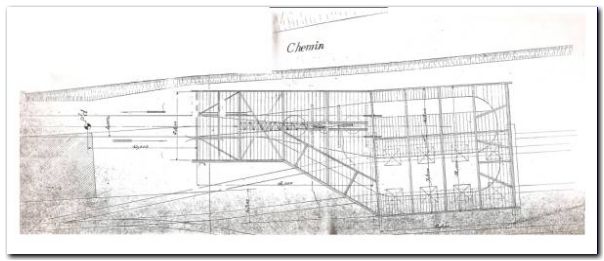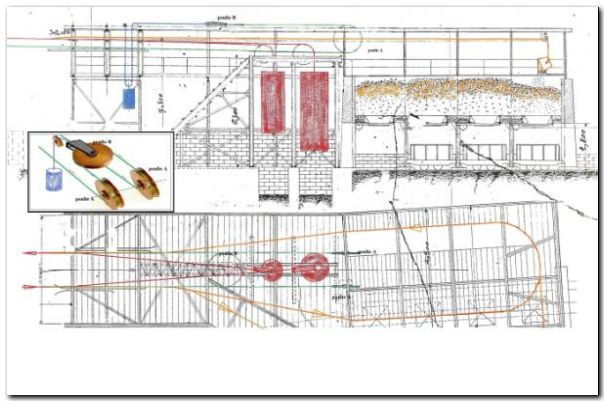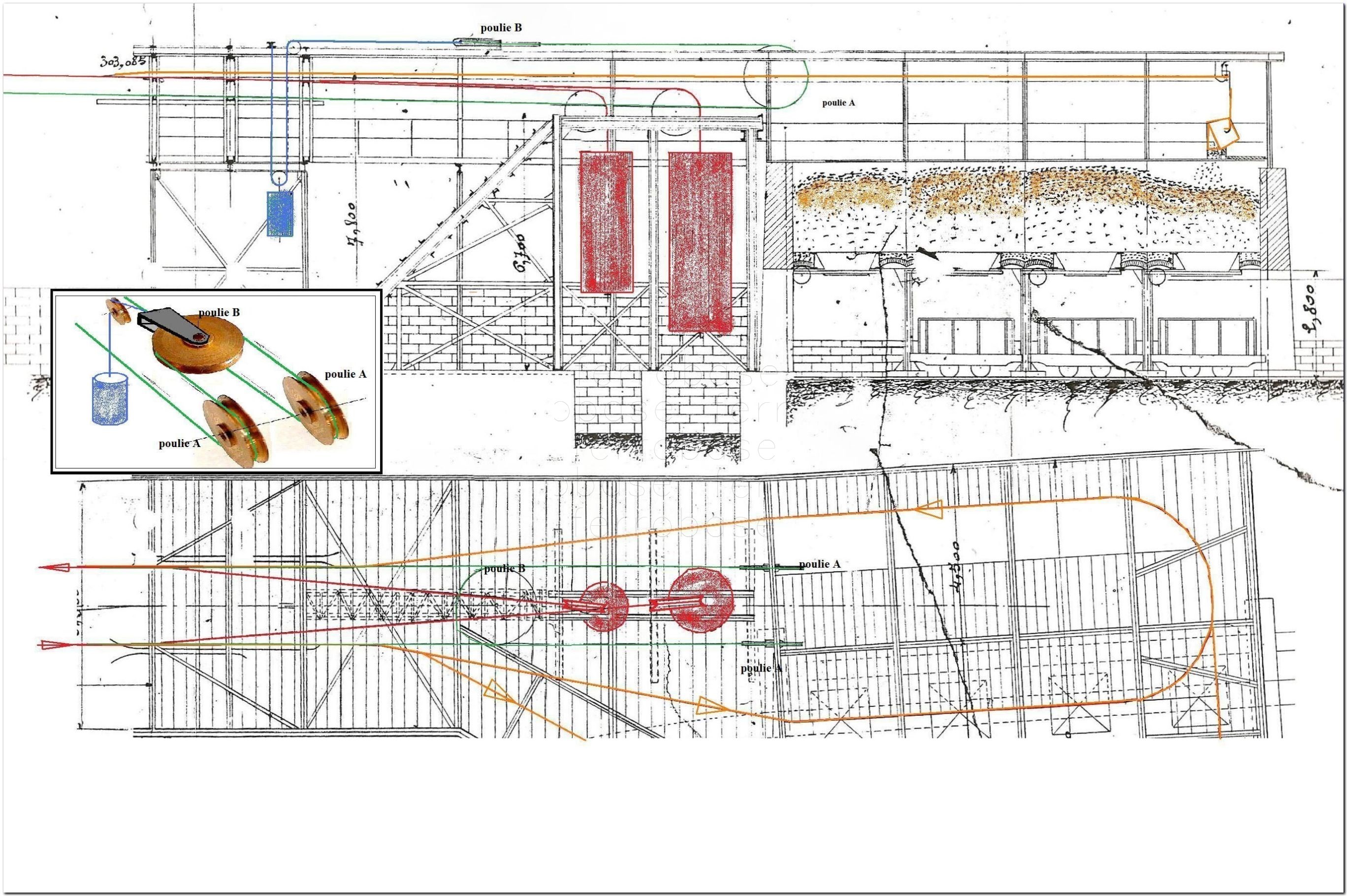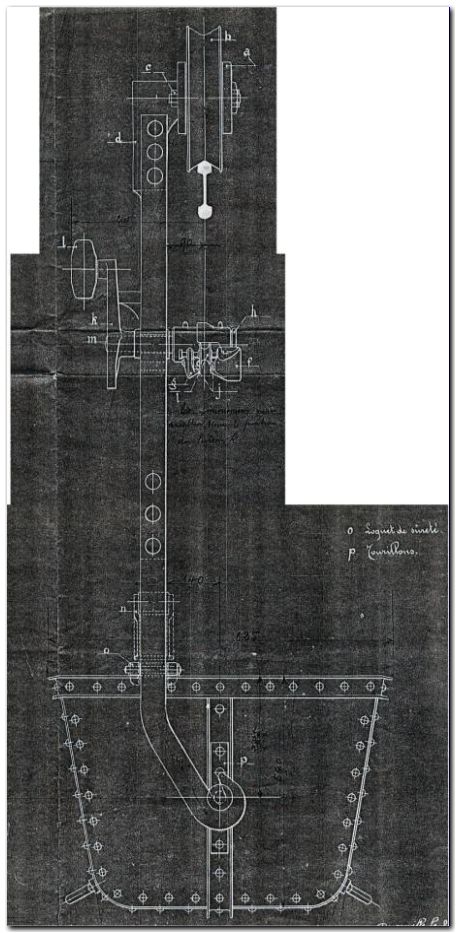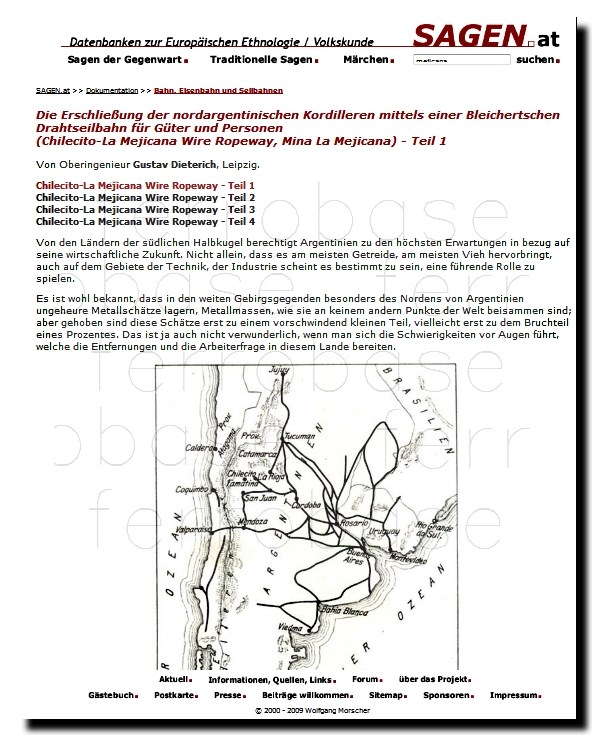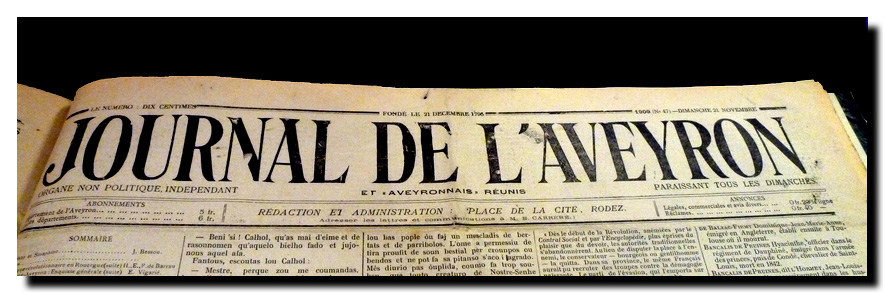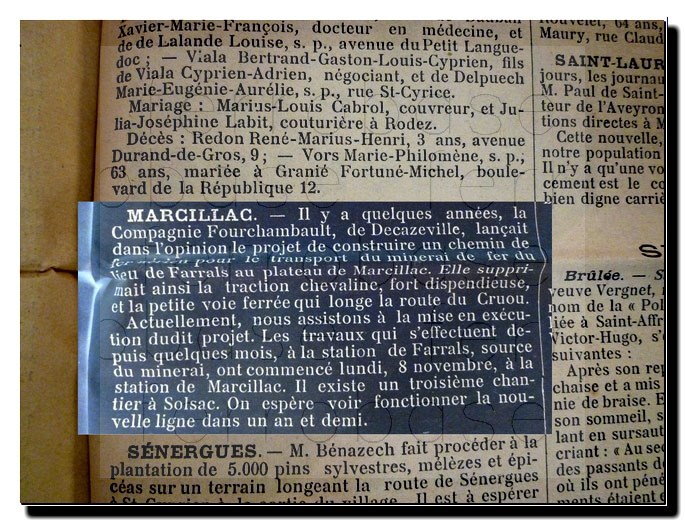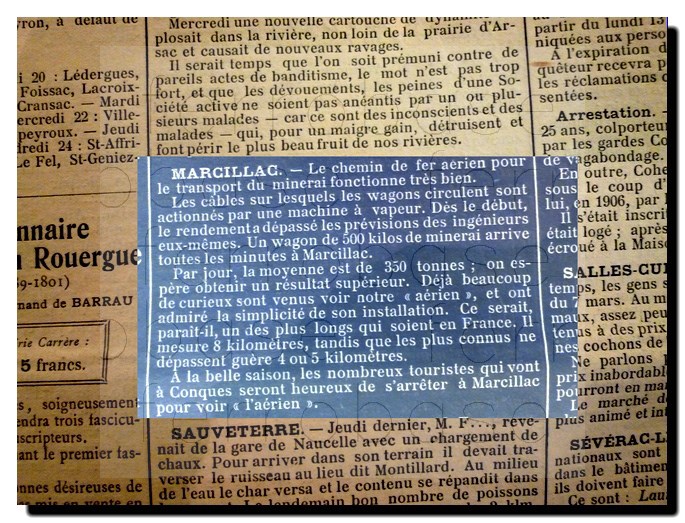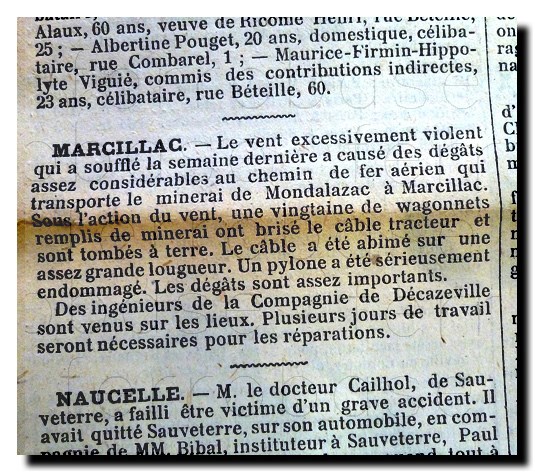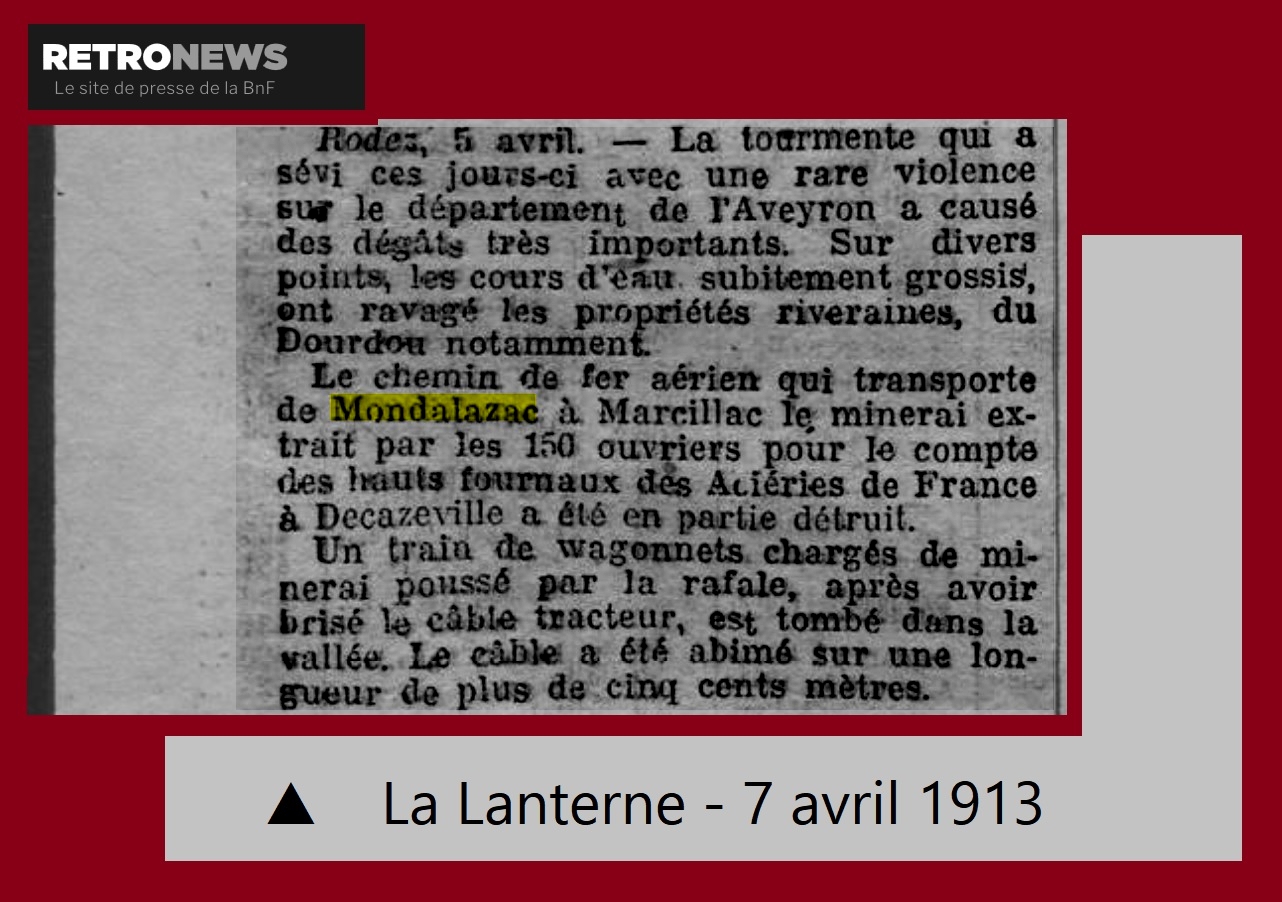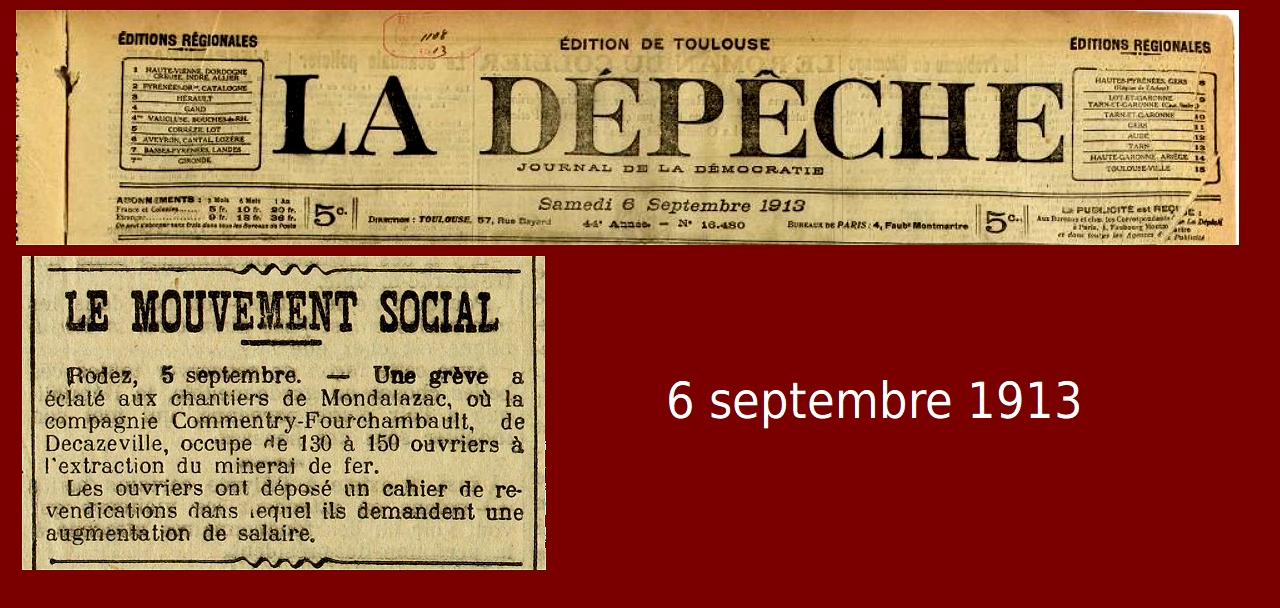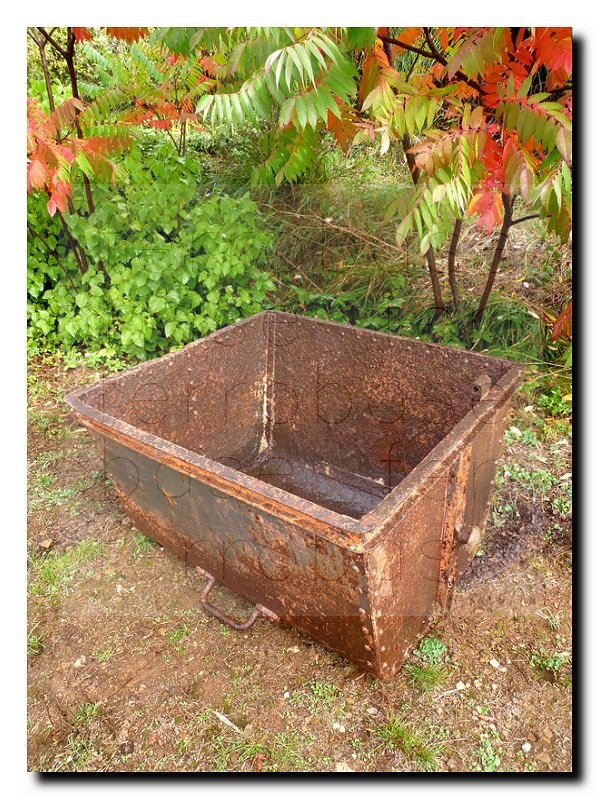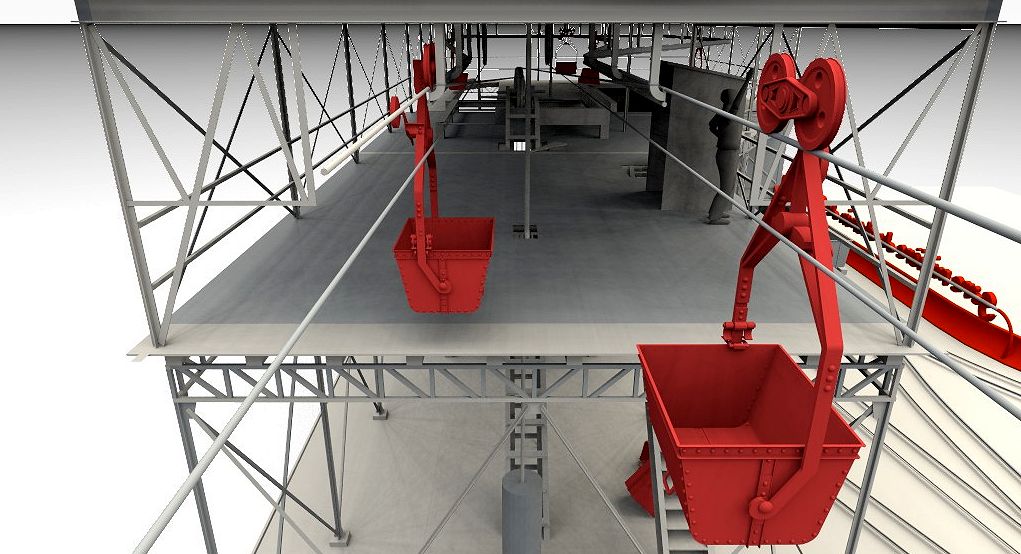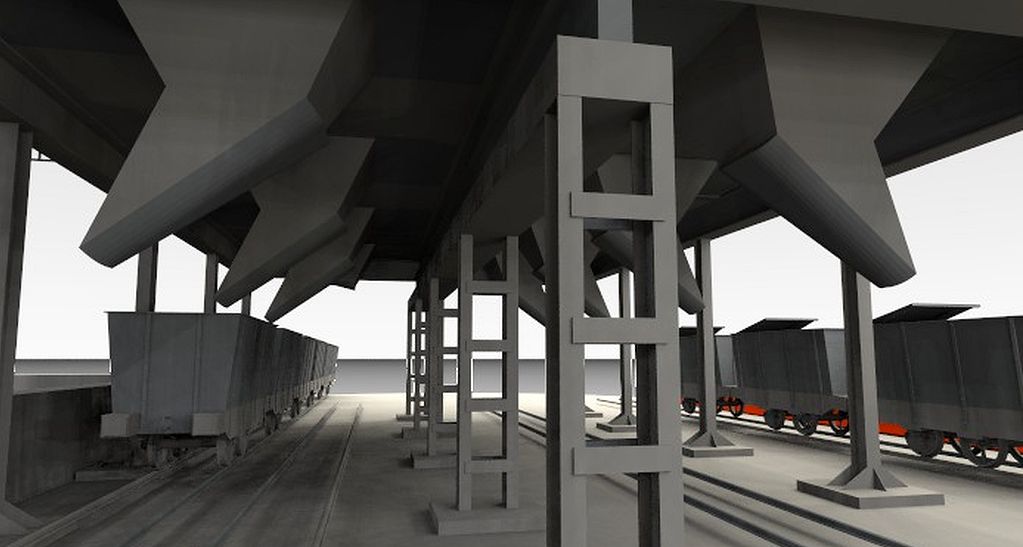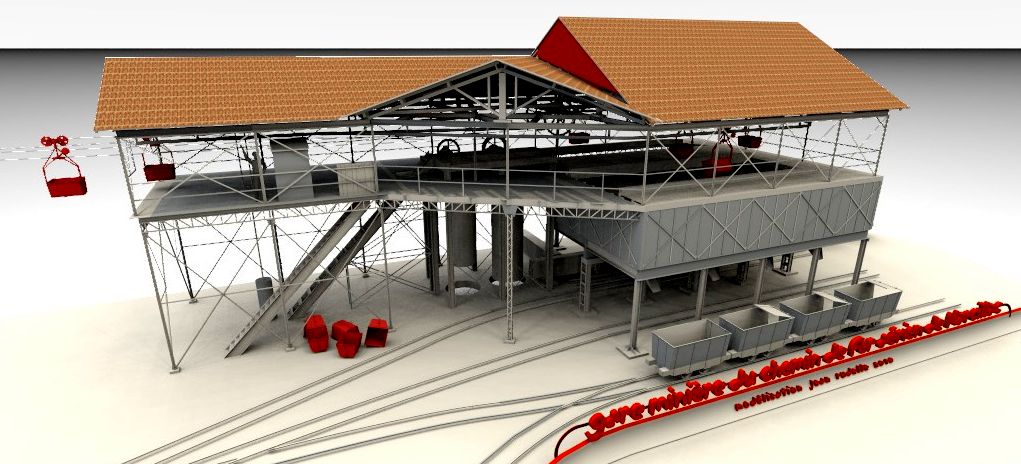Les chemins de fer miniers de Mondalazac
et Cadayrac
le chemin aérien
pages
en cours de développement (depuis 11-2008)




▼ première découverte, la gare
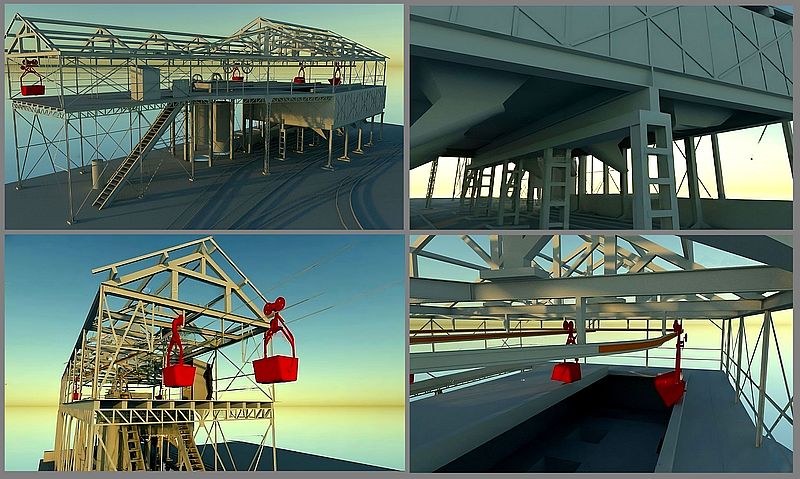
Et Mondalazac,
c’était exactement comment le chemin
aérien ?
▲ clic
Mondalazac, c'est sur le plateau, et Marcillac, dans la vallée ; c'est important de le noter, car les difficultés seront bien sûr de franchir ces 300 m ou presque de différence d'altitude.

Le minerai de fer, ici, c’est donc également un problème de relief, de relief géographique, et donc de transport. Le relief est assez simple à décrire : Mondalazac est sur le plateau, le causse Comtal, et Marcillac, où se trouve la gare minière vers Firmi et Decazeville, est en bas, dans une vallée. Le modèle numérique de terrain que nous vous proposons montre bien, à notre avis, les principaux traits de la géomorphologie locale. Pour les curieux de technologie, vous trouverez quelques lignes plus bas, des données sur l’établissement de ces modèles de terrain. Au premier plan, la vallée du Dourdou : le ruisseau coule de la gauche vers la droite, c'est-à-dire vers le bas de l’image. Il vient depuis Bozouls, plus haut sur le causse, et dans quelques kilomètres, il passera sous les vieilles pierres de Conques. Sur la droite, au delà du pont rouge, et venant des environs de Rodez, en haut du modèle, la vallée du Créneau, qui passe à Marcillac et rejoindra plus bas le Dourdou. Sur le causse, les mines de Mondalazac, et à proximité immédiate, une petite vallée, celle du Cruou, ruisseau qui viendra rejoindre le Créneau à Marcillac. La différence d’altitude entre les mines et Marcillac est légèrement supérieure à 250 mètres.
Chemins de traverse, un peu de technique spatiale…
(les poètes pourront passer leur chemin et nous rejoindre plus loin…)
17h43 UTC, au Kennedy Space Center, KSC : c’est loin d’ici, mais ce qui va occuper une foule d’ingénieurs et techniciens de l’espace pendant 11 jours nous concerne. La mission spatiale du Shuttle Endeavour part donc ce 11 février 2000 pour son orbite de travail à 233 km au-dessus de nos chemins. La mission principale de la navette consiste en une cartographie radar de la planète, permettant ultérieurement de reconstituer le relief de notre globe. C’est la 97 ème mission spatiale, la mission STS-99 ; 176 orbites plus tard, le 22 février, ce sera le retour à la maison de la navette, des radars, de son équipage, et…..des résultats enregistrés ! 11 jours, un petit séjour là haut, un grand pas pour la télédétection ! Quelques chiffres : 149 orbites, sur les 176 du vol, seront consacrées à ces enregistrements radar ; 222,4 heures non stop de mesures, 12,3 terabytes de données informatiques engrangées. Des millions de km2 balayés.Ce sont les résultats de 7 ans de projet, dont 4 consacrés au développement des instruments, mission radar et interférométrie, les 10 jours de mesures ; un an de calculs ( ! ) suivra avec 9 mois pour la seule production des données. Depuis quelques années les résultats de ces mesures sont disponibles sous la forme de petits fichiers sympathiques : 1201 lignes par 1201 colonnes (2 884 802 b) pour des données précises à trois secondes d’arc, soit 90 m environ. Les mesures initiales sont à une seconde d’arc, mais non disponibles pour nous…européens - disponibles en 2018-...Le résultat est aussi fantastique qu’une locomotive 030T Couillet prenant son élan pour franchir le viaduc de l’Ady…D’autant plus qu’en février 2000, le causse est nu, et la végétation dans les vallées encore en sommeil, ce qui permettra aux radars de ne pas être trop trompés sur les mesures. Tout comme leur possibilité d’être assez insensibles aux nuages et pluies diverses. La précision des mesures en altitude sera meilleure que 9 mètres, ce qui nous convient parfaitement pour vous présenter nos sites. Merci donc à cette mission SRTM, Shuttle Radar Topography Mission. On peut trouver l’histoire de cette mission sur www2.jpl.nasa.gov/srtm. En ligne, les données de la mission, les appareils, les mesures, leur traitement, des exemples et vidéos de la mission, les liens indispensables….Nous avons particulièrement noté le rapport SRTM_paper.pdf : tout sur la gestion de ce projet, depuis les algorithmes mathématiques de traitement jusqu’aux difficultés de s’assurer de la position dans l’espace de la navette pour conserver une précision nominale au sol inférieure à 9 m, 233 km plus bas ! Les fichiers terrains sont disponibles sur différents sites serveurs (ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version1/Eurasia), sous la forme de fichiers zip ; nous avons utilisé ici le fichier N44E002.hgt.zip, c'est-à-dire 44° nord de latitude et 2° est de longitude, coordonnées du coin en bas et à gauche du fichier. (vous pouvez consulter: http://srtm.csi.cgiar.org, site général du projet srtm, à remercier pour l'ensemble des données...)
Et pour terminer cette voie de traverse très technique, quelques indications sur le reste du travail. Le fichier terrain est un élément du problème de représentation, important, essentiel, mais n’est qu’un élément ! La moulinette qui va nous permettre d’importer, lire, calculer, afficher, modifier …le modèle numérique que nous proposons est 3DEM, un remarquable outil. Mais pas suffisant à lui tout seul non plus ! La carte que nous avons utilisée pour la plaquer sur le modèle de terrain, ce que permet 3Dem, c’est notre bonne vieille carte d’état major : un travail de repérage est nécessaire pour faire coïncider des représentations au départ différentes, mais la machine calcule vite ! et bien !
Si vous souhaitez approfondir vos découvertes sur la modélisation de notre globe, nous vous proposons les deux adresses suivantes, surtout à destination des scientifiques . Nous les avons utilisées avec profit, les deux se complétant. Le logiciel WORLD WIND (la version active en août 2009 est la 1.4) est une ressource offerte gratuitement par la Nasa : l 'application 2D/3D permet de visualiser notre planète, jouer avec l'ombre et le soleil, l'exagération du relief et surtout de plaquer sur le terrain des données diverses, essentiellement scientifiques (hydrologie, géologie, météo, mines ...), mais pas seulement, offertes par des fournisseurs de données WMS. L'adresse est http://worldwind.arc.nasa.gov/index.html. Mais attention ! Cette monumentale masse de données (ici c'est par téra octets qu' il faut compter!) nécessite une connection haut débit, et surtout de se lever tôt, pour nous rouergats. En effet les difficultés et lenteurs d'accès sont importantes en cours de journée et après midi....Une autre possibilité, réalisée pour contourner quelques difficultés de World Wind est d'utiliser DAPPLE. Son but est identique, son interface également et il est semble-t-il plus facile et plus rapide d'arriver à un modèle satisfaisant. Les fichiers dont les adresses sont au bout d'un clic de souris sont plus scientifiques. Son accès nécessite, on s'en doute, un accès rapide à internet. L'adresse de Dapple : http://dapple.geosoft.com. La version active en 08/2009 est la 2.1.0. Dapple est une application offerte également librement aux chercheurs. Ces deux applications de modélisation permettent bien sûr d'utiliser avec facilité les données SRTM évoquées plus haut, mais également d'enrichir le modèle par des données satellites diverses, comme Landsat 7 (résolution métrique).
Les poètes nous retrouvent ici....
Retour sur le causse ! Nous proposons deux représentations du relief. Sur l’une, quelques repères ont été ajoutés : les lecteurs non familiers pourront plus facilement imaginer les lieux. Et, cerise sur ce beau gâteau, chaussé de vos lunettes spéciales, verre rouge à gauche bien sûr, vous pourrez tout à loisir naviguer dans l’espace, ce n’est pas réservé aux seuls professionnels des navettes ! (les lunettes ? Vous les trouverez dans des ouvrages pour enfants, vous les rendrez après c’est promis, dans des revues de photographies, boutiques diverses, plus facile en tout cas qu’on peut le penser, et l’effort de les trouver sera oh combien récompensé par le résultat). En effet 3Dem permet, toujours parce que les enregistrements radars SRTM nous en donnent la possibilité et fournissent l’information, de réaliser un anaglyphe : mot compliqué pour désigner cette image rouge et bleuâtre, dans laquelle vous pourrez goûter aux joies du relief : la connaissance très précise de nos chemins de fer miniers n’aura alors plus beaucoup de mystères, enfin c’est ce que nous avons souhaité ! Fin de la voie de traverse, atterrissage et retour sur les chemins.
▲ clic pour agrandir
▼ un site touristique ?
Avant de retrouver notre wagonnet sur son fil, il est important d’évoquer ce qu’il y avait avant ! Et oui, comment faisait-on pour descendre le minerai de la mine des Espeyroux à Marcillac puis Firmi ?
Nous sommes par exemple en 1872, le 28 août.
Un projet de chemins de fer d’intérêt local, à voie normale de 1,44 m, est discuté en séance. Il est présenté par MM. Anatole de Mieulle et le marquis de Gouvello, député du Morbihan, au nom d'une société non encore formée et qui reste à créer sous le nom de La Méridienne.
Ce projet est présenté sans aucune demande de subvention ni de garantie de la part du Département. Celui ci demande aux investisseurs un cautionnement dont un premier versement de 100.000 francs, à la signature du contrat avec le Préfet.
Les promoteurs proposeront ce versement sous la forme d'actions Commentry et Fourchambault. Ces actions sont présentées par M. Deseilligny, président de la commission des travaux publics, comme apports " excellents, de toute sûreté et d'un classement parfait ". Elles sont proposées au conseil à 400 francs alors que le cours était de 520 francs. Cet effort financier des promoteurs devait prouver leur capacité à mener à bien le projet.
Dans le cahier des charges, titre I, article 1, figure la description des deux lignes du projet dont celle de Rodez vers Aurillac, la première citée.
"… la première partira de la gare définitive de Rodez, empruntera les rails de la ligne d'Orléans sur 4 kilomètres environ et s'en détachera après ce parcours pour se diriger vers Cadayrac et Mondalazac, d'où elle rentrera dans la vallée du Criaut (Cruou ? ) dont elle suivra la rive droite pour entrer dans la vallée du Créneau en suivant aussi le versant droit. Elle traversera ensuite le Créneau aux environs de Nauviale pour passer dans la vallée du Dourdou et la parcourir jusqu'au passage du Lot, un peu après Grandvabre, en longeant la rive gauche. Dans ce trajet la ligne passera par ou près Sébazac, Cadayrac, Marcillac Combret, Nauviale, St Cyprien, Conques et Grandvabre. "
Ce projet est retenu par les Conseillers. Malgré quelques difficultés sur le versement des cautions, le Préfet signera un traité au nom du Département en 1873. Mais l'avenir s'assombrit très sérieusement. Lors de la séance suivante du 23 août 1873, La Méridienne est à nouveau à l'ordre du jour, pour considérer le projet abandonné et "comme nul et non avenu, par l'expiration du délai de trois mois, après la date de ce traité, sans le paiement des 200.000 f rancs de cautionnement ".
Un premier projet qui aurait donc traversé le causse vient de disparaître.
En 1877 ce sera la présentation d'un nouveau projet par la compagnie des chemins de fer de Bourges à Gien et d'Argent à Beaune la Rolande. Il s'agit d'un projet beaucoup plus ambitieux, soutenu par 200 députés et sénateurs, visant à donner à 14 départements du centre, le "paté" oublié par les premières concessions, un avenir ferré. Le duc de Brissac préside cette compagnie, dont un des projets nous intéresse. Il s'agit d'une ligne de Paris à Narbonne via Bourges, Montluçon, Aurillac et Rodez. La société est beaucoup plus solide financièrement que la précédente et le trajet Aurillac Rodez reprend le tracé envisagé par La Méridienne. Ce projet n'aura pas de suite, ce qui permettra au causse de conserver sa tranquillité...
Acte III. En mars 1909, le projet de ligne d'Aurillac à Espalion est à l'ordre du jour. L'accord du Conseil Général du Cantal est acquis, mais le projet ne sera pas réalisé. Dans les discussions du Conseil de l'Aveyron, une proposition de modification du trajet est faite : passage direct d'Entraygues à la gare de Bozouls, avec un passage sur le causse comtal, et sans emprunt de la vallée du Lot et passage par Estaing et Espalion. La proposition est motivée par une longueur identique de tracé mais un coût moindre pour rejoindre Rodez, au vu du relief du causse. Ce ne fut qu'une proposition...de plus. Projet abandonné…
On ne peut évidemment pas ne pas penser, devant ces projets, au désenclavement des mines de Mondalazac. La position de M. Deseilligny soulignée plus haut semble (beaucoup ? ) intéressée à leur succès. Rappelons que la compagnie d'Aubin, concurrente de M. Deseilligny, a résolu les problèmes de la concession de Muret et des mines de Cadayrac par sa voie de 1,10 m vers la gare de Salles la Source, et les voies du Paris Orléans, qui appartiennent en fait à la même compagnie.
L'entretien continuel des routes du causse, le chemin n° 21, écrasé par les convois de minerais vers Marcillac semble trouver un début de solution en 1864. Cette année là, le rapport du Conseil Général fait état du transport par la voie de Cadayrac à Salles la Source et prévoit la disparition des " charois sur la route n° 21 de Solsac à Mondalazac et de Solsac à Marcillac". Connaissant l'opposition des deux compagnies d'Aubin et Decazeville, nous ne comprenons pas cette affirmation du rapport, le transport systématique du minerai de Mondalazac vers Salles la Source par la voie de 1,10 m n'ayant, à notre connaissance, jamais été d'actualité, même si, par contre, une partie des minerais de Cadayrac était quelquefois livrée à Marcillac pour la Compagnie de Decazeville. Voici ce passage quelque peu énigmatique du rapport : " Les parties du chemin n° 21, comprises entre Solsac et les Espeyroux, d’une part, et Solsac et Marcillac, de l’autre, qui étaient soumises à un roulage écrasant, par suite des transports de minerai que les compagnies d’Aubin et Decazeville effectuaient, ne seront plus désormais fréquentées que par le roulage local, attendu que les compagnies effectueront leurs transports par la voie ferrée de Cadayrac à Salles la Source." A notre connaissance, le transport de minerai de la concession de Decazeville par la voie de 110 depuis Cadayrac, puis la voie ferrée du PO après transbordement, et enfin l'embranchement vers Decazeville depuis Viviez n'a pas été d'actualité...
Le fond de plan ci-dessous est celui de l ' " Atlas Cantonnal " de l ' Aveyron. Pour illustrer notre propos, il présente le très grand avantage, à défaut d'une cartographie très précise, d'être contemporain (vers 1860) des faits rapportés. La totalité des acteurs des transports de minerais ont été surlignés en couleurs, depuis les transports initiaux sur les chemins jusqu'au dernier transport, le mode aérien, disparu vers 1920.
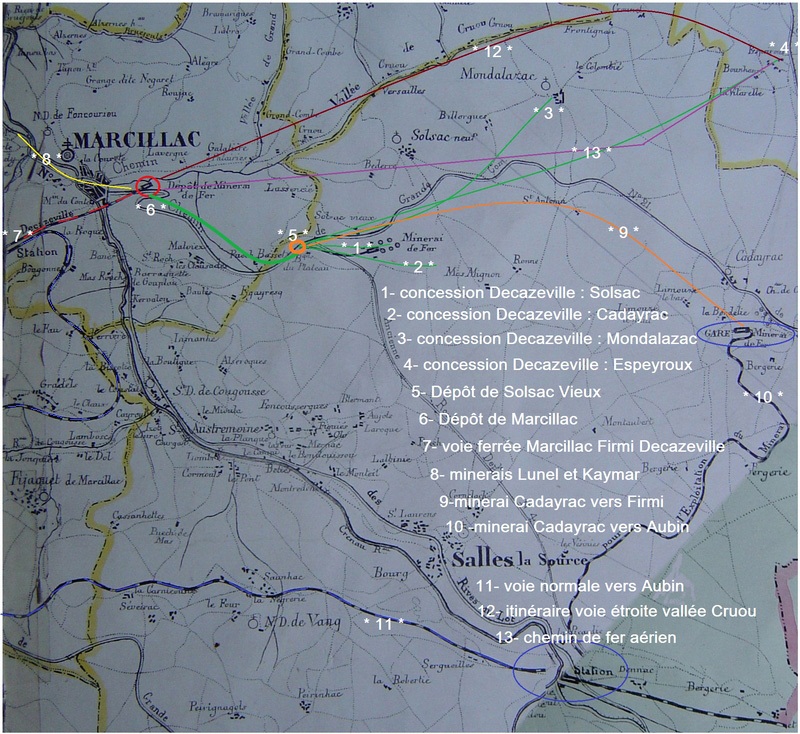
Transport de minerais, entrepreneurs et litiges.
Vers 1860, l'essentiel du minerai du causse suivait les chemins,- ou le chemin ! - menant à la gare des minerais de Marcillac. De là, la voie ferrée qui vient d'être mise en service est utilisée vers Firmi, par traction hippomobile d'abord puis à l'aide de locomotives ensuite. La concession de Muret, pour la compagnie d'Aubin est favorisée sur ce point : les mines sont reliées par la voie de 110 à la station de Salles la Source où les machines du Paris Orléans prennent en charge les convois pour les forges d'Aubin.
La Compagnie de Decazeville usait de plusieurs modes. Elle avait elle même chevaux, attelages, et les personnels. Elle utilisait également les services d'entrepreneurs indépendants qui passaient contrat. Monsieur Pers, entrepreneur à Marcillac était l'un de ceux ci. Le 23 avril 1859, il signe un traité avec M. Cabrol, qui va bientôt quitter la Direction. Ce contrat qui comprend 14 articles précise comme il est de règle les droits et devoirs de chacun. M. Pers s'engage à fournir à Marcillac 6.500 tonnes par mois de minerais, à raison de 250 tonnes par jour ouvrable, ce qui fait 26 jours de travail en moyenne dans le mois. En fait le service essentiel se fera du plateau de Solsac-Vieux à Marcillac. Le minerai du plateau est donc d'abord convoyé à Solsac, puis à Marcillac. Le transport des Espeyrous (et quelquefois de Cadayrac) à Solsac est à priori du ressort de la Compagnie, sauf si le stock de Solsac est insuffisant. Dans ce cas, priorité sera donnée à Monsieur Pers, depuis les mines pour ce transport. M. Pers doit même être mis à contribution avant les moyens de la Compagnie. Les voituriers, chevaux, charrettes et autres moyens sont fournis par l'entrepreneur. Celui-ci doit charger également les wagons en gare. Il participera financièrement à l'entretien des chemins, en proportion du minerai transporté. Un équipage transporte 27 tonnes par jour et le prix réglé sera de 1 franc 35 centimes par tonne ; la durée du traité est fixée à cinq ans, jusqu'au 31 mai 1864.
Ce contrat n'ira pas à son terme. La disparition des activités de la Compagnie le condamne. Il y a également le départ de François Cabrol, et apparemment une gestion assez cahotique de la Société à cette époque. L'arrivée de nouveaux Directeurs, comme Jean Evariste Declerck qui lui succède, brillant ingénieur, polytechnicien et ingénieur des Mines, ne sera pas plus efficace.
C'est ce nouveau directeur qui aura à connaître du litige avec M. Pers.
Le 9 janvier 1862 le tribunal civil de première instance de Villefranche de Rouergue va statuer.
Le conflit Pers-Compagnie porte sur les modalités d'exécution du traité signé entre MM. Pers et Cabrol. La Compagnie, ne respectant par les termes, livre avec ses propres moyens le minerai non pas au plateau de Solsac, mais directement à Marcillac. C'est ainsi que pendant plus de huit mois, malgré les demandes pour faire décharger au plateau, les voituriers de la Compagnie passaient outre en descendant à la gare un tonnage de minerai égal ou supérieur à celui contractuellement fixé par le traité avec M. Pers. Il en est résulté des fausses manoeuvres, du chômage et des pertes d'argent, la production du seul site de Solsac ne pouvant fournir les 250 tonnes jours demandées. De plus les subventions du Département pour l'entretien du chemin étaient utilisées par la Compagnie à d'autres chemins vicinaux. Sur ce problème vient se greffer la perspective de la perte du transport par voie ferrée de Marcillac à St Christophe (à l'aide de chevaux). M. Pers y perd le prix payé, et doit évacuer les lieux et écuries. Il souligne " la mauvaise marche du service et le mauvais entretien de tout ce qui concerne la Compagnie, raisons du dommage très considérable qu 'il subit, par la mort de chevaux par exemple...l' irrégularité du service du chemin de fer et le mauvais entretien de cette voie ont, par la faute de la Compagnie, causé des dommages au concluant, soit en lui faisant subir des chômages et prolongeant le stationnement des étalages, soit en compromettant la vie des chevaux ou leur santé...".
La demande de réparation des dommages porte sur une somme de 70.000 francs. Cela équivaut au paiement du transport de 52.000 tonnes de minerai, ou à l'activité de 250 tonnes jour pendant 207 jours. Pas négligeable du tout ! Si la Compagnie entend résilier le traité, M. Pers demande la somme de 140.000 francs., soit l'équivalent de 400 jours de travail !
Pour sa part la Compagnie maintient sa volonté de poursuivre l'exécution du traité comme par le passé. Elle retire par contre sa demande de mettre fin au transport par la voie ferrée et accepte que le dit transport Marcillac - St Christophe se poursuive jusqu'au 31 mai 1864, comme le transport de Solsac à Marcillac.
Les exposés des parties montrent donc l'intense activité de Marcillac en 1860. Non seulement la gare reçoit les minerais des mines de Solsac, mais elle reçoit également ceux des sites de Mondalazac, des Espeyroux et de Cadayrac. Pour cette dernière il nous manque une précision, permettant de bien comprendre les termes de " exploitées en même temps par la Compagnie de Decazeville". Ce site dit de Cadayrac n'est évidemment pas celui désigné ainsi et exploité par le concurrent d'Aubin. La gare des minerais de Marcillac était également le lieu de chargement pour Firmy et Decazeville des minerais de Lunel et de Kaymar. Les mêmes attendus nous renseignent également sur la mine de Solsac, citée dans nos pages mais non décrite : "....que la mine de Solzac-Vieux, située non loin de cette même côte, se trouve la plus rapprochée de la gare et est desservie par une voie ferrée, qui transporte le minerai qui est extrait de la mine sur le plateau dit de Solzac-Vieux, mentionné à l'article 2 du traité, lequel plateau n'est autre qu'une plate-forme disposée à côté du chemin public, pour servir de dépôt, non seulement de ce minerai, mais encore selon les besoins du service, ainsi que cela a été reconnu par la Compagnie des minerais d'Espeyroux et de Cadayrac, qui pour aboutir à la côte de Marcillac sont obligés de passer sur ce point, et dont les carrières plus éloignées sont desservies par des chemins de traverse, qui ne sont guère accessibles qu'aux chars à boeufs".
Faire une phrase aussi longue est en soi une belle performance !
Elle nous renseigne, un peu, sur la présence d'une voie ferrée de la mine de Solsac au plateau. Cette très courte voie apparaît sur une carte de " l ' Atlas cantonnal de l ' Aveyron" . Son débouché se situait donc tout en haut de la côte, la route actuelle. Une maison est encore, en 2010, présente à proximité, et c'est là que se faisait une partie des pesages de minerais.
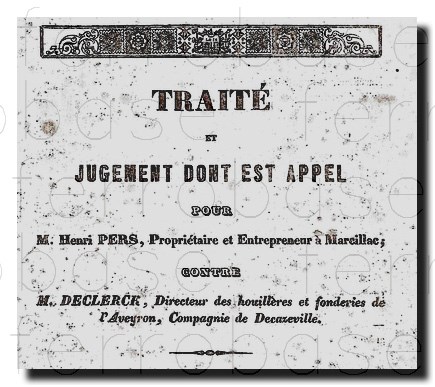
Le problème développé est donc celui de l'insuffisance de production de la mine de Solsac, et donc de la nécessité de déposer à ce plateau les minerais des autres sites pour permettre à M. Pers de transporter ses 250 tonnes par jour, comme indiqué au traité. Les " grandes voitures " de M. Pers étaient conçues pour ce trafic et pour le trajet Solsac Marcillac : elles ne pouvaient parcourir le causse jusqu'aux Espeyroux sans dégrader fortement les chemins. Les charrettes, les " petites voitures" des autres transporteurs libres étaient plus légères et adaptées à ces convois. La Compagnie qualifiait ainsi les voitures de M. Pers : "...aux proportions colossales de ses voitures, au poids énorme et exceptionnel de ses chargements...".
Les attendus du jugement mentionnent aussi les relations personnelles entre M. Pers et le personnel de Marcillac: " ...par suite de l'aigreur qui, de l'aveu de toutes parties, s'était glissée dans leurs rapports journaliers avec le sieur Pers...". Le jugement explique également " l'apparente résignation " de M. Pers, qui tenait " à ménager une compagnie aussi puissante que celle de Decazeville". L'entrepreneur était par exemple lié à la Compagnie pour des transports de castine.
C 'est par plus de vingt-cinq pages d'exposés que le tribunal, jugeant à la charge d'appel, et constatant l'ensemble des faits, déclare, par interprétation du traité, que " la Compagnie a contrevenu à ses engagements pour n'avoir pas fourni habituellement au sieur Pers, sur le plateau de Solzac-Vieux, un approvisionnement de 200 tonnes par jour ouvrable...".
Pour fixer le montant des dommages trois experts sont désignés, dont M. Boisse, ingénieur civil, ancien directeur des mines de Carmaux. Son nom est bien connu pour ses travaux de géologie locale. Il y a aussi M. Jausion, ingénieur des mines à Rodez, dont les relations tendues avec M. Cabrol sont décrites par ailleurs : M. Jausion est à l 'origine du différent Cabrol- Riant (Aubin) qui se terminera en Conseil d'Etat, posant un problème juridique de droit minier inédit et non prévu par la loi de 1810.
Ces difficultés de toutes sortes avec les entrepreneurs indépendants de transports trouveront une solution dans la construction de la voie ferrée dans la vallée du Cruou. Mais ce sera une autre histoire, décrite par ailleurs, avec une autre société, la Société Nouvelle des Houillères et Fonderies de l'Aveyron. L'histoire se répétant quelquefois, l'augmentation des besoins amènera à son tour l'abandon de cette deuxième solution pour la mise en place, par une autre société, Commentry Fourchambault et Decazeville, du chemin de fer aérien, parcourant à nouveau le causse, mais au dessus, une simplification énorme du problème !
Le
chemin de fer à voie de 66 dans la vallée du Cruou
On a vu dans les évocations de souvenirs et témoignages, un écho
sur le lieu dit Frontignan, dans la vallée du Cruou et un témoignage de
la voie de 60 qui existait dans la vallée du Cruou. (En fait la voie
était à l'écartement de 0,667, pour être en accord avec celle posée à
la gare même de Marcillac; il est difficile d'envisager deux
écartements au dépôt...). Cette voie a bien existé.
La route construite entre Marcillac et Mondalazac le fut avec la
participation de la Compagnie des mines,
qui avait obtenu l’accord de l’administration des Ponts et Chaussées
pour établir en accotement une voie ferrée . Sur la carte d’état
major, on peut retrouver la trace de cette voie. La carte
en notre possession est en fait une feuille au 1/50 000, issue
de la carte d’origine au 1/80 000. La
coupure au 1/50 000 est numérotée 195, et
intitulée Figeac SE. Il s’agit du type 1889, révisée en 1906. Mais dans
la légende déclinaison magnétique, la date du 1 janvier 1934 est
inscrite, et en bas à droite de la feuille, figure la date 1-38, soit,
sauf erreur, janvier 1938.
Il est assez remarquable de retrouver sur une carte, imprimée
donc en 1938, le tracé d’une voie qui n’avait plus d’utilité depuis
près de 30 ans, puisque le chemin aérien date de 1911. On retrouve
également sur cette carte le lieu dit Frontignan évoqué plus haut.
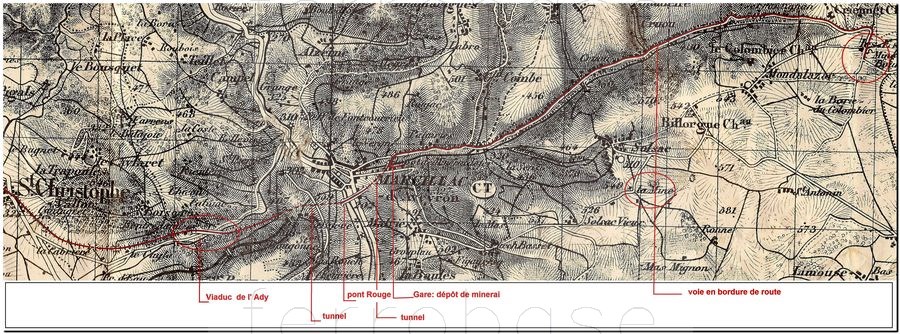
Sur cette image, le tracé a été surligné en rouge pour plus de
lisibilité. A Marcillac même, on visualise parfaitement le remblai de
passage du Cruou qui conduit la voie ferrée rive droite du
ruisseau jusqu’en haut de la vallée. Sur l’agrandissement de la
carte, on retrouve l’indication Dépôt de minerai de fer, à
l’emplacement même de la gare dont on va décrire les
installations. Il est utile de préciser également que sur la
carte postale de cette gare, ci-dessous, cette voie
apparaît avec sa courbe très prononcée tout à gauche de l’image.
Cette carte postale doit dater de 1912-1914 environ, et cette voie ne
doit plus être en fonction depuis un an ou deux .
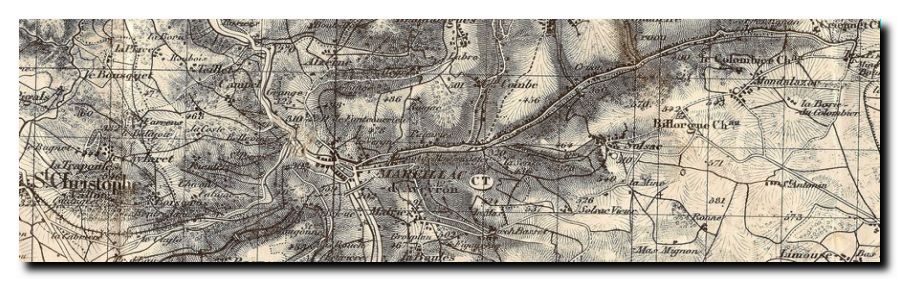
Sur
cet extrait, on remarque le tracé de la voie, en accotement de la
route Marcillac Les Espeyroux. On notera également que la route était
construite uniquement pour servir de support à la voie ferrée et
faciliter l’activité minière : elle se prolonge en
effet difficilement jusque Mondalazac…aussi bien que vers l’est, vers
la route de Villecomtal…La compagnie des mines n’avait pas vocation à
financer la construction des routes !
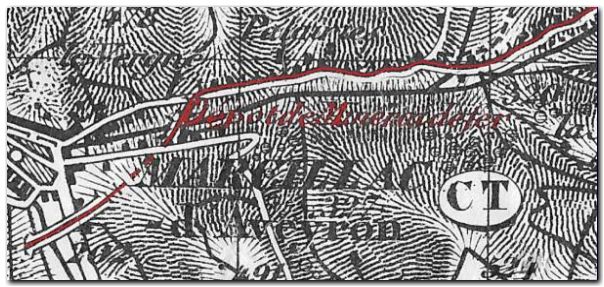
L’exploitation de cette voie ferrée se faisait donc par
chevaux, et on ne dispose pas de photographies – mais il doit bien en
exister ! – à publier. La longueur du tracé est de l’ordre de 7
km, soit sensiblement identique au parcours aérien. Un
projet de mise à écartement à 1 m de la
voie, projet qui était commun au projet
Decazeville Marcillac a été élaboré.
En avril 1893, Monsieur Pradié, Conseiller Général de Marcillac évoque en séance la construction du chemin de fer industriel pour attirer l'attention sur les retards d'exécution du projet.
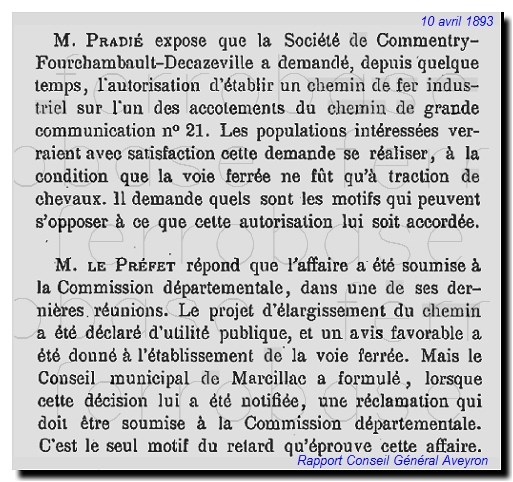
L’atlas
Cantonnal (ainsi titré) de l’Aveyron, publié en 1858 fait apparaître
ainsi le secteur de Marcillac .
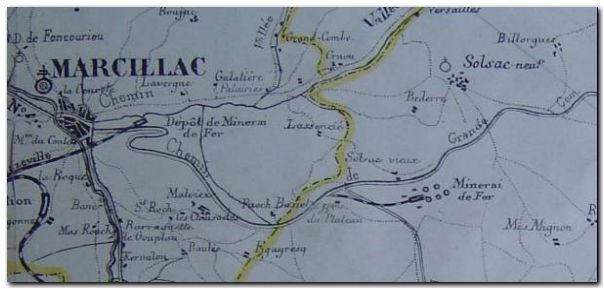
Les
observations
suivantes sont utiles pour nos recherches :
-
la voie ne figure pas après Marcillac
-
pas de route dans la vallée du Cruou, ceci
étant lié à cela ; seul le chemin est mentionné
-
présence du dépôt de minerai à Marcillac,
minerai convoyé par le chemin de Grande communication de Solsac
-
présence
de la mine de Solsac, située dans le périmètre de la concession de
Mondalazac, et d’un court tronçon ferré ; c’est à peu près la
seule source qui indique ce tronçon, pour nous encore parfaitement
inconnu….La carte d’état major indique le lieu dit les Mines, et la
carte des concessions mentionne également le site.
On
notera, accessoirement, que cette carte fait très rapidement
figurer les voies ferrées, mais sans tunnels, viaducs, ponts ou autres
détails !
A propos de cartes …quart d’heure
récréatif
Les recherches
de cartes permettent parfois de faire de véritables trouvailles !
Un exemple. Le site
www.lib.utexas.edu/maps/historical permet, comme son intitulé le
précise de rechercher une carte ; c’est une véritable mine (c’est
le cas de le souligner…). Par exemple, le US Army Map Service,
(www.lib.utexas.edu/maps /ams/France/) traduction non indispensable,
offre librement quelques cartes de France, réalisées par ses
services. Dans la série M562, de 1954, au 1/250 000 et en couleurs, la
feuille NL31-11 Mende réserve quelques surprises ! Un extrait
autour de Marcillac :
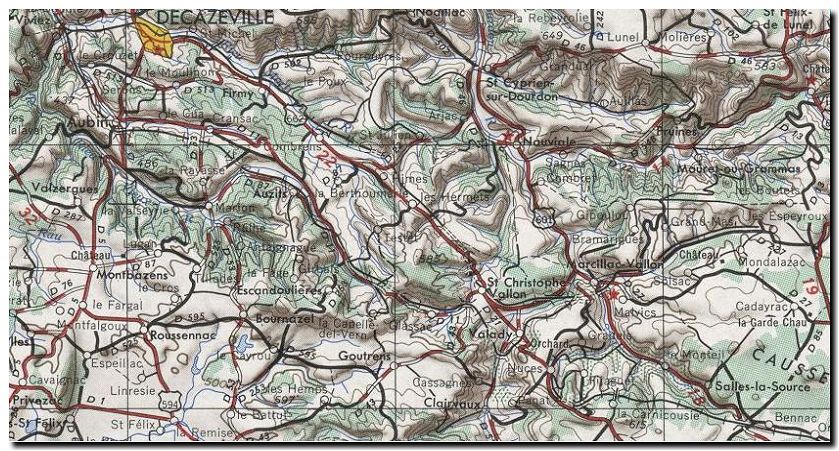
Et
oui, nos chemins de fer miniers vus par le US Army Map Service, en
1954 ; tout y figure ou presque : on part de Decazeville,
puis Firmy, St Christophe, sans oublier les tunnels, le viaduc Malakoff
(oui en 1954 !), Marcillac. Et, cerise sur le chemin de fer, on
peut alors traverser le Cruou et remonter jusqu’aux Espeyroux, le tout
par voie ferrée !!! On peut penser que cette compilation est une
recopie de carte un peu plus ancienne, l’orthographe Firmy trahit
bien ce travail. Mais en remettant le tout dans son contexte, la
carte est bien utile…Donc aucune hésitation, la voie du
Cruou est bien réelle…. ! D’autant que sur cette carte, elle
est bien précisée en voie étroite (narrow gauge) par un
graphisme particulier.
Autre site, http://www.davidrumsey.com/directory/where/France. Parmi les 585 cartes de France, deux extraits nous intéressent.
Le premier est issu
d’une édition de 1920
par Times Atlas, Historic Maps France
- south-western section; Bordeaux. by Bartholomew, J. G. (John George),
1860-1920 ; John Bartholomew & Co.
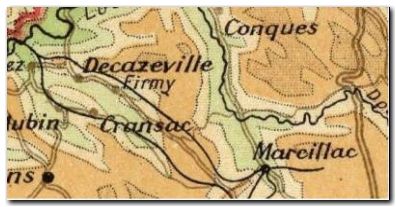
Cette carte a donc été publiée en 1920 et donne très schématiquement pour qui n’a pas les clés d’interprétation, le tracé depuis Decazeville à Firmy, Marcillac et Espeyroux. Difficile à repérer, mais une information très pointue, pour une échelle du 1/1000000 !
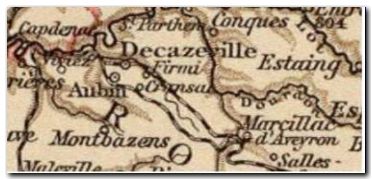
On
repère simplement, au 1/750 000, le tracé Decazeville Marcillac, sans
volonté exagérée de détails…
Installation aérienne
Pour information, c'est un décret du 1 er avril 1909 qui a déclaré d’utilité publique l’établissement d’un chemin de fer aérien destiné à relier les mines de fer de Solsac et Mondalazac au chemin de fer de Marcillac à Decazeville (Aveyron), demande formulée par la Société Anonyme de Commentry- Fourchambault et Decazeville. Cette société avait pris la suite de la société nouvelle des houillères de Decazeville, qui elle même avait poursuivi les activités de la société originelle de Decazeville.
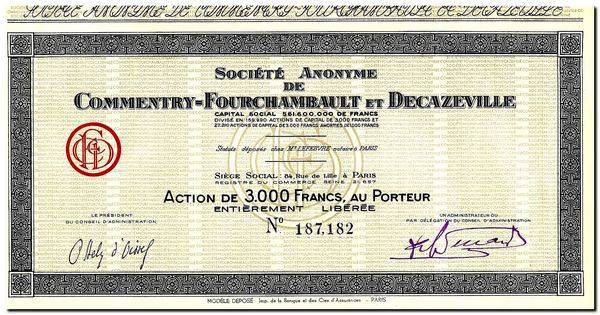
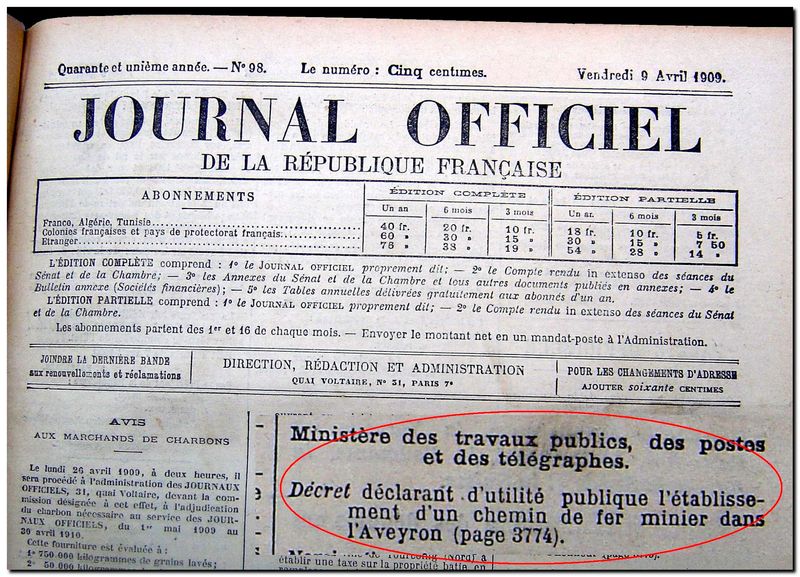
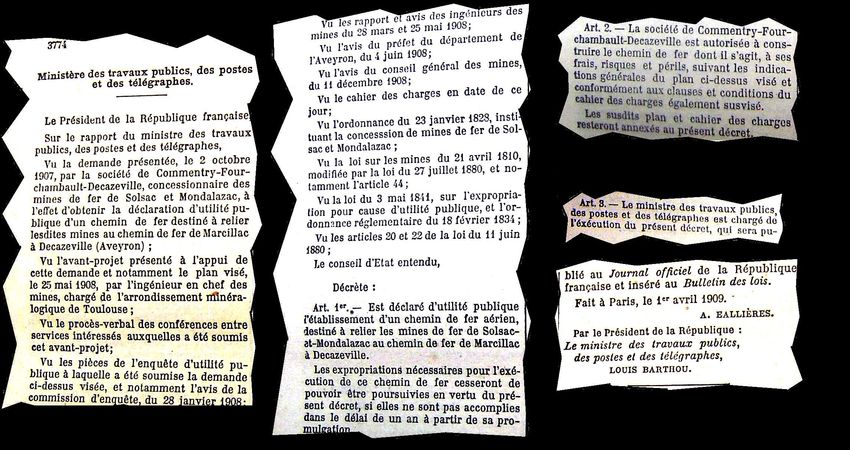
Le décret est bref, trois articles. Rien de particulier, sauf à retrouver dans les attendus et visa la trace datée des demandes, avant projets, projets et consultations. On apprend ainsi que la demande avait été formulée deux ans auparavant, le 2 octobre 1907 ; la commission d’enquête avait rendu son avis le 28 janvier suivant, et les ingénieurs des mines donnaient le leur les 28 mars et 25 mai 1908. Un début de parcours rapide pour le projet, rapide au regard des habitudes actuelles, mais peut-être tout à fait normal en 1908…La société de Commentry-Fourchambault et Decazeville devait procéder aux acquisitions foncières dans le délai d’un an.
Le décret est suivi dans la même page du cahier des charges du projet. Un document absolument essentiel. Daté également du 1 er avril 1909 il se compose de 15 articles en trois titres, tracé et construction, articles 1 à 9, entretien et exploitation, articles 10 et 11, et clauses diverses pour terminer. Nous donnons copie intégrale du texte, vu son importance dans la genèse du chemin aérien.
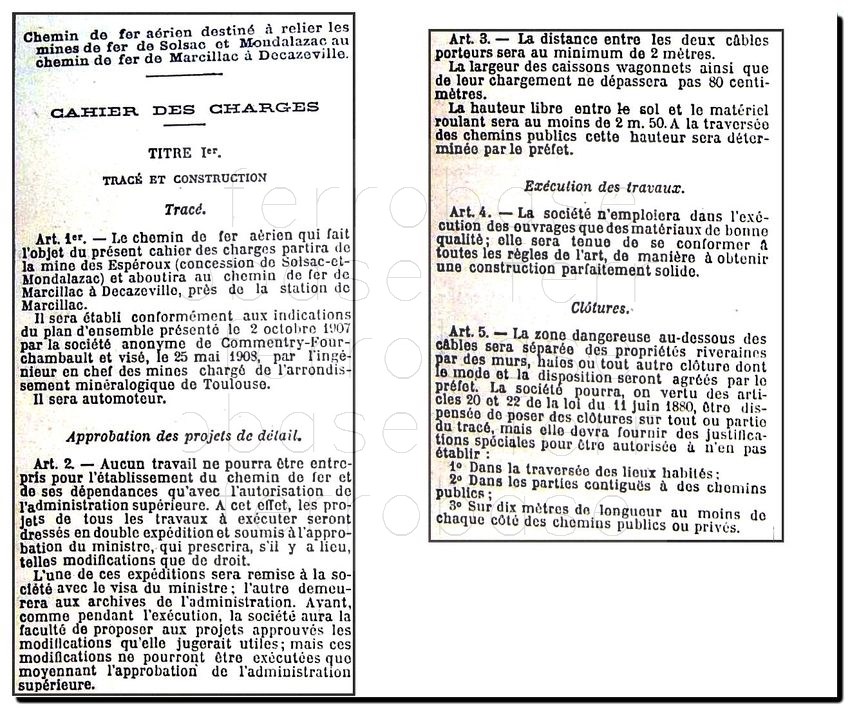
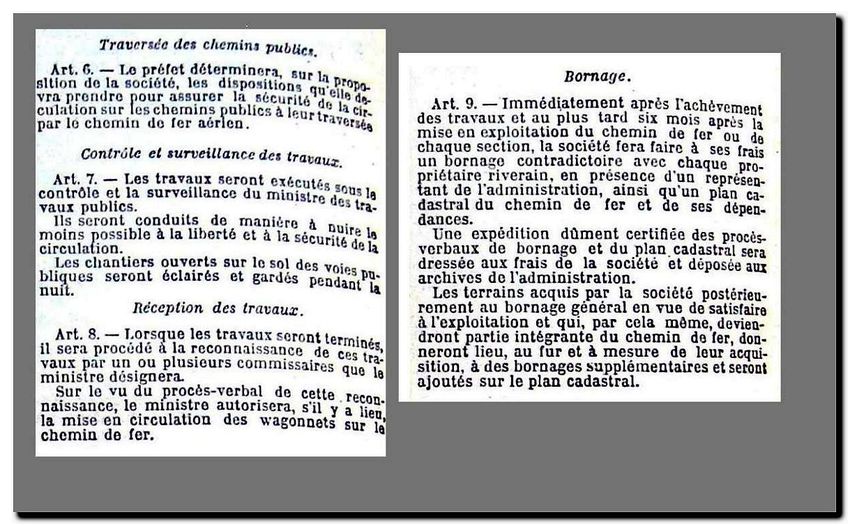
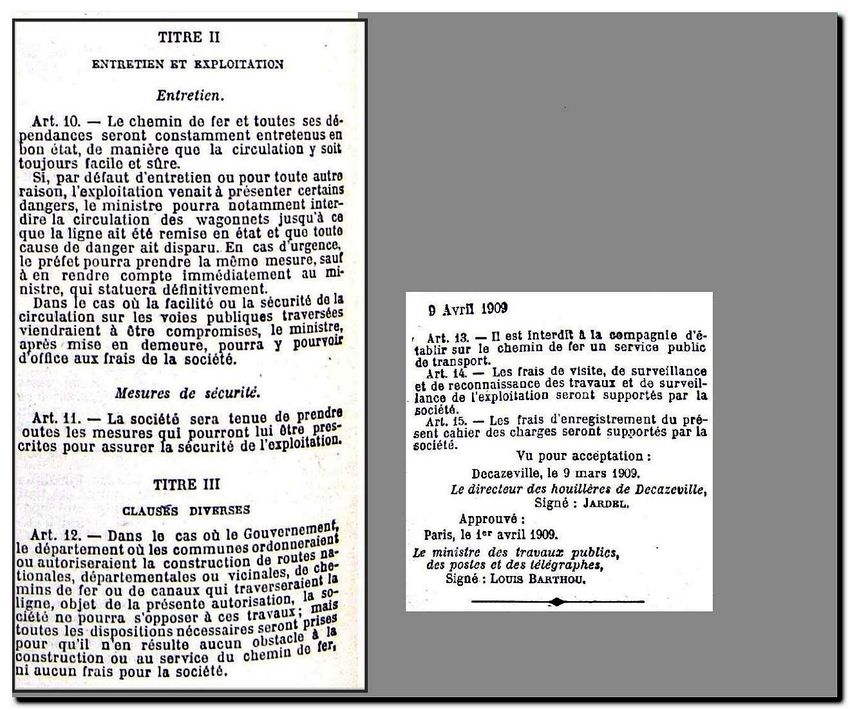
Il y a enfin l’article 13 qui précise, sans aucun humour évidemment, que le service public de transport n’est pas envisageable ! Une précision nécessaire ? Oui, si on fait foi aux remarques que nous rapportons plus loin, montrant que tout le monde n’avait pas lu cet article 13…
Nous avons pu recueillir un témoignage, sur Jogues et ses installations. Jules Malrieu, né juste à la toute fin des activités du chemin aérien se souvient parfaitement de ce qu'il y avait ici. Il évoque ainsi le compteur mécanique de bennes, ou la possibilité de garer des wagonnets. Un frein à vis permettait, au desserage, de lancer l'aérien. Si le mouvement n'était pas actif, le chemin aérien étant automoteur, un balancier pouvait être activé. Les conditions d'hiver, neige, vent, givre... pouvaient empêcher d'utiliser manuellement le balancier. Une machine à vapeur suppléait alors au lancement manuel. Un régulateur de vitesse était également présent à Jogues. En hiver, le mouvement du câble tracteur, même limité, suffisait à dégivrer l'ensemble de l'installation. J. Malrieu évoque également la présence des treuils électriques à la mine des Ferrals, pour remonter les wagons de minerai. Sur un autre sujet, il se souvient que son frère allait faire du feu dans la chaudière d'une locomotive, abandonnée sur le carreau de Cadayrac. Une locomotive Poynot, aux débuts du vingtième siècle, se reposait donc à Cadayrac, délaissée ici depuis 20 ans environ.
Les dates suivantes permettent de retracer en partie la chronologie du projet.
25 juin 1907 : demande officielle de pénétration sur les propriétés privées pour étude de projet.
11 juillet 1907: rapport favorable de l'ingénieur des Mines, qui souligne l' opposition de quelques propriétaires...
2 octobre 1907: lettre au Ministre pour demande d'autorisation de construction
20 novembre 1907 : arrêté du Préfet prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique
13 décembre 1907 : avis favorable de la Chambre de Commerce de Rodez
1 avril 1909 : déclaration d'utilité publique par le Ministre
16 avril 1909 : arrêté du Préfet désignant les territoires concernés
1 mai 1909: enquête parcellaire
7 juin 1909 : arrêté du Préfet déclarant cessibles les propriétés
15 juin 1909: jugement d'expropriation
4 juillet 1909 : publication dans le journal l'Aveyron
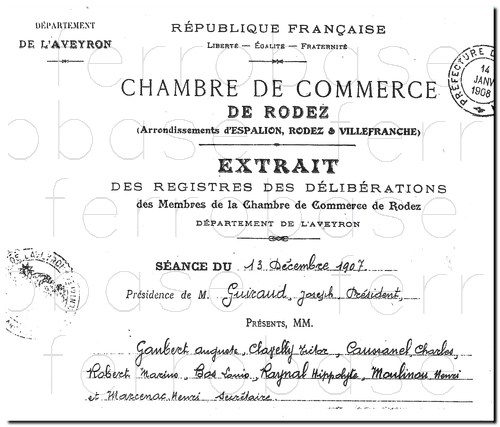
L'enquête parcellaire fournit par exemple les renseignements suivants. La longueur du projet sur la commune de Marcillac est de 1757,45 m, et de 4900 mètres sur celle de Salles la Source. Le chemin aérien fera donc 6657, 45 mètres. Sur la commune de Salles la Source, 52 propriétés sont à acquérir, et 71 sur celle de Marcillac, soit un total de 123. La superficie cumulée est de 2,77 Ha. Rapportée à la longueur de la ligne, la largeur moyenne de la bande de terrain acquise par Commentry est de l'ordre de 4 mètres. C'est cette bande de terrain qui figure encore dans sa presque totalité au cadastre. La traversée des chemins se fera à une hauteur de cinq mètres, et certains passages étaient protégés des chutes éventuelles par une couverture en planches. La hauteur minimale que fixe le projet est de 2,50 m. Dans le chapitre 6 on peut retrouver quelques autres données. On notera, par exemple, dans le programme des travaux, que la date de commencement de la station de chargement des Espeyroux est fixée au 15 mai 1909, celle de la station intermédiaire de Jogues au 15 juin, et celle de la gare de Marcillac au 15 novembre 1909. L'achèvement des travaux des pylones est fixé au 15 juillet 1910.
Dans son rapport du 11 juillet 1907, l'Ingénieur de Mines donne la principale motivation du projet. Il est curieux de constater que dans sa lettre au Ministre du 2 octobre 1907, Antoine Jardel, le directeur des Houillères de Decazeville ne donne lui aucune motivation particulière: " nous nous proposons d'établir un chemin de fer aérien destiné à transporter le minerai de fer...". L'annonce est (un peu ? ) sèche. En 1906, la production des mines de Mondalazac était de 40.000 tonnes, et il est prévu de la porter à 100.000 tonnes. Le chemin de fer à traction animale du Cruou devenait insuffisant, et le rapport souligne " l'absolue nécessité pour les concessionnaires de la mine de Mondalazac d'établir une voie économique de transport de minerais pour permettre l'exploitation dans de bonnes conditions du gîte reconnu". Ce même rapport souligne que la demande de pénétrer sur les propriétés privées est le premier acte de la procédure. Ayant évoqué à plusieurs reprises l'opposition rencontrée, l'Ingénieur des Mines relève également que les propriétaires de terrains n'ont pas le droit de s'opposer à des travaux préparatoires à un projet (qui sera) d'utilité publique. C'est le seul document qui fasse état de quelques oppositions...
Ci-dessous figurent quelques éléments d’archives (A.D. Aveyron, 39S-2). Il s’agit du dossier d’enquête parcellaire des années 1909 et 1910. On trouvera ainsi les éléments du jugement du tribunal civil prononçant l’expropriation le 15 juin 1909. C’est ce jugement qui donne la pleine propriété des terrains à la société Commentry. Le 3 août suivant, le Préfet prend un arrêté publiant le tableau des offres légales : il s’agit des indemnités offertes suite à l’expropriation. Les divers arrêtés et décisions sont annoncés comme il se doit à la population à son de trompe et affichés à la porte principale de l’église et de la maison commune. Nous donnons également copie de la lettre de la Société, listant le contenu du dossier soumis à l’approbation ministérielle, dont toutes les pièces ne figurent pas sous cette cote...Les principales observations sur le projet portent sur quelques ponts-abris. Il s’agit des protections mises en place au droit des chemins. La hauteur assez considérable près de Solsac (de l’ordre de 20 à 40 mêtres) de la ligne et donc des wagonnets laisse craindre aux spécialistes que lors d’une chute de matériaux, causée par le vent par exemple, le minerai ne se retrouve à coté du pont... Un élargissement de 4 à 6 mètres est demandé et accepté. Que les trompes sonnent, et place aux affiches !
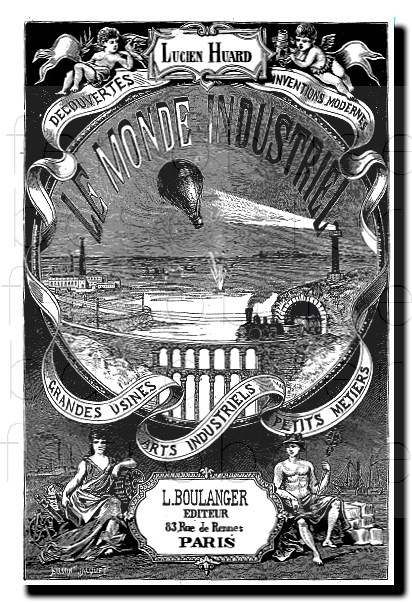
Avant de poursuivre notre découverte du tracé du chemin de fer aérien, il est instructif de savoir que l'installation de Marcillac n'était pas la première de la région, ni la première que la Compagnie de Decazeville mettait en place. Dans un ouvrage intitulé Le Monde Industriel, paru en 1884 et dont la couverture ne devait pas laisser indifférent, Lucien Huard présente dans le tome 1 un article sur le transport des matériaux dans les mines. Pour les installations aériennes, il évoque, entre autres, les brevets Otto et Bleichert comme étant les plus employés. Pour ce dernier, il nous apprend que le représentant en France était Weidknecht. En 1884 il précise enfin que le nombre d'installations est de l'ordre de 200, pour le monde entier, et cite Decazeville comme utilisateur d'installations de câbles aériens...Est-ce cette installation qui figure sur quelques anciennnes cartes postales ?
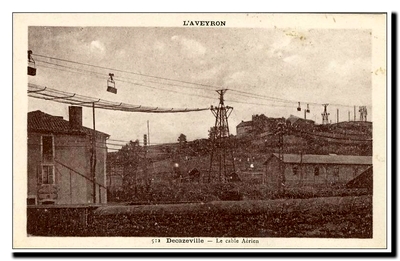
Le tracé
Répondre
précisément à cette question nécessite
auparavant de trouver des sources, car sur le terrain, les traces sont à peu près, et à priori,
absentes ou invisibles pour
le promeneur habituel .
C’est peut
être le point le plus facile à aborder. La
carte IGN actuelle, pour sa version visible sur le site Geoportail donne à peu
près intégralement le tracé de la voie ferrée de Marcillac à Firmi. Le
point de départ, dit gare de Marcillac,
est donc facile à pointer : proche de
la route, et en contre bas,
qui conduit à Solsac au départ de Marcillac. Le chemin qui se
trouve là et les installations d’une
exploitation agricole ont pris la place de cette fameuse gare dont il
reste bien heureusement des photos, et des plans. Juste derrière, vers
Marcillac, le portail du tunnel, qui conduit la voie vers le pont
rouge. On suivra cette voie par ailleurs.
La gare

Ces
pierres, au premier regard bien banales, et qui devraient bientôt
disparaître, ne le sont pas, banales ! Ce sont les restes du
massif du premier pylône au départ de la gare, et de manière plus
précise, c'est ce massif qui est là, tout à droite sur la carte
postale, une phototypie Labouche de Toulouse. Un siècle à quelques
années près séparent ces deux documents.
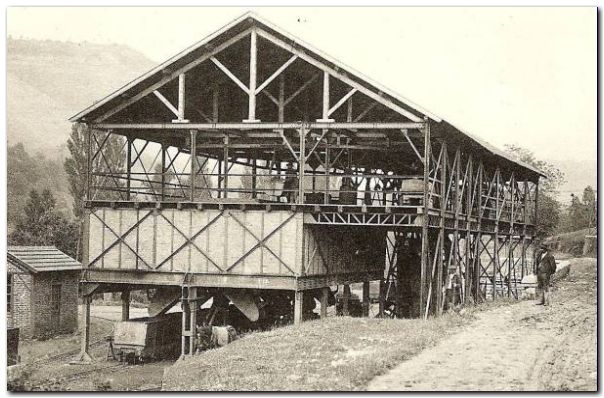
Une autre carte postale ancienne (non montrée ici) présente la gare : prise sous le même angle, il y manque le cheval, mais les pylônes et wagonnets vers Solsac sont mieux intégrés au cliché. Le premier pylône, ici, est assez difficilement rendu, tout à droite....
Les vues de cette gare de chemin de fer aérien, nom consacré, se présentent pratiquement toutes sous cet angle, avec ou sans cheval ! Aussi, c'est avec plaisir que nous vous offrons une image rare et presque inédite : la gare, mais vue de l'intérieur ! Cette photographie combien précieuse complète les plans et coupes donnés plus bas. Parmi les détails remarquables de la vue :
- charpente et toitures des parties arrière
(les plans de charpente sont tous différents, bien que contemporains
....)
- plancher étage. On note la présence d'un ouvrier, à l'arrivée des
wagonnets pleins, et l'abri tout à coté, pour se protéger si besoin
est des vents froids et de la pluie...
- le plan de voies au sol, et la position de la voie du triangle de
retournement des machines, au premier plan
- l'ensemble des trois contre poids de lestage
- le wagonnet, bien sûr, et tout en haut à droite, le bouquet sur le faîte de la toiture. Détail insignifiant ? Oh non ! Comme il n'a pas dû rester bien longtemps, le cliché date des tous premiers temps de l'exploitation, et en hiver ou début de printemps. La date probable se situe entre fin 1910 et début 1911. On remarque également, mais les ressources informatiques sont impuissantes à corriger la définition de la carte, un panneau, accroché sur la charpente, sous le bouquet . Que révèle-t-il ? Cette carte a circulé, mais sous enveloppe. La correspondance est à usage strictement privé et ne nous renseigne pas sur nos mines!
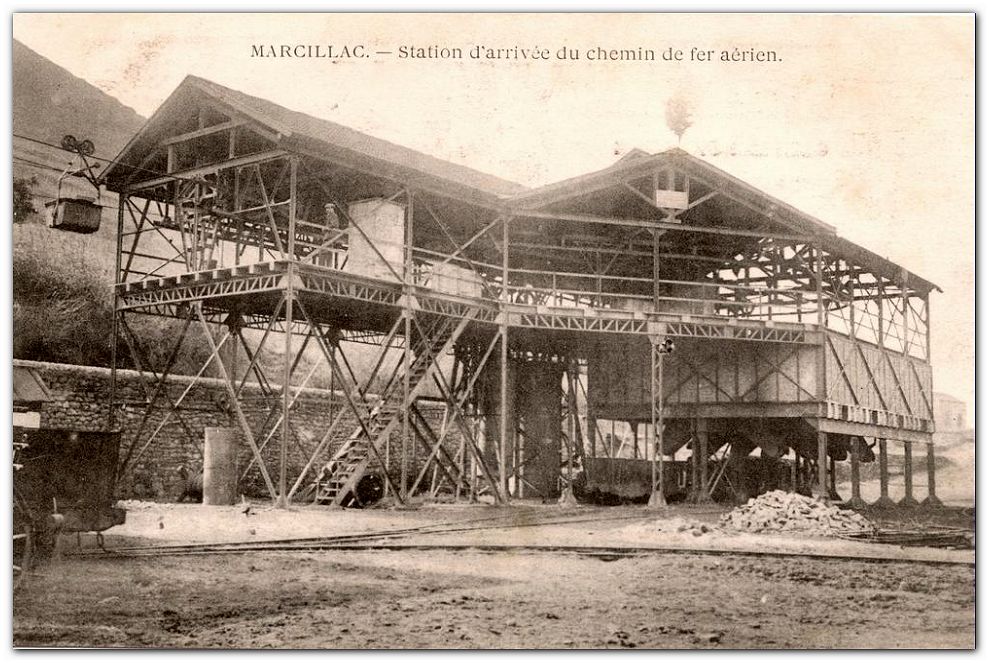
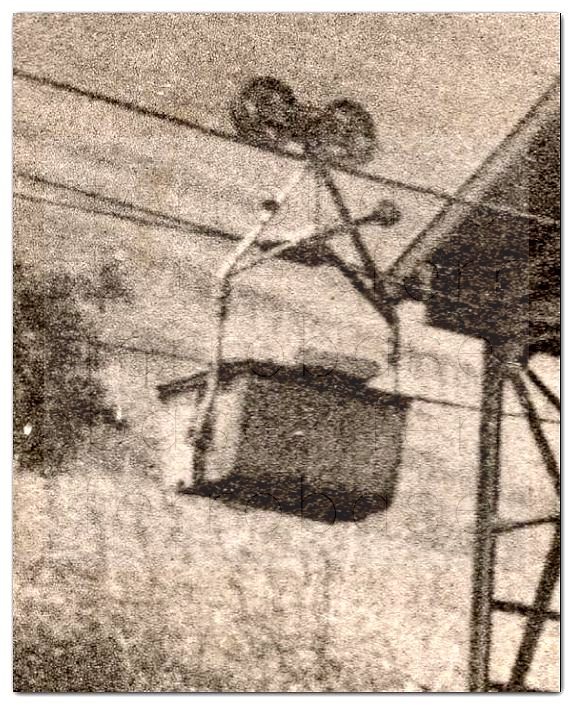
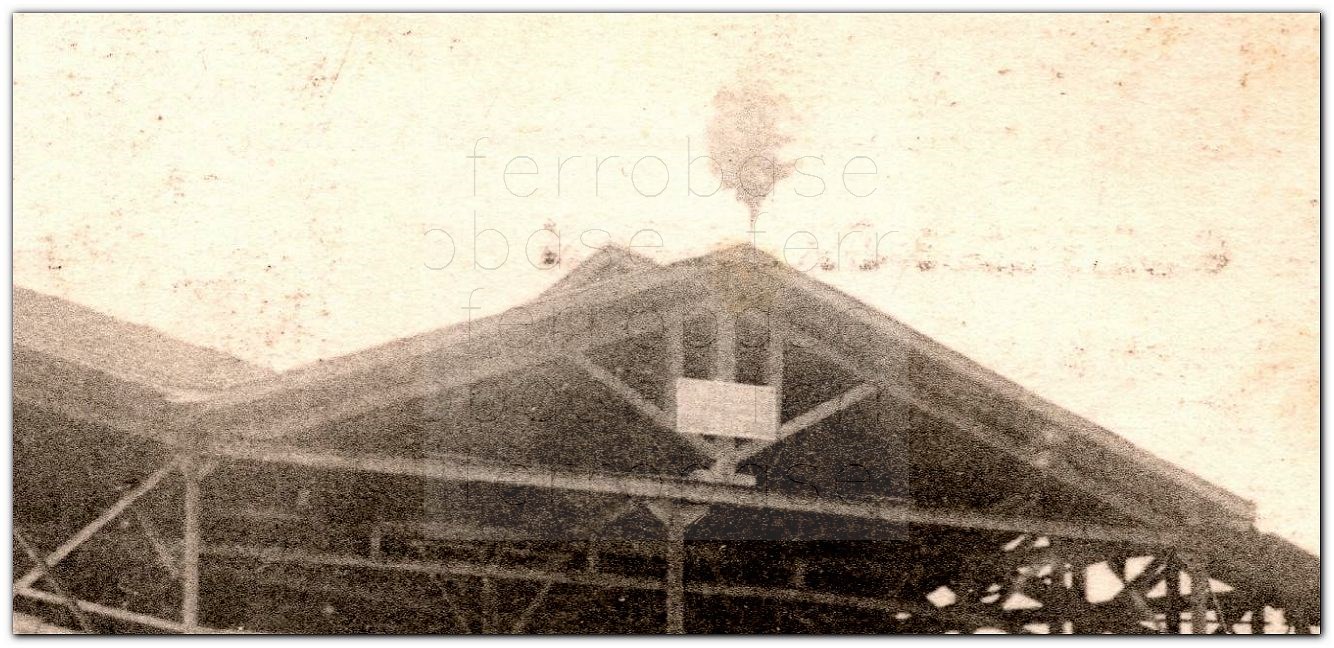
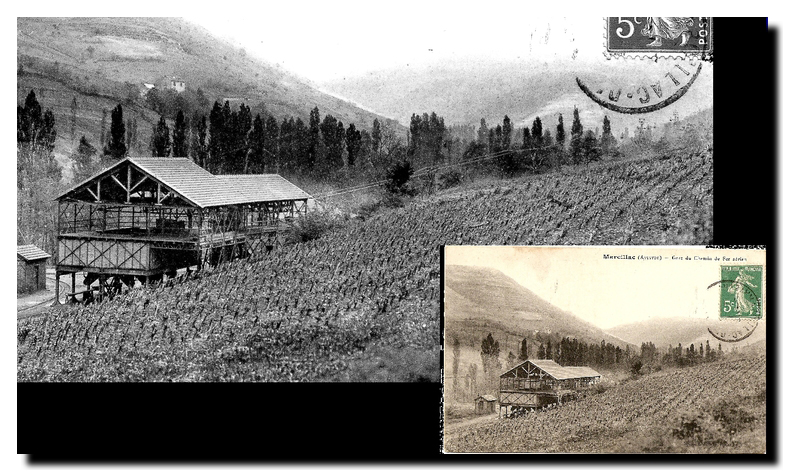
La carte postale ci-dessus montre bien la gare dans son environnement .Le tampon est illisible et ne peut, hélas, renseigner sur la date. La première version du timbre date de 1907, et seuls quatre mots (il en fallait moins de 5) constituent la correspondance ; c'est à dire que rien n'apporte de précisions ! Elle a été envoyée depuis Marcillac. L'abri à gauche est bien repérable, tout comme les voies ferrées sur le plateau du dépôt et vers le remblai du Cruou. Le cliché est à situer vers fin 1910-1911 ; ce sont les tous débuts d'exploitation de l'installation, rien ne traine sur le sol...ni sur le plancher de la station. Sauf à penser que le coup de balai ait été particulièrement efficace, la station vient donc d'être terminée, ce qui pourrait justifier cette carte postale d'un photographe ruthénois, rare sous cet angle. La carte montre parfaitement les câbles, qui jouent avec la lumière, en arrière des vignes. Et tout au fond, à droite sous le pied de la semeuse, que voit-on ? Ceci, mais certainement peu nombreux sont ceux qui auront compté les wagonnets, si, si, Yes, we can !
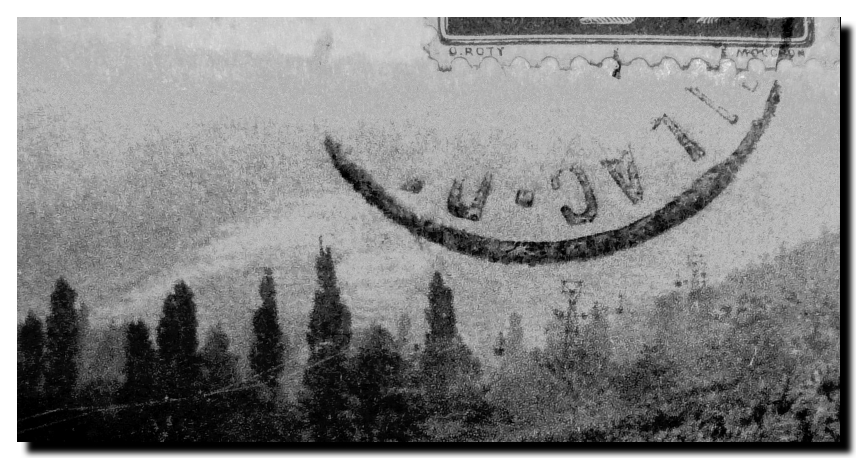
Les photographes ne se sont pas beaucoup bousculés sur ce plateau du dépôt...Cependant en regardant bien les cartes postales, il est possible de récupérer quelques informations. Cette carte nous donne un bon exemple de découverte. Plusieurs versions du même cliché existent, et sur celle présentée, le nom de l'éditeur ne figure pas. Par contre, tout au fond figure....un pylône : à cet emplacement, sa forme géométrique et les barres obliques du contreventement le trahissent ! Ouvrez l'oeil...
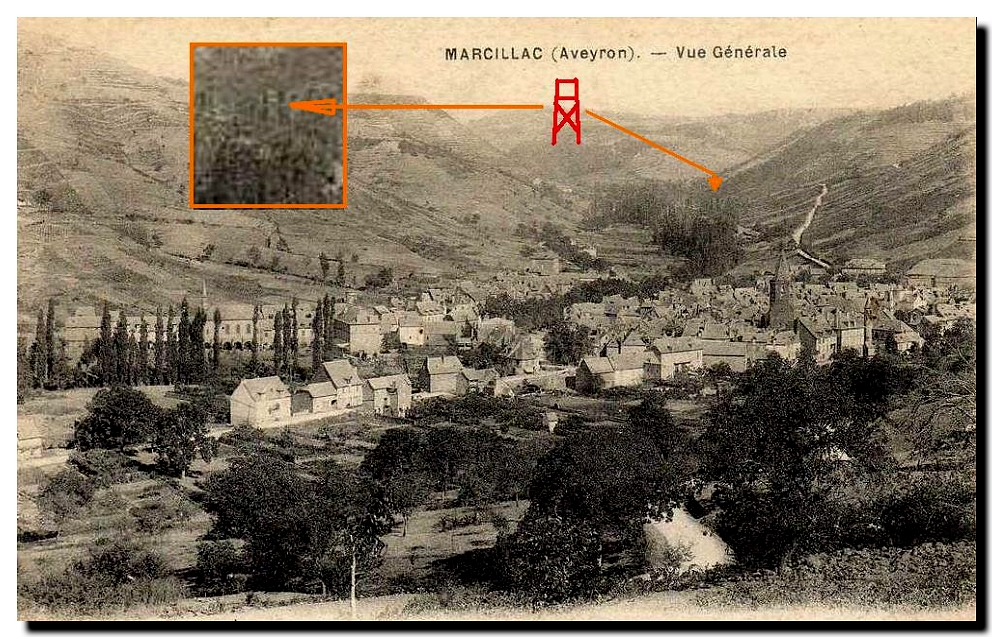
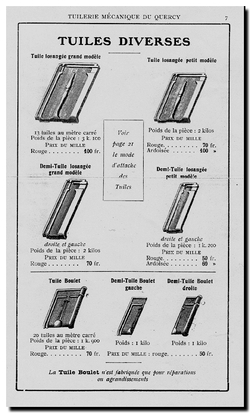
La couverture de la gare est constituée de tuiles. Elles provenaient
très vraisemblablement des tuileries Lacabane au Puy Blanc, près
de Figeac, dans le Lot, département voisin. Il semble qu'elles
furent réemployées après démolition sur un bâtiment encore présent (en
septembre 2010) à Marcillac. Le catalogue de la tuilerie en fait
bien état entre 1900 et 1909. (merci
à Jacques Thébaud (association http://puyblanc.free.fr) et
Bernard Olivié pour
leur contribution). Nous les
avons bien volontiers adoptées pour la modélisation numérique présentée
chapitre 10.
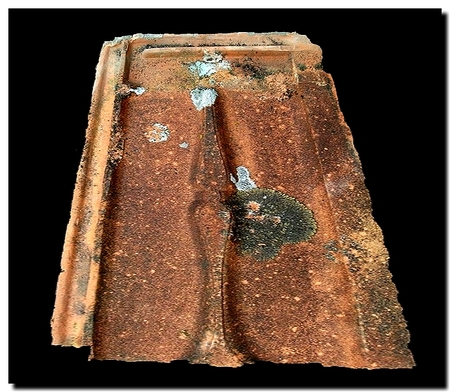
Tuile mécanique losangée
Le wagonnet aérien des vues précédentes est le même que celui-ci,
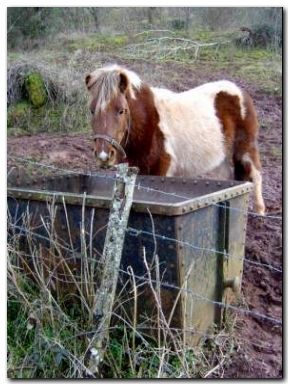
ou cet
autre qui vit ses derniers moments à
l’ombre d’une cabane perdue dans la nature. On notera les restes de
tonneau ou barrique, témoins des deux activités passées et ou présentes
de Marcillac.
B.
Olivié, homme ressource de Marcillac, vient très récemment de rectifier
une erreur : le gentil poney n'a pas devant lui un wagonnet de
Marcillac ; sa géométrie n'est pas d'ailleurs identique. Mais
notre image nous plait et nous la conservons ! Les
diaporamas vous présentent d'autres images.

Autre image, les wagonnets sont bien d'ici, mais le poney, bien que présent, n'a pas voulu venir poser....
Bien après la fin de l'exploitation, en période de pénurie de fer et tôles, des wagonnets ont fait l'objet d'un troc abreuvoir ciment contre wagonnet, et sont partis pour une deuxième carrière sur des fils pyrénéens... Ils regrettent sûrement la belle vallée du Cruou !
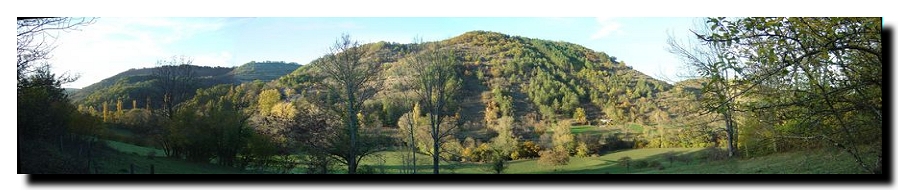

Celui-ci est bien caché !
Suivre le wagonnet
demande maintenant quelques efforts. Rien apparemment sur le
terrain ! En reprenant les conclusions de l’importateur
Mourraille, on se souvient qu’il évoquait l’avantage d’une occupation
de terrain très faible : une longue bande de terrain très étroite.
Il est possible en 2008, soit près d’un siècle plus tard, de retrouver
cette trace. Le site Geoportail, toujours lui, permet de superposer à
la photographie aérienne une couche d’informations
supplémentaires ; c’est ainsi que l’on peut superposer à l’image
la carte, bien utile pour se repérer, et dans le cas précis de
l’Aveyron, le fond cadastral. L’histoire nous aide bien : les
remembrements sont peu nombreux dans ce pays de causses, et pour la
plupart, les limites parcellaires perdurent depuis…..des siècles ou
presque ! En effet, on peut aux environs de Solsac, de Jogues, de
Mondalazac visualiser sur le cadastre des parcelles très allongées et
présentant des élargissements : gagné ! Ce sont bien sûr les
limites des parcelles de la compagnie, et les emplacements des pylônes.
Le reste sera un jeu d’enfant : une règle, un crayon et on obtient
le tracé complet et parfaitement véridique de ce chemin de fer aérien.
La figure suivante présente un extrait de ce travail d’archéologue
ferroviaire ou minier .
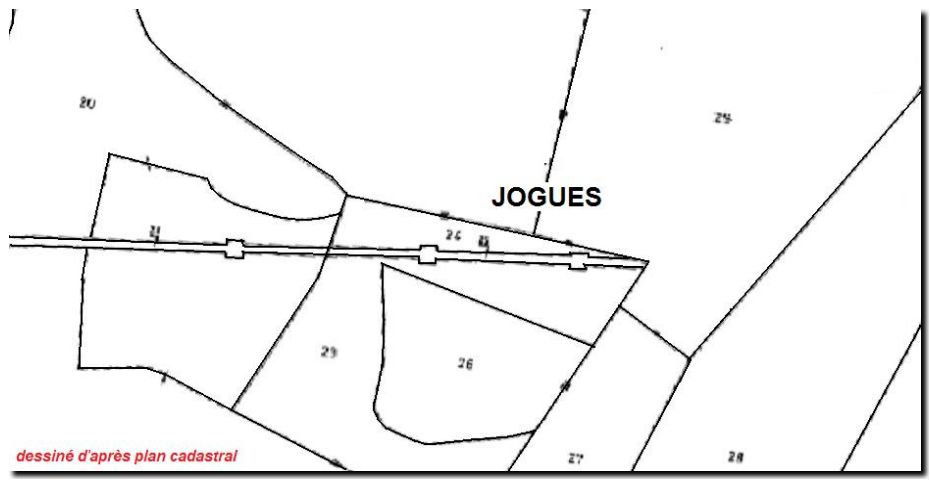
Il reste enfin le plaisir de parcourir l’intégralité du tracé, avec le respect qui s’impose des propriétés privées.

On fera alors des
découvertes remarquables : la quasi-totalité des pieds de pylônes
peut se retrouver, avec les têtes des tiges filetées sur les massifs,
le plus souvent bien cachés dans les broussailles ou les bois.


On retrouvera également tout près
de l’église de Solsac, un passage très curieux ou le chemin de fer
passait en tranchée (oui en tranchée ! ) : cela évitait bien
sûr un pylône trop haut, mais surtout que la ligne ne se trouve trop
élevée pour une descente plus que vertigineuse vers Marcillac. Ce
passage est très accessible par le chemin qui conduit à une grotte
fameuse. En plongeant vers la gare de Marcillac, un pylône devait
porter la ligne aérienne à près de
40 m de hauteur. Auparavant le profil en long du tracé est donné
par un schéma qui montre ce que pouvait être le cheminement de la ligne.



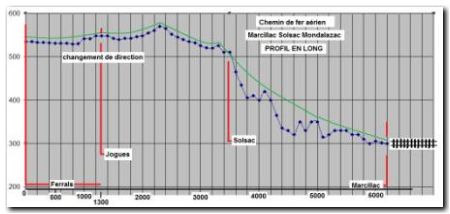
Le plan
cadastral présente le grand intérêt de fournir des informations
précises. Mais ce n'est pas un document immuable. Il peut (il doit ! )
être modifié à tout instant à la suite de mutations foncières. Et pour
éviter que les quelques trous qui apparaissent fin 2008 dans notre
tracé cadastral ne deviennent de grandes lacunes puis disparaissent
définitivement, emportant tracé et souvenir du parcours, nous
vous proposons le tableau suivant. Il fournit les coordonnées Lambert
II étendu des éléments de la ligne aérienne ; dans l'axe de celle ci,
nous proposons les débuts ou fins de parcelle, de 5 m de largeur
environ, repérés Pxx et les centres des massifs de fondations des
pylônes, repérés Mxx. Le point de départ se situe aux Ferrals, à la
mine, et le parcours se déroule vers Jogues et Marcillac. Ce tableau
permettra de conserver une trace plus efficace de cette ligne. Ce
tableau est valide à la date de février 2009 et reprend l'intégralité
des éléments cadastraux.
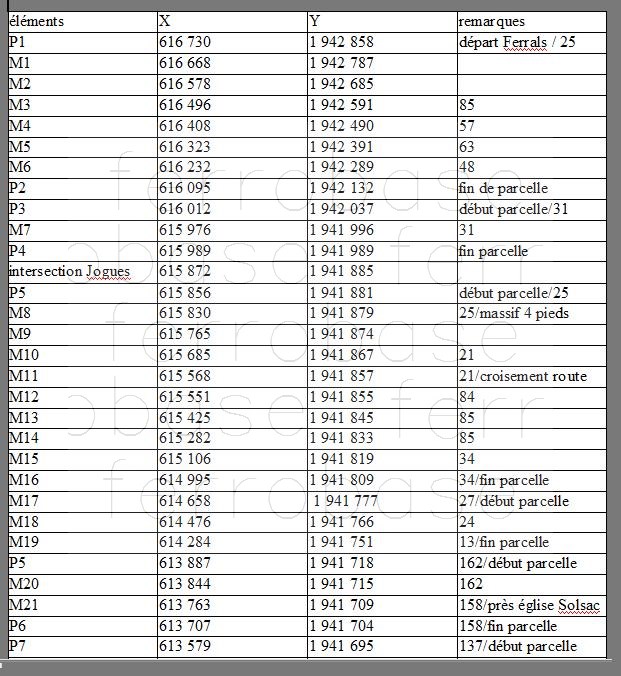
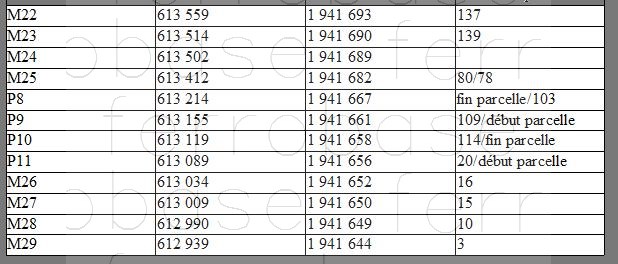
- le sens de parcours va de la mine, à Ferrals, vers Jogues, puis vers Marcillac
- les éléments repérés Pxx concernent les débuts ou fins de parcelles (largeur uniforme de 5 m)
- les éléments repérés Mxx concernent les massifs de fondations des pylônes
- le point haut de la ligne se situe entre les massifs M16 et M17, un peu avant Solsac
- P7 : tout proche du passage bas en tranchée à Solsac
- M23 et M24 : massifs jumeaux, en bord de chemin sous Solsac
- M25 : correspond au plus haut pylône de la ligne
- P14 : ruisseau de Bederre
- dernière colonne : les numéros sont ceux des parcelles, tels qu'indiqués sur le cadastre
On notera enfin que ne figure pas dans les éléments du cadastre la fin du tracé jusqu'à la gare de Marcillac.

Ci-dessus, la tranchée de Solsac. Nous vous proposons d'autres images dans la page diaporama, accessible depuis la page de menus. Ce passage en tranchée était parfaitement contraire aux dispositions du cahier des charges...
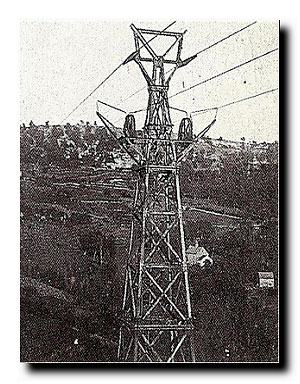 (coll. J. Ulla)
(coll. J. Ulla)
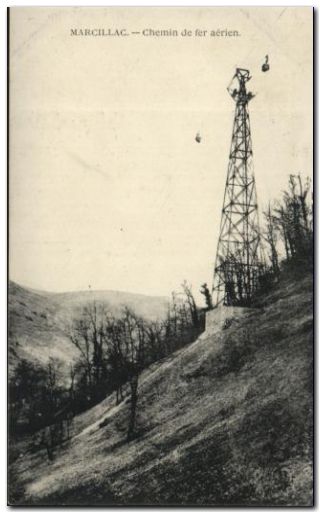
Ci dessus, deux vues du grand pylône près de Solsac, et une vue actuelle des restes du massif de fondations. Un siècle plus tard, la végétation est seule locataire du terrain !

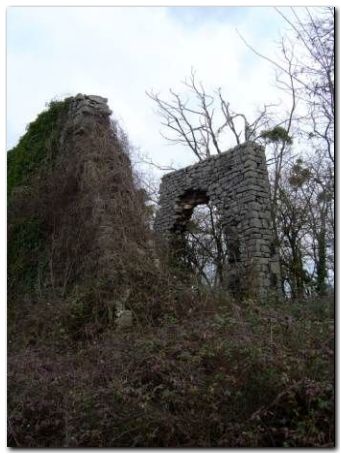
Ce qui subsiste de la
station intermédiaire de Jogues, seul changement de parcours de la
ligne.


Le
profil en long est globalement plat au départ puis plonge vers
Marcillac en fin de parcours. L’altitude de départ, à Mondalazac est
proche de 535 m, puis 548 m à Jogues, à la station de changement de
direction, 570 m un kilomètre après, ce sera le point haut, avant
Solsac, et 300 m à la gare de Marcillac. Sur l'image
d'hiver, à droite, Jogues est au centre.
 La
largeur de la bande de terrain qui figure sur le cadastre est de
l'ordre de 4,50 m, et les réserves de terrain pour les massifs d'assise
des pylônes font 6,50 m environ de coté. Le massif support du pylône de
40 m était plus important : le terrain acquis est donc plus important,
13 m par 13 m. Les portées de ce pylône étaient respectivement vers
Jogues, de 86 m, et vers Marcillac de 362 m environ. Sur le plateau,
l'espacement des pylônes est de l'ordre de 100 à 120 mètres. L'auteur
de ces lignes imagine mal comment la paysanne du plateau pouvait
emprunter (enfin, ce n'est pas le bon terme, car formellement
interdit, on s'en doute ! ) un wagonnet au passage très bas de Solsac :
sauter dans un wagonnet vide ou plein, et se retrouver propulsée à 40 m
de hauteur, sur des portées pareilles, relève d'aptitudes rares...Même
très enjolivée, l'histoire fait quand même frémir ! Evidemment,
il fallait la complicité active du personnel !
La
largeur de la bande de terrain qui figure sur le cadastre est de
l'ordre de 4,50 m, et les réserves de terrain pour les massifs d'assise
des pylônes font 6,50 m environ de coté. Le massif support du pylône de
40 m était plus important : le terrain acquis est donc plus important,
13 m par 13 m. Les portées de ce pylône étaient respectivement vers
Jogues, de 86 m, et vers Marcillac de 362 m environ. Sur le plateau,
l'espacement des pylônes est de l'ordre de 100 à 120 mètres. L'auteur
de ces lignes imagine mal comment la paysanne du plateau pouvait
emprunter (enfin, ce n'est pas le bon terme, car formellement
interdit, on s'en doute ! ) un wagonnet au passage très bas de Solsac :
sauter dans un wagonnet vide ou plein, et se retrouver propulsée à 40 m
de hauteur, sur des portées pareilles, relève d'aptitudes rares...Même
très enjolivée, l'histoire fait quand même frémir ! Evidemment,
il fallait la complicité active du personnel !
Cette activité - illicite ! - de transport apparait un peu partout sur la planète, là où les wagonnets circulent. Voici un exemple en deux actes : à gauche, une vue d'artiste, et à droite la réalité. Le cliché est d'origine http://library.mines.edu/Glass_Slides1, la bibliothèque numérique de l'université du Colorado. Son centre de recherches sur les transporteurs aériens propose également près de 90 images des débuts, une découverte passionnante.
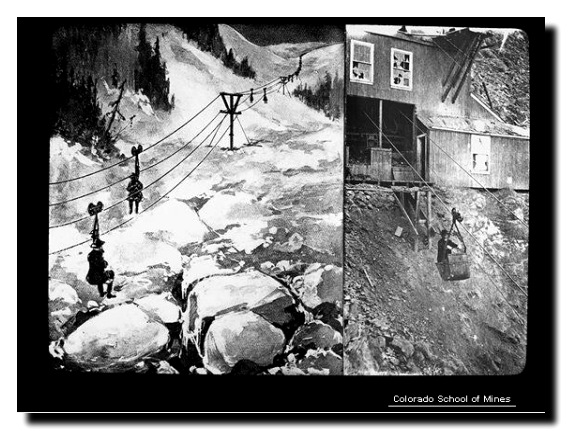
Un dernier exemple d'aptitudes certaines: cette fois, il s'agit de militaires, anglais, à Gibraltar. Nous sommes en 1894. Parue dans l'Univers Illustré, 24/02/1894, visible dans Gallica. Le système est bi-câbles, et semble assez artisanal...
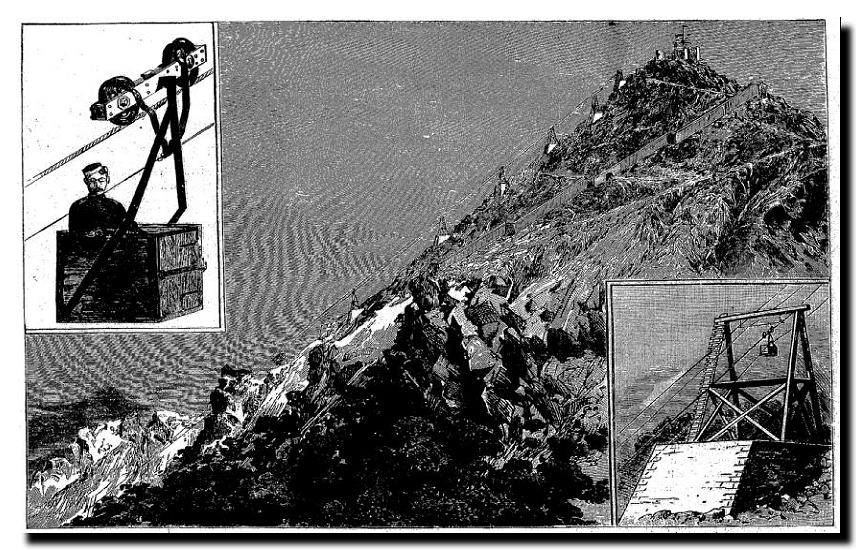
Retour sur le causse. La surface totale des terrains acquis, après la déclaration d'utilité publique, pour réaliser le chemin aérien est de l'ordre de 30 000 m2, légèrement plus avec les élargissements des massifs. Pas négligeable donc. En janvier 2010, le cadastre permet de retrouver 44 parcelles sur la commune de Salles la Source, de 25 à 1377 m2, pour un total de 13.153 m2. Mais non jointives, la continuité du tracé n'est plus assurée...
Nous pouvons compléter ces
informations par les indications d'un plan ou document d'archives, non
daté mais ayant servi à la réalisation du chemin aérien, à situer donc
entre 1909 et 1911. Ce plan, numéroté 14990, et 03209,
fournit un tableau des caractéristiques géométriques des pylônes :
numéro, hauteur, type, diamètre des rouleaux porteurs, et diverses
précisions sur les plans concernés. Nous avons repris ci-dessous le
tableau des numéro, hauteur, type et diamètre.
Nous regrettons bien sûr de ne pas avoir (encore !
) mis la main sur le plan des travaux lui même, mais nous pouvons
faire quelques commentaires sur ces données chiffrées. Les numéros sont
établis de la mine de Ferrals vers le dépôt de Marcillac : 57
pylônes sont indiqués, plus un pylône bis, le 39. Les hauteurs sont
très variables, et la hauteur maximale est bien de l'ordre de quarante
mètres, après Solsac.
Quatre types de pylônes sont mentionnés :
léger, moyen, lourd, et lourd renforcé, comme le 39 bis de 40 m. On
trouvera ci-dessus deux des très rares photographies
disponibles de ce pylône, dont une carte postale.
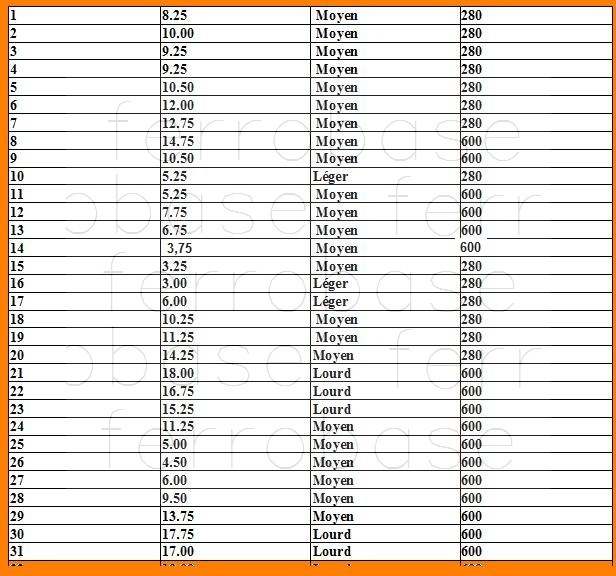
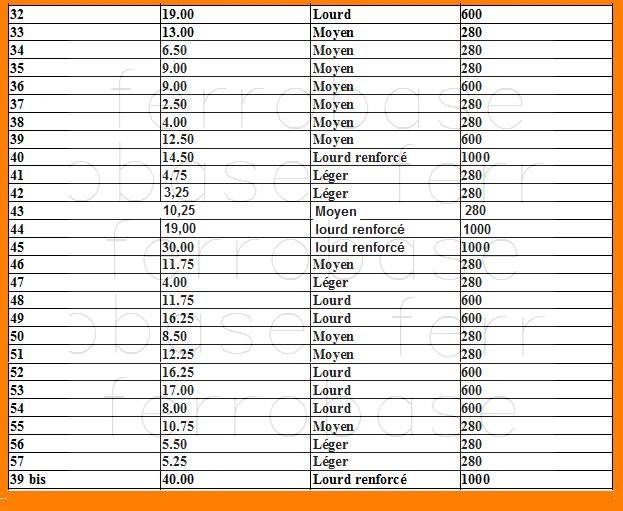
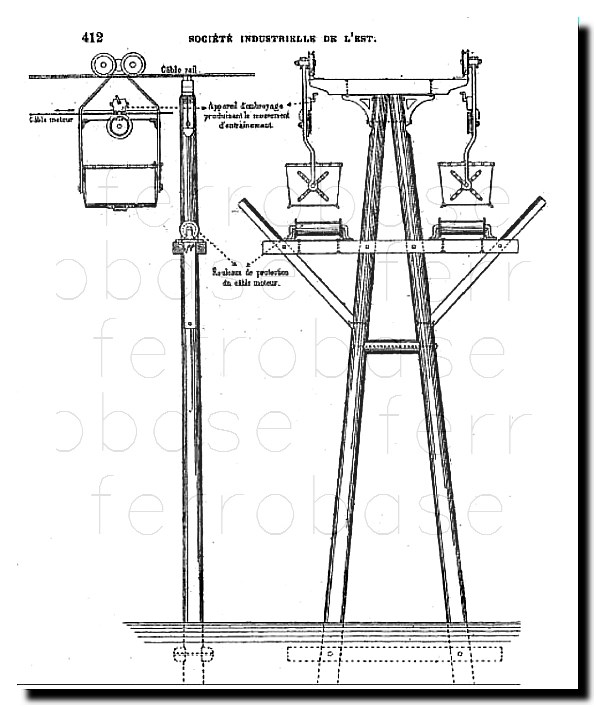
Carte, carte…
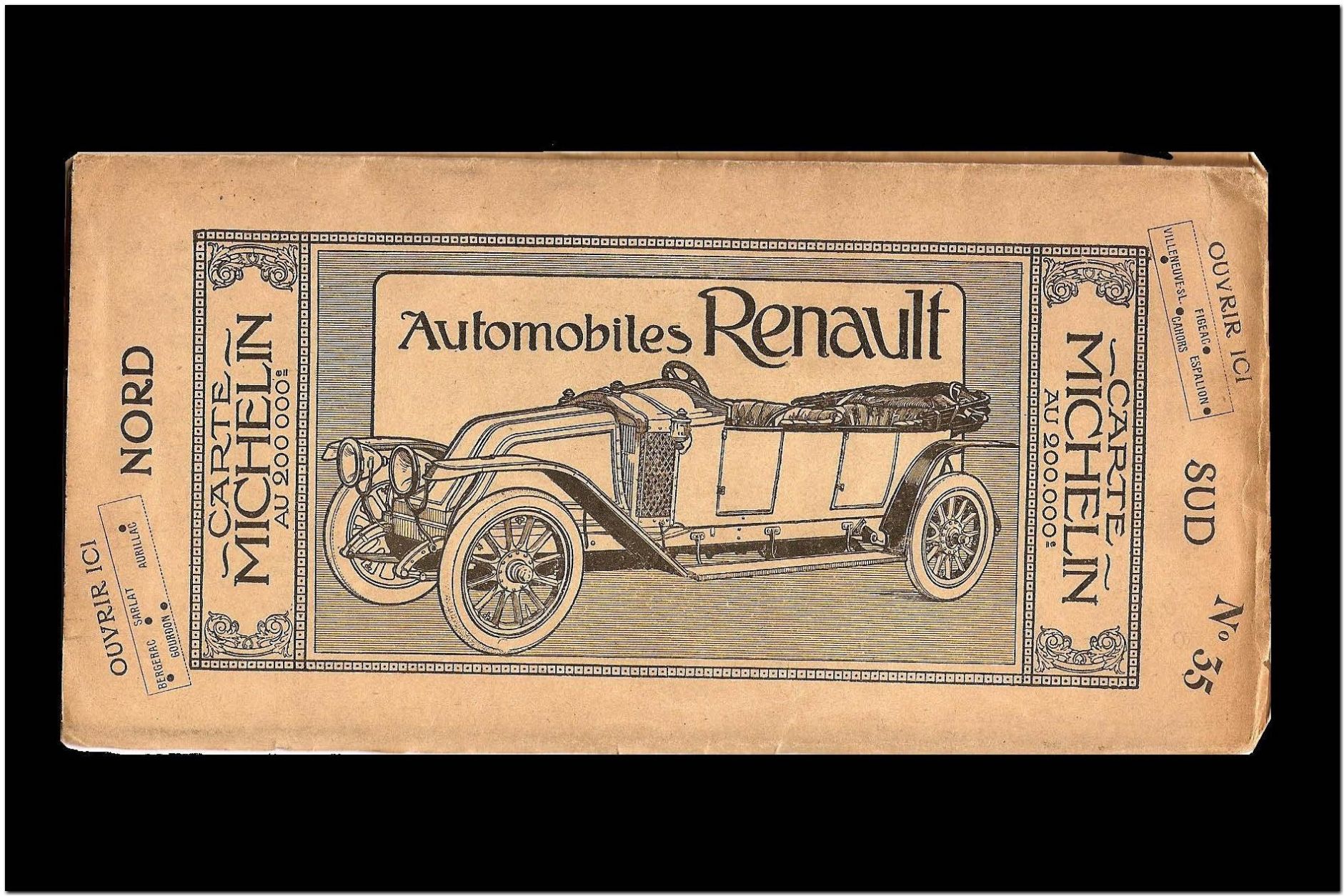
Sur
les cartes actuelles, rien sur cette ligne aérienne bien sûr, quoique….
Il faut remonter aux premières cartes routières Michelin au
1/200 000, la première très exactement. Parue vers 1915, 1912
probablement, et en dehors de sa couverture très illustrée, elle fait
figurer la ligne de la voie de Firmi à Marcillac, ce qui se
conçoit, et….le chemin de fer aérien de Marcillac à Mondalazac, qui
venait alors d’être construit. Beaucoup plus surprenant pour une carte
dite, et à finalité, routière ! Et marqué comme tel sur la carte :
chemin de fer aérien. Rien de routier dans ce projet, mais sans
doute une concession à la nouveauté de cet équipement dans le
paysage ! L'extrait de carte, très agréablement colorée, aurait dû
se trouver ci-dessous...
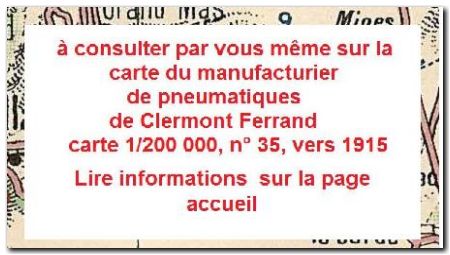
les analyses et
courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles
sont incorporées. Pour les œuvres d'art graphiques ou plastiques,
l'exception de citation impose de veiller au respect de l'intégrité de
l'œuvre.
La contrefaçon
est une reproduction et/ou une représentation illicite d'une œuvre et
le simple fait de citer une marque peut constituer une contrefaçon.
Ce paragraphe
parait assez éloigné de nos chemins ; il n'a d'autre but que de
justifier l'image ci-dessous, quelques cm2 de la carte 1912 du
manufacturier de pneumatiques de Clermont Ferrand, extrait donc
parfaitement identifié (auteur et source), et extrait non modifié de
l'oeuvre. Cette courte citation est réalisée compte tenu du caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique de l'oeuvre. A
contempler donc sans modération. rappelons que la carte dans son
intégralité donne l'ensemble du parcours de Marcillac à Firmy.
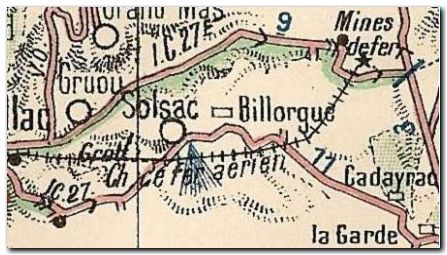
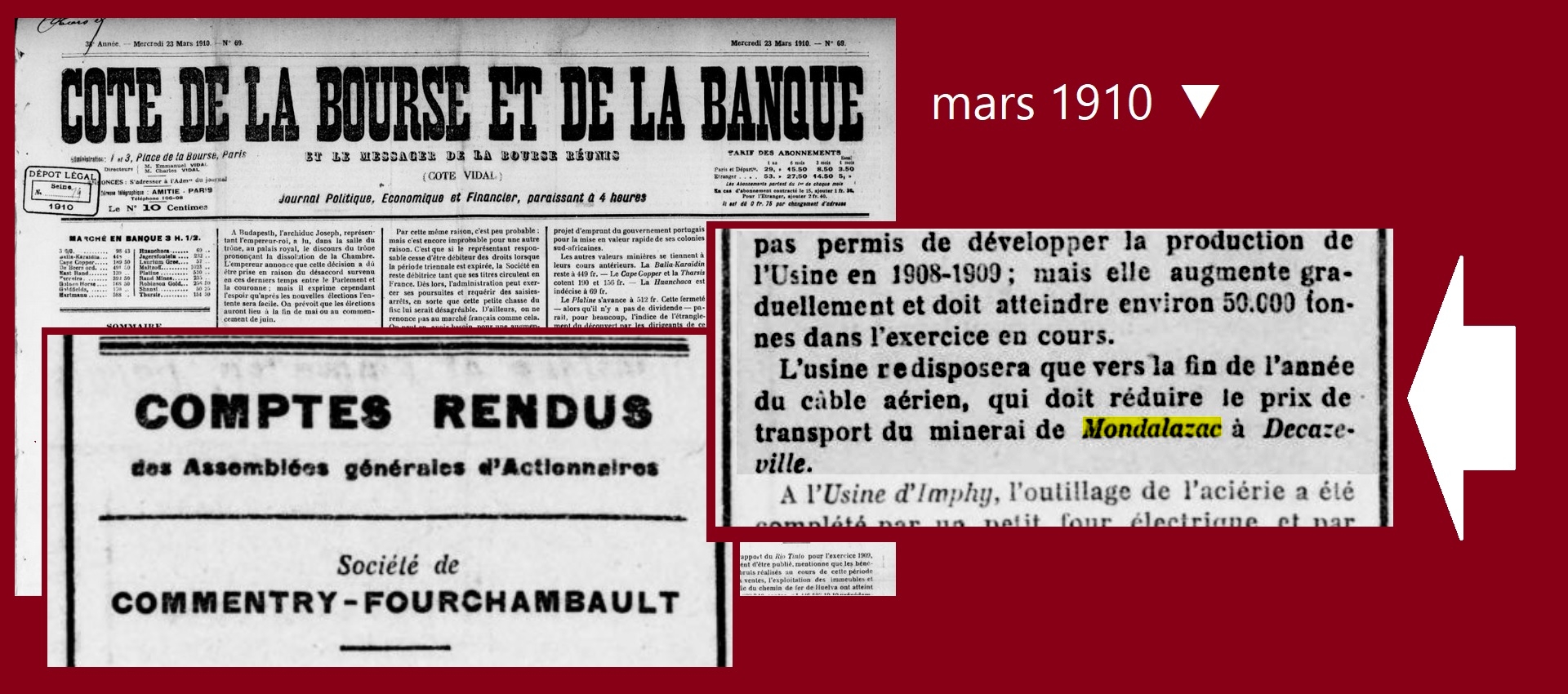
Les archives
L’ASPIBD, à Decazeville mène un travail remarquable : sauvegarde et diffusion de témoignages miniers divers. On trouvera sur son site aspibd.org l’information voulue. C’est grâce à l’obligeance de MM. Herranz et Granier, Président et Secrétaire, que nous pouvons proposer, sortis des archives de l’association, les plans suivants, ou extraits de plans : la gare de Marcillac, les plans de wagonnets et ceux de la mine de Mondalazac. Pour chacun d’entre eux, nous donnons, la taille et la date, lorsque celle-ci est parfaitement attestée.
Plan de mine, format : 0,75 x 0, 60 m, 1/1000, date : 1912
Il s’agit d’un plan d’ensemble des concessions de Mondalazac et de Muret, plan en couleurs daté exactement du 18 janvier 1912, et réalisé à Decazeville. Le dessinateur n’est pas mentionné.
On trouve sur ce plan le tracé du câble aérien, comme indiqué, le périmètre des gisements et leur épaisseur, l’emplacement des sondages avec des précisions sur l’exploitation possible ou non, les sondages abandonnés. Il y a également une coupe du plateau. Y figurent également les exploitations de Lagarde, pour la concession de Muret, le tracé du départ de la voie ferrée de 1,10 m, l’ancienne exploitation à ciel ouvert de La Rosière et la mine de Solsac.
Le périmètre joint Solsac Vieux, Solsac neuf, Le Colombié, Cruounet, Agals, Muret, La Vayssière, Puech Essuch, et se referme à Solsac Vieux.12 sondages sont indiqués exploitables en puissance et teneur, 5 (ceux en rouge ci-dessous) inexploitables pour teneur trop faible, 2 pour faible puissance. Pour la concession de Muret, figurent le périmètre de la mine, le tracé de l’affleurement. On donne ci-dessous trois extraits : l’ensemble de la concession de Mondalazac avec en vert le trait du câble aérien, un agrandissement de la zone de Mondalazac et un de la zone de Cadayrac.
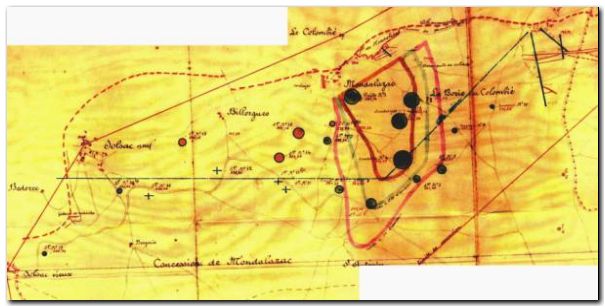
Le nombre de sondages repérés sur le plan est de 21. Un
puits, le puits n° 1 à Mondalazac est indiqué, ainsi qu'un ancien
puits dit de recherches au nord est de celui-ci. Le trait
qui barre le plan en biais en bas à droite est la limite de la
concession et constitue donc la limite des concessions de
Mondalazac, au dessus, et de Muret en dessous.
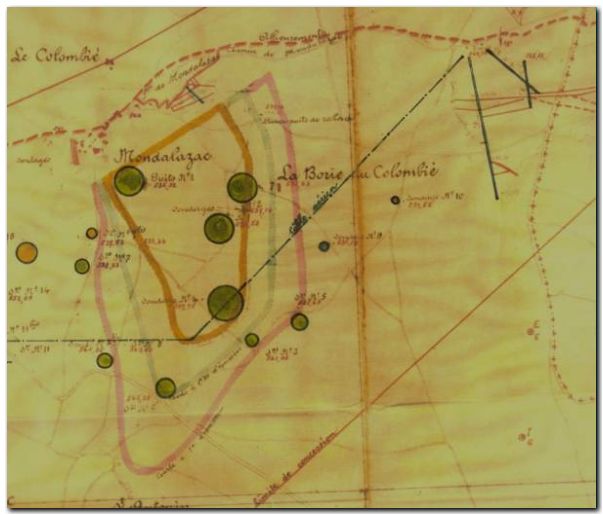
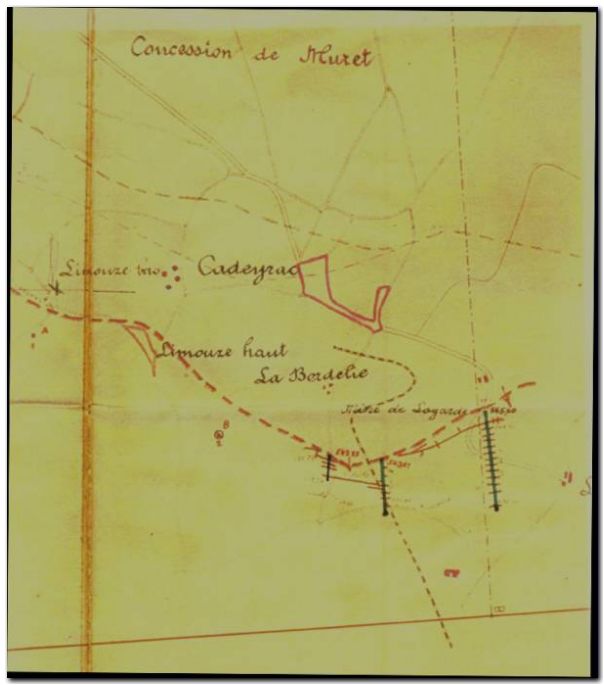
L’exploitation de la concession de Mondalazac par la Compagnie des Houillères et Fonderies de l’Aveyron n’a pas toujours été très simple. C’est ainsi que la Compagnie des forges et fonderies d’Aubin, très concurrente, était propriétaire en 1846 dans le périmètre de la concession de Mondalazac d’une propriété et avait demandé au Préfet de l’Aveyron l’autorisation d’exploiter à ciel ouvert le minerai présent, autorisation accordée. La Compagnie de Decazeville, concessionnaire, intenta alors une action afin d’annuler cette décision. Une bataille juridique sur le droit du sol et du sous-sol se termina devant le Conseil d’Etat qui donna raison à la Compagnie de Decazeville. (Annales des Mines, p551-565, décision Conseil d’Etat, 13 août 1850, à lire dans le tome XVIII, quatrième série,1850, disponible sur Google books).
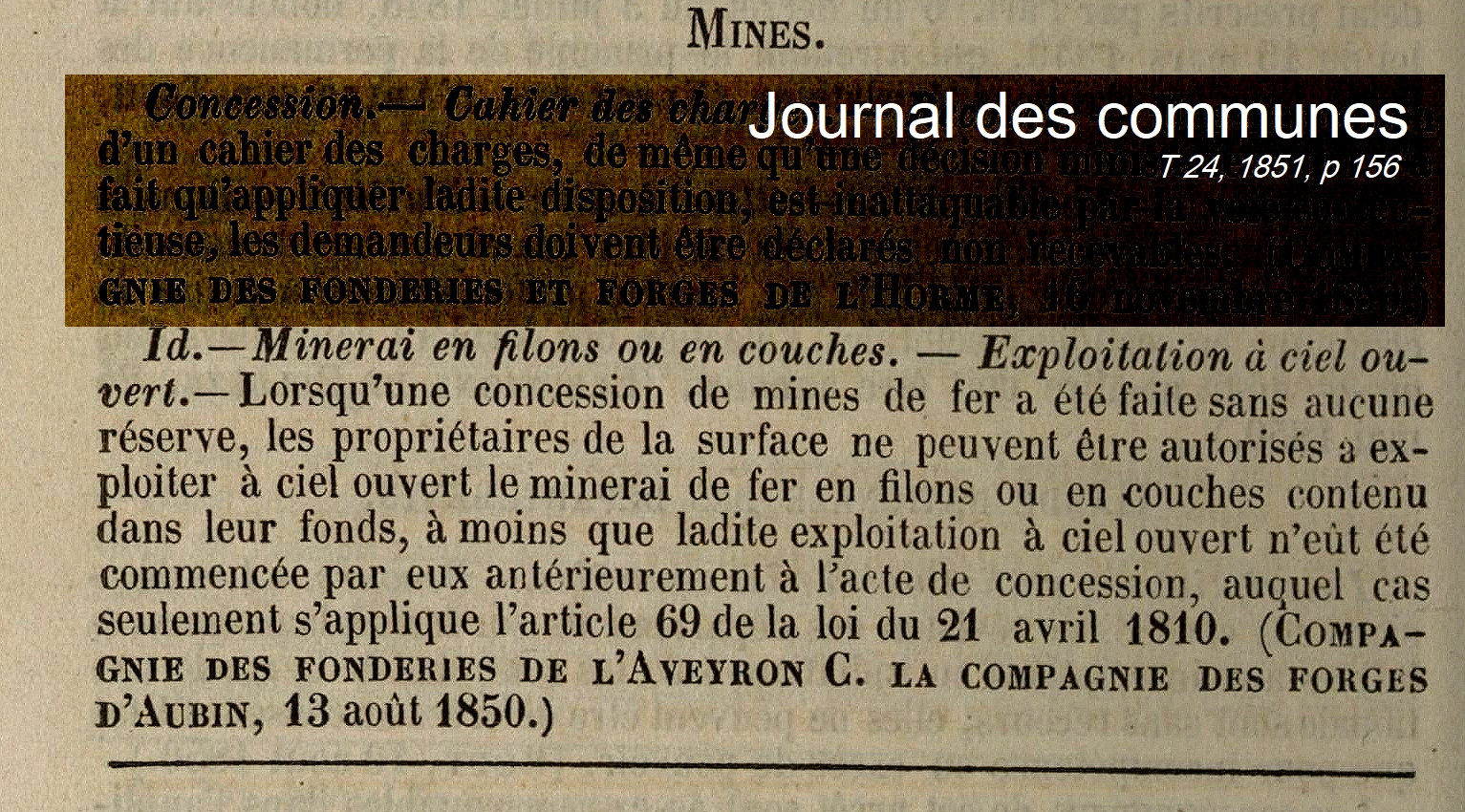
Plans de gares
Gare intermédiaire
Il s’agit bien sûr de la station d’angle de Jogues, la seule intermédiaire du parcours.
Ce plan, non reproduit ici a les dimension suivantes 1,00 m de large et 0,67 m de hauteur. Très difficilement reproductible, il donne néanmoins de très intéressantes indications . Le cachet ci dessous, bien anodin en apparence, qui figure en haut à gauche du plan sera pour nous une véritable clé permettant recherches et recoupements fructueux.
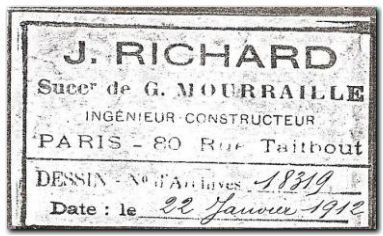
L’indication J. Richard, successeur G. Mourraille, atteste donc que le système était bien d’origine Otto Pohlig ; la date est celle du 22 janvier 1912, le n° d’archives 18319.
Un autre n° est donné, 2753 .
L’échelle est le 1/20. Il ne s’agit pas du plan de la station (hélas ! ), mais de deux détails de construction : prolongement des cornières guides, comme indiqué sur le document. Le détail donc des cornières après débranchement des wagonnets des câbles pour le changement de direction. Il y a deux plans et trois coupes.
Une mention manuscrite en surcharge à la fin de la nomenclature des pièces : bons n° 24 et 25 du 20 mars 1912. On peut donc dater assez précisément la date de construction, ou du moins la date de ce travail de prolongement à Jogues. Au 80 de la rue Taitbout, en 1904 s’établit la société d’Embranchements Industriels . J. Richard était-il lié à cette création ?
Gare de Marcillac
Le plan a les dimensions suivantes : 85 cm de large, 65 de hauteur. Il est référencé n° 03174 et daté Decazeville 20 juillet 1909 ; son échelle : 1/100. Son entête : Houillères de Decazeville, Chemin de fer aérien de Mondalazac, Station de déchargement au plateau de Marcillac. Une autre référence 15232 est donnée.
Il donne une élévation, une vue en plan et deux coupes. Les quatre dessins sont sommairement cotés.
Coupe transversale
▲ clic
Coupe
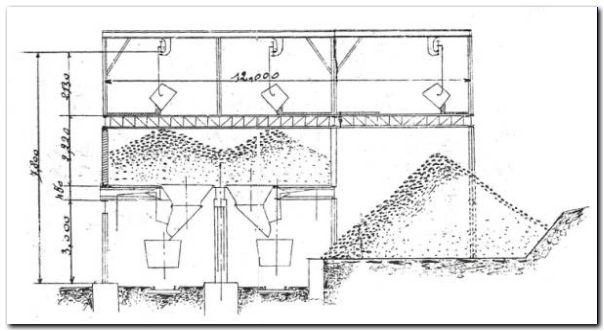
Elévation extrait
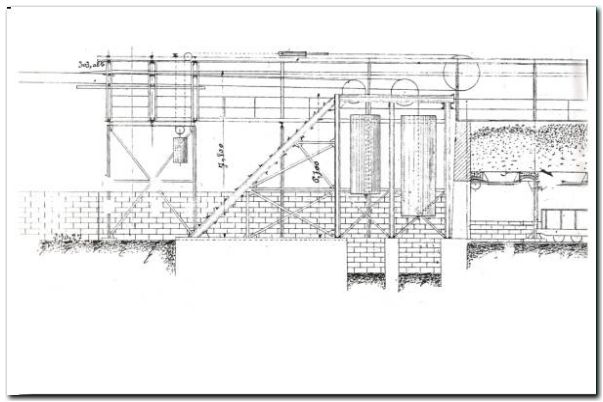
Elévation
Vue en plan ensemble
vue en plan extrait
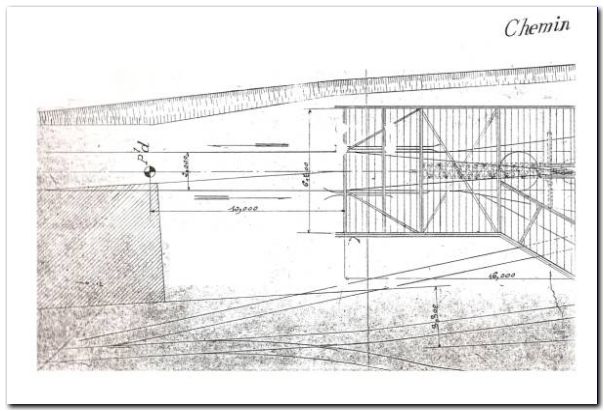
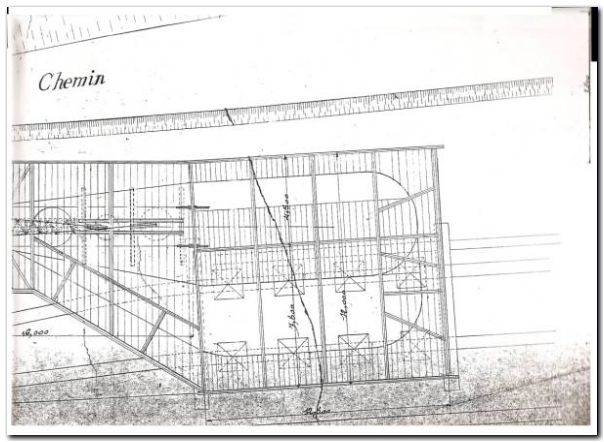
▲
clic
On a mis en regard sur le dessin ci-dessus l’élévation et la coupe pour mieux comprendre le fonctionnement de la gare. On trouvera ainsi en rouge les câbles porteurs, en orange le cheminement du wagonnet après avoir été déconnecté des câbles, en vert le câble tracteur, et en bleu le système tendeur de la poulie du câble tracteur. Un encadré présente le détail du parcours du câble tracteur. Le sens de parcours est également indiqué.
Le câble porteur principal est donc en bas du plan, et est fixé à un gros contrepoids destiné à lui donner la tension nécessaire. Le deuxième contrepoids rouge, plus modeste tend le deuxième câble porteur, supportant donc les wagonnets vides repartant vers jogues et Mondalazac.
Le wagonnet une fois déraillé, est conduit manuellement sur son rail de guidage vers l’un des deux parcours possibles. Par retournement il se déverse au-dessus de l’une des quatre trémies de chaque cheminement.
 Sur
une ancienne carte postale de la gare, plus précisément une phototypie
d’un imprimeur toulousain, et après très grand agrandissement, on peut
voir un mineur avec son outil destiné à accrocher le wagonnet. Trois
personnes sont présentes ainsi que, ne l’oublions pas, le cheval qui
manœuvre les wagons.
Sur
une ancienne carte postale de la gare, plus précisément une phototypie
d’un imprimeur toulousain, et après très grand agrandissement, on peut
voir un mineur avec son outil destiné à accrocher le wagonnet. Trois
personnes sont présentes ainsi que, ne l’oublions pas, le cheval qui
manœuvre les wagons.

Il y avait donc deux câbles porteurs. Le câble tracteur est lui unique dans l’installation, au moins sur ce segment Marcillac Jogues. Son parcours en vert ne mérite pas d’explication particulière, et on suivra son parcours sur l’élévation, la coupe et le schéma explicatif. Le dispositif souligné en bleu est le système de tension de la grande poulie B de deux mètres de diamètre du câble tracteur. Un contrepoids aide à cette mise en tension. On peut déduire de ces plans que le moteur de l’installation, destiné à mettre en mouvement le câble tracteur n’était pas installé à Marcillac. Il pouvait se situer à Jogues, compte tenu de l’importance des ruines présentes. Il pouvait aussi se tenir à Mondalazac, le câble tracteur pouvant parfaitement être continu et non en deux segments. Les deux types d’installations ont existé. La première hypothèse, Jogues, nous apparaît plus plausible. Ce sera d'ailleurs le cas, d'après les témoignages oraux reçus.
Les dimensions de la gare : un carré de 12 m environ de coté, flanqué coté Solsac d’une construction trapézoidale de 16 m de longueur. L’ensemble avait une hauteur uniforme de l’ordre de 8,50 m, le câble porteur étant à 7,80 m de hauteur à l’entrée des installations. Il y avait également trois niveaux dans la partie carrée de la gare : le niveau haut, arrivée des wagonnets et manutention pour déchargement et remise en câble, un niveau intermédiaire où se trouvait le minerai après déversement, et le niveau sol avec les rails de la gare. Les deux voies de 0,66 m qui passent sous le bâtiment et une troisième figurent sur le plan. Mais le plan exact des voies n’est pas donné sur ce plan. La voie que l’on peut apercevoir sur la carte postale, à gauche du cheval, et qui part probablement sur le remblai qui traverse le ruisseau du Cruou n’est pas non plus présente sur ce plan pourtant antérieur de quelques années à la carte postale… Est-ce la voie – évoquée dans le cadre minier historique - qui cheminait ensuite le long de la route vers Mondalazac ? Oui assurément. La photo montre alors une disposition de voies différente du projet qui figure sur le plan. Il est vrai que le chemin aérien rendait caduque cette ancienne voie, qui n’avait donc plus lieu de figurer sur le plan. Elle a pu enfin subsister quelque temps dans l’exploitation de la gare…ou le projet du plan n’a pas été entièrement réalisé comme prévu. Toutes les interprétations sont permises !
Les deux coupes sont assez semblables ; ce sont deux variantes avec une seule différence dans la hauteur du niveau sol, 3m au lieu de 2,80 m. La hauteur totale n’est pas modifiée, le niveau intermédiaire de stockage du minerai déversé passe de 2,42 m à 2,22 m.
▲ clic
La géométrie assez tourmentée de la poulie tendeur des câbles tracteurs peut se justifier par la nécessité de dégager tout l’espace au niveau de la partie déchargement et manutention des wagonnets, ce qui est obtenu en reportant le contre poids de cette poulie et la poulie de 2 m elle-même en avant de l’installation …
Autres remarques sur le plan de gare : rien ne permet de préciser le plan de toiture, par ailleurs assez particulier pour ses fermes. On se reportera à la carte postale, plus explicite sur ce point. Il apparaît enfin que la construction réelle, celle de la carte postale, reprend bien le plan général du projet : quatre travées étroites pour le bâtiment de déchargement des wagonnets, et quatre travées plus importantes pour la partie entrée sortie des installations, coté Solsac, les deux travées de déchargement des voies, et la zone stockage tampon à droite de la gare.
La station intermédiaire de Jogues
C'est le seul document graphique d'ensemble que nous possédons sur cette station qui permettait le changement de direction. Ce document est important, mais difficile à interpréter.
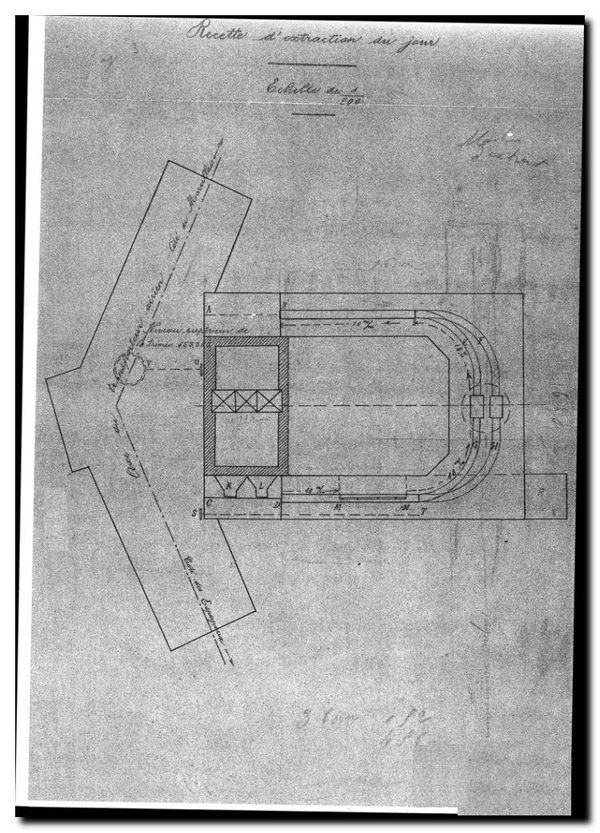 Les axes vers
Marcillac et Les Espeyroux situent les installations. La
construction elle même est donc en deux parties qui
convergent, de 7m par 18m, symétriques. Une poulie de 2 m de
diamètre est figurée coté Marcillac. La construction centrale, de
17m par 24 m, représente un chemin de roulement GE en
pente, un second qui semble être à plat, HF, une trémie et deux
axes: Vu et ST. En redessinant le plan, pour lui donner plus de
contraste et de lisibilité, nous ils sont soulignés en rouge. Le seul
élément dont nous sommes parfaitement assuré est la cote qui figure
pour le haut de trémie : 553,56 m. Elle permet de situer ce
point haut de la ligne, qui faisait 6657,45 m de longueur dans son
intégralité. Le fonctionnement précis de cette station ? Nous
avons des idées bien sûr, mais rien de très assuré....en l'absence
d'autres documents, qui restent eux aussi à découvrir. Parmi les
questions non résolues : rôle exact des axes Vu et ST, signification de
R en bas à droite (rampe ? ), rôle de la trémie, liaison avec les
circulations vers Mondalazac et Mondalazac ? C'est peut-être le dessin
de l'installation particulière de reprise du minerai vers Marcillac,
minerai extrait à proximité de Jogues? Possible, car le plan de mine
montré plus haut, et qui date de 1912, donc parfaitement contemporain
du chemin aérien, fait figurer des couches exploitables de plusieurs
mètres d'épaisseur à Jogues même. Ce minerai pouvait donc être déversé
dans la trémie centrale et repris par des wagonnets en K et L qui
étaient conduits de CD vers AB, puis Marcillac ? Une hypothèse qui
demande donc à être confirmée ; Toute information sera étudiée
avec plaisir....
Les axes vers
Marcillac et Les Espeyroux situent les installations. La
construction elle même est donc en deux parties qui
convergent, de 7m par 18m, symétriques. Une poulie de 2 m de
diamètre est figurée coté Marcillac. La construction centrale, de
17m par 24 m, représente un chemin de roulement GE en
pente, un second qui semble être à plat, HF, une trémie et deux
axes: Vu et ST. En redessinant le plan, pour lui donner plus de
contraste et de lisibilité, nous ils sont soulignés en rouge. Le seul
élément dont nous sommes parfaitement assuré est la cote qui figure
pour le haut de trémie : 553,56 m. Elle permet de situer ce
point haut de la ligne, qui faisait 6657,45 m de longueur dans son
intégralité. Le fonctionnement précis de cette station ? Nous
avons des idées bien sûr, mais rien de très assuré....en l'absence
d'autres documents, qui restent eux aussi à découvrir. Parmi les
questions non résolues : rôle exact des axes Vu et ST, signification de
R en bas à droite (rampe ? ), rôle de la trémie, liaison avec les
circulations vers Mondalazac et Mondalazac ? C'est peut-être le dessin
de l'installation particulière de reprise du minerai vers Marcillac,
minerai extrait à proximité de Jogues? Possible, car le plan de mine
montré plus haut, et qui date de 1912, donc parfaitement contemporain
du chemin aérien, fait figurer des couches exploitables de plusieurs
mètres d'épaisseur à Jogues même. Ce minerai pouvait donc être déversé
dans la trémie centrale et repris par des wagonnets en K et L qui
étaient conduits de CD vers AB, puis Marcillac ? Une hypothèse qui
demande donc à être confirmée ; Toute information sera étudiée
avec plaisir....En tout état de cause, cette station est plus complexe dans ses installations que celle illustrée plus haut de l'ouvrage de Levy- Lambert.
Lors d'une récente rencontre avec Bernard Olivié, nous avons abordé une explication de texte approfondie sur ce plan de Jogues, cote archives 48118M209. Un texte retrouvé dans les archives de l'Aspibd permet de formuler quelques éléments de réponse aux interrogations que nous avions sur la station. Il semble que ce plan soit en fait un élément d'un (autre ? ) projet : une construction annexe à la station elle même. C'est l'ensemble qui figure donc à droite de la station proprement dite. Un puits, très profond, c'est le cercle de 3,80 m environ de diamètre est un puits d'extraction, tout à droite du schéma. Les bennes montantes et descendantes figurent sur ce plan. Le reste serait le figuré de la circulation de ces bennes pour une reprise des matériaux extraits et leur transport via la ligne aérienne bien sûr vers Marcillac. La description de ce projet est donnée plus bas.
Station intermédiaire, extrait du plan 1/200
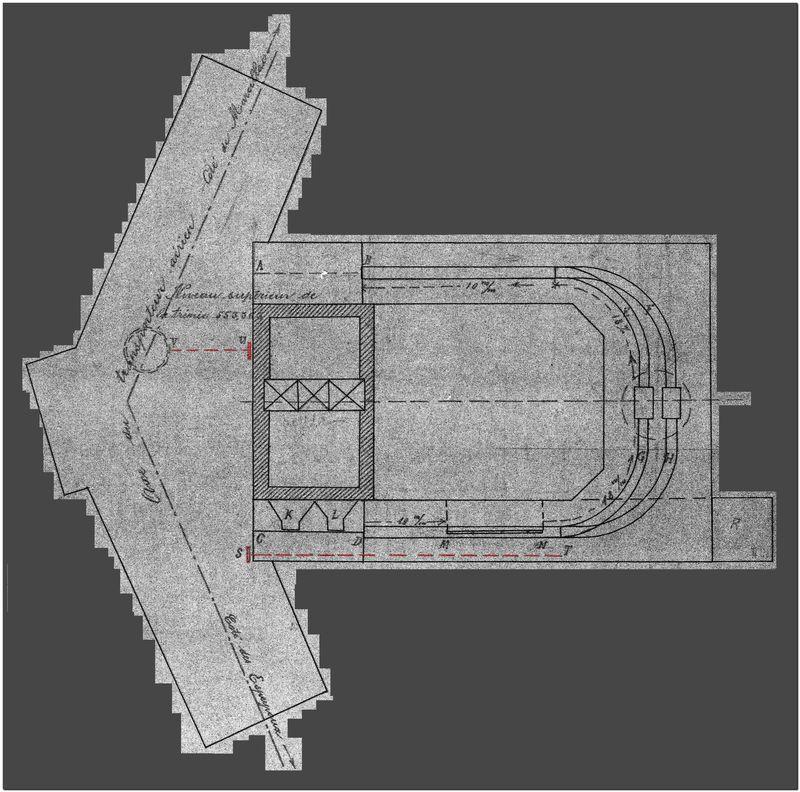
Le puits de 70 mètres
Un puits d' extraction de minerai est donc prévu : 3,50 m de diamètre, et une profondeur de 70 m. Ce n'est pas rien ! Le projet de M. Deschanel règle les détails des chevalements, des cages, du pont culbuteur et de la circulation des bennes d'extraction. Celles ci seront du type Joudreville, type pour nous totalement inconnu ! (appel à informations.....). Joudreville, loin d'ici, dans le département de Meurthe-et Moselle possède des mines de fer. La Société Civile des Mines de Joudreville, a été constituée en 1900 par les deux sociétés de Commentry, Fourchambault et Decazeville d'une part et des Hauts Fourneaux de la Chiers d'autre part. Les gens de Decazeville avaient donc de bonnes raisons de choisir ce type de bennes, connu d'eux. Les bennes prévues ici seront à un écartement plus réduit, sans plus de précisions, que celles de Joudreville. Le rapport détaille le fonctionnement des installations. Nous allons donc reprendre la description du projet, avec quelques certitudes de plus, et de nouvelles interrogations...
Les bennes pleines sortent du puits, et par les voies ferrées E et F, en pente, rejoignent le tronçon AB, pour mise en place dans le culbuteur rotatif. Trois bennes pleines, de 950 litres de capacité chacune, peuvent trouver place dans le culbuteur . Celui-ci peut alors se translater vers le bas du plan, en CD. Le rail AC est horizontal, mais une pente est prévue sur l'autre rail, de B vers D. La mise en place du minerai de la benne dans le wagonnet aérien se fait par la rotation du culbuteur, au centre de la trémie. Pour cela, le rail de guidage des wagonnets aériens, qui ne figure pas sur ce plan, passe donc sous la trémie, puis se poursuit vers le câble de Marcillac. Arrivées ensuite en CD, les bennes vides quittent automatiquement le culbuteur - le point D est plus bas que le point C - et suivent la pente des rails vers le tronçon MN. En M, une chaîne releveuse accroche la benne et la remonte en N, point haut de l'installation. La pente du rail ramènera la benne vide vers le puits, par les rails G et H .
La hauteur totale du bâtiment est de l'ordre de 17 mètres, à l'axe des deux molettes, et le puits de 70 mètres est à environ 16 mètres des installations aériennes. Le mouvement de translation du culbuteur et sa mise en rotation seront commandés par une prise de mouvement VV, réalisée sur le câble tracteur vers Marcillac. Le mouvement est ensuite transmis à l'axe ST qui commande le culbuteur. Si cette prise de mouvement s'avère trop hasardeuse, le projet prévoit une solution de remplacement par moteurs électriques. Les deux trémies K et L qui figurent sur le plan servent à déverser le minerai non pas dans les wagonnets aériens, mais à réaliser une mise en stock au niveau du sol. Le minerai est déversé par K et L dans deux chars de terrassements qui viennent alors à droite déverser leur contenu sur le sol en R. La passerelle de circulation de ces chars est établie deux mètres en dessous de la passerelle de circulation des vides CD. Cette mise en stock est reprise suivant les nécessités comme le sont les stocks de castine, également exploitée ici. Une modification des rails aériens pour raccorder l'ensemble stock castine à la boucle sous la trémie est prévue.
La recette d'extraction, c'est à dire les dispositions de sortie des bennes pleines, est celle figurée sur le plan. Elle est à environ 7 mètres de hauteur. Une deuxième recette est prévue au niveau du sol. Elle servira à manoeuvrer les bennes descendantes de bois et matériaux divers, ainsi que les bennes montantes pleines de terres. Il est enfin précisé que les cages dans lesquelles se trouveront les bennes Joudreville sont à un seul étage, et ne comprennent qu'une benne par cage. Ces cages sont guidées dans leurs mouvements par deux câbles guides. Pour ces câbles, on prévoit d'utiliser des vieux câbles porteurs du chemin aérien de 36 mm de diamètre. A la lecture de ce rapport de travaux, on apprend incidemment que le fonçage du puits de 70 mètres prendra 5 à 6 mois.
Question essentielle : ce puits a-t-il existé et le projet mené à bien, suite à la demande de devis aux Ateliers ? Nous n'en avons pas la certitude, et notre opinion est d'ailleurs qu'aucune suite ne fut faite au travail de M. Deschanel.
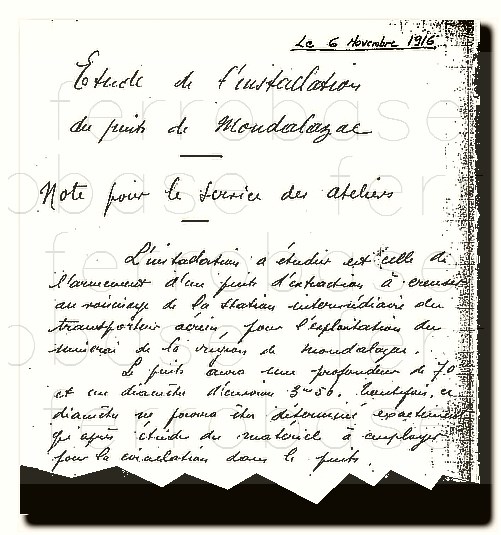
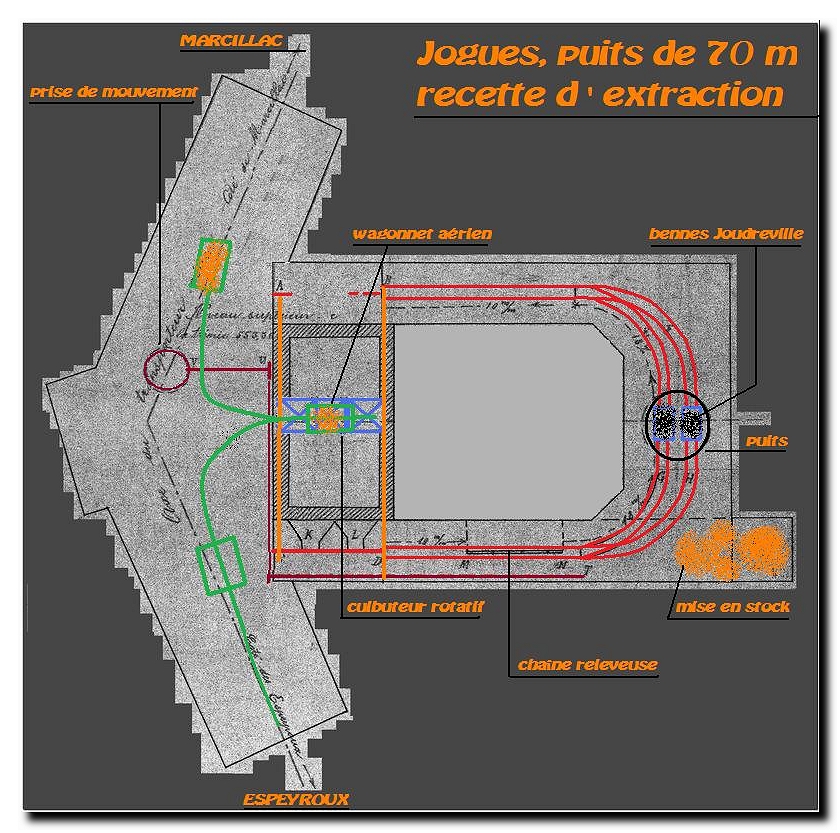
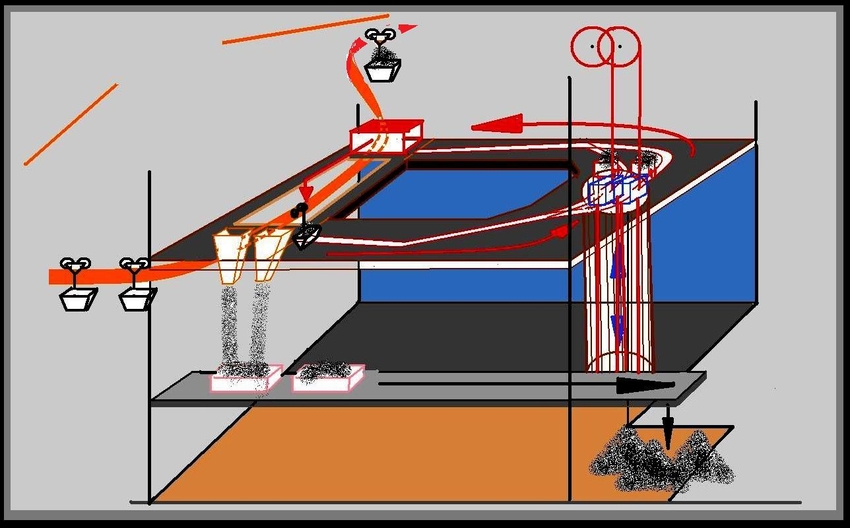
Et avant de poursuivre, pourquoi une station d'angle à
Jogues ?
Et oui! C'est
bien la première question qui se pose. N'était-il pas plus simple de
joindre directement le site de la mine sur le causse au dépôt de
Marcillac dans la vallée ? Pourquoi faire plus compliqué ?
Cette question
plus que pertinente trouve en fait sa réponse dans trois éléments de
réponse. Sur la carte ci dessous, dite état major 1889, nous avons
porté le tracé direct et le tracé retenu.
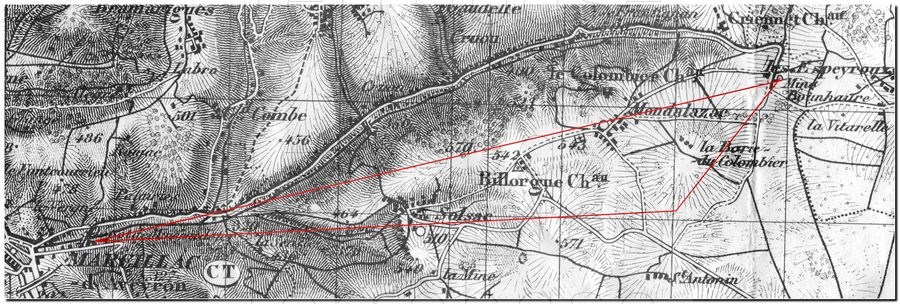
Premier élément de réponse : le tracé direct passe à
très peu de distance, pour ne pas dire plus, du village de Mondalazac.
Difficile pour la compagnie de Decazeville de faire admettre aux
habitants le passage continuel des wagonnets au dessus de leur tête ;
inutile de développer...
Deuxième élément de réponse : la carte des gisements connus, voir plus
haut, montre près du lieu de Jogues des possibilité importantes
d'exploitation. Le sondage n°4 réalisé près de Jogues précise un
site exploitable, avec une puissance (épaisseur en termes de géologue),
de l'ordre de 2,90 m. C'est d'ailleurs la puissance la plus
considérable notée sur ce plan de 1912. Le sondage est à 200 m
exactement du point de changement de direction du chemin aérien, et
vers Ferrals. Dans les environs proches vers le nord, vers
Mondalazac et la Borie du Colombié, orthographe d'époque, deux autres
sondages et un puits font également mention de possibilités
d'exploitation, avec des puissances analogues. Le potentiel est donc
important à cet endroit, et il est peut être plus économique de prévoir
une station intermédiaire, celle de Jogues donc, pour reprendre le
minerai vers Marcillac. Une autre bonne raison de faire cette station,
est de reprendre à cet endroit du calcaire (castine) . En effet,
une carrière de castine existait à Frontignan, dans la vallée du Cruou,
et la réalisation du chemin aérien mettait fin à cette carrière. La
castine est un des éléments du process industriel du haut
fourneau pour constituer le laitier qui rassemblera les impuretés
provenant des matières premières, et faciliter la fusion du minerai
et la fluidité du métal en fusion. Elle joue un rôle de fondant.
Ce deuxième groupe d'éléments plaide donc pour la station de Jogues,
puisque castine il y a ici.
Une troisième bonne
raison de réaliser cette station réside à notre sens dans la
technologie prévue. La topographie des lieux amène à descendre
fortement vers Marcillac. Il est donc tentant pour le projeteur de
retenir une technologie automotrice : les wagonnets chargés vont
entraîner le câble auxquels ils sont liés par le simple effet de la
gravité. Le dit câble tracteur pourra donc à son tour reprendre les
wagonnets vides pour les remonter sur le plateau. Et oui, cette
technologie existait ailleurs avec succès. Alors pourquoi pas ici ?
Seulement, pour pouvoir être envisagée, il fallait bien sûr que la
descente soit proche, pour ne pas dire très proche, de la gare de
départ. Le trajet direct ne permettait pas facilement cette solution :
le parcours sur le plateau, horizontal ou presque, aurait été trop
long. La solution par Jogues présente une descente dès le départ,
relativement courte, mais réelle, suivie de la montée vers le point
haut de Solsac, seul élément négatif, mais suivie ensuite par la très
longue et impressionnante descente vers la gare de Marcillac. Au prix
de quelques efforts de démarrage (dont nous n'avons pas beaucoup
d'éléments d'explications...), la solution automotrice est bien
envisageable, et c'est d'ailleurs celle qui fut retenue : efficace et
économique. Pour se rendre compte du réel bénéfice de la solution, on
peut faire un rapide calcul. Pour une pente de 30°, l'effort
d'entraînement sur le câble sera très exactement égal à la moitié du
poids du wagonnet. Une simple question de sinus pour les matheux ! Et
les centaines de kilos d'effort, pour parler simplement, seront
rapidement atteints et dépassés, un wagonnet chargé représentant à lui
seul une charge de quelques centaines de kilos. Le reste, c'est
un problème d'huile, de graisse, de météo et autres facteurs ! Vous
êtes encore sceptiques ? Essayez donc de retenir une brouette
fortement chargée en descente...
Le développement est un peu long, mais l'ensemble des ces éléments nous
amène à penser que la solution de la station d'angle était vraiment une
solution économiquement souhaitable. Enfin, le problème du déraillement
du wagonnet de son câble porteur pour effectuer le changement de
direction est relativement très simple à réaliser ; on trouvera
les détails de la technologie par ailleurs dans ces pages.
Les wagonnets
Wagonnet
1
Plan fait à Decazeville, le 26 juin 1915, plan constructeur 17834, plan n° 1338
Format 0,61 x 0,70 m, échelle 1/5
Ce plan présente deux dessins, élévation et coupe, et une nomenclature.
C’est le wagonnet habituel du système Otto Bleichert. Le système de prise de mouvement est une griffe de blocage à contrepoids. La hauteur totale du système sous le câble tracteur est de 1, 757 m. Les dimensions du wagonnet : 85 cm de largeur (élévation) sur 75 cm (profil ) et 54 cm de profondeur ; les roues de roulement ont 34 cm de diamètre total et 29,5 cm sur la gorge de roulement ; elles sont espacées de 43,5 cm. Sur le plan, existe la surcharge manuscrite « transport aérien de Mondalazac à Marcillac, mines de Mondalazac ». Le plan est signé de Vidilly.
Ci-dessous et dans l’ordre, vue de profil et élévation.
▲
clic
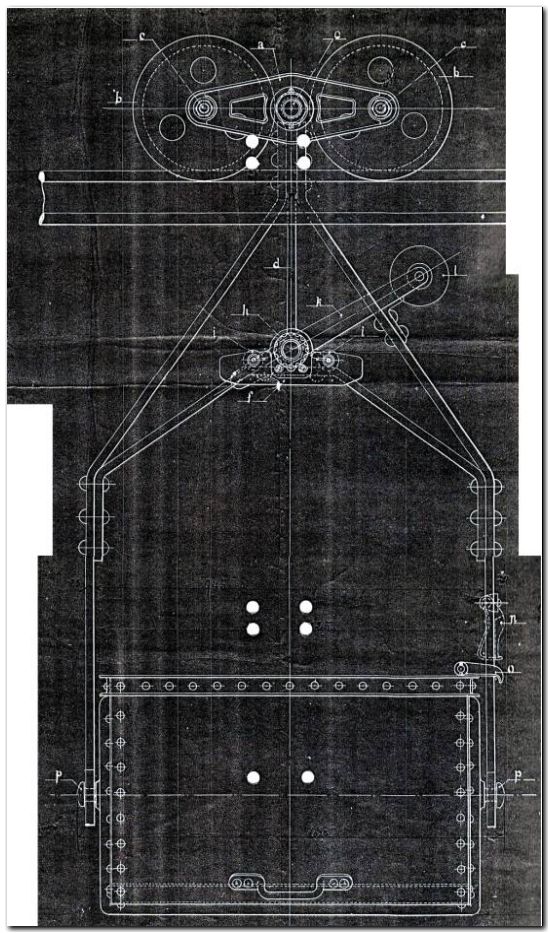
wagonnet
2
Autre plan de wagonnet, antérieur au wagonnet 1, dimensions 59,5 cm de large, 53 cm de haut
Plan aquarellé, daté Decazeville 11 Août 1908, échelle 1/50
En surcharge classement 94-1
Ce wagonnet diffère du précédent ; la hauteur totale est de 1,55 m, prise sous le câble porteur, le wagonnet fait 800 mm (de face) x 600 mm (coupe) et 400 mm de hauteur. La poignée de manutention est différente, tout comme la griffe de blocage sur le câble tracteur, plus rudimentaire.
L’en tête du plan : prolongement du chemin de fer à voie étroite de Firmy à Marcillac, projet de chemin aérien entre Marcillac et Mondalazac, suspension et benne pour le transport des minerais, année 1908-1909.
Ci-dessous et dans l’ordre Vue de face et coupe suivant AB (AB est l’axe de la vue de face).
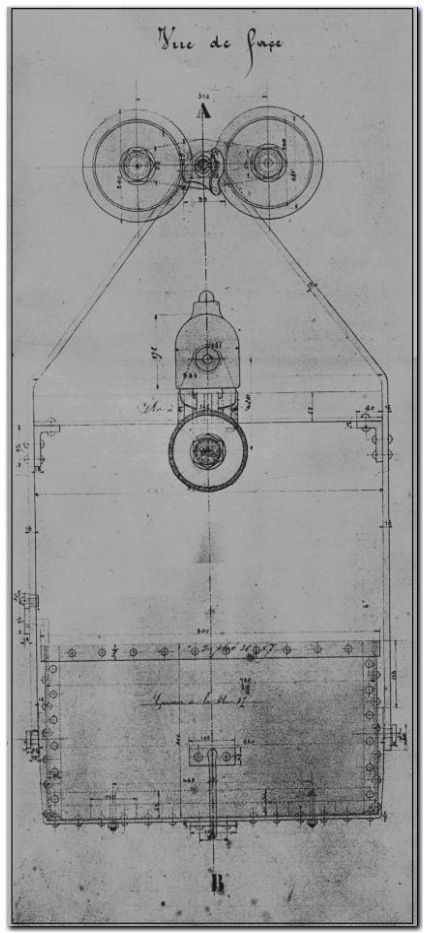
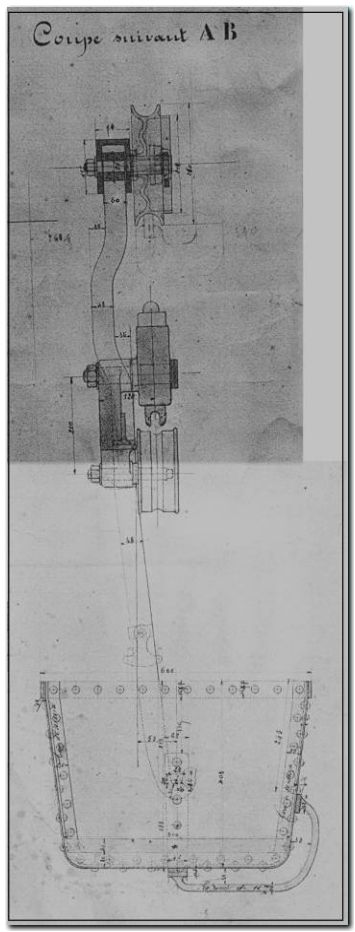
Et le départ de la
mine ?
Le départ des wagonnets se situe sur le plateau, près de Mondalazac, près du lieu dit les Ferrals. Le tracé cadastral fait apparaître l’assiette foncière du chemin aérien jusqu’à proximité du hameau.
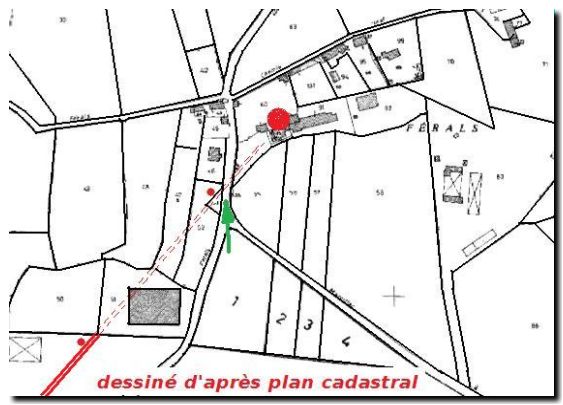
La
partie inférieure, surlignée par nous en rouge existe bien sur le
cadastre. Nous avons prolongé en pointillés rouges ce tracé jusqu’à la
jonction avec une autre parcelle, triangulaire, dont le parfait
alignement avec le chemin aérien ne doit sûrement rien au hasard. Le
gros site rouge correspond au départ indiqué sur la carte des gisements
présentée par ailleurs.
Le
site des modélistes de Lanuejouls,
http://www.cfpa.asso.fr/Menu_LIENS_CLUB.html, présente une ancienne
carte postale, pas très courante et très intéressante :
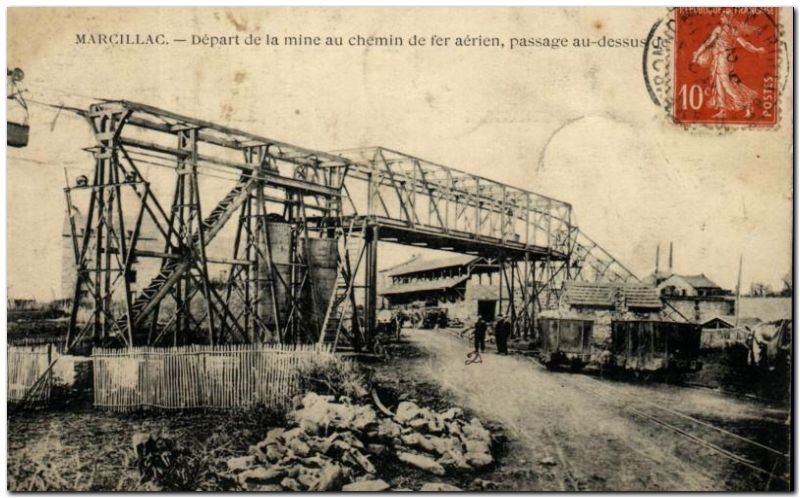
Bien qu’intitulée Marcillac, il s’agit de la station des Ferrals. En effet, il n’y avait que trois installations : la gare de Marcillac, que nous connaissons maintenant parfaitement et ce n’est pas elle, la station intermédiaire de Jogues, ce n’est manifestement pas elle, et Les Ferrals. La partie gauche des installations était établie sur la parcelle triangulaire évoquée plus haut.
On
note la présence du compagnon inséparable du mineur à cette époque, le
cheval, tout à droite. Il a peut-être connu la descente, et la
montée ( ! ) par la vallée du Cruou lorsque le chemin aérien
n’existait pas. Il doit assurer maintenant les mouvements de wagons
dans les emprises de la mine. Quant à Monsieur D, à gauche et au
centre, il s’agit peut-être du Directeur ? Pas impossible, pour
une photo posée, les trois personnes fixant l’opérateur.
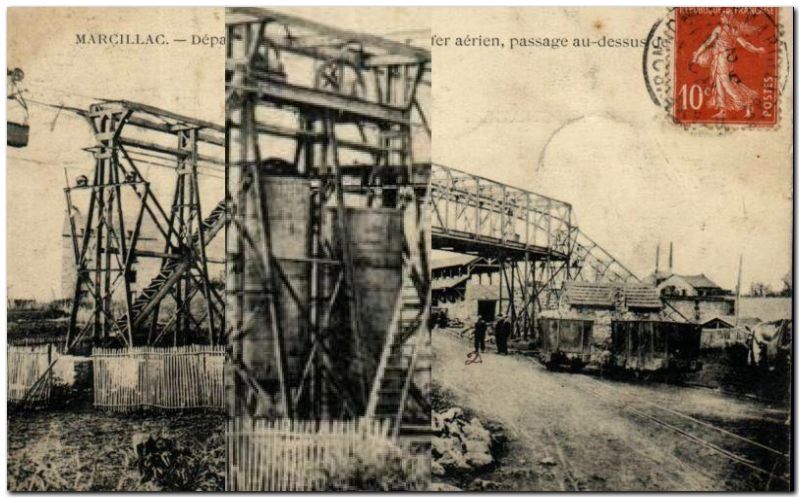
Sur le plan technique, on remarque tout en haut à gauche un wagonnet : vide, il va entrer dans l’installation. Vide, car d’une part il n’y a aucune flèche du câble porteur, et le sens de circulation que nous avons indiqué auparavant est bien confirmé. Une autre confirmation provient de l’examen des « bidons », appelons les lests comme cela, qui constituent les systèmes de tension des deux câbles. Le câble du wagonnet en question vient s’enrouler sur la première poulie, celle qui est tendue par le poids le plus faible. Le lest en arrière est de diamètre plus important et correspond à une poulie qui n’est d’ailleurs pas dans la même direction, et correspond au câble porteur arrière, celui des wagonnets chargés. Tout cela est bien en accord avec le parti technique que nous avons détaillé à Marcillac.
Deux wagons sont présents : la voie ou plutôt les deux
voies, desservent en bas à droite les
sites d’extraction. Ces voies étaient présentes sur la carte.
Au-dessus des trois
personnes présentes, dont monsieur D, un wagonnet chargé
va bientôt prendre le câble porteur arrière. Les rails de
roulement vers le dépôt de minerai à
droite sont très inclinés et soutenus par des chevalements aussi
rustiques qu’efficaces. Cinq sont au moins présents sur le cliché.
L’intitulé de la carte souligne un passage au-dessus de… ? Probablement la route, et comme il n’y a qu’une route à traverser, nous avons indiqué par une flèche verte sur le plan cadastral la position du photographe et le sens de prise de vue. L’angle de la photo correspond parfaitement avec cette position. Il existe sûrement d’autres clichés de ce départ de wagonnets….encore à découvrir.
Grâce à Francis Mazars (Musée de la Mine, Aubin) nous pouvons présenter d'autres images de Ferals : la station de chargement, vue datée du 20 février 1917. Un agrandissement montre trois wagons, qui ne circuleront que sur le plateau de la mine. En effet en 1917 la voie du Cruou a très probablement disparu. La porte arrière des deux wagons extrêmes est relevée. Il n'y a pas de bennes aériennes présentes, et la propreté des lieux doit être remarquée. La comparaison avec la carte postale ci-dessus est sans appel ! Est-ce du au caractère officiel et institutionnel de la photo ? Rangement et nettoyage sont de rigueur !
Une comparaison attentive des photographies de l'installation montre enfin que la carte postale ci-dessus est sans doute postérieure, donc entre 1917 et 1920, fin des activités aériennes.
Photographies D.R., coll. F. Mazars, Musée de la mine, Aubin
Datée également de 1917 et du même jour, la deuxième photographie montre un bâtiment important, qui cumule deux fonctions : central électrique (la mention danger de mort sur la porte de droite est explicite), et treuil : à l'étage de ce bâtiment un treuil est présent. Sa fonction semble évidente. Mais nous comprenons mal où pouvait bien passer le câble : verticalement dans le bâtiment puis dévié à l'extérieur ? La fenêtre de l'étage ne semble en effet pas être conçue pour un usage quelconque de treuil...Seules certitudes : le treuil est bien présent, et le catalogue des archives de la compagnie légende cette photo sous le nom de treuil...Un détail : la fixation très soignée en façade des lignes aériennes nombreuses qui convergent ici.
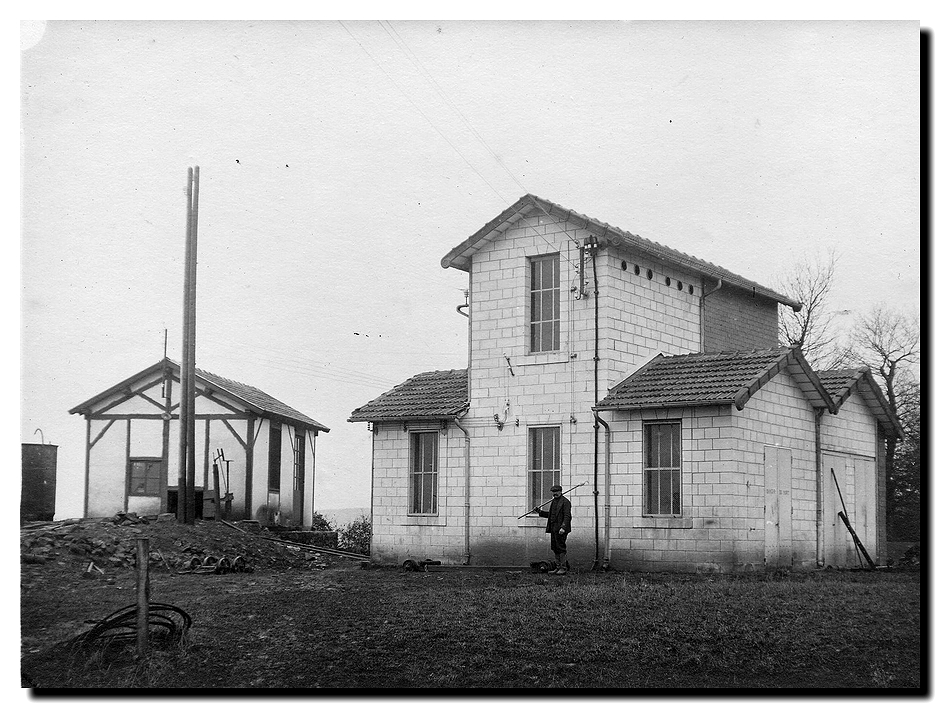
La dernière image, plus récente, de cette série montre une arrivée du car (de la compagnie ? ) à la colonie, un 23 juillet. Le photographe aurait presque pu immortaliser le câble aérien dans son image : les arbres derrière le véhicule nous le cachent.

Le chargement des wagonnets aériens pouvait s'effectuer par gravité: le minerai, déversé au dessus, remplit au dessous les wagonnets qui sont présentés. Le schéma suivant (Etude sur le transport des minerais par câbles aériens) montre l'essentiel du dispositif. Dans le diaporama consacré aux images américaines, figurent également des vues de station de chargement.
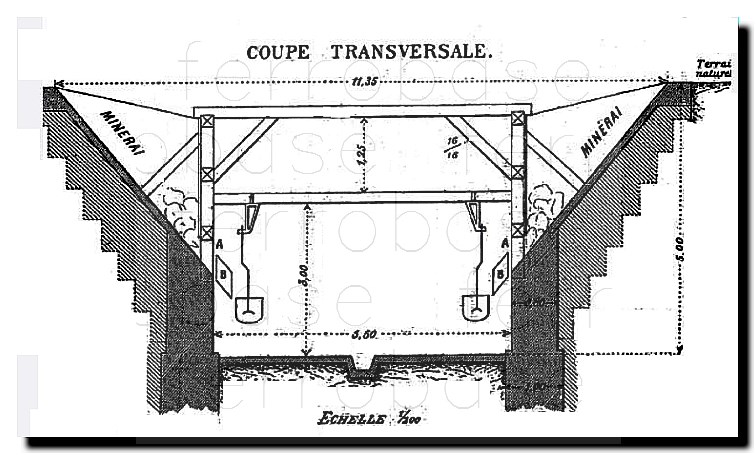
Mentionnons enfin, pour tous ceux qui découvrent ces parcours, la présence, à proximité, de bâtiments qui portent le nom quelque peu incongru en ce lieu pour notre époque de casernes : là étaient logés les mineurs, dont l’histoire est retracée dans quelques pages du volume Marcillac de la collection Al Canton. Les habitats sont très structurés et la ligne aérienne des wagonnets très proche.
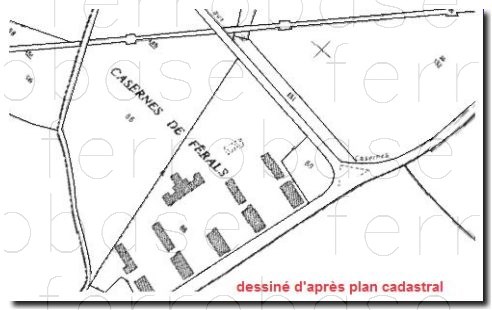
Bien après la fin des exploitations, certains de ces bâtiments ont connu des activités plus ludiques, une colonie de vacances ayant occupé les lieux. Il en reste une image à la mise en scène très appuyée ! Apparemment, des filles, pour la colonie des Fauvettes. Mais les garçons y eurent leur place !
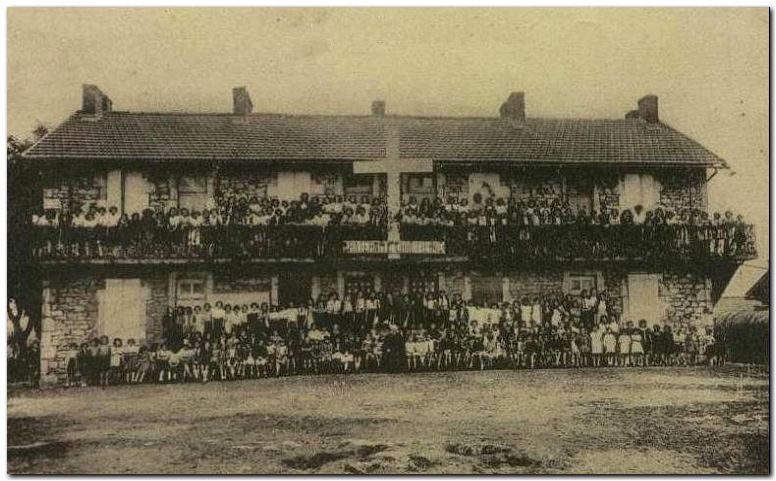
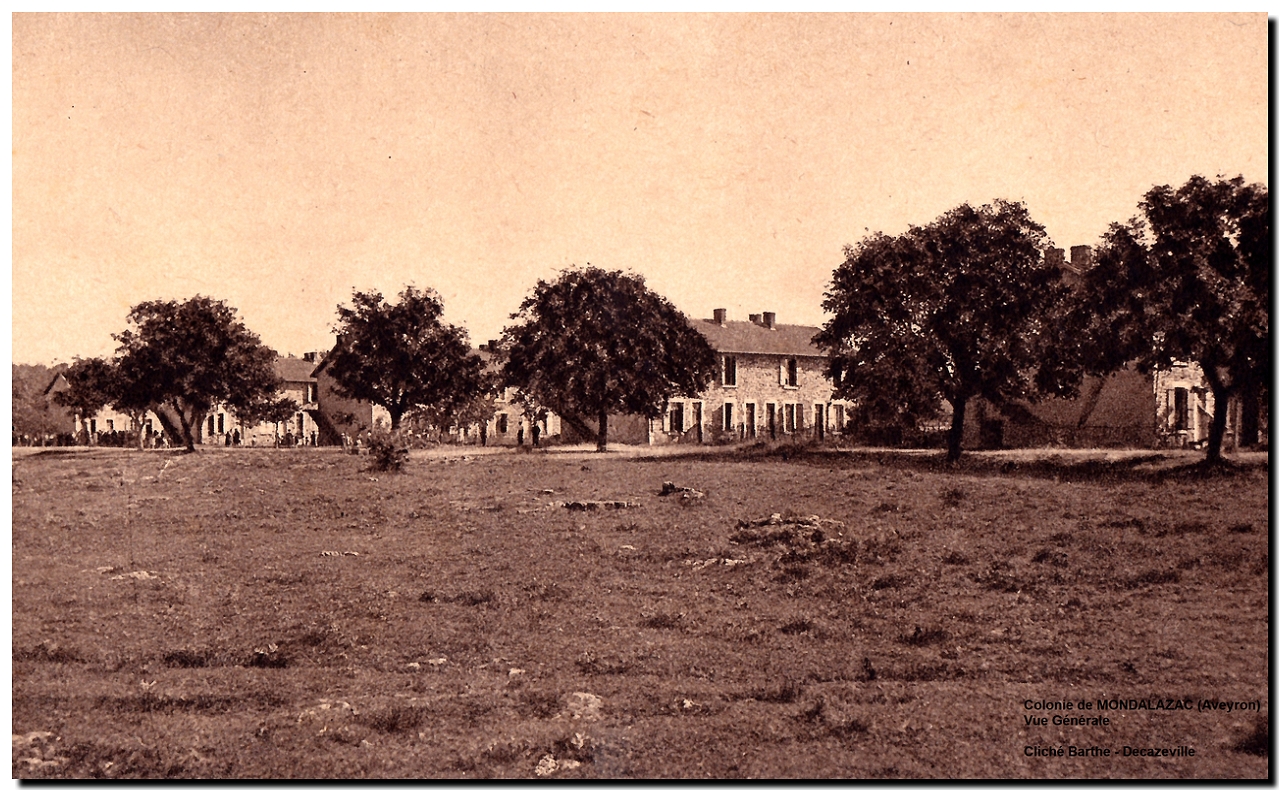

Le colon a envoyé la carte ci-dessus en 1942 (cliché Barthe). La monumentale croix est présente en façade.
Regardez bien ! Il y a beaucoup de monde au devant des bâtiments. La vue est prise de l'intérieur.
clic▼

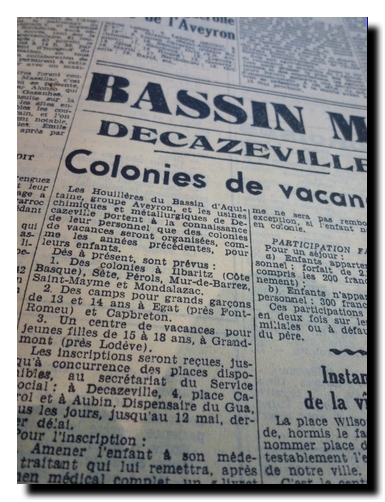
Midi Libre, 2 mai 1950

Nous essayons de retrouver une époque ; voici un témoignage : une journée à cette colonie des Fauvettes...
(source
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/citoyen/05-06/aveyron/aveyron-1905.html)
Il s'agit d'un
tout autre sujet : la Loi de 1905 en Aveyron, sur la séparation église
état, dossier réalisé par le Service éducatif des Archives
Départementales de l'Aveyron, professeur : Sylvie PASCAL.
8h : méditation, messe, actions de grâces
8h30 : toilette
8h45 : petit déjeuner
9h30 : correspondance et jeux de cour
10h : départ vers les chênes
10h30 : répétitions de chants
10h45 : gymnastique
11h15 : jeux libres
12h : dîner
13h : sieste
14h15 : chapelet et lecture spirituelle
14h45 : confection d'ouvrages en laine pour l'exposition
15h30 : goûter
16h : grand jeu dans la forêt
18h15 : retour dans la colonie
18h30 : souper
19h15 : jeux
19h50 : examen de conscience et prière du soir
20h15 : coucher
Au delà de l'anecdote, nous retenons l' importance de la forêt pour le grand jeu...Les images d'époque, que vous pourrez trouver dans le lien à la une, page des menus, illustrent ce qu'était ce lieu des casernes. Que reste-t-il aujourd' hui des arbres et de la forêt ?
La fin, administrative, de l'histoire des wagonnets, mines et lignes sera effective en 1931, par la demande officielle de renonciation aux concessions. C 'est la forme légale qui consacre, peut-on dire, la toute fin d'exploitation. (coll. J. Ulla)
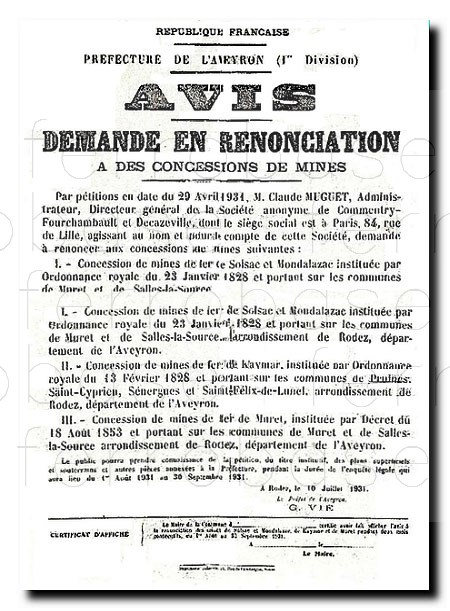
Archives, vieux papiers…
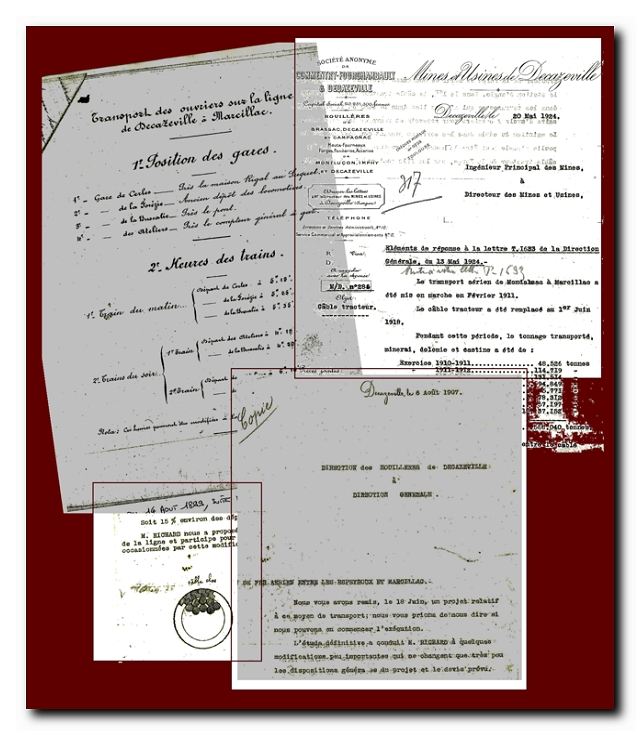
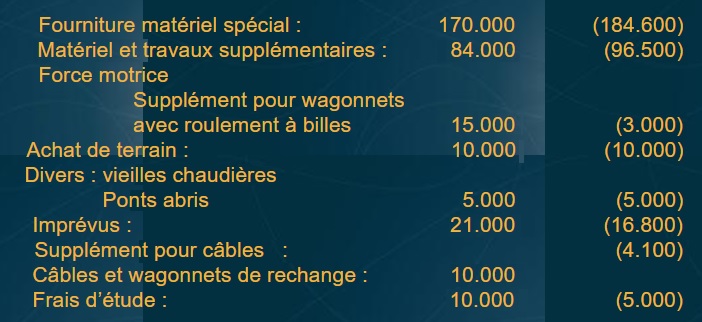
On note que les modifications portent sur l’adoption de câbles porteurs clos et non à surface lisse, sur des wagonnets à roulement à billes et l’ établissement, initialement non prévu, de rails au sol aux Espeyroux. Apparaît également l’installation non prévue de force motrice « pour le cas où l’on veut vider la ligne ». Le projet mentionne le prix des deux ponts abris, au passage des chemins, 1.200 francs au plus.
Monsieur Richard, l’ingénieur-constructeur, participe pour moitié ( ! ) aux frais des nouveaux câbles clos et abandonne sa commission de 2,50 f/kilog. pour frais d’étude…
Un autre document, du 21 octobre 1910, fournit des précisions sur le poids des matériaux métalliques utilisés. C’est ainsi que la station de chargement des Espeyroux apparaît pour 64 174 kg, celle de Jogues, intermédiaire, pour 35 205 kg, et la station terminale de Marcillac pour 90 059 kg ; les systèmes de tension, « 1 et 2 » précise le document, 12 870 kg, et les 58 pylônes de la ligne, 115 020 kg.
Compte tenu des 9 020 kg des 10 cylindres contrepoids, le total ressort à 326 348 kg.
Le seul pylône 39 bis pèse 15 235 kg…
Le total à cette époque, proche de la mise en service, est donc de 474 493,94 francs. Prudent, le rédacteur précise « les dépenses se monteront vraisemblablement à 500000 francs au moins ».
Ce chiffre est donc, à peu de choses près, le prix de revient de l’installation à sa mise en service, qui interviendra en février 1911.
Le câble tracteur de Mondalazac – il était donc unique – mis en service en février 1911 a été remplacé le 1 er juin 1918. La lettre de l’ingénieur principal des mines de Decazeville à son directeur donne un tableau des tonnages transportés à Mondalazac, « minerai de fer, dolomie et castine » durant cette période :
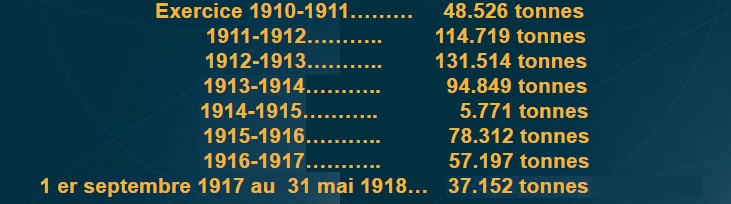
On constate que le conflit de 1914 a provoqué un quasi arrêt de l’exploitation, près de 95 % de diminution ( ! ), et que la reprise, très marquée les années suivantes, n’a pas permis de retrouver les chiffres de 1911 à 1914. L’effet de la mise en service du chemin aérien est très net, un doublement de production entre les exercices de 1910 et 1912. De plus, dans le chiffre de 1910, 48.526 tonnes, il faut garder en tête que 5 mois concernent l’avant aérien, et sept mois l’après aérien. Il y a donc nettement plus qu’un doublement de capacité dû à l’installation. Le choix du système était donc parfaitement réaliste.
un calcul, pour voir...
Sur la base, notre hypothèse, de 300 jours de travail effectif par an, les sept ans 9 mois représentent 2330 jours de fonctionnement du câble. C’est donc 244 tonnes par jour, chiffre moyen, de matériaux qui furent transportés. Si chaque benne de l’aérien transportait 500 kg, 488 wagonnets sont donc passés chaque jour à la gare de Marcillac. Ce chiffre doit donner une idée valable de l’activité, très soutenue, car c’est pratiquement 50 wagonnets par heure, six jours sur sept, et 300 jours par an, pendant plus de sept ans…wagonnets vidés à Marcillac, et bien évidemment remplis sur le causse. En faisant la part des interruptions pour causes diverses, intempéries, arrêt de charge à la mine et autres, l’installation de Richard s’avère donc être de bonne conception.
Avec les bases de calculs précédentes, par jour, ce furent 323 wagonnets reçus chaque jour ouvré à Marcillac (1 er septembre 1910 au 1er septembre 1911 ), 764 l’exercice suivant, puis 877, 632, 38, 522 et 381 pour l’exercice 1916-1917. Au plus fort de l’activité, un wagonnet toutes les quarante secondes est à recevoir, pousser, basculer, pousser et remettre sur son câble…Nous n’avons pas calculé les kilomètres parcourus par le mineur de service ( ! ) : il fait deux fois la longueur de la gare pour chaque wagonnet…C’est aussi quarante secondes pour recevoir le wagonnet aux Espeyroux, le charger de 500 kg de matériaux, et le remettre sur le câble…La logistique devait être parfaitement rodée. Les ingénieurs de Decazeville devaient être satisfaits, tout en gardant en tête que le rendement espéré était dit le Journal de l'Aveyron de 500 tonnes journalières, soit finalement le double de ce qui fut réalisé : un chiffre iréaliste ?
Il est important de préciser enfin que l’origine de ce courrier tient à la rupture du câble tracteur de l’installation de Decazeville, rupture survenue quelques mois seulement après son remplacement. A Mondalazac, le câble tracteur tirait 568.040 tonnes avant de casser, celui de Decazeville 40.000 à 80.000 tonnes seulement...
A la suite de cette rupture, à Decazeville, le 12 juin 1924, la Direction Générale proposait une modification des serrures de passage du câble tracteur à la poulie de la station d’angle de la Forge. C’est en effet lors de ce passage que devaient se produire des ruptures de fils. On apprend ainsi que cette station d’angle était très différente de celle de Mondalazac. Sur le causse les wagonnets étaient poussés à la main lors du passage alors qu’à la Forge ce passage ne nécessitait aucune présence. Dans sa réponse, la direction de Decazeville propose le 18 juillet 1924 une analyse différente du problème. Elle souligne en particulier que les bennes chargées de Mondalazac descendaient. Celles de la Forge, beaucoup plus chargées, 1200 kg par exemple de scories d’aciérie, montent au terril. Le câble est donc plus fortement sollicité. La prise de câble par les bennes est également plus brutale qu’à Mondalazac, à cause de l’inclinaison de départ plus forte. " Une solution serait d’employer des câbles plus souples, mais aussi plus chers" . Le courrier conclut à un essai.
Il était écrit que 1924 serait une année difficile pour les câbles. Le 8 septembre, à 9 heures du matin, une rupture du câble tracteur se produit à la Forge. Evidemment il y a aussi des chutes de bennes. C’est le non décrochage automatique qui est cette fois en cause. A l’arrivée sur le terril, une benne ne se décroche pas pour passer sur le rail et entraîne avec elle le câble tracteur. Celui-ci est cisaillé et provoque l’accident. Une interruption d’une dizaine de jours est à prévoir…Il n’y avait pas à Mondalazac de dispositif automatique semblable.
Voie de 66 et transports de mineurs
Dans cet ensemble d’archives, figure enfin un document particulièrement intéressant : les modalités de transport des ouvriers sur la voie de 66 de Decazeville à Marcillac. Nous avons donné sur le site une photo de ces convois de « baladeuses » d’ouvriers. Bien que hors sujet dans ce chapitre " aérien ", nous donnons ces détails ici par souci de cohérence de sources...
Au 14 août 1899 il y avait donc quatre gares :
Cerles, près de la maison Rigal au Suquet (au delà de Firmi vers Marcillac)
La Forézie, à l’ancien dépôt des locomotives (actuellement, au plan d’eau)
La Buscalie, près du pont (à quelques centaines de mètres de la découverte)
Gare des Ateliers, près du compteur général à gaz. (et proche de la découverte)
Le premier et seul train du matin part de Cerles à 5h15 vers Decazeville. Le soir, sont prévus deux trains, départ des Ateliers à 4h10 et 6h10, comme il est précisé sur l’affichette officielle.
Nous avons également un brouillon manuscrit de la marche des trains le 18 août 1927, une trentaine d’années plus tard. Il y a cette fois 8 trains, plus ou moins spécialisés.
Le premier, réservé aux mineurs du poste de jour et aux ouvriers de la découverte de Lassalle, part de Cerles à 5h20. Il sera à Decazeville à 5h45.Une heure plus tard, ce sera le tour des ouvriers des Ateliers, et employés (6h20-6h45).
Le soir, le train n°5, départ 16h Decazeville, sera à Hymes à 16h50. Il est réservé aux ouvriers de la Découverte et criblages. Le train n°8, le dernier de la journée, réservé aux ouvriers mineurs du poste de nuit quitte Decazeville à 22h25 pour une arrivée à Cerles à 22h50...
Annexe : un record…
" Il existe, aux pieds des Andes, au nord de Ghiiecito, au point le plus occidental atteint par les chemins de fer argentins, des mines d'or, d'argent, de fer et de cuivre d'une très grande richesse qu'on appelle les mines de Famatina et qui étaient restées à peu près inaccessibles jusqu'à ces derniers temps.
Les plus importantes, situées à Upalungos, se trouvent à une altitude de 4700 â 5000 m au-dessus du niveau de la mer, et fournissaient par an environ 4 000 t de minerai riche que des porteurs et des mules descendaient à Chilecito, à 1 200 m seulement d'altitude.
L'exploitation de ces mines présente de grandes difficultés, à cause des conditions climatiques. Chilecito est dans un climat tropical, tandis qu'à Upalungos la température moyenne en hiver descend à - 18 degrés. La raréfaction de l'air rend le travail presque impossible à ces hauteurs et, de plus, le pays manque à peu près totalement d'eau et de combustible. On conçoit donc que l'exploitation de ces minerais ait été presque insignifiante, bien qu'ils fussent connus pour contenir jusqu'à 38 % de cuivre et 3 % d'argent.
Après l'ouverture du chemin de fer jusqu'à Chilecito, les mines furent acquises par une Compagnie anglaise et le Gouvernement Argentin résolut de les relier au chemin de fer à Chilecito. La seule solution possible était la construction d'une ligne aérienne qui a été établie par la maison Bleichert, de Leipzig.
Cette ligne est double : une pour l'aller, l'autre pour le retour ; chacune comporte deux câbles, un de support et un de traction placé sous l'autre ; le premier est fixe et le second est en mouvement continu. Les wagonnets sont suspendus à un chariot qui roule par des galets sur le câble de support ; ces wagonnets ont une capacité de 500 kg, ce qui fait avec la tare un poids total de 680 kg. Ils se succèdent à une distance de 110 m, ce qui fait 45 secondes à la vitesse de 2,50 m par seconde à la descente. La remonte des wagonnets vides se fait en partie par le poids des wagonnets descendants ; mais dans les sections à faible déclivité, il faut employer un travail supplémentaire. Les câbles de support vont d'une station à l'autre et sont amarrés à chacune par des dispositions analogues à celles qu'on emploie dans les ponts suspendus. Les wagonnets sont transportés mécaniquement d'un câble à l'autre ; ils sont accrochés au câble de traction par l' accrochage automatique Bleichert.
La ligne, entre Chilecito et Upalungos, est divisée en huit sections par sept stations. La distance totale est de 35 800 m et la différence de niveau de 3 507 m. La distance entre les stations varie de 3 660 à 8 850 m et les déclivités de o à 30 %, atteignent même par endroits 100 %.
Entre les stations, à des distances de 2 000 m environ, les câbles sont supportés sur des montants métalliques. A certaines stations se trouvent des garages et une installation de force motrice avec chaudières et machines à vapeur pour la mise en mouvement des câbles de traction.

Le fer est presque exclusivement employé dans la construction de cette voie de transport, il y a 275 supports en treillis dont la hauteur varie de 3,05 à 48 m. Les câbles sont en fils d'acier ; les câbles de support ont des sections différentes : ceux de montée, moins chargés, ont 28 mm et ceux de descente 35,5 mm de diamètre; les câbles de traction.....ont 18 mm de diamètre. Dans certaines sections, la descente engendre un excès de force par rapport à la résistance à la montée qui est absorbé par des freins.
En dehors des wagonnets transportant le minerai, il y a des véhicules pour les provisions, les outils, etc., il y en a même un pour le transport du personnel qui peut contenir quatre hommes ; il y a aussi des réservoirs pour monter de l'eau qu'on ne trouve pas à la partie supérieure.
Les câbles de traction sont graissés par une disposition ingénieuse consistant en un petit chariot contenant un réservoir d'huile et une pompe rotative ; le mouvement des roues du chariot actionne la pompe qui envoie de l'huile sur le câble. Les diverses stations communiquent entre elles par le téléphone.
Le montage des appareils a été une opération très délicate. Le travail s'est fait par sections, en commençant naturellement par la partie inférieure ; comme les transports se faisaient à dos de mules, on avait soin de diviser les pièces en parties de 150 kg au plus. On a employé plus de 1 000 mules à cet effet ; les pièces d' un poids supérieur, jusqu'à 1 000 kg, étaient portées par des masses d' hommes. Ainsi, les câbles, par longueurs de 200 â 300 m, pesant environ 3000 kg, exigeaient, suivant les endroits, de 60 à 300 hommes qui les portaient déroulés. A mesure que la pose de la ligne avançait, on transportait les câbles en les attachant à des wagonnets roulant sur la partie déjà installée.
Les travaux ont employé 1 200 hommes ; commencés en octobre 1903, ils ont été terminés à la fin de 1904. La ligne est exploitée par le Gouvernement ; elle emploie 640 wagonnets. Le transport par mules coûtait avant 62,30 f par tonne ; avec un débit de 40 t â l'heure, le coût, par la ligne aérienne, n'est plus que de 6,50 f, ce qui représente un peu moins de 0,20 f par tonne-kilomètre. "
Une description très concise, complète et nous y retrouvons la plupart des éléments évoqués sur le causse.
Une telle installation, la deuxième du monde donc, ne pouvait pas ne pas nous intriguer. La recherche sur le web est plus que fructueuse. Il n'est pas possible de donner ici l'ensemble des ressources. Nous en proposons quelques unes, parmi les plus démonstratives.
Et pour commencer, Youtube ! Plusieurs vidéos sont accessibles, certaines très récentes ont été mises en ligne en janvier 2009.
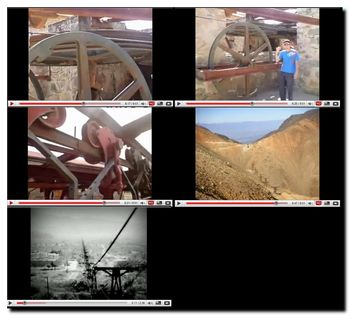
Première proposition :
Cable Carril - Chilecito La Rioja, mettre ceci dans le champ de recherche de Youtube, et ce sera 9'51" d'images, de belles images ; bien sûr nous sommes à près de 4500 m d' altitude ( ! ) et le vent souffle, y compris dans le micro ! Une suite de ce reportage, qui est commenté, se trouve avec la référence suivante : Cable Carril - Chilecito - La Rioja ((Parte 2)). Ici, ce n'est pas le son qui pose problème, mais plutôt l'image...mais cela dure 10'34"!
Autre proposition, toujours sur Youtube : Chilecito - Cablecarril La Majicana - La Rioja. C'est beaucoup plus professionnel, pour 2'36".
Attention ! Si ces liens étaient valides en décembre 2008, il semble que ce ne soit plus le cas en juillet 2009 ! Les deux reportages de notre première proposition ne figurent plus dans le monde virtuel de youtube. On peut par contre toujours utiliser Cable Carril - Chilecito La Rioja comme clé de recherche pour pouvoir accéder à d'autres reportages sur ce haut lieu du tourisme argentin.
Le serveur http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_La_Mejicana, propose un article séduisant. Et une belle image, parmi d'autres:

Empresa constructora: Adolf Bleichert & Co. Leipzing Gohlis Alemania.
Llamado a licitación: 4 de enero de 1902.
Autorización de construcción: por ley 4208, de noviembre de 1901 del Min. de Obras Publicas de la Nación.
Presupuesto: 217.988 pesos oro.
Aceptación de la propuesta: 27 de mayo de 1902 por decreto del Poder ejecutivo.
Firma del convenio: 31 de julio de 1902.
Comienzo de la Obra: febrero de 1903.
Terminación de primera sección: estación 1 a la 5, julio de 1904.
Terminación de la segunda sección: estaciones 6 a la 9, diciembre de 1905.
Primera Empresa Concesionaria: Famatine Development Co. Inglaterra.
Artífice de la Obra: Doctor Joaquín V. González.
Inauguración: 29 de julio de 1904.
Presidente de la Nación: Julio A. Roca.
Gobernador: Doctor Wenceslao Frías.
Intendente/ comisionado en Chilecito: Cannelo B. Valedes.
Longitud: 35 Km. (comprendre longueur)
Altura: llega hasta los 4603 msnm. (altitude en m au dessus du niveau de la mer)
Número de Torres: 262.
Número de Estaciones: 9.
Diferencia de altura entre Chilecito y La Mejicana: 3510.
Motores y Potencia: 6 motores entre 35 y 60 HP.
Estaciones y Tensión de anclaje: 16.
Fecha de paralización de trabajos: año 1926.
Fecha de declaración como Monumento histórico Nacional: 25 de Octubre de 1.982.
Altura de la torre mas baja: 3 mts.
Altura de la torre mas alta: 56 mts.
Altura mínima de las vagonetas hasta el suelo: 3 mts.
Altura máxima: 450 mts.
Mayor distancia entre torres: 668 mts.
Carga útil por vagoneta: 250 Kg.
Longitud del túnel: 159 mts.(entre estación 4 y 5).
Instalación telefónica: la primera realizada en el país.
Capacidad de Transporte: 400 toneladas diarias.
Distancia total del recorrido: 35.061 mts.
Estación I: Chilecito 1075msnm.
Estación II: El Durazno 1539 msnm.
Estación III: El Parron 1974 msnm.
Estación IV: Siete Cuestas (Rodeo de las Vacas) 2539 msnm.
Estación V: Cueva de Romero 2689 msnm.
Estación VI: El Cielito 3244 msnm.
Estación VII: Calderita Nueva (Cueva de Illanes) 3910 msnm.
Estación VIII: Los Bayos 4371 msnm.
Estación IX: La Mejicana (Upulungos) 4603 msnm.Velocidad de las vagonetas: 2.5 mts./h.
Tiempo total del recorrido de los 35 Km: 4 horas.
Prestación horaria: 40.000 Kg./h.
Total del cable usado: 140.000 mts.
Mayor separación entre dos torres: 608 mts., entre las estaciones 6 y 7.
Total de remaches: 10.000.000 aproximadamente.
Altura de las torres: entre 1 a 55 mts.