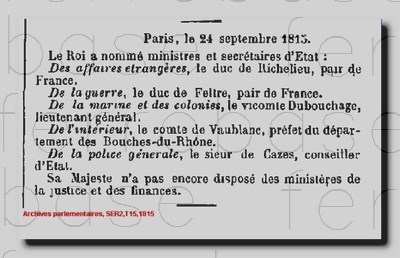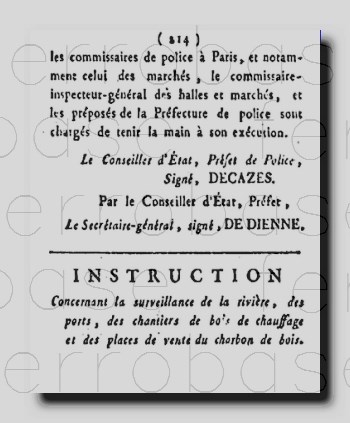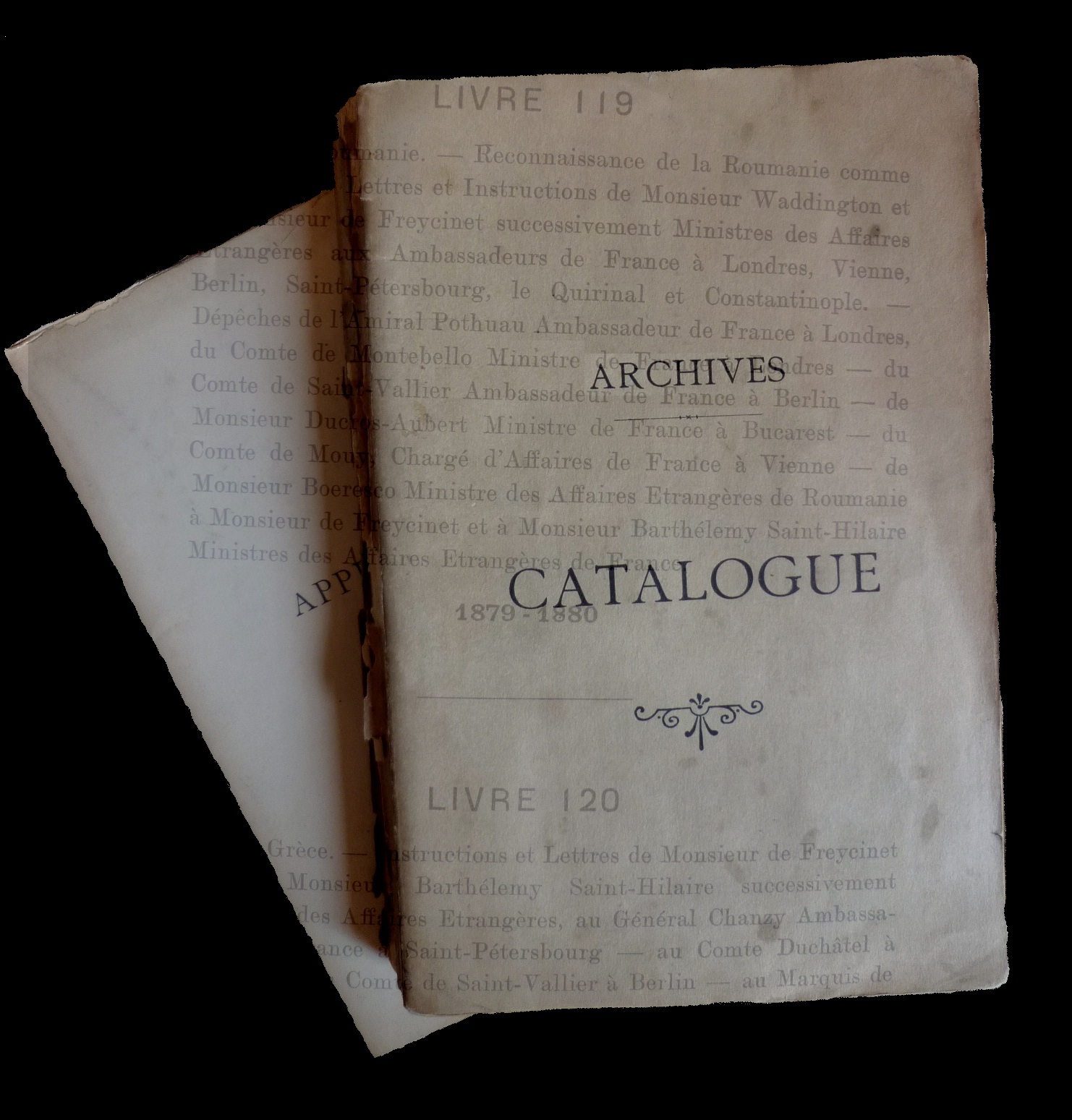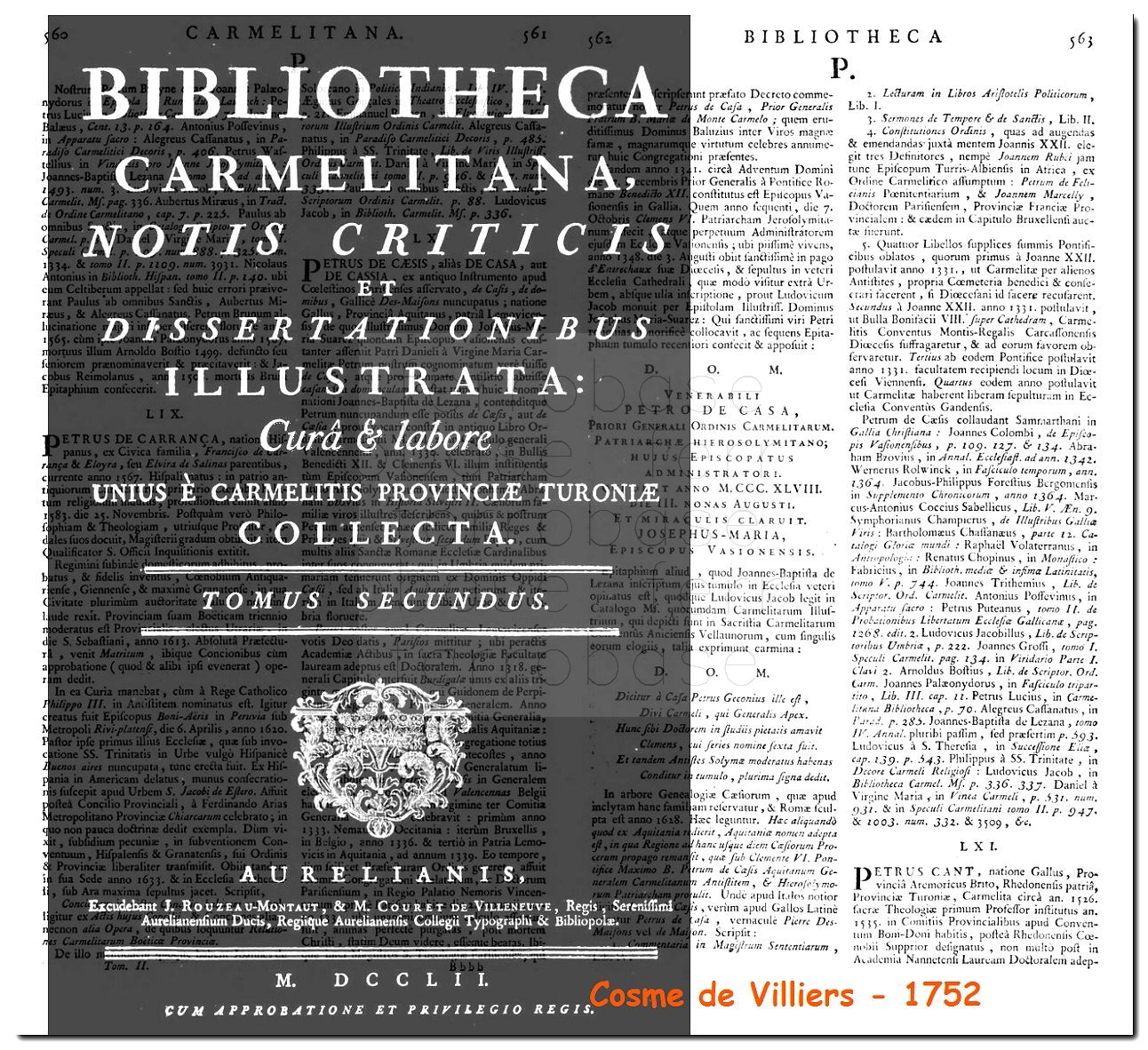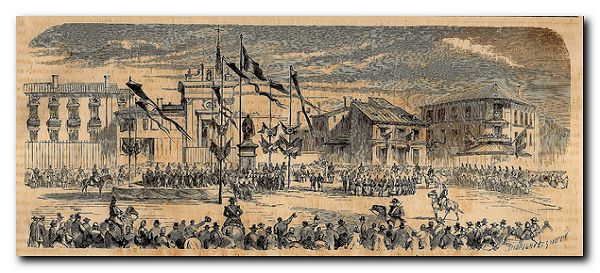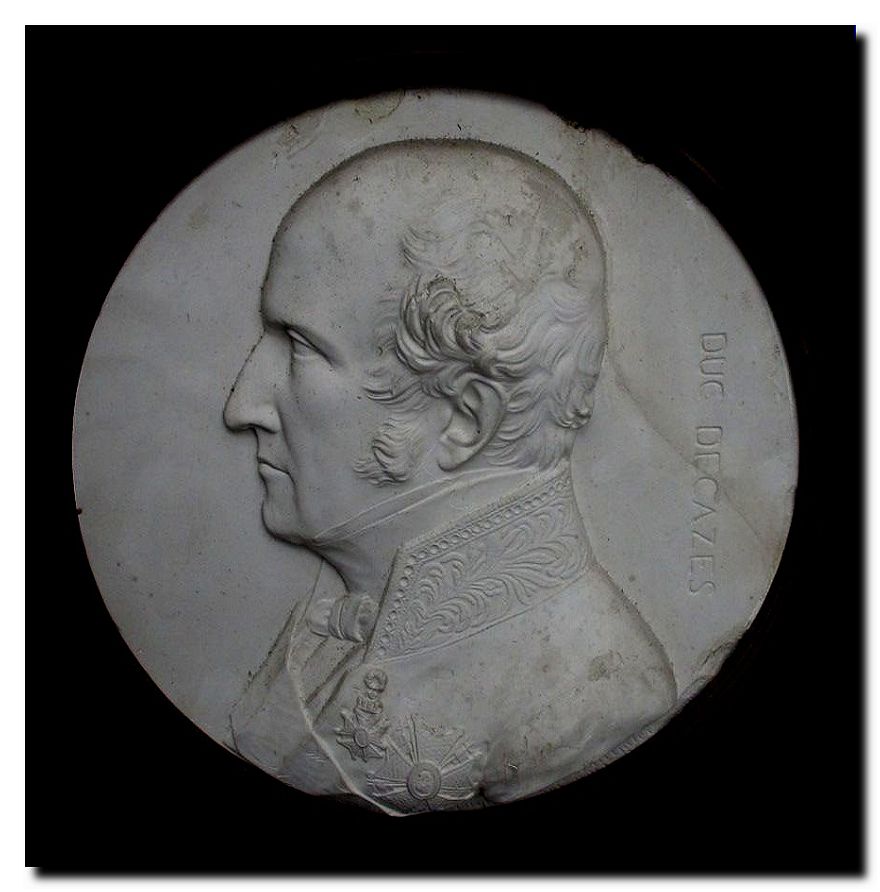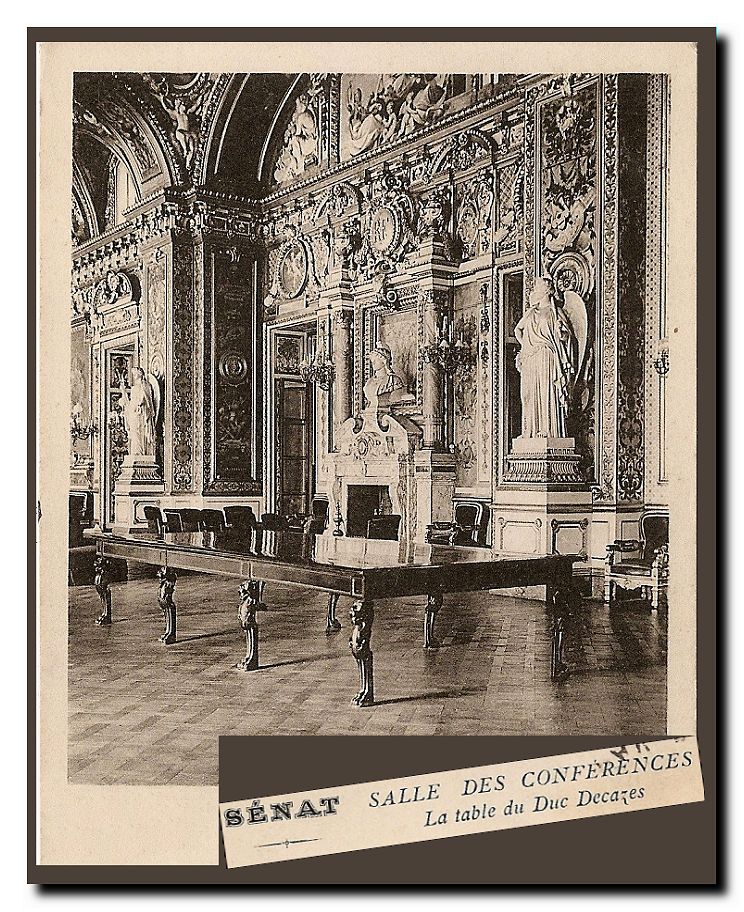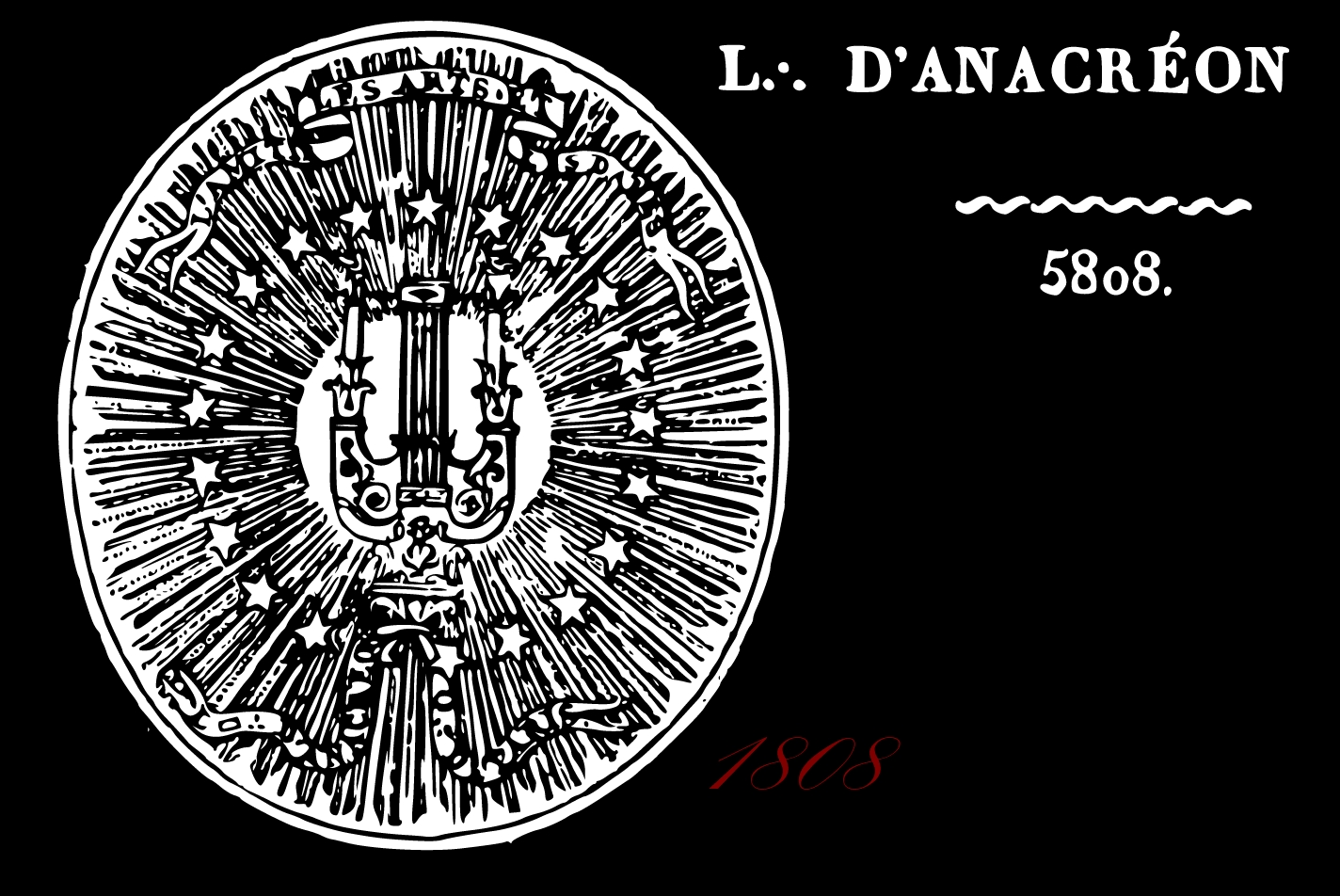►
Les images de ce site, et particulièrement de cette page peuvent
apparaitre avec une surcharge ferrobase, suite à "incivilités"
diverses. Voir ici
 les trois corbeaux sont bien là !
les trois corbeaux sont bien là !
RETOUR
page menu
▲
le duc et la duchesse Decazes, portraits, Gérard (col part)
Monsieur, comte, duc de Glücksbierg,
duc Decazes...Decazeville
le
24 octobre 1860, disparaissait le duc
Decazes
 Jean-Louis
Nicolas JALEY
"
buste du duc Elie Decazes et
de Glucksburg "
plâtre
64
x 57 x 32,5 cm
Inv:
D.836.1.5
photographie
:
Jean-Christophe Garcia
droits
réservés, musée des
beaux-arts et d'archéologie de Libourne.
Infographie
Jean Rudelle
Jean-Louis
Nicolas JALEY
"
buste du duc Elie Decazes et
de Glucksburg "
plâtre
64
x 57 x 32,5 cm
Inv:
D.836.1.5
photographie
:
Jean-Christophe Garcia
droits
réservés, musée des
beaux-arts et d'archéologie de Libourne.
Infographie
Jean Rudelle
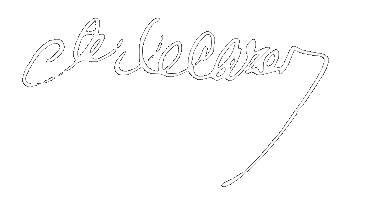
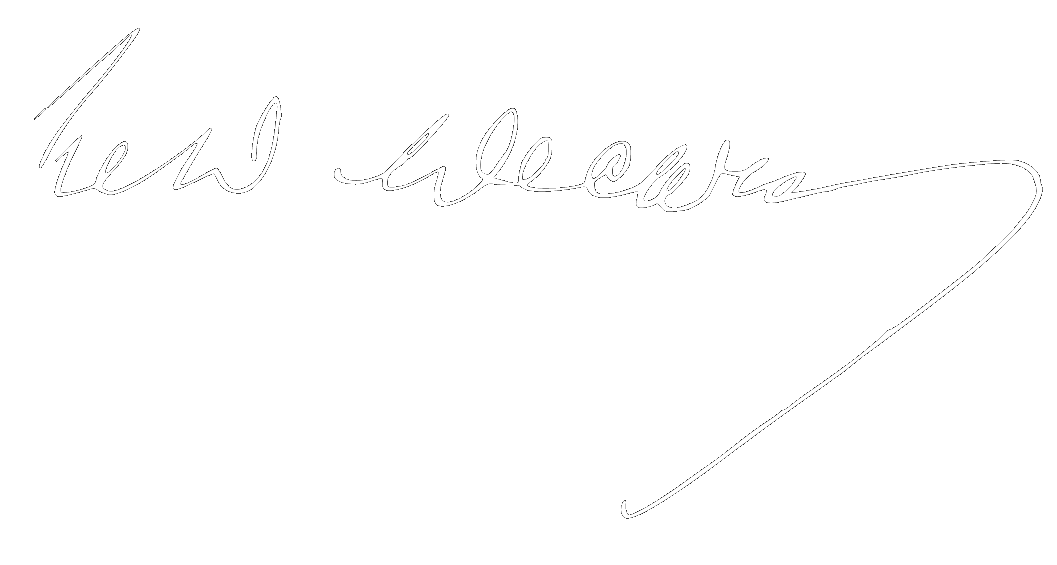 ▲
comte puis duc...
et
ministre (ni comte ni duc), ▼
▲
comte puis duc...
et
ministre (ni comte ni duc), ▼
Petit
arrangement….
12
janvier 1816. Le tout nouveau Ministre Secrétaire d’Etat
au Département de la Police Générale, en fonction depuis un trimestre,
informe par un court billet son correspondant qu’il ne peut " officiellement
faire ce que demande M. le G(énér)al
Sarrazin…" mais qu’il pourra
peut-être arranger cette affaire "officieusement "
en demandant au
Gal de " passer
chez moi ". Cet arrangement nous vaut une signature
très inhabituelle et bien curieuse…de
Cazes pour Elie,
mais son frère Joseph pouvait pour sa part user de cette graphie.

...et
tout simplement ▼ Monsieur Decazes, en octobre 1815, jeune ministre
puis en 1816


et comte Decazes pour le Ministre (comte depuis le 27 janvier 1816)

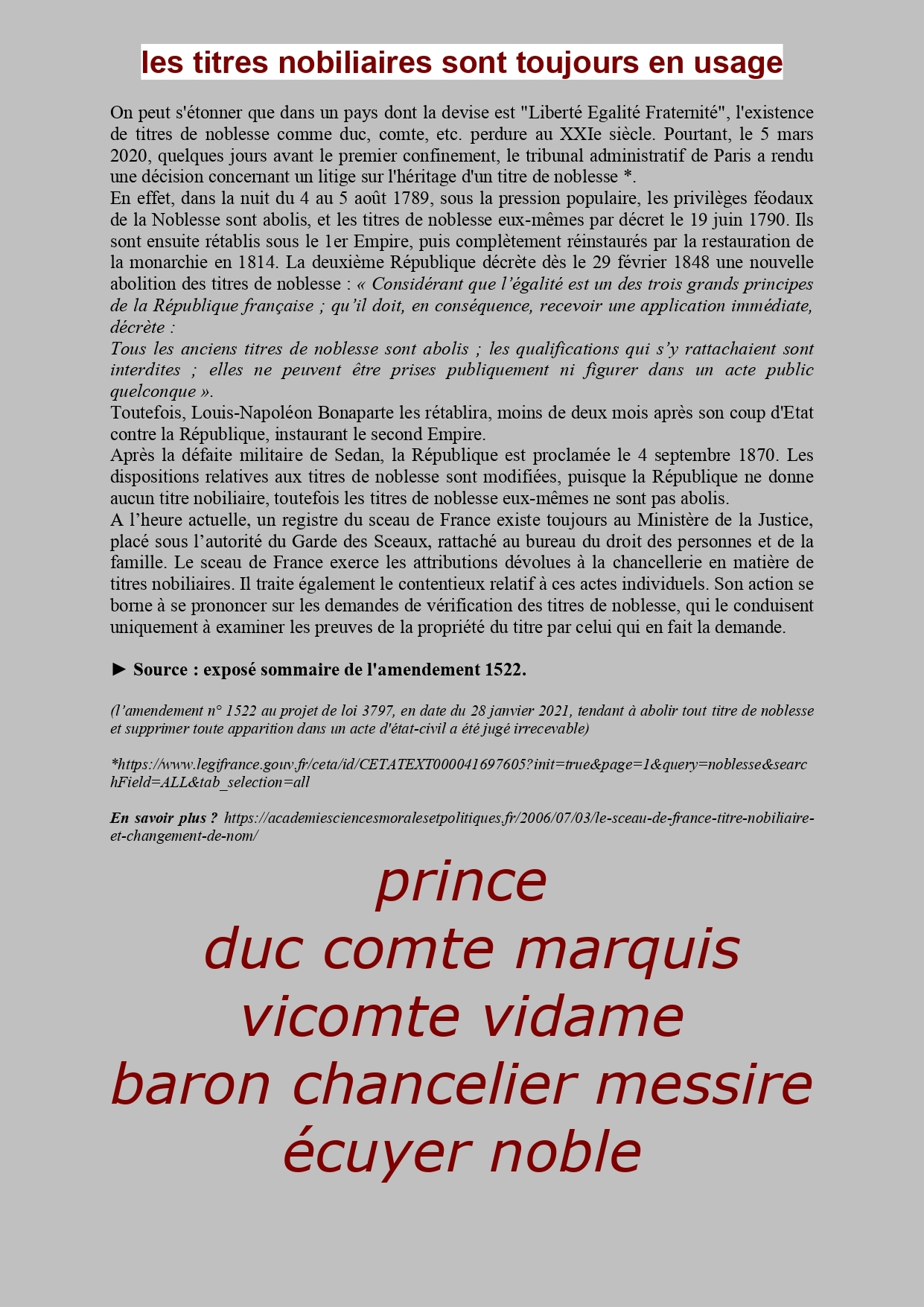 ▲
le saviez-vous ?
▲
le saviez-vous ?
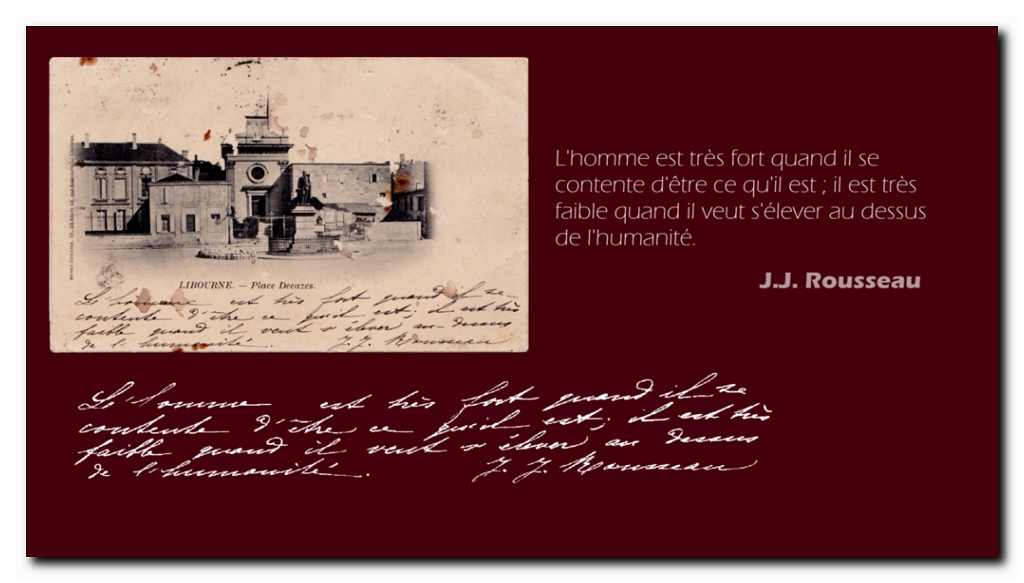 clic
clic
citation de l'Emile,
livre second, résume-t-elle la personalité du duc ?

Louis
XVIII, 5 francs, 1815
Cette pièce de 5 francs, en argent,
ici la version frappée à Rouen, commémore la première et la seconde
Restauration : la pièce est en effet fabriquée avant les Cent
Jours...puis après ! Louis XVIII, roi de France, est bien connu, mais
qui connaît alors Elie Decazes ? Il lui faudra, pour accéder à la
notoriété, attendre la seconde Restauration : en quelques semaines le
juge deviendra préfet, ministre, et confident du Roi...
Le graveur,
Tiolier, sera également quinze ans plus tard le graveur du jeton de
présence de la Société des Houillères, jeton à découvrir sur ce site,
chapitre 11
Le jeune préfet (il sera ministre le mois prochain) aura à gérer les tracas des troupes d'occupation...
Elie
duc Decazes
coll.
part (photo et infographie JR)
Il existe de
multiples représentations du fondateur des Forges. Ce tableau, par un
peintre inconnu, est une copie d'un tableau de Gérard. La copie
cependant diffère par le costume : Elie Decazes, il n'est pas encore
duc au moment où l'original fut fait, porte sans doute ici un habit
officiel de député, ce qu'il fut jusqu'en 1816. Gérard, dans son
tableau le montrait en habit civil.
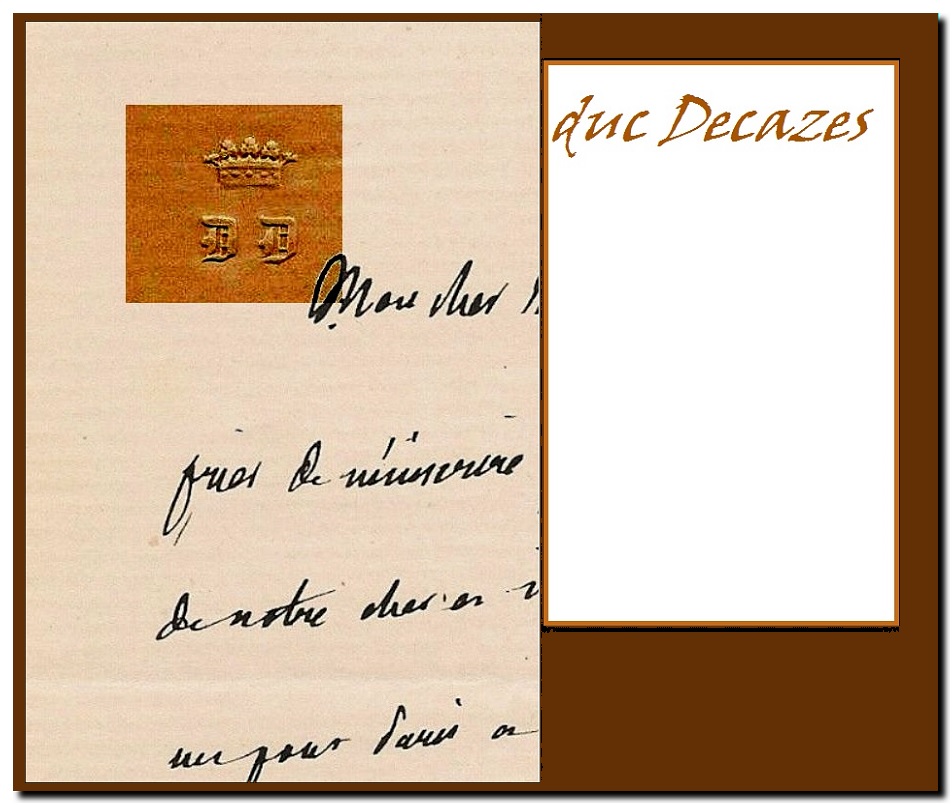
Rare, et élégant, papier à lettre, une
couronne de duc, D D...
 Eglise de Bonzac. Vitrail, couronnes de duc et duc et pair
Eglise de Bonzac. Vitrail, couronnes de duc et duc et pair
blasons familles Decazes (à gauche) et Saint-Aulaire (à droite)
(DR, publication 33910 Bonzacais, Facebook)
Comte, duc et duc,
tout cela, pour un même homme !
Comprendre qui était Monsieur Decazes n’est pas chose
facile ! Rarement nous aurons trouvé des descriptions, portraits
et biographies aussi contradictoires. Pour certains, le duc est
un travailleur laborieux ayant bien mérité de la patrie, pour d’autres
le sang est à ses pieds ! Pour tous, il ne laisse pas
indifférent ! Nous allons tenter de vous faire comprendre la
complexité du personnage. Nous aurons ainsi la possibilité de mieux
comprendre l'itinéraire qui le conduira à Decazeville : pourquoi ici,
pourquoi des mines, pourquoi lui ? Un hasard ? Non, absolument pas ! Et
il n'était pas seul...
Cette histoire est donc passablement compliquée. L'époque ne facilite
pas les choses, près de quarante ans de révolution avant de voir une
accalmie, et une autre révolution, industrielle celle là, qui vient
imposer ses éléments.
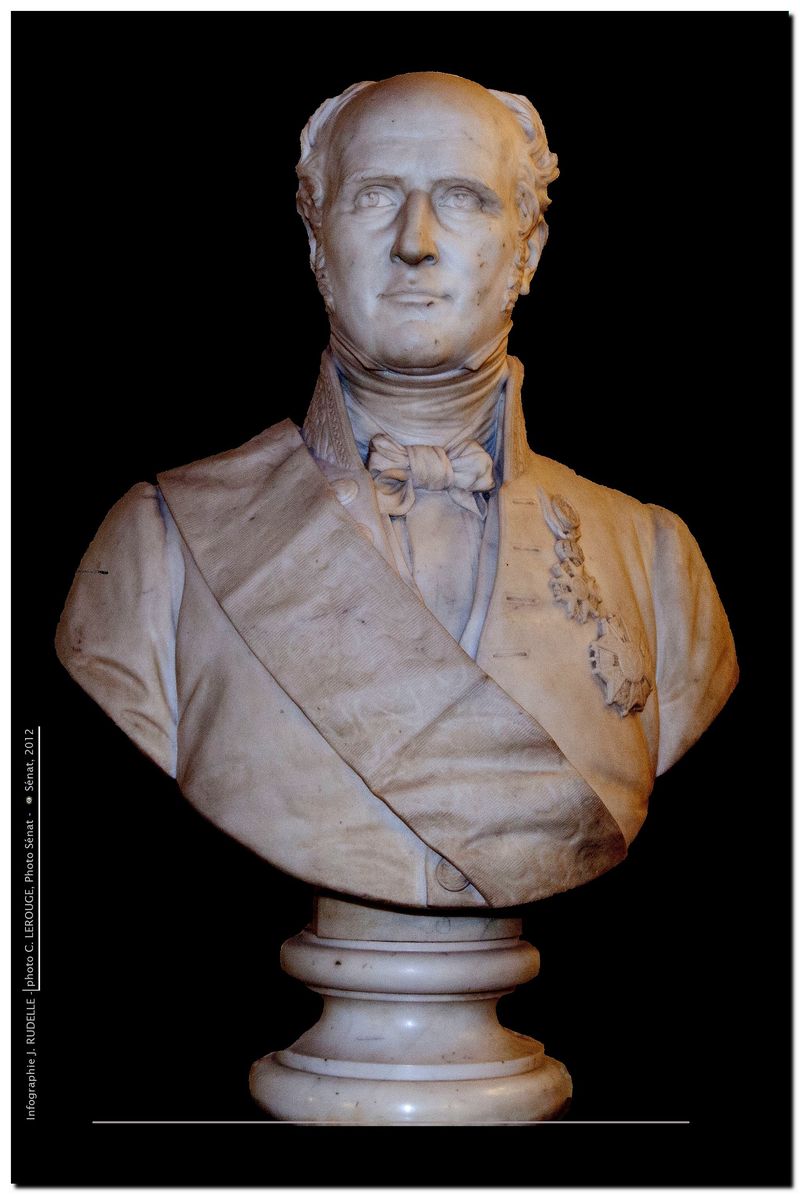
Le
duc Decazes, pair de France, sera nommé Grand
Référendaire de la Chambre des pairs. Cette haute
fonction est sûrement à l'origine de la présence de
son buste, par Gustave Crauk, dans la galerie des Bustes du
Sénat.
Photographies
C. Lerouge,
Photo Sénat, Copyright Sénat-2012
Infographies
JR
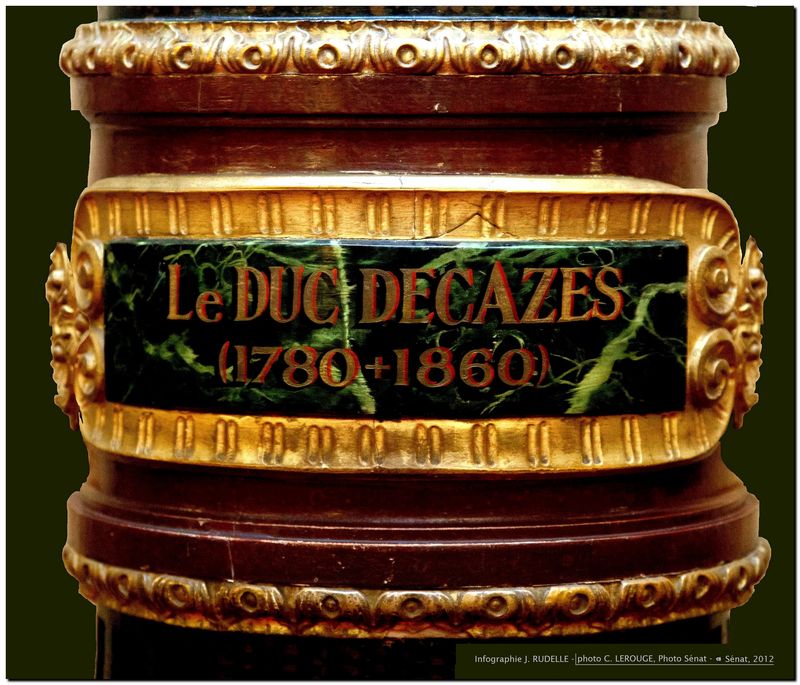
Prélude, avertissement, est-ce bien
nécessaire ?
Pour les plus jeunes, les moins
jeunes, les Decazevillois, les Rouergats, les estrangers et les curieux..
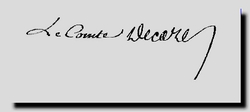 Il est possible que la lecture des pages suivantes soit une véritable
surprise, elle l'a été pour nous quand nous les avons écrites !
L'époque qui nous intéresse, 1815-1825, vient après des "évènements"
violents : révolution, guerres diverses...et ceux qui furent les
acteurs de ces évènements ont des personnalités hors du commun, mêmes
si elles sont très différentes les unes des autres. Il n'était pas
d'usage pour eux de cacher les faits et les mots et écrits sont le
reflet
de cette violence, qui ne sera pas, y compris pendant la période
Decazes, que verbale. Il est important de garder cet aspect de la
situation en tête, pour conserver un peu de recul devant ces
textes. Extravagants ? Outranciers ? Et donc à rejeter ? Chacun
se
fera son idée...Si nous avons par exemple cité M. Clausel de
Coussergues, ce n'est pas pour son propos plus qu'enflammé : le roi
Louis XVIII a entendu son Cri,
il y a répondu dans ses lettres au
comte, c'est bien le signe d'une certaine importance. Les intérêts
des uns et des autres ne sont pas seulement politiques, et ce n'est
pas uniquement croyons nous une lutte pour des idées et pour le
pouvoir, ou les pouvoirs.
Pour certains, comme Chateaubriand, sa
fortune est faite, et il peut se consacrer à ces luttes en apportant sa
notoriété, au risque de la compromettre par quelques phrases
couperets. Pour d'autres, venant d'intégrer la noblesse, au
hasard des alliances, ralliements et autres rapprochements intéressés,
il est important de consolider l'ascension sociale, et les propos
tenus à la Chambre des Députés, ou à la Chambre Haute, ne sont
pas sans importance et sans effet. Le caractère qui peut
apparaître excessif des propos trouve aussi une justification dans la
liberté naissante de la presse : il faut user de cette liberté,
pratiquement le seul moyen de se faire (re)connaître. On écrit
beaucoup, hommes comme femmes. Il est possible que de nos jours, les
mêmes situations ne seraient pas analysées et décrites avec les mêmes
termes. Monsieur Decazes, qui n'est que Monsieur au début de ces pages,
va se trouver placé aux toutes premières places, après
Waterloo. Peut-on réaliser deux siècles plus tard, ce que vont être les
écueils de l'exercice ? L'exposition du Ministre à toutes les
oppositions montre bien finalement l'intérêt de cette personnalité ;
venu il y a peu, dix ans à peine, de sa Gironde natale, il sera
l'un des plus puissants personnages durant ces années de Restauration.
Comprendre
pourquoi il consacrera une grande part de sa fortune, vers 1820-1825
aux mines du Rouergue est notre seul objectif.
Il est possible que la lecture des pages suivantes soit une véritable
surprise, elle l'a été pour nous quand nous les avons écrites !
L'époque qui nous intéresse, 1815-1825, vient après des "évènements"
violents : révolution, guerres diverses...et ceux qui furent les
acteurs de ces évènements ont des personnalités hors du commun, mêmes
si elles sont très différentes les unes des autres. Il n'était pas
d'usage pour eux de cacher les faits et les mots et écrits sont le
reflet
de cette violence, qui ne sera pas, y compris pendant la période
Decazes, que verbale. Il est important de garder cet aspect de la
situation en tête, pour conserver un peu de recul devant ces
textes. Extravagants ? Outranciers ? Et donc à rejeter ? Chacun
se
fera son idée...Si nous avons par exemple cité M. Clausel de
Coussergues, ce n'est pas pour son propos plus qu'enflammé : le roi
Louis XVIII a entendu son Cri,
il y a répondu dans ses lettres au
comte, c'est bien le signe d'une certaine importance. Les intérêts
des uns et des autres ne sont pas seulement politiques, et ce n'est
pas uniquement croyons nous une lutte pour des idées et pour le
pouvoir, ou les pouvoirs.
Pour certains, comme Chateaubriand, sa
fortune est faite, et il peut se consacrer à ces luttes en apportant sa
notoriété, au risque de la compromettre par quelques phrases
couperets. Pour d'autres, venant d'intégrer la noblesse, au
hasard des alliances, ralliements et autres rapprochements intéressés,
il est important de consolider l'ascension sociale, et les propos
tenus à la Chambre des Députés, ou à la Chambre Haute, ne sont
pas sans importance et sans effet. Le caractère qui peut
apparaître excessif des propos trouve aussi une justification dans la
liberté naissante de la presse : il faut user de cette liberté,
pratiquement le seul moyen de se faire (re)connaître. On écrit
beaucoup, hommes comme femmes. Il est possible que de nos jours, les
mêmes situations ne seraient pas analysées et décrites avec les mêmes
termes. Monsieur Decazes, qui n'est que Monsieur au début de ces pages,
va se trouver placé aux toutes premières places, après
Waterloo. Peut-on réaliser deux siècles plus tard, ce que vont être les
écueils de l'exercice ? L'exposition du Ministre à toutes les
oppositions montre bien finalement l'intérêt de cette personnalité ;
venu il y a peu, dix ans à peine, de sa Gironde natale, il sera
l'un des plus puissants personnages durant ces années de Restauration.
Comprendre
pourquoi il consacrera une grande part de sa fortune, vers 1820-1825
aux mines du Rouergue est notre seul objectif.
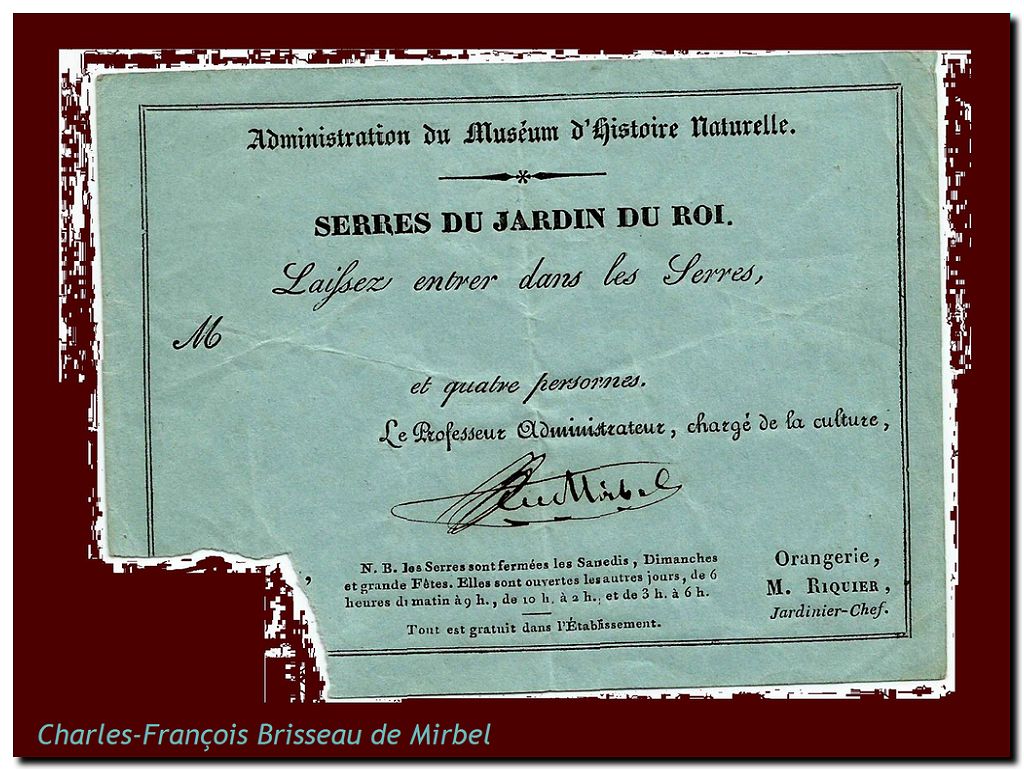 Charles-François
Brisseau de Mirbel, botaniste de son état, ami du duc, secrétaire
général au ministère de la Police, puis de l'Intérieur.
Charles-François
Brisseau de Mirbel, botaniste de son état, ami du duc, secrétaire
général au ministère de la Police, puis de l'Intérieur.
Mirbel fut secrétaire des commandements du roi Louis de Hollande en
1806.
Lizinska
de Mirbel, miniaturiste renommée, eut l'occasion de faire le portrait
d'Elie Decazes.

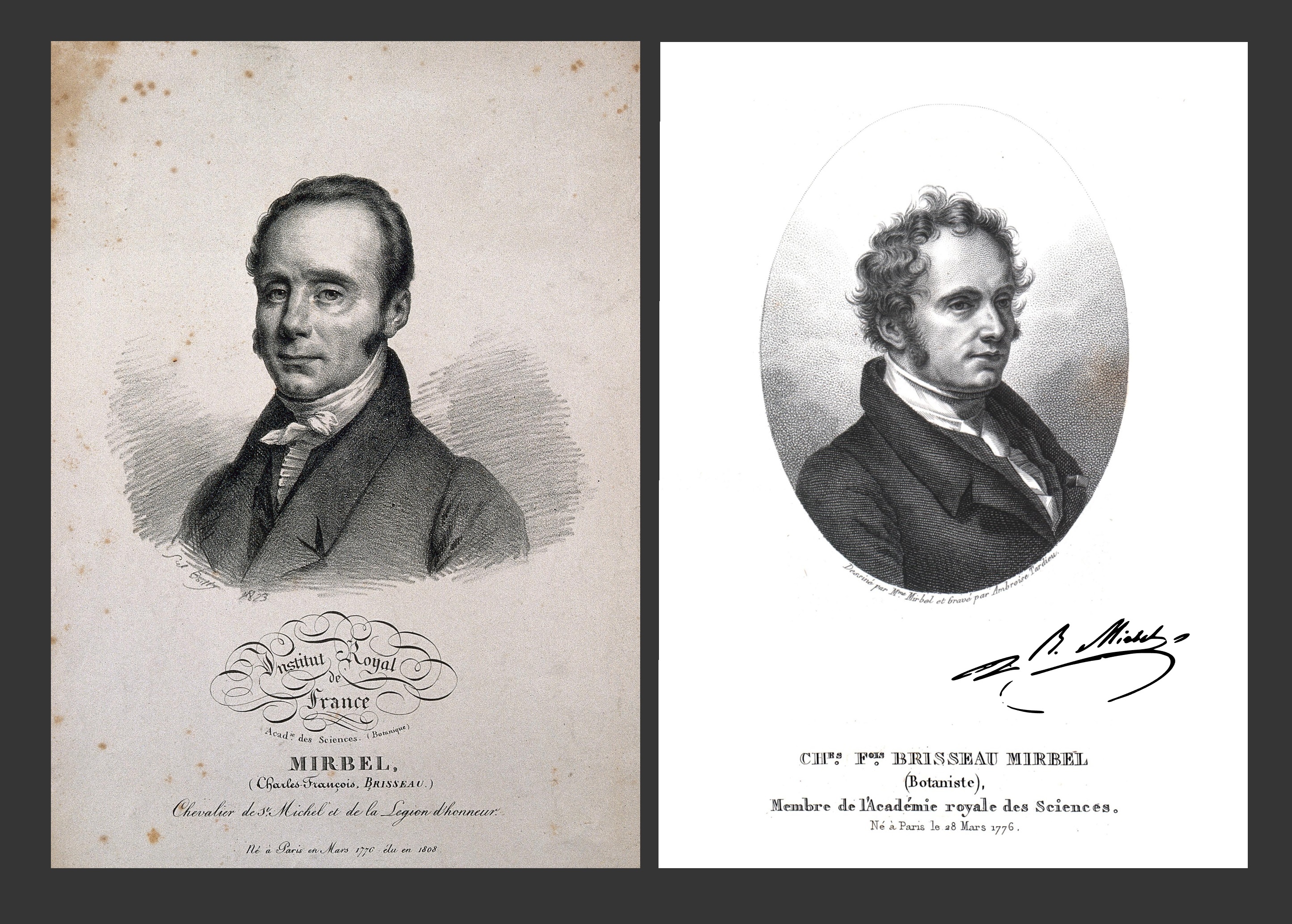
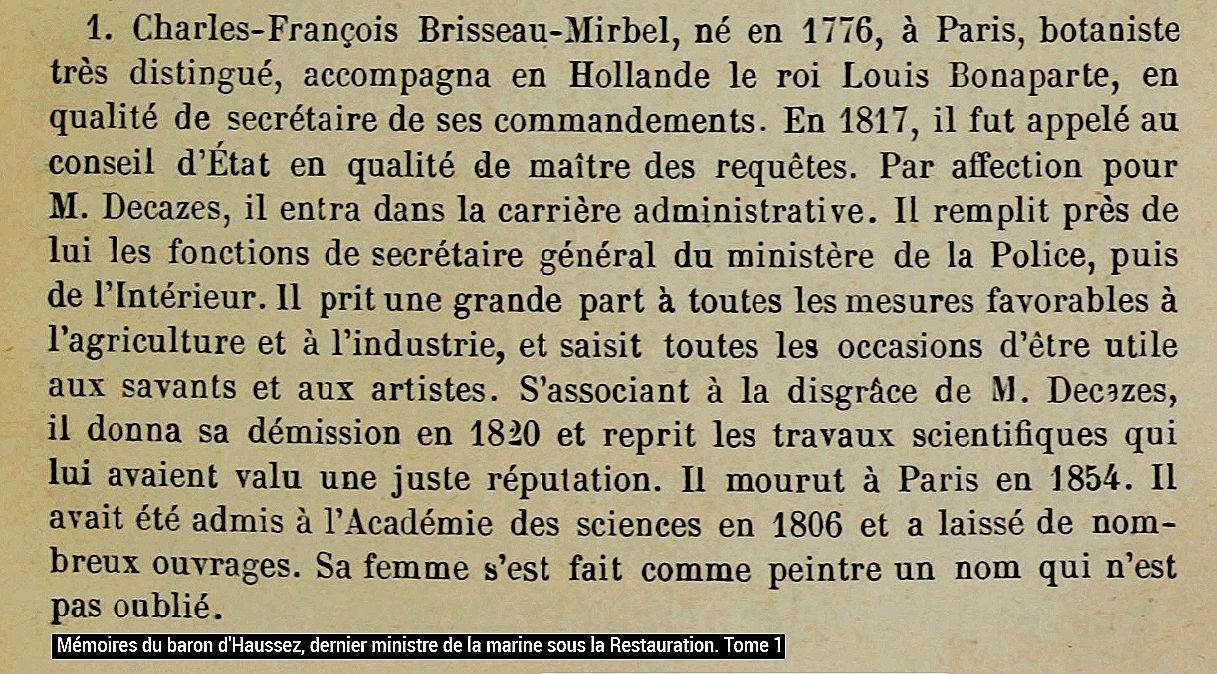
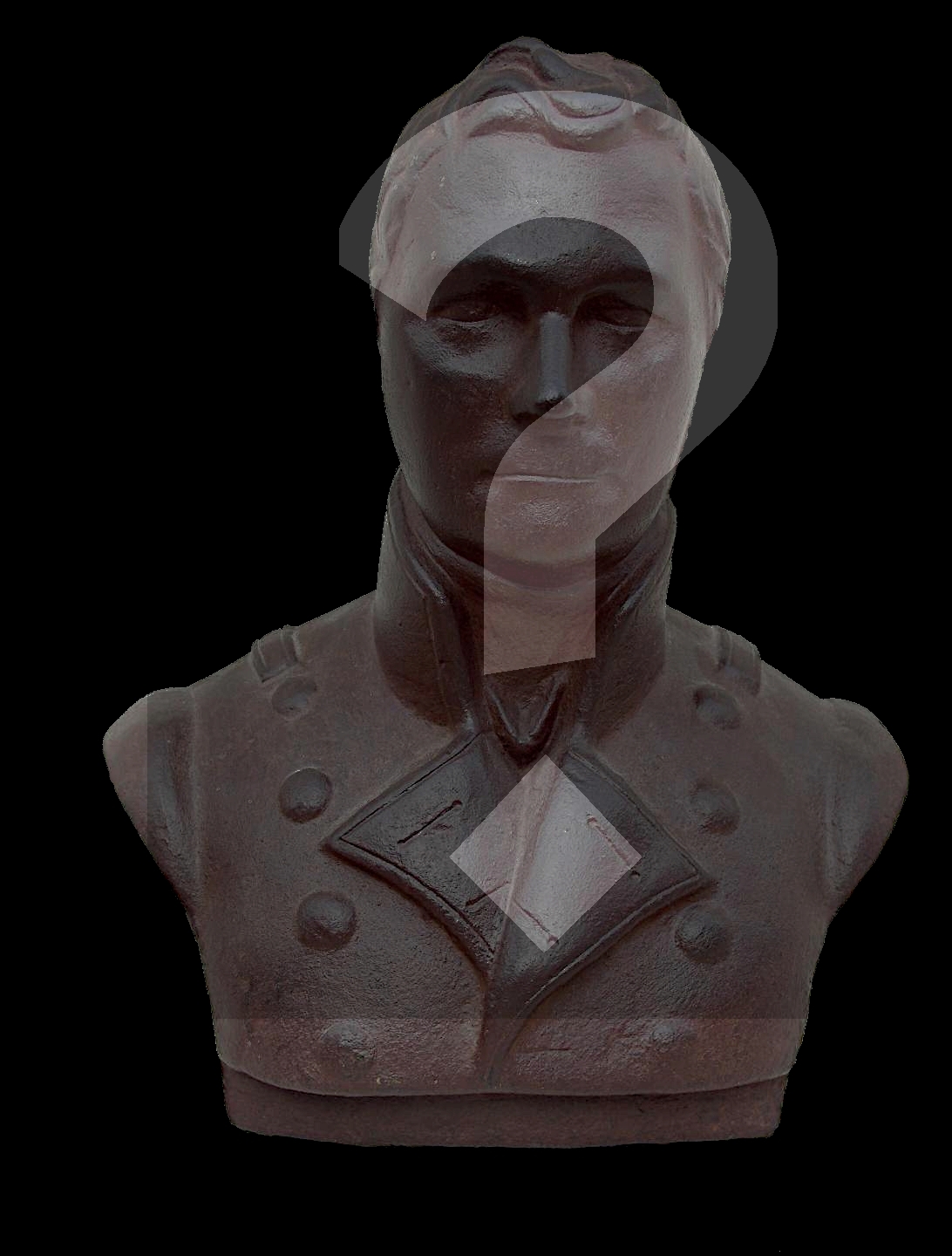 ▲ clic ???????????
Présent
dans une collection particulière, ce buste ressemble à....Mais aucun
indice ne permet son identification !
Buste
fonte (probablement un tirage), hauteur 24 cm, largeur 20 cm.
Si
vous le connaissez, ou si vous pouvez identifier le costume,
écrivez-nous : jrudelle@ferrobase.fr
▲ clic ???????????
Présent
dans une collection particulière, ce buste ressemble à....Mais aucun
indice ne permet son identification !
Buste
fonte (probablement un tirage), hauteur 24 cm, largeur 20 cm.
Si
vous le connaissez, ou si vous pouvez identifier le costume,
écrivez-nous : jrudelle@ferrobase.fr
des
châteaux...

◄
Nous
n'évoquerons pas dans ces pages, ou très
brièvement, l'implication "agricole" du duc. Ce fut pour lui aussi
important, et peut-être plus que les mines ! Curieux et véritablement
novateur, il va dans ses propriétés expérimenter beaucoup dans les
techniques de l'élevage ou de la culture. Et nous n'oublions pas ses
vignes, toujours actives et exploitées en bordelais, une belle
étiquette, une couronne.... Il avait mis en place au Palais du
Luxembourg, qu'il habita longtemps en sa qualité de Grand Référendaire,
étant membre de la Chambre des Pairs, un ensemble assez remarquable et
remarqué de vignes...
Près de Libourne, vers
Saint-Aigulin et Le Fouilloux, le duc achète en 1818 un
domaine important, le domaine de Gibaud. Pour
certains, ce fut un cadeau de Louis XVIII à son ministre préféré...
C'est
là
qu'il va mener ses expérimentations. Le château a disparu après un
incendie, le 20 juillet 1916 (d'autres
sources évoquent 1915 ou 1919...). Le domaine n'était plus
propriété de la famille Decazes à cette époque. Voici une carte postale
ancienne montrant le château, construit en 1818 d'après les plans du
duc. Un écho paru dans un bulletin municipal évoque avec quelques
précisions bien venues ce domaine disparu. Pour la duchesse, Gibaud
était aussi ruineux que les mines ! En 1849, le duc est décidé à vendre
son domaine de 500 hectares (on évoque souvent, pour nous à tort, près
de 800 hectares ; le chiffre de 500, pour la totalité de la propriété,
figure dans une lettre écrite par le duc en 1849, lue en séance du
Conseil Général de la Charente Inférieure le 4 septembre 1849. Le
domaine fut vendu 601.000 francs en 1870 à M. Mahieu, un richissime
entrepreneur parisien - voir Le Vieux St-Maur, Mahieu Maire, Bulletin
Société d'Histoire et d'Archéologie de St-Maur des Fossés, 65-66,
1993-1994. Dans cette publication, le chiffre de 589 hectares est
avancé).
Pour en savoir plus sur cette
activité agricole, voir les ouvrages de Trigant de Latour de Brau et
Ernest Daudet, repris dans la bibliographie.
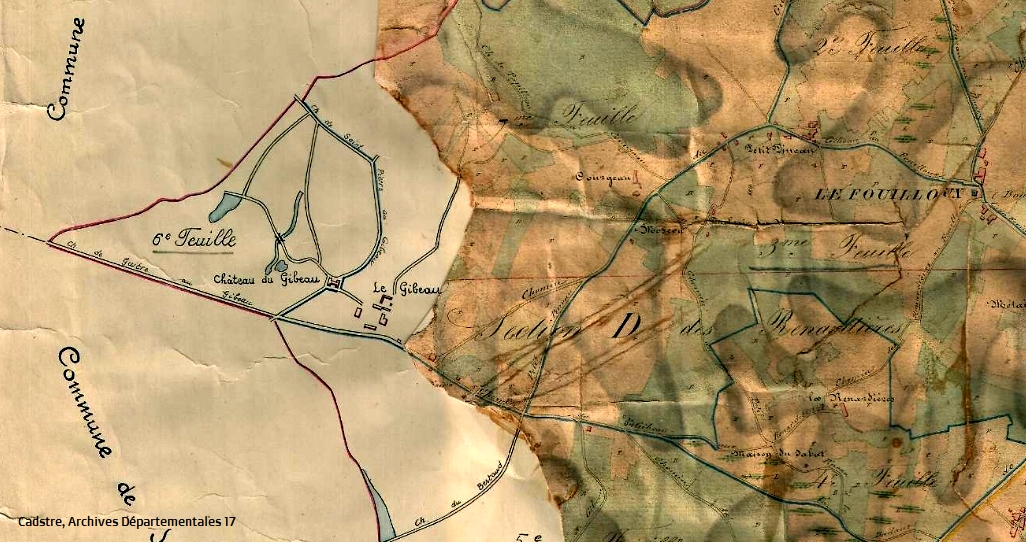
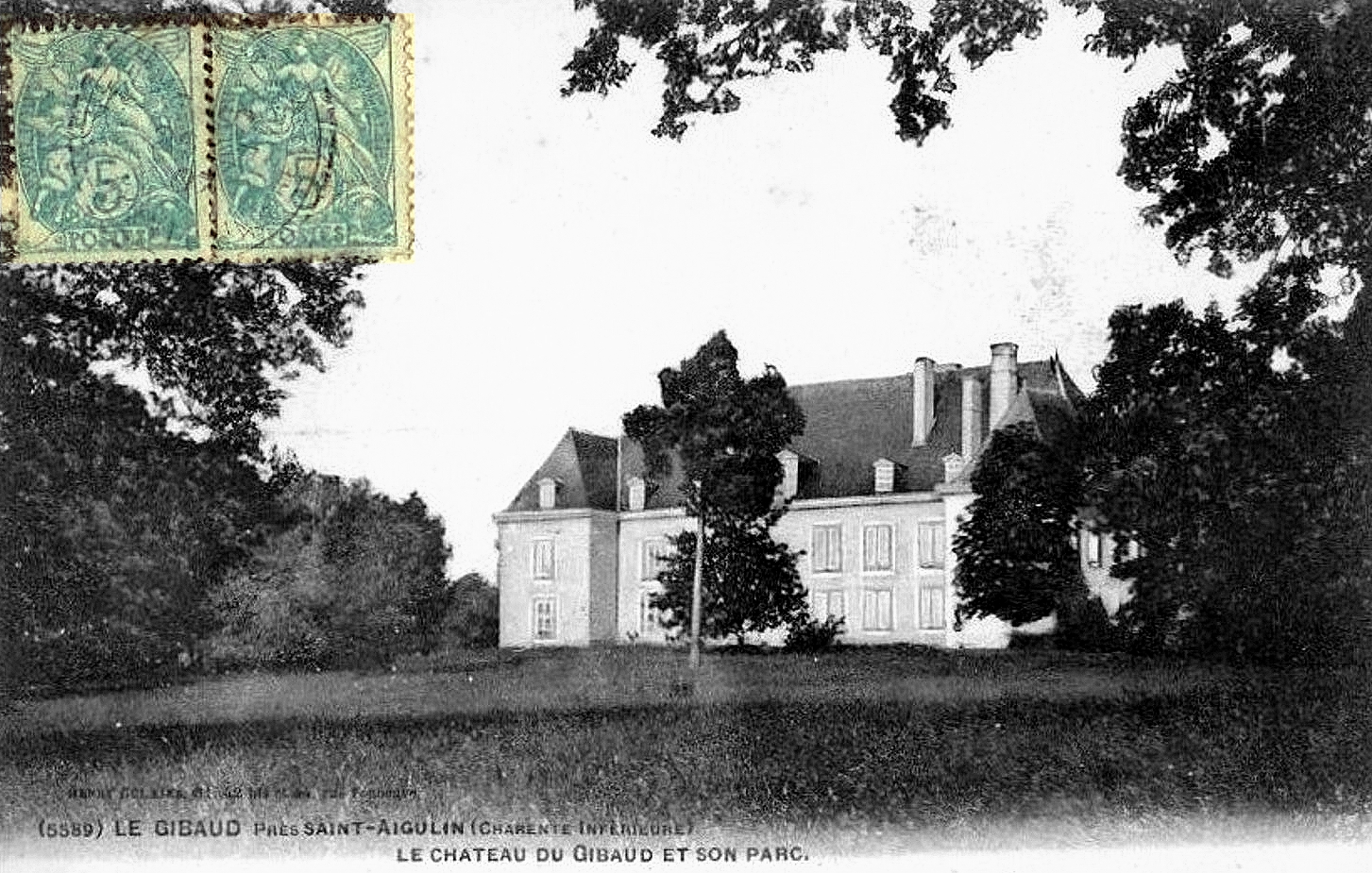
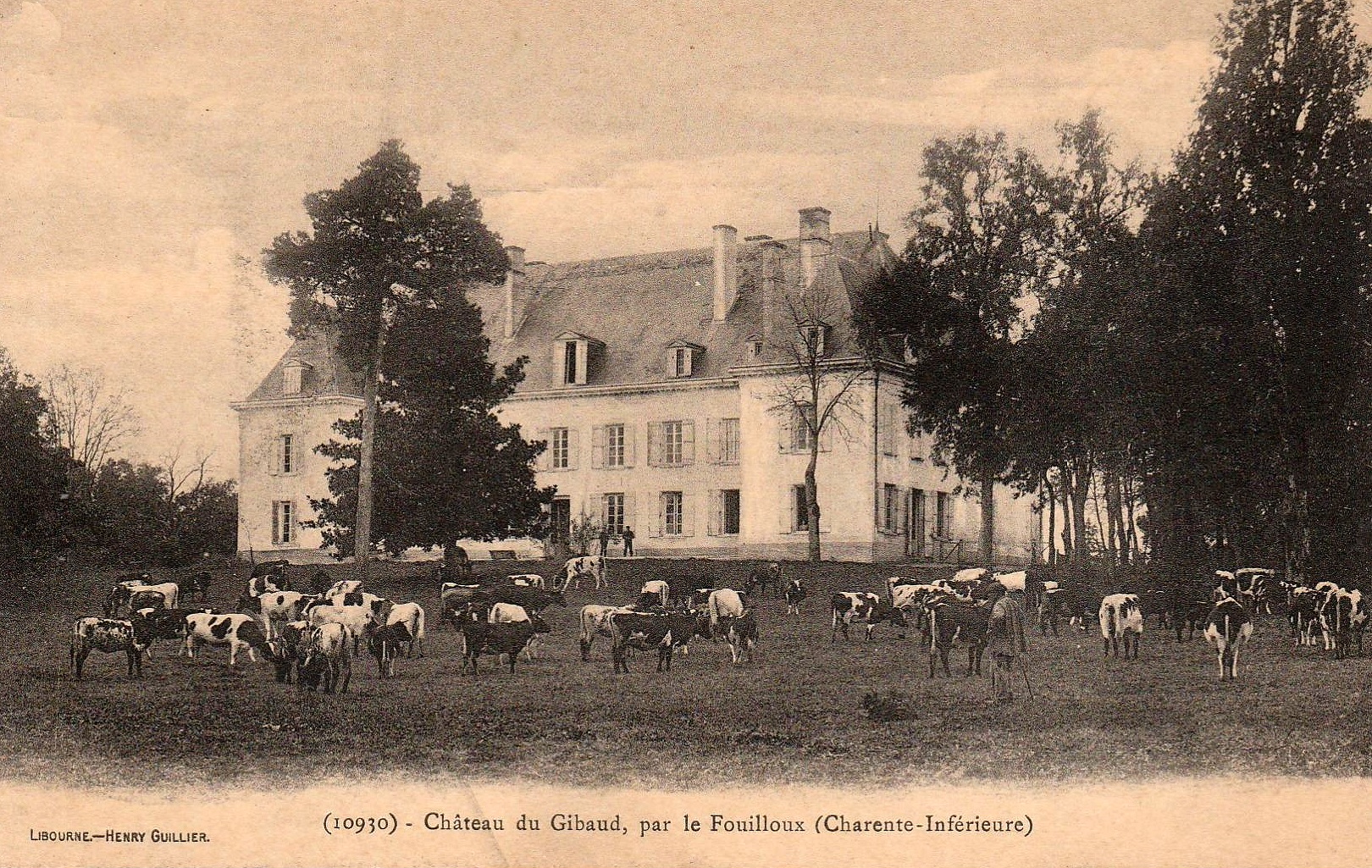
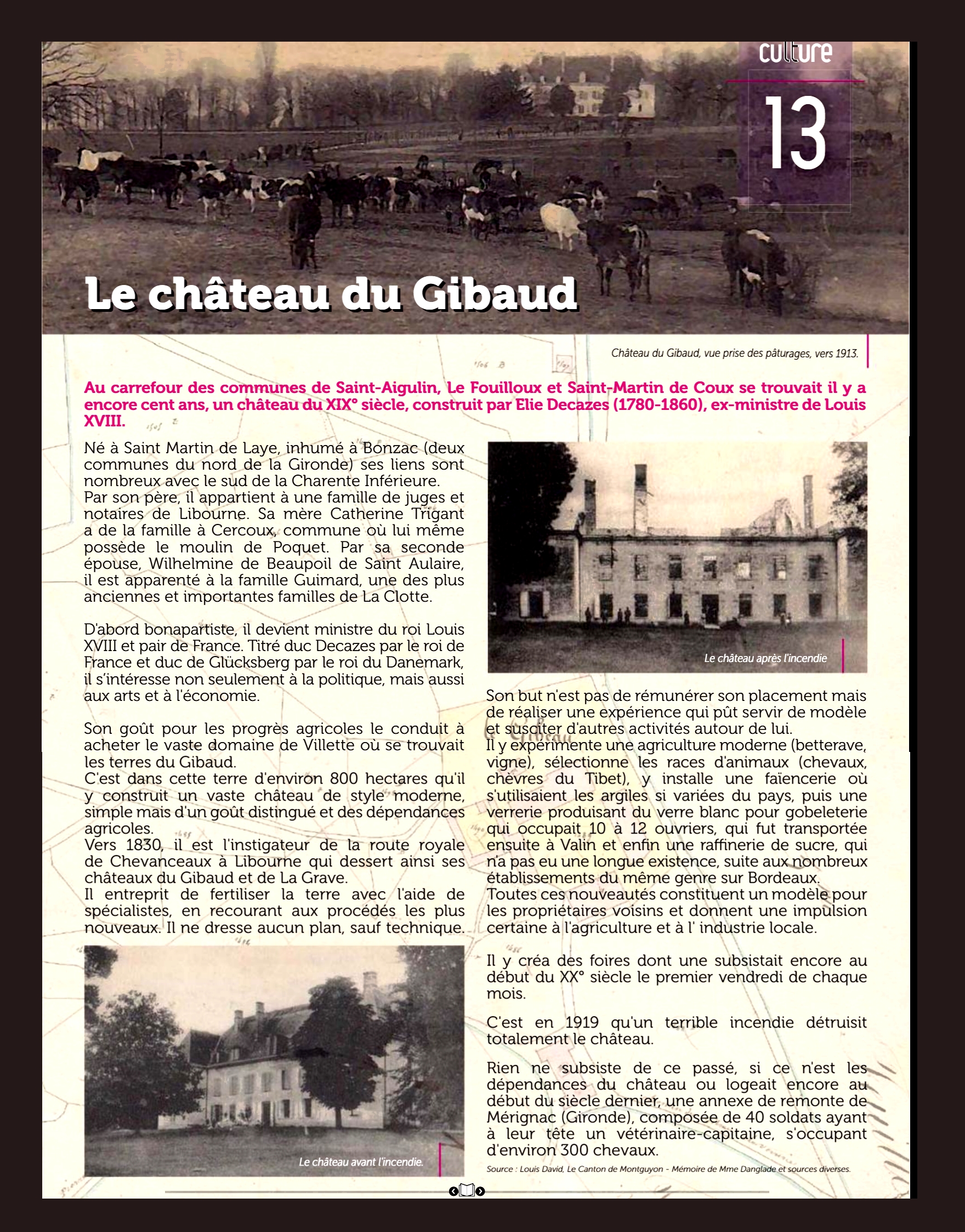 ▲
Bulletin Municipal, Le Petit Aigulinois, hiver 2013-2014, n° 124
▲
Bulletin Municipal, Le Petit Aigulinois, hiver 2013-2014, n° 124
Le
domaine fut
vendu 601.000 francs en 1870
Un
autre château...
▼
celui de La Grave, à Bonzac

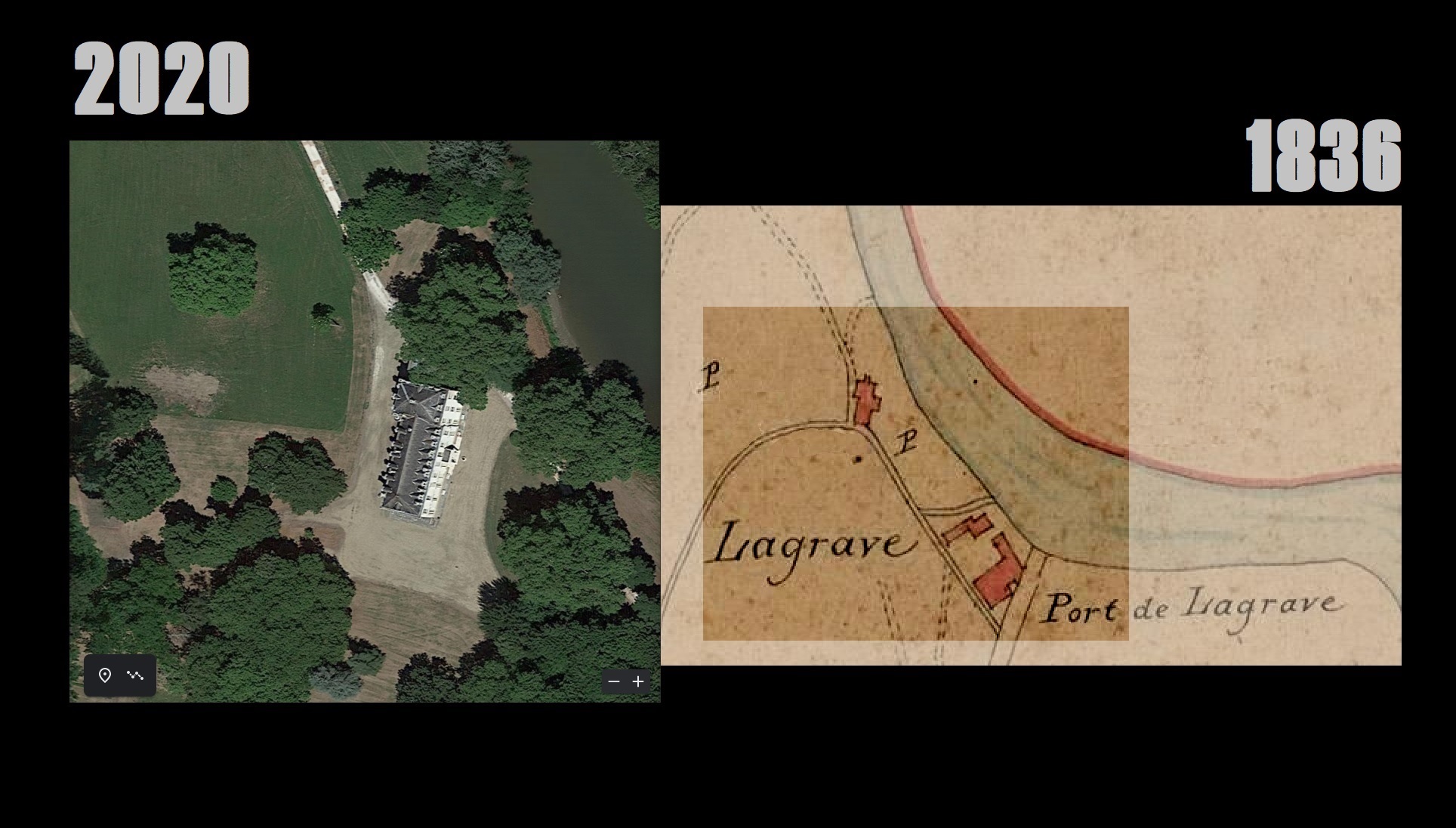


Un
autre château...(ter)
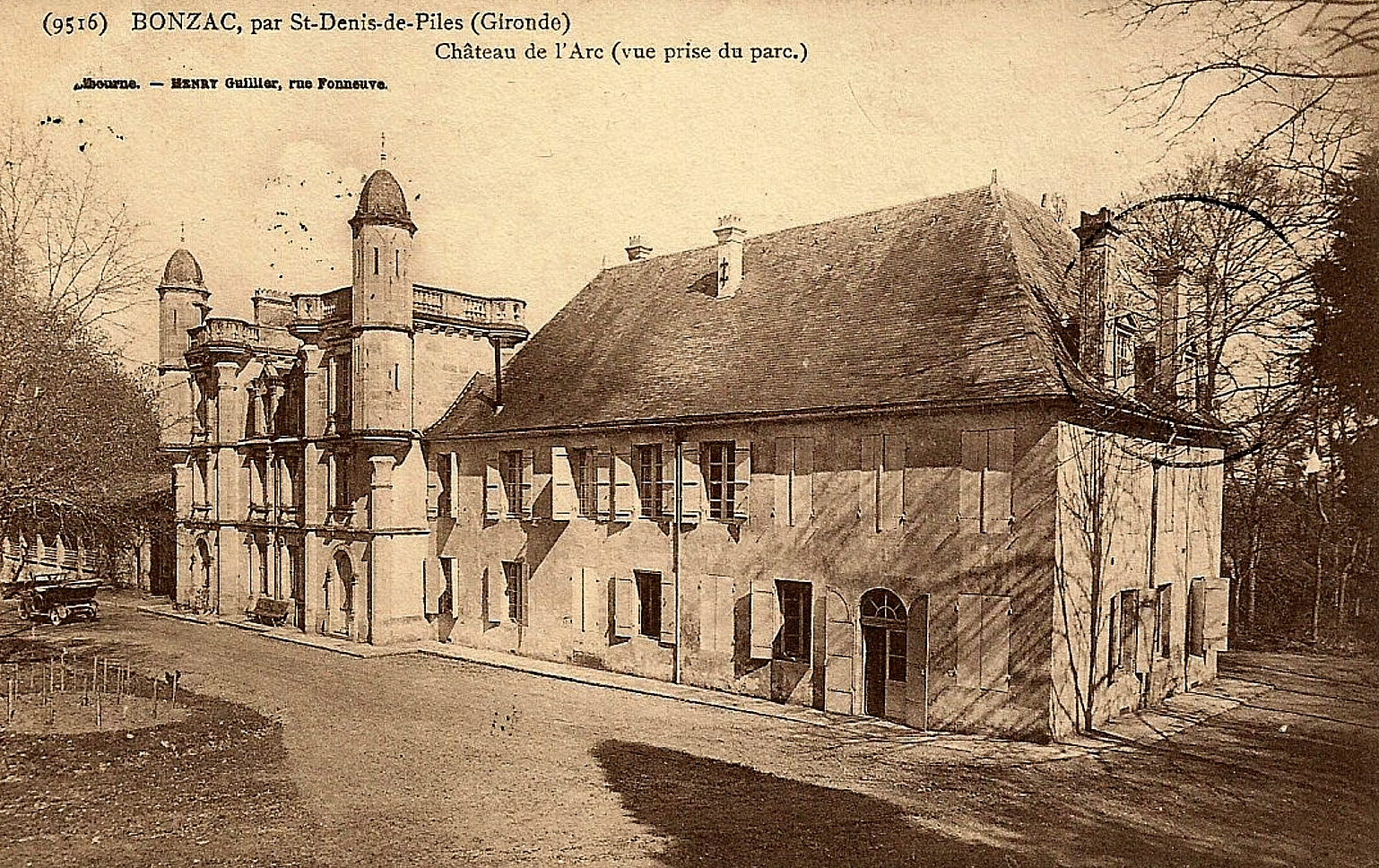 ▲
Château de l'Arc, Bonzac
▲
Château de l'Arc, Bonzac
Un
autre château...(quater)
 ▲
Amy, Oise
▲
Amy, Oise
Le château -détruit- d'Amy, dans
l'Oise, dont on voit ici deux pavillons, était par le jeu d'alliances
propriété de Louis Clair Beaupoil de Saint-Aulaire, qui possédait
également un
château à Etiolles. Il fut ainsi un temps propriété du duc Decazes par
son mariage avec Egédie Beaupoil de Saint-Aulaire.
▼
le château d'Etiolles
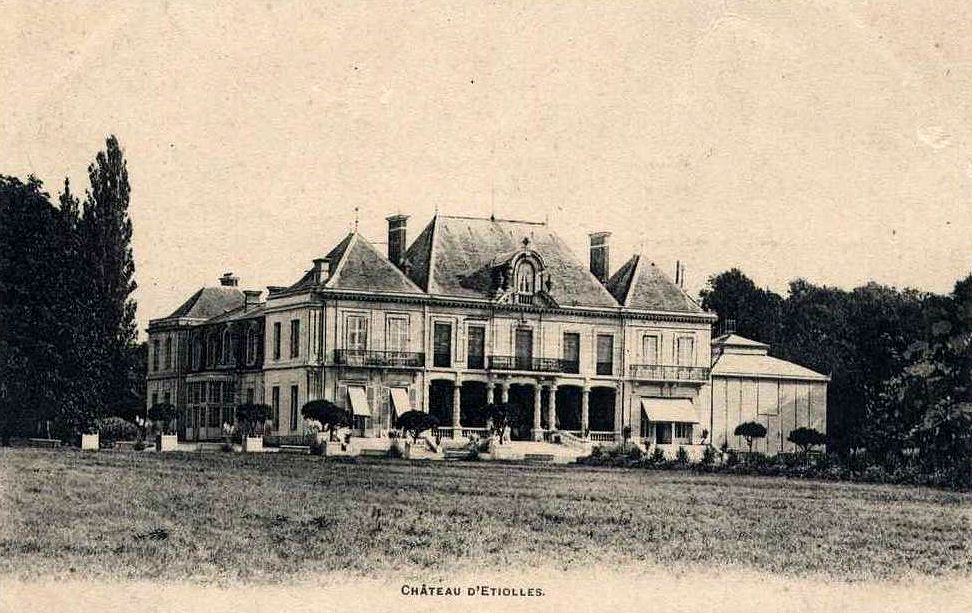
▼
variations sur un thème
On
remarque les armoiries dans la pierre de La Grave
Une
maison
A Libourne, M. Decazes père résidait
rue Ste-Catherine, au numéro 15, aujourd'hui 23 rue Waldecq Rousseau,
après renumérotation en 1974. Elie fera construire
là, vers 1820, cette belle demeure. M. Piola, maire, y résidait vers
1870. (informations Sylvie Rullier, Histoire et
Archives, mairie de Libourne)
un
patrimoine
On dit le duc "notoirement ruiné" en 1830...Est-ce
bien exact ? La lecture de la lettre patente de Charles X relative au
titre de pair du duc peut fortement faire douter de cette ruine. A lire
chapitre 6 ici. Et la
liste que vous découvrirez ne donne qu'une partie des biens du duc.
Premier acte :
Monsieur Decazes, de la Police générale à l'Intérieur

▲ Police générale, 1816
▼ Intérieur, 1819
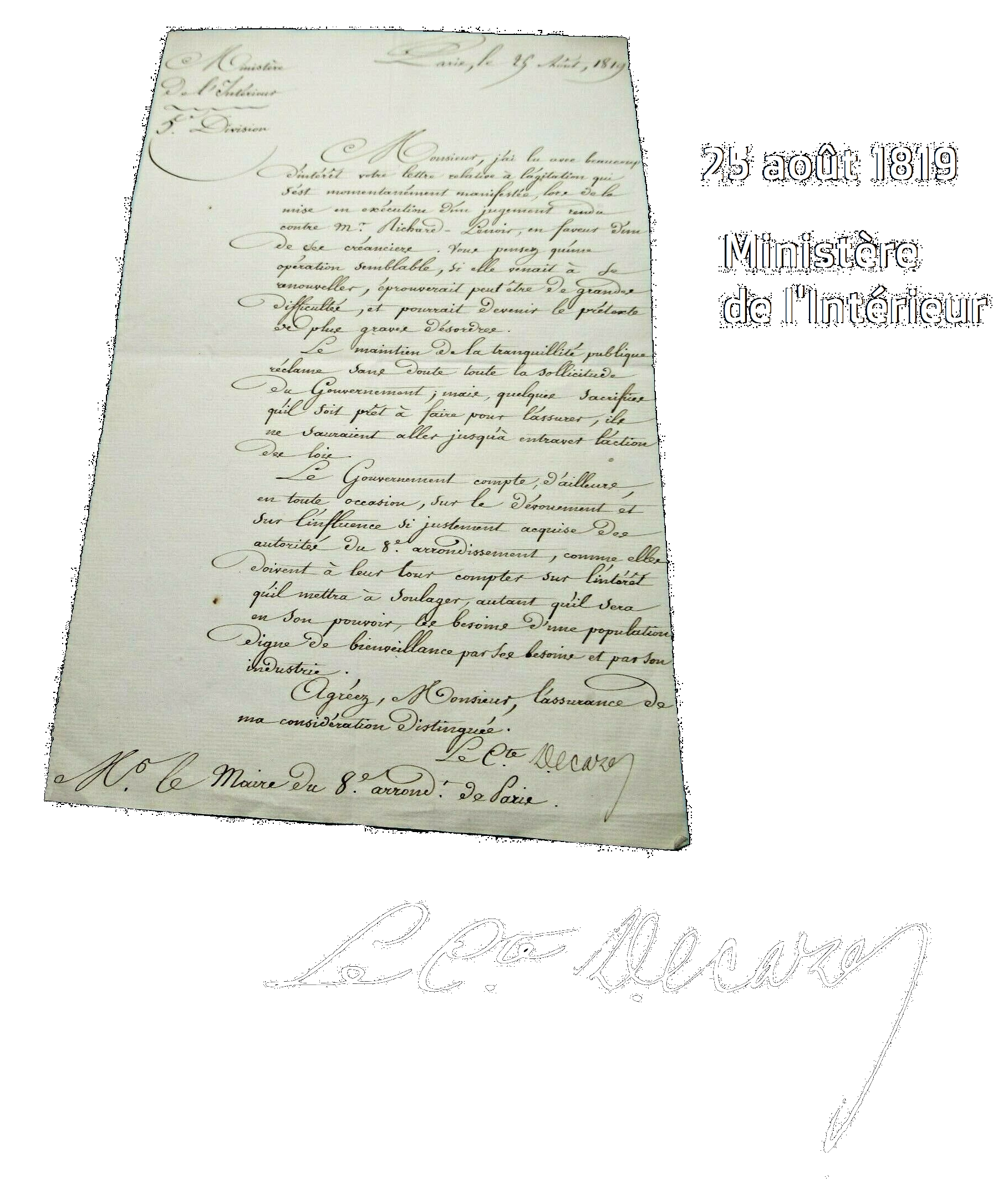 ▲
Ministre de l'Intérieur en 1819, Elie Decazes signe Comte Decazes.
Le
titre de duc de Glücksbierg était danois, donc étranger, et non porté
officiellement pour ces fonctions.
▲
Ministre de l'Intérieur en 1819, Elie Decazes signe Comte Decazes.
Le
titre de duc de Glücksbierg était danois, donc étranger, et non porté
officiellement pour ces fonctions...
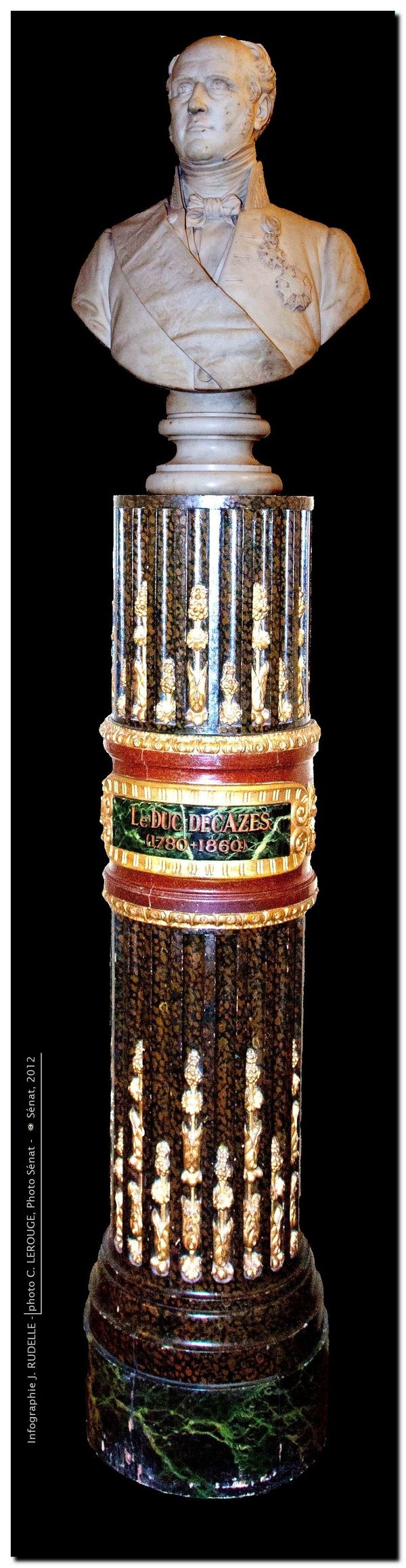 Parmi ceux qui trouvent dans le ministre, ex préfet, ex
secrétaire de madame mère Laetitia, ex…., des raisons de dresser un
portrait aimable, il y a le journaliste qui rapporte ainsi une
description de Decazeville (L'Exposition,
journal de l'industrie et des arts utiles... 1re [et 5e] année.
Année 5 - - 1839-1844, Gallica Bnf ) :
Parmi ceux qui trouvent dans le ministre, ex préfet, ex
secrétaire de madame mère Laetitia, ex…., des raisons de dresser un
portrait aimable, il y a le journaliste qui rapporte ainsi une
description de Decazeville (L'Exposition,
journal de l'industrie et des arts utiles... 1re [et 5e] année.
Année 5 - - 1839-1844, Gallica Bnf ) :
"
En effet, il y a vingt ans à peine, là où l'on compte aujourd'hui une
population de cinq mille âmes, il n'y avait qu'une grange et quelques
pauvres familles aux environs. Cependant on disait vaguement qu'il y
avait dans ce lieu retiré, sous ce sol stérile, de nombreuses couches
de houille, et, dans le terrain houiller lui-même, d'épaisses couches
de minerai de fer. Le duc Decazes, auquel la politique laissait à cette
époque des loisirs après lui avoir imposé durant longtemps des veilles
laborieuses et de dures épreuves, le duc Decazes fit
l'acquisition de cette propriété, et il y fonda l'établissement et la
ville qui portent son nom. On voit donc que si l'ancien ministre de
Louis XVIII est un homme d'État habile et éclairé, un orateur élégant,
un homme du monde d'un esprit éminent et d'une parfaite distinction,
il a aussi quelques droits au titre d'industriel. Le succès, mais non
pas la fortune, couronna tout d'abord l'entreprise du noble pair."
Homme d’Etat habile? Oui assurément ;
élégant et d’une
parfaite distinction ? Le buste du musée des beaux-arts
de
Libourne peut en témoigner, tout comme celui du
Sénat. Le titre d’industriel ? Nous sommes là
un peu sur la
réserve : François Cabrol nous apparaît comme le technicien
métallurgiste de Decazeville: ce n'est pas du tout
Decazes qui fonda Decazeville ; ce fut l'action de Cabrol qui
permettra ce développement, et donc cette fondation... Et pour le
nom, on aurait pu logiquement penser à " Cabrolville ", mais ce fut
Decazeville, pour rendre hommage à l'actionnaire principal ;
c'est en 1833, le 3
novembre, que ce baptême aura lieu : « le village de Lasalle est
distrait de la commune d'Aubin pour former sous le nom de Decazeville
une commune particulière ». Ainsi fut-il décidé par le
ministère. 1833, ce sera bientôt la fin d'une période très
difficile pour les forges.
◄ duc Elie
Decazes,
buste par Crauk
galerie
des bustes, Sénat
Photo
Sénat, Copyright Sénat-2012
Infographie JR
Revenons à notre portrait. Pour ce qui concerne l'évocation
des loisirs de Monsieur Decazes, c’est suite à l’assassinat
en 1820 du duc de Berry par un fanatique opposé aux Bourbons qu’il les
doit…Ministre de l’Intérieur, il eut à assumer les risques de sa
charge. Nous reviendrons plus bas sur cet épisode important.
Parmi les biographies à charge, si
on peut dire, il y a le
Dictionnaire de la conversation et de la lecture : inventaire raisonné
des notions générales les plus indispensables à tous (1867) ... sous la
direction de William Duckett, seconde édition 1868
(Google books, tome 7, page 237-240.)
Dans ce portrait de plusieurs pages, dû sans doute à la plume du
journaliste W. Duckett, car non signé, la charge est forte, très forte
même. Rappelons nous que le duc est décédé en 1860...
Dès le
début, le ton est donné : « ex-secrétaire
des commandements de Madame, mère de l'empereur, ex-conseiller à la
cour d'appel de Paris, ex-volontaire royal, ex-préfet de police,
ex-ministre de la police générale, ex ministre de l'intérieur,
ex-président du conseil, ex-ambassadeur de France à Londres, ex-pair de
France, ex-grand référendaire de la chambre des pairs, chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit, grand officier de la Légion d'Honneur, et
grand croix d'une foule d'ordres étrangers, créé dès 1818, par le roi
de Danemark, duc de Glucksbjerg, (...) né à Saint Martin-de-Laye, près
de Libourne (Gironde), le 8 septembre 1780 ». La litanie
des ex est suffisamment explicite...
Le maître clerc dans l’étude girondine de son procureur de père
va rapidement quitter sa charge et « monter » à Paris
chercher fortune.
Les
historiens curieux de la suite pourront la lire par eux-mêmes dans le Dictionnaire.
Son itinéraire politique va se dessiner concrètement à l'époque de la
Restauration. Préfet de police, très exactement la veille, au
jour près, du retour de Louis XVIII, il va ensuite faciliter la
tâche de ce gouvernement qui aurait pu devenir " réparateur et qui ne fut que violemment
réacteur ".
La suite de cet itinéraire nous éloigne sans doute de nos
préoccupations de chemins miniers, mais n'est pas sans importance
historique. Le procès du maréchal Ney et sa condamnation, sa
dépêche de Ministre de l'Intérieur " Fusillez
les tous " concernant les évènements de Grenoble,
justifient sans doute le mot de Chateaubriand : " le pied lui a glissé dans le sang...
".
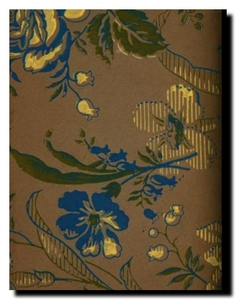
Dès son départ du Ministère de l'Intérieur
après l'assassinat du duc de Berry, est imprimé le Cri des victimes du duc de Cazes, par M.
Clausel de Coussergues, Paris, 1820, (Google Books).
Une extravagance ? En tout cas, une belle couverture de l'exemplaire
de l'Université du Michigan ! La lecture du Cri permet, par
exemple, de suivre son itinéraire à Londres, qui fut bref,
quelques mois : est-ce suffisant pour se donner une vocation
d'entrepreneur ?
Siégeant à l'extrême droite des ultra royalistes, M.
Clausel de Coussergues, député de l'Aveyron, - ce qui aurait
bien pu éloigner à jamais Decazes du Rouergue ! - se fit
remarquer
par son accusation célèbre : "Je
propose à la Chambre de porter un acte d'accusation contre M. Decazes,
ministre de l'Intérieur, comme complice de l'assassinat de monseigneur
le duc de Berry."
Le Député et auteur du Cri,
pamphlet explicatif de son propos, revint sur cet épisode dans un
discours à la Chambre, le 16 juin 1821, et rappelait ainsi le
départ du duc Decazes de son Ministère : "Le
député qui est dans ce moment à cette tribune accusa, le 14 février,
l'homme tout puissant qui dirigeait cette police. Il fut l'organe de la
France entière (Une foule de voix : Non, non, parlez pour vous.).
Le cri universel éloigna ce ministre du palais de nos rois."
(Discours de M. Clausel de
Coussergues, député de l'Aveyron, sur les
fonds secrets de la police, séance du 16 juin 1821, Google Books)
Rien dans le portrait critique du Dictionnaire de la
conversation ne vient souligner l'image de
l'industriel.
"
Rappelé de Londres, (il) se retira donc dans ses terres, où il
chercha à se consoler de sa chute en jouant le rôle de grand seigneur
protecteur de l'agriculture et de l'industrie; rôle qui lui coûta fort
cher et qui lui réussit assez mal, puisqu'il était notoirement ruiné au
moment où éclata la révolution de Juillet ", telle est la
conclusion du Dictionnaire sur cette période de sa vie. Ce parcours
politique connut une certaine suite, sinon un renouveau plus tard, sous
Louis-
Philippe...
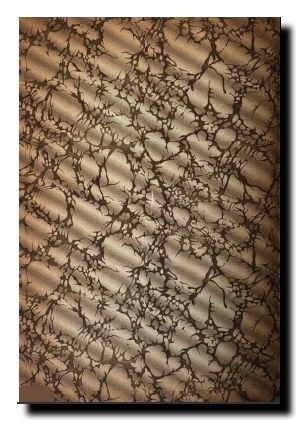
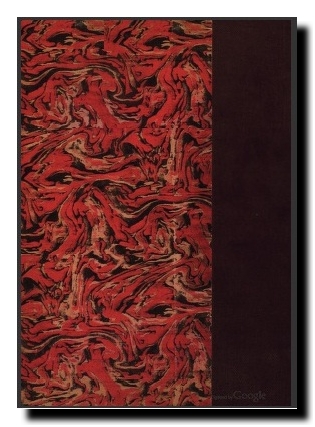
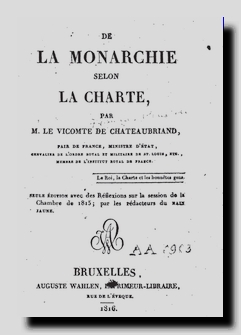
Pour prolonger cette évocation de la
personnalité du duc Decazes, on peut lire le propos de Chateaubriand,
qui a eu souvent, nous allons le découvrir, l'occasion de
s'opposer au duc. Ce propos a été publié dans son fameux
pamphlet contre le ministre de la police, De la Monarchie selon la Charte,
en 1816, à Bruxelles. Il attaquera plus tard Decazes
après l'assassinat du duc de Berry, en février 1820.
Revenons un
instant sur cette disparition qui a provoqué un véritable séisme
politique.
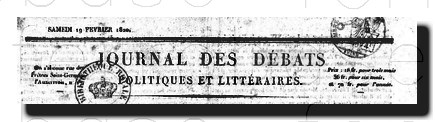
Le dimanche
13 février 1820, le duc de Berry, dernier
dans la lignée des Bourbons est assassiné sur les marches de l'Opéra.
Il décèdera six heures plus tard. Le meurtrier, Louvel, proclame
haut et fort sa haine des Bourbons et déclare avoir agi seul. Le
lendemain, 14 février, le comte Decazes, il n'est pas encore duc, -
sinon duc de Glücksbierg, un titre étranger - ministre secrétaire
d'état au département de l'intérieur, président du conseil des
ministres, annonce officiellement au président de la Chambre des
députés la mort du duc de Berry, neveu du roi (JDD, Journal des
débats, 15/02/1820). L'émotion est évidemment très forte,
et pour
certains, explique l'appel de Clausel de Coussergues, député de
l'Aveyron, à ses collègues, demandant immédiatement la mise en
accusation de Decazes. Rejeté un 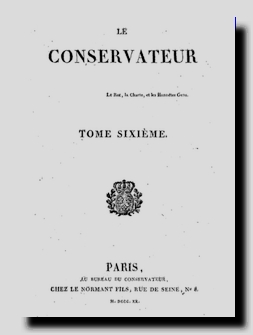 premier
temps pour vice de forme, cet appel va faire des dégâts. Il connaît un
appui dans la position de Chateaubriand, vicomte de son état et
royaliste convaincu, qui publie le 18 février dans son
propre journal, Le Conservateur
(Gallica Bnf, tome 6, 1820), et repris le 19 dans le Journal des débats, un article sans
appel contre Decazes.
premier
temps pour vice de forme, cet appel va faire des dégâts. Il connaît un
appui dans la position de Chateaubriand, vicomte de son état et
royaliste convaincu, qui publie le 18 février dans son
propre journal, Le Conservateur
(Gallica Bnf, tome 6, 1820), et repris le 19 dans le Journal des débats, un article sans
appel contre Decazes.
" La
main qui a porté le coup n'est pas la plus coupable. Ceux qui ont
assassiné Mgr le duc de Berry sont ceux qui, depuis quatre ans.....(
)...Tout est possible sans un ministre, tout est impossible avec lui...
".
La fin de l'article désigne ainsi
nommément le comte Decazes, avec un sens de la formule parfait !
Immédiatement après, sous la signature de Louis Florian Paul de
Kergorlay, député sur la même ligne politique que l'auteur du
Cri, un autre article
appelle à la même démission.
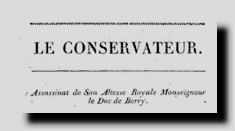
La conclusion sera donnée ce même jour 19 février
1820, à dix heures du soir, peut-on lire, dans le Journal des débats :
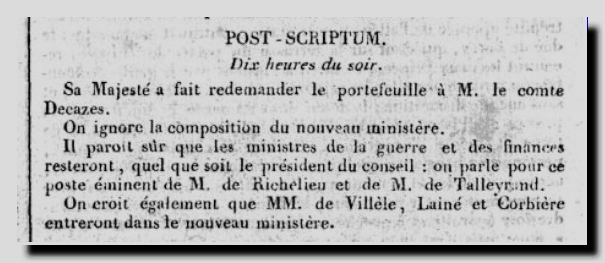
Le lendemain, 20 février 1820, Louis XVIII se résignera à signer les
deux ordonnances suivantes. La première, dans l'ordre du Bulletin des
Lois n° 345 porte le n° 8234. Elle fait le Comte Decazes Ministre
d'Etat et Membre du Conseil Privé. Elle accepte la démission du comte,
président du Conseil pour raison de santé...Ernest Daudet, dans son
ouvrage de référence, n'évoque qu'un rhume, chose finalement assez
commune semble-t-il en février....
La seconde ordonnance, n° 8235, est celle qui fit le
comte duc, lui et ses descendants en ligne directe.
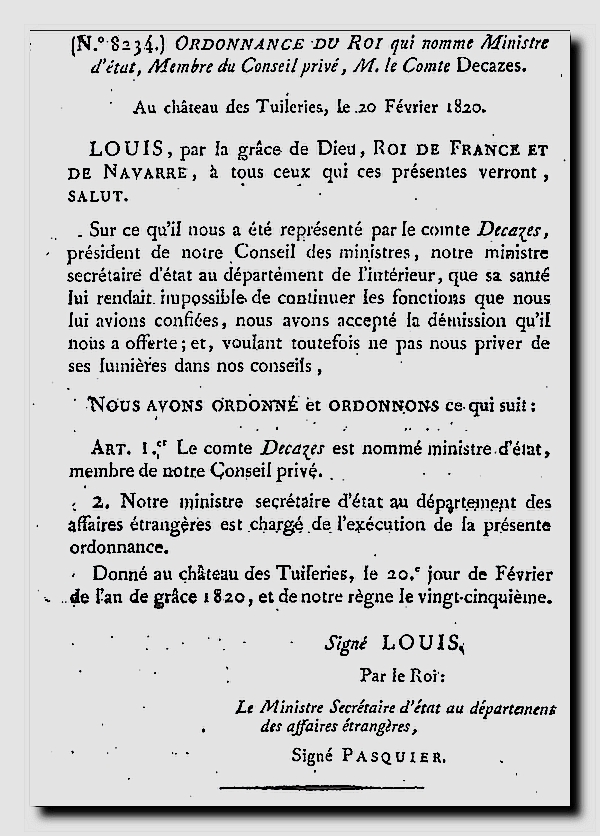
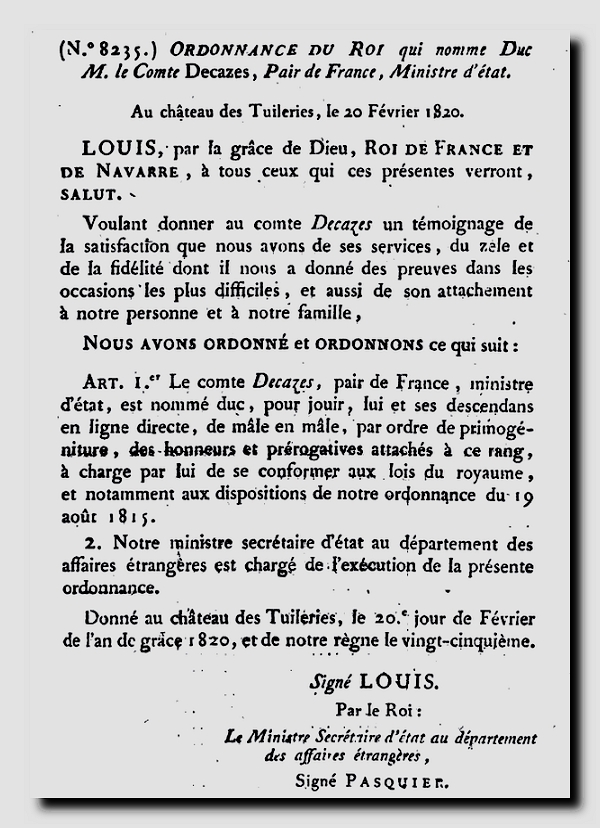
Le
char funèbre du duc de Berry, 1820.
Il
accompagnera Louis XVIII en 1824, et le prince Jérôme Bonaparte en
1860.
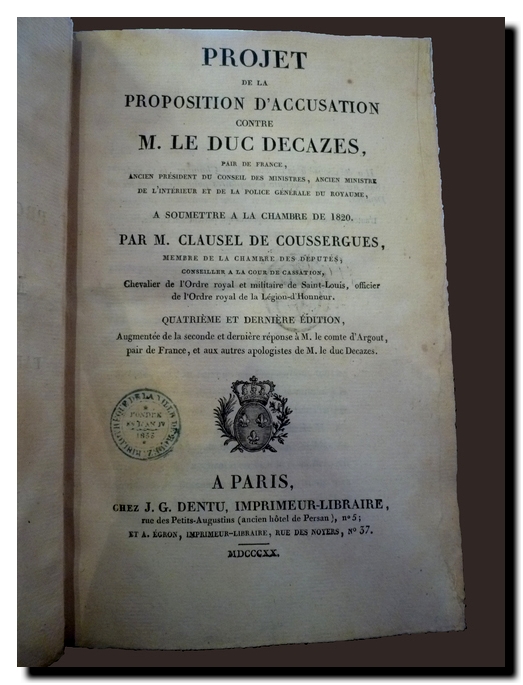
Le groupe des députés ultra-royalistes est donc presque parvenu à ses
fins : écarter, définitivement si possible, le ministre tant
détesté, se rapprocher de Louis XVIII, vieillissant, malade. Il reste
seulement à prendre le pouvoir, les
pouvoirs.
Ce sera une autre histoire que la nôtre, qui s'écrira dans quelques
années, après la mort du monarque en 1824. L'influence du duc ne va pas s'éteindre au soir de ce
19 février. Même absent, ses amis et ennemis s'affronteront en son nom.
Clausel
de Coussergues va développer son argumentation et publier son
Projet d'accusation en 1820. Argumentation et argutie
remplissent les 451 pages ( ! ) de l'ouvrage,
compte tenu des pages annexes. L'auteur s'oppose
également au comte de Saint - Aulaire, beau-père du duc, et au comte
d'Argout, deux des défenseurs de Decazes en ces moments
difficiles.
 Clausel
de Coussergues
Clausel
de Coussergues

membre de la
chambre des députés
Combien de députés ont-ils réellement lu l'exemplaire déposé
pour eux, 250 le furent, à la questure de la Chambre
?
M. Clausel de Coussergues doit son patronyme au village de Coussergues,
près de Rodez. Il repose, décédé le 17 juillet 1846, dans la chapelle
familiale, Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Coussergues. Privée, elle ne
se visite pas : élevée en 1839 et bénite en 1843 par le frère évêque de
Chartres. Pour ne pas rester sur une vision trop connue du bouillant
député Clausel, on pourra par exemple lire les lettres de Mme de
Chateaubriand à son ami rouergat (voir bibliographie, chap 5).
M. Clausel de
Coussergues fut très proche de l'écrivain.

◄ Clausel de Coussergues
Aquarelle par Jean de Nattes
Dessin réalisé vers 1850, donc
après la disparition du député. Le tableau ci-dessous, (Giraldon ?), est sans doute celui
qui inspira Jean de Nattes. Mais il y a quelques différences...
Col
SLSA, Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron
Photographie,
infographie JR
◄ clic
 ◄
clic
Clausel
de Coussergues, coll. part.
inf
Jean Rudelle
◄
clic
Clausel
de Coussergues, coll. part.
inf
Jean Rudelle
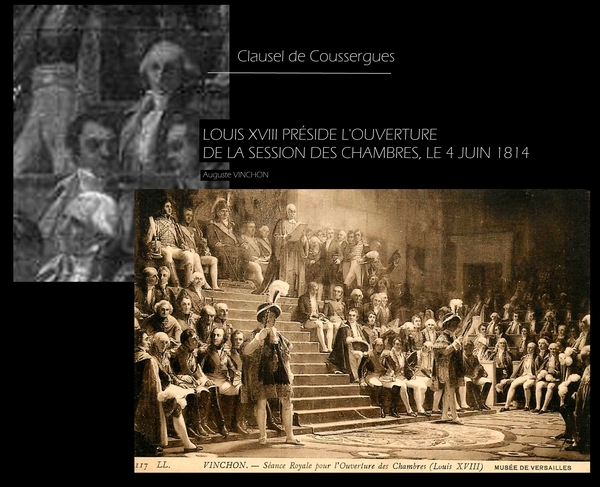 ◄
clic
◄
clic
Le
peintre Vinchon, pour son monumental tableau (5,76 m de large) a
emprunté le portrait
pour représenter Clausel de Coussergues (in lettre
de Clausel de Coussergues fils à Société des lettres, sciences et arts
de l'Aveyron, 15 juillet 1859).
Le député avait été l'un
des rédacteurs de la Charte constitutionnelle de 1814, ci-dessous
▲
acte royal avec son étui et son sceau de cire verte, couleur des actes
à valeur perpétuelle
Les
actes de Louis XVIII de nomination de M. Decazes étaient semblables
A la suite de l'article Decazes,
figure dans
le Dictionnaire de la conversation l'article Decazeville. Il est
amusant de comparer l'image donnée dans le Dictionnaire avec celle
parue dans l'Exposition.
"
Cette localité se réduisait il y a vingt-cinq ans à une simple grange,
qui donnait son nom à la vallée. La renommée disait pourtant qu'il
existait par là des couches de houille d'une puissance inouïe, et dans
le terrain houiller lui-même, comme sur les points les plus favorisés
de l'Angleterre, des couches épaisses de minerai de fer. On montrait
le Lot coulant à deux pas comme une voie navigable, facile à améliorer,
qui devait porter sur le marché de Bordeaux et au loin les produits de
l'usine de fer une fois établie. C'était un Eldorado, disait-on, qui
attendait un conquérant ; ce conquérant fut M. le duc Decazes. Il
attira dans le pays des ingénieurs, des mécaniciens et des ouvriers ;
on se mit à l'œuvre, et l'on constata tout d'abord que la déesse aux
cent voix n'avait rien exagéré. D'innombrables couches de houille
furent découvertes, parmi lesquelles une de 30, 50 et en quelques
endroits même de 75 mètres d'épaisseur. Le minerai de fer dit des
houillères se rencontrait en grande abondance, ainsi que d'autres
minerais, du fer oligiste, du fer hydraté, du fer oolithique, de la
castine et des matières réfractaires, argiles et grès, pour la
construction de l'intérieur des fourneaux. L'usine fut construite par
un habile ingénieur, M. Cabrol, qui en prit la direction. A quelque
temps de là, les chambres votèrent plusieurs millions pour
l'amélioration du Lot ; et cependant l'entreprise demeura plus de dix
ans sans donner aucun produit.
Les
forges de Decazeville sont adossées à un vaste plateau qui les domine
et où s'opèrent les préparations préliminaires des matières premières
telles que la fabrication du coke, le grillage, le cassage, la
trituration et le mélange des minerais. Les transports s'effectuent
par un ensemble de petits chemins de fer débouchant d'innombrables
galeries ou partant de l'orifice de puits desservis par des machines à
vapeur. Au moyen de chemins de fer de niveau, de viaducs, de plans
inclinés, de puits, de souterrains, on arrive à tous les gisements, à
toutes les galeries d'exploitation, quel que soit le niveau où ils se
trouvent situés dans les montagnes voisines. Ces divers travaux ont un
tel développement, qu'il ne faut pas moins de 70 kilomètres de chemin
de fer pour les desservir, et que l'on pose tous les jours des voies
nouvelles. Ils amènent tous les jours à Decazeville cinq cents tonnes
de houille et deux cent cinquante tonnes de minerai cru. Decazeville
possède six hauts fourneaux ; la branche la plus importante de sa
production consiste dans la fabrication des rails ; elle s'élève
jusqu'à
mille deux cents tonnes par mois, sans compter une assez grande
quantité de fers en feuilles et en barres de tous échantillons. La
force qu'on y utilise peut s'estimer à six ou sept cents chevaux
vapeur. C'est sans contredit par sa puissance mécanique et la variété
de ses produits une des plus importantes et des plus complètes usines
de fer que possède la France. "
Pour
compléter ce passage lyrique, il n'est pas sans intérêt de
savoir que cette prose n'est pas du rédacteur du Dictionnaire. C'est un
copier-coller pratiquement intégral d'un passage de l'article -
long - de Michel Chevalier, paru le 30 juillet 1843
dans le Journal des débats, à
la suite de la visite à Decazeville du
duc de Montpensier. L'article complet peut être lu à cette adresse :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k446274z.pleinepage.r=Decazeville.f3.langFR; il montre bien l'atmosphère
particulière des forges.
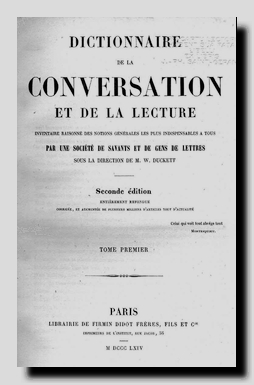
Si le Dictionnaire est donc très critique sur le parcours du duc
Decazes, il rend par contre un hommage appuyé à François Cabrol, dans
son métier d' ingénieur. On peut remarquer enfin que cet article,
publié en 1868, vient au moment où François Cabrol a abandonné
Decazeville depuis huit ans, et à l'époque où la société de Decazes a
laissé la place aux Schneider du Creusot, par la création de la Société
Nouvelle, avec l'arrivée de M. Deseilligny...La faillite était
intervenue en 1865.
L'une des conclusions du
Dictionnaire est forte :
" ...
ministre qui ne sut rien créer, rien organiser, esprit étroit et
vaniteux, cœur dur, sec et égoïste, de l'administration de qui il n'est
resté d'autre souvenir que celui d'un projet de prison spéciale pour
les écrivains ! En 1819 ce projet reçut même un commencement
d'exécution, ainsi que le témoigne un mur digne de la Bastille qu'on
peut encore voir aujourd'hui rue de La Harpe, devant une partie des
bâtiments du lycée de Saint-Louis, auxquels il sert de clôture. On ne
doit nullement savoir gré à M. Decazes de ce tardif retour à la Charte.
S'il se décida à rompre en visière avec les hommes dans les rangs
desquels il avait conquis sa position, et à faire rentrer le pouvoir
dans les voies de la légalité, après avoir tant contribué lui-même à
l'en faire sortir, il y fut poussé bien plus par le besoin de sa propre
conservation ministérielle que par son respect pour les lois ou par son
amour pour les libertés publiques."
Voici un autre portrait de
Decazes : Biographie des hommes du
jour, Germain Sarrut et B. Saint-Edme, T1, Paris, Krabe, 1835; Decazes,
p 22-34. (Google Books )
Justice, Vérité, Impartialité,
sont les principes directeurs de la Biographie:
" Pour nous, narrateurs impartiaux, nous
dirons les faits, nous ne dirons que les faits avérés..."
Avec de telles affirmations, nous pouvons espérer quelque impartialité
pour l'homme qui fut l'un des plus puissants de l ' époque, sinon
le plus puissant.
Decazes, sera le quatrième portrait, pages 22
à 34. Bien que placé à cette place d'honneur, il n'a pas droit à
une gravure ; oubli (bien sûr que non ! ) regrettable, car
celles de la Biographie sont remarquables de vérité !
C'est donc une démonstration, (exacte ? ) du zèle
royaliste de Elie Decazes. Après avoir rappelé la fortune familiale,
assise par l'achat que fit le père d'Elie à la nation du château et
de la terre de Fronsac, révolutionnairement confisqués et vendus en
1793, l'enfance d'Elie et ses études à Vendôme précèdent l'exposé
d'une carrière politique tourmentée. On souligne l'action de Decazes
à l'occasion de l'arrestation du maréchal Ney, et sa condamnation.
Fait comte par ordonnance du roi le 27 janvier 1816, la Biographie
rappelle également les évènements tragiques de Grenoble, sans
toutefois citer le fameux " fusillez
les " attribué au Ministre qu'était alors Elie Decazes. Il sera
fait pair le 31 janvier 1818.
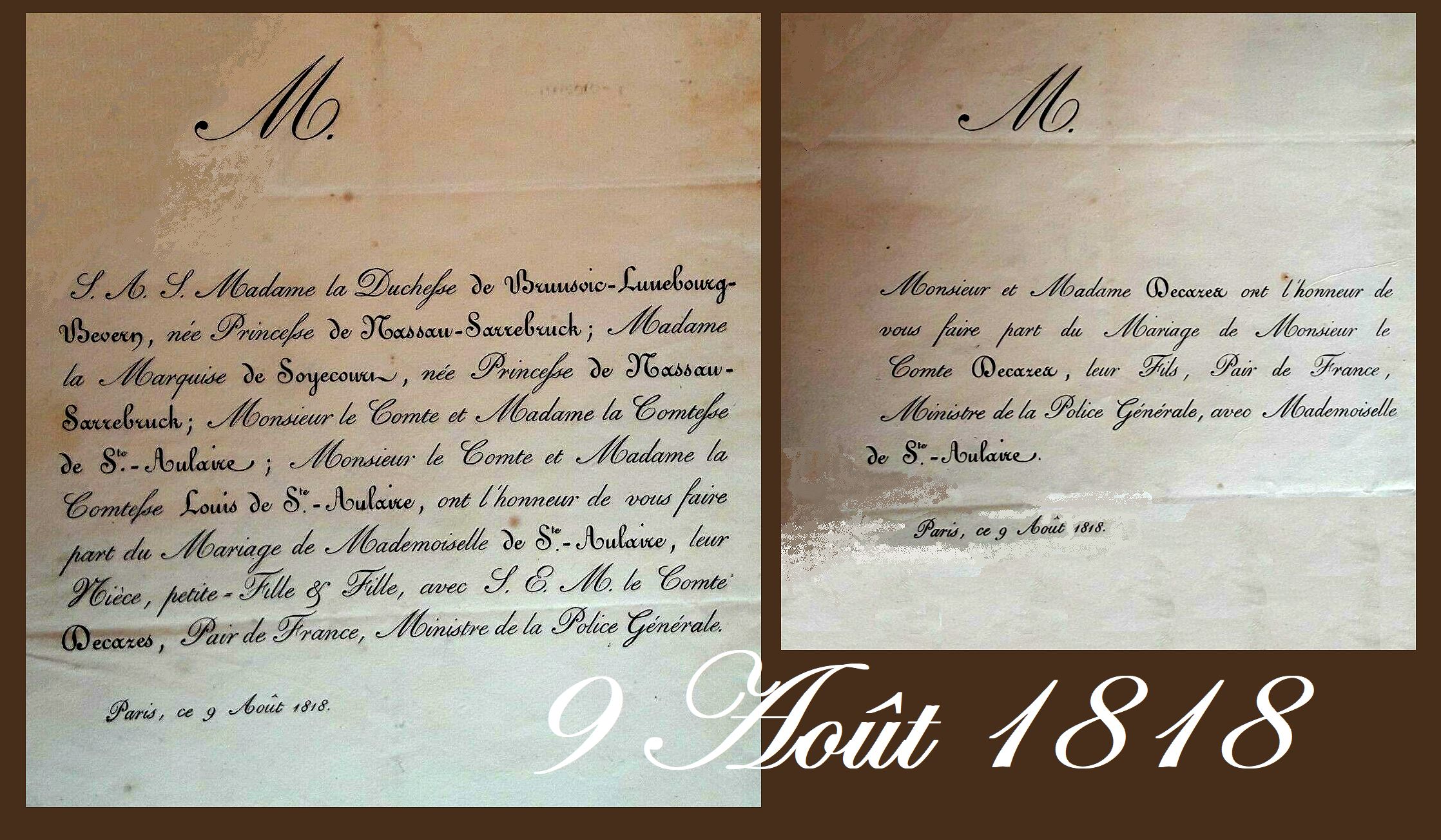 ▲
mariage, deux princesses dans le faire-part d'Egédie...
▲
mariage, deux princesses dans le faire-part d'Egédie...
Le
biographe termine par ce passage: "
telle a été la carrière parcourue par cet homme, ennemi de la liberté
de la presse et de la liberté des citoyens,(...), grand spéculateur en
chef de complots imaginaires...".
La Biographie et ses 918
pages offre bien d'autres portraits. Il y a
par exemple celui du comte d'Argout. Celui qui sera un des premiers
actionnaires de Decazeville, est présenté comme " un
des plus zélés et des plus constants adversaires du parti patriote ; il
appartient à la coterie Pasquier, Decazes et compagnie ..."
On peut y lire le portrait du marquis de Sémonville,
également actionnaire des débuts : "
Le vieux marquis...est sans contredit l'un des membres de la chambre
haute qui, à toutes les phases de nos quarante années de révolution, se
sont toujours faits remarquer par la souplesse avec laquelle ils ont su
dans toutes les circonstances flatter le pouvoir, quel qu'il fût, qui
ont toujours placé l'intérêt de leur vanité et de leur ambition avant
l'intérêt du pays."
Ces trois biographies ne mentionnent aucune activité des
intéressés dans le domaine industriel... et on aura peut-être compris que la
Biographie n'a pas de sympathie particulière pour Decazes et ses
amis.

 ▲
Glücksburg ? C'est là !
▲
Glücksburg ? C'est là !
 Place
Decazes, Libourne
Place
Decazes, Libourne
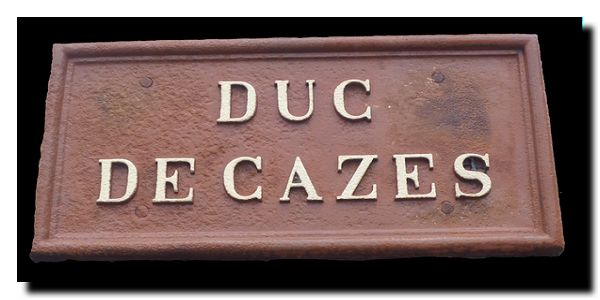 à
Decazeville, Decazes ou de Cazes ? On peut hésiter !
à
Decazeville, Decazes ou de Cazes ? On peut hésiter !
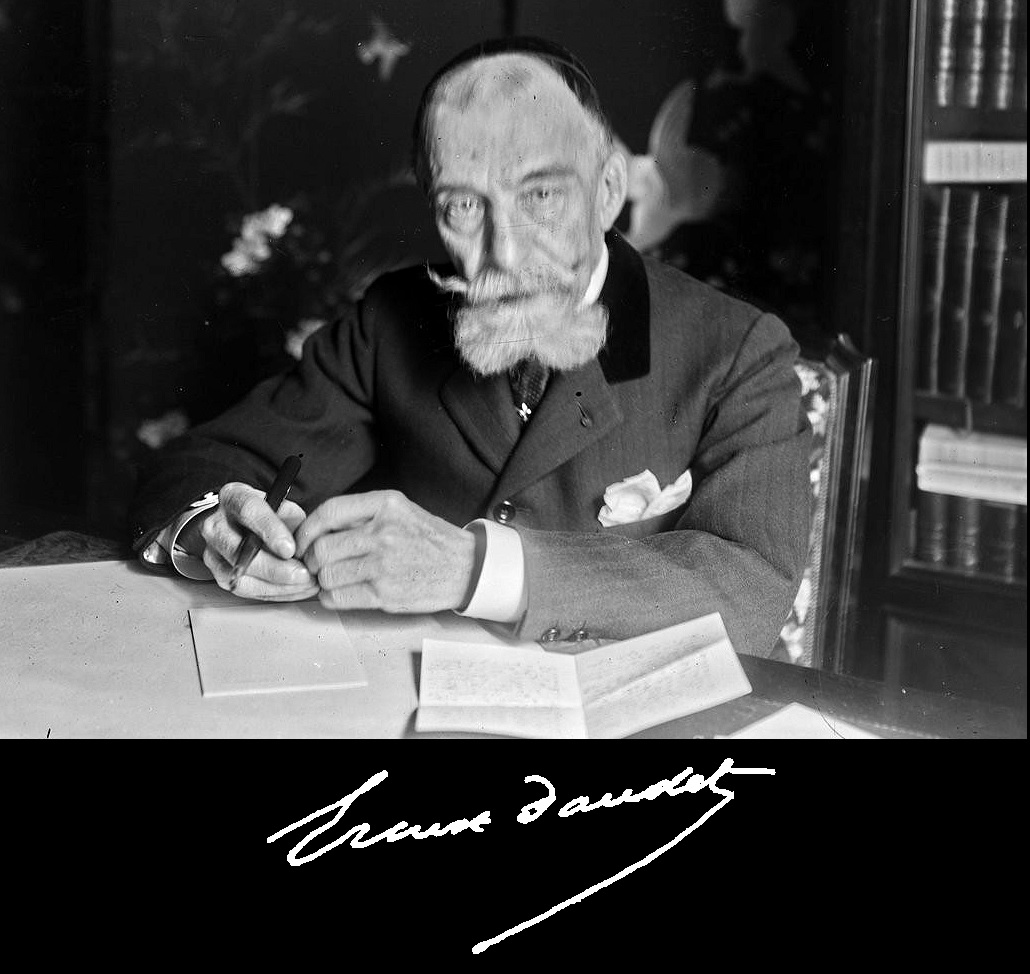 ▲
Ernest Daudet, Gallica
▼
Ernest Daudet, Album Mariani
▲
Ernest Daudet, Gallica
▼
Ernest Daudet, Album Mariani
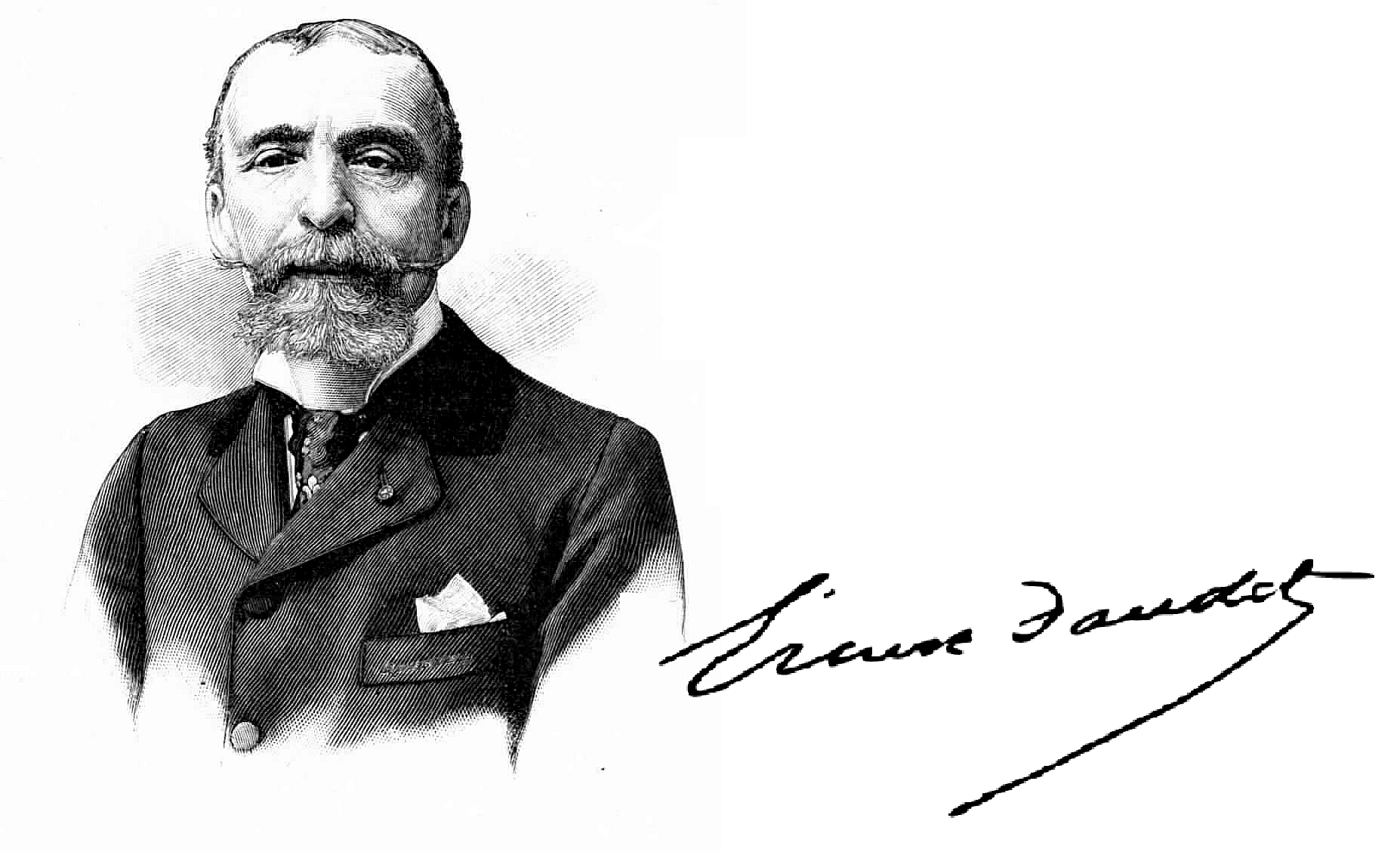
* Ernest Daudet est (peut-être) l'auteur
du catalogue des archives de La Grave, voir plus bas sur cette page,
Archives de la Grave, sans date, Catalogue, 496 pages
Né en 1780 et élevé dans la bourgeoisie de Libourne, chez son
parrain, le jeune Elie fit ses études à Vendôme : elles ne sont pas
commentées par Daudet... Vers 1800, sa famille le voit devenir acteur.
En fait de théâtre, il sera, nous semble-t-il, plus facilement
auteur ! Parti à Paris, " puisque la
fortune ne descend pas chercher "
ses élus, il étudie le droit et sera " homme de loi " puis
avocat. Il n'y a pas un mot dans le travail de Daudet sur les
activités de Elie dans le cabinet de son père à Libourne...
Elie Decazes va épouser en 1805
Mademoiselle Muraire, dont le père est premier
Président de la cour de cassation. C'est ce beau père qui va
faciliter l'entrée d'Elie au service de la mère de l'empereur, et
ce mariage sera bien sûr une occasion pour Elie de rencontrer la
fortune, l'autre, à défaut pour le moment de richesse.
Il faut souligner l’importance, pour la carrière d’Elie
Decazes, de ce mariage avec Elisabeth Muraire. Quelques indications
supplémentaires ne sont pas sans intérêt pour comprendre cette bonne
fortune. Lorsque
le mariage eut lieu, le 5 août 1805, ou le 1er, suivant
d’autres
sources, Monsieur Muraire était un grand dignitaire : comte de
l’Empire,
conseiller d’Etat, premier président à la cour de Cassation, grand
officier de la Légion d’honneur.
Il sera
grand croix de l’ordre de la Réunion.
Il
avait assumé des responsabilités de maire, président de district et
député du
Var... Et nous ne sommes pas exhaustif dans cette énumération !
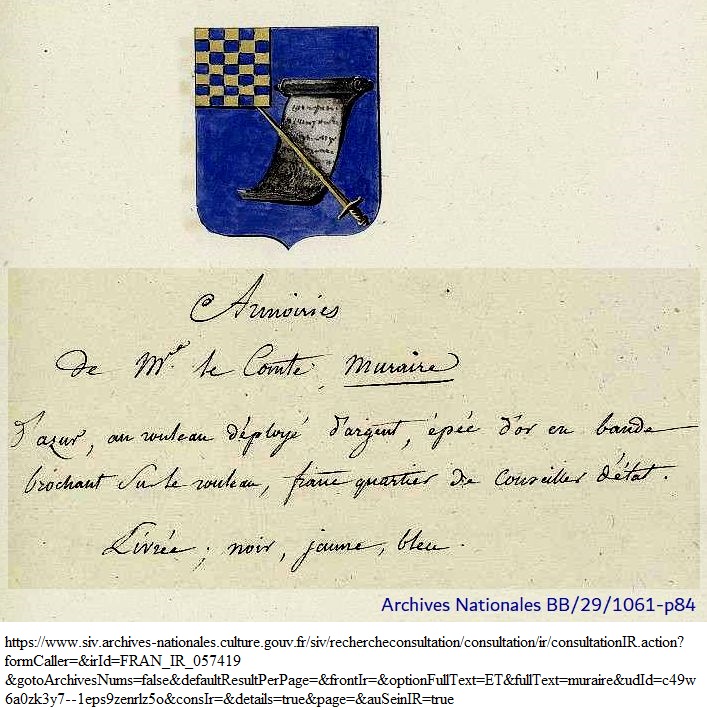
Mademoiselle
Muraire avait une sœur jumelle, Victoire, qui 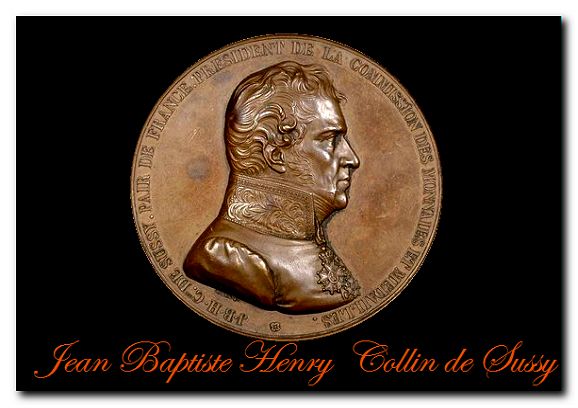 se marie la même année à 15 ans
à
Jean Baptiste Henry Collin de Sussy. Le beau frère d’Elie sera plus
tard comte
et à l’origine du musée de la Monnaie à Paris. Plus important que le
beau-frère dans ce
cercle familial, le père de ce beau-frère, le comte de Sussy. Il a laissé son nom dans l’histoire comme directeur
général des douanes, (il l’était en 1805), puis plus tard président de
la cour
des comptes. Il sera en 1812 un ministre du commerce de Napoléon. Ces
indications nous montrent que le jeune juge, si bien entouré, va
pouvoir
relativement vite gravir quelques échelons dans l’appareil de la
justice. Ce
comte de Sussy sera fait pair sur la proposition d’Elie Decazes lors
des
nominations de la « fournée » de mars 1819 et Elie Decazes
soutiendra
son beau père Honoré Muraire lorsque celui-ci connaîtra quelques
difficultés
dans les années agitées qui vont suivre.
se marie la même année à 15 ans
à
Jean Baptiste Henry Collin de Sussy. Le beau frère d’Elie sera plus
tard comte
et à l’origine du musée de la Monnaie à Paris. Plus important que le
beau-frère dans ce
cercle familial, le père de ce beau-frère, le comte de Sussy. Il a laissé son nom dans l’histoire comme directeur
général des douanes, (il l’était en 1805), puis plus tard président de
la cour
des comptes. Il sera en 1812 un ministre du commerce de Napoléon. Ces
indications nous montrent que le jeune juge, si bien entouré, va
pouvoir
relativement vite gravir quelques échelons dans l’appareil de la
justice. Ce
comte de Sussy sera fait pair sur la proposition d’Elie Decazes lors
des
nominations de la « fournée » de mars 1819 et Elie Decazes
soutiendra
son beau père Honoré Muraire lorsque celui-ci connaîtra quelques
difficultés
dans les années agitées qui vont suivre.
Sa jeune épouse décède le 24 janvier 1806.
Une
« Tenue de deuil » sera organisée par la loge maçonnique
d’Anacréon à
laquelle appartenaient Honoré Muraire et Elie Decazes. Elisabeth
Decazes était
également membre d’une loge. Le site « Musée
virtuel de la musique
maçonnique » évoque cette Tenue. Il y a donc, dès ce
mois d’août
1805 un véritable tourbillon dans lequel Elie Decazes trouvera les
éléments de
sa future réussite. Ce même site, (http://mvmm.org/c/docs/decazes.html),
permet
également, par un renvoi, de lire dans Le Globe, une revue maçonnique, une biographie du duc, dans laquelle les
aspects maçonniques indiqués permettent une approche plus complète de
sa
personnalité.

Dans les débuts, il sera donc juge et même
président des assises à Paris. Le lendemain des Cent Jours sera
une ère de faveur pour Elie Decazes, qui saura tirer avantage de son
écartement passé décidé par Napoléon. Passons sur les
circonstances ... Avec Fouché comme ministre ( ! ), il sera préfet de
police de Paris, la veille même, stricto sensu, de l'entrée de
Louis XVIII dans Paris. Il va devoir composer avec des républicains,
bien disposés à résister, et des bonapartistes pour qui le coup
de main est l'objectif. Son ministre est de plus dès le début son
ennemi déclaré. Parmi ses opposants, il y a aussi et déjà à cette
époque Chateaubriand. L'épisode du maréchal Ney est évidemment décrit
longuement par Daudet.
Devenu Ministre de la Police dans le gouvernement Richelieu, il va le
rester pendant les trois ans de ce ministère, avant de remplacer le duc
Richelieu en 1818.
Les élections de 1815, la Chambre Introuvable, amènent à
Paris une majorité d'ultra-royalistes, violents, vindicatifs,
opposés au régime constitutionnel que soutiennent Elie Decazes et
Richelieu. " La marche du ministère
est difficile parce qu'il navigue entre deux écueils " écrit
Decazes, " nos ennemis sont nos amis",
(nov 1816). Ou, " nous,
(le ministère Richelieu Decazes), soutenons les
intérêts moraux révolutionnaires ", précise Decazes, qui prête
le propos accusateur à Chateaubriand.
La dissolution de cette chambre, constamment opposée à tous les
projets, sera un objectif pour Decazes, objectif dont il va avoir à
convaincre le duc de Richelieu et le roi Louis XVIII. Ce sera plus
difficile pour ce dernier, mais l'objectif est atteint le 5 septembre
1816. L'opposition de Chateaubriand, orale et écrite, des
ultras, des royalistes, de la famille royale, et de tous ceux qui se
voyaient bien aux pouvoirs, n'y étant pas, sera dès lors constante :
si le roi n'avait eu une si forte sympathie pour Decazes, il n'aurait
bien sûr pu se maintenir. Pour ce qui est de l'illustre
écrivain, il va être rayé par le roi de la liste des ministres
d'Etat. Toute honorifique que ce soit, cette position importait à
Chateaubriand qui, déçu de ne pouvoir accéder au pouvoir politique par
un poste de ministre, va devenir, contraint ou forcé, l'égal
des plus exaltés ultra-royalistes : ses écrits deviennent violents
envers Decazes.
Ci-dessus, portrait duc Decazes, carte
Gironde, Vuillemin
Mémoires
d'Outre-Tombe (T4) : ces quelques lignes de Chateaubriand
sont
sans doute excessives, évoquant l'objet, l'esclave, le favori, de
Louis
XVIII
Buste de Louis
XVIII, musée des beaux-arts de Libourne.
"
L'artiste avec ce portrait sculpé all'antica transforme discrètement
la présence physique du roi vieillissant en portrait antique très
imposant idéalisant les traits du roi et le transformant en portrait
allégorique. Il s'éloigne d'un simple portrait individuel exprimant
ainsi la puissance politique du modèle et l'autorisant ainsi à entrer
dans la postérité. Le portrait dans sa nudité antique et intemporelle
se détache des normes classiques et officielles...."
Musée des beaux-arts,
Libourne, notice
Ecole française, XIX ème siècle
Plâtre, H.63cm,L.39 cm,Ep.31 cm
Envoi de l'Etat en 1836
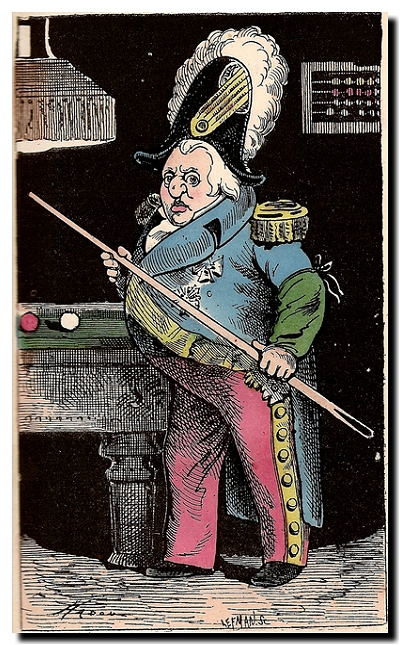
Le roi Louis XVIII fut bien sûr la cible de très nombreux
caricaturistes. Voici un trait d'humour, avec ce dessin de P. Hadol (Touchatout, Histoire
de France tintamarresque, L'Eclipse, Paris, 1872) ; tout est à
prendre, au moins,
au second degré : les deux balles rouge et blanche, le thème du
billard, ou les demi-manches de protection...
◄ La duchesse Decazes,
née Egédie Beaupoil de Saint-Aulaire,
et son fils Louis,
miniature sur ivoire, d'après Isabey
Il existe d'autres miniatures
d'Egédie de Saint-Aulaire par Isabey. En 1818 par exemple. Egédie, qui
a seize ans, en offre une à Elie avant son mariage. Voir ci-dessous.
 ▲
Egédie Saint-Aulaire, par Isabey
(DR,
casa Necchi Campiglio, Milan)
▲
Egédie Saint-Aulaire, par Isabey
(DR,
casa Necchi Campiglio, Milan)
1818,
à trente huit ans, ce sera l'année du second
mariage du comte Decazes. Son précédent mariage est relativement
lointain. Voulu par
Louis XVIII et Mme Princeteau soeur de Elie, qui dirige la maison
parisienne du ministre, le choix se porte sur Mademoiselle de
Saint-Aulaire. Le comte de Saint-Aulaire sera plus tard en 1826 du
cercle très restreint des premiers actionnaires des Houillères et
Forges. Sur pression de la tante de la future duchesse, la
duchesse de Brunswick, qui ne voulait que d'un duc pour sa petite
nièce, le roi du Danemark fit Elie Decazes duc de Glücksbierg, seul
titre de duc créé dans ce royaume... Le titre danois, duc de Glücksbierg, fut transféré et porté par son
premier fils Louis, du vivant du duc Elie Decazes.. Le mariage
fut grandiose, les 10 et 11 août
1818. Les souvenirs de la jeune duchesse, alors âgée de seize ans, sont
rapportés dans le texte de Daudet. L'écrivain rapporte
également les lettres que Louis XVIII n'arrêtait pas de faire
porter au duc, " son fils bien aimé ".
Dans ces échanges, le tutoiement est de rigueur entre le roi et Decazes
(mais non pour l'inverse ! ) et Ernest Daudet montre bien les liens
très étroits qui sont alors ceux entre le roi et son ministre
ou son épouse, " ma fille bien
aimée ".
Il semble évident que le roi en 1818 fait toute confiance à Decazes
pour la conduite des affaires du pays, en luttant constamment contre
son frère, futur Charles X, et son neveu par exemple, le comte de
Berry. L'opposition
de ces derniers ne fait que s'accroître devant l'étoile qu'est
devenu Elie Decazes, " voulant
nationaliser la royauté et royaliser la France " selon ses
dires.
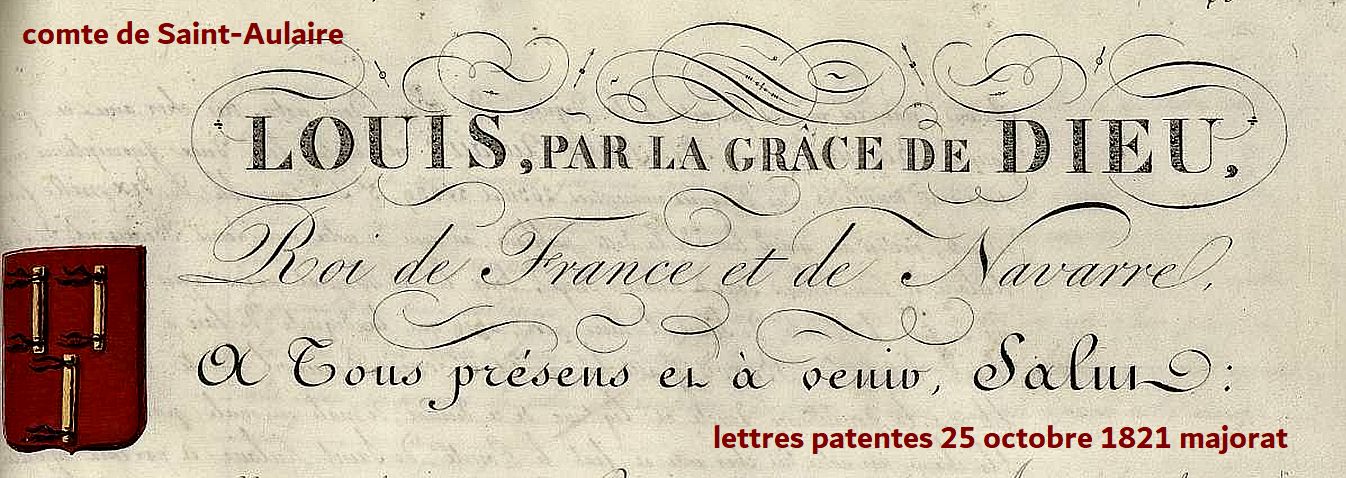
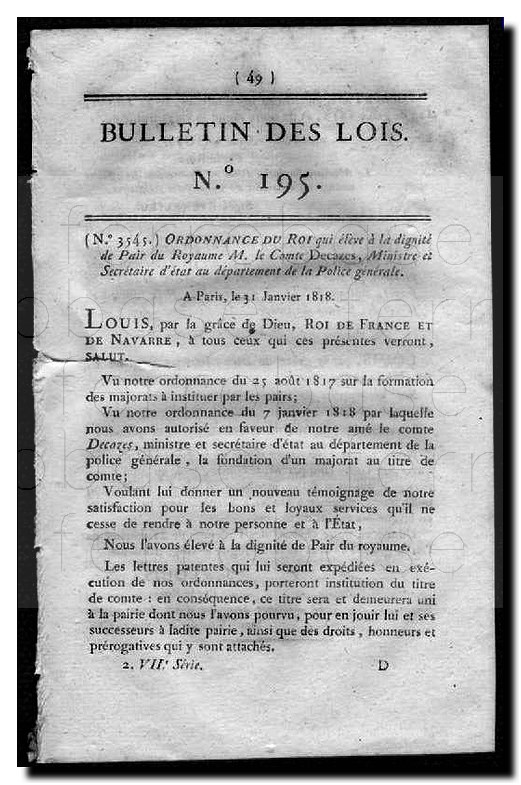
En 1819, le ministère de la police est supprimé, selon le vœu même de
Decazes, qui devient l'élément essentiel du nouveau cabinet Dessoles
- Decazes, comme ministre de l'intérieur. En novembre de cette année
1819, il accède enfin à la présidence du Conseil, la
première marche, tout en restant ministre. A gauche comme à
droite, c'est l'opposition la plus totale, contre celui qui possède
une telle influence sur le roi. Le Journal des débats, à droite, en
fait une cible permanente. En janvier 1820, on le traite de Catilina,
ce qui n'est pas un compliment, ou de charlatan politique....
Decazes aurait bien voulu semble-t-il quitter ce poste, mais le duc
Richelieu n'était pas encore prêt à reprendre du service, à côté, ou
sous le regard de
cet ami devenu politiquement assez encombrant.
13 février 1820, Paris s'amuse. Enfin, une partie du monde,
comme on
dit, est à l'Opéra, à cette époque salle
Montansier, disparue et aujourd'hui square Louvrois. Ce n'est pas
le cas de Decazes. Le ministre
travaille lorsqu'à onze heures du soir, on lui amène la
nouvelle : le
duc de Berry, le dernier des bourbons, neveu de Louis XVIII et un
des ses nombreux ennemis affichés, est assassiné sur les
marches de
l'Opéra. Il décèdera six heures plus tard. Au
cours du trajet qui le
conduit sur place, le ministre de l'intérieur et
président du
conseil aura cette phrase "
nous sommes tous assassinés ".
Il voyait juste, très juste ! En quelques jours, le destin de la France
changera de mains, et la destinée de Decazes bascule.
Au delà du drame, c'est un séisme politique, et au milieu de la
faille, le ministre, bien seul, soumis on le devine, à toutes les
attaques. Rappelons simplement l'opposition du député aveyronnais
Clausel de Coussergues, ultra parmi les ultra, demandant
immédiatement à la Chambre la mise en accusation pour traîtrise (
! ) du président du conseil, et lui faisant porter toute la
responsabilité de l'assassinat. On se souvient aussi du mot de
Chateaubriand : " les pieds lui ont
glissé dans le sang, il est tombé
". Ce propos serait d'ailleurs repris d'un article du 14 février
d'Alphonse Martainville. Directeur du Drapeau Blanc, journal (plus que)
monarchiste. Louis XVIII, dans ses Mémoires (par le duc de D***, T12, Paris 1833,
Archive.org), cite nommément le journaliste et non
l'écrivain.
Le 26 février 1820, le duc, la duchesse, le petit Louis, et la soeur du
duc quittaient discrètement Paris pour la Gironde, un exil obligé, et
voulu par Richelieu, qui ne désirait pas voir Decazes à ses cotés dans
cette période très troublée. Decazes ne reviendra que le 22 juin, et
sera à Londres le 13 juillet, pour honorer quelque temps ses fonctions
d'ambassadeur. Sur la route, il fit une pause à Beauvais, chez
son ami le préfet de Germiny, un actionnaire futur des Houillères.
L'histoire connaît des rencontres curieuses : c'est Chateaubriand
que Louis XVIII enverra à Londres pour remplacer son adversaire
désormais déchu le duc Decazes à l'ambassade...Peut-on imaginer les
détails de la rencontre ? A -t-elle seulement eu lieu ? Peut-on
imaginer une telle rencontre, le duc Decazes souhaitant la
bienvenue à Monsieur Chat-Briand, ainsi
nommé par M. Decazes dans une lettre de 1817 ?
Vous aviez peut-être gardé le
souvenir suivant de l'écrivain,
"
le seul mot de chevalerie, le seul nom d'un illustre chevalier, est
proprement une merveille, que tous les détails ne peuvent surpasser
" (Génie du Christianisme, 1803) ; il faut bien reconnaître que
quinze
ans plus tard, les beaux principes de chevalerie ne sont pas ou plus
d'actualité...
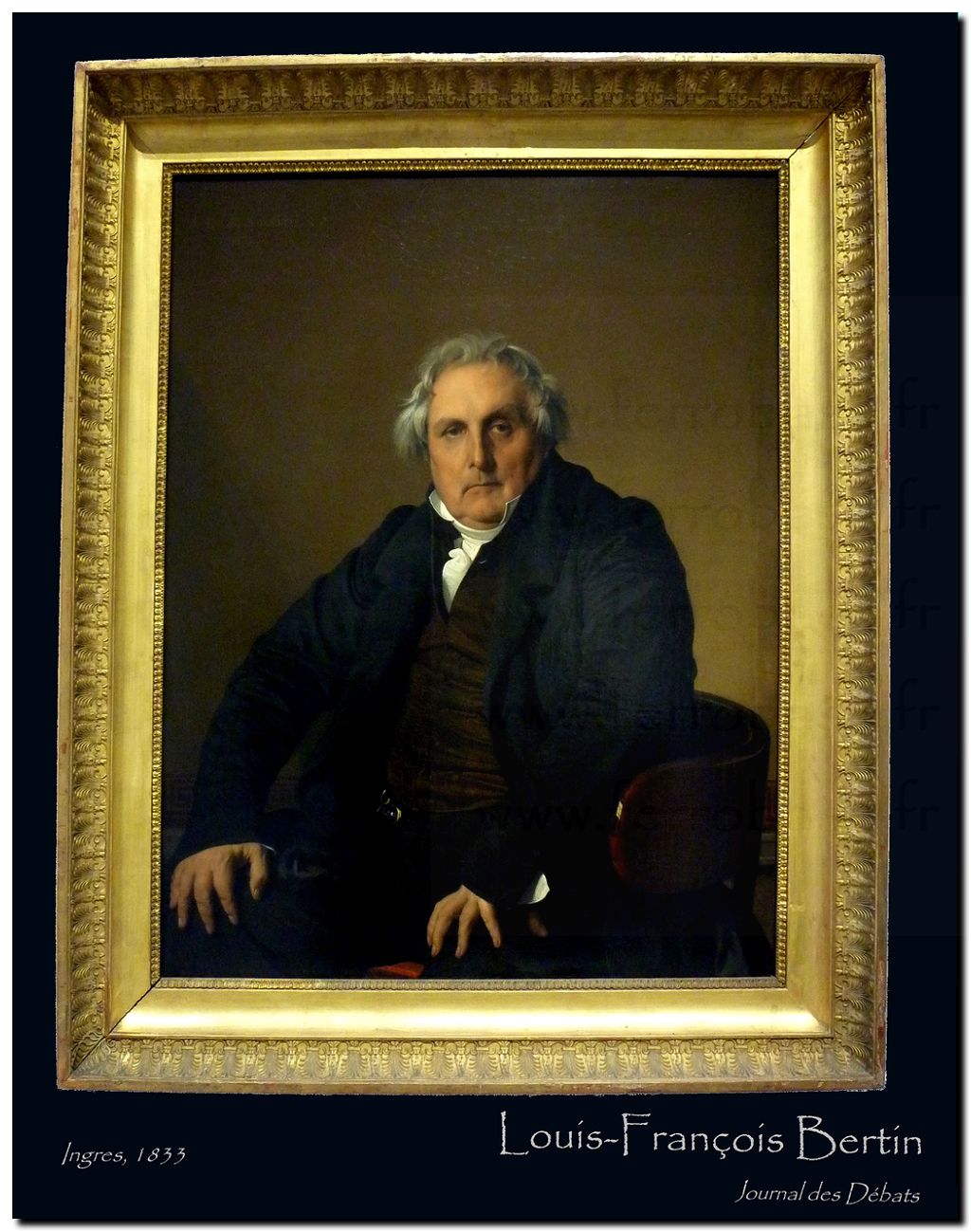
Voici
Bertin, l'un
des adversaires permanents du duc, "Buonaparte d'antichambre"
( ! ) La posture peinte par Ingres montre
une forte personnalité ! Ce journaliste a fondé le Journal des
Débats. Parmi les collaborateurs, Chateaubriand. L'article présenté est
très sévère :
"la
main qui a porté le coup n'est pas la plus coupable. Ceux qui ont
assassiné Mgr le duc de Berry sont ceux qui, depuis quatre ans,
établissent dans la monarchie des lois démocratiques...."
JDD, 19 février 1820
vicomte de Chateaubriand
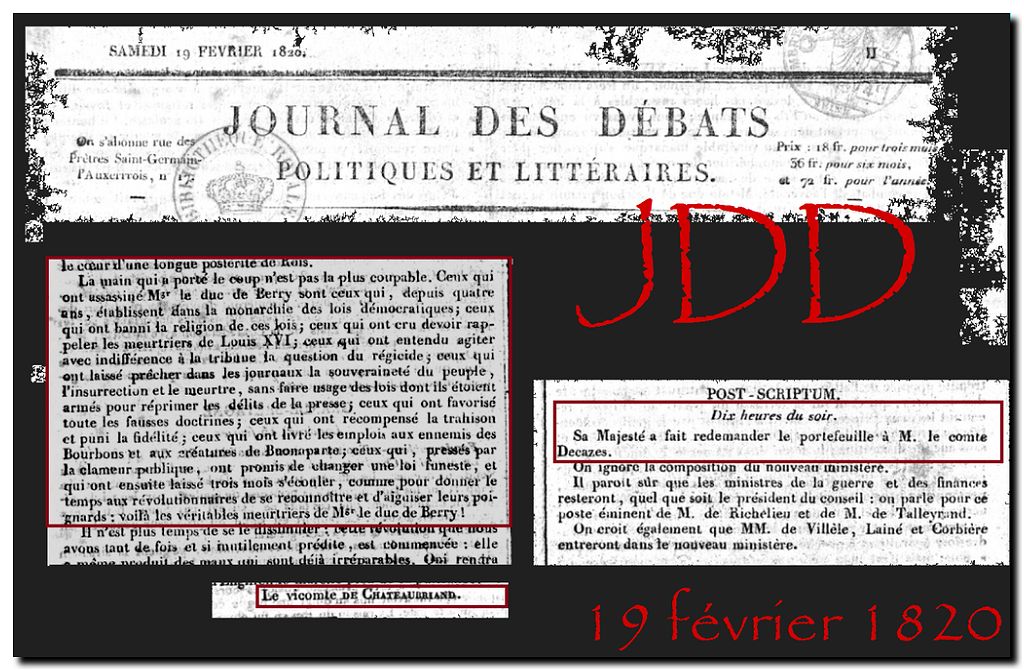
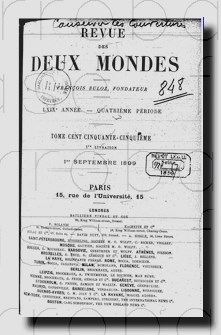
La suite ? La Revue des deux mondes, période 4, tome
155, 1899-10 (1899-09, Gallica Bnf)
présentera, toujours sous la signature de Ernest Daudet,
l'ambassade
du duc Decazes à Londres, brève, mais pas sans effet
direct pour
l'Aveyron, ses mines, et le fer de Mondalazac. C'est au cours de ce
bref séjour, de quelques mois, que François Cabrol
rencontre,
dit-on, le duc. On connaît presque la suite ! Le portrait
très
détaillé que fait donc Ernest Daudet de Decazes, dans ses
relations
avec Louis XVIII, dépeint un duc royaliste certes, mais
plutôt modéré,
et ayant constamment utilisé la conciliation. Mais il n'y a
aucune tace d'une rencontre Cabrol-Decazes. Nous pensons d'ailleurs
qu'ils ne furent jamais ensemble chez les grands bretons...
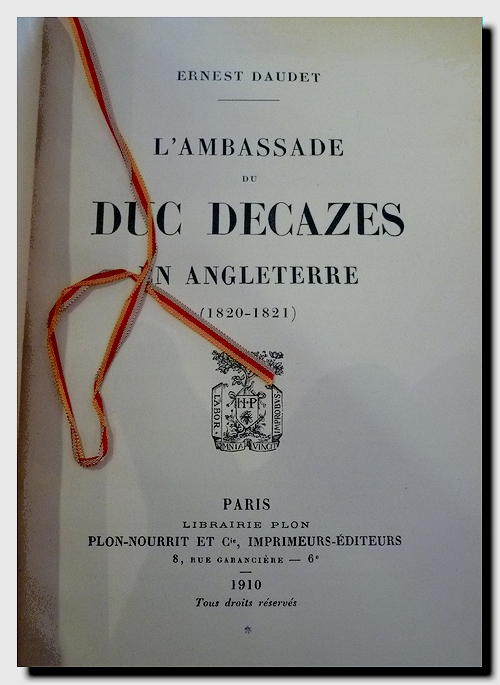
Nous avons recherché, vainement, dans les textes de Daudet cette
rencontre de
Londres : 348 pages de lectures. C'est du Daudet, et issu, comme
le texte précédent, de ses consultations des archives de la famille
Decazes. Après quelques chapitres " parisiens ", le duc et la
duchesse Egédie sont présentés dans leur ambassade, un bâtiment triste,
à Londres.
Après un accueil qui nous paraît tenir plus de la curiosité que d'un
véritable intérêt de la part de la cour anglaise, le duc aura à
tenir compte de la situation locale, très confuse : le roi
George IV est alors en procés de divorce avec son épouse.
Les
ambassades étrangères présentes à Londres semblent seulement
faire semblant d'accueillir le duc.
C'est à Londres, le 4 octobre 1820, que la nouvelle de la
naissance du duc de Bordeaux, fils du défunt duc de Berry
va lui parvenir, par, entre autres, les courriers du roi Louis
XVIII.
Mais rapidement les ennuis s'accumulent : une distance certaine
commence à se faire jour avec le roi, et Decazes, qui la redoute,
voudrait
bien revenir à Paris prendre sa défense, ce que le roi lui défend, en
lui intimant assez dûrement de faire son métier d'ambassadeur. Il
sent bien une montée de l'influence des ultras, dans laquelle il a
tout à perdre...
Ses relations avec son
ministre, Pasquier ne sont pas vraiment excellentes, et surtout,
la santé de la duchesse est au plus bas. Un changement d'air est
inévitable, et le retour du duc, duchesse et petit Louis
s'effectue début mars 1821.
Le texte de Ernest Daudet, très documenté, et pour cause,
ne dit pas un mot, pas une phrase, sur l'intérêt qu'aurait pû
manifester le duc Decazes pour l'industrie anglaise, et
particulièrement la métallurgie. Pas un mot sur une rencontre avec
François Cabrol....Bien sûr, au moment où Daudet écrit son texte, il
n'est pas sans connaître l'itinéraire du duc qui va investir, plutôt
que s'investir personnellement, dans le Rouergue. C'est donc
très sûrement une volonté de l'auteur de ne rapporter que des
faits de société et ou politiques, en écartant toute intrusion
dans les affaires personnelles de la famille, industrie ou agriculture.
Le roi Louis XVIII a lui même commenté le départ du duc de son poste de
ministre dans ses lettres, lettres privées, mais également
dans ses mémoires, de
manière plus officielle. Et là, son humour est assez remarquable,
lorsqu'il
évoque par exemple le " deuil
général au château " à l'annonce de la nomination de duc :
Le roi n'a
rien oublié de son action : les récompenses, comprendre une forte "dot",
près de un million de francs, la nomination comme
ministre d'Etat, membre du conseil privé, duc, pair
de France et ambassadeur.
Cette galerie de portraits, que nous aurions pu prolonger, nous
décrit les personnes et quelques intérêts divers de cette époque. Mais
rien ne vient évoquer l'arrivée du duc dans l'Aveyron. Rien, ou
plutôt presque rien...car les hommes sont presque tous en place,
et l'arrivée du duc est déjà programmée...malgré lui !
Le
duc Decazes a inspiré beaucoup de graveurs et de peintres. Le
portrait ci-dessus est très commun. Inspiré du tableau de Gérard,
la date portée, 1828, est celle de la gravure. En bas à
droite, on peut découvrir la signature du duc. Ce portrait, (infographie JR) appartient à une
famille qui
sera liée plus tard à celle du duc Decazes.
► amusant
: ces portraits furent au préalable publiés dans des fascicules
séparés. Le portrait d'Elie Decazes, était ainsi inclus dans les X et
XI ème livaisons, comme l'indique le Journal de l'imprimerie d'octobre
1829. On relèvera dans la liste, Charles X, Madame la Dauphine, la
duchesse de Berri et le duc, qui se seraient évidemment bien passés de
la compagnie du duc...Est-ce volontaire de la part de l'éditeur ?
▼
Duc Decazes
Lithographie de Delpech d'après un dessin, 1828, de Louis Dupré
Tirée de Iconographie des Contemporains, Delpech, 1832
Deux versions, parmi d'autres, dont
à droite une coloration d'époque (1842) à la main, de cette lithographie
qui reprend (inversée) la peinture de Gérard, présentée en début de
page.
Biblioteca Digital Hispanica et
https://biblio.com.au/book/decazes-portrait-elie-duc-decazes-delpech/d/1322997268
clic pour
agrandir
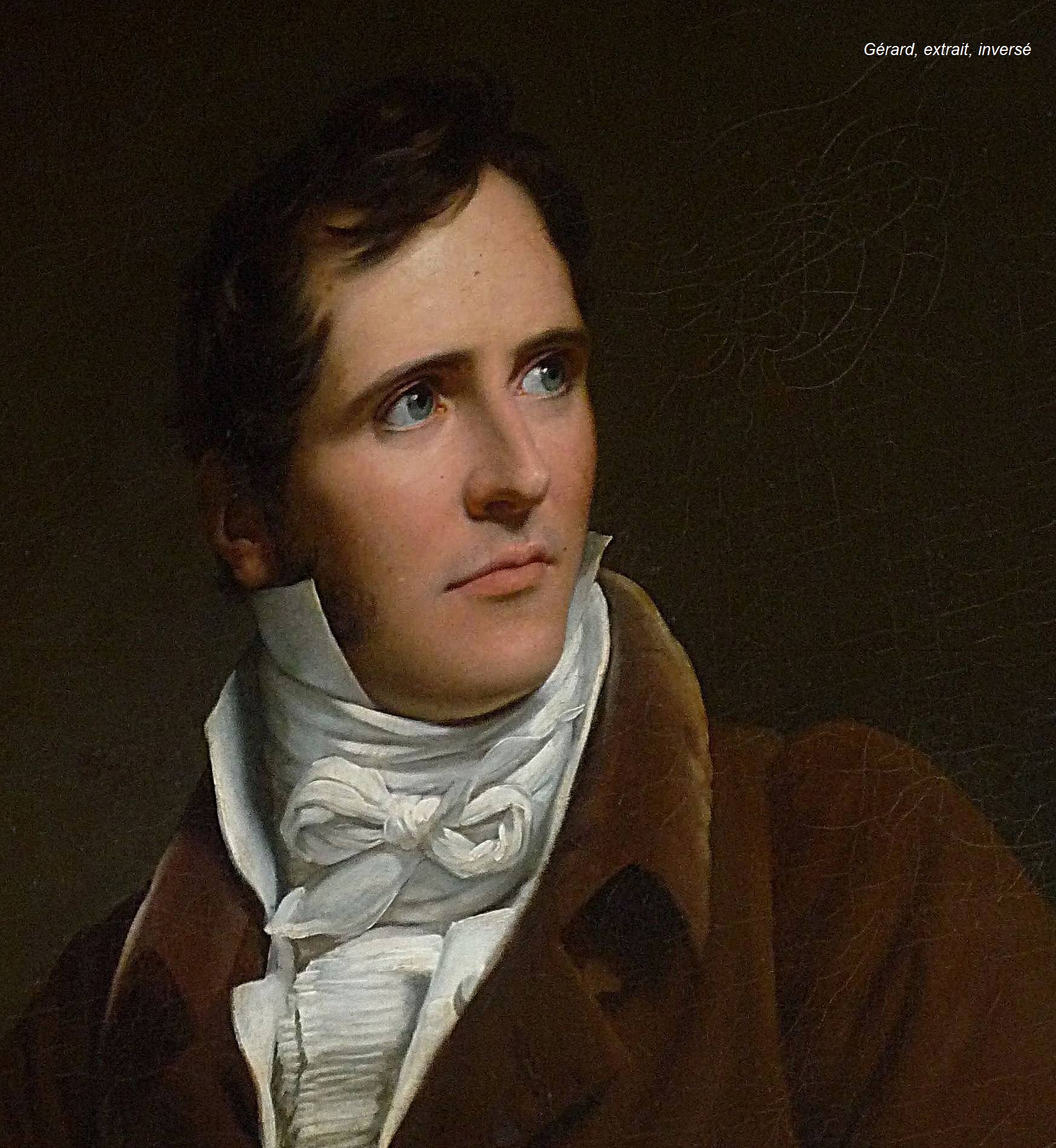 ▼
une nième version, colorisée, et peut-être mieux vendue ?
▼
une nième version, colorisée, et peut-être mieux vendue ?
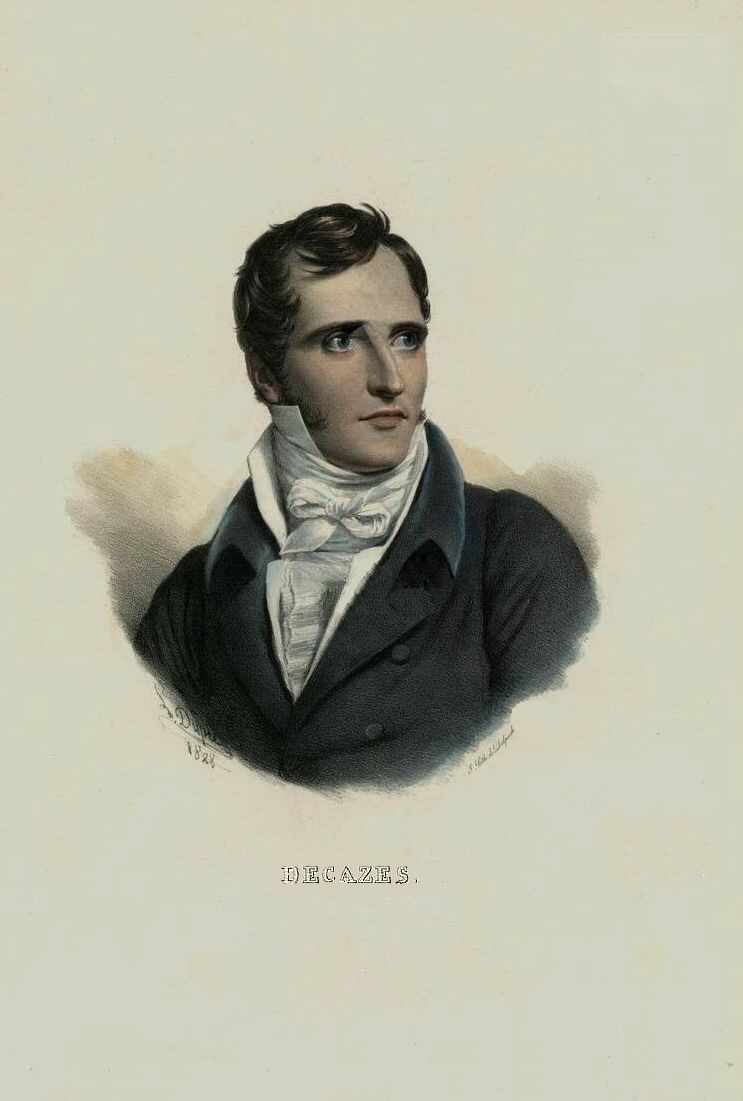
Il
existe évidemment de nombreux portraits du duc et de la duchesse
(Sainte-Aulaire), en
pied, des bustes et des miniatures. Au hasard de
nos découvertes, on
peut citer les portraits peints par Court et portant les n°
66 et 101
dans la catalogue des oeuvres du peintre, "
Tableaux peints par M. COURT, exposés au profit des oeuvres de
l'association des artistes peintres " (Paris, J. CLAYE, 1859,
in Google books). Un de ces deux tableaux, le 101 ?, se trouve au musée
Frederiskborg au Danemark, propriété du roi du
Danemark, et avait été exposé au salon de 1847, avec le n° 391. Nous
le présentons ci-dessous avec une vue de deux tableaux très semblables
: le
premier est celui du Danemark ; nous n'avons pas d'informations
précises sur l'origine du second, même pose mais costume très
dépouillé, déniché dans un catalogue de
peintures. Le premier est également publié (en tons de gris) par H.
Auschitzky (voir biblio) et bien référencé par l'auteur au
Danemark. Le
troisième est peint vers 1830. Il s'agit d'un
travail préalable de Court pour son tableau du serment de Louis
Philippe. Il a fait l'objet d'une vente en 2020 à Bruxelles.
Parmi les miniatures de Court, citons celle de madame de MIRBEL, elle
même miniaturiste.
Monsieur de
Mirbel, botaniste réputé, fut de 1815 à 1820 très lié à Elie
Decazes,
comme secrétaire général de ses deux ministères.
 ▲
duc Decazes, Joseph-Désiré Court, Frederiskborg
▲
duc Decazes, Joseph-Désiré Court, Frederiskborg
 ▲
duc Decazes, Joseph-Désiré Court
▲
duc Decazes, Joseph-Désiré Court
Ce
tableau se retrouve sur une gravure (J.D. Court) où il est
accompagné des armoiries
du duc Decazes, les 3 corbeaux. Au bas de la gravure des armoiries
ci-dessous on remarque le
collier de l'ordre de
l'Eléphant, prestigieuse décoration danoise, dont Elie Decazes
fut fait chevalier le 27 juin 1846 ; plusieurs autres décorations
figurent dont la
Légion d'Honneur au centre, sous l'écu, et celle de chevalier du
Saint-Esprit, à sa droite.
Pour information, voici une liste (sans doute non exhaustive) des
titres honorifiques, au dessous de l'image.
(archives
La Grave)
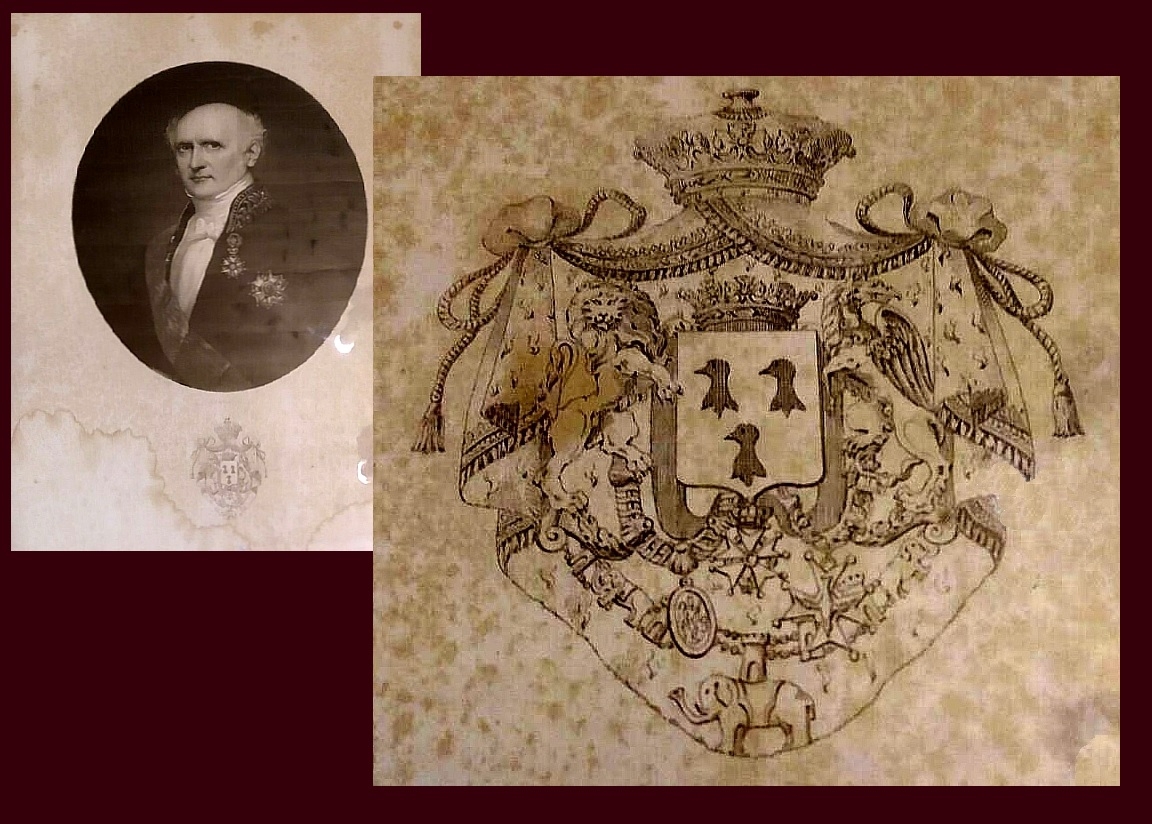
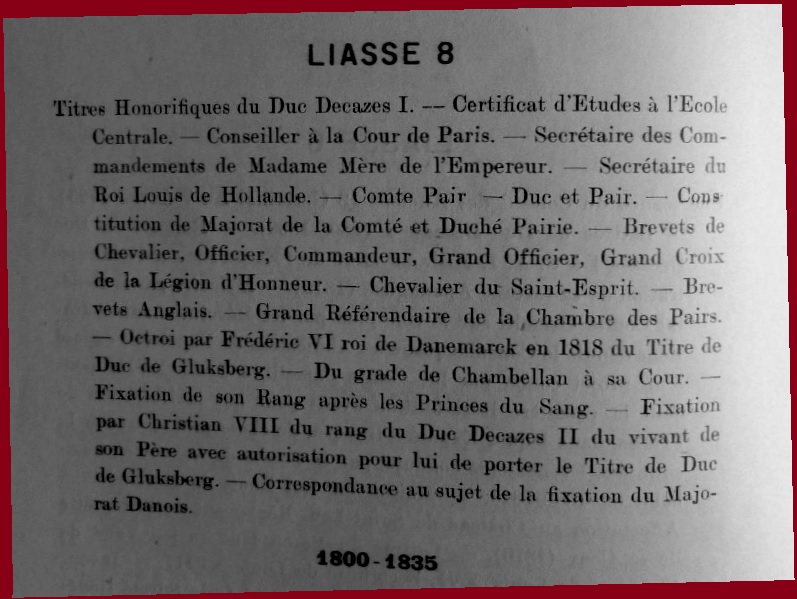
▼duc Decazes, Joseph-Désiré Court, DR, coll. part.
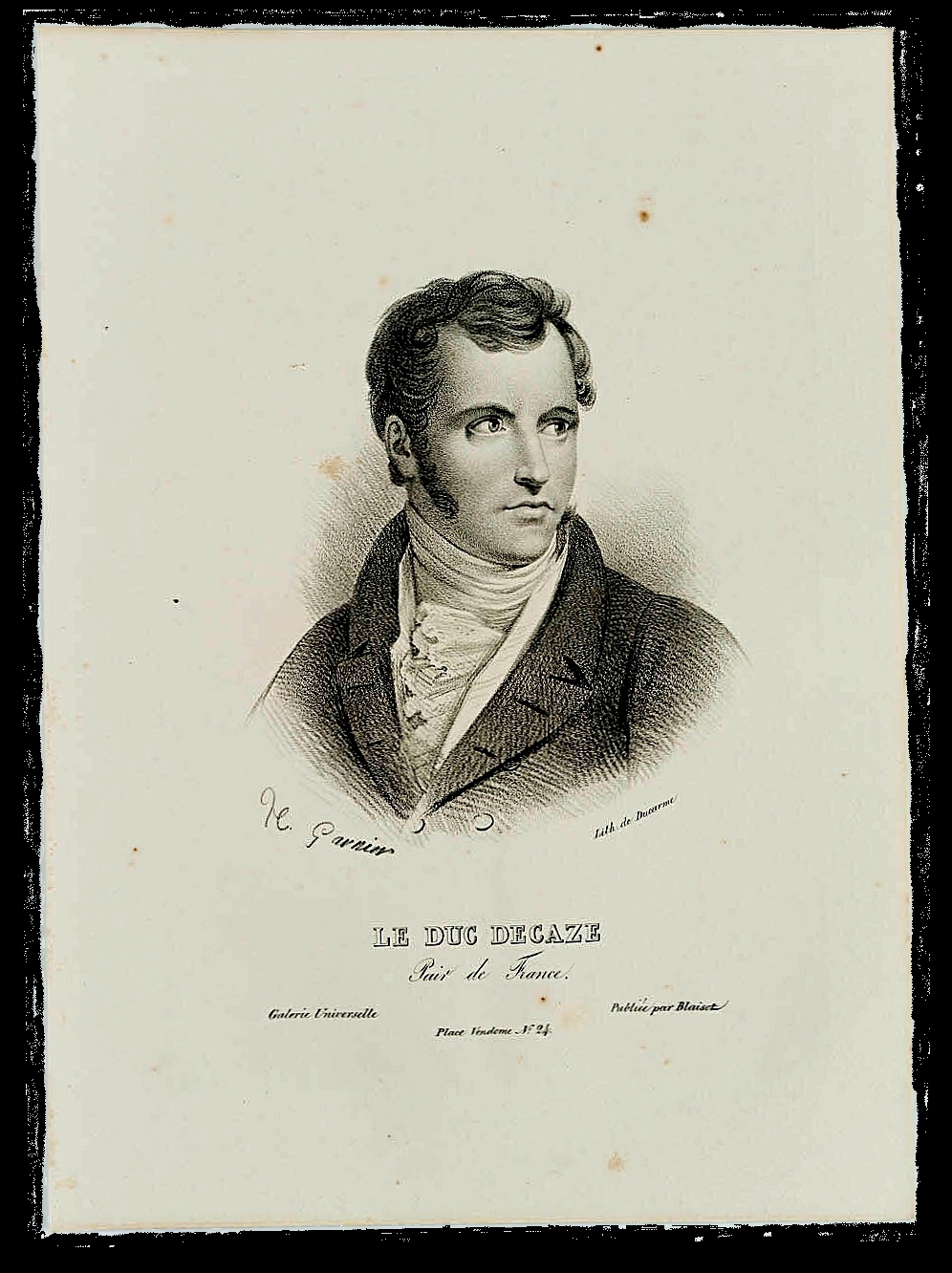 ▲
Le duc Decaze (sic), Galerie Universelle, Blaisot
▲
Le duc Decaze (sic), Galerie Universelle, Blaisot
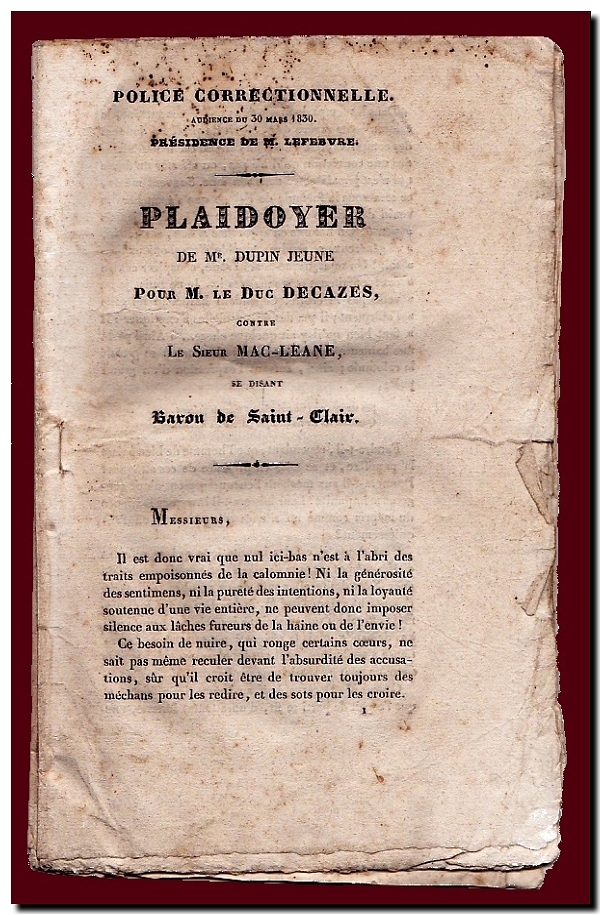
L'assassinat du duc de Berry, et les griefs de complicité portés à
l'encontre du duc ne cessent pas rapidement. Le 30 mars 1830, le duc et
quelques autres personalités gagnent un procès en diffamation après
publication des écrits d'un sieur Mac-Leane. La plaidoirie de l'avocat
reprend le parcours politique du duc. La lecture du Plaidoyer permet d'avoir une
vision globale de cet évènement et du contexte, 34 pages à ne pas
laisser de coté !
Le calomniateur n'a pas interjeté appel de sa condamnation à un an de
prison, maximum que la loi de cette époque prévoyait pour ce délit.
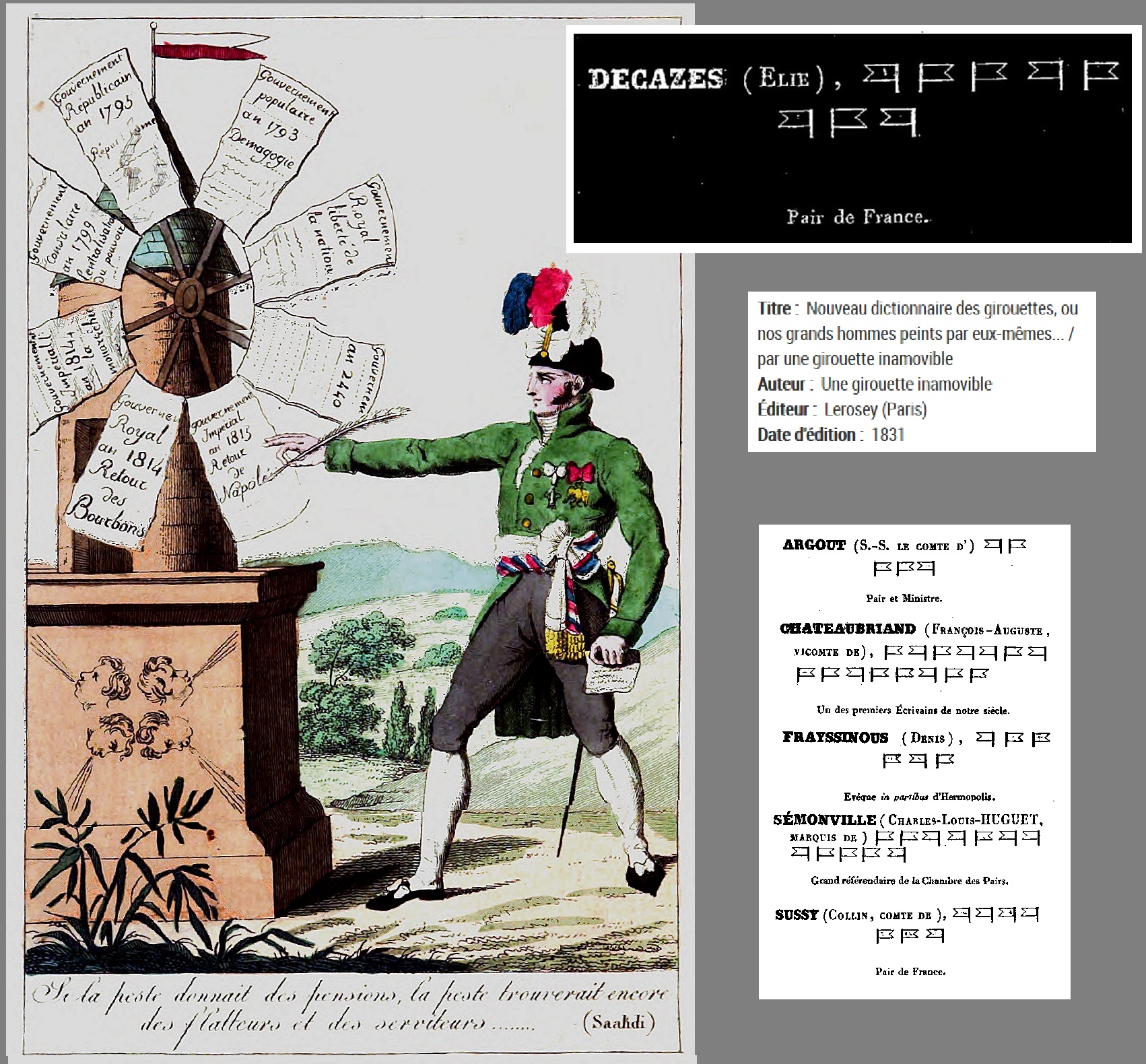 Girouette...
Girouette...
un mot d'humour !
Le parcours politique et social
d'Elie Decazes lui vaudra de figurer dans la version de 1832 du
Dictionnaire des girouettes. La première version de 1815 ignorait
évidemment tout du duc, même pas comte d'ailleurs à cette date. Il est
gratifié de 8 girouettes, un score très honorable, pour souligner sa
politique de bascule ! Fouché
et Talleyrand sont épinglés avec 12 girouettes, mais le record est de
23 !
Nous avons retenu également quelques unes des "personnalités"
rencontrées sur notre site. Les notices du Dictionnaire méritent la lecture.
◄clic
▼
Une caricature (méchante),
et une leçon d'histoire, "un écart d'imagination" !
Le
journal La Mode ne manquait
pas de commenter l'actualité. En 1835, en plagiant un tableau de
Gérard, une entrée à Paris,
voici une autre entrée, imaginaire, épreuve
avant la lettre, souhaitée par les Bourbons, celle de Henri V,
fils du duc de Berry.
Le duc Decazes est présent (!), mais en bien mauvaise posture, comme le
souligne l'analyse de La Mode.
(gravure
offerte avec la livraison du 5 janvier 1835, voir aussi 5 juillet pour
analyse, Gallica)
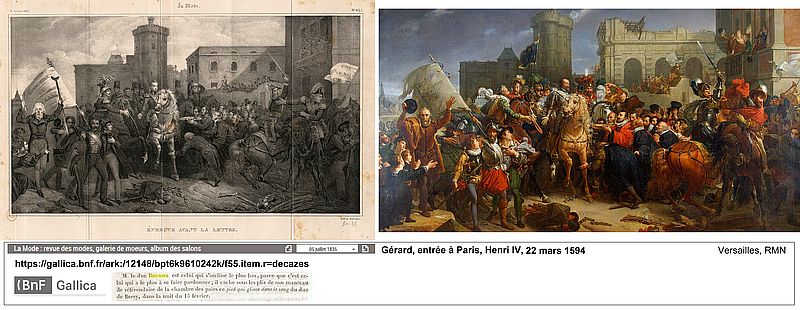 ▲
clic pour agrandir
▲
clic pour agrandir
Un frère...
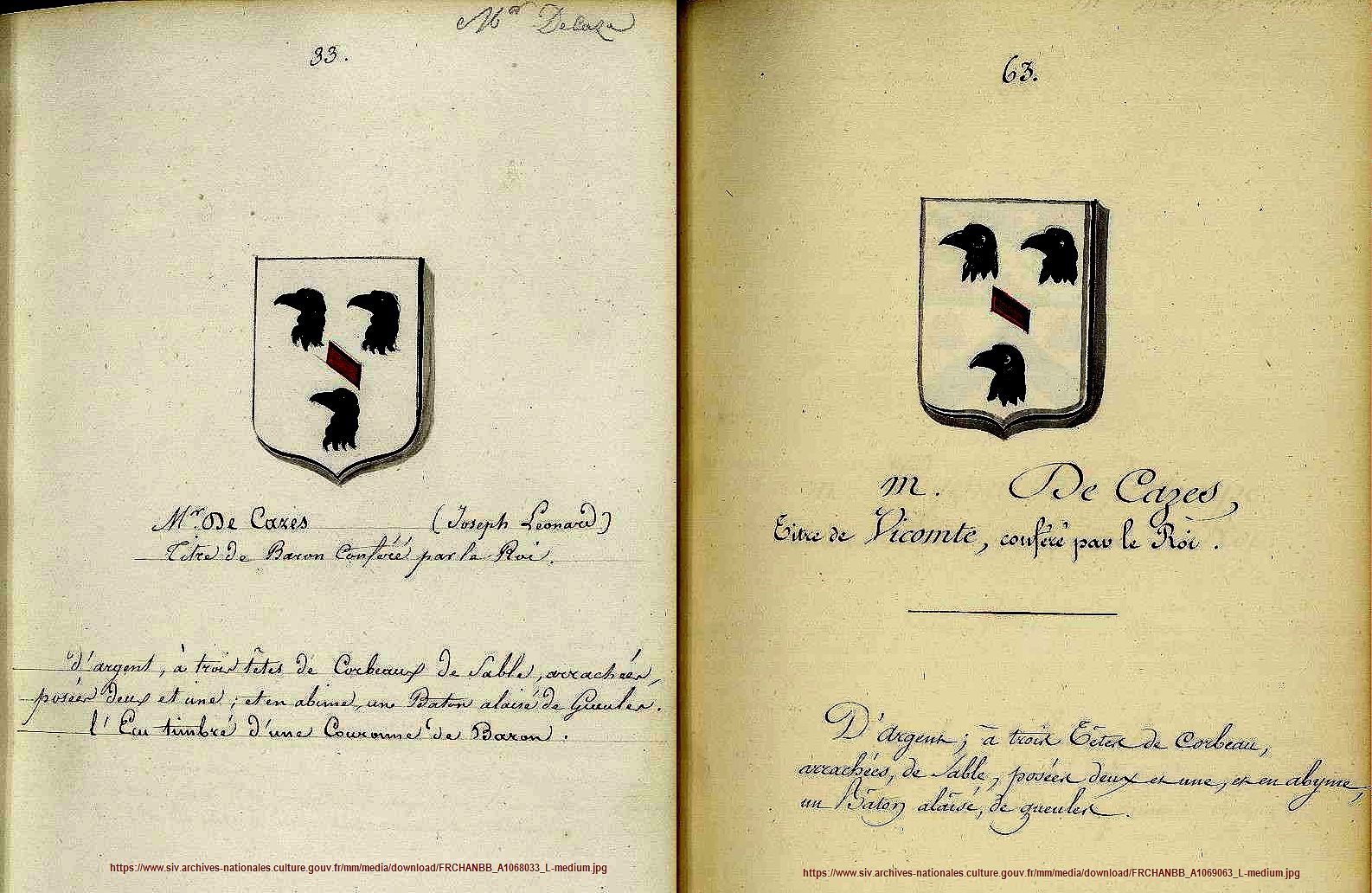 ▲
Armoiries, Joseph Decazes (De Cazes)
baron
le 10 janvier 1816, vicomte le 20 novembre 1818
on
notera la différence,
"...en abime, un baton...",
avec celles, ci-dessous, de son frère duc,
▲
Armoiries, Joseph Decazes (De Cazes)
baron
le 10 janvier 1816, vicomte le 20 novembre 1818
on
notera la différence,
"...en abime, un baton...",
avec celles, ci-dessous, de son frère duc,
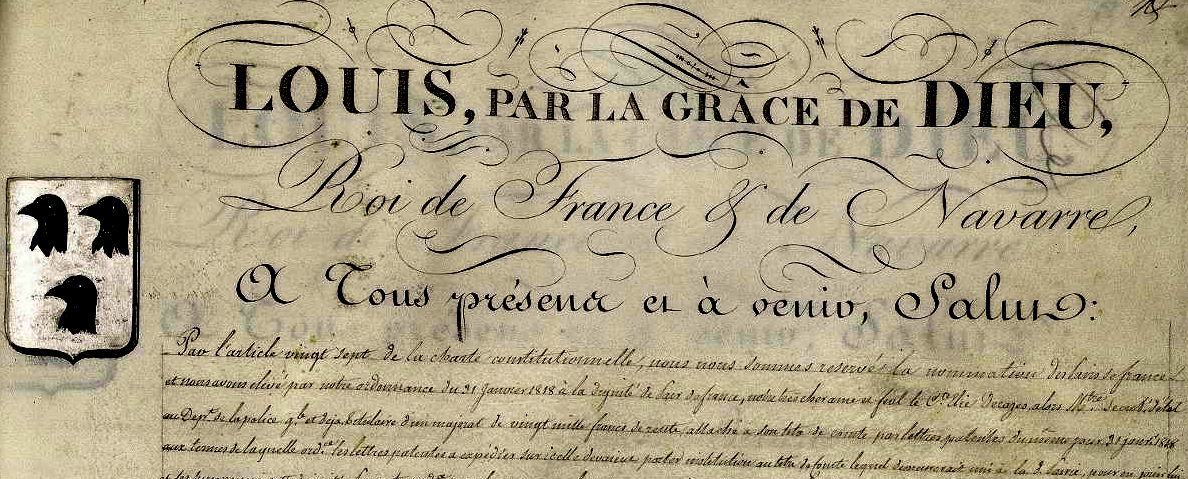
▼ En 1813, les deux frères, Elie veuf, conseiller à la Cour Impériale,
et Joseph célibataire, auditeur au Conseil d'état,
partageaient la même adresse, 11 rue Bergère
mais non la même orthographe...
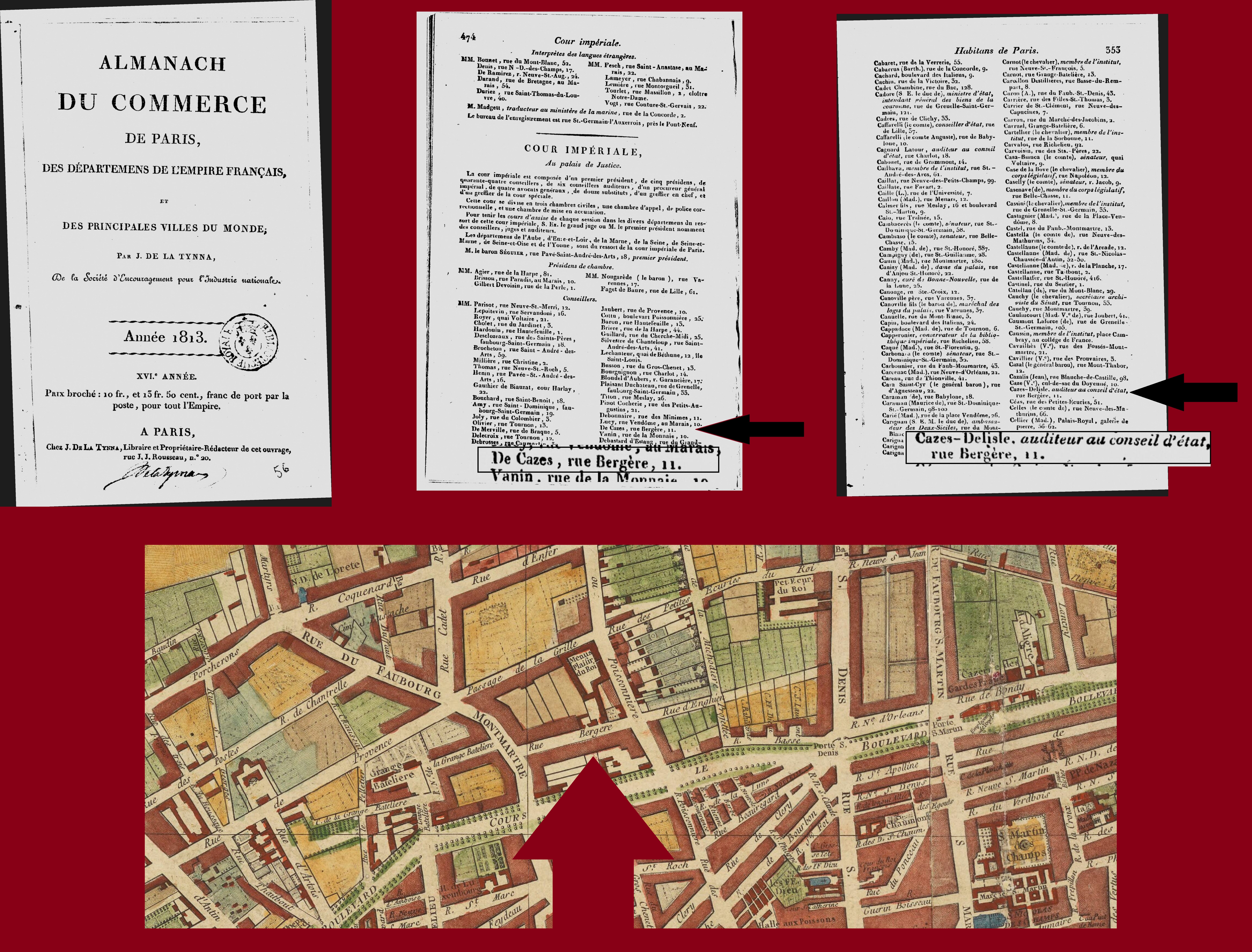
Elie Decazes avait un frère, né trois ans après lui,
en 1783, Joseph Leonard
Decazes. Baron puis vicomte de son état, il épousa en 1816 Ida de
Bancalis. Aucun
intérêt direct ici, sauf que la famille de Bancalis était une vieille
famille issue autrefois du Rouergue, vers Pruines, pas loin des
futures mines, et même si Ida n'était plus de ce pays, elle ne
pouvait ignorer ses origines rouergates lointaines... La carrière de
Joseph fut essentiellement administrative : auditeur en 1810, il est
sous préfet de Castres en 1814, et préfet du Tarn en 1815, le 12
juillet exactement. Il le reste jusqu'en 1819 pour la même fonction
dans la Bas Rhin, une réelle promotion. Il sera à nouveau préfet du
Tarn, le 19 juillet
1820, pour une décennie entière. En 1830 il est élu député du Tarn,
jusqu'en 1846.
L'orthographe de ce début du dix neuvième siècle n'est absolument pas
rigoureuse sur les patronymes, et le frère d'Elie peut également
se rencontrer comme préfet de Cazes de l'Isle : c'est le même homme.
Pour information, la préfecture
du Tarn était classée en 6 ème classe, avec un traitement annuel de
20.000 francs pour le préfet, celle de l'Aveyron, en 7 ème classe,
18.000 francs, et celle du Bas-Rhin, 2 ème classe, 40.000 francs. (pour vivre la
vie d'un préfet sous la Restauration, voir la thèse de P. Michon, "Mon
roi, ma patrie et mon département", Le Corps préfectoral de la
Restauration (1814-1830), EPHE, thèse doctorat, 2017)
Donnons enfin un dernier élément, qui, à lui seul,
pourrait constituer la clé du problème : Joseph Decazes
n'était pas que
Préfet. Ingénieur de l'Ecole Polytechnique (X 1802) il fut
membre du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées et avait donc le
même profil que son jeune et futur collègue, Robert Cabrol, qui sera
ingénieur X et membre du corps des Ponts quelques années plus tard. Robert était le frère de François
Cabrol, et débutera sa carrière aux Ponts
dans le département du Tarn. Sur le berceau de Decazeville, pas encore née, se penchent donc
trois polytechniciens et un duc...
Vous avez suivi ? Bien suivi ?
Il se trouve que dans le Tarn, à cette époque, vers 1820-1825, les
activités minières étaient plus développées que dans l'Aveyron. Et
notre préfet de frère avait compris tout l'intérêt de s'occuper de
mines : la houille, le fer, c'est l'avenir devait-on dire un peu
partout, enfin chez ceux qui pouvaient investir. C'est ainsi que
Joseph Decazes, en 1825, "
a repris les droits avec l'espoir de créer à Ambialet une usine de fer
mais il a subi la concurrence des industriels de Saint Juéry. Ceci est
une autre histoire ..." Il est vraiment dommage que le Larousse
ne puisse nous en dire plus, sur cette autre histoire ! Le site
institutionnel du conseil général du Tarn, dans la rubrique archives,
fait état " d'intérêts familiaux
dans des sociétés minières à Campagnac et à Carmaux."
43J 124-127. Cette dernière précision est de toute importance
pour nous. Est-elle la clé ? Est-ce ce frère qui a proposé à Elie de
s'intéresser à l'Aveyron et à ses ressources minières autour d'Aubin ?
Ce n'est pas impossible, et sans doute très probable. La
présence de ce frère, alors préfet du Tarn, lors de la première coulée
à Firmy en 1828 est attestée, et peut confirmer cette influence
de Joseph sur Elie. Le développement des Houillères et fonderies, et
par conséquent celui des mines de fer, est donc bien le fait des
deux frères Decazes. Joseph
viendra également à Decazeville plus tard pour représenter son
frère...La clé de Decazeville, au sens premier, c'est donc très
vraisemblablement Joseph Decazes: un oubli serait injuste. Et on ne
peut aussi s'empêcher de penser que François Cabrol doit peut-être à
son frère Robert sa venue dans ces affaires industrielles, sa rencontre
avec Elie Decazes découlant très simplement de cette proximité des deux
tarnais. Joseph Decazes avait un temps eu en mains une concession de
mines de fer près d'Alban, en 1825, soit l'année même ou son duc de
frère allait faire de même en Aveyron, concessions de Frayssé et Roc
Saint Michel. Cette précision est donnée dans l'Explication de la carte géologique du Tarn,
en 1848, par un ingénieur des mines, M. de Boucheron.
Faiblement exploitée, le minerai était conduit à
Saint Juery, la concession fut administrativement fermée par une
renonciation en 1846, soit 20 ans après les débuts. Les
conditions pratiques de l'abandon semblent laisser à désirer... (in Annales des Mines, 4 ème série, tome
IX, 1846, ordonnance 20.547)
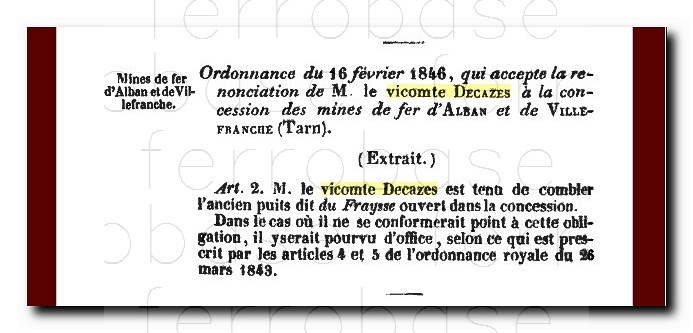
Joseph
Decazes avait également, en 1843, des intérêts
miniers en Belgique, aux
mines de houille de Ham sur Sambre. On peut enfin rappeler que
préfet du Bas Rhin en 1819-1820, il a pu rencontrer dans son
fief alsacien M. Humann : M.
Humann sera un des principaux actionnaires du premier cercle en 1826,
et le premier Président du conseil de la future
société des forges de 1826.
Un portrait de J. Decazes est donné chapitre 12, sous la forme
d'une
gravure. Un
autre portrait, par Ginain, de ce partenaire essentiel figure depuis
1902 dans un musée. A la suite du paragraphe suivant, vous
pourrez découvrir ce tableau et notre analyse.
Joseph
Decazes devint baron en 1816, et vicomte en 1818.
▼ vicomte Decazes
Il briguera le 1er octobre 1831, dans le 5e collège de l'Aveyron
(Villefranche), la succession de M. Humann, qui avait opté pour
Schélestadt. Et ici, nous retrouvons ce frère, cette fois dans
l'Aveyron, en 1831. Monsieur Humann était actionnaire de la
première heure des Houillères avec son frère le duc. Il est vraiment
écrit que le Rouergue devait croiser la route des Decazes. La présence
du frère dans le Tarn, son intérêt pour les mines, partagé par
Elie, sont donc des éléments essentiels de cette histoire.
 ▲
Joseph Leonard Decazes (Cazes de l'Isle)
▲
Joseph Leonard Decazes (Cazes de l'Isle)
Le parcours "sidérurgique" de Joseph
Decazes, un peu antérieur donc à celui de son frère, n'a rien
d'exceptionnel. Il fut même sans lendemain. Voici une brève
description, donnée par Frédéric Bitton. Il s'exprime dans un article
du Bulletin spécial Mélanges, cinquantenaire de sa fondation,
1878-1928, publié par la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres
du Tarn, Imp Nouvelle, Albi, 1928, p. 37 sqq.
…Vers la fin du siècle dernier, en 1787,
François-Gabriel,
vicomte de Solages, découvrit une mine de fer dans les cantons d'Alban
et de
Villefranche. Un décret de la Convention, en date du 12 thermidor an
III (30
juillet 1795), lui en accorda la concession pour cinquante années.
L'exploitation
de cette concession, d'une superficie de 5000 hectares,
fut
abandonnée en 1811, puis reprise en 1825 par le vicomte Joseph Decazes,
qui
aurait été aux droits de Solages. On se trouvait alors au moment où la
Société
Garrigou, Massenet et Cie avait été autorisée à oouvrir un
établissement au
Saut-de-Sabo. En 1826, le vicomte Decazes parlait même de créer à
Ambialet
"…une usine de fer où le minerai serait traité avec la houille de
Carmaux…"
Pourtant
une lettre de 1838, où perce l'embarras de l'ingénieur des mines, en
présence
de la grosse influence des compétiteurs (le maréchal Soult était
commanditaire
de Léon Talabot), constate qu'il n'y a eu aucune exploitation sérieuse
de
Decazes. En 1840, on trouve trace que celui-ci céda gratuitement
certains
droits à la société rivale….Une ordonnance royale du 16 février 1846
accepta la
renonciation de Decazes….
L'ordonnance de renonciation, voir ci-dessus, est publiée dans les
Annales des Mines. Mais seul
l'article 2 est donné. L'article 1 aurait (peut-être ? ) fourni
quelques détails, comme la motivation officielle de Joseph
Decazes de sa demande...
 Carbonel-Decazes
▲
un bouton de livrée...curieux !
Carbonel-Decazes
▲
un bouton de livrée...curieux !
clic
pour découvrir
Chronique…
Il
y a dans
les Bulletins des sociétés savantes des chroniques. On y trouve non pas
les
dernières découvertes des membres mais les petites nouvelles de la Société
et quelques
informations qui peuvent souvent passer pour anodines, surtout plus
d’un siècle
plus tard. Anodines, vraiment ? Lisez la suite.
Le parcours
de découvertes autour du thème des mines du causse nous a amenés à nous
intéresser à Decazeville, et bien évidemment au duc Decazes. Un
chapitre entier
du site lui est consacré, et c’est celui que vous lisez. Nous avons
décrit
comment l’arrivée en Aveyron du « noble pair » fut en fait le
résultat de l’action de trois autres personnalités, le frère du duc,
Joseph, et
les frères Cabrol, François et Robert. En lisant de manière un peu
distraite la Revue historique,
scientifique et littéraire du Tarn, (18 ème volume, 2ème
série, 10
ème année, 1901, page 364 ), 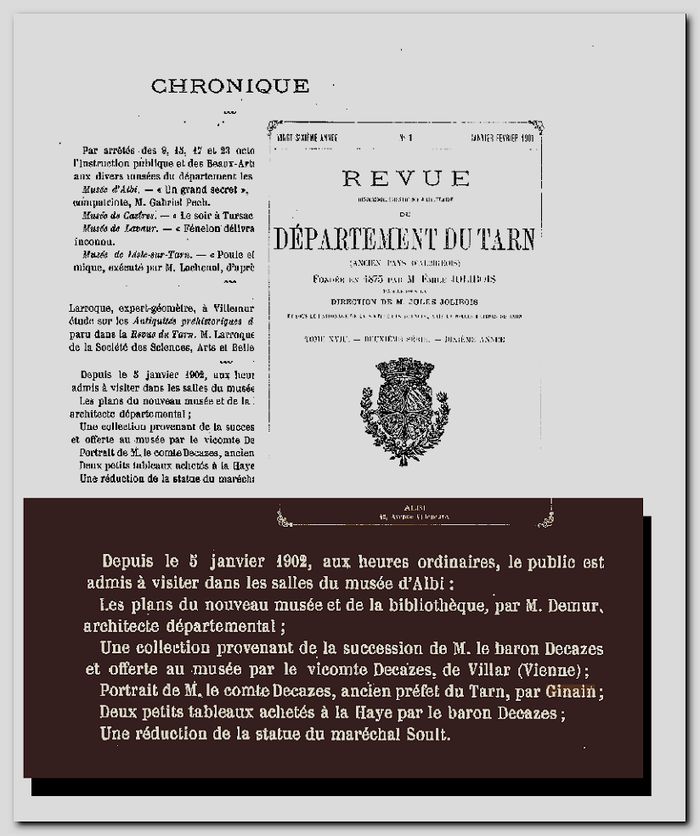 et plus précisément la Chronique, on
apprend
qu’un don fait au musée d’Albi comprend entre autres pièces, un
portrait de
Joseph Decazes par Ginain, portrait visible depuis le 5 janvier 1902. (La Société des
Sciences, Arts
et Belles Lettres du Tarn est toujours active en 2011 )
et plus précisément la Chronique, on
apprend
qu’un don fait au musée d’Albi comprend entre autres pièces, un
portrait de
Joseph Decazes par Ginain, portrait visible depuis le 5 janvier 1902. (La Société des
Sciences, Arts
et Belles Lettres du Tarn est toujours active en 2011 )
Quelques
recherches et contacts plus tard, nous avons le plaisir de vous
proposer, avec
la complicité active de Danièle Dewynck, Conservateur en Chef du musée
Toulouse
Lautrec, ce beau portrait du frère du duc, le vicomte Decazes, dans son
costume
de préfet. Sans cette Chronique, nous n’aurions jamais supposé que le
musée
dédié au peintre eût en ses réserves ce tableau… (photographie DR,
Musée Toulouse Lautrec, Albi, infographie JR)
C’est donc
une huile sur toile, 0,65
m
par 0,45 m,
représentant M. de Cazes. Au-delà de cette orthographe, finalement
assez
courante à l’époque, il s’agit bien de notre vicomte que la gravure
présentée
sur ce site montre en un âge beaucoup plus avancé. Son costume
officiel de préfet est celui des préfets
de la
Restauration, les
broderies autres que celles du col sont encore présentes. On peut
s’attarder aussi
sur quelques détails comme les boutons. Quelle est la date exacte de ce
portrait de Ginain ? La première réponse est bien sûr que ce ne
peut être
qu’une copie d’un autre tableau. Ginain, né en 1818 ne peut avoir connu
le
vicomte dans cette tenue ! Il a donc certainement repris un autre
portrait
pour réaliser le sien. Un deuxième indice de datation est à relier aux
décorations. Le vicomte Decazes a été promu officier de la Légion d’Honneur
le 19
juillet 1820, le jour même de sa deuxième nomination de préfet et date
de son retour dans
le Tarn, après un court séjour en Bas
Rhin. Il avait été nommé chevalier en 1818. Or sur
ce tableau il ne porte pas cette distinction*, ce que tout préfet
en tenue officielle ferait : nous en déduisons donc que la date
de
représentation se situe entre 1815 et 1818. Joseph Decazes a
donc entre 32 et
35 ans. Pour ce qui est de la date de réalisation de ce tableau,
mystère…pas avant 1840 sans doute.
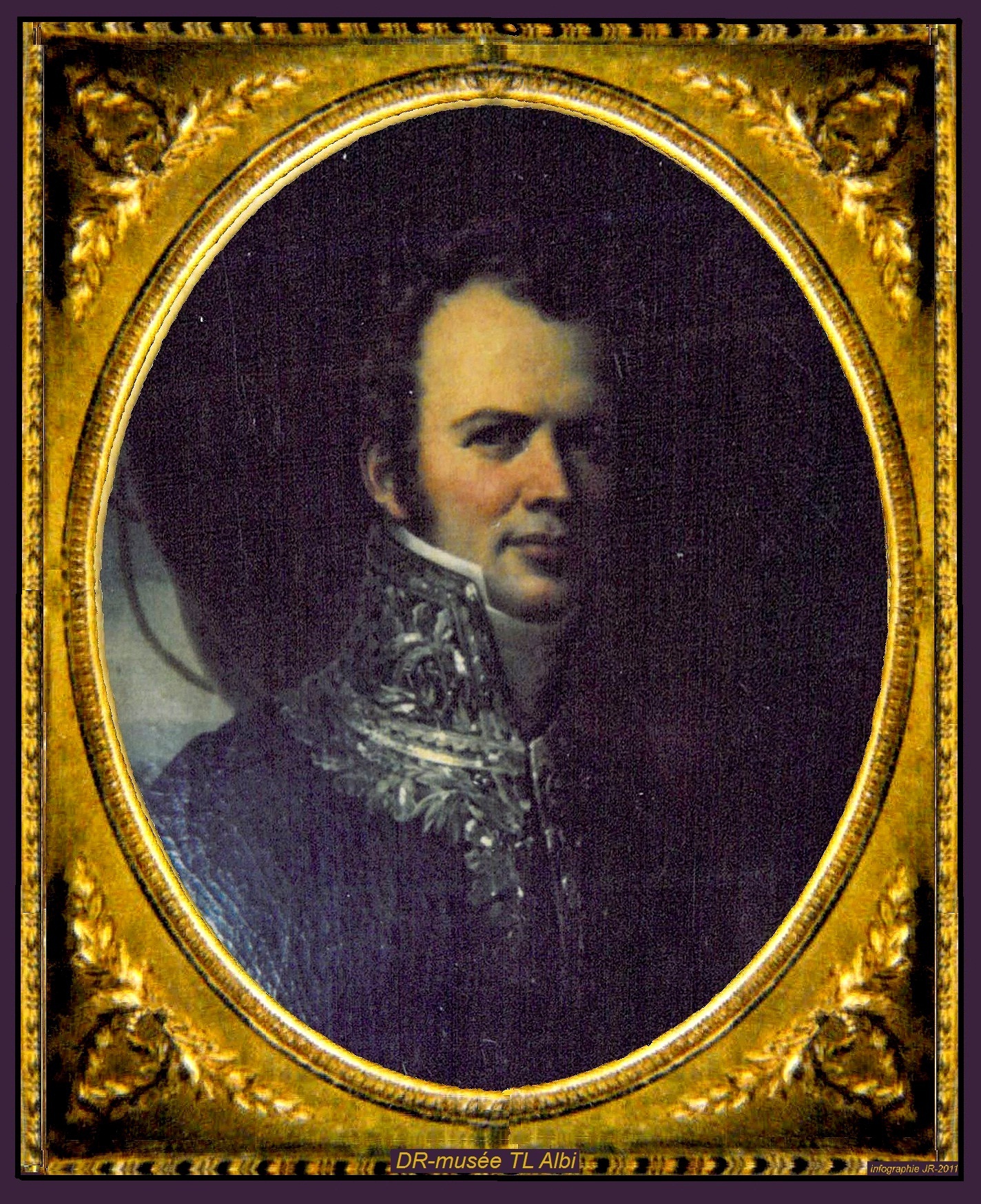
Joseph
de Cazes (sic), par Ginain, musée Toulouse Lautrec Albi, infographie
JR,
2011
* L'exposition Elie Decazes
à l'initiative du musée des Beaux-Arts de Libourne, 2024-2025, donne à
voir une copie de ce tableau, avec ajout de la Légion d'Honneur...

coll.part, cliché JR, DR
Rappelons que Joseph Decazes, ingénieur
polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées avait
commencé un parcours
professionnel en Hollande. Nommé auditeur au conseil
d’état en mars 1810, il
sera sous les ordres d’un maître des requêtes, M.
Wandenhoute, au service des
ponts et chaussées en Hollande. On sait que son
frère Elie avait été secrétaire
auprès du
roi Louis de Hollande, frère de Napoléon Bonaparte. Les
deux frères ont donc
connu le plat pays. Le roi Louis abdique
en juillet 1810, entraînant le départ de son
secrétaire Elie. Joseph Decazes
démissionnera de sa position technique en 1811 pour
suivre une carrière administrative,
sous-préfet, puis préfet, puis après la tourmente
de 1830, député de l’Aveyron,
puis du Tarn. Ses qualités
intellectuelles s’accordent avec son apparence sur ce portrait de
Ginain.
Et si vos pas vous mènent
vers ici, remerciez celui qui fit ce don
au musée, et saluez M. le
Préfet du Tarn ; en son Hôtel des Intendants d’Albi, Joseph
Decazes, qui a
provisoirement quitté le musée, figure dans ses salons…

◄ Louis Bonaparte, roi de Hollande et Hortense
(Wikipedia)
Les
deux frères Decazes, Elie Decazes et
Joseph de Cazes de l’Isle (curieusement les deux frères portent un
patronyme
différent qui sera inusité quelques années plus tard) ont dans leur
jeunesse
connu ce département français, lorsque Louis Bonaparte en fut roi,
jusqu’en
1810. Elie y était pour son activité auprès de Louis, comme
bibliothécaire
particulier, à compter du 23 octobre 1807. Il devient quelques semaines
plus
tard secrétaire des commandements de la reine Hortense, le 21 novembre
1807.
Les relations d’Elie avec Hortense ont d’ailleurs pu donner lieu à
commentaires…
Il fut aussi conseiller du Cabinet, en 1808, fonction assez floue.
Pour
sa part, Joseph, ingénieur des
ponts et chaussées, se consacre par exemple aux digues du royaume. Les
archives
départementales du Tarn conservent également des traces de ce travail.
L’inventaire des archives du Cabinet
de
Louis Bonaparte, roi de Hollande, articles AF IV (1806-1810) réalisé
par S. de
Dainville-Barbiche (Archives Nationales) en 1984 apporte quelques
précisions
sur ce séjour hollandais, et pour l’auteur, l’importance d’Elie dans
l’organigramme
du roi Louis ne doit pas être surestimée…Au départ de Louis en 1810,
qui quitte
la Hollande après son désaccord avec son empereur de frère, les frères
Decazes
se retrouvent à Paris.
****
L'intérêt constant
de
Joseph pour les forges de Decazeville apparaît par
exemple le 24 juillet 1843. Ce jour là, le duc de Montpensier, dernier
enfant du roi Louis Philippe, visite les forges. C'est à
cette occasion que François Cabrol édifia son fameux arc de triomphe en
rails...Monsieur et Madame Cabrol reçoivent donc, en compagnie de
diverses personnalités, dont Joseph Decazes, alors député d'Albi,
et de monsieur Princetot, le neveu du duc Decazes. Le duc Decazes
était retenu à Paris et absent. (Journal des
débats, 28-07-1843, Gallica Bnf ).
Nous avons évoqué plus haut la présence de Decazes
lors de la première coulée le 25 décembre 1828. Il semble que le duc
était même présent quelques jours auparavant, le 17 exactement, lors du
chargement du haut fourneau (voir
Usines et Métallos, ASPIBD, tome 1). Nous avons retrouvé dans
les pages du journal Le
Constitutionnel
l'écho ci-dessous. A défaut de donner une date précise, il confirme
bien la présence de Elie Decazes en Aveyron en cette fin d'année 1828.
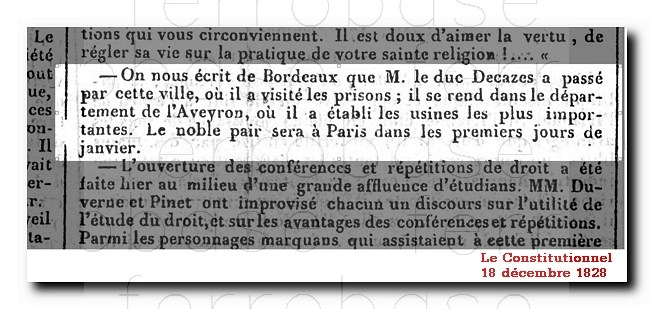
Il est souvent dit et écrit que le duc venait rarement dans ses
forges
; il y a sans doute une nuance à apporter à ce propos,
car personne n'a
de toutes façons tenu la comptabilité de ces visites ;
les carnets du duc ne sont pas accessibles... Voici un extrait
de lettre : Elie Decazes écrit au peintre Gérard, baron
de son état. On
notera la date, 1831, l'optimisme du fondateur, avant les quelques
années de crise qui vont suivre, et le lieu, Saliès .
Elie est chez son
frère, ancien préfet du Tarn.
Deuxième acte : l'implantation Rouergate
Le développement des mines de Mondalazac, à compter des années 1850,
n'aurait pu se faire si Les Houillères et Fonderies de Decazeville
n'avaient eu besoin du minerai. Ce besoin de minerai de fer est apparu
dès le début du dix neuvième siècle, le 28 juin 1826 exactement.
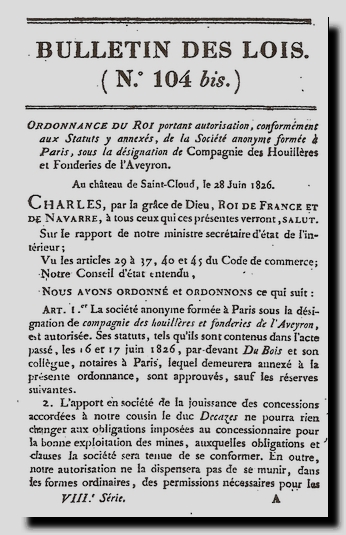
C'est en effet ce jour là que Charles, par la grâce de Dieu, ROI DE
FRANCE ET DE NAVARRE,.....signe l'ordonnance de création de la
Compagnie des Houillères et Fonderies de l'Aveyron. Cette ordonnance
fait l'objet du n° 104 bis du bulletin des lois (Bulletin des lois, 1827, Vol 5, n° 104
bis, Google).
L'ordonnance
apporte des informations essentielles, par exemple les
actionnaires du début. Pas ceux que Elie Cabrol citera dans son Viaduc de l'Ady :
ceux là sont ceux de la deuxième "version" de la compagnie, après
augmentation de capital ; nous donnons ici les tous premiers, de la
toute première compagnie, nom, prénom et qualité, dans l'ordre de
l'ordonnance. L'adresse n'est pas donnée pour ne pas alourdir la
liste.
Sa
Seigneurie Elie duc Decazes et de Gluksbeirg, ministre d'état, pair
de France, chevalier des ordres du roi, ancien ambassadeur de France en
Angleterre (160)
M. Jean-George Humann,
propriétaire, membre de la Chambre des députés (76)
M. le comte
Antoine-Maurice-Apollinaire d'Argout, pair de France (20)
M. Nicolas -Auguste Baudelot,
ancien agent de change (100)
M. Jacques Milleret, banquier
(10)
M. Martin-Louis Goupy, banquier
(30)
M.
Adolphe-Pierre-François Cottier, banquier, agissant au nom de sa maison
de commerce, connue sous la raison André et Cottier (50)
M. Michel-Frédéric Pillet-Will,
banquier (50)
M. Pierre-François Paravey,
banquier (15)
M. Joseph Moulard, propriétaire
(10)
M. le comte Louis Beaupoil de
Sainte-Aulaire (10)
M. le comte Louis-Spiridion
Frain de la Villegontier, pair de France (15)
M. le comte Henri-Charles
de Germiny, pair de France (20)
M.
le marquis Charles-Louis Huguet de Sémonville, pair de France,
grand référendaire de la Chambre des Pairs (10)
Nous avons déjà rencontré plusieurs de ces 14 actionnaires dans
l'histoire d'Elie Decazes. Elie Cabrol dans sa liste de
24, (avez-vous fait le parallèle entre le prénom du fils
de Elie Decazes, prénommé Louis, et le prénom du fils de François
Cabrol, prénommé Elie, chacun rendant ainsi hommage à son protecteur et
mentor...? ), fait état de François et Robert Cabrol, un frère,
seront actionnaires de
la deuxième version de la société, quelques mois plus tard.
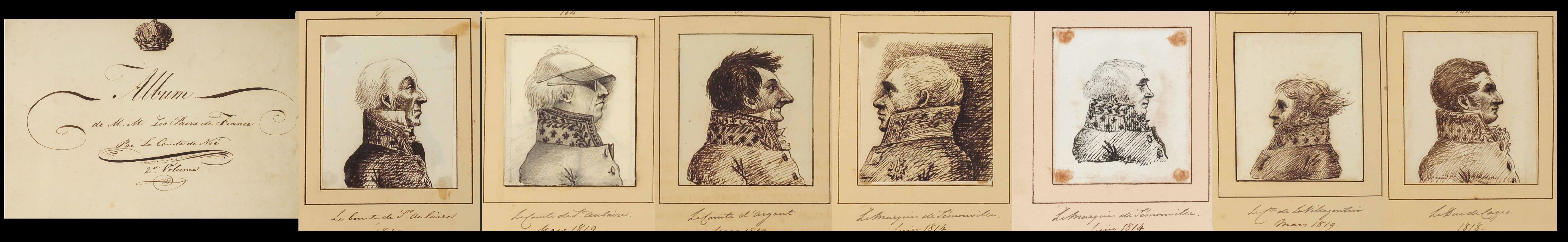
L'objet de la société
est d'après l'article 4 des statuts : " la
compagnie se propose de régulariser et perfectionner l'exploitation
des houillères et mines, de faire construire et exploiter des
hauts-fourneaux pour fondre les minerais de fer et fabriquer des pièces
moulées en fonte, d'établir des forges et laminoirs, le tout d'après
des procédés anglais, en employant les houilles et coaks pour
combustibles. "
Le caractère métallurgique est
clairement mis en avant.
Le capital de 1.800.000 francs est divisé en 600 actions de 3.000
francs chacune. Dans la liste des actionnaires nous avons donné (xxx)
le nombre d'actions souscrites par chacun, ce qui souligne d'ailleurs
l'ordre pour nous très énigmatique de cette liste, qui n'obéit pas à
une logique évidente ! De plus, en faisant les comptes, le
total de 600 n'est pas au rendez-vous..Il en manque 24 ... Le duc est
l'actionnaire principal et il fait de plus apport de
concessions et établissements divers acquis par lui auparavant, ce qui
lui donne droit au tiers des bénéfices, entre autres dispositions. Son
apport direct est donc de 480.000 francs, non compris les apports en
nature mentionnés plus loin. 52 articles constituent les statuts.
En annexe, l'ordonnance royale donne la liste des propriétés, mines,
Houillères et dépendances apportées en jouissance par le duc, liste en
19 points. On y trouve des mines, dont celle du Kaimar, des bois, des
droits, des gisements, mais pas encore trace de la concession du causse
comtal, qui ne viendra donc enrichir le patrimoine que plus tard, en
1828.
 On peut " tenter " quelques calculs pour
réaliser ce que peut représenter l'investissement des
actionnaires. Nous avons mis à contribution le site de
l'International Institute of Social History, (http://www.iisg.nl/hpw/data.php)
pour trouver par exemple le prix du kg
de pain en 1826 : 0,25 F/kg (source : mercuriales d'Angoulème ).
L'investissement du duc Decazes, pour le seul montant des actions,
480.000 francs 1826 équivaut à 1.920.000 kg de pain. Au prix du
kg actuel (source INSEE,) de 3,34 euros (moyenne 2009), la
conversion donne un chiffre de l'ordre de six millions d'euros
investis.
On peut " tenter " quelques calculs pour
réaliser ce que peut représenter l'investissement des
actionnaires. Nous avons mis à contribution le site de
l'International Institute of Social History, (http://www.iisg.nl/hpw/data.php)
pour trouver par exemple le prix du kg
de pain en 1826 : 0,25 F/kg (source : mercuriales d'Angoulème ).
L'investissement du duc Decazes, pour le seul montant des actions,
480.000 francs 1826 équivaut à 1.920.000 kg de pain. Au prix du
kg actuel (source INSEE,) de 3,34 euros (moyenne 2009), la
conversion donne un chiffre de l'ordre de six millions d'euros
investis.
Un autre calcul est bien sûr possible.
Exemple. Le
salaire moyen d'un mineur à cette époque est de l'ordre de
deux francs par jour. L'investissement équivaut ainsi à
240.000 journées de travail d'un mineur. Si on estime actuellement à
environ 50 euros le salaire journalier (valeur minimale), les
240.000 journées deviennent 12 millions d'euros.
C'est différent, nous nous y attendions, aux six millions
précédents. En
retenant donc un ordre de grandeur de 8 à 10 millions d'euros
pour cet investissement, nous devons être proche de la réalité.
L'importance de l'investissement est
bien réelle, et il ne s'agit là que de l'achat des
actions.
Le cadre est en
place, les fonds appelés, les hommes au travail. Et
pour bien comprendre pourquoi Decazeville, pourquoi ici, il nous reste
à rassembler les éléments du puzzle : que faut-il vraiment pour faire
du
fer ? Du minerai, c'est le cas ; des hauts fourneaux pour le faire
fondre ? Ils vont être construits, la société s'engage sur deux hauts
fourneaux à mettre en place à la Forézie, à Firmy ; du bois ? C'est
plus discutable, mais des solutions existent ; de la houille pour
fabriquer le coke qui servira dans les
hauts fourneaux ? Elle est présente.
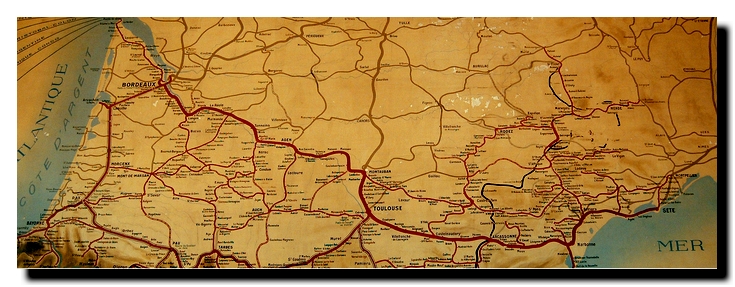 Carte
du réseau Midi, en traits rouges, en gare de Bordeaux.
Rodez est au centre droit de l'image, et Decazeville entre Rodez
et Figeac. Bordeaux est le "port " naturel des forges. (réseau vers
1880 )
Carte
du réseau Midi, en traits rouges, en gare de Bordeaux.
Rodez est au centre droit de l'image, et Decazeville entre Rodez
et Figeac. Bordeaux est le "port " naturel des forges. (réseau vers
1880 )
Réunir une telle
conjonction d'éléments dans le même lieu géographique est chose rare,
et ce sera le cas ici dans le bassin dit houiller. Seule difficulté
prévisible, les difficultés de navigation sur le Lot pour importer ce
qui manquera ou exporter les produits des forges ; Decazes n'est pas
sans savoir en 1826 que des fonds seront bientôt consacrés
(enfin, c'est une promesse politique) à
cette amélioration garantissant ainsi son entreprise. Il reste à
trouver un directeur, et un vrai. Il lui faut réunir des qualités
d'ingénieur, tout est à construire ou presque, et des qualités de
métallurgiste,
c'est un élément essentiel, l'avenir des chemins de fer s'annonce. Si
de plus il pouvait parler anglais, ce serait mieux, car les techniques
de forges anglaises
sont ... anglaises, et l'appel est fait à du personnel anglais
pour ces débuts. Si sa connaissance du pays était réelle, les
mineurs d'ici sont plutôt rudes, alors il aurait sa place toute
trouvée. Cet homme miracle, un pur rouergat, polytechnicien,
métallurgiste, meneur d'hommes, ancien militaire, sera au rendez
vous : c'est François Cabrol, ni trop jeune, ni trop âgé, très heureux
de pouvoir développer son pays de naissance. Son histoire nous
est trop connue dans ces pages pour y revenir. Decazes avait
dit-on
rencontré Cabrol en 1821 à Londres, un pur hasard ? Mais qui est donc
ce dit-on, souvent rapporté
?
Acte trois : la fabrication du fer,
l'objectif initial de la Société
La fabrication du fer va entraîner parallèlement l'exploitation
des minerais de fer du bassin. Insuffisants en quantité, François
Cabrol va d'abord se tourner vers le causse Comtal, et ce sera le
développement des mines, et chemins de fer miniers, par la même
occasion. Cette histoire est à découvrir dans les autres pages. Par
contre, nous voulons terminer ici sur un élément dont on ne prend pas
suffisamment conscience : le fer, c'est d'abord une histoire de bois
! Sans bois, pas de fer
!
Le fer
? une histoire de bois ? Vraiment ?
Et oui ! le fer, c'est vraiment un problème de bois, au moins dans les
premières années du dix neuvième siècle, bien que le bois soit encore
présent dans les techniques sidérurgiques jusqu'en 1860, où 1/3 de la
fonte est d'origine bois et non houille (Wikipedia, source exacte ?
). Pour mieux comprendre cette importance du bois, et donc des
propriétaires ou industriels de la filière, quelques mots de technique
sidérurgique ne seront pas inutiles.
Fer, fonte, acier.
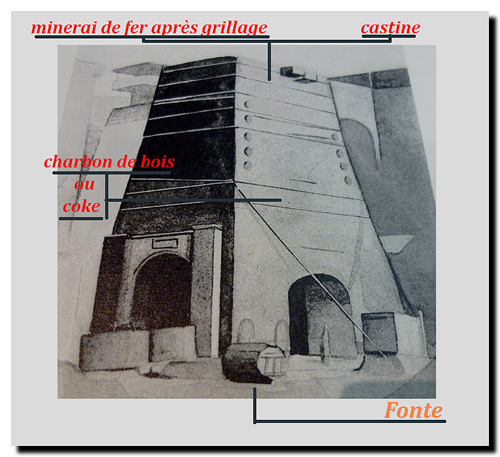 Le schéma (haut fourneau,
Decazeville, 1842, in Levêque) présente les principaux liens
qui unissent l'ensemble des
éléments. Pour résumer : le minerai de fer devient fonte dans les hauts
fourneaux, et la fonte deviendra fer ou acier par la suite, par
des traitements appropriés qui vont lui retirer du carbone.
Le schéma (haut fourneau,
Decazeville, 1842, in Levêque) présente les principaux liens
qui unissent l'ensemble des
éléments. Pour résumer : le minerai de fer devient fonte dans les hauts
fourneaux, et la fonte deviendra fer ou acier par la suite, par
des traitements appropriés qui vont lui retirer du carbone.
La première étape consiste donc pour notre minerai, de Mondalazac par
exemple, en une opération de grillage, qui aura pour effet d'enrichir
le minerai en fer. Évidemment, dans les premiers temps, c'est le bois
qui est à l'oeuvre, ou le charbon de bois, pour cette opération. Ce
minerai grillé, enrichi, va ensuite poursuivre son chemin dans
les hauts fourneaux. Mélangé à de la castine, qui va faciliter le
processus, et porté à de hautes températures, par combustion de charbon
de bois, avant utilisation du charbon de terre, c'est à dire le coke,
issu de la houille, ce qui fond est récupéré en bas du haut fourneau,
ce sera la fonte. Le bois n'est pas utilisé directement dans le haut
fourneau. Pour augmenter son pouvoir calorifique, il subit une
opération préalable de transformation en charbon de bois. Il en sera de
même plus tard pour la houille, transformée en coke.
La fonte peut maintenant être utilisée dans les
applications. Ce
mélange fer-carbone, avec plus de 3% de carbone, a cependant des
inconvénients majeurs, bien connus en ce début de
siècle : c'est un
matériau cassant et qui ne peut, surtout, pas se laisser
laminer. Pour
ce faire, il faut réduire la proportion de carbone. Ce sera
l'opération d'affinage dans les fours de puddlage, pour obtenir
le fer puddlé, utilisable
ensuite en train de laminoir.
Puddler
en anglais, c'est brasser, en gaulois : la fonte en fusion est
brassée par les ouvriers en présence de scories. La
teneur en carbone
de la fonte va diminuer. C'est un travail pénible,
délicat et
dangereux. Pour sa
part, l'acier est obtenu à partir de la fonte, par des
procédés
différents. Sa teneur en carbone varie de 1,5 à 3 %. Il
peut évidemment
se plier, s'étirer et se laminer.
Les forges à
l'anglaise, originaires bien sûr de l'autre côté de la
Manche, sont essentiellement des usines où vont se rencontrer en ce
début de siècle, des fours à puddler et des trains de laminoirs. Ces
forges vont connaître en France un développement considérable entre
1816 et 1826. Et dans l'histoire de ce développement, Decazeville,
qui n'existe pas encore, du moins sous ce nom, c'est Aubin, ne
joue pas dans le peloton de tête des précurseurs, loin s'en faut. Ses
atouts, on vient de le voir, sont pourtant bien présents : du minerai
de fer reconnu et apparemment en quantité, à Aubin, à proximité, et à
Mondalazac, de la houille, nécessaire pour le coke des hauts
fourneaux, et une rivière plus ou moins navigable pour évacuer les
produits vers Bordeaux, le Lot, et pour amener les bois du Périgord.
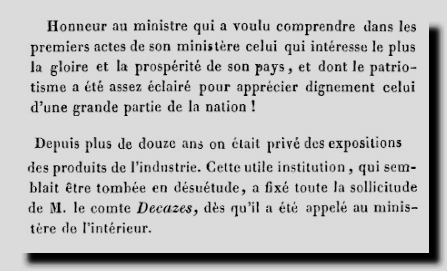 L'histoire
métallurgique du futur bassin va se construire après
l'exposition de 1819, tenue au Louvres, dans 41 salles. Voulue
par Louis XVIII, on peut penser que le ministre secrétaire d'état
au département de l'intérieur, le comte Decazes en est l'instigateur.
La précédente exposition avait eu lieu en 1806. Dans les instructions
du ministre on lit l'intérêt pour les activités économiques du pays,
mais sans accent particulier, ce n'est pas le lieu, pour des activités
minières et ou métallurgiques. La Description
des expositions des produits de l'industrie française, tome1,
Paris, 1824
(à découvrir sur le site du Cnam) présente l'ensemble de ces pièces
administratives préparatoires à l'exposition, ordonnances du roi et
lettres de Decazes au roi et aux préfets. L'ouvrage qui se veut
complet, est également l'occasion de présenter un traité fouillé de
métallurgie, celle du fer notamment. La fonte à la houille,au coak,
une nouveauté, anglaise, est largement développée,
mais nul mot, encore, sur l'Aveyron et ses richesses...
L'histoire
métallurgique du futur bassin va se construire après
l'exposition de 1819, tenue au Louvres, dans 41 salles. Voulue
par Louis XVIII, on peut penser que le ministre secrétaire d'état
au département de l'intérieur, le comte Decazes en est l'instigateur.
La précédente exposition avait eu lieu en 1806. Dans les instructions
du ministre on lit l'intérêt pour les activités économiques du pays,
mais sans accent particulier, ce n'est pas le lieu, pour des activités
minières et ou métallurgiques. La Description
des expositions des produits de l'industrie française, tome1,
Paris, 1824
(à découvrir sur le site du Cnam) présente l'ensemble de ces pièces
administratives préparatoires à l'exposition, ordonnances du roi et
lettres de Decazes au roi et aux préfets. L'ouvrage qui se veut
complet, est également l'occasion de présenter un traité fouillé de
métallurgie, celle du fer notamment. La fonte à la houille,au coak,
une nouveauté, anglaise, est largement développée,
mais nul mot, encore, sur l'Aveyron et ses richesses...
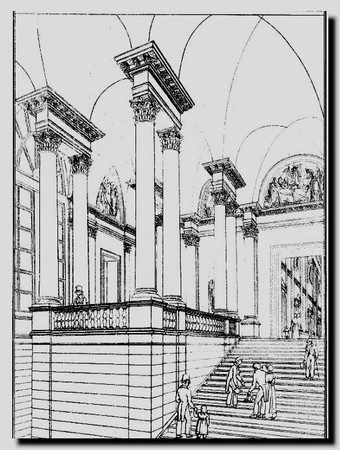
Monsieur Héron de
Villefosse, Conseiller d' Etat, a remis en 1826 un rapport sur l'état actuel des Usines à fer de la France,
rapport qui sera par la suite publié dans les Annales des Mines (tome
XIII, 1826, Gallica Bnf). C'est un document copieux, 140 pages, qui
présente l'immense intérêt de donner un état de l'ensemble de la
filière en 1826. L'auteur était inspecteur divisionnaire au Corps
royal des Mines, membre de l'Académie royale des Sciences, un vrai
technicien de la chose. Le but de l'étude est en fait de donner des
éléments permettant de se faire une idée de l'effet de la loi sur les
Douanes de 1822 ; on en attendait une amélioration des produits, une
baisse des prix, et une amélioration globale face à la concurrence,
essentiellement anglaise.
De nombreux tableaux témoignent de l'effort documentaire de l'auteur.
C'est ainsi qu'en 1825, 45 départements sont concernés, mais non
l'Aveyron, pour 379
hauts-fourneaux. Parmi ceux ci, quatre (4 ! ) seulement utilisent la
houille carbonisée, c'est à dire le coke ; les autres utilisent le
bois. Dans la décade 1815-1825, à la faveur de la paix revenue, les
besoins sont très largement non couverts par cette production, les
importations de fonte compensent ce manque. A cette époque, au moins
pour les cinq premières années, Monsieur Decazes, de part ses
responsabilités politiques doit parfaitement entrevoir la situation et
ses besoins. C'est dans un tableau supplémentaire, présentant
les nouvelles entreprises de hauts-fourneaux, que l'on peut lire, à la
toute dernière ligne du tableau :
"Aubin, Cie des Houillères et Fonderies de
l'Aveyron, houille carbonisée,
". Les indications du tableau précisent la provenance de la houille :
Aubin, Firmy, Cransac, etc, et celle du minerai de fer : Pruines,
Veuzac, Lugan, etc. Une remarque précise que la compagnie, créée en
1825, se propose de construire 2 hauts-fourneaux, et accessoirement 6
autres.
C'est donc le tout début de ce qui deviendra le Bassin, sous entendu,
et faussement, houiller, tout au moins pour ces débuts qui se
veulent avant tout métallurgiques. Aubin, c'est à dire le futur
Decazeville, va donc naître, et dans la bonne série des hauts fourneaux
à la houille carbonisée; ils sont quinze de prévus, mais des
hauts fourneaux au bois sont encore en construction : 14. Pas de grosse
différence en nombre, mais énorme en tonnes de fonte produite, les "
houille " ayant une production quatre fois plus importante que les "
bois ". De plus, pour la fabrication du " fer ", les déchets des fontes
à
la houille sont plus faibles ; le duc Decazes de 1825 avait donc vu
juste dans son entreprise de forges à l'anglaise. Un bon choix !
Une telle forge peut donc se définir par la présence simultanée sur un
site de hauts fourneaux à la houille et de trains de laminoirs. En
1825, c'était chose courante en Angleterre...Ce sera le cas, enfin
pourrait-on dire, ici à Aubin, c'est à dire le futur Decazeville.
Arrivée tardive donc dans le paysage industriel français, mais avec des
moyens importants.
La dynamique était enclenchée, et l'augmentation du nombre de forges,
l'investissement est moindre que pour des mines, va nécessiter
un accroissement considérable des besoins en fonte....ce qui va
entraîner un accroissement tout aussi important des productions de
fonte par les hauts fourneaux ...au bois. La conséquence est assez
prévisible : en 1825, la demande en fers entraîne une augmentation très
forte du prix de ce matériau, et donc les prix du minerai et du bois
s'envolent...La sécheresse de l'année 1825 se concrétise par le
manque d'eau, et donc une nouvelle augmentation des fers, par
diminution de l'offre. La loi Douanes de 1822, protégeant en partie
les fabricants de fer, a provoqué deux révolutions :
l'augmentation du nombre des forges à la houille, et
l'augmentation du prix des fers. Parallèlement les forges au bois se
sont
trouvées relativement protégées d'une ruine trop rapide. Le quart du
produit des coupes de bois de toute la France, le quart donc du revenu
net de ce genre de propriétés, est issu de l'activité des usines à
fer en 1825. On comprend un peu mieux la volonté de ces producteurs à
maintenir des prix de fer, donc de bois, élevés...et l'opposition
des consommateurs de fer, trouvant l'addition un peu
forte ! Et dans les intérêts croisés des propriétaires de bois, des
propriétaires d'usines à fer, des capitalistes, et des entrepreneurs
ou maîtres des forges, ce sont les propriétaires de forêts, souligne le
rapporteur qui tirent le plus de bénéfices des prix élevés du
fer...sans que leur investissement soit par trop considérable !
La solution proposée pour diminuer le prix du fer est donc d'augmenter
la production de fonte par houille carbonisée, le coke, vu le
prix excessif atteint par le bois, et donc la fonte au bois. Cela
implique une politique coordonnée sur les moyens de transport, les
canaux et rivières, pour favoriser les échanges de minerais et de
houille. En admettant ceci fait, c'est tout naturellement ou presque
que le rapporteur envisage enfin la baisse des prix du bois, qui
serait moins demandé par les maîtres des forges...
Une autre solution est envisageable: la réduction des droits d'entrée
établis par la loi de 1822 des Douanes. " Alors
la France serait à la merci du commerce étranger, et pour quel objet ?
Pour le fer, premier besoin de l'agriculture et de l'industrie,
premier gage de la victoire et de la paix ", lit-on dans le
rapport. Pour favoriser donc la fonte à la houille, il faut résoudre de
nombreux problèmes : celui du prix de transport et celui du
transport de la castine nécessaire sont bien présents. De plus il
faudrait pouvoir trouver en France des sites d'extraction de houille
favorables, en termes de coût de production et de transport. Les
travaux d'amélioration de la navigation du Lot, favorisant les
parcours vers Bordeaux, port naturel pour Decazeville, vont s'inscrire
dans cette perspective.
En 1834, mettant à profit son retrait provisoire des affaires,
François Cabrol va publier, chose rare pour lui, un livret d'une
soixantaine de pages, Du tarif
à l'entrée en France des fontes et des fers, Paris, Crapelet,
pour bien marquer son opposition, qui sera constante, à toute
réduction des droits.
Cet éclairage économique ne serait pas complet sans préciser que le
duc Decazes, en bon gestionnaire, sera membre en 1833 du très
influent Conseil Général des Manufactures, composé en grande partie de
maîtres des forges. Fin 1833, une (très timide) réduction des droits
intervient. Il fallait bien faire un geste ! Un sacrifice très
symbolique de la part de la coalition maîtres des forges et
propriétaires des bois. Le duc Decazes a été le rapporteur général des
débats, en sa qualité de président du conseil d'agriculture - il n'a
pas seulement vécu dans la sidérurgie ! -, une des formations du
Conseil Général des Manufactures. Il va se féliciter de cet accord qui
en réalité ne changera rien aux prix. Les intérêts des maîtres et
propriétaires sont, il faut en prendre conscience, également ceux du
roi et de sa famille, propriétaires de plusieurs centaines de
milliers d'hectares de bois (240.000 ha en 1833), étangs,
lacs....Un prix du bois fort, provoquant un prix du fer
fort, est donc absolument essentiel. Le discours précise même que
c'est dans l'intérêt des très
nombreux ouvriers occupés dans ces usines...
Ce sont là quelques uns des éléments économiques qui vont favoriser le
démarrage des activités de Decazeville. Le tableau est presque complet,
le cadre est précisé, place maintenant aux acteurs, aux mineurs,
chevaux, locomotives et wagons. L'histoire va devenir plus technique,
et, dans ses débuts, plus difficile à maîtriser : l'action
forges de Decazeville perd 50% de sa valeur en 1833... et
François
Cabrol se retire provisoirement...Il reviendra, heureusement !
Car
les quinze premières années de la Société vont
être difficiles : les actionnaires seront constamment priés de croire
en l'avenir et ses promesses d'eldorado. Ce n'est qu'en 1846
que le duc, président de son Conseil, pourra, enfin, annoncer une bonne
nouvelle : la Société est bénéficiaire. François Cabrol, mis en
avant ce jour là par le duc, le méritait bien : ceci,
dit-il, c'est " grâce à
l'intelligence du directeur, M. Cabrol, l'un de nos premiers ingénieurs
".
Ce 19 mai 1846, dans les salons de M. Lemardelay, la séance annuelle de
la Société a dû avoir un cachet particulier. Il y a alors 215
actionnaires, et le capital est de 7.200.000 francs depuis 1832.
Le duc souligne qu'en 1826, la ville n'avait pas d'habitants :
elle est en 1846 la deuxième ville du département de l'Aveyron,
avec 5 000 âmes, dont 3 000 travaillent aux forges. Le Journal des chemins de fer du
samedi 23 mai 1846 donne également les précisions, importantes
pour les 215, sur l'état des finances : l'action initiale de
3 000 francs, qui n'a pas produit d'intérêts durant quinze
ans, se trouve portée à 5 625 francs, et le dividende est fixé
pour 1845 à 360 francs : un petit 7% qui a dû être apprécié comme il se
doit. En cette année 1845, 15.000 tonnes de fer sortent des forges,
dont 13.000 en rails. La seule ombre au tableau est la canalisation du
Lot, promise, mais toujours ajournée. Il y aura bientôt dix
hauts-fourneaux sur le site.
Pas
d'intérêts durant quinze ans ? Est-ce vraiment le cas ? Nous avons pu
retrouver des écrits de François Cabrol qui peuvent contredire cette
déclaration du Journal. On
pourra lire cette discussion dans le chapitre 6 du site.
Dans
quelques années, après les multiples voies ferrées, près de 70
km, mises en place de
Firmi à Decazeville, les besoins accrus en minerai seront l'occasion
de développer la concession de Mondalazac Solsac, de créer la voie
ferrée d'une vingtaine de kilomètres jusqu'à Marcillac, et ses
ouvrages d'art. Une autre histoire va s'écrire, celle que
vous pouvez découvrir, si ce n'est fait, dans les autres pages.
****
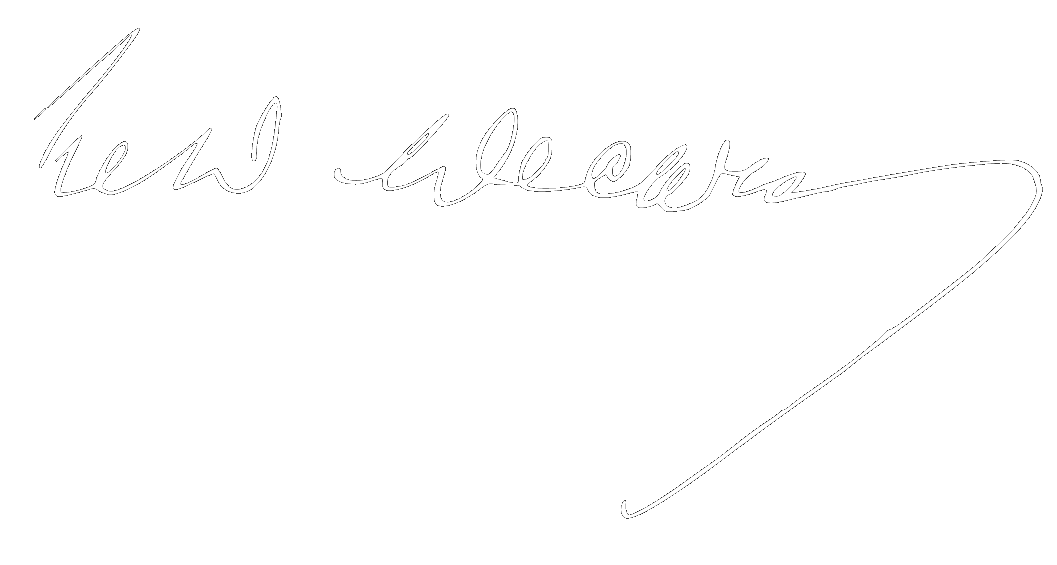 duc Elie
Decazes
duc Elie
Decazes
Avant de tourner cette page,
quelques lignes
sur la disparition du duc Elie Decazes, le 24 octobre 1860. Le
Figaro du 28 octobre 1860, à la fin de la nécrologie rappelle les
circonstances, accidentelles, de ce décès. Les journaux comme La
Presse ou le Journal
des débats vont bien sûr rappeler les principaux faits historiques
auxquels le duc a lié son nom. Dans un long article signé, le
Journal des débats souligne le 23 novembre 1860 que "
rappeler tous les actes utiles de ce ministère, ce serait écrire les
pages les plus honorables de l'histoire de la Restauration...".
Une dernière interrogation, à propos du duc Elie: pourquoi faut-il, au
mépris de toute vérité historique, que l'on mentionne
habituellement " 1860
Decazeville ", comme lieu de son décès, ou " Decazeville ou Paris",
avec un peu plus de prudence ? C'est bien Paris, après l'accident
de Tours. Il est inhumé à Bonzac, près de la ville de
Libourne en Gironde, ville
historique de Decazes...
Le Journal de l'Aveyron se
fera l'écho de la disparition du duc Decazes, à deux reprises. Le 31
octobre 1860, un bref paragraphe informe de cette disparition,
sans détails aucuns. L'orthographe incorrecte de Cazes sera rectifiée le 7
novembre avec le rapport de la cérémonie tenue à
Decazeville.
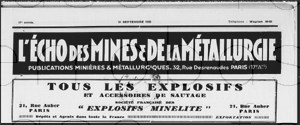
C'est une véritable énigme ! L'Echo des Mines et de la
Métallurgie, dans son numéro du 10 septembre 1929 relate les cérémonies
du Centenaire des mines et usines qui eurent lieu à Decazeville.
Un article sur quatre pages évoque les discours tenus. Monsieur
Ramadier, député-maire de la ville avait pris l'initiative de ces
cérémonies. Nous retenons ceci du discours de M. Guillemot, directeur
des Mines et Usines, lors de la pose de la plaque commémorative sur le
piédestal de la statue du duc Decazes : " ...S'il
a pu ainsi donner son nom à la commune, le duc Decazes lui donna aussi
son coeur : c'est ici qu'il voulut passer ses dernières années, c'est
ici qu'en 1860 il mourut."
Les origines du duc ? Quelques lignes plus
haut, l'auteur de l'article rappelait que le duc Decazes, "
originaire de la région et connaissant par conséquent les ressources
minières de cette contrée, (il) parvint, après de grands efforts
et avec la collaboration de François Cabrol à faire surgir dans la
vallée un centre houiller et métallurgique....".
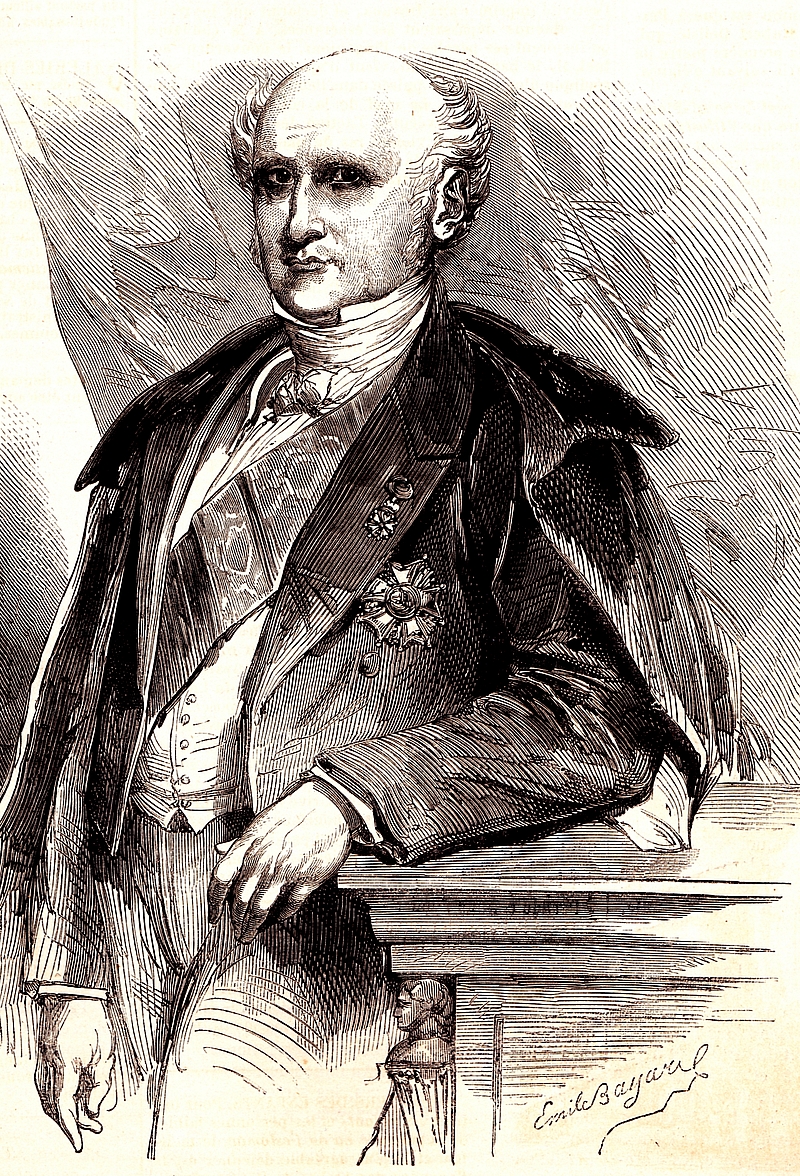 L'Illustration, Journal Universel
du 3 novembre 1860 met à la une un portrait du duc pour évoquer
sa
récente disparition. Une place d'honneur ! Mais les 26 petites lignes
en
page deux qui présentent plus que brièvement le duc Decazes
aux générations qui n'ont pas connu 1815 ne sont qu'un avis sans
relief, l'essentiel, et encore....Il n'y a par exemple aucune mention
des activités industrielles de Decazeville...Le portrait présente
joliment l'homme politique, qu'il n'était plus, et contraste assez
curieusement avec les 26 lignes suivantes.
L'Illustration, Journal Universel
du 3 novembre 1860 met à la une un portrait du duc pour évoquer
sa
récente disparition. Une place d'honneur ! Mais les 26 petites lignes
en
page deux qui présentent plus que brièvement le duc Decazes
aux générations qui n'ont pas connu 1815 ne sont qu'un avis sans
relief, l'essentiel, et encore....Il n'y a par exemple aucune mention
des activités industrielles de Decazeville...Le portrait présente
joliment l'homme politique, qu'il n'était plus, et contraste assez
curieusement avec les 26 lignes suivantes.
◄▼ L'Illustration, Journal Universel
(► www.lillustration.com)
Le Monde
Illustré, concurrent
direct de l'Illustration
publiera pour sa part, le 3 novembre 1860 également, ce portrait.
Toujours à la une, comme l'Illustration,
mais âge plus avancé, et moins de décorations...La notice, 62 lignes,
est ici nettement plus informative que la précédente...
d'argent aux
trois têtes de corbeau arrachées de sable
Sur
l'écu, les corbeaux, symbole de longévité, et juste au dessus, la
couronne ducale (de France) ; le tout déposé dans le manteau de
pourpre doublé d'hermine des grands dignitaires, surmonté de la
couronne et du bonnet.
Après son mariage en 1818, comte, pair et non
encore duc (en France ...),
les armoiries étaient différentes : la couronne de comte, et deux
écus,
trois corbeaux de la famille Decazes à gauche, et trois couples
Sainte-Aulaire à droite. Ces couples, terme de vènerie, liaient les
chiens deux par deux, avant la chasse elle même. Il est parfois indiqué, à tort, que
ce sont des épis.
La symbolique du corbeau peut pour sa part renvoyer à la longévité ou
témoigne d'une présence religieuse dans la famille : un Pierre de
Cazes, né en 1280, était Général des Carmes et Patriarche de Jérusalem
....
Ce dessin figure
au bas d'un portrait du comte de
Cazes
(sic ! ) gravé par Paul Toschi d'après un tableau de F. Gérard. Deux
animaux, étrangement disparus plus tard, portent le tout, conformément
à la tradition : un lion à gauche, et un griffon, mi-aigle,
mi-lion, à droite. Le portrait du comte est celui présenté - avec
la
seule précision Gérard - dans le document de H. Auschitzky et
mentionné en page des liens accessible depuis la page d'accueil.
▼comte de Cazes (gravure Gerard Toschi),
version Bibliothèque Nationale Espagne, Madrid
Les
approximations historiques, pour ne pas écrire erreurs, sur quelques
épisodes de la vie du duc Decazes perdurent. Elles
trouvent peut-être leur origine dans le Larousse de 1922 ? La
consultation du prestigieux dictionnaire montre cependant que
l'erreur sur le lieu du décès du duc n'était pas faite dans les
éditions de la fin du 19 ème siècle...éditions qui ne mentionnent pas
le lieu, comme l'édition de Pierre Larousse du Grand Dictionnaire
Universel, tome 6, 1870, qui se contente de mentionner "m. en 1860". Le
Larousse est beaucoup lu et repris : on retrouvera donc l'erreur
à de multiples occasions...
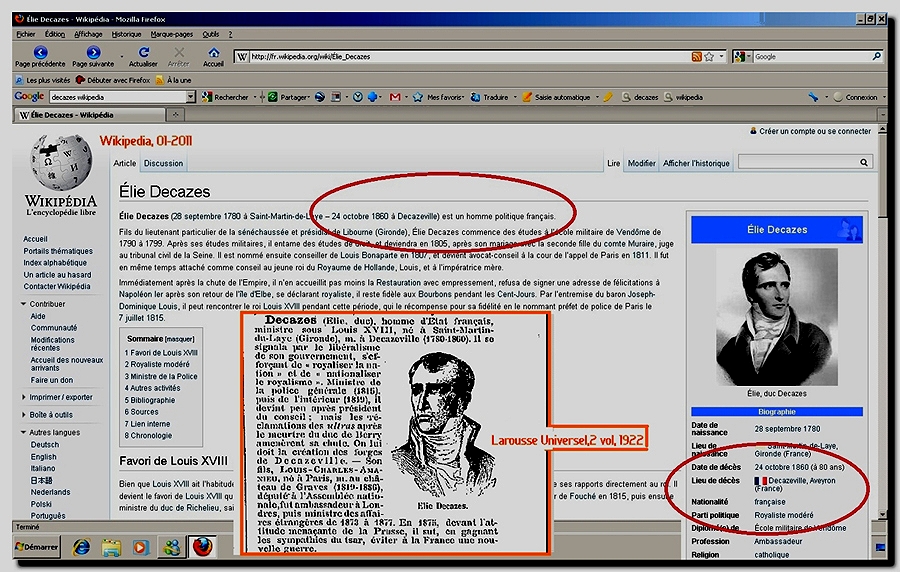
L'erreur géographique sur le lieu du décès du duc est une constante
dans les publications. Voici une copie d'écran particulièrement
amusante. Le magazine en question, dont la renommée n'est plus à faire,
publie en 2006 un numéro spécial, l'histoire
de France pour les nuls. Dans
l'article intitulé le retour des rois, le lecteur apprendra donc ceci,
et restera sans doute encore un peu nul, ce qui est fort désagréable !
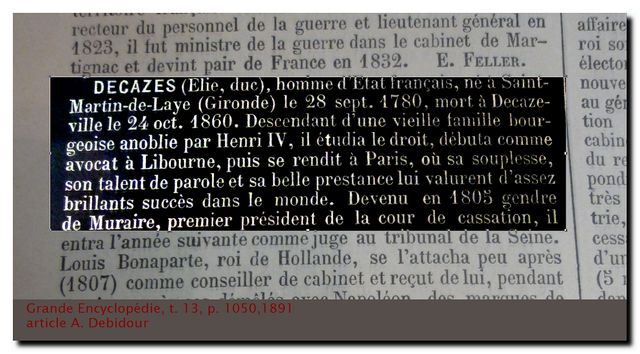
La
Grande Encyclopédie, avec ses 31 volumes est une
référence. Le tome 13, paru en 1891, présente,
page 1050, sous la signature d'un Inspecteur général de
l'Instruction Publique, un article Decazes. Comme attendu ( ! ),
celui-ci décède le 24 octobre 1860, ce qui est exact,
mais à Decazeville, ce qui l'est beaucoup moins...
▼
site "officiel" de la famille Decazes
pendant
longtemps, l'erreur était ici présente !
Rectifiée
le 30 novembre 2021
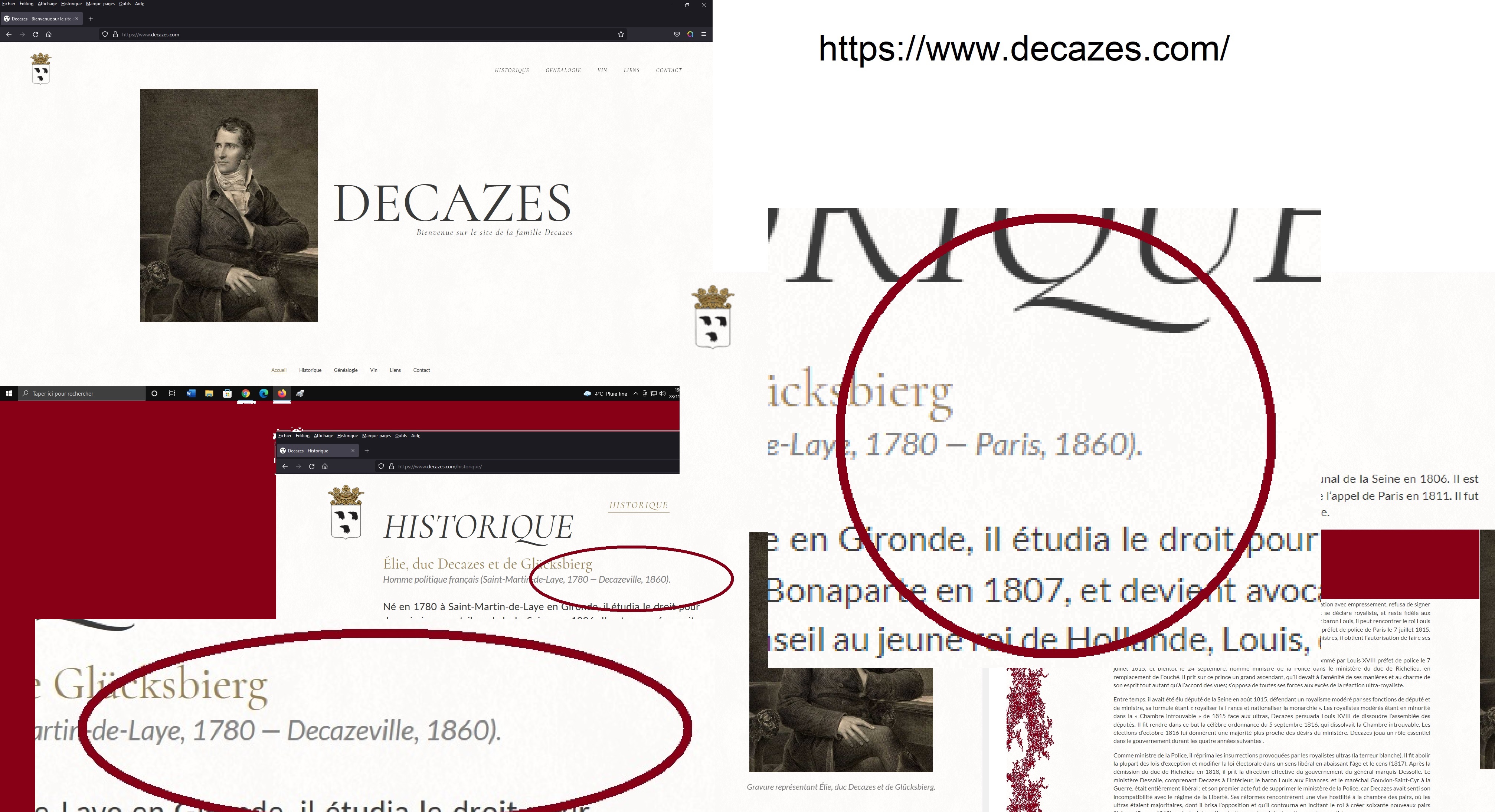
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Cette
page
de notre site était donc consacrée au duc Decazes, pour essayer de
comprendre
l’itinéraire qui le fit s’intéresser au Rouergue minier de 1820. Son
frère
Joseph, nous l’avons vu, a joué un rôle
important dans cette découverte. Il se trouve qu’il y avait également
un autre
frère, de François Cabrol cette fois, qui a bien pu jouer également un
rôle
important.
Robert
était son prénom, ou alors Pierre, ou alors comme il est quelquefois
écrit
Pierre Robert. On peut compléter par Barthélémy pour ce frère né en
1791, deux
ans avant François Gracchus. Les parents Jean Cabrol et Jeanne Albene
vendaient
du drap place du Bourg à Rodez, place emblématique pour les
ruthénois :
c’est là que se dressait la guillotine. Jean Cabrol ne fut pas étranger
à son
usage, mais ceci est une toute autre histoire que la nôtre… Si vous
inversez
Pierre Robert, vous devriez d’ailleurs deviner une certaine parenté
avec un
révolutionnaire bien connu…dont la carrière va s’interrompre disons
brutalement
en 1794.
Robert
(Pierre) Cabrol a
par contre fait une belle carrière. Ingénieur polytechnicien, promotion
1809,
il a donc connu sur les bancs de l’X son frère François, qui était pour
lui un
« bizuth » ; François appartenait à la promotion
suivante de
1810, qui n’était d’ailleurs pas la première de Polytechnique, comme il
est
quelquefois écrit par erreur. François sera admis, on le sait, dans le
service
de l’artillerie en 1812 pour une carrière militaire en demi-teinte
avant de
quitter l’uniforme pour les combats industriels et sa réussite
incontestable
aux Forges de Decazeville. Son frère Robert sera pour sa part ingénieur
des
Ponts et Chaussées à dater du 20 novembre 1811. Il sera en fonction
dans le
Département du Tarn de 1826 à 1835 et n’a pas pu ne pas évoquer avec
Joseph Decazes,
alors préfet, le frère d’Elie, un futur développement des forges du
bassin
d’Aubin. Ce grand frère a-t-il poussé
son cadet François vers Decazes et donc le futur Decazeville ?
C’est bien
probable. Il était parfaitement convaincu de l’avenir des forges. On le
retrouve en effet comme actionnaire pour quatre actions (10 pour
François)
lors de la première augmentation de capital en 1829 de la Société des
Houillères et Fonderies de l’Aveyron, un doublement du capital par
création de
600 actions de 3.000 francs. Il est amusant de constater que dans
l’acte
publié dans le Bulletin
des Lois du
Royaume de France (8 ème série, règne de Charles X, tome onzième,
bulletin 301
bis)
il apparaît comme
Pierre-Robert
Cabrol, ingénieur des ponts et
chaussées demeurant à Alby, Tarn et plus loin comme M.
Robert Cabrol dans la liste
détaillée des souscripteurs. Ce frère poursuivra
sa carrière au service des
ponts et sera plus tard ingénieur en chef directeur (1 classe) à
Nantes où son action est bien
attestée.
Elie et Joseph Decazes d’une part,
François et Robert Cabrol d’autre part : l’épopée de Decazeville
est
vraiment une affaire de familles
!
▼ Robert Cabrol,
Journal de mission
https://patrimoine.enpc.fr/document/ENPC01_Ms_Fol_0194
En 1816, Robert
Cabrol présente à son Ecole son Journal de mission, travail
traditionnel d'élève ingénieur. Une belle écriture, et un prix pour
l'ingénieur en herbe !
Le
Premier
Cercle de 1826 : les premiers actionnaires de Decazeville
Une
analyse détaillée des statuts de la toute
première
Société, dite Compagnie des Houillères et Fonderies
de l’Aveyron, et de ses
fondateurs apporte quelques lumières sur la part relative des uns et
des
autres, dont celle du duc Decazes évidemment. Les parcours publics et
privés de
ces fondateurs ne sont pas quelconques. Les
statuts de la Compagnie ont été publiés dans le
Bulletin des Lois, 1827, n° 104 bis,
p.234 et suivantes de la version pdf de
Gallica BnF.
Question préliminaire : que
représente en 1826 le prix de l’action, soit 3.000 francs ?
Une
réponse : à peu de
choses près, en 1826, c’est 50 ans d’abonnement à un journal comme Le
Figaro,
qui vient de naître, ou le Journal
des débats. …En 2010, cela représenterait donc une somme de l’ordre
de 15.000
€…C’est aussi en 1826, lorsque le kg de pain blanc est à 0,30 franc,
l’équivalent de 10 tonnes de pain. En 2010, pour un prix de 3,34 € le
kg, l’action
représenterait un coût de 33.000 €.
Si
les lignes suivantes
concernent exclusivement les quatorze fondateurs de cette compagnie, il
ne faut
pas ignorer dans ce premier cercle, la présence toute virtuelle, mais
décisive
de trois personnalités, Joseph Decazes, frère du duc, et des frères François et Robert Cabrol, tous trois
polytechniciens de formation. Nous avons par ailleurs dans les pages du
site,
rappelé leur rôle essentiel. Précisons seulement que les frères Cabrol apparaîtront
dans l’augmentation de capital en 1829.
En 1832, il y aura enfin un élargissement plus conséquent de ce premier
cercle
des actionnaires, et l’entrée par exemple dans le capital d’autres
banquiers.
Le rôle de ces trois personnes ne sera pas rappelé ici.
Le Bulletin des Lois 104 bis (juin 1826) présente donc les 14
premiers actionnaires (en fait il seront 15 pour ces 600
actions). Le Bulletin 301 bis de 1829 informe de la
première augmentation de capital,600 actions et les 15
deviennent 28. En mai 1832, Bulletin des Lois n° 018,
nouvelle et
dernière augmentation, avec 600 nouvelles actions ; le total
sera donc de 1800, pour un capital de 5.400.000 auquel on doit ajouter
1.800.000 d'apport du duc avec la remise en pleine
propriété à la société de ses
concessions et autres actifs, contre remise d'actions spéciales.
53 actionnaires apparaisent en 1832, dont Joseph Decazes, les
Cibiel...François Cabrol était actionnaire en 1829. Ses
frères Robert et Auguste seront également présents
dans ce capital. Dans son ouvrage Le
viaduc de l'Ady,
Elie Cabrol, fils de François, cite les premiers actionnaires,
mais en oublie certains, et commet quelques erreurs dans les dates de
présence...

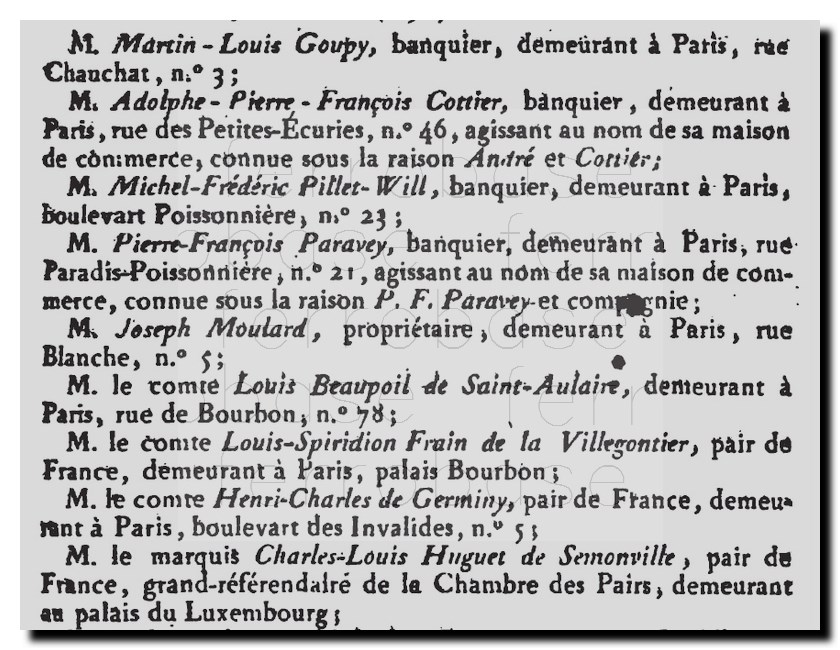
Est-ce un
rappel inconscient de l’action politique du duc entre 1815 et 1820,
constamment
contraint à un équilibre difficile entre progressistes et conservateurs
? Au niveau des membres fondateurs, on
trouve
en effet un groupe de banquiers et un groupe de notabilités, dans un
équilibre
parfait : sept « notables » et sept
banquiers, si nous mettons Monsieur Moulard,
nommé comme propriétaire, dans cette catégorie de notables…
Monsieur
Baudelot
apparaît comme ancien agent de change.
Monsieur Paravey, suite au dépôt de bilan de sa banque, se suicidera en
1828.
Quelques-uns uns de ces actionnaires, de part leur exposition publique,
ont
fait la joie des caricaturistes et dessinateurs divers. Quelques-uns
uns de ces
portraits et croquis apparaissent ici.
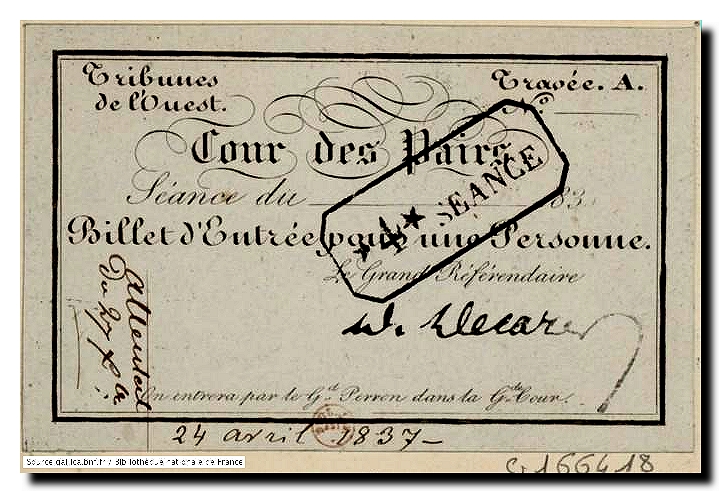 Parmi ces
quatorze fondateurs, la profession de banquier est parfaitement
explicite sur
les raisons d’être présent, en ce début d’industrialisation du dix
neuvième
siècle Mais il n’y a que deux banques présentes en tant que telles. Les
positions de pair et ou de préfet expliquent également les liens avec
le duc,
soit lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, soit en sa qualité de
pair, Grand
Référendaire. Nous avons donc treize bonnes raisons de rencontrer ces
fondateurs. Treize, et non quatorze ! En effet, le cas de Monsieur
Joseph
Moulard est une énigme, pour nous. Que pouvait donc faire ce
"propriétaire" et
quels étaient ses liens avec le duc ? Qui était-il ? Nous avons trouvé
la trace
d’un Joseph Moulard, commissaire général de la Monnaie en 1831, et
celle d’un
homonyme ou le même, intendant du roi de Wesphalie en 1813…
Parmi ces
quatorze fondateurs, la profession de banquier est parfaitement
explicite sur
les raisons d’être présent, en ce début d’industrialisation du dix
neuvième
siècle Mais il n’y a que deux banques présentes en tant que telles. Les
positions de pair et ou de préfet expliquent également les liens avec
le duc,
soit lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, soit en sa qualité de
pair, Grand
Référendaire. Nous avons donc treize bonnes raisons de rencontrer ces
fondateurs. Treize, et non quatorze ! En effet, le cas de Monsieur
Joseph
Moulard est une énigme, pour nous. Que pouvait donc faire ce
"propriétaire" et
quels étaient ses liens avec le duc ? Qui était-il ? Nous avons trouvé
la trace
d’un Joseph Moulard, commissaire général de la Monnaie en 1831, et
celle d’un
homonyme ou le même, intendant du roi de Wesphalie en 1813…
La moyenne
d’âge, calculée sur neuf
fondateurs parfaitement identifiés, est
d’un peu plus de 49 ans en 1826, date de la création de la société.
Certains de
ces banquiers sont connus pour leurs activités en faveurs de classes
moins
favorisées par la fortune.
Six des
notables sont pairs. Il y a quatre
comtes, un marquis, et un duc. Ils furent respectivement nommés pairs (Almanach
royal et national pour l’année 1838 ) :
-marquis de
Sémonville, Grand Référendaire Hon., le
4 juin 1814
-comte
d’Argout, le 5 mars 1819
-comte de
Germiny, le 5 mars 1819
-comte de
la Villegontier, le 5 mars 1819
-comte de
Sainte-Aulaire, le 5 mars 1819 (orthographe
respectée)
-duc
Decazes, Grand Référendaire, le 31 janvier 1818
Plusieurs
sont plus particulièrement liés au duc Decazes, étant devenus pairs par
son
appui, dans la fournée (les fameux 62) du 5 mars 1819, ou préfets, lorsque
le duc était ministre de l’Intérieur. Il y a aussi le lien familial :
la
duchesse Decazes était née Saint-Aulaire. Par ailleurs une fille, Marie
Louise,
de Monsieur Humann, futur ministre des finances, épousera un fils, Charles Gabriel, de
Henri Charles Lebègue, comte de Germiny. Il n’y a pas que les
intérêts qui se croisent ! Sur ce dernier comte, certaines sources
évoquent
comme partenaire dans la création de la société du duc Decazes, Charles
Gabriel
Lebègue de Germiny, gendre de M. Humann,
et non Henri Charles de Germiny
son père. Il nous semble qu’il y a là une erreur, les
statuts, ceux signés devant notaires, mentionnant bien
Henri Charles….
On
mentionnera également, que les liens professionnels et familiaux se
croisent
dans un quasi inextricable nœud bancaire : M. Humann, futur Ministre
des
finances aura à son cabinet Charles
Gabriel de Germiny. Ce dernier rédigera le décret nommant le comte
d’Argout
gouverneur de la Banque de France en 1834. On retrouvera dans les
histoires de
la Banque de France, du Crédit Foncier et de la Caisse d’Epargne les
patronymes
de Humann, Germiny, Argout, Pillet-Will…Le comte d’Argout, qui fera l’éloge funèbre du ministre Humann en
1842, a lui-même été ministre dans quatre portefeuilles différents au
cours de
la décennie 1830-1840. Le comte de Germiny fils, Charles Gabriel sera à
son
tour ministre des finances en 1851…et fera l’éloge funèbre du comte
Pillet-Will
en février 1860.
Les
compétences de certains sont
remarquablement en adéquation avec les
visées industrielles du duc : Louis Spiridion Frain de la
Villegontier
est ingénieur polytechnicien, X 1794, et du corps des mines, alors que
Louis
Beaupoil de Saint Aulaire, polytechnicien également de cette première
promotion, 1794, est du corps des Ponts et Chaussées.
Le duc Decazes remplacera
plus tard Charles de Sémonville comme Grand Référendaire,
pratiquement
Président, de la chambre des pairs au palais du Luxembourg. Certains de
ces
investisseurs ont laissé une trace durable dans l’histoire. Monsieur
Humann,
qui fut plusieurs fois ministre des
finances, avait pris des participations financières dans les mines
d’Audincourt
en 1824, dans les Salines de l’Est en 1825. Il fut le premier Président
de la
Compagnie de Decazeville, présidence qui n’échut donc
pas au duc Decazes… L’Aveyron connaîtra également Monsieur
Humann comme député en 1828 à Villefranche de Rouergue.
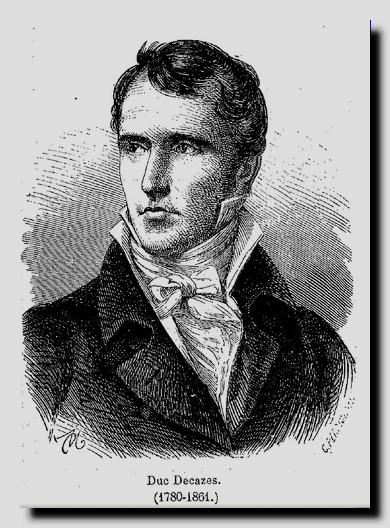
duc
Decazes, par Dunki
Le
Comité
d’Administration de la société était constitué, suivant l’article 18, du duc Decazes, de MM. Humann, Président,
Dominique André, Pillet-Will, Baudelot, Goupy, Milleret, Paravey. Il y
avait
deux suppléants, MM. Moulard et d’Argout. On retrouve à ce Comité les
six
premiers actionnaires (en nombre d’actions). M. Paravey est au
neuvième rang,
et M. Milleret au dernier et quatorzième…Seules deux banques en tant
que telles
sont présentes : André et Cottier, et P.F. Paravey. Tous les autres
sont
présents au capital à titre personnel. Cette disparité montre peut-être
la
difficulté, évoquée par certains, du duc Decazes pour construire, "mendiant ", son
capital. La totalité des actions n’était d’ailleurs
pas souscrite à la date de
création, 576 sur 600.
Le cercle
restreint des six pairs montre, on s’en doute,
une remarquable unité de pensée. C’est ainsi que la
Biographie pittoresque des pairs de
France, Eugène-François Garay de Monglave, Paris, 1826 (Google books)
décrit le duc Decazes et ceux qui l’entourent (extraits) :
Comte d’Argout : "….il vote avec les
défenseurs de nos
libertés ".
Duc Decazes : "..on a bien des reproches à
lui faire,
mais il parait aujourd’hui s’être rallié franchement aux amis d’une
sage
indépendance ".
Comte de Lavillegontier : "…C’est un ancien
camarade de
M. Decazes à l’école polytechnique ".
Comte de Germiny : (ancien) " …député à la chambre
introuvable…… C’est un brave homme qui ne vend pas davantage sa
conscience à la
chambre des pairs ".
Marquis de Semonville : " …Il reprit, à la
seconde
restauration, les fonctions de pair et celles de grand référendaire… ".
Comte de Saint Aulaire : " …Il comprend la
liberté et il
sait la défendre ".

Humann,
par Daumier.

Ci-dessous, Humann, par Gabriel Christophe Guérin,
(DR, avec autorisation du Musée historique de Strasbourg,
photographie Mathieu Bertola )
Le
portrait ci-dessous se retrouve également sous la forme d'une
photographie dans Biographies
alsaciennes, série 2, par Antoine Meyer. Ce photographe de Colmar,
né
en 1845 et qui n'a pas connu le ministre présente en 1884 une
photographie du tableau, mais légèrement retouchée (pourquoi donc ? )
sur des détails
vestimentaires, boutons ou veste. Monsieur Humann figure
évidemment dans la même pose, debout, bras croisés, en pantalon
blanc et épée au coté. Précisons enfin que Monsieur Humann fut un
temps, suite à une infidélité un peu forcée à l'Alsace, député de
l'Aveyron.

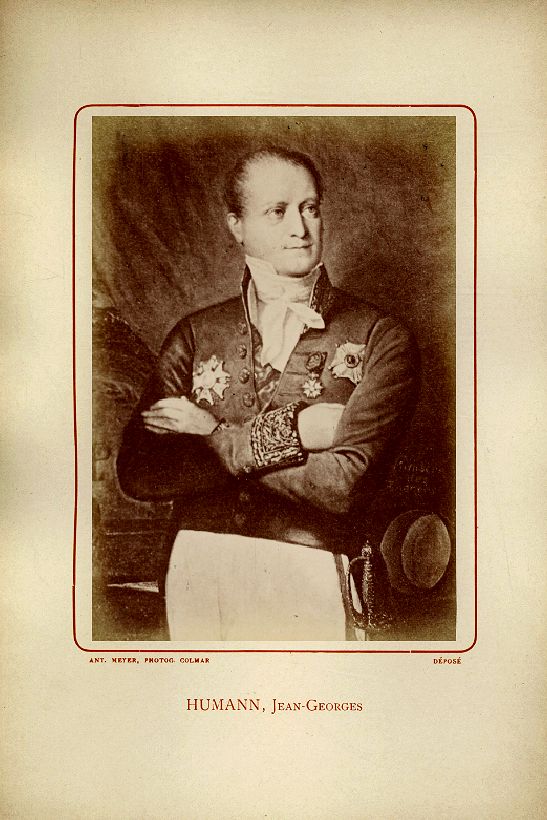

▲ Jean Georges
Humann, décédé dans son bureau de ministre...
▼
En savoir plus sur la famille Humann ?
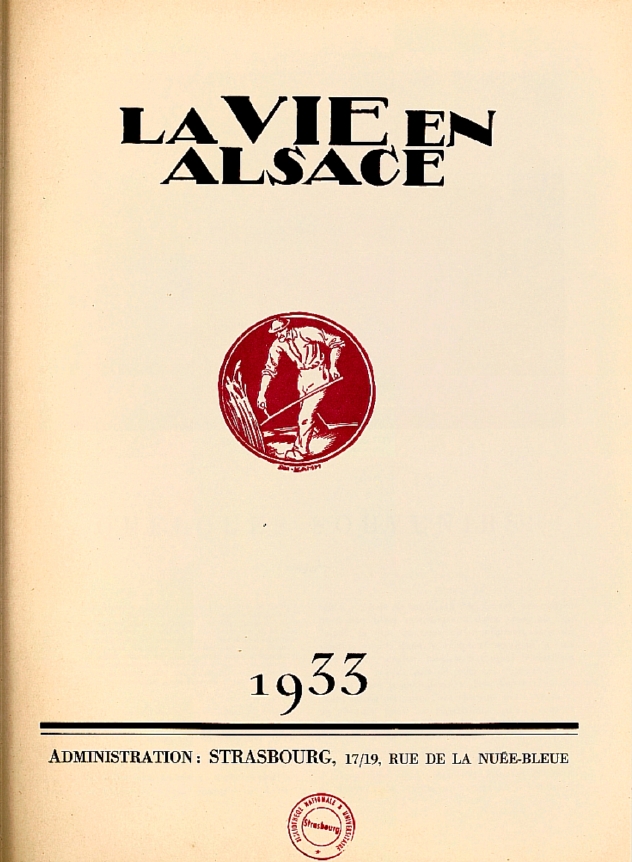
et
ici ▼
Les
appréciations précédentes sont toutes de
l’année même de la création de la Compagnie. On aura compris que le
comte de
Lavillegontier est aussi le comte de la Villegontier, et que
l’évocation de
Decazes concerne le frère, Joseph, qui
fut par exemple préfet du Tarn, et était bien ingénieur polytechnicien
de la
première promotion, 1794. Ces citations ne doivent pas être prises trop
au
sérieux : à cette époque l’objectivité n’est pas de mise, et on aurait
pu
trouver des portraits beaucoup plus critiques…
Les
investisseurs privés, non
banquiers, c'est-à-dire les six pairs, menaient une activité politique
reconnue
à la chambre, et n’y faisaient pas que de la figuration. Leur activité
apparaît, par exemple, dans le comité des pétitions. Ce comité est
constitué de
six membres, élus dans les bureaux par les pairs. On peut donc penser
que les
élus au comité sont plus ou moins, et plutôt plus que moins, élus en
regard de
leurs compétences et activités. Tous les fondateurs de Decazeville,
sans exception, furent membres du comité :
par exemple, le
comte de La Villegontier, aux sessions de 1825 et 1828, le duc Decazes
et le
comte d’Argout en 1830, le comte de Saint Aulaire et le comte d’Argout
en août
1830, le duc Decazes en 1831 et 1833, le comte de Germiny en 1835 et
1837, les
comte de Germiny et M. Humann en 1838… (Archives nationales,
Chambre des Pairs, registre du comité des
pétitions, 1814-1848, J. Mady, 2002 ).
Le groupe des notables entourant le
duc est donc constitué de personnes impliquées fortement dans la
société de ce
premier quart du dix neuvième siècle. Leur situation en 1826 est
pratiquement
définitive, et ils ne recherchent sans doute pas absolument un profit,
semblant
être là plus par sympathie pour le duc que par intérêt spéculatif.
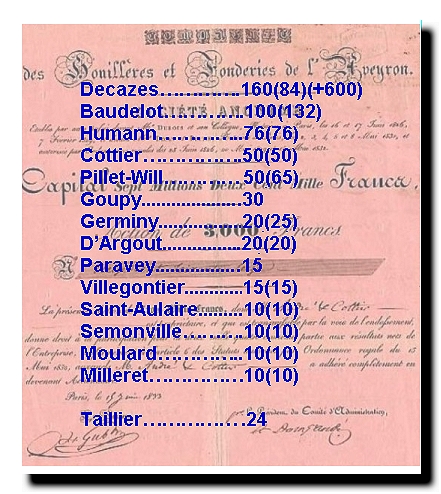 Le premier cercle : actions
souscrites en 1826 (en 1829 ) (+ actions spéciales )
Le premier cercle : actions
souscrites en 1826 (en 1829 ) (+ actions spéciales )Une parenthèse arithmétique
Le
nombre
total des actions souscrites étant de 576- pourquoi donc la
totalité des 600
premières actions prévues n’était-elle pas
dès le départ placée ?? - le total souscrit
par les banquiers est de 265, 46%, et
les notables se partagent 311 actions, 54 % du total : un hasard dans cette répartition ? Sans doute pas.
L’attribution
des 24 actions restantes au pool des banquiers ne changerait rien à la
conclusion.
L’article 3
des statuts donne au duc Decazes 33%
des bénéfices de la société, contrepartie des " avantages " apportés. L’article 11 permet
la création et attribution de 300
actions spéciales au duc. L’article 18 règle le fonctionnement du
Comité
d’Administration : sept membres, chacun a droit à une voix, quel que
soit le
nombre d’actions possédées, et 3 suppléants. Le duc siège au Comité, et
s’il
n’en fait pas partie a droit à participer avec voix consultative (art
18).
L’article 36 précise le fonctionnement des Assemblées Générales : 3
actions
donnent droit à une voix, avec un maximum de 20 voix par actionnaire.
Ceci
précisé, nous vous proposons un peu d’arithmétique, économique,
financière et
électorale.
Le duc Decazes est l’actionnaire principal : 160
actions
souscrites, soit un déboursé de 480.000 francs. En faisant l’hypothèse
que les
300 actions spéciales représentent réellement la valeur de son apport,
on peut
donc estimer à 300*3000 francs, soit 900.000 francs cet apport en
nature, d’où
un investissement total du duc en 1826
de 1.380.000 francs. Monsieur Baudelot vient ensuite, pour 300.000
francs, puis
Monsieur Humann, 228.000 francs, présenté semble-t-il donc à tort
quelquefois comme
second actionnaire…Il est en effet le second de la liste sur le texte
du Bulletin
des lois, mais non le
second actionnaire. Le total banquier est de 795.000
francs (30 %) et le total des
autres
notables investisseurs sera de 1.833.000 francs, soit 70% du total de
la
société du futur Decazeville en 1826, actions souscrites et apports en
nature.
On peut donc noter que la mise sur
rails de la Société est essentiellement le fait de notables, et non de
banquiers. Ces derniers étaient-t-ils frileux sur des investissements
industriels, ou est-ce la volonté de Elie Decazes de ne pas se mettre
trop à la
merci du secteur de la banque ?
Sur ce montant global, 2.628.000 francs, la part amenée donc par
le duc Decazes, 1.380.000 francs, représente un peu plus de 52 % du
total, très
très loin devant Monsieur Baudelot,
11,4 % ou Humann, 8,6 %. On retiendra
également que les banquiers (avec
30,25 %) ne sont pas, et de loin,
majoritaires dans ce capital. L’importance relative du duc
montre bien
que cette création est avant tout le fait d’un homme, et non d’un
groupe
d’investisseurs. La part des deux banques (Cottier et Paravey)
ressort à 65
actions seulement, soit en valeur 7,5 % seulement du capital.
Decazeville est
donc en 1826 une affaire privée.
Si Elie
Decazes apparaît donc comme le personnage central, avec ses 52 % de
capital, l’application de l’article 36
sur le plafond des voix en Assemblée Générale, amène une constatation
curieuse.
Les 300+160 = 460 actions du duc valent
460/3 voix, soit 153, et donc 20 par application du dit article
36 et de
son critère de plafonnement. Lequel plafond est également applicable
aux
actions de MM. Baudelot et Humann, qui se retrouvent avec 20 voix chacun en Assemblée Générale, tout comme le duc Decazes. Ce calcul d’arithmétique
financière et électorale porterait
alors à constater, qu’en Assemblée Générale, type 1826,
et seulement en AG, Elie Decazes aurait
14,29 % des voix, MM. Baudelot et Humann, idem, etc…. La part en voix
du
groupe des banquiers atteint de ce fait
54 % contre 46 % au noyau des
investisseurs notables privés. Il y a là une contradiction avec
leur
position minoritaire dans le capital… Heureusement que les articles 3 (33 % des bénéfices) et 18, par exemple,
étaient là pour sauvegarder les intérêts du duc ! Etre
pour 52 % dans le capital, et n’avoir droit en
AG qu’à 14 % des voix intrigue….Ou alors
c’est que les AG, convoquées au 1 er avril de chaque année, ne
représentaient
pas un rouage capital dans l’administration de la Société…On notera
aussi, que
l’attribution des 300 actions spéciales ne change rien à ce calcul :
présentes
ou pas, le résultat, suite au plafonnement,
est exactement le même, 14,29 % de voix ! Ces
dispositions de plafonnement
ne sont pas, sauf erreur, en
1826 d’ordre légal : nous avons retrouvé la même année des dispositions
très
diverses dans des statuts de société, comme aucun plafonnement, ou dix
voix….
La lecture
des statuts informe sur les 300 actions spéciales, et l’attribution des
33% des
bénéfices au duc. Est-ce à dire que le duc n’avait droit qu’à 33 % des
bénéfices ? Certainement pas. Après attribution des 33% des bénéfices,
les 66%
restant étaient répartis proportionnellement au nombre des actions
détenues.
Dans ce très probable calcul, le duc se voyait donc crédité, possédant
(160+300) = 460 actions sur un total de 900 (600+300), de 51% des
bénéfices
restant à distribuer. Le fondateur principal de la Société pouvait donc
au
final espérer 67 % des bénéfices à
venir…ce qui ne fut jamais le cas. La Société ne dégagera, on le sait,
des
bénéfices que bien après cette création de 1826 et
le nombre alors accru des
actionnaires diminue les 51 % de clé de répartition.
Le résultat après 1829 est présenté
plus loin.
Pour
résumer : 14,29% des voix en AG, une voix sur 7 (14,29
%) en Comité
d’Administration, 33 % des bénéfices, valeur minimale garantie, et 52 % d’apport, sont les chiffres clés en
1826 du duc Elie Decazes
dans ses implications minières en Aveyron.
Ces chiffres ne doivent pas masquer la croyance dans le progrès
qui animait ces personnes. Il était en effet sûrement difficile dans
les années 1820-1830 d'anticiper le devenir des fontes à la houille,
technologie de base de la compagnie du duc. Les courbes de production
des fontes au bois et à la houille sur l'étendue du siècle montrent en
effet que les fontes au bois étaient en 1826 les plus communes. Leur
croissance était également plus forte que celles à la houille. On ne
peut que rester étonné devant la clairvoyance de ceux qui
allaient attendre le milieu du siècle pour voir se confirmer leur
croyance initiale...Le premier graphique montre la seule période
1819-1846 (d'après un rapport du
Jury central de l'exposition de Paris, 1849, p.295).
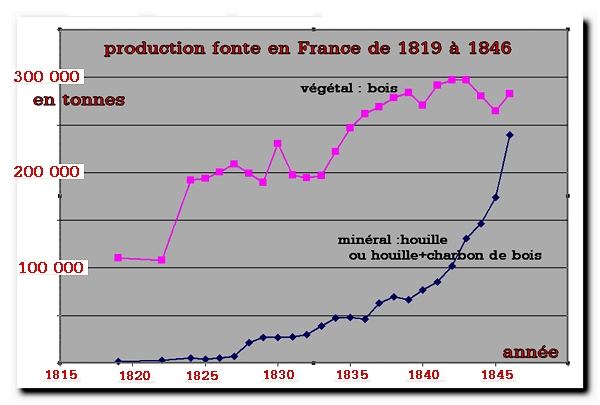
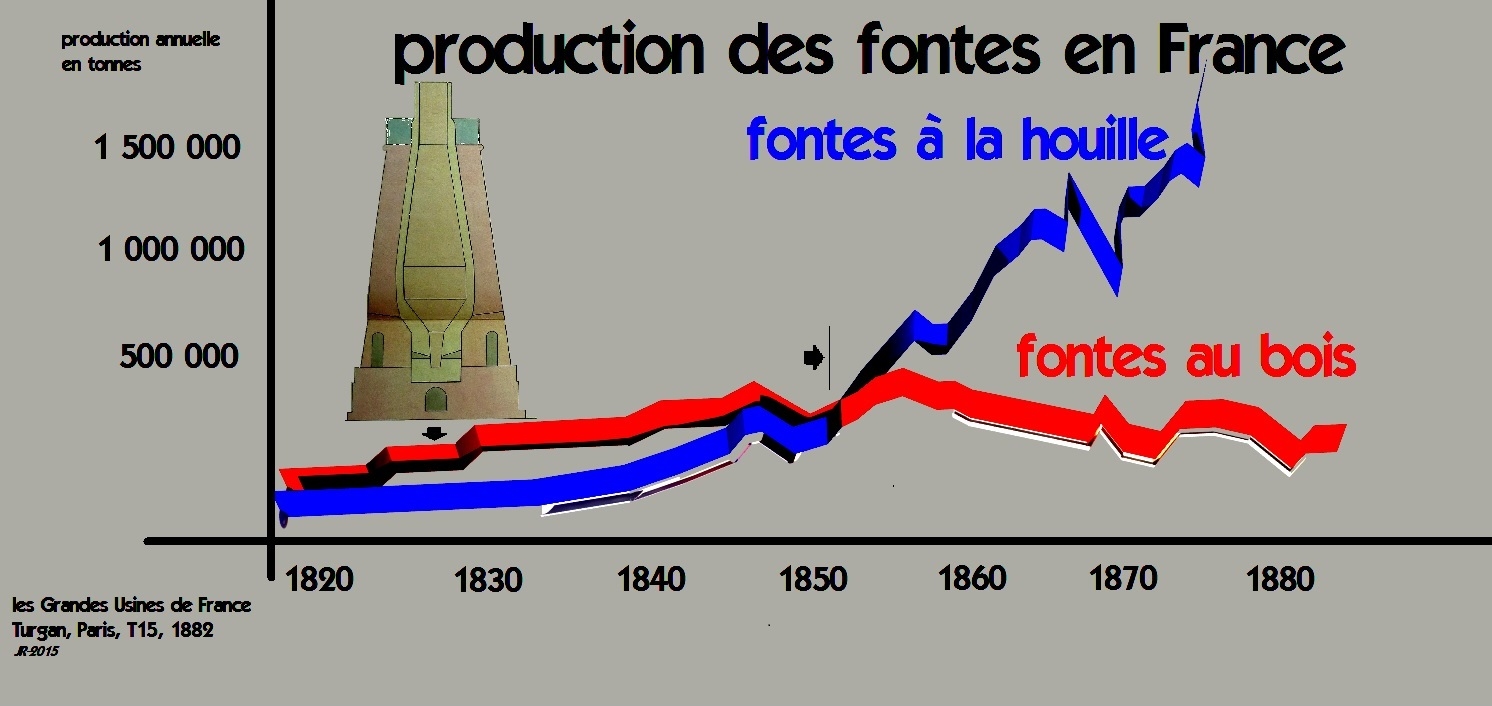
Nota
: en 1781 s'établit au Creusot la première entreprise qui ait été créée
en France en vue de fabriquer et d'élaborer la fonte de fer au moyen du
combustible minéral (in G. Crepel, Le Haut pays minier, p.92, Espace
Sud, 1995)
C'est
avec une certaine exagération que la dédicace à François Cabrol, sur sa
statue, fait du maître des forges rouergat l'importateur de la
technique...


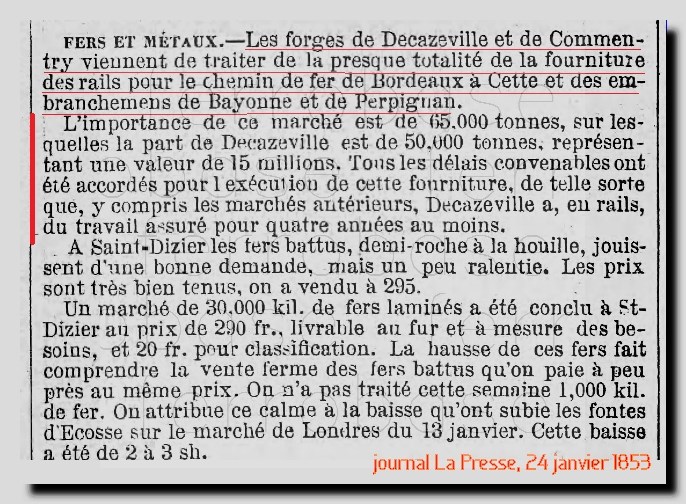
Ci-dessus,
un épisode glorieux des forges de Decazeville, épisode décrit par
ailleurs, qui ne se confirmera pas....
Le Deuxième Cercle
En 1829 un acte additionnel,(publié
au Bulletin des Lois, tome onzième, n° 301 bis du règne de Charles X,
Google
books)
daté du 7 février est passé
devant le notaire François Dubois ayant pour but de doubler le capital de l’entreprise. " Pleinement
rassurés…sur les ressources en minerais et ….convaincus des succès de
l’entreprise " les associés de la première heure décident de
doubler le
capital en doublant le nombre des actions. Les 600 nouvelles actions
sont
toutes souscrites.
Un premier
intérêt de ce document est qu’il nous précise que les 600 actions
initiales
avaient bien été souscrites. En analysant le nom des actionnaires, on
trouve en
effet un Jean Baptiste Ange Amédée Melin, vicomte du Tailier. Comme il
n’apparaît pas comme nouvel actionnaire, c’est donc qu’il était le
dernier des
actionnaires du premier cercle, et nous lui attribuons donc les 24
actions qui
n’avaient pas de propriétaire en 1826.
Cette
première modification ne change aucune de nos conclusions précédentes,
sauf sur
l’équilibre que nous trouvions parfait entre notables et
banquiers : après
1826, et avant 1829, il y aura donc huit notables et sept banquiers, en
noms
personnels ou au nom de leur société.
Parmi
les souscripteurs de 1829,
nous allons retrouver douze des quinze
premiers. La confiance est de mise dans l’avenir de
la Compagnie. Monsieur Paravey n’est pas cité, et on comprend
cette absence. MM. Goupy et le vicomte de Tailier (Taillis) restent
sur leur mise
initiale. On compte 13 nouveaux actionnaires, et parmi eux, 5
aveyronnais. Il
n’y en avait aucun parmi les quinze premiers.
Les
articles 3 et 11 amènent une nouvelle
création et attribution de 300 actions spéciales au duc, qui en retour de ces avantages
consent à prolonger de quarante-neuf ans la mise à disposition
des biens
qu’il apporte.
Le rang des
actionnaires ne connaît pas de bouleversement à l’occasion du
doublement de
capital. Le duc Decazes voit son importance relative (il possède 844
actions
sur les 1800 de la nouvelle composition de 1829) diminuer
un peu et
s’établir à 46,9%, M. Baudelot 11%,
Humann 8,4%, Pillet-Will 5,6 %, Cottier, 5,6 %, de Germiny 2% et
d’Argout 2 %.
Il s’agit là des premiers de la liste. L’ensemble des autres
actionnaires
représentent 2 ou moins de 2% chacun de ce capital. Lorsque des
bénéfices
seront à distribuer, le duc sera toujours crédité des 33 % statutaires
réservés et des
46,9 % du restant, soit 31,2 %, donc au final percevra 64 % des
bénéfices.
Cette
analyse peut être l’objet de corrections, à notre sens mineures. M.
Baudelot
n’est plus là ; on trouve J.J. Baudelot comme nouvel actionnaire
(5
actions) et madame Baudelot, épouse Detaillis pour 132 actions. Il y a
aussi
le cas de M. Pillet-Will (65 nouvelles actions) qui agit en 1829 pour
le compte de sa
compagnie, et donc plus en son nom personnel. Il est possible également
que des
actions aient pu faire l’objet de ventes entre actionnaires…
On notera
enfin dans ce deuxième cercle,
l’apparition des Frères Cabrol, François, le Directeur de la
Compagnie
pour 10 actions, ce qui n’est pas négligeable, et son frère Robert,
ingénieur à
Alby, pour 4 actions, ainsi que la
position de Monsieur de Bonald, payeur
à Rhodez, qui est donc l’actionnaire le
plus minoritaire de tous avec deux
actions…et donc, sauf erreur, sans voix à l’Assemblée Générale, ou
une ?
Pour
résumer : 9,17 % des voix en
AG, toujours une voix sur 7 (14,29 %) en Comité d’Administration, 33 % des
bénéfices, valeur minimale garantie, 64% valeur
maximale, et
47 % d’apport, sont les chiffres clés en 1829 du duc
Elie Decazes dans ses
implications minières en Aveyron. Ces chiffres ne vont pas varier
sensiblement
tout au long de la vie de la Compagnie.
Le
15 mai 1832, une ordonnance du Roi
approuve une délibération de l'assemblée des
actionnaires de la compagnie. Une nouvelle, ce sera la dernière,
augmentation de capital est faite, le portant à 7.200.000 francs
: 3.600.000 du capital initial des 1200 actions, après la
seconde augmentation, auquel s'ajoutent les 600 actions du duc et
600 nouvelles actions de 3000 francs à émettre. Ce nombre
de 2400 actions ne variera plus. Parmi les souscripteurs nouveaux, dont
la liste figure à l'ordonnance du Bulletin des Lois, nous
relevons le vicomte du Taillis (50), Cabrol (17), sans indication de
prénom,la banque Pillet-Will (183), Humann (34). 11 actions
seront la propriété des Cibiel fils aîné et
jeune, un nombre modeste. On sait que Cibiel venait à cette
époque, en 1831, de céder l'une de ses concessions
au frère du duc...Ce frère, Joseph, souscrira 5 actions.
Parmi les modifications majeures de 1832, il faut noter la cession en
pleine propriété à la société des
apports du duc Decazes, auparavant concédés en jouissance temporaire.
Le duc de Cazes (sic ! ) consent
à réduire à un intérêt d'un quart sa
part sociale d'un tiers qui lui avait été primitivement
alloué dans les résultats de l'entreprise.(art 2). Les 600
actions spéciales du duc sont transformées en actions assimilées en tout point
à celles dont le montant a été versé en argent. (article 5).
Pourquoi eux ? Galerie de portraits.
Une simple
question, dont la réponse n’est pas évidente : pourquoi ces 13 ou 14
compagnons, et quels sont donc leurs liens avec le duc Decazes ? Nous
avons
donné quelques éléments de
compréhension, les positions de pairs ou de préfets, ou un lien
familial, (Elie, gendre de Saint Aulaire), qui
peuvent expliquer cette présence, tout comme les combats politiques du
duc
entre 1815 et 1820. Voici, pour
prolonger cette connaissance des fondateurs, quelques éléments
complémentaires,
cette fois principalement sur le noyau des banquiers, moins connus, car
beaucoup
plus discrets dans la société.
ANDRE et COTTIER,
Il
s’agit d’une banque et non
d’un particulier, banque fondée en 1800 par
Dominique André et son neveu François Cottier. Ce sont des
banquiers
protestants, dans une tradition saint-simonienne.
 ◄François Cottier (Wikipedia)
◄François Cottier (Wikipedia)
François
Cottier sera un des
fondateurs de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Paris, créée sur
l’initiative de Benjamin Delessert, en
1818, avec, entre autres, Louis Goupy,
et Frédéric Pillet Will qui sont membres de ce premier cercle avec le
duc
Decazes. C’est une banque solide, impliquée régulièrement dans le
placement des
emprunts d’Etat.
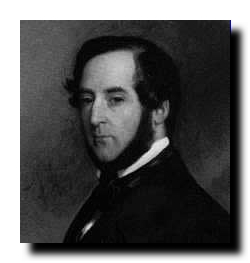
Ernest André, le fils de Dominique,
est le gendre de François Cottier, en épousant Louise Cottier en
1832. Ce fils Ernest sera plus tard ami de Morny, celui qui fut
sûrement et
plus d’une fois, sur le chemin de Cabrol, par son action dans la vallée
voisine, à Aubin.
Au
décès de F. Cottier, en 1843,
la banque se maintient avec Marcuard. Elle est " parmi les premiers
noms de
la banque de l’époque ". Ses implications industrielles concernent
par
exemple des canaux (Bretagne, Nivernais, Berry, Briare), de
l’immobilier à
Paris, des compagnies d’assurance…
En 2010, le souvenir de André et Cottier se retrouve dans le
musée Jacquemart André à Paris. La banque serait
classée de nos jours AAA…Le portrait ci-dessus est celui
d'Ernest André. Le site www.museeprotestant.org présente
une page spéciale André et le (beau) portrait de Dominique André.
Martin
Louis GOUPY
Il
intervient sous la profession de banquier,
mais à titre
personnel. Il est également connu pour ses fonctions de régent, un des
quinze
administrateurs, de la Banque de France, de 1811 à 1826. Son père
Guillaume qui fut
lui aussi régent en 1814 de la Banque de France décède
en 1819, et sera remplacé au fauteuil de
régent par… François Cottier.
Le
père de Martin Goupy
s’était associé
à son oncle Busoni,
italien, pour fonder la banque Busoni, Goupy et Cie en 1805 ; après sa
disparition en 1819, sa fortune sombrera peu après dans la
faillite de son fils. C’est en effet
Martin Louis qui a succèdé à la banque avec Busoni après 1819.
Martin
Louis Goupy est donc déclaré en
faillite en 1821, puis, curieusement, à
nouveau en 1829 (Archives de la Seine). En 1823, il était
cité
comme "ancien
banquier ". Les origines italiennes de Busoni
expliquent les intérêts italiens de cette banque.
La
famille Goupy est une famille
à la généalogie complexe. Au siècle précédent, le grand-père de Martin
Louis
Goupy était un entrepreneur ayant une grande activité à Paris.
Martin Louis a
épousé Angélique Thérèse Ducos dont le
père Basile fut également régent de la Banque de France.
La faillite de Martin Louis Goupy
cause alors des soucis à ce beau-père qui avait en 1826 fait paraître
dans le moniteur
universel (le Journal Officiel de l’époque) une note précisant
qu’il
n’avait "aucun intérêt dans aucune
entreprise ou compagnie industrielle "
. Cela visait-il les investissements de son gendre ? M. Ducos
était un
ami du duc Decazes, en tout cas
suffisamment pour que le duc le recommande au consul à Londres lorsque
ce
beau-père jugera
prudent de s’éloigner
de Paris et du ministère Villèle dont il se sent persécuté. C'est
peut-être ce beau-père Ducos qui a facilité les contacts entre Goupy et
Decazes...
Michel
Frédéric PILLET-WILL, (comte,
après 1826)
Banquier, il intervient ici en son nom.

armoiries
Pillet-Will
D’origine
savoyarde, il épousera
Françoise Will, fille du banquier genevois du même nom chez qui il
travaillait,
et ajoute alors le patronyme Will au sien.
"Prototype de l’homme charitable ", il sera auprès de Delessert pour la
création de la Caisse d’Epargne à
Paris. Il était apparenté à celui-ci par sa belle sœur, née Will.
Il crée sa propre banque en 1821. Il
sera régent de
la Banque de France de 1828 à 1861, une longue période. Ses activités
sont
connues dans le monde des compagnies d’assurances, les mines, et les
chemins de
fer.
Nous
avons déjà évoqué M.
Pillet-Will : membre du Comité d’Administration, et devant les
résultats disons
insuffisants de Decazeville, il se déplacera en Rouergue pour ce qui
aujourd’hui porterait le nom d’audit. Le résultat fut publié sous le
titre de Examen
analytique de l’usine de Decazeville, Paris, P. Dufart, 1832. Cet
examen ne
fut pas du goût de François Cabrol, qui abandonnera de ce fait la
direction de
la Compagnie, pour revenir quelques années plus tard.
► Voir ici pour plus
d'informations sur l'Examen analytique de l'usine de Decazeville
Il fut un mécène
pour la
Savoie (Frédéric-Michel Pillet-Will,
Mécène de la Savoie 1781-1860, par Maurice Messiez, sur le
site de
la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie). Paradoxalement,
si cette
action publique est bien connue, trouver son portrait, y compris en
Savoie, est œuvre difficile….Nous vous proposons ci-dessous un
portrait, par Benoit Hermogaste Molin, 1810-1894 . Une version
plus satisfaisante sera prochainement en ligne. Le portrait présenté a
été offert par Michel-Frédéric Pillet-Will lui même à la ville de
Montmélian. On pourra lire dans le bulletin
de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie
(Bnf), 1925, tome 62, le récit de cette remise et du banquet organisé
à cette occasion. La photographie du tableau est extraite du
bulletin.
Il
publia, De la dépense et
des produits des canaux et des chemins de fer. De l'influence des voies
de
communication sur la prospérité industrielle de la France, Paris, 1837,
P.
Dufart, une grosse étude de plus de
400 pages, dont la rédaction n’est pas sans rappeler celle de son Examen.
Son
éloge funèbre à Paris par M.
de Germiny, souligne deux constantes de son action, sa présence pendant
32 ans
à la Banque de France et sa générosité pour la Savoie, son pays natal
(in La Gazette de Savoie, 19 février
1860).
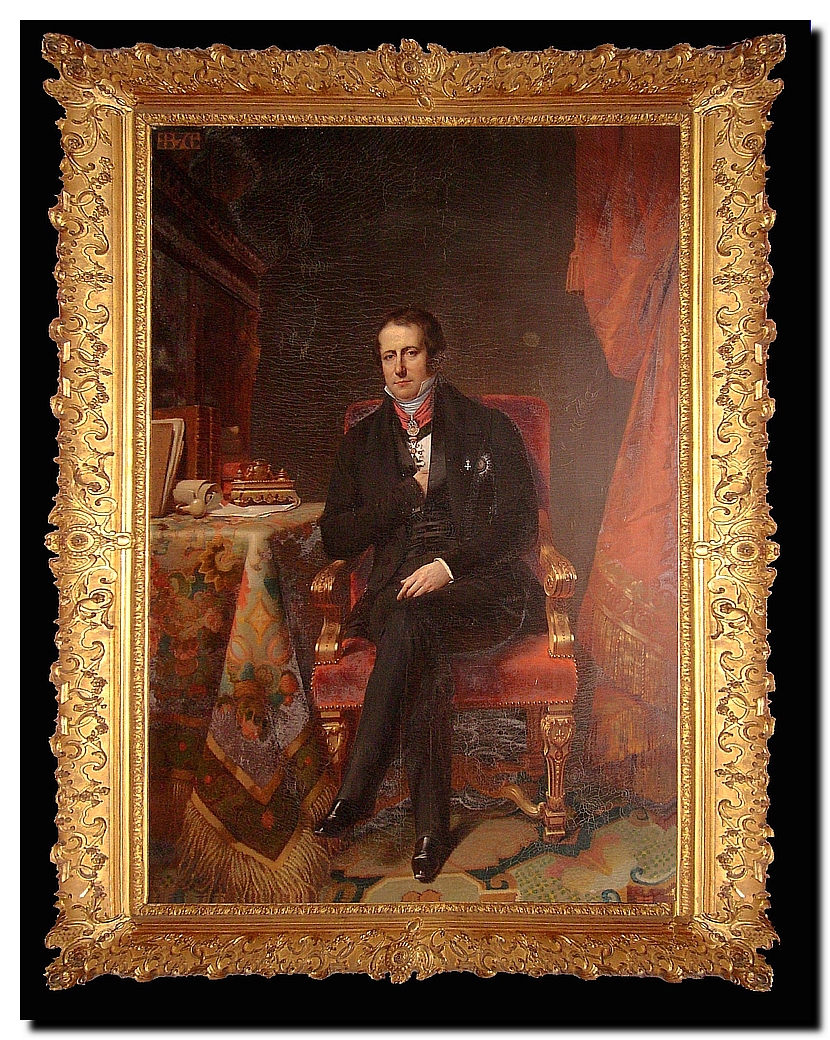
le
comte Pillet-Will, par B. H. Molin, 1843
Infographie Jean Rudelle
sur document du Service du
Patrimoine, Ville de Montmélian (Savoie)
Pierre François
PARAVEY
Il agit au nom de
sa
banque,
Il
fonde celle-ci en 1818 commanditée par le
Duc de Dalberg.
Le capital sera de 1,5 millions de francs. Le Prince de Talleyrand sera
un peu
plus tard de cette aventure en
s’associant en 1824 avec un apport d’un million de francs, et la
promesse de 20
% des bénéfices.
Seul
gérant, mais son frère sera un
moment dans la banque, ses intérêts
spéculatifs se retrouvent dans des mines, les canaux….
P.F.
Paravey était une personnalité
bien différente des précédents banquiers. Son associé, le duc Dalberg,
apporte
une réputation sulfureuse d’aventurier des affaires, de toutes natures.
Les
activités de la banque semblent "être des affaires dangereuses " pour cette banque devenue rapidement
importante sur la place de Paris. Ses spéculations sur les terrains et
hôtels
particuliers de la capitale conduiront à sa perte. Il sera des préteurs
au
nouvel état d’Haïti, devenu indépendant, mais obligé de payer aux
anciens
colons français une somme de 150 millions…
Des
spéculations sur les blés, la faillite de certains de ses créanciers
conduisent
au suicide P.F. Parevey en avril 1828. Les tribunaux auront alors à
connaître
de nombreux litiges sur la succession du gérant. Cette faillite se
solde par
des millions perdus par le prince de Talleyrand et quelques autres
partenaires.
Jacques MILLERET
Banquier,
agissant en son nom
Il faut croiser beaucoup de sources, tourner bien des pages et confronter le tout
pour obtenir une vision claire de Monsieur Milleret. Il était pourtant
une
personnalité reconnue dans le domaine minier et nous apparaît comme une "grande pointure industrielle"
auprès du duc Decazes.
Il est né à
Jonchery, Haute Marne, un 15 juin 1779
et a donc 47 ans en 1826, dans la moyenne de ses collègues. Il décèdera
en août
1864. Un temps député de la Moselle (mais
pourquoi n’est-il donc pas dans les
annuaires ? ) il démissionne en 1831. On le cite également
comme
secrétaire d’état…Il sera receveur général des finances dans la Moselle
et
réside habituellement à Metz.
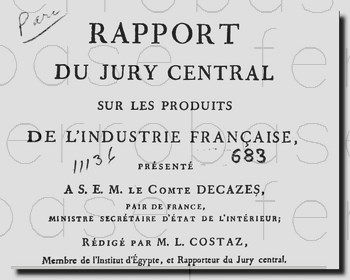 Les aspects
qui nous concernent débutent en 1817 lorsqu’il suit l’initiative de
Beaunier,
premier directeur de l’école des mines de Saint-Etienne, en fondant
l’usine de
la Bérardière à Saint-Etienne. Spécialisée dans le travail des aciers,
elle va
devenir rapidement une référence.
Les aspects
qui nous concernent débutent en 1817 lorsqu’il suit l’initiative de
Beaunier,
premier directeur de l’école des mines de Saint-Etienne, en fondant
l’usine de
la Bérardière à Saint-Etienne. Spécialisée dans le travail des aciers,
elle va
devenir rapidement une référence.
Sous la raison sociale Beaunier, de Brou et
Cie (la première épouse de M. Milleret était née Eléonore....de
Brou) les aciéries se font remarquer à l’exposition de 1819 par
une
médaille
d’or. Le duc Decazes se souvient peut-être en 1826 du rapport écrit qui
lui fut
fait sur l’exposition. En 1820 nous retrouvons Milleret siégeant au
titre Acier
au Conseil Général des Manufactures, conseil mis en place et présidé
par le
duc. Jacques Milleret possède des implantations à Paris, Metz et au
Luxembourg.
En
1818
Milleret participe à la création, avec Louis de Gallois (X1794, même
promotion que d'autres actionnaires de Decazeville ! ) et
d’autres,
de la Compagnie des mines de fer de Saint-Etienne. (statuts complets dans Bulletin des lois, 7 série,
tome 12, Google
books, bulletin n° 428, et ordonnance de création, n° 417 du 25
octobre 1820). Curieusement Milleret ne figure dans aucune liste
des
actionnaires….En 1821
cette compagnie va être une des premières à mettre en place des forges à l’anglaise, et introduire donc
la technologie de la fonte à la houille. (voir Antoine NAEGEL, Négociants en
fer et forges à l’anglaise,
1817-1826, http://halshs.archives-ouvertes.fr). Des hauts
fourneaux sont
construits en 1822 et 1825. Il sera également un des fondateurs du
chemin de
fer de Saint-Etienne à la Loire, et figure expressément dans les
actionnaires.
Sa domiciliation au 7 rue d’Antin est identique à celle figurant dans
les actes
de la compagnie du duc Decazes. M. Milleret poursuit des implantations
dans des
aciéries en Isère, Baupertuis et Allivet. Dans les années 1840, il
écrira beaucoup
sur les chemins de fer, soutenant les principes de la garantie d’un
minimum
d’intérêt par l’Etat ou celui de
l’apport des terrains par les communes et les départements aux
compagnies de
chemins de fer.
Sa fortune le verra dès 1812 propriétaire
du domaine de Preisch, à la
frontière du Luxembourg. Les crises économiques de 1830 vont provoquer
une
multitude de faillite, dont la sienne. Il revendra cette propriété et
le
château en 1832. Il sera déclaré en faillite en 1831 au Luxembourg,
tout comme en
France.
Jacques Milleret, une très bonne
pioche pour le duc Decazes, devait être pour le Comité d’Administration
où il
siégeait, le spécialiste incontestable,
faisant sur son nom la synthèse d’activités bancaires, minières et
industrielles. Il avait un parcours un peu similaire à celui du duc
Decazes
dans la Loire, avec plus de dix ans d’avance.
En 2010, le souvenir reste très vivace d’une de ses filles
fondatrices
des sœurs de l’Assomption, canonisée dernièrement, en 2007. De
caractère décrit comme "voltairien "
peut-on lire, un de ses fils sera polytechnicien (X1872). Nos
recherches nous amenant à nous intéresser à
sa fille, Marie Eugénie, vont nous mettre sur la voie d'une
pépite, la photographie de ses parents, trouvée bien loin d'ici !
Voici donc, sans regrets sur la qualité approximative du document, mais
sans doute une rareté, les photographies de Madame et Monsieur
Milleret, il y a donc....longtemps.
 Madame,
Monsieur Jacques
Milleret
Madame,
Monsieur Jacques
Milleret
Le
quinzième homme….
C’est
celui
qui ne faisait pas partie des quatorze premiers en 1826, et qui
apparaît
furtivement au bas d’une page,en 1829 comme actionnaire; on ne
l'attendait pas, mais il existe, en se joignant aux quatorze avant donc
l'augmentation de capital de 1829.
Jean-Baptiste Auguste Amédée MELIN, vicomte du
TAILIER
Sauf
erreur, il semble que ce soit plus précisément Jean-Baptiste Auguste
Amédée
MELIN RAMOND DU TAILLIS, effectivement vicomte. Il était le fils
adoptif d’un
général (1807) de division trois
étoiles de Napoléon, Adrien Jean Baptiste Amable RAMOND DU TAILLIS, ou
du BOSC
DU TAILLIS. Ce père, fait comte de l’Empire en 1808
fut Pair. On le retrouve dans l’histoire sous le nom de comte
DUTAILLIS…
A coté de
ces inexactitudes multiples, Jean Baptiste, celui des Houillères, était
propriétaire
en 1830 d’un magnifique château, le château de la Grange, sur la
commune
d’Yerres, près de Paris. Nous n'avons pas d'autres informations, mais
c'est mieux que rien !
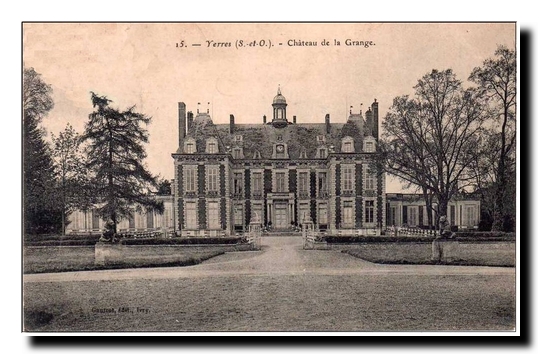
Nicolas Auguste BAUDELOT
Il est cité
dans ce premier cercle comme ancien
agent de change, ce qui donne une
indication sur son âge probable, et peut expliquer qu’en 1829 on
retrouve Madame
Baudelot comme épouse Detaillis, et un JJ Baudelot comme nouvel
actionnaire.
Monsieur Baudelot est décédé en octobre 1828 à Paris. Il était sûrement
riche, au
vu du nombre d’actions souscrites, 232, à la fois en 1826 et par son
épouse en
1829, ce qui en fait le deuxième actionnaire de la Compagnie.
Nommé
agent
de change de Paris le 22 octobre 1817,
sa fonction est attestée en 1819. Ce sont nos seules certitudes sur
Monsieur Baudelot....
Monsieur MOULARD
Pour
terminer cette connaissance du premier cercle, il nous reste à évoquer
à
nouveau le cas de Monsieur Joseph MOULARD. Ce "propiétaire" pourrait
bien être un Commissaire Général de la Monnaie. En 1835, un Joseph
Moulard occupe en effet cette fonction, avec... un Président de la
Commission des Monnaies qui nous est connu, le comte de Sussy, pair de
France, évoqué plus haut dans cette page. Le fils du comte de Sussy
avait épousé la soeur de la première épouse -née Muraire- d'Elie
Decazes. Cette proximité d'indices semble bien être une bonne
justification...
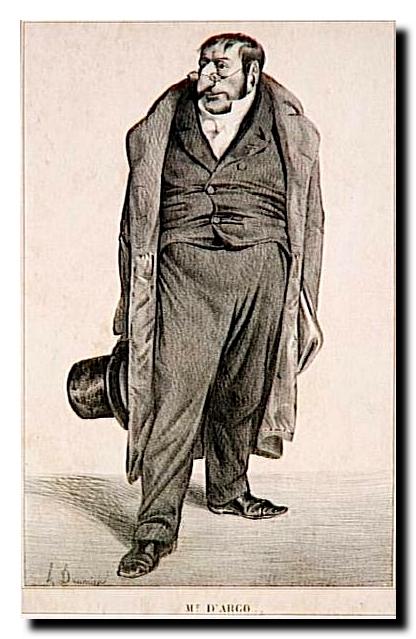
Les
autres
personnalités de cette Compagnie, d’Argout, ci-contre par
Daumier, de Germiny, Semonville,
Saint-Aulaire, La Villegontier…..sont beaucoup plus connues, et
quelques
aspects de leur biographie font l’objet de portraits. On lira par
exemple,
l’Histoire biographique de la Chambre des pairs,... Alexandre Lardier, ou
la Biographie
pittoresque des pairs de France, Eugène-François Garay de
Monglave, Paris, 1826. Ces deux références sont accessibles sur Google
books. Le portrait de Semonville ci-dessous a été repris par plusieurs
dessinateurs de l'époque sous des versions variées.
d'Argout
par Daumier
 marquis
de Semonville
marquis
de Semonville
Louis Clair de
Beaupoil, comte de Saint-Aulaire
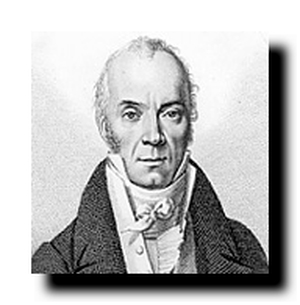
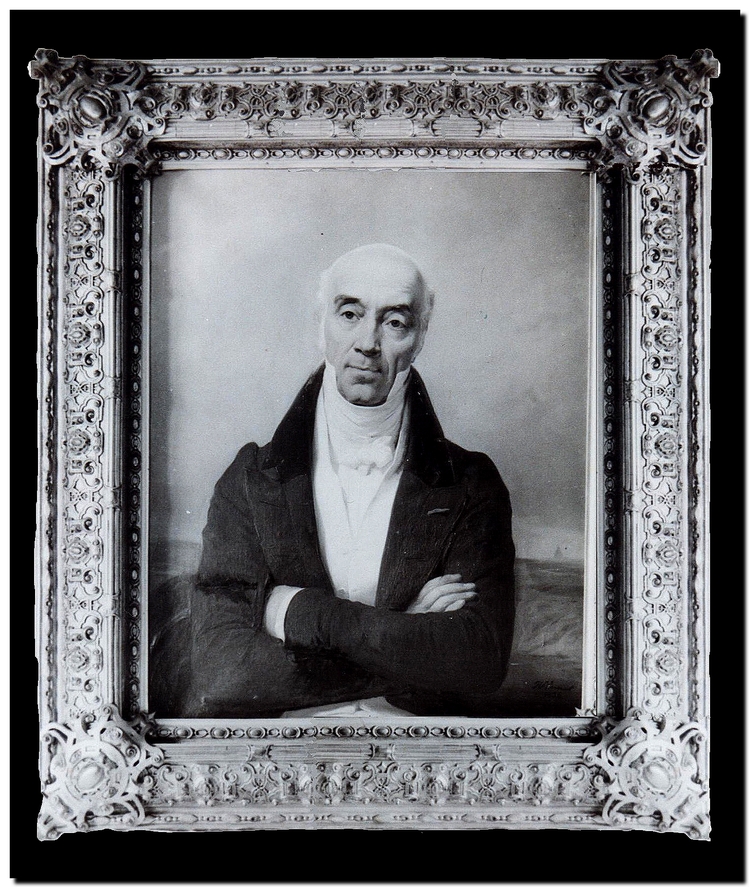 ▲Louis
Clair de Beaupoil, comte
de Saint-Aulaire, par Horace Vernet, 1837
▲Louis
Clair de Beaupoil, comte
de Saint-Aulaire, par Horace Vernet, 1837
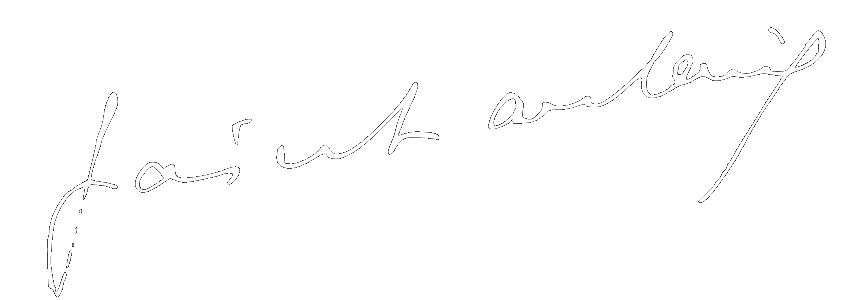 ▼médaille
de Jehan de Sainct-Aulaire, maître d'hôtel de François 1er
Né
vers 1480, ce lointain ancêtre faisait déjà apparaitre les batons de
couple dans
ses
armoiries, que l'on retrouvera bien plus tard accolées aux corbeaux du
duc mais avec les rubans inversés....
▼médaille
de Jehan de Sainct-Aulaire, maître d'hôtel de François 1er
Né
vers 1480, ce lointain ancêtre faisait déjà apparaitre les batons de
couple dans
ses
armoiries, que l'on retrouvera bien plus tard accolées aux corbeaux du
duc mais avec les rubans inversés....

Le comte de Saint-Aulaire, ou Sainte-Aulaire, beau père du duc
Decazes a écrit en 1827 une Histoire
de la Fronde,
oeuvre littéraire qui lui valut d'être admis à l'Académie. Un portrait
de l'auteur figure, généralement dans le volume 1, et, détail amusant,
diffère selon l'édition. Voici deux variantes, une classique, montrant
un comte sérieux, et une plus artistique....
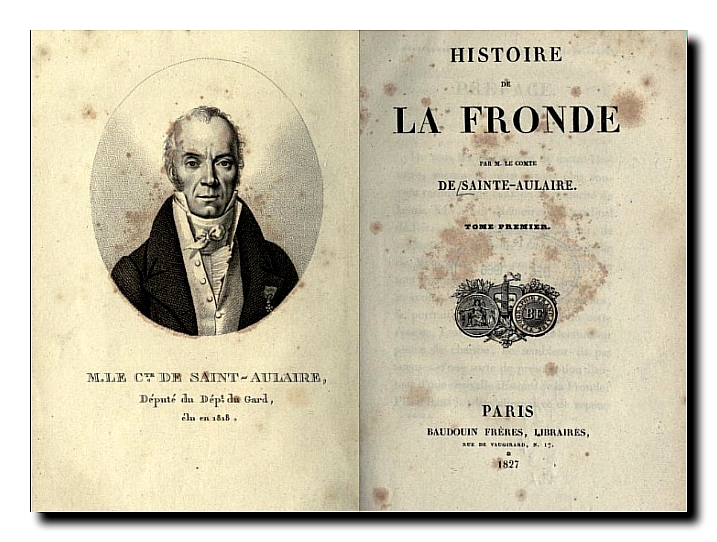
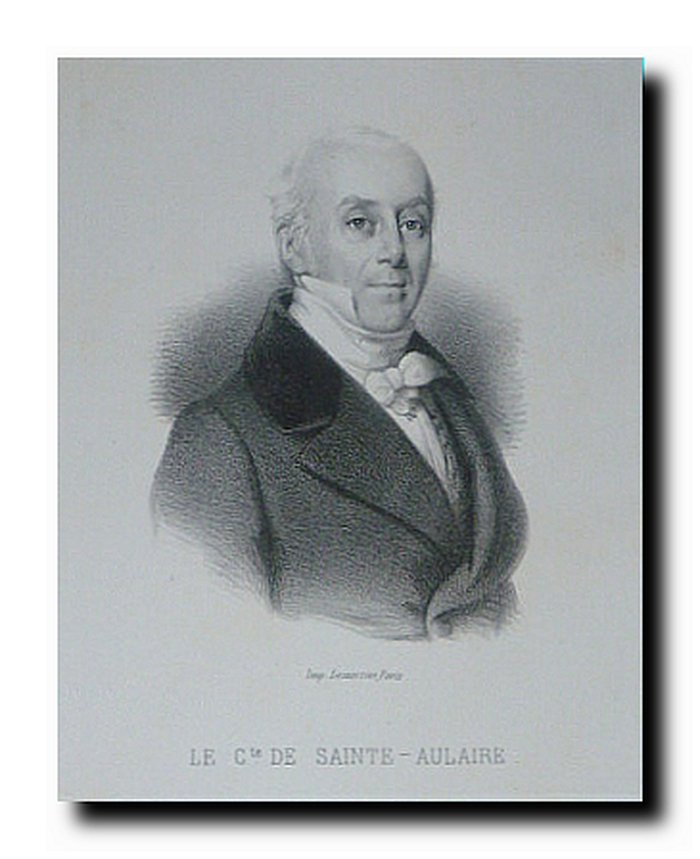
La belle famille du duc Decazes, Sainte-Aulaire (ou
Saint-Aulaire) est d’essence périgourdine. Louis Beaupoil de
Sainte-Aulaire a
écrit des Portraits de Famille,
publiés par son fils en 1879 (Cassard,
Périgueux, editeur). Une occasion d’entrer dans l’intimité de la
famille est
ainsi donnée ; on pourra lire (Gallica BnF), dans le Bulletin de la
Société Historique et Archéologique du Périgord, volume de 1911,
pages 62-104,
sous la signature de Robert Villepelet, quelques extraits concernant
notre
époque, vers 1820. Si Louis fut baptisé à Saint Méard de Dronne, on
apprend
qu’il naquit en Bretagne, le 9 avril 1778, au château de la Mancelière.
Il est
possible également de trouver une biographie du beau-père du duc
Decazes, écrite
par Robert Villepelet : le comte
Louis de Sainte-Aulaire, Préfet de la
Haute Garonne, 1814-1815, extrait de la revue Historique, tome CLX, 1929.
La
position du préfet, très opposé aux
Ultras
explique en partie sa position, lorsqu’il s’opposera aux visées de M.
Clausel de
Coussergues voulant faire traduire en justice le comte Decazes suite à
l’assassinat
du duc de Berry. La biographie explique également que celui qui fut
chambellan, malgré lui, ( ! ), de l'Empereur, préfet avec
Napoléon, préfet avec Louis XVIIl, n’a trahi ni
Napoléon, ni Louis XVIII…Il était sûrement difficile pour le comte de
tenir sa position administrative à Toulouse en ce début d'avril 1815,
poste de préfet qu'il va abandonner.
En savoir plus ?
►
une biographie du comte de Saint-Aulaire
►
et ici un -très- beau dessin !
Note complémentaire
(avec nos
remerciements à Aline Vidoni et René Dorel)
Louis Clair Beaupoil
de Saint-Aulaire repose au cimetière d'Etiolles.
Nous avons contacté Aline Vidoni, à la mairie d'Etiolles. Elle a pu
nous nous préciser qu'effectivement, en 2021, le souvenir du comte
n'est pas totalement perdu. Un enclos du nouveau cimetière regroupe des
pierres tombales anciennes, dont celle de Louis Clair. René Dorel,
historien d'Etiolles, nous a communiqué la note suivante, ICI qui
complète la biographie précédente.


▲▼ La pierre tombale de Louis Clair Beaupoil de
Saint-Aulaire,
la
cinquième au premier plan en partant de la gauche

▼
notre proposition de déchiffrage
GLORIA IN EXCELSIS DEO
ET IN TERRA PAX HOMINIBUS
BONAE VOLUNTATIS
_______________________
LOUIS COMTE DE SAINTE AULAIRE
NE LE 9 AVRIL 1778
DECEDE
LE 12 NOVEMBRE 1854
____________________________
SURSUM
CORDA
Louis Spiridion FRAIN de la VILLEGONTIER
La présence de ce breton dans le premier cercle ne relève pas du hasard
des affaires....
Celui
qui est qualifié à tort camarade de
Elie Decazes à
Polytechnique,
voir plus haut, est issu
de la noblesse bretonne. Né à Fougères en 1776, il
a donc quatre ans de plus que le duc. Il perdra très
tôt
ses deux parents, et son tuteur le confiera alors au
collège de Vendôme pour assurer son instruction. Et
c’est
précisément dans ce collège que Louis va
rencontrer le jeune Elie, lui aussi
instruit à Vendôme. L’amitié de
collège perdurera toute la vie, et il n’était
donc pas étonnant de voir Louis dans ce premier cercle des
investisseurs.
Après de très brillantes études, il entre à l’école
polytechnique qui vient d’être créée en 1794, la première promotion.
Cet
ingénieur des mines en 1797 ne fera pas de carrière industrielle.
Lointain parent de
Hugues Capet il entre en politique à la Restauration
en 1815, comme sous préfet de Versailles. Il sera préfet de
l’Allier en 1816, puis en poste équivalent en Ille et Vilaine, de 1817
à 1824.
Ses rapports administratifs avec le ministre de la Police ou de
l’Intérieur,
c'est-à-dire Elie Decazes, sont constants. Il sera Pair en 1819 et très
actif à
la Chambre. Il apparaît surtout comme un technicien administratif et
hommes
d’affaires en évitant les
débats
politiques. Il décède en 1849 à Parigné.

Pour
résumer : camarades de collège, pair, préfet,
comte....Les itinéraires du duc et de Louis se sont très
souvent croisés.
Deux biographies, parmi d’autres (Gallica) :
Biographie
universelle,
ancienne et moderne, Louis Gabriel Michaud, vol 85, p. 386-403, Paris,
1862
Revue
générale
biographique,
E. Pascalet, 4 ème année, huitième volume, tome 1, Paris, Amyot, 1844,
pages
5-50.
-*-*-*-*-*-
25 ans plus tard, 1857, faisons le
point
Voici
un point de situation, à destination des investisseurs de 1857, paru
dans l'Annuaire de la Bourse et de la
banque, Birieux. Le Conseil d'administration est présidé par le
duc Decazes. Avec lui, on retrouve quelques uns des actionnaires des
débuts, des descendants, et toujours la présence de banquiers, comme
André ou Rotschild. Adolphe Tiers, plus connu comme historien et homme
politique figure également. Le cours de l'action atteint des sommets...
Vendredi 7 juillet 1815, jour de
chance...
Comment
peut-on débuter en politique : faîtes donc comme Elie
Decazes, le 7
juillet 1815, avec un sens de
l’opportunité remarquable, et sûrement sans trop avoir réfléchi !
Voici
quelques éléments de la -petite- histoire…
 L’arrivée
officielle de Elie Decazes
à Paris et dans les instances politiques est un mystère,
au moins sur un plan strictement administratif. Dès la
fin des Cent Jours, il retrouve Paris
après son exil à Libourne. Les
historiens, biographes et autres témoins des évènements de ce début
juillet
1815 soulignent unanimement les conditions,
disons pour le moins confuses, qui ont présidé à la formation du
premier
gouvernement de cette deuxième restauration. Monsieur
de Talleyrand, qui va être l’homme fort de cette équipe ne
connaît pas le vendredi 7 juillet Elie
Decazes ; et c’est pratiquement entre deux portes, dans la fièvre
des
consultations et de la distribution des postes entre monarchistes
constitutionnels que Decazes saisit l’opportunité de la vacance du
poste de
préfet de police de Paris. Il fallait être le bon jour, à
la bonne heure et au bon endroit,
c'est-à-dire dans les salons de M. de Talleyrand, et Elie Decazes avait
compris
que c’était là qu’allait se jouer l’avenir du pays. Le comité
Talleyrand, qui
faisait office de gouvernement sans avoir de nomination officielle
était le bon
rouage. Et dans ce comité, Decazes avait quelques connaissances et
appuis. Ses fonctions de président de la
cour
d’Assises l’avaient amené sur le devant de la scène. Au tout début de
1815,
lors de la première restauration, Elie Decazes avait même été pressenti
pour
être préfet de police. Il ne le fut point.
Et le comité officieux qui va se retrouver le lendemain
gouvernement
officiel se souvient sans doute de
cette proposition non aboutie. C’était pour Elie Decazes un premier
atout. Mais
selon les apparences et les récits des témoins, c’est vraiment le
hasard qui
place ce 7 juillet le poste de préfet
sous les yeux d’Elie. Le poste n’était pas d’ailleurs le seul problème
à
résoudre pour les futurs ministres. La
dissolution de la Chambre des représentans, comme on
l’écrivait, était
envisagée et crainte, car des manifestations hostiles pouvaient se
produire.
Elle ne présentait pas, aux yeux du futur préfet, de difficultés. Il
suffirait
d’une ordonnance de dissolution ; son ancienne qualité de
capitaine d’une
compagnie de la garde ferait le reste, Elie étant sûr de ses hommes qui
gardaient de lui une très bonne impression après le retour napoléonien
du 20
mars et son exil forcé à Libourne. C’est ce qu’il dit et soutint dans
les
salons.
L’arrivée
officielle de Elie Decazes
à Paris et dans les instances politiques est un mystère,
au moins sur un plan strictement administratif. Dès la
fin des Cent Jours, il retrouve Paris
après son exil à Libourne. Les
historiens, biographes et autres témoins des évènements de ce début
juillet
1815 soulignent unanimement les conditions,
disons pour le moins confuses, qui ont présidé à la formation du
premier
gouvernement de cette deuxième restauration. Monsieur
de Talleyrand, qui va être l’homme fort de cette équipe ne
connaît pas le vendredi 7 juillet Elie
Decazes ; et c’est pratiquement entre deux portes, dans la fièvre
des
consultations et de la distribution des postes entre monarchistes
constitutionnels que Decazes saisit l’opportunité de la vacance du
poste de
préfet de police de Paris. Il fallait être le bon jour, à
la bonne heure et au bon endroit,
c'est-à-dire dans les salons de M. de Talleyrand, et Elie Decazes avait
compris
que c’était là qu’allait se jouer l’avenir du pays. Le comité
Talleyrand, qui
faisait office de gouvernement sans avoir de nomination officielle
était le bon
rouage. Et dans ce comité, Decazes avait quelques connaissances et
appuis. Ses fonctions de président de la
cour
d’Assises l’avaient amené sur le devant de la scène. Au tout début de
1815,
lors de la première restauration, Elie Decazes avait même été pressenti
pour
être préfet de police. Il ne le fut point.
Et le comité officieux qui va se retrouver le lendemain
gouvernement
officiel se souvient sans doute de
cette proposition non aboutie. C’était pour Elie Decazes un premier
atout. Mais
selon les apparences et les récits des témoins, c’est vraiment le
hasard qui
place ce 7 juillet le poste de préfet
sous les yeux d’Elie. Le poste n’était pas d’ailleurs le seul problème
à
résoudre pour les futurs ministres. La
dissolution de la Chambre des représentans, comme on
l’écrivait, était
envisagée et crainte, car des manifestations hostiles pouvaient se
produire.
Elle ne présentait pas, aux yeux du futur préfet, de difficultés. Il
suffirait
d’une ordonnance de dissolution ; son ancienne qualité de
capitaine d’une
compagnie de la garde ferait le reste, Elie étant sûr de ses hommes qui
gardaient de lui une très bonne impression après le retour napoléonien
du 20
mars et son exil forcé à Libourne. C’est ce qu’il dit et soutint dans
les
salons.
« Allez
dire à ceux qui vous envoient que
nous
sommes ici par la volonté
du peuple,
et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes."
Le
mot célèbre de Mirabeau, non oublié bien sûr et rappelé, faisait
craindre bien
des tracas. Mais s’il fut effectivement à nouveau prononcé, il ne s’en
suivit
que des applaudissements de la part des députés. Lorsqu’ils trouvèrent,
sur
ordre du préfet porte close le 8 juillet, rien ne se produisit, sinon
une
réunion hors mur de principe pour protester. Le préfet Elie Decazes
avait
parfaitement pesé les risques du jour, contrairement aux ex-futurs
ministres.
Il venait ainsi de réussir son examen d’entrée.
Elie
Decazes Préfet de police.
Poste à très haut risque, et dont pas grand monde ne voulait dans les
salons.
Le préfet qui est désigné doit gérer
l’opposition annoncée de la Chambre des représentants, qui se montrera
finalement très calme. Il doit gérer en même temps la rentrée que l’on
souhaite
triomphale de Louis XVIII dans la capitale, retour que l’on souhaite surtout sans mauvaise rencontre au roi
nouveau. Il y a également la position de la garde nationale de Paris,
pas
favorable au roi dit-on. Il est possible donc d’imaginer une situation
très
bouillonnante. Personne n’est trop sûr de quoi que ce soit, et pour le
poste de
préfet on hésite… Elie Decazes se porte donc volontaire et se retrouve
en
quelques minutes quasiment préfet de police autoproclamé, avec une
première
mission, celle de la sécurité du roi. Il a également proposé la
dissolution de
la Chambre et se porte garant de la garde.
Son ministre de tutelle sera le duc d’Otrante, autrement dit
Fouché,
prince d’Empire, oui, le régicide, dont la présence dans ce
gouvernement fait
tache…et qui ne doit pas attirer les sympathies. Il sera écarté dans
quelques
semaines, mais, cela, le 7 juillet, personne ne pouvait l’imaginer.
Fouché,
dans son fauteuil, en apercevant
Decazes le 7 juillet se fait préciser son identité : aucune
amabilité ne
suivra…
Un début en
demi-teinte ?
Eugène
Forgues, magistrat, publie en 1908 un travail fouillé sur les premières
semaines de la Restauration, juillet à septembre 1815. On peut
découvrir dans ces notes, les fiches d'un policier, Foudras, inspecteur
à la préfecture de police, donc dans les murs du préfet Decazes.
Foudras est à cette époque chargé d'un travail vraiment particulier,
"espionner" le ministre Fouché, pour en rendre compte au roi. Bien
évidemment, il ne s'interdit pas de parcourir quelques chemins de
traverse ! Une fiche
datée du 25 juillet, Decazes est en poste depuis 15 jours à peine,
permet ainsi à Foudras de donner son analyse de la personnalité du
préfet,
des défauts et des qualités...
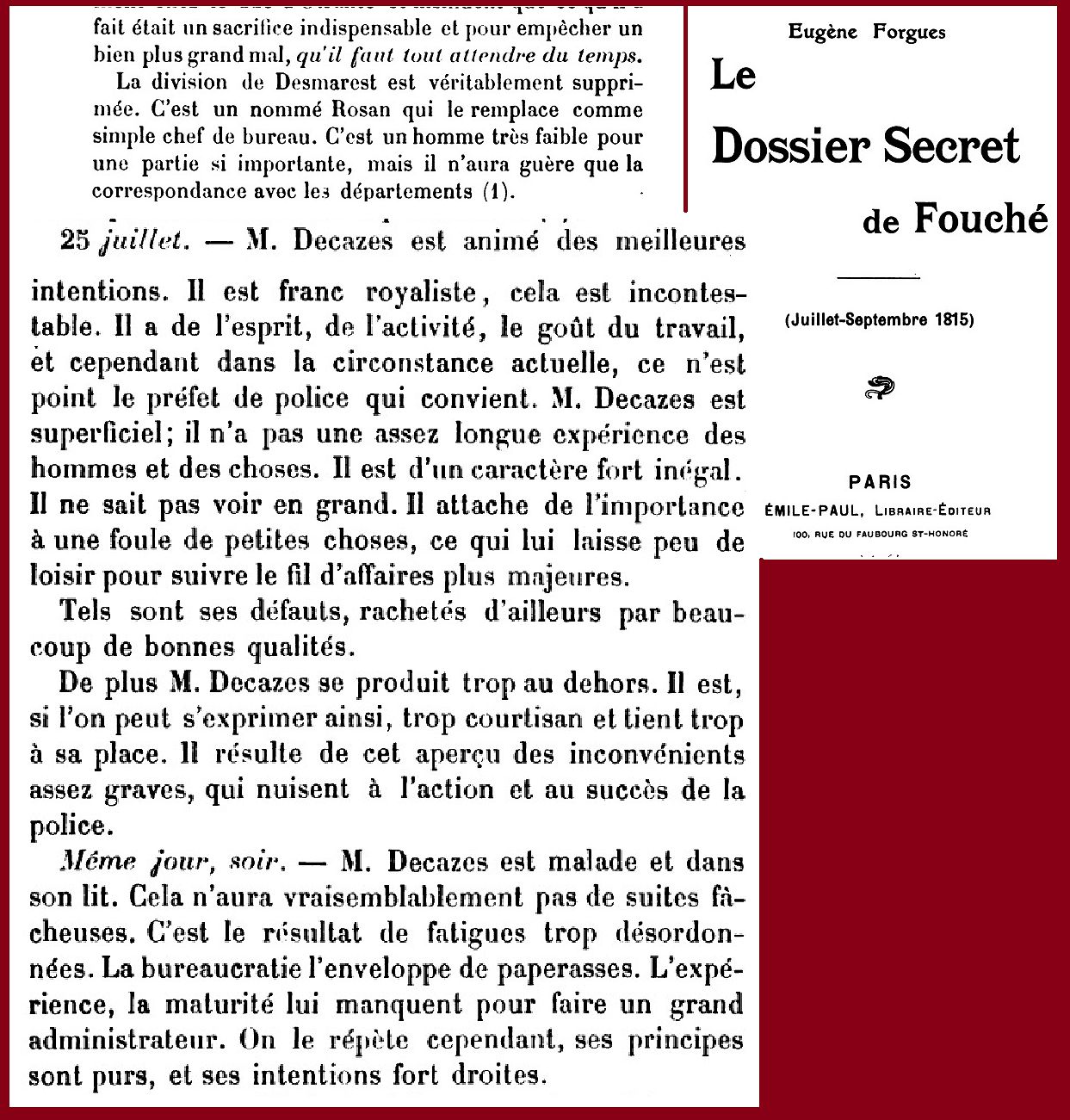
Elie
Decazes, dans ces
circonstances très troublées, se montre donc très intrépide. Cette
image avec
peut-être une certaine imprudence calculée, n’est pas celle attachée
habituellement à l’homme, prototype du Monsieur de très bonne famille,
calme,
réservé, de conversation agréable, bref le contraire d’un
risque-tout ! Cette arrivée est
d’ailleurs anonyme, sur le plan administratif.
Nous avons en effet lu et relu le Bulletin des Lois de cette
époque.
L’annonce officielle de la nomination du préfet de police ne figure pas
dans le
Bulletin. Elle aurait pourtant dû paraître. Alors ? La composition
du
ministère est bien publiée, le 7 juillet, mais non la nomination du
préfet.
N’était-on pas sûr du succès du nouveau promu ? Attendait-on son
échec ? Les relations, à priori exécrables du préfet et de son
ministre
régicide, sont-elles pour quelque chose dans cette lacune ? Il est
vrai
que la mission de Decazes auprès de la Chambre, fermer les portes et
assurer la
sécurité publique, était comprise comme étant sous sa propre
responsabilité,
celle de Monsieur Decazes, et non sous celle du préfet de police, de
peur de
ternir dès le début l’image du gouvernement. Le baron Pasquier, garde
des sceaux et ministre de l'intérieur par intérim dans ce premier
gouvernement évoque rapidement dans ses Mémoires (tome 3) la
nomination de Decazes. C'est bien par défaut de la personalité
pressentie (Angles, ministre d'état jugeait cette proposition
inférieure à son statut) que Decazes se retrouva préfet dans les salons
de M. de Talleyrand. Le baron précise que l'ordonnance fut
publiée au
Moniteur le lendemain, 8
juillet. Le Moniteur Universel
fait bien état de cette
nomination, et la mentionne sans donner l'intégralité du texte dans le
volume Index de 1815. Mais c'est le numéro du 10 juillet, et non
du 8, qui annoncera cette nomination, en page 3, sans commentaire
particulier. Deux mois plus tard, le préfet va devenir ministre en
prenant le portefeuille de Fouché : la nomination de ministre sera
alors celle du Conseiller, et non du préfet... On notera enfin
que la nomination de préfet est celle de M. de Caze,
orthographe souvent utilisée en lieu et place de Decazes. Il y a
même -au moins - un cas où un auteur, M. Capefigue, dans
son Histoire des grandes opérations
financières, 1860, tome 4, évoquera la création de Cazeville...
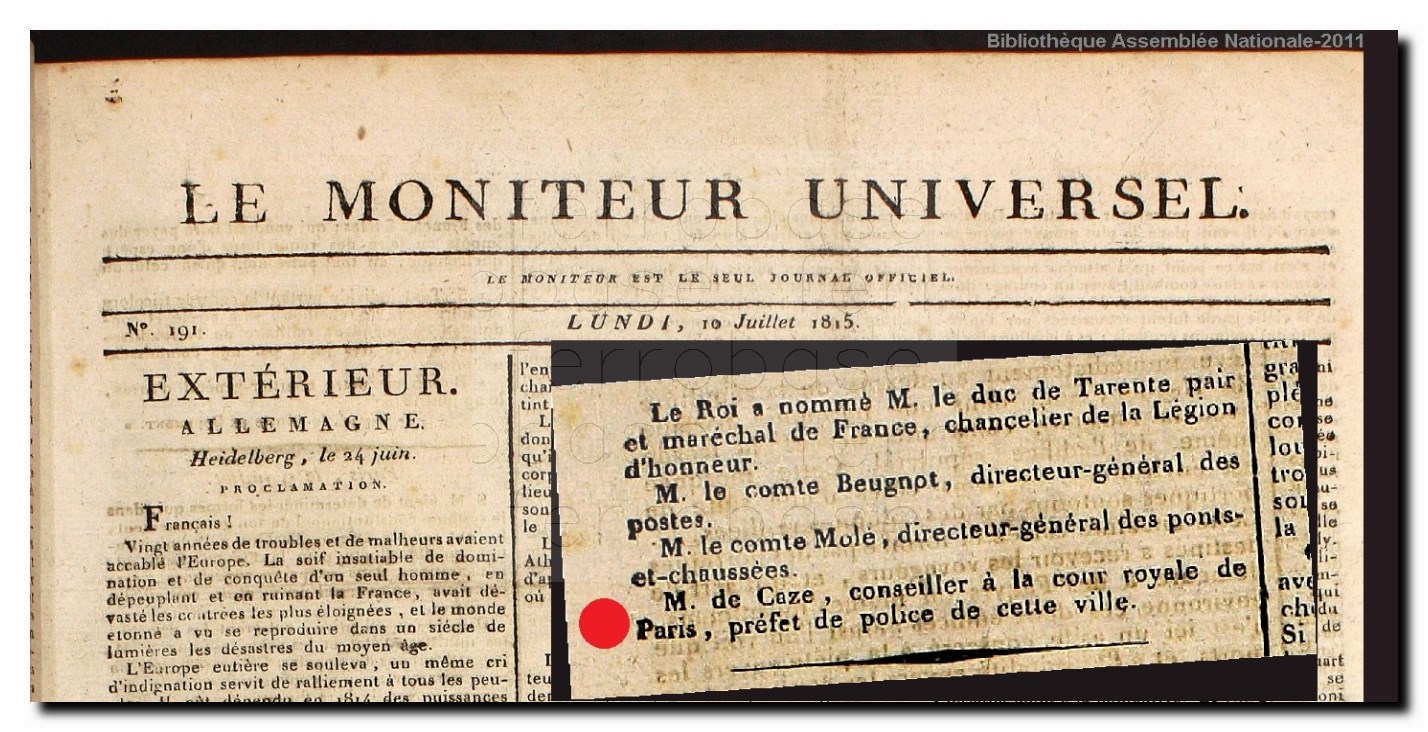
Samedi
8 Juillet 1815 : « Le Roi a fait aujourd’hui son entrée
dans sa capitale, à trois heures après-midi ». Tout se
passa donc bien
pour le préfet de police Decazes, comme le rapporte le texte des
Archives
parlementaires, recueil complet des débats…,SER2, T15, seconde
restauration,
règne de Louis XVIII(Gallica). « Une
tranquillité parfaite a régné »
ajoute le texte, qui reprend un article du Moniteur Universel du 9
juillet.
La
suite du volume des Archives
présente les premières ordonnances du roi, le texte du congrès de
Vienne… mais
aucune trace de notre préfet. Il faut croire qu’il était cantonné pour
la
dizaine de semaines de cet été 1815 à des tâches très techniques ;
son
accès au roi, qui ne le connaît pas directement, est d’ailleurs
inexistant, les
verrous mis en place pour isoler Louis XVIII semblent parfaitement
fonctionner.
Il faudra attendre un peu pour que le préfet de police
puisse rencontrer le monarque. Un attentat
ou menace d’attentat sur une
personnalité donne l’occasion au préfet d’aller faire, sur injonction
de son
ministre, son rapport directement au roi. Ce premier entretien va
marquer à
jamais les deux hommes. Dorénavant, et à la demande du roi, le préfet
de police
viendra faire son rapport directement, en ignorant son ministre de
tutelle.
C’est très exactement l’instant où Elie Decazes va entamer son
ascension
politique. Nous sommes en août 1815. Et c’est également
le moment où Decazes va se créer ses
premiers ennemis. Une vraie vie politique débute pour lui.
Si
l’arrivée officielle en politique est quelque peu floue, ce n’est
évidemment
pas le cas pour tous. Une
ordonnance, n° 11 du 12 juillet 1815,
nomme une vague de 28 préfets. Et dans la vague, on trouve Monsieur De
Caze,
sous préfet à Castres, promu préfet du Tarn.
Monsieur De Caze ? C’est Joseph, le frère du nouveau préfet
de
police Elie Decazes. L’orthographe n’est pas très rigoureuse, et les
copistes
du Bulletin et bien d’autres vont
d’ailleurs employer dans ces années 1815-1820, des orthographes
variées :
De Caze, De Cazes, ou Decazes, y compris en 1818, pour celui qui est
pourtant
ministre, et même le premier de tous….Ce 12 juillet donc, les deux
frères sont
préfets.
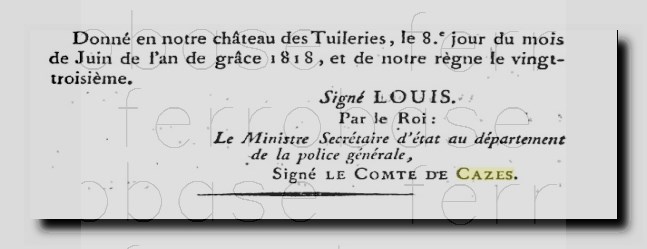 Orthographe
variable, tout comme les fonctions du comte.
Orthographe
variable, tout comme les fonctions du comte.
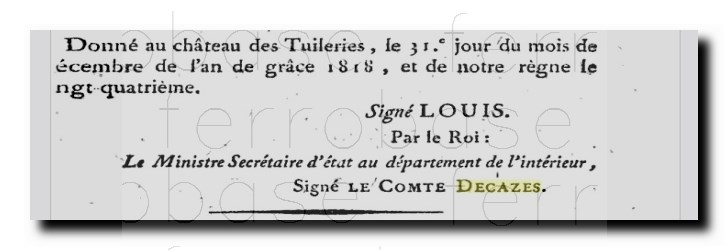
C’est le 24
août 1815, avec l’ordonnance n° 80 que la position officielle d’Elie
Decazes
apparaît dans le Bulletin des Lois (BDL) : il s’agit de sa nomination
comme
conseiller d’Etat en service extraordinaire (Bulletin des lois n°
17) :
son nom est suivi de la mention préfet de police. Les ordonnances du
préfet
seront présentées et signées à partir de cette date sous la mention conseiller d’état, préfet de police.
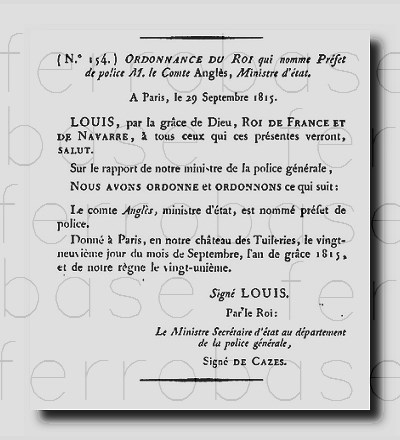 Le 29
septembre 1815, le BDL publie
l’ordonnance 154 : elle nomme un ministre d’état, le comte Anglès
préfet
de police. L’ordonnance est signée du
Ministre secrétaire d’état au département de la police générale,
DE
CAZES (en deux mots, sic ! ).
Cette ordonnance nous apprend donc à la fois le changement de préfet de
police
et la disparition du prince Fouché, dont ce sera la mort politique, et la nomination d’Elie Decazes à son poste
de ministre, qui nomme donc son successeur à la préfecture. Beaucoup d’informations dans une seule
nomination ! Il aura
suffit d’une dizaine de semaines pour voir
Elie Decazes passer d’une situation
parfaitement discrète à l’un des postes les plus exposés. L’intermède
préfet
est donc de courte durée. Elie Decazes aura su l’utiliser pour
conforter sa
position. Il a surtout
saisi l’incroyable chance d’approcher par
ses fonctions Louis XVIII. Faire quotidiennement son rapport au roi, un
peu
fatigué des hommes de sa cour, et pouvoir lui faire
entendre autre chose que des propos convenus n’était pas donné à
tout le monde.
Le 29
septembre 1815, le BDL publie
l’ordonnance 154 : elle nomme un ministre d’état, le comte Anglès
préfet
de police. L’ordonnance est signée du
Ministre secrétaire d’état au département de la police générale,
DE
CAZES (en deux mots, sic ! ).
Cette ordonnance nous apprend donc à la fois le changement de préfet de
police
et la disparition du prince Fouché, dont ce sera la mort politique, et la nomination d’Elie Decazes à son poste
de ministre, qui nomme donc son successeur à la préfecture. Beaucoup d’informations dans une seule
nomination ! Il aura
suffit d’une dizaine de semaines pour voir
Elie Decazes passer d’une situation
parfaitement discrète à l’un des postes les plus exposés. L’intermède
préfet
est donc de courte durée. Elie Decazes aura su l’utiliser pour
conforter sa
position. Il a surtout
saisi l’incroyable chance d’approcher par
ses fonctions Louis XVIII. Faire quotidiennement son rapport au roi, un
peu
fatigué des hommes de sa cour, et pouvoir lui faire
entendre autre chose que des propos convenus n’était pas donné à
tout le monde.
Nous avons évidemment recherché l’ordonnance de
Louis XVIII
nommant son nouveau ministre : introuvable au Bulletin des
Lois !
Même mystère que pour la nomination de préfet ! L’ascension de
Elie
Decazes, parfaitement réelle, est vraiment discrète, administrativement
parlant,
discrétion assez inexplicable… On pourrait penser que ces nominations,
qui ont
fait l’objet d’ordonnances signées, n’ont pas été publiées pour une
raison ou
une autre, au Bulletin Des Lois. Elles n’auraient alors même pas eu
droit à une
numérotation administrative, car les ordonnances publiées portent
toutes un
numéro, depuis le n° 1, et les bulletins du semestre 1815 concerné, le
second, les présentent toutes, sans
omission quelconque…Il y a peut-être une explication à ces anomalies
administratives : le BDL consulté ne serait pas
la version très officielle ? Explication que nous ne
retenons pas, l’absence de publication ayant été à notre connaissance
déjà
remarquée et signalée, au moins une fois, par un contemporain. Pour
compliquer
une situation confuse, il faut savoir aussi qu’en 1815, au moins deux
sources
présentaient les textes officiels : le Bulletin des Lois et La
Gazette
Nationale nommée en 1815 le Moniteur Universel. Pour quelques décisions
urgentes, les circonstances suppléaient aux formalités de l’ordonnance
et de la
publication.
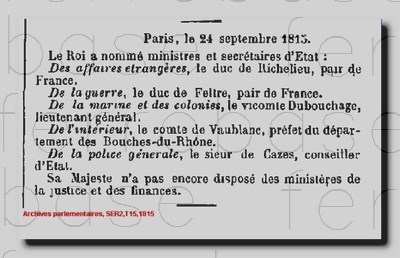
Si pour le
poste de préfet, nous pensons qu’il n’y eut pas en effet de
publication, et
peut-être pas de nomination tout court par le roi,
devenir ministre, qui plus est de la police en remplacement de
Fouché, ne peut être fait très discrètement. C’est dans les Archives
Parlementaires, SER2, T15, 1815, seconde restauration page 34 que
figure la
décision de Louis XVIII de nomination
comme ministre de la police générale, en date du 24 septembre 1815. Elle concerne aussi quelques
autres ministres. Dans le libellé,
on remarquera évidemment que Elie est nommé de Cazes, conseiller
d’Etat. Exit également
le titre de préfet de police
discret ! C’est le conseiller qui est promu ministre, et non le
préfet… La
lecture des Archives montre également l’élection antérieure d’Elie
Decazes
comme député de la Seine, élections du 21 août 1815,
dans une nouvelle chambre qu’il aura constamment à combattre
dans
les années suivantes. Mais si la nomination officielle est donc
attestée, sa
non publication au Bulletin des Lois reste inexplicable…
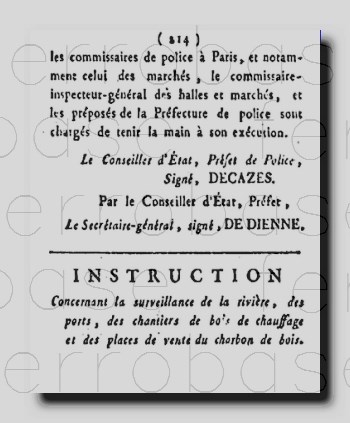
Une
des rares signatures de Decazes, en sa qualité de Préfet de Police
Octobre
1815 : la nouvelle chambre, « l’introuvable » élue les
14 et 22
août, celle de tous les dangers va
siéger. Ce sera alors pour le jeune ministre de la police générale
l’occasion
de se retrouver à la tribune ; mais ceci est une autre histoire
que la
nôtre…
Cinq ans
plus tard…
Nous avons
rappelé la fin politique très difficile du comte Decazes, lorsque
l’assassinat du duc de
Berry vint interrompre une carrière de premier plan. Non seulement
cette disparition du duc de Berry allait donner aux opposants de
droite,
royalistes et ultras des arguments inespérés pour demander à Louis
XVIII de se
séparer de son favori, mais elle se produisit exactement
la veille du jour où le ministre devait
livrer bataille pour faire adopter des textes dont personne, ni à
droite ni à
gauche ne voulait : loi électorale, et deux lois suspendant la liberté de la presse et la liberté
individuelle. Cette position intenable ne fut évidemment pas tenue et
le
ministère fut changé devant une coalition contre nature. Le journal Le Temps, dans son numéro du jeudi
20 mars 1862 publie un extrait de
l’Histoire du gouvernement parlementaire,
Duvergier de Hauranne, Levy, Paris, tome 5, qui parut en 1862.
Cet
extrait, publié comme feuilleton du Temps, en page une,
concerne le récit très détaillé des jours
qui suivirent l’assassinat du duc de
Berry et montre comment Louis XVIII fut contraint de se séparer de
Decazes.
Après le récit des journées de juillet 1815, il n’est pas inintéressant de prendre connaissance, presque heure par
heure, de celles de février 1820, du
dimanche 13 au dimanche 20, qui
conclurent cette période de sa vie publique ; le comte sera
bientôt duc -de France-,
ambassadeur, mais plus jamais ministre.
Un
jour pour se faire une place,
une semaine pour la perdre…
Notes
de lecture
Un
récit très détaillé sur des
épisodes de la seconde restauration et de ses débuts peut être lu dans
les
Mémoires d’un bourgeois de Paris, T2, pages 1 et suivantes, Dr L.
Véron, Paris,
1856 (Gallica).
Le Moniteur
Universel (ou la gazette nationale) de 1815 est disponible sur
archive.org,
mais les journées après le 7 juillet 1815 ne figurent pas. Un
« trou » vraiment regrettable !
Les Archives Parlementaires (Gallica) sont
également une source précieuse d’informations à la source, aucune
interprétation n’étant de mise dans les propos et textes
rapportés. Un vrai livre d’histoire(s) à
décrypter.
Le journal
Le Temps est disponible sur Gallica BNF.
M. Auschitzky,
arrière.....neveu du duc, a écrit et décrit ce
qu'étaient les grandes familles de Libourne. La saga de Madeleine
Danglade est ainsi l'occasion pour l'auteur de nous offrir un chapitre
16 de 274 pages consacré à ce grand oncle le duc Elie Decazes. A
savourer, absolument ! Vous pouvez trouver un lien sur la page des
liens remarquables et remarqués....
Archives, certitudes et incertitudes
Les
archives existent pour être consultées !
C’est ce qu’a fait par exemple
Ernest Daudet, qui a pu ensuite rédiger ses deux ouvrages, l’un
consacré aux
relations du duc Decazes avec le roi Louis XVIII, et le second à la
période
anglaise, le duc étant alors ambassadeur à Londres. Il n’existe pas
beaucoup
plus de sources historiques. Nous avons pu consulter non pas les
archives, mais
un catalogue de ces archives. Si des questions n’ont toujours pas de
réponses,
cette lecture des 496 pages du catalogue
et d’un appendice permet de lever toutefois quelques incertitudes.
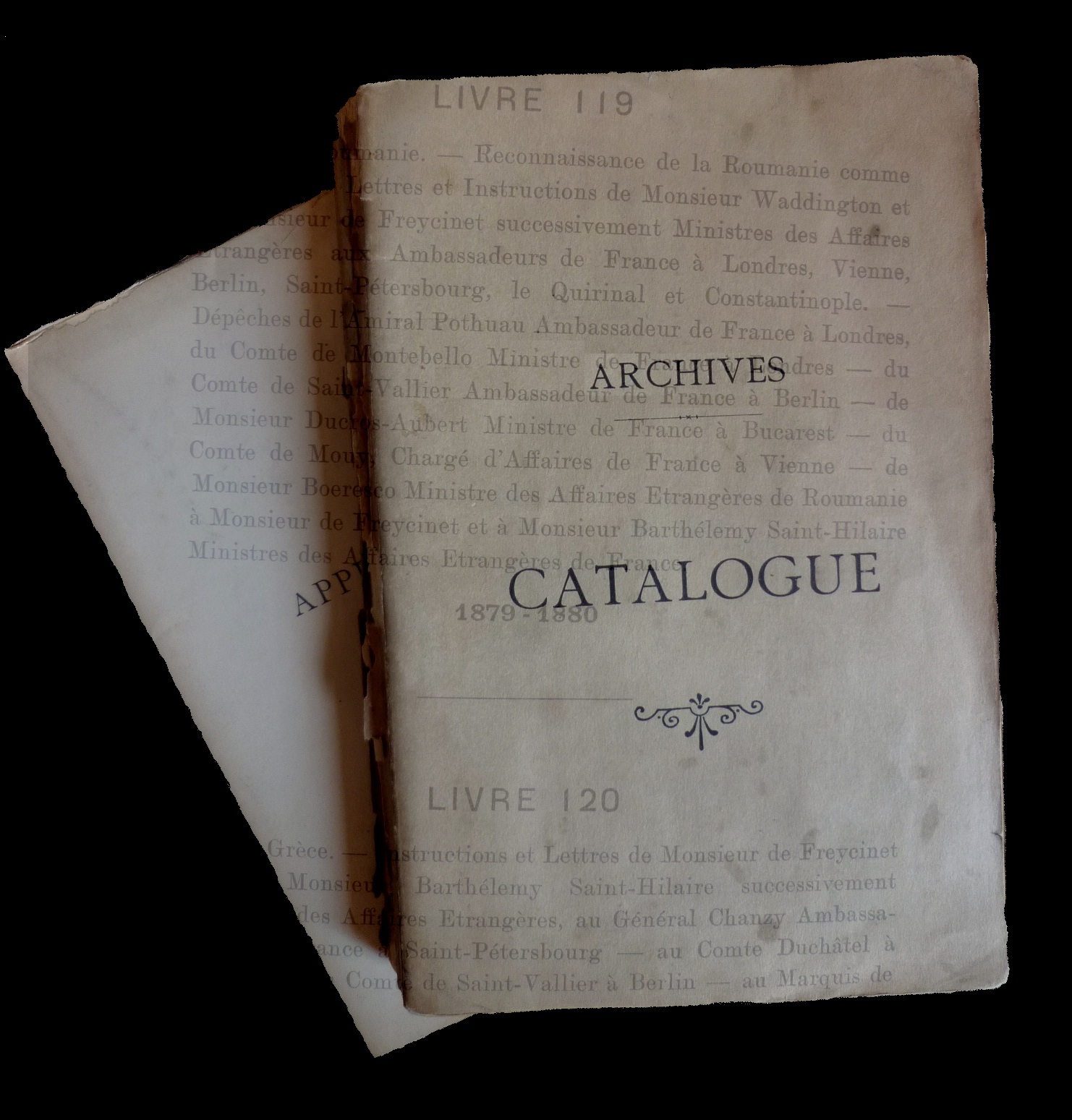
Sur
la famille Decazes
Nous
avons évoqué l’ascendance d’Elie Decazes, une noblesse de province,
pour
résumer. Plusieurs cotes ou liasses permettent de préciser ce fait. La
généalogie indiquée remonte à 1286, et l’origine de la famille de
Cazes, en
deux mots, est italienne. On retrouve ainsi
en Ombrie, en Italie centrale, une
famille Gens Coesia (ou Coesiis) qui
serait à l’origine de la souche de Cazes. Depuis la naissance de Pierre
de
Cazes* en 1280, la continuité semble attestée. Un membre de la famille
aurait
ensuite émigré en Limousin puis
Aquitaine. Plusieurs historiens évoquent la non qualité de noble de la
famille
Decazes. Très récemment, en 2011, on pouvait lire une communication
niant cette
ascendance. Pourtant les archives semblent prouver le contraire.
Plusieurs
références font ainsi état des lettres patentes de reconnaissance de
Noblesse
données par Henri IV en 1595. Elles furent données à Raymond de Cazes
en
reconnaissance des services rendus par lui et ses aïeux. Les mêmes
sources
précisent également l’origine des armoiries, les trois corbeaux. C’est
à la
même date de 1595 que l’autorisation fut donnée à Raymond de Cazes de
porter
les Armes d’Argent à Trois Têtes de corbeaux de sable. C’est une
confirmation,
car ces armoiries étaient déjà, est-il écrit, celles de la famille. Le
duc
Decazes n’a donc fait que suivre la tradition familiale en portant ces
armoiries. En 1779, une confirmation de cette Noblesse fut accordée par
le
Conseil du Roi. On notera enfin la présence d’une convocation aux
assemblées de
la noblesse adressée à Jean Decazes pour élire un député aux Etats
Généraux de
1789. L’absence de cette convocation est
quelquefois, et donc à tort, avancée pour justifier la non noblesse de
la famille Decazes.
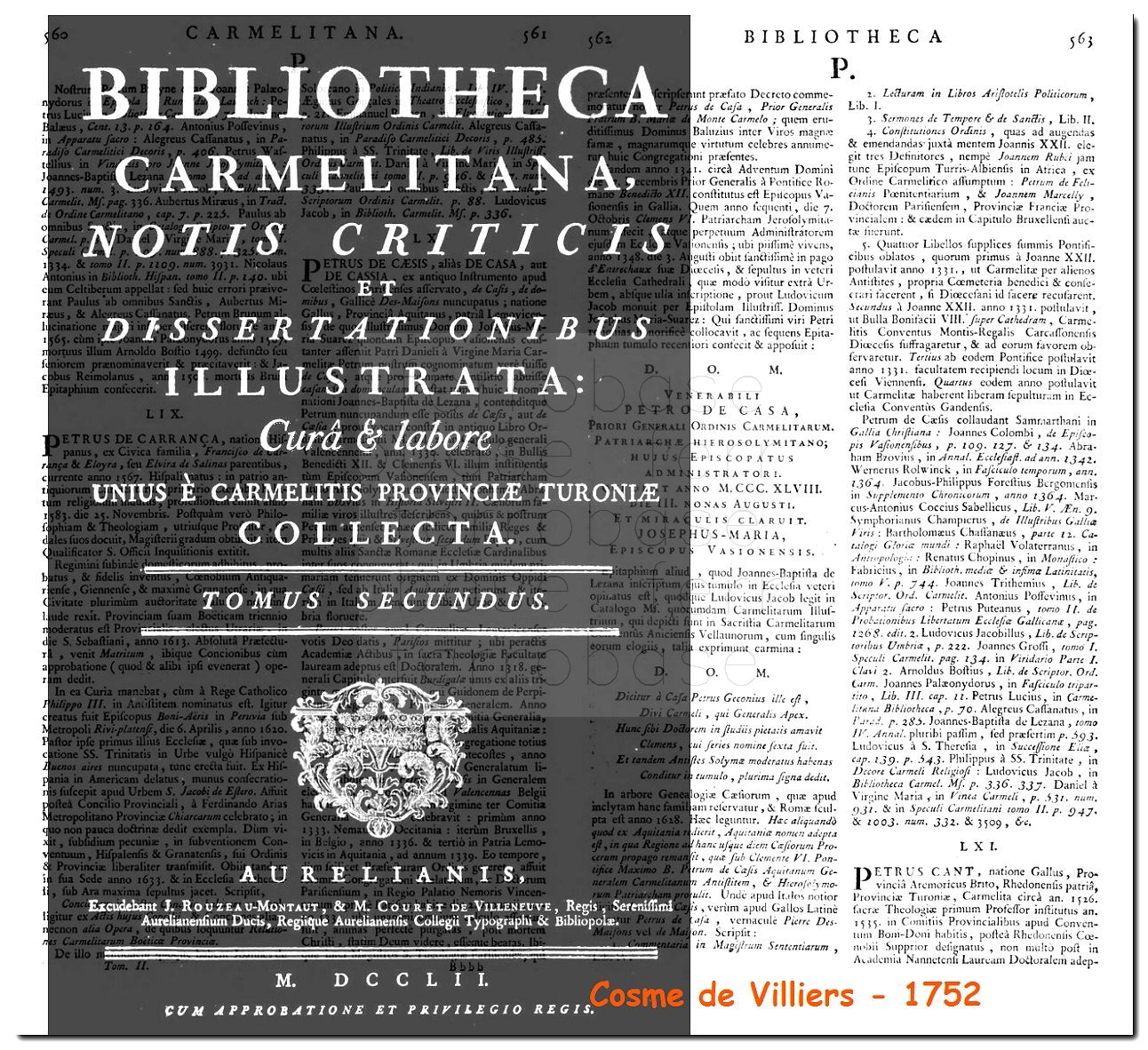
*Le catalogue fait état de Pierre de Cazes, 1280-1348, Général des
Carmes et Patriarche de Jérusalem. Est-ce également Pierre de Casa,
connu comme prieur général des Carmes, Patriarche lui aussi, né à
Limoges ? Il semble bien que oui...
Les informations sur Petro de Casa que fournit Cosme de Villiers de
Saint-Etienne, en 1752, dans sa Bibliotheca
carmelitana (t2, col 561,563) confirment en tous points les
indications sur Pierre de Cazes lues dans le catalogue.
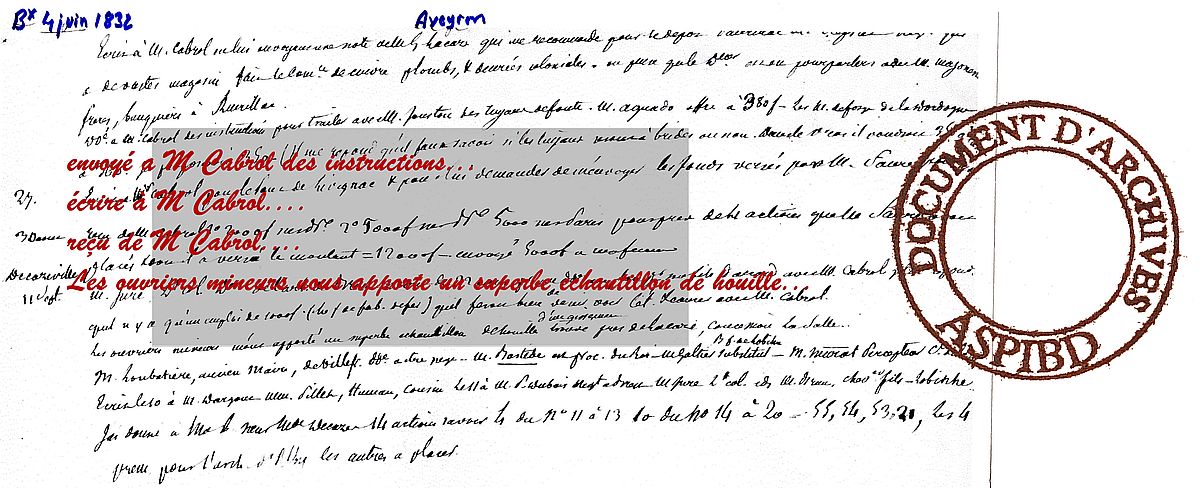
▲ Au jour le jour....Le duc suivait de très près la marche de la société !
extrait d'un carnet, 1831 : écrire, reçu, envoyé....
Sur
l’implication industrielle du duc Decazes
Il
est évidemment important d’essayer de retrouver dans ces archives
l’implication
industrielle du duc. On apprend que des mémoires du duc existent :
écrites
de sa main, ou reprise des mémoires de la duchesse ? La plupart de
ces
mémoires sont de la main de la duchesse. Elles semblent très précises,
donnant
par exemple la liste des invités à dîner du couple pendant les années
de
Restauration, ou décrivant l’enfance du
duc jusqu’en 1814, ou son mariage en 1818. Existent
également les agendas du duc, de 1820
à 1849, et de 1853 à 1860 par exemple, qui notait jour après jour
l’essentiel
de ses activités. Malgré cela, rien ne permet de retrouver trace de son
implication rouergate. Il est vraiment curieux que cette partie de son
activité
industrielle ne laisse aucune trace dans ce catalogue. Ces archives là,
relatives aux forges de l’Aveyron ne font pas partie de l’inventaire.
Pourquoi ? Est-ce voulu ? Par contre, sont évoqués des
éléments
industriels, comme des mines du Gard, en 1832 et 1834, d’autres mines
diverses
à la même époque, des mémoires sur les chemins de fer locaux des
Landes, Saint
Germain, Versailles ou belges. Le duc s’intéresse aussi à des projets
de
canalisation toujours dans les Landes en 1833, ou au projet de liaison
Oise
Somme.
On
retrouve l’implication de la famille dans l’épisode manqué de la
colonie de
Nouvelle Zélande. Nous avions trouvé dans les archives –du Tarn - du
vicomte
Joseph Decazes, frère du duc, un dossier sur cette épisode, conduit par
la
société Nanto-Bordelaise. Il y a également un intérêt du duc dans la
canalisation de Suez, dès 1840, dossier présent lui aussi dans les
archives citées
de Joseph.
De
nombreuses lettres de la duchesse au duc et inversement, à
cette époque importante 1825-1840 pourraient
peut-être apporter quelques précisions sur le projet des Forges. Tout
au plus,
nous avons noté que peu de correspondances existent dans ce catalogue
avec les
investisseurs du premier cercle des Forges. Il y a par exemple des
courriers à
l’époque de la création avec le comte de Sainte-Aulaire, beau père du
duc, avec
le comte d’Argout, 1820-1830, le banquier Pillet Will, ou Humann, de
1825 à
1830 pour ce dernier, tous actionnaires
à Decazeville. Celles adressées au comte Pillet-Will sont datées
1833-1837 : on sait que celui-ci fut envoyé faire l’audit des
forges à
Decazeville, ce qui l’opposa à François Cabrol. Mais manquent bien
d’autres noms,
dont précisément celui de Cabrol. En 496 pages, aucun courrier de
François
Cabrol n’est mentionné…Ce n’est sûrement pas un oubli du rédacteur du
catalogue. Sur ce chapitre industriel, figurent en archives des
courriers datés
de Londres : ils pourraient peut-être préciser si oui ou non le
duc s’est
vraiment intéressé aux hauts fourneaux à la houille dès 1821, intérêt
absolument pas attesté ni évident…De nombreuses lettres du vicomte
Joseph à
Elie, sur les périodes 1811-1813, 1810-1814 et surtout 1814-1829 sont
mentionnées.
Vers
1820, un dossier évoque « affaires d’Angleterre 1820-1822 »,
sans
autres précisions. Il y a enfin les lettres du duc au comte
Sainte-Aulaire sur
la période 1820-1829 qui pourraient nous en apprendre plus. Nous avons
noté
également la présence de rapports sur l’état de l’Industrie Française
de 1806 à
1819 : on sait que le duc remit à l’honneur les expositions
nationales,
celle de 1819 fera l’objet d’une inauguration royale et d’un rapport
ici
présent. Mais la présence de ces rapports au ministre ne préjuge pas de
son
intérêt particulier pour des forges à la houille….
Sur
les relations du duc avec le Danemark
Parmi
les centaines de liasses répertoriées, quelques unes sont consacrées au
mariage
du duc en 1818. On connait l’une des conditions de ce mariage
d’Elie :
Egédie, dont la mère, marquise de Soyecourt, est née Henriette
Seiglière de
Belleforière de Soyecourt, décédée en 1808, était la petite fille du
prince de
Nassau Saarbruck. Le roi du Danemark fera Elie duc, permettant alors ce
mariage. Habituellement le titre annoncé est duc de Glucksbierg ;
dans le
catalogue, rédigé vers la fin du XIX ème siècle, l’orthographe
constante est
Gluksberg…Un débat existe sur cette question d’orthographe, pas
anecdotique du
tout pour certains historiens.
La
famille Soyecourt est abondamment présente dans ces archives, 158 pages
du
catalogue, depuis l’institution de la Seigneurie Soyecourt en 1398.
C’est le
comte de Sainte-Aulaire, père de la future duchesse, qui va négocier
l’obtention de ce titre de duc auprès du roi du Danemark, 1817-1818.
Certaines
liasses concernent l’acquisition de terres au Danemark. Ceci est
particulièrement important pour assurer le titre danois. Ce majorat est
quelquefois nié. D’autres lettres concernant ce majorat sont datées de
1840-1856. Le roi Christian VIII
confirmera les titres danois du duc, et figure en archives
l’autorisation de Louis XVIII pour les
accepter. En 1823-1824 un voyage au Danemark permet au duc (de France)
de
négocier la transmission de son titre danois à son fils Louis.
Plusieurs
lettres du duc et de la duchesse au roi du Danemark sont mentionnées à
cette
époque.
Courriers
divers
Parmi
les pièces qui trouvent un écho dans nos préoccupations, on peut noter
la liste
des titres honorifiques et brevets détenus par le duc, ou ses lettres
au comte
Muraire, en 1805, 1807 et 1811 par exemple. Il est curieux de constater
ici l’absence explicite totale dans le
catalogue de toute allusion aux fonctions de franc-maçon d’Elie
Decazes. C’est
le comte Muraire, Premier Président à la cour de Cassation, qui avait provoqué cette entrée d’Elie
Decazes dans la maçonnerie. Elie Decazes avait épousé en un premier
mariage une fille du comte Muraire,
décédée très jeune. Il y a enfin des courriers divers : à Clausel
de
Coussergues, le bouillant député ultra aveyronnais dont on se rappelle
l’action
un peu excessive contre le ministre, après l’assassinat du duc de
Berry. Le
député fut un des éléments de la chute politique de Decazes en 1820.
Des pièces
sont relatives à l’implication du duc Decazes II (sic) à l’occasion de
l’élection législative en Aveyron de 1876. Le duc sera élu à Paris.
Pour
terminer, il faut citer la présence dans ce catalogue
d’archives privées de
plusieurs liasses relatives aux mémoires du duc et de la
duchesse. Non
publiées, elles seraient pourtant de grand intérêt.
Plusieurs cahiers font état
de celles de la duchesse. Un avant propos aux mémoires du duc
est cité. En
1815-1816 c’est la table des matières qui figure.
L’appendice, sans date de
publication, tout comme le catalogue, présente en près de
quarante pages une rédaction très
détaillée et chronologique
de la vie essentiellement politique du duc Decazes, de sa naissance en
1780 à
1858, deux ans avant sa disparition. Dans cet appendice est
également évoquée
la généalogie de la Maison Sainte-Aulaire, de 1393
à 1854.
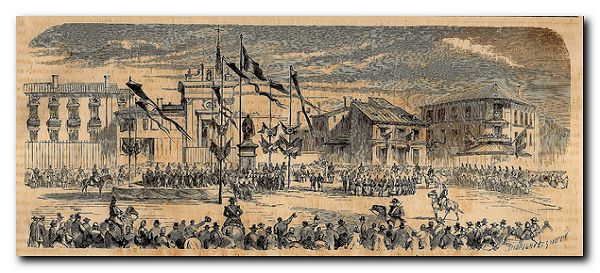
Le duc Decazes
est présent par ses statues. Celle de Libourne, ci-dessus inaugurée le
2 mars 1865, est due à Dumont, et non comme assez souvent indiqué
Jaley...Le fondeur fut Thiebaut. Trois mètres de hauteur, sur un
piedestal de quatre, le duc est en costume de la Restauration. Déposée
en 1941 puis disparue, elle est remplacée en 1951 par la statue
actuelle, toute différente.
L'extrait suivant
du Bulletin de Libourne, septembre 2011 en retrace l'histoire,
► ICI.
Decazeville en Aveyron rend également
honneur au duc par une statue.Les deux statues de bronze sont réunies
ci-dessous.

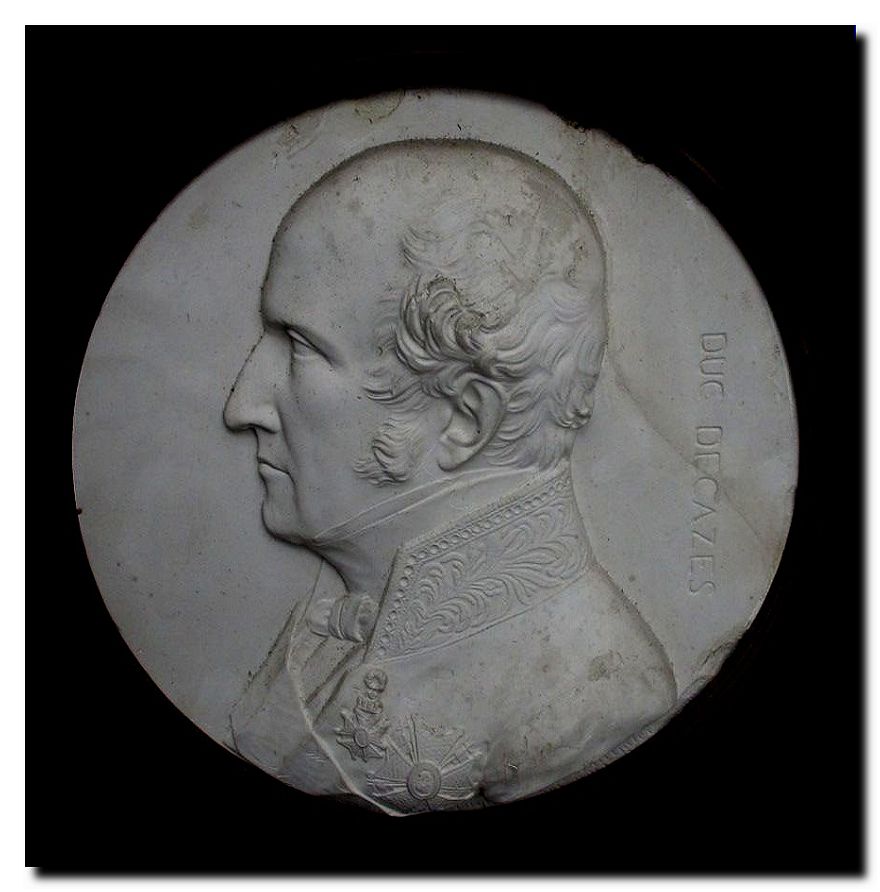
Vous avez pu découvrir, sur ce site, de multiples portraits du duc Elie
Decazes : statues, bustes, tableau, gravures et même photographie.
Voici, pour varier, un médaillon en plâtre. Le duc porte les insignes
de la Légion d'Honneur, ainsi que la plaque de Grand Croix, à
gauche sur la poitrine, comme il se doit. Celle-ci lui fut attribuée en
1841. Le cordon est aussi présent.
On ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec le tableau, dans
un musée danois, de Court : c'est à la même époque, avec le même
habit et les mêmes décorations, mais de profil.
infographie JR
photographie aimablement
communiquée par B. Lefevre
médaillon plâtre, diam 24 cm,
cerclé laiton, socle bois
sans signature
http://www.proantic.com/display.php?mode=obj&id=16358
Après
son départ contraint (et forcé) du Palais en 1848, le duc ne souhaitait
pas -ne pouvait pas-
récupérer cette belle table, sa propriété, n'ayant plus un habitat en
rapport ! Elle ne pouvait évidemment pas s'intégrer dans une pièce du
deuxième étage de la rue Jacob ! Vers 1850 une transaction intervient
pour un rachat par le Sénat. Connue sous le nom de table
Decazes, vous pouvez la découvrir au Palais du Luxembourg,
toujours en place de nos jours.
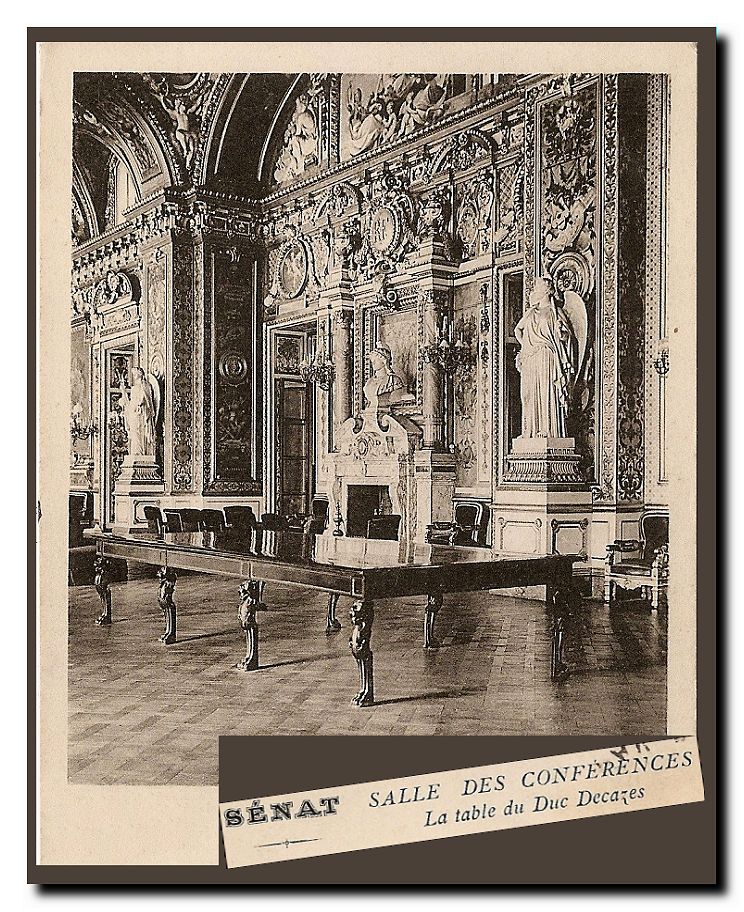
 duc
Decazes, franc-maçon
duc
Decazes, franc-maçon

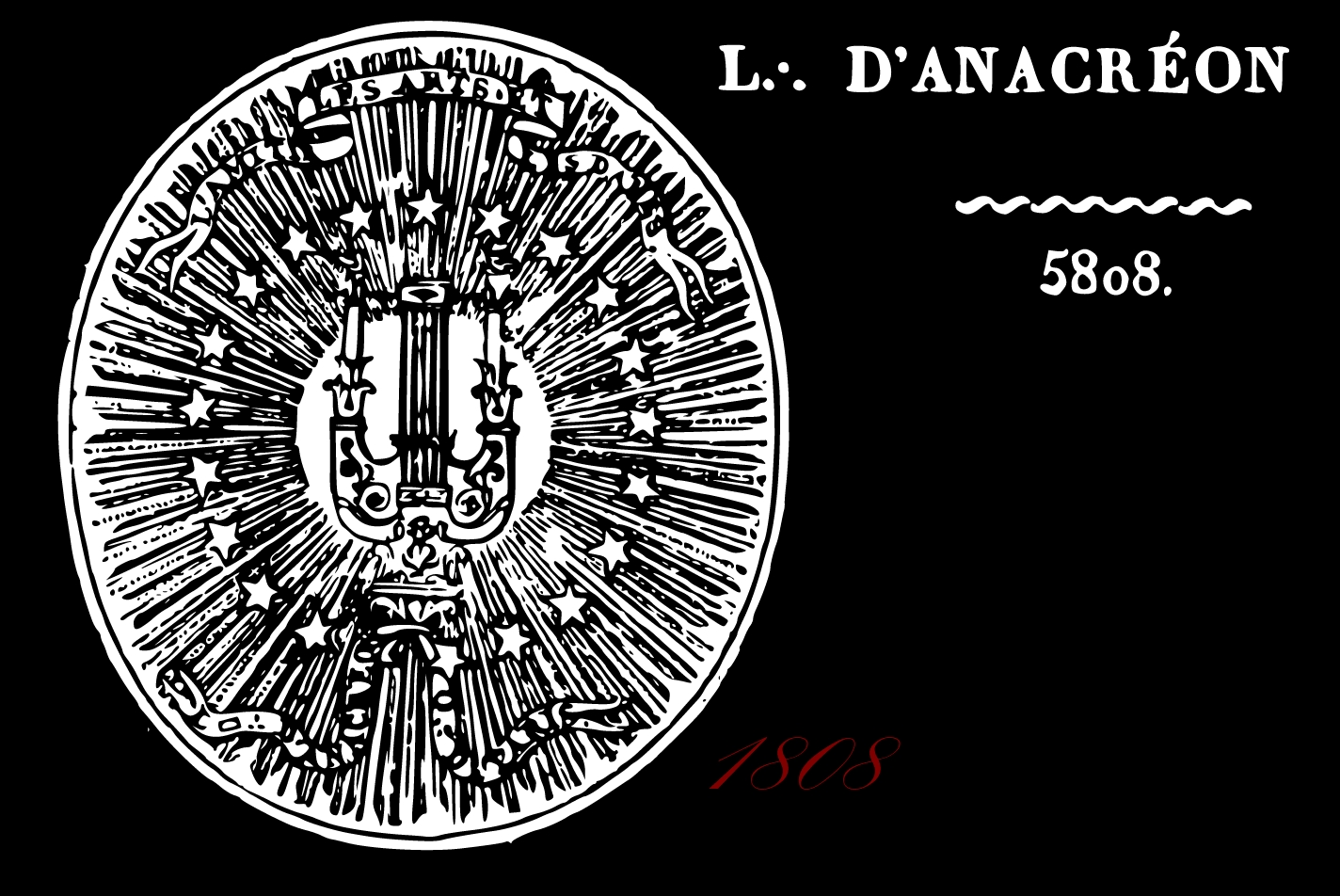
Le duc Decazes fut un des plus hauts
dignitaires de la franc-maçonnerie, du début du XIX ème siècle,
introduit par le comte Muraire, jusqu'à sa disparition en 1860. Nous
n'avons que peu souligné dans nos pages les fonctions de maçon du
duc...Le lien ci-dessous (clic sur l'image) vous
permet de mieux faire connaissance du duc
dans ces fonctions. L'article très documenté - Charlet Christian, Louis XVIII, Decazes et
la Franc-maçonnerie, Bulletin Société Française de Numismatique, mai
2007- fournit une lecture
complète de la célèbre médaille de 1818 de Barre, médaille maçonnique et
politique pour le ministre de l'époque.
► On rectifiera dans ce texte, page
106, la date du mariage, en août 1818 et non 1819 comme indiqué. Par ailleurs, même
page, il
engloutit sa fortune....L'affirmation,
souvent rencontrée, ne nous semble pas être parfaitement véridique...On
notera également la confusion entre Président de la Chambre des pairs,
ce que n'a jamais été Elie Decazes, et la fonction différente de Grand
Référendaire, ce qu'il fut.
 ▲
clic, pour analyse complète
▲
clic, pour analyse complète
Cette
médaille maçonnique -et politique-, frappée en commémoration de
l'évacuation du sol de la France par
les troupes étrangères,
d'où
la mention ETRANGERS RETIRES,
fut remise au Roi le 2 décembre 1818 par le comte Decazes.

Comte
Decazes élu...
Temple
inauguré
Grande
Loge installée
Etrangers
retirés...
Frère
Joly, orateur de la Grande Loge Ecossaise : "...une médaille qui
éternise pour nous, s'il est possible, le souvenir du départ des
troupes étrangères et qui constate que la délivrance du territoire
français, stipulée dans le traité du 9 octobre courant, coïncide avec
l'élection du Très Illustre Frère comte Decazes, Très Puissant
Souverain Grand-Commandeur titulaire du Rite Ecossais, avec
l'installation de la Grand-Loge écossaise, avec l'inauguration de son
temple".
(in
Compte-rendu des travaux du Suprème Conseil)
On
a beaucoup écrit, bien ou moins bien, sur le passé maçonnique du duc
Elie Decazes...
une analyse critique de ces écrits est ici hors sujet.
Le fichier Bossu (BnF) montre l'appartenance d'au moins 7 membres du
premier cercle. Figure aussi celle
de Mirbel, le fidèle secrétaire général des ministères d'Elie Decazes...

 Octobre
2024-janvier 2025. Le musée des Beaux-Arts de Libourne propose une
exposition. Retrouvez des informations dans la page Actualités.
Ferrobase vous offre également une visite virtuelle rapide (clic sur
l'image ci-dessus). Vous pourrez trouver de réelles pépites, comme un
portrait d'Elisabeth Muraire, celui de la soeur du duc, ou un insolite
portrait d'Elie Decazes, jeune...
Octobre
2024-janvier 2025. Le musée des Beaux-Arts de Libourne propose une
exposition. Retrouvez des informations dans la page Actualités.
Ferrobase vous offre également une visite virtuelle rapide (clic sur
l'image ci-dessus). Vous pourrez trouver de réelles pépites, comme un
portrait d'Elisabeth Muraire, celui de la soeur du duc, ou un insolite
portrait d'Elie Decazes, jeune...





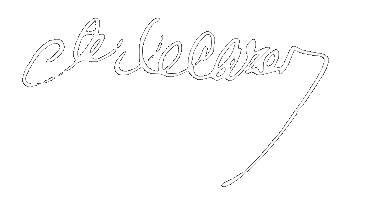
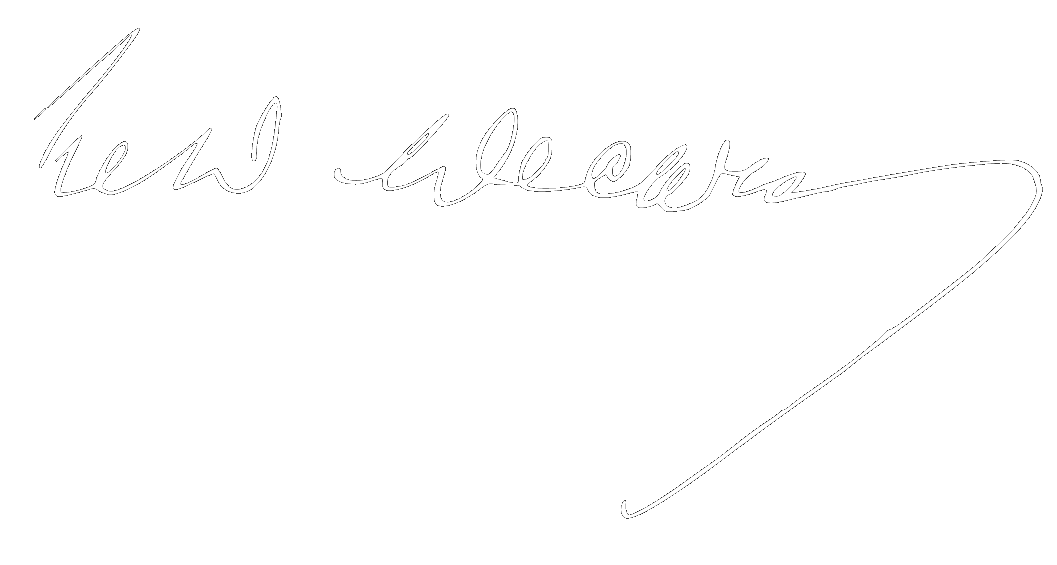




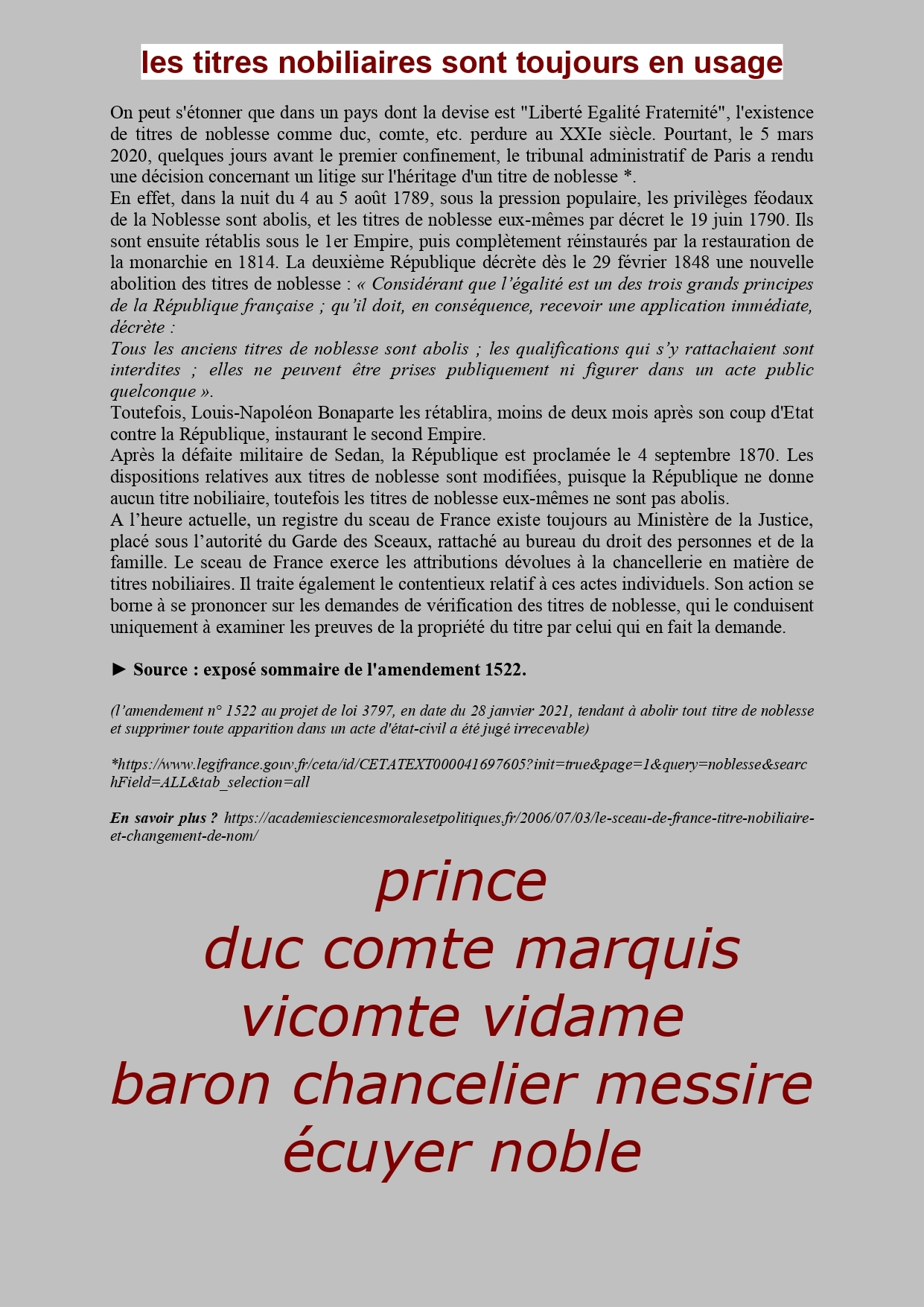
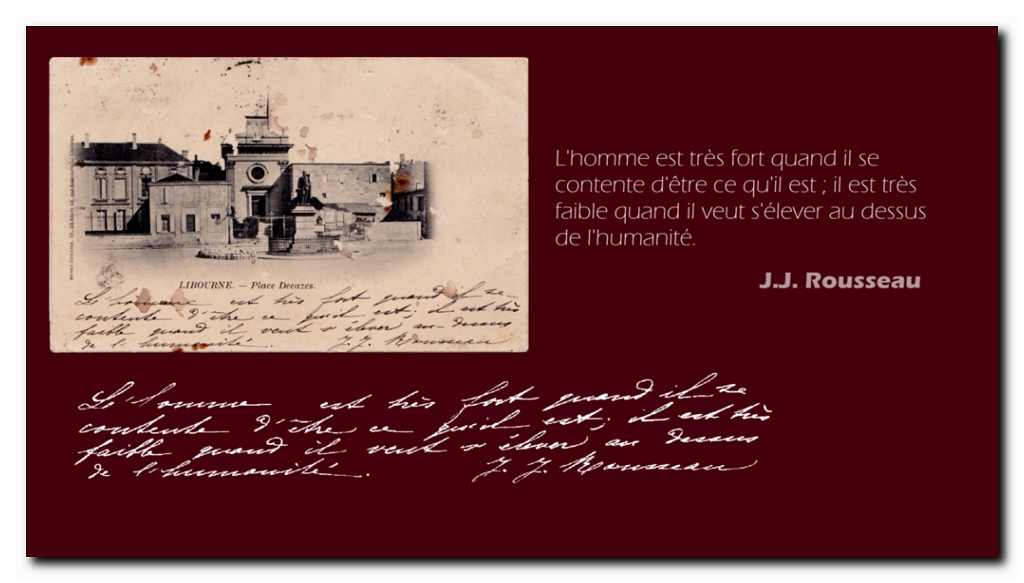 clic
clic
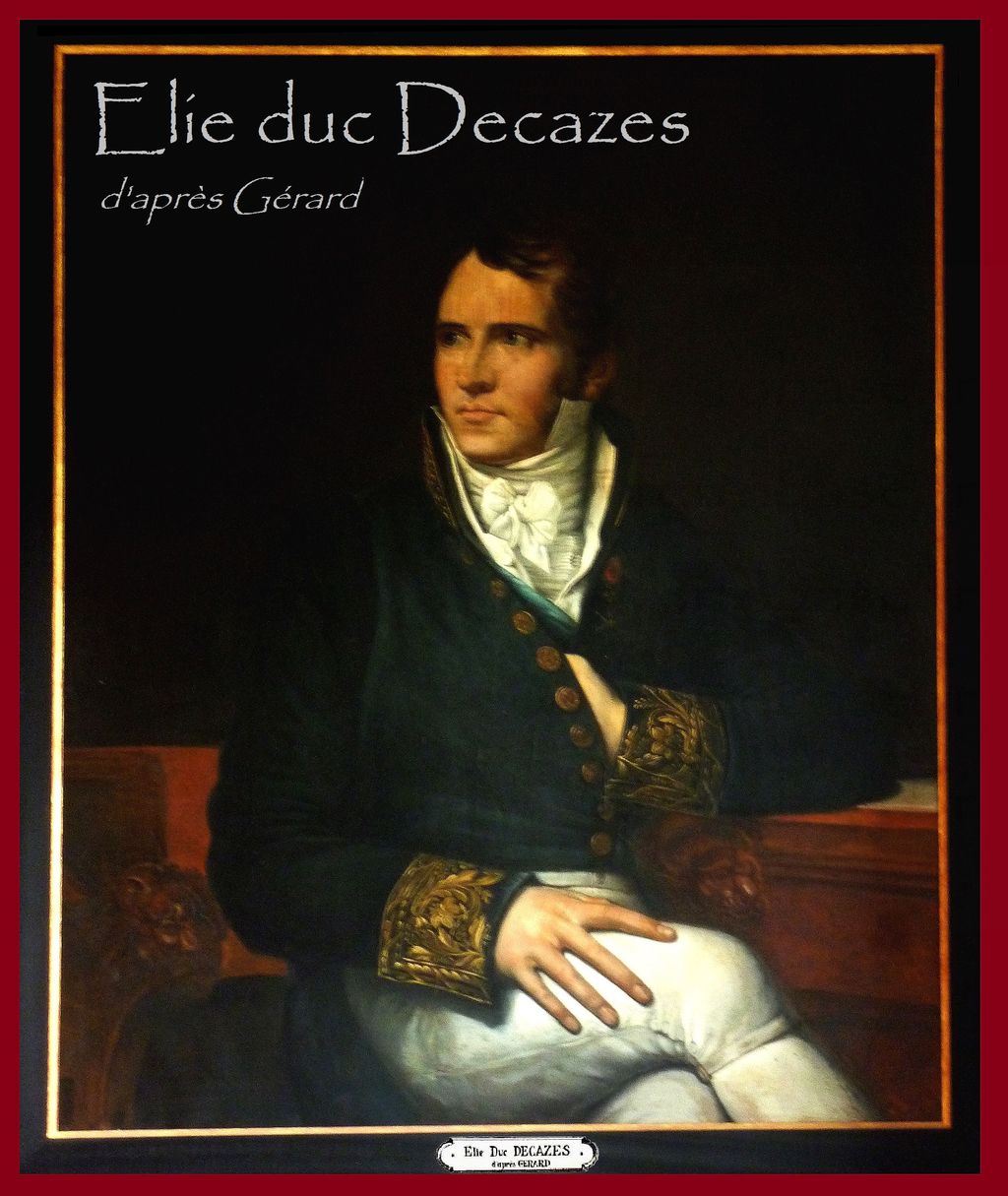
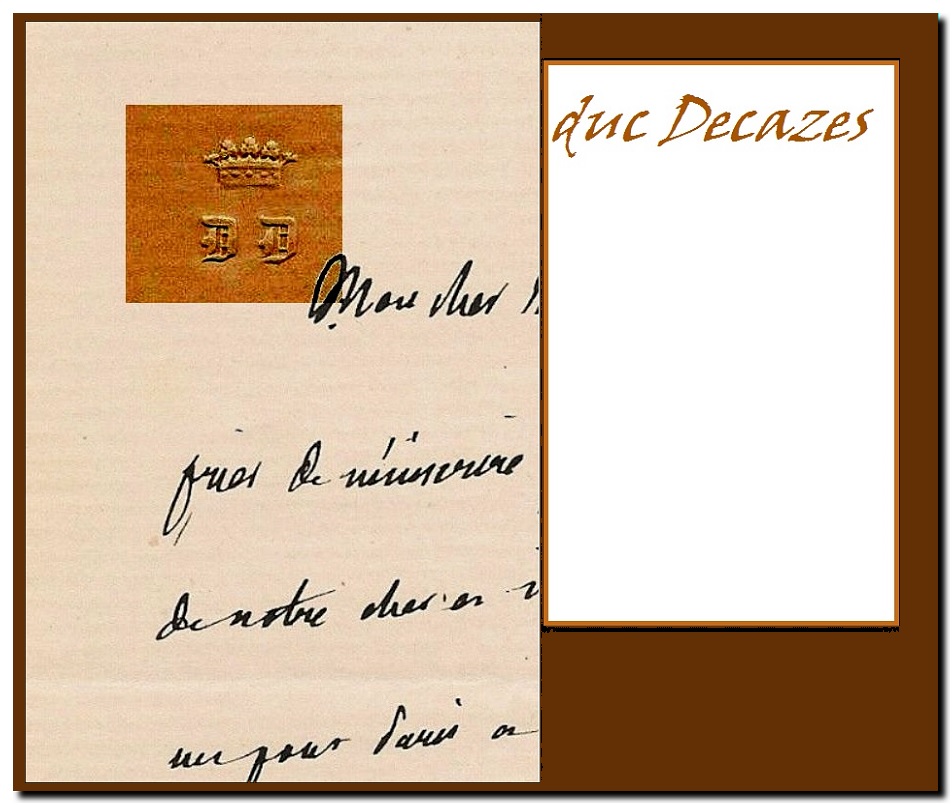

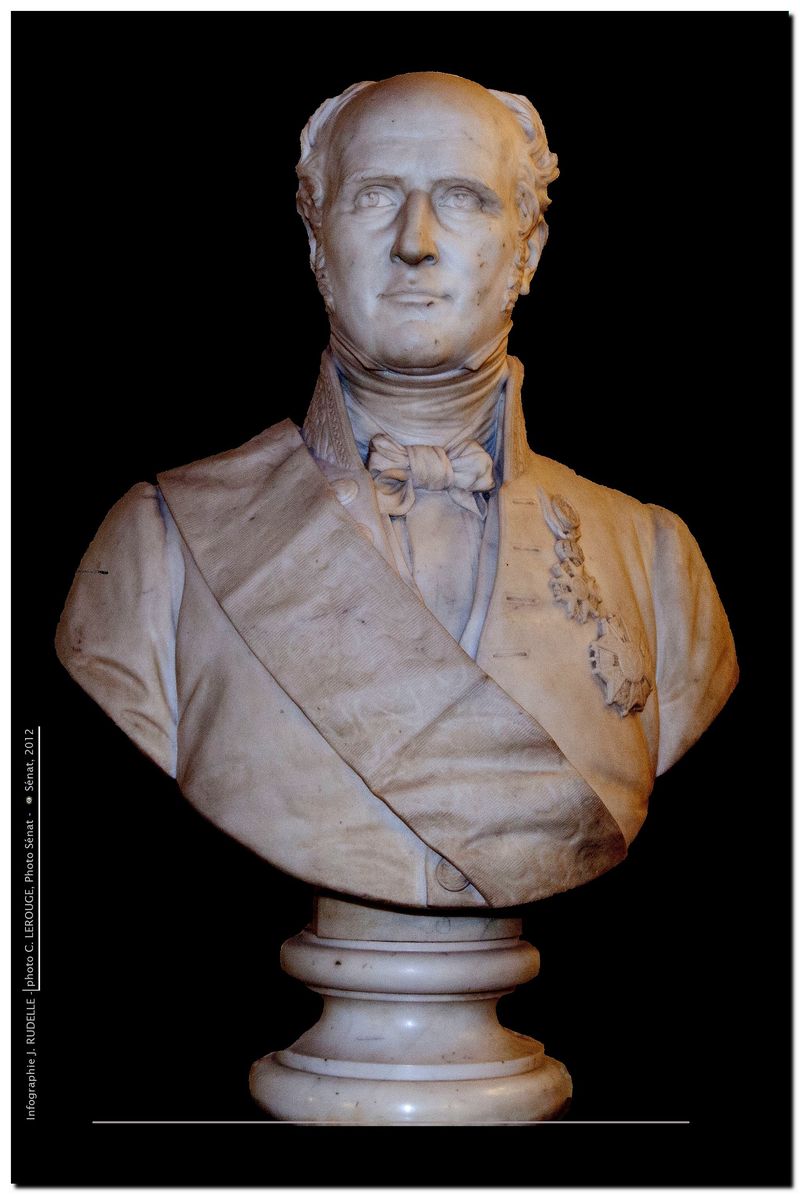
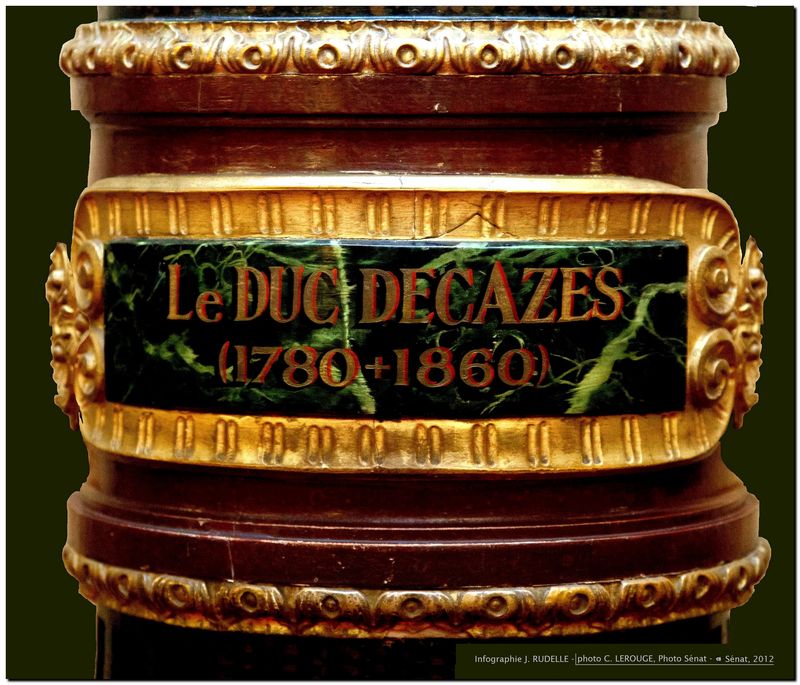
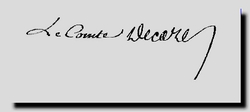 Il est possible que la lecture des pages suivantes soit une véritable
surprise, elle l'a été pour nous quand nous les avons écrites !
L'époque qui nous intéresse, 1815-1825, vient après des "évènements"
violents : révolution, guerres diverses...et ceux qui furent les
acteurs de ces évènements ont des personnalités hors du commun, mêmes
si elles sont très différentes les unes des autres. Il n'était pas
d'usage pour eux de cacher les faits et les mots et écrits sont le
reflet
de cette violence, qui ne sera pas, y compris pendant la période
Decazes, que verbale. Il est important de garder cet aspect de la
situation en tête, pour conserver un peu de recul devant ces
textes. Extravagants ? Outranciers ? Et donc à rejeter ? Chacun
se
fera son idée...Si nous avons par exemple cité M. Clausel de
Coussergues, ce n'est pas pour son propos plus qu'enflammé : le roi
Louis XVIII a entendu son Cri,
il y a répondu dans ses lettres au
comte, c'est bien le signe d'une certaine importance. Les intérêts
des uns et des autres ne sont pas seulement politiques, et ce n'est
pas uniquement croyons nous une lutte pour des idées et pour le
pouvoir, ou les pouvoirs.
Pour certains, comme Chateaubriand, sa
fortune est faite, et il peut se consacrer à ces luttes en apportant sa
notoriété, au risque de la compromettre par quelques phrases
couperets. Pour d'autres, venant d'intégrer la noblesse, au
hasard des alliances, ralliements et autres rapprochements intéressés,
il est important de consolider l'ascension sociale, et les propos
tenus à la Chambre des Députés, ou à la Chambre Haute, ne sont
pas sans importance et sans effet. Le caractère qui peut
apparaître excessif des propos trouve aussi une justification dans la
liberté naissante de la presse : il faut user de cette liberté,
pratiquement le seul moyen de se faire (re)connaître. On écrit
beaucoup, hommes comme femmes. Il est possible que de nos jours, les
mêmes situations ne seraient pas analysées et décrites avec les mêmes
termes. Monsieur Decazes, qui n'est que Monsieur au début de ces pages,
va se trouver placé aux toutes premières places, après
Waterloo. Peut-on réaliser deux siècles plus tard, ce que vont être les
écueils de l'exercice ? L'exposition du Ministre à toutes les
oppositions montre bien finalement l'intérêt de cette personnalité ;
venu il y a peu, dix ans à peine, de sa Gironde natale, il sera
l'un des plus puissants personnages durant ces années de Restauration.
Comprendre
pourquoi il consacrera une grande part de sa fortune, vers 1820-1825
aux mines du Rouergue est notre seul objectif.
Il est possible que la lecture des pages suivantes soit une véritable
surprise, elle l'a été pour nous quand nous les avons écrites !
L'époque qui nous intéresse, 1815-1825, vient après des "évènements"
violents : révolution, guerres diverses...et ceux qui furent les
acteurs de ces évènements ont des personnalités hors du commun, mêmes
si elles sont très différentes les unes des autres. Il n'était pas
d'usage pour eux de cacher les faits et les mots et écrits sont le
reflet
de cette violence, qui ne sera pas, y compris pendant la période
Decazes, que verbale. Il est important de garder cet aspect de la
situation en tête, pour conserver un peu de recul devant ces
textes. Extravagants ? Outranciers ? Et donc à rejeter ? Chacun
se
fera son idée...Si nous avons par exemple cité M. Clausel de
Coussergues, ce n'est pas pour son propos plus qu'enflammé : le roi
Louis XVIII a entendu son Cri,
il y a répondu dans ses lettres au
comte, c'est bien le signe d'une certaine importance. Les intérêts
des uns et des autres ne sont pas seulement politiques, et ce n'est
pas uniquement croyons nous une lutte pour des idées et pour le
pouvoir, ou les pouvoirs.
Pour certains, comme Chateaubriand, sa
fortune est faite, et il peut se consacrer à ces luttes en apportant sa
notoriété, au risque de la compromettre par quelques phrases
couperets. Pour d'autres, venant d'intégrer la noblesse, au
hasard des alliances, ralliements et autres rapprochements intéressés,
il est important de consolider l'ascension sociale, et les propos
tenus à la Chambre des Députés, ou à la Chambre Haute, ne sont
pas sans importance et sans effet. Le caractère qui peut
apparaître excessif des propos trouve aussi une justification dans la
liberté naissante de la presse : il faut user de cette liberté,
pratiquement le seul moyen de se faire (re)connaître. On écrit
beaucoup, hommes comme femmes. Il est possible que de nos jours, les
mêmes situations ne seraient pas analysées et décrites avec les mêmes
termes. Monsieur Decazes, qui n'est que Monsieur au début de ces pages,
va se trouver placé aux toutes premières places, après
Waterloo. Peut-on réaliser deux siècles plus tard, ce que vont être les
écueils de l'exercice ? L'exposition du Ministre à toutes les
oppositions montre bien finalement l'intérêt de cette personnalité ;
venu il y a peu, dix ans à peine, de sa Gironde natale, il sera
l'un des plus puissants personnages durant ces années de Restauration.
Comprendre
pourquoi il consacrera une grande part de sa fortune, vers 1820-1825
aux mines du Rouergue est notre seul objectif.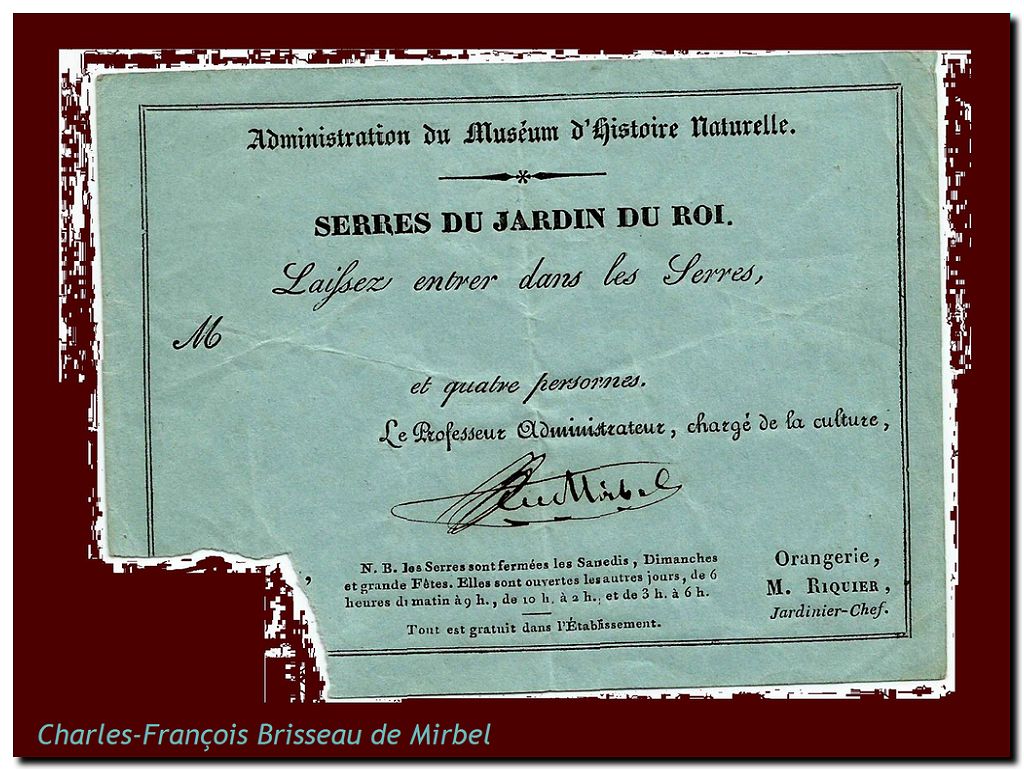

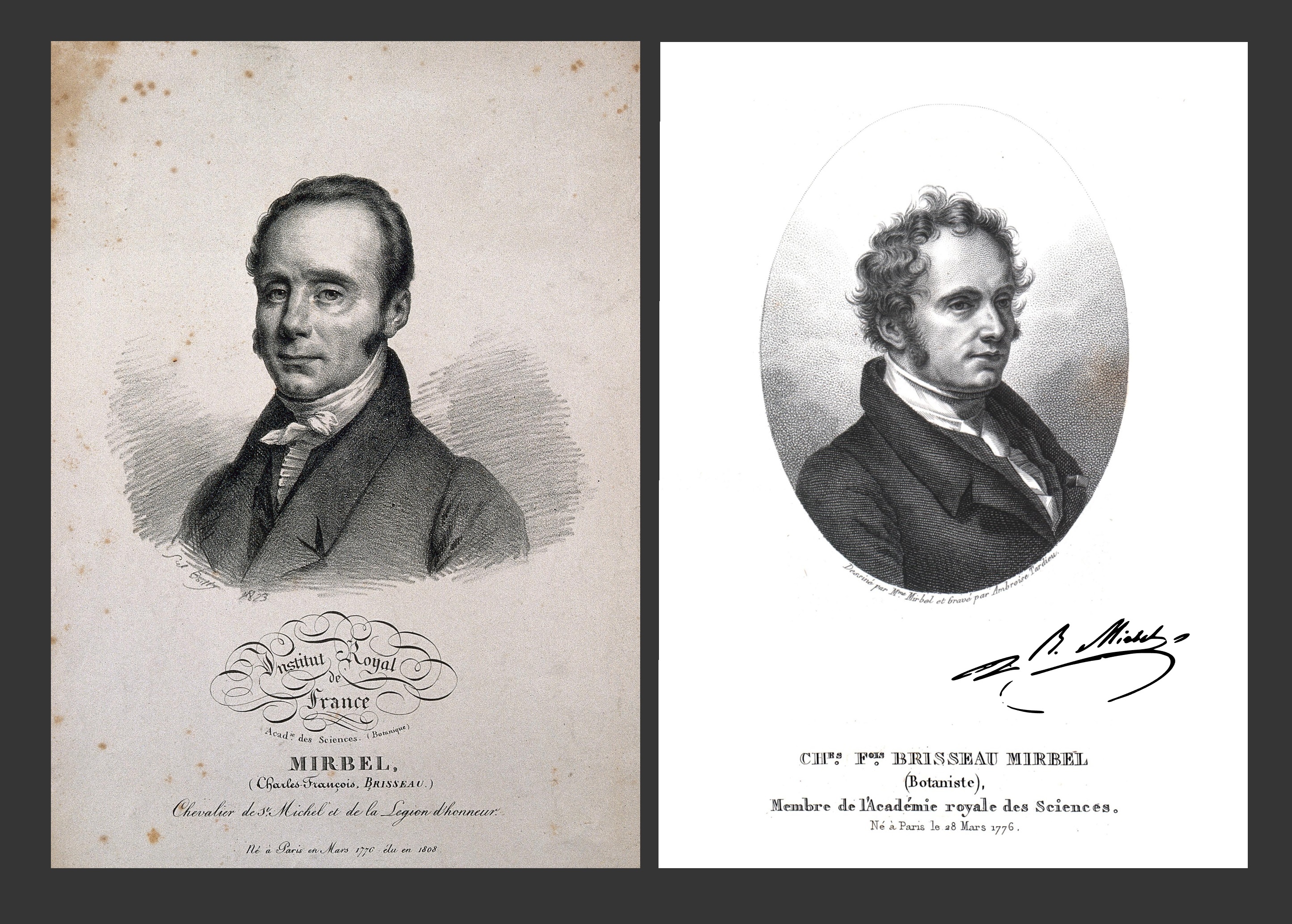
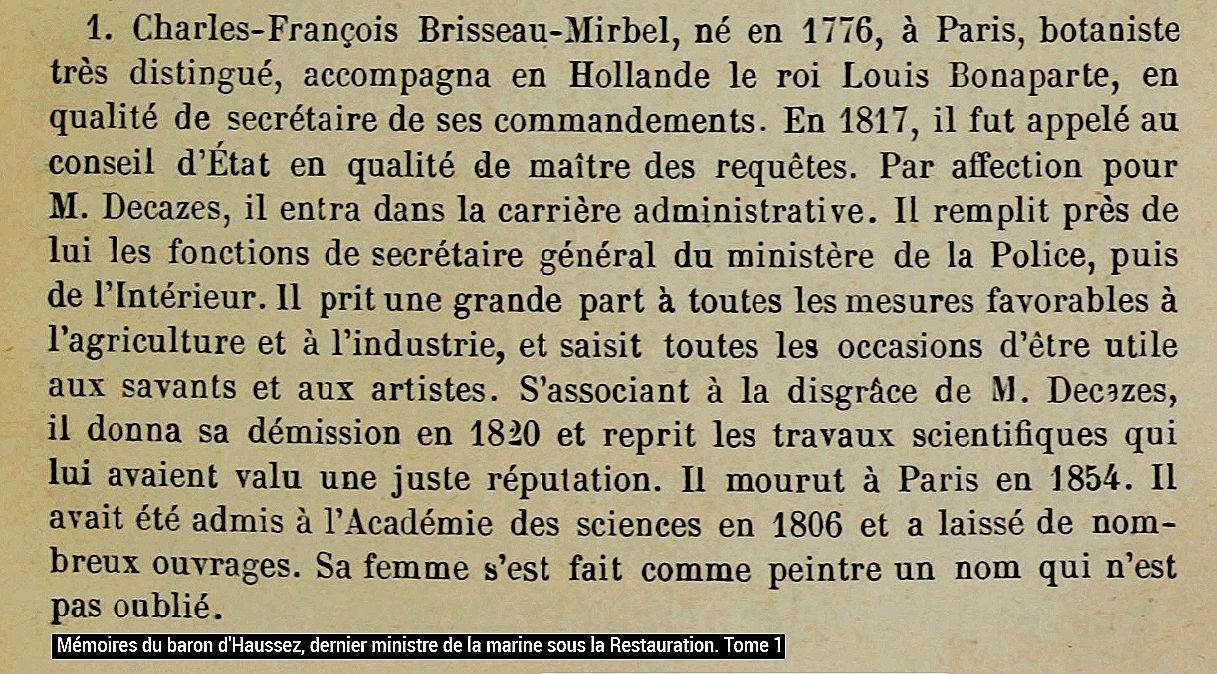
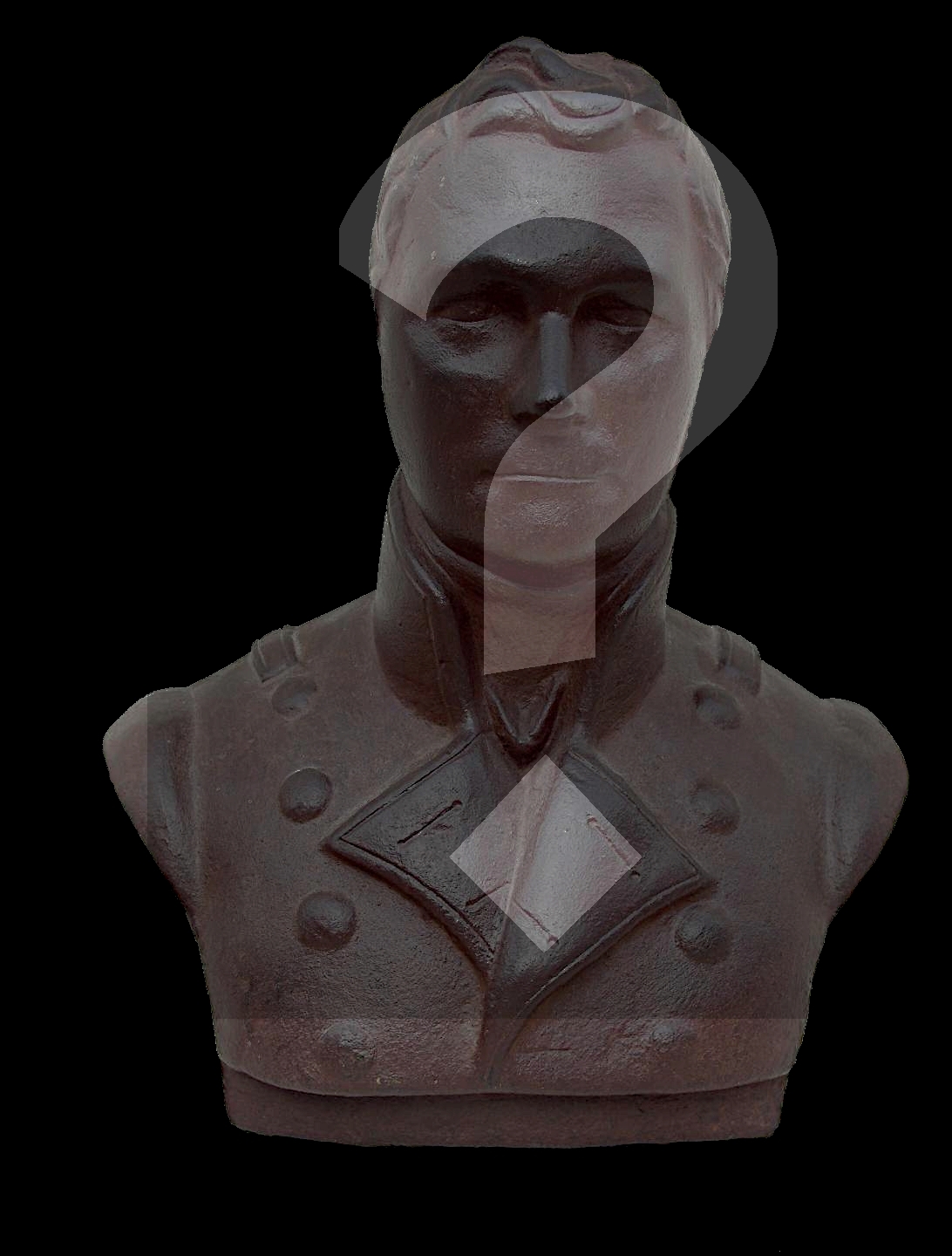


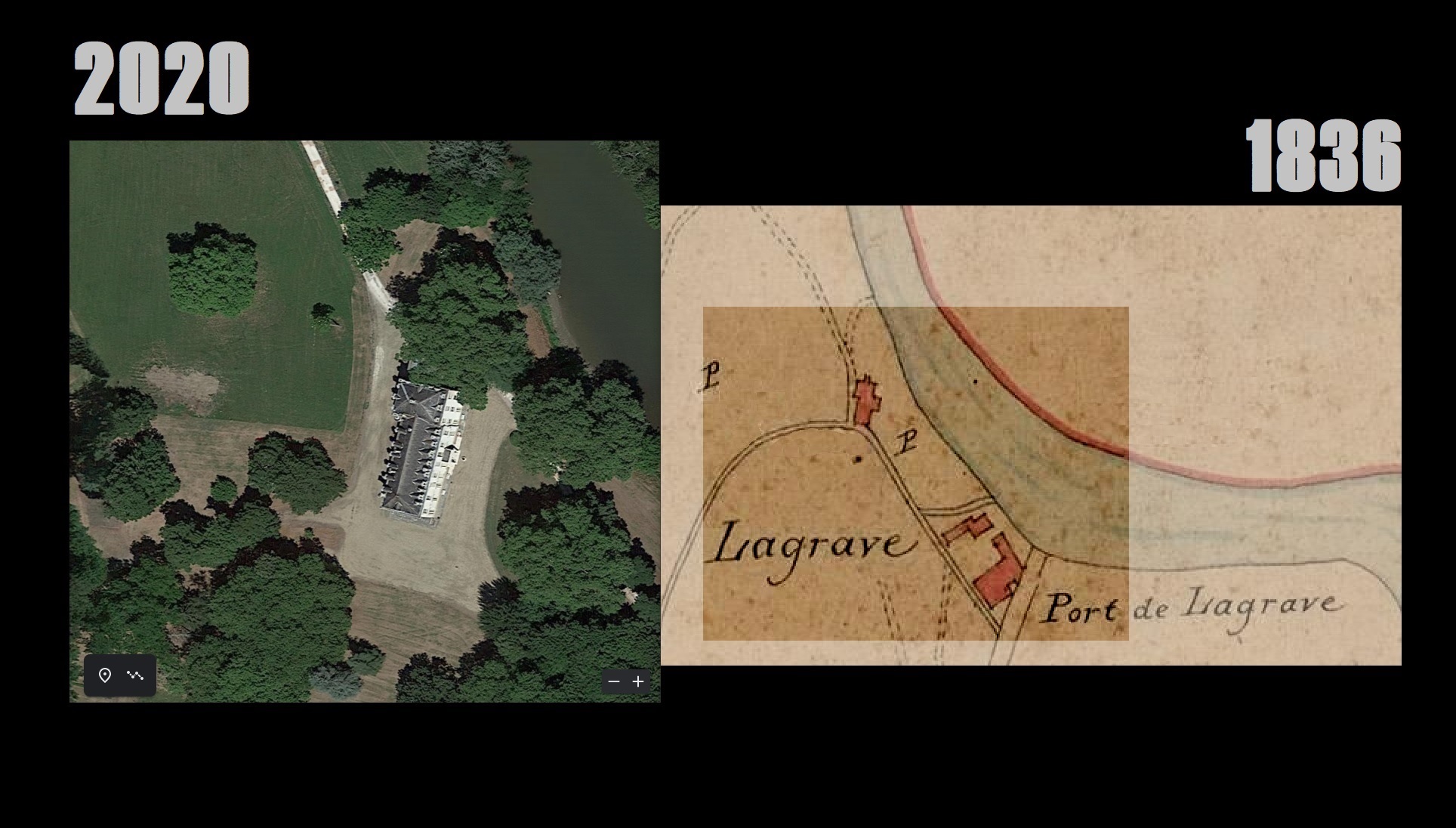



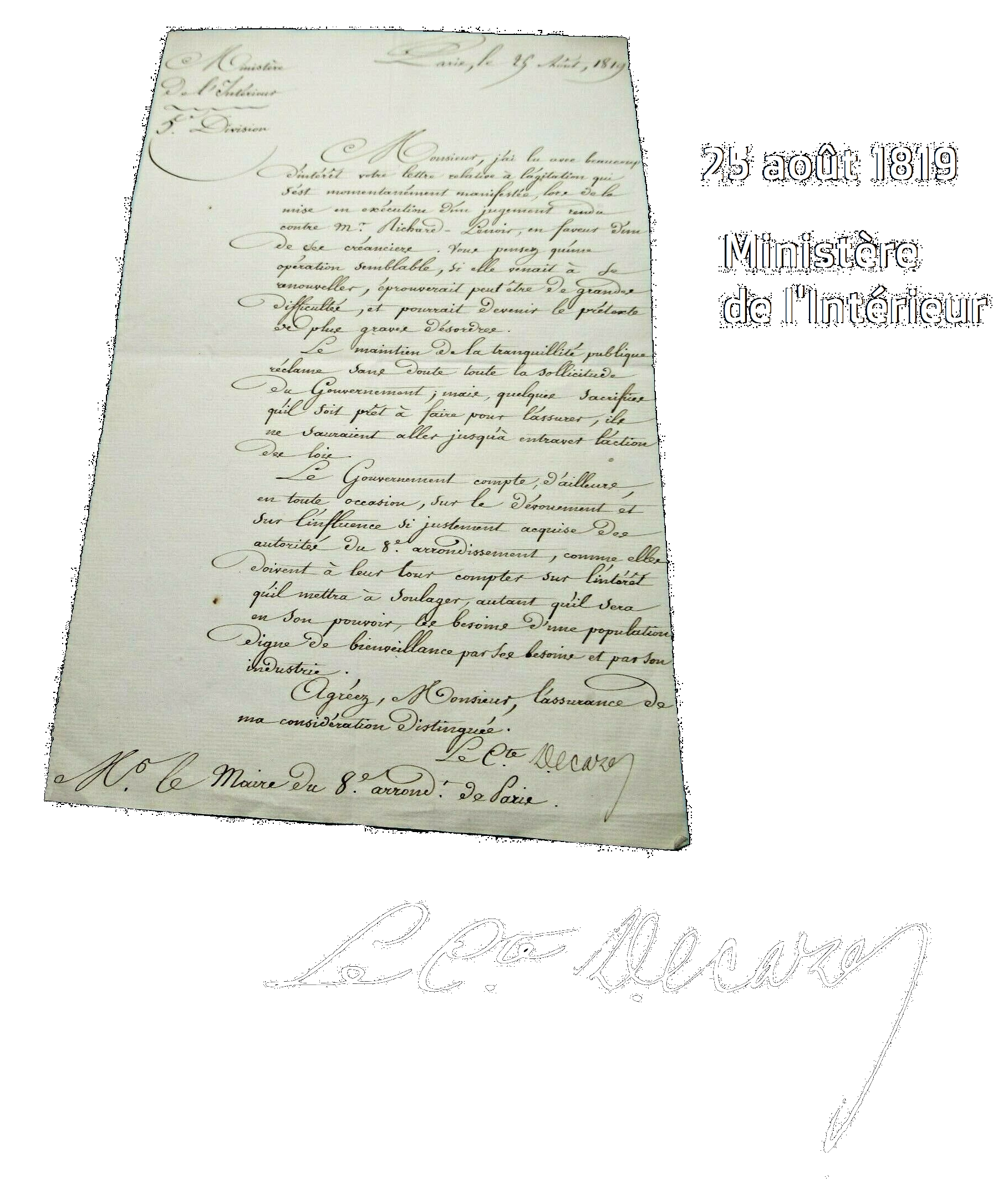
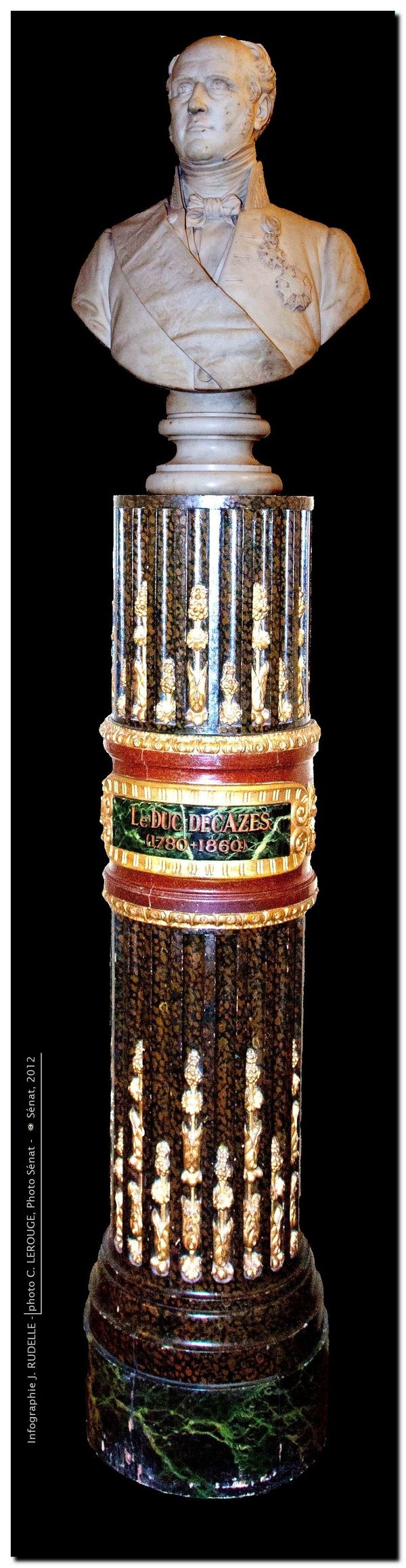 Parmi ceux qui trouvent dans le ministre, ex préfet, ex
secrétaire de madame mère Laetitia, ex…., des raisons de dresser un
portrait aimable, il y a le journaliste qui rapporte ainsi une
description de Decazeville (L'Exposition,
journal de l'industrie et des arts utiles... 1re [et 5e] année.
Année 5 - - 1839-1844, Gallica Bnf ) :
Parmi ceux qui trouvent dans le ministre, ex préfet, ex
secrétaire de madame mère Laetitia, ex…., des raisons de dresser un
portrait aimable, il y a le journaliste qui rapporte ainsi une
description de Decazeville (L'Exposition,
journal de l'industrie et des arts utiles... 1re [et 5e] année.
Année 5 - - 1839-1844, Gallica Bnf ) : 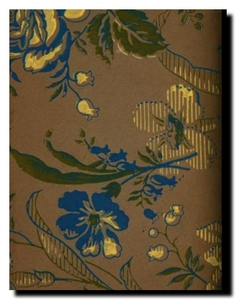
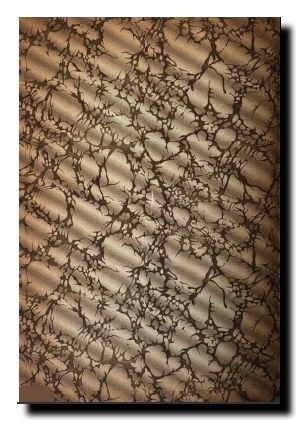
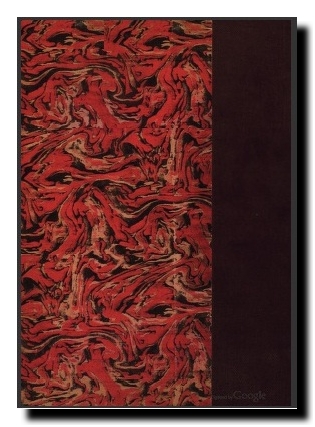
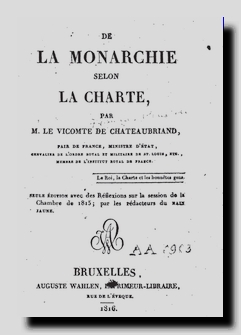
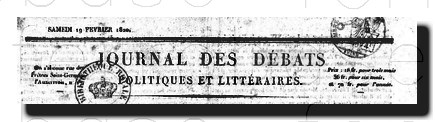
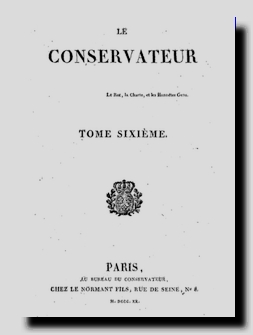 premier
temps pour vice de forme, cet appel va faire des dégâts. Il connaît un
appui dans la position de Chateaubriand, vicomte de son état et
royaliste convaincu, qui publie le 18 février dans son
propre journal, Le Conservateur
(Gallica Bnf, tome 6, 1820), et repris le 19 dans le Journal des débats, un article sans
appel contre Decazes.
premier
temps pour vice de forme, cet appel va faire des dégâts. Il connaît un
appui dans la position de Chateaubriand, vicomte de son état et
royaliste convaincu, qui publie le 18 février dans son
propre journal, Le Conservateur
(Gallica Bnf, tome 6, 1820), et repris le 19 dans le Journal des débats, un article sans
appel contre Decazes. 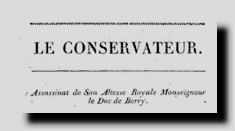
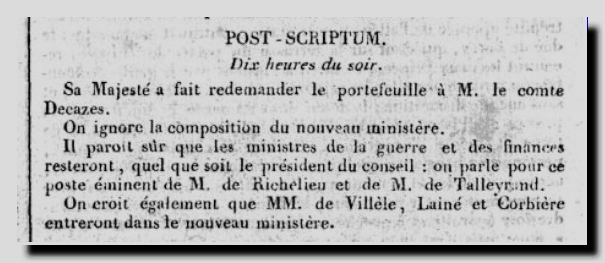
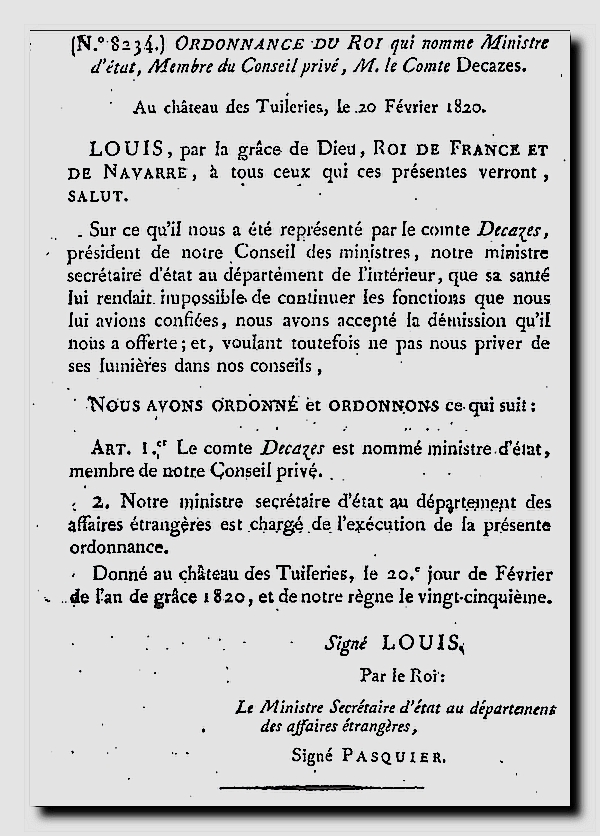
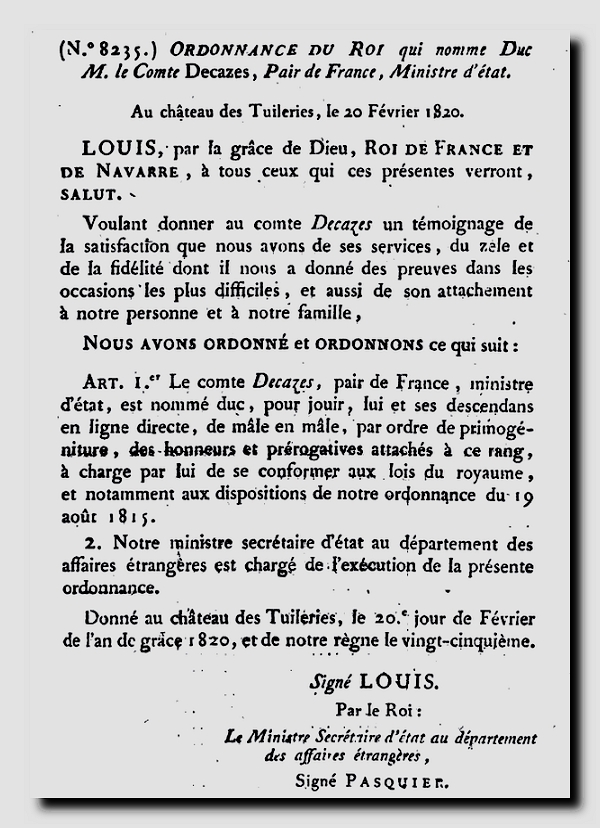
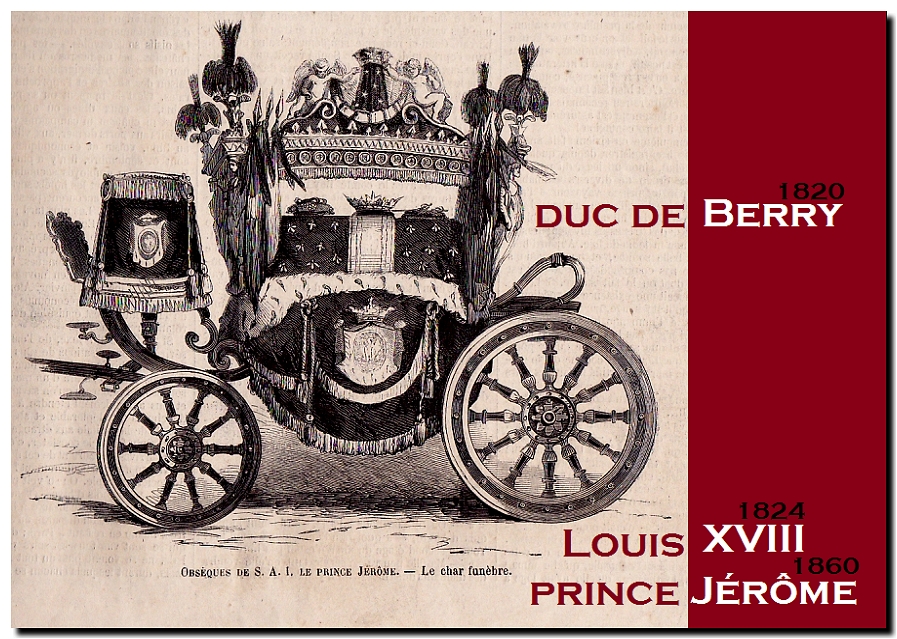
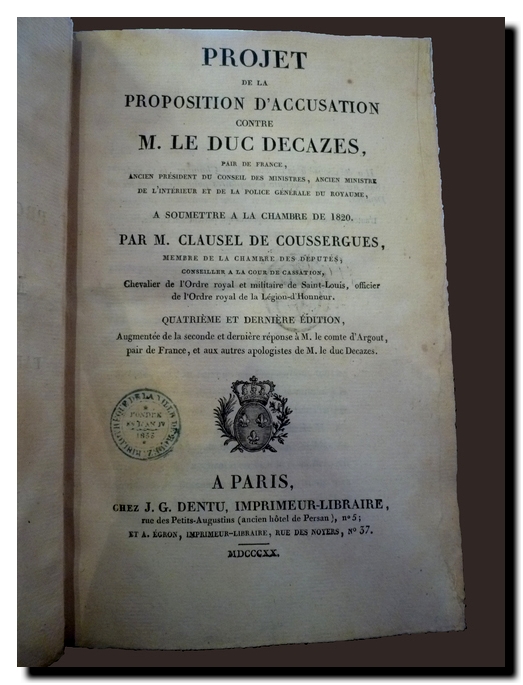


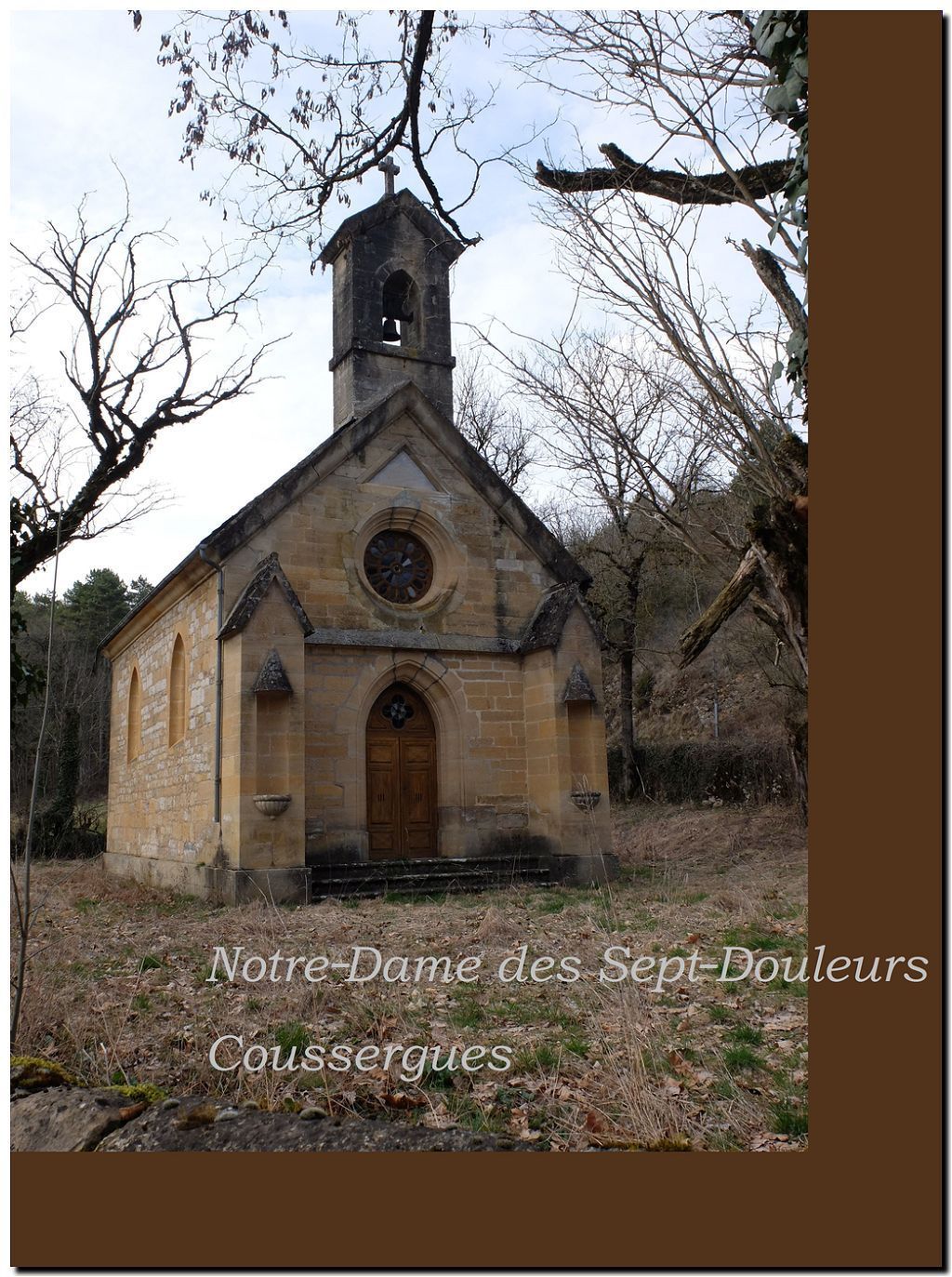

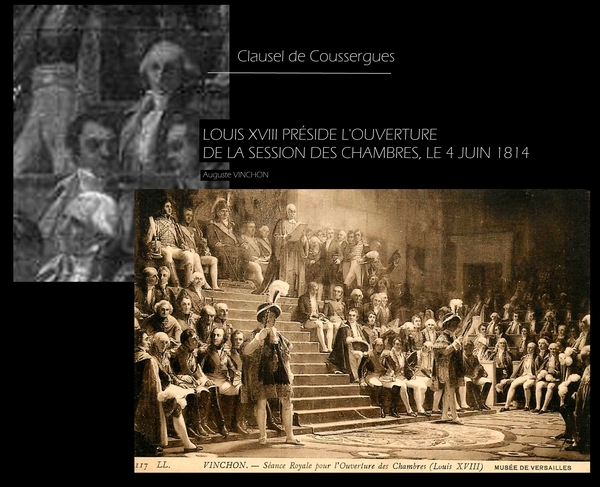 ◄
clic
◄
clic
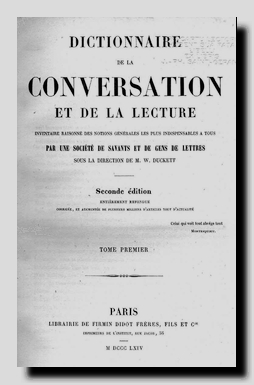

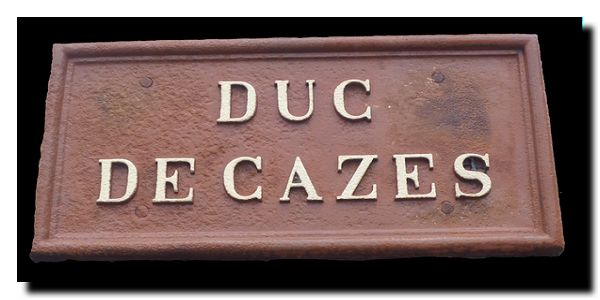
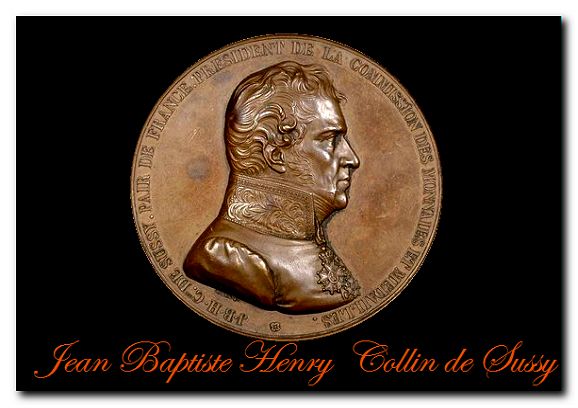 se marie la même année à 15 ans
à
Jean Baptiste Henry Collin de Sussy. Le beau frère d’Elie sera plus
tard comte
et à l’origine du musée de
se marie la même année à 15 ans
à
Jean Baptiste Henry Collin de Sussy. Le beau frère d’Elie sera plus
tard comte
et à l’origine du musée de 
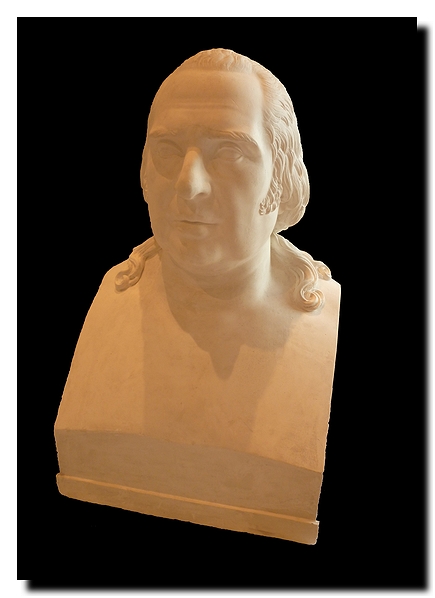
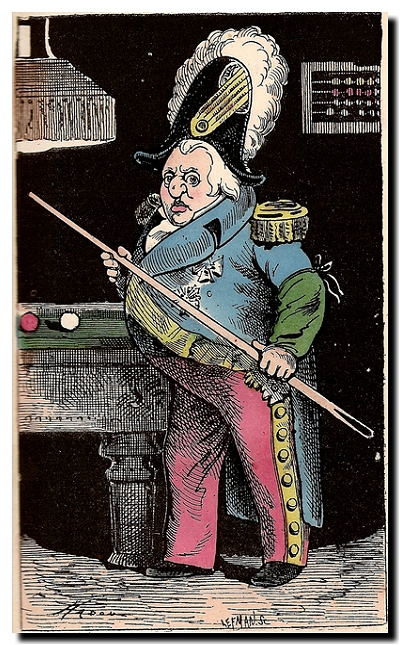
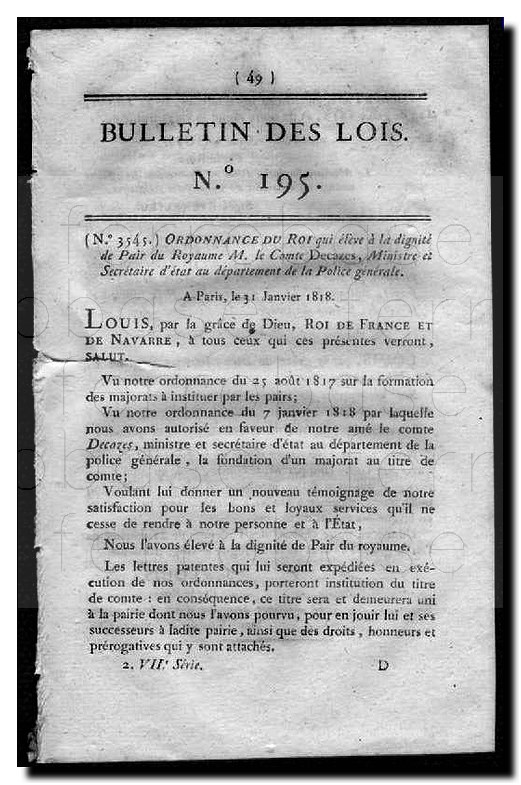
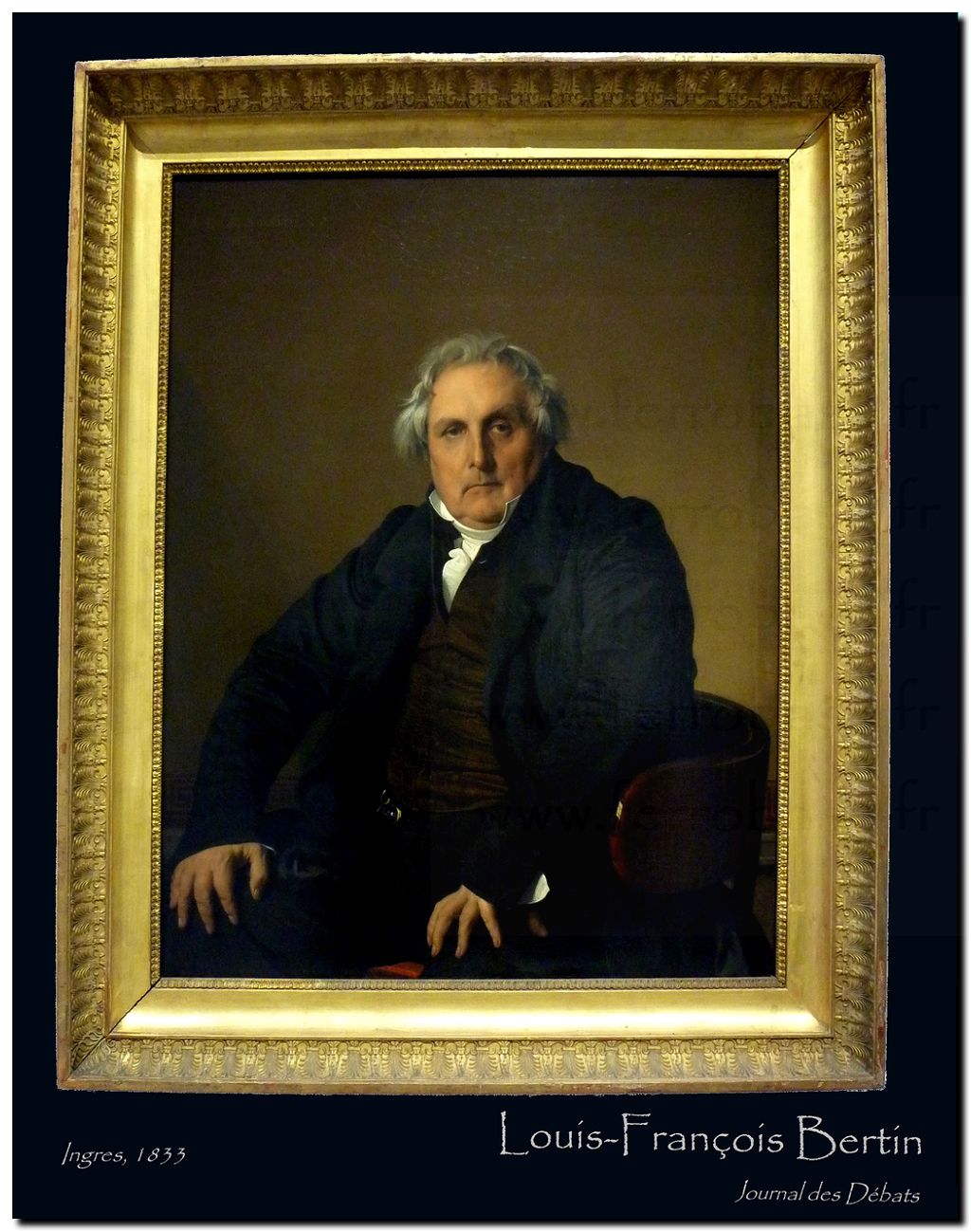
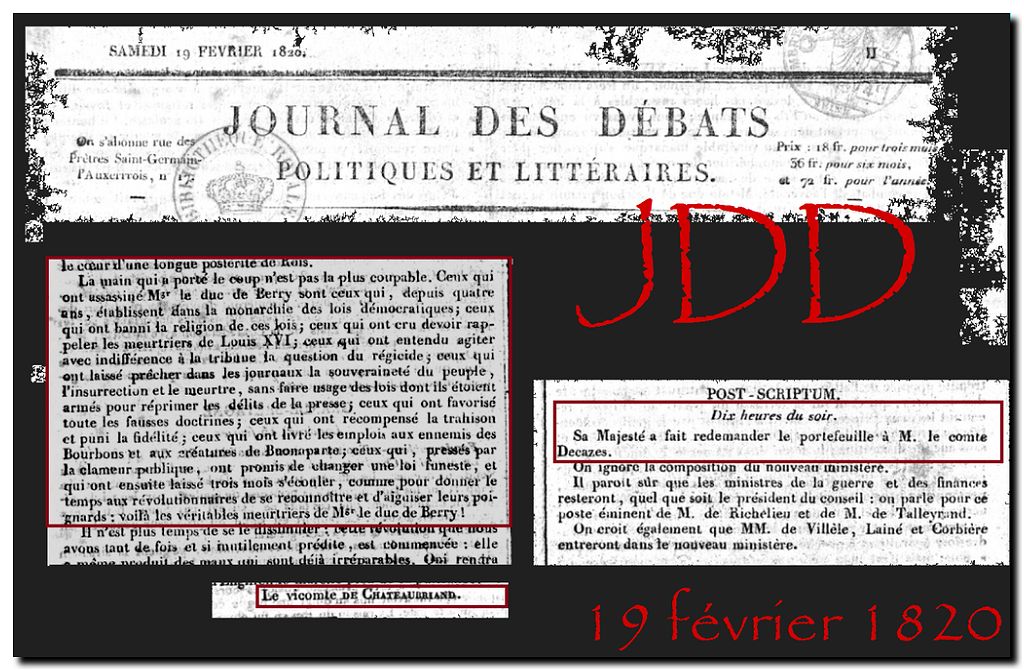
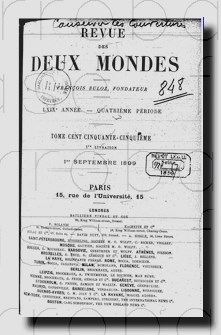
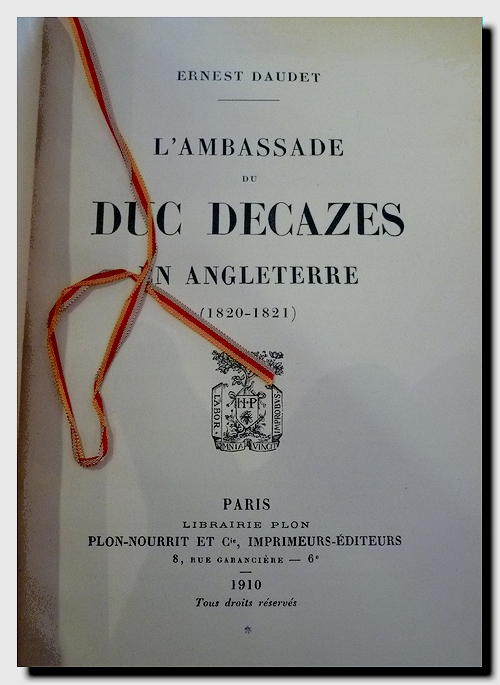
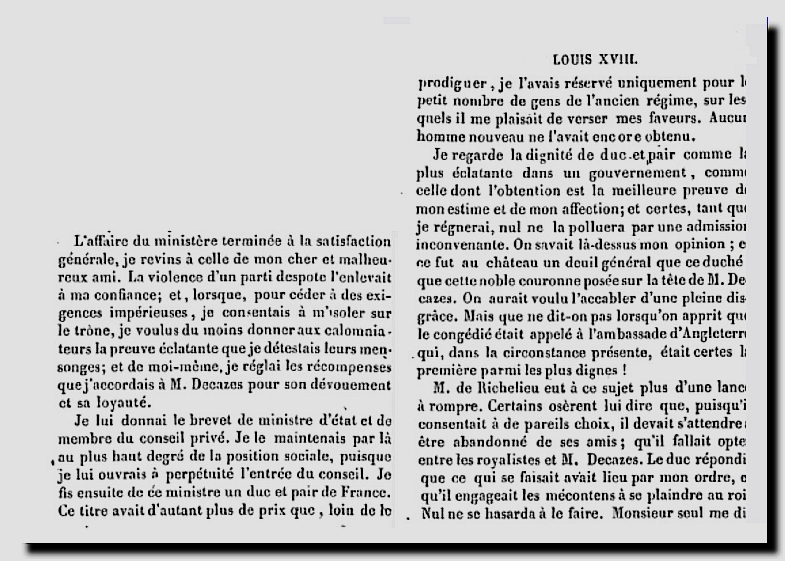
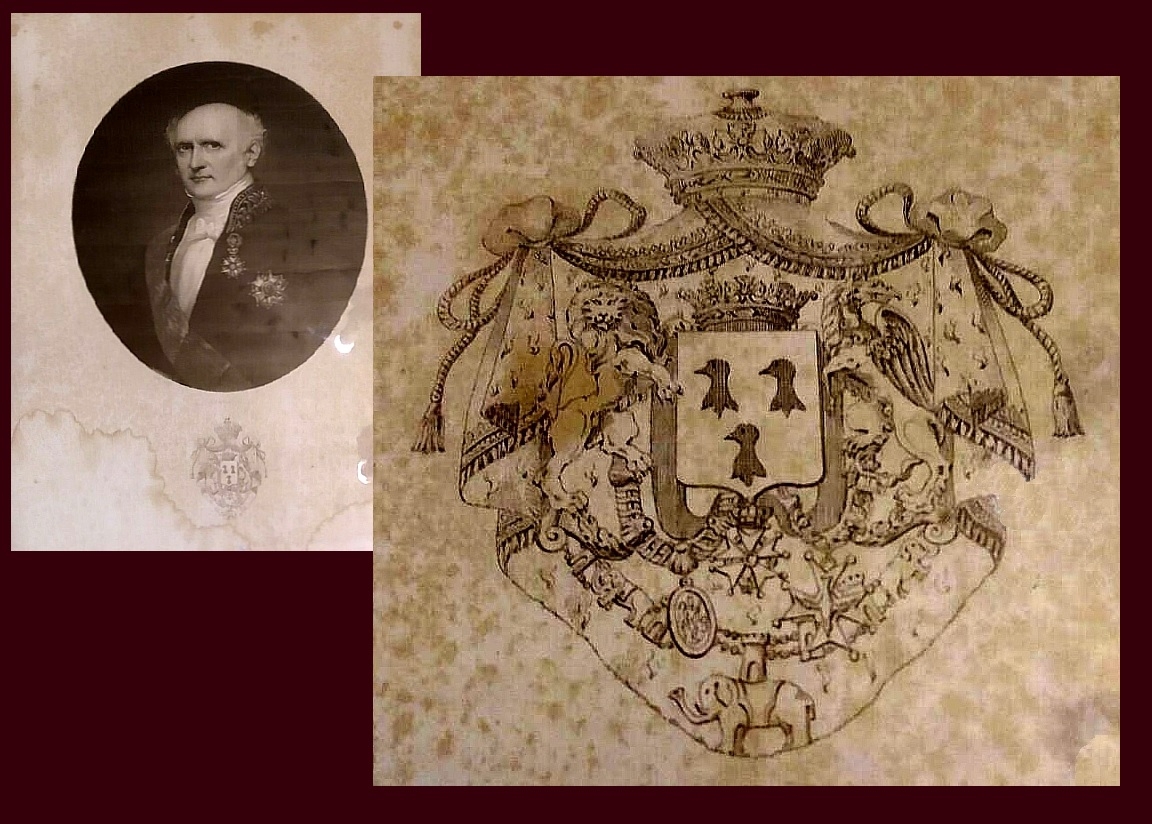
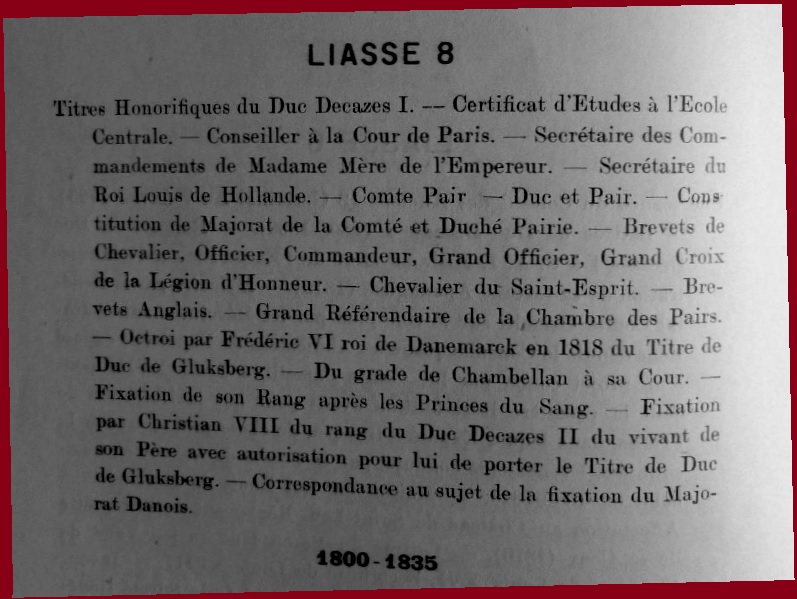
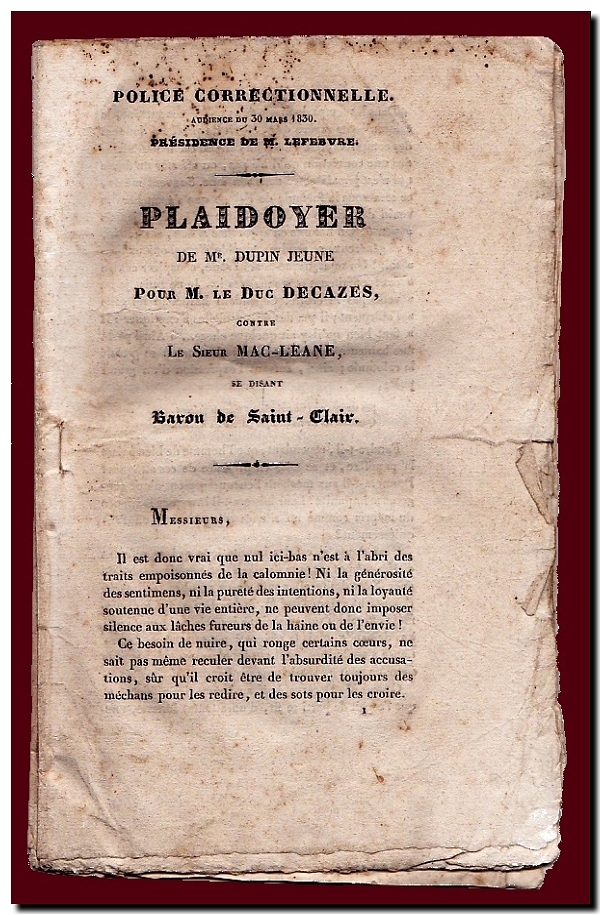
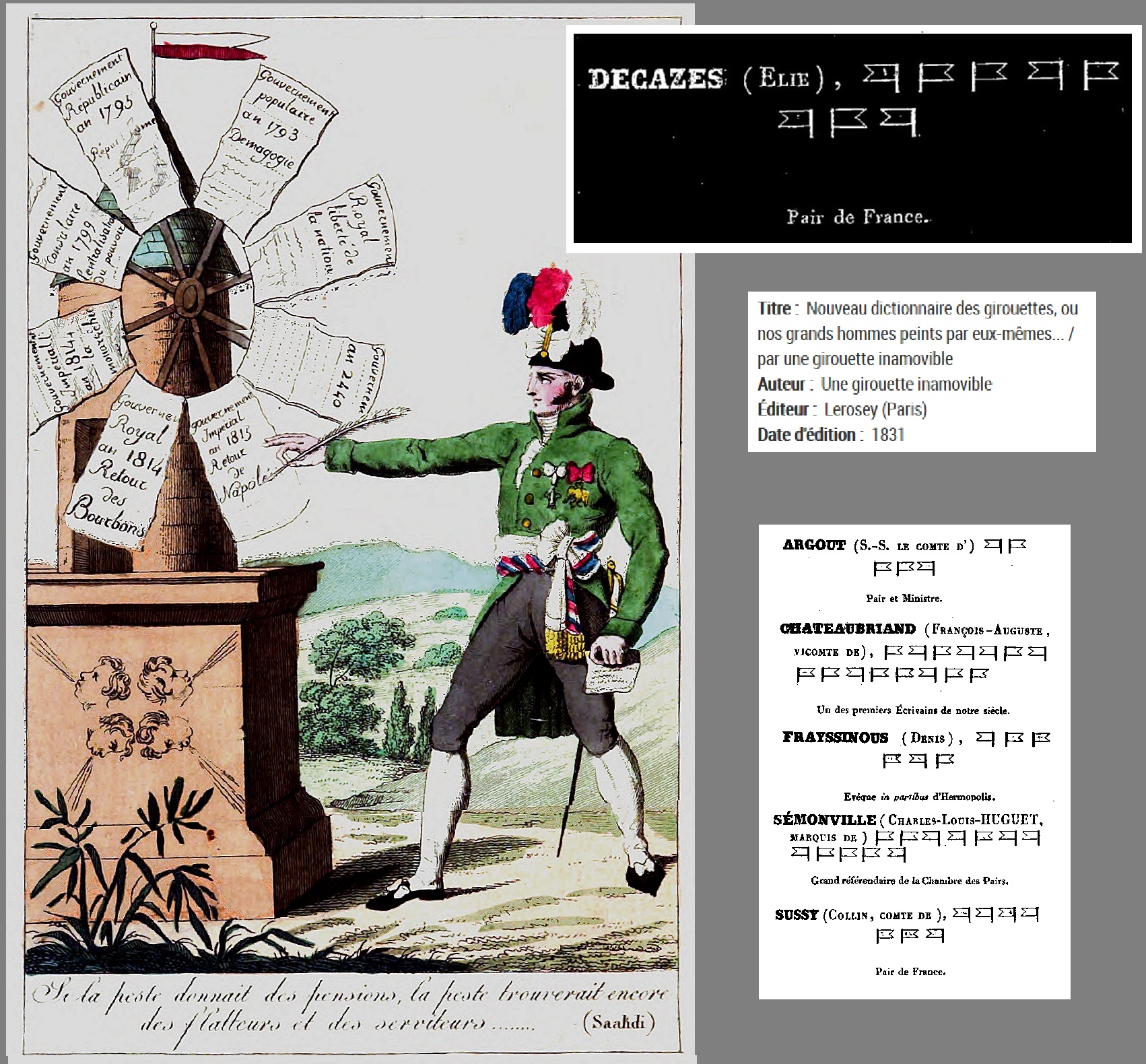 Girouette...
Girouette...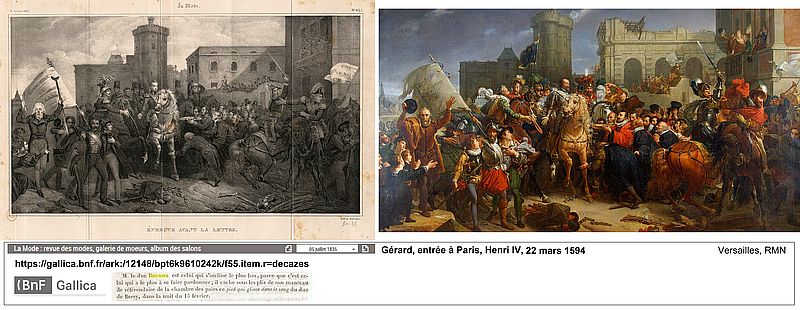
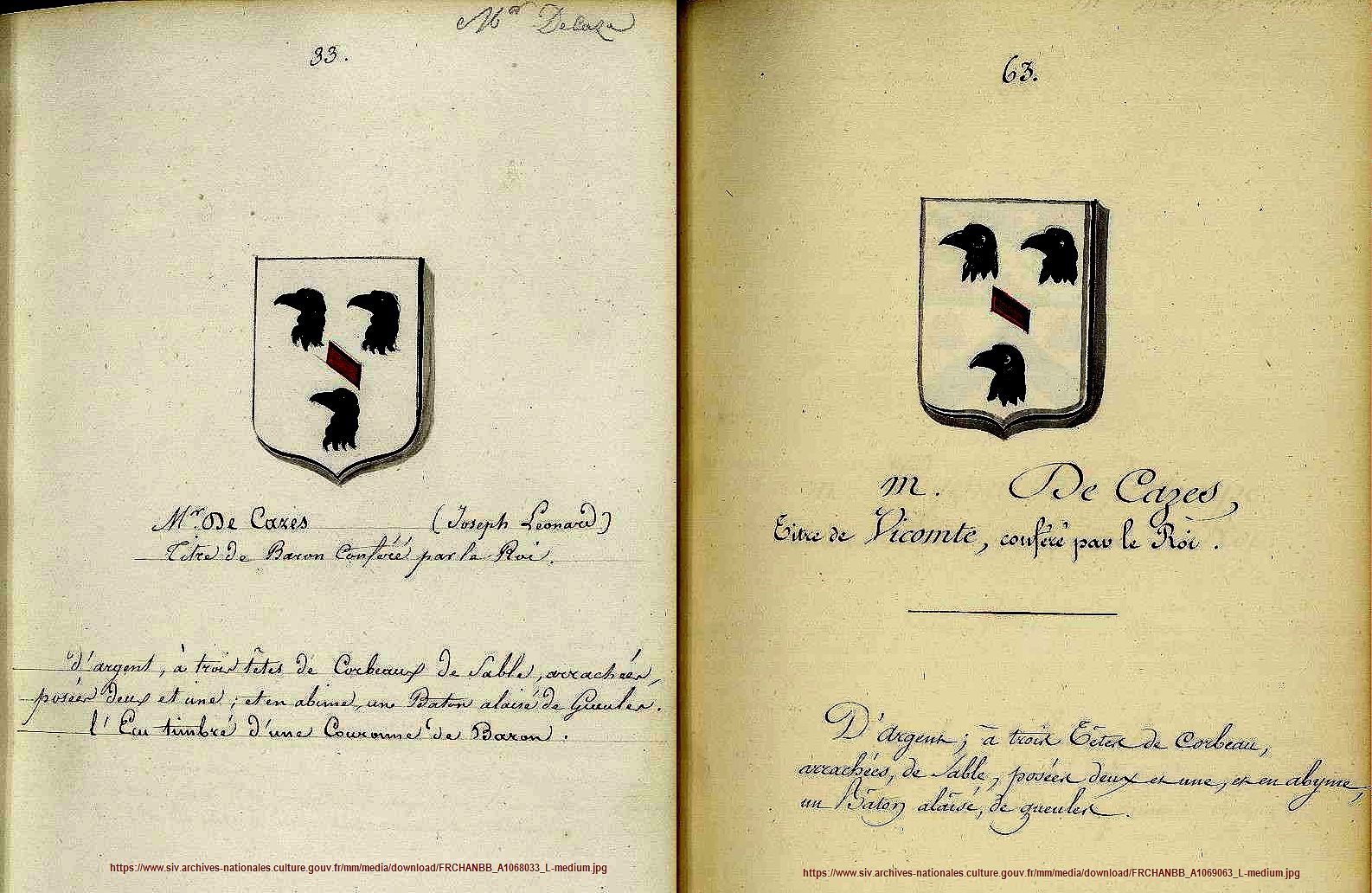
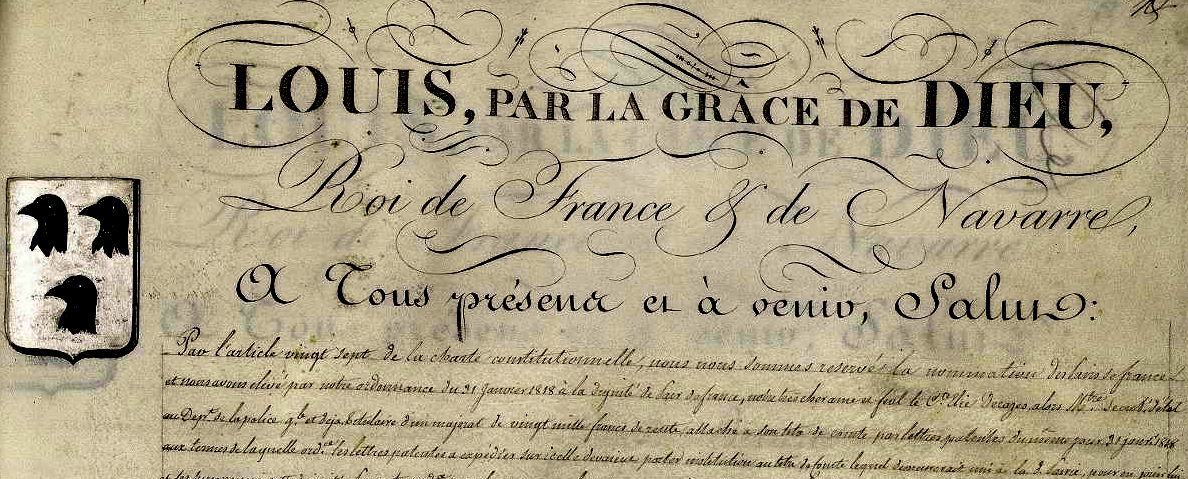
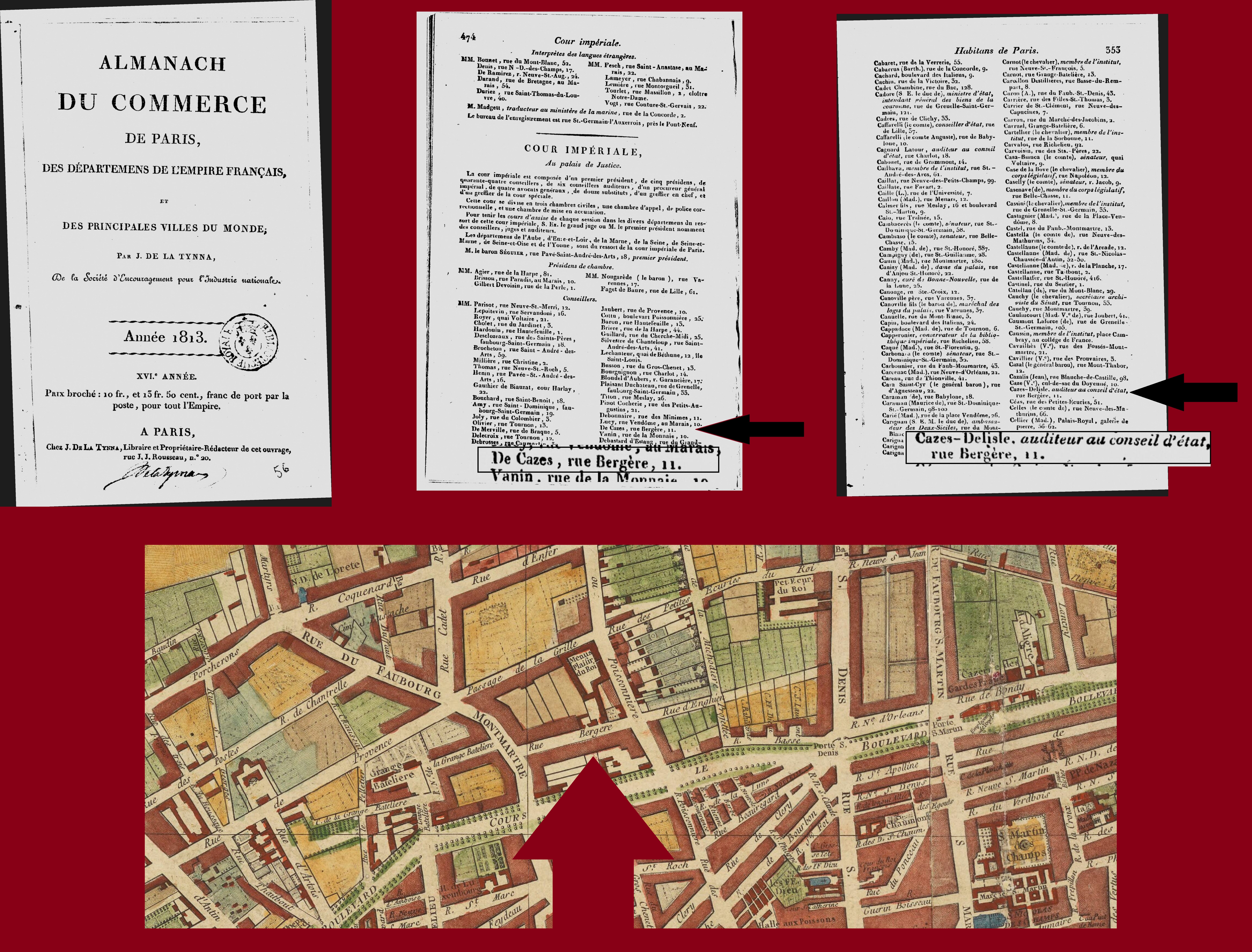
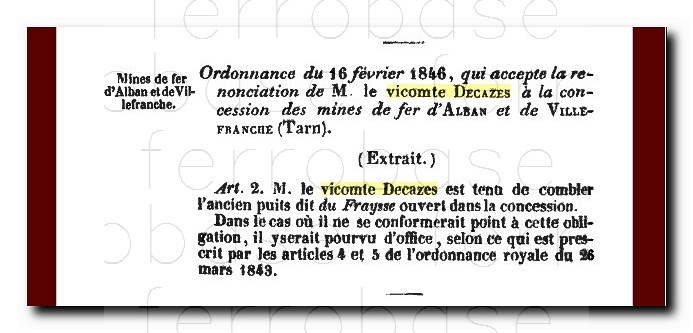
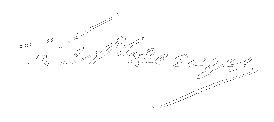

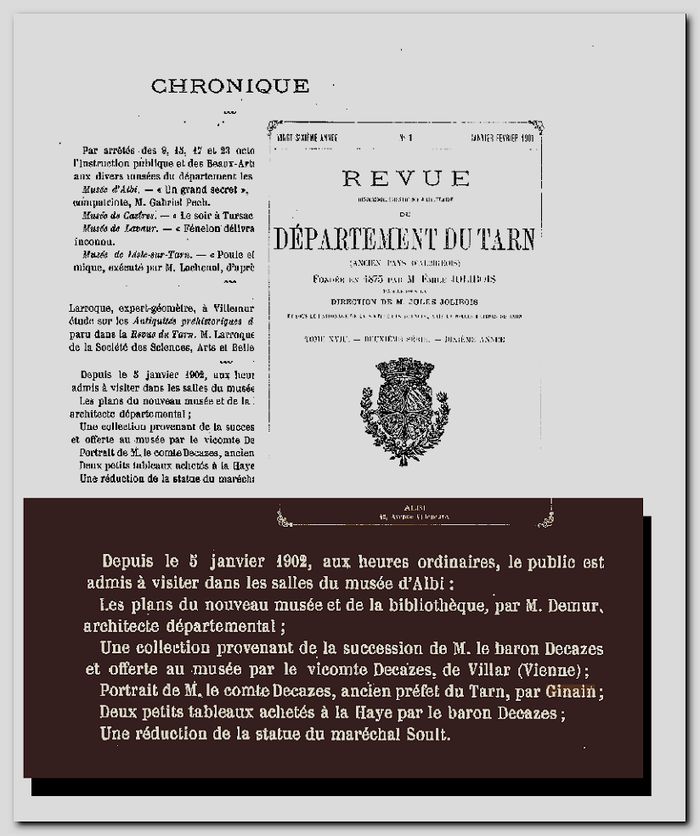 et plus précisément
et plus précisément 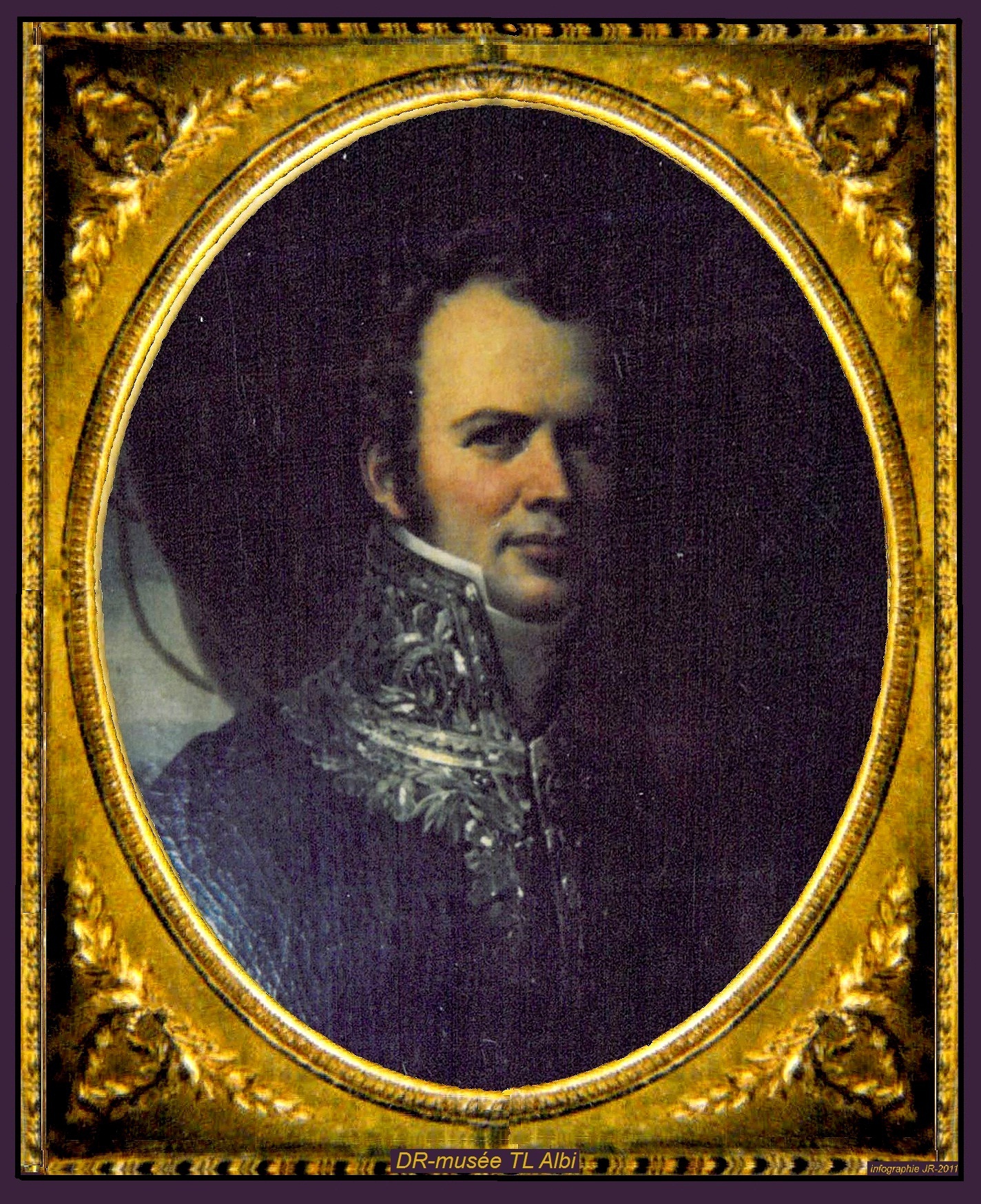

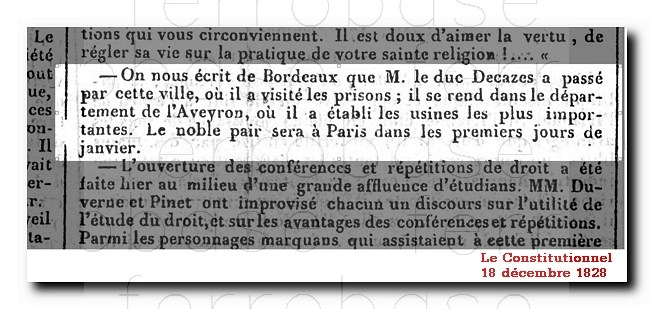
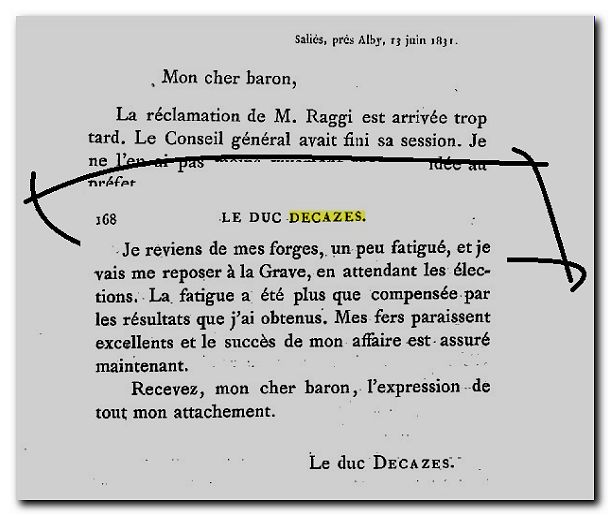
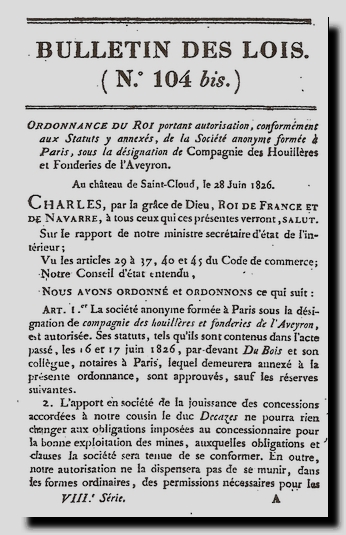
 On peut " tenter " quelques calculs pour
réaliser ce que peut représenter l'investissement des
actionnaires. Nous avons mis à contribution le site de
l'International Institute of Social History, (http://www.iisg.nl/hpw/data.php)
pour trouver par exemple le prix du kg
de pain en 1826 : 0,25 F/kg (source : mercuriales d'Angoulème ).
L'investissement du duc Decazes, pour le seul montant des actions,
480.000 francs 1826 équivaut à 1.920.000 kg de pain. Au prix du
kg actuel (source INSEE,) de 3,34 euros (moyenne 2009), la
conversion donne un chiffre de l'ordre de six millions d'euros
investis.
On peut " tenter " quelques calculs pour
réaliser ce que peut représenter l'investissement des
actionnaires. Nous avons mis à contribution le site de
l'International Institute of Social History, (http://www.iisg.nl/hpw/data.php)
pour trouver par exemple le prix du kg
de pain en 1826 : 0,25 F/kg (source : mercuriales d'Angoulème ).
L'investissement du duc Decazes, pour le seul montant des actions,
480.000 francs 1826 équivaut à 1.920.000 kg de pain. Au prix du
kg actuel (source INSEE,) de 3,34 euros (moyenne 2009), la
conversion donne un chiffre de l'ordre de six millions d'euros
investis. 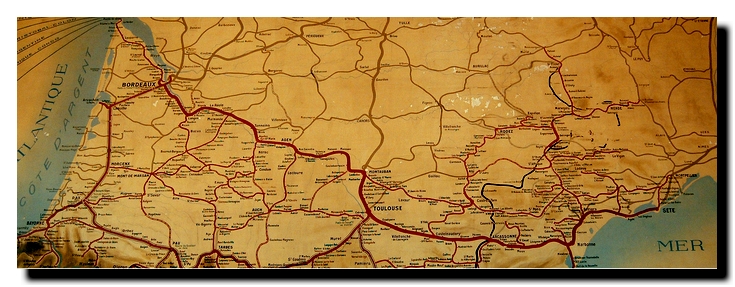
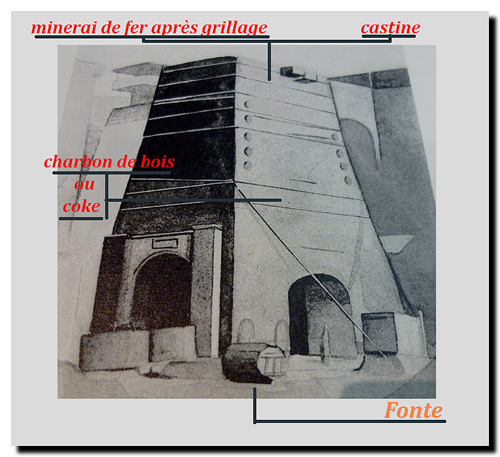 Le schéma (haut fourneau,
Decazeville, 1842, in Levêque) présente les principaux liens
qui unissent l'ensemble des
éléments. Pour résumer : le minerai de fer devient fonte dans les hauts
fourneaux, et la fonte deviendra fer ou acier par la suite, par
des traitements appropriés qui vont lui retirer du carbone.
Le schéma (haut fourneau,
Decazeville, 1842, in Levêque) présente les principaux liens
qui unissent l'ensemble des
éléments. Pour résumer : le minerai de fer devient fonte dans les hauts
fourneaux, et la fonte deviendra fer ou acier par la suite, par
des traitements appropriés qui vont lui retirer du carbone.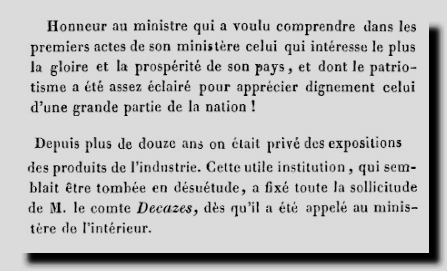 L'histoire
métallurgique du futur bassin va se construire après
l'exposition de 1819, tenue au Louvres, dans 41 salles. Voulue
par Louis XVIII, on peut penser que le ministre secrétaire d'état
au département de l'intérieur, le comte Decazes en est l'instigateur.
La précédente exposition avait eu lieu en 1806. Dans les instructions
du ministre on lit l'intérêt pour les activités économiques du pays,
mais sans accent particulier, ce n'est pas le lieu, pour des activités
minières et ou métallurgiques. La Description
des expositions des produits de l'industrie française, tome1,
Paris, 1824
(à découvrir sur le site du Cnam) présente l'ensemble de ces pièces
administratives préparatoires à l'exposition, ordonnances du roi et
lettres de Decazes au roi et aux préfets. L'ouvrage qui se veut
complet, est également l'occasion de présenter un traité fouillé de
métallurgie, celle du fer notamment. La fonte à la houille,au coak,
une nouveauté, anglaise, est largement développée,
mais nul mot, encore, sur l'Aveyron et ses richesses...
L'histoire
métallurgique du futur bassin va se construire après
l'exposition de 1819, tenue au Louvres, dans 41 salles. Voulue
par Louis XVIII, on peut penser que le ministre secrétaire d'état
au département de l'intérieur, le comte Decazes en est l'instigateur.
La précédente exposition avait eu lieu en 1806. Dans les instructions
du ministre on lit l'intérêt pour les activités économiques du pays,
mais sans accent particulier, ce n'est pas le lieu, pour des activités
minières et ou métallurgiques. La Description
des expositions des produits de l'industrie française, tome1,
Paris, 1824
(à découvrir sur le site du Cnam) présente l'ensemble de ces pièces
administratives préparatoires à l'exposition, ordonnances du roi et
lettres de Decazes au roi et aux préfets. L'ouvrage qui se veut
complet, est également l'occasion de présenter un traité fouillé de
métallurgie, celle du fer notamment. La fonte à la houille,au coak,
une nouveauté, anglaise, est largement développée,
mais nul mot, encore, sur l'Aveyron et ses richesses...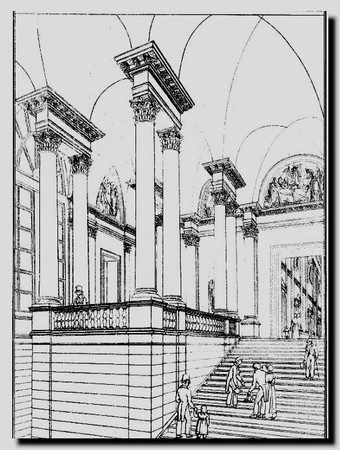
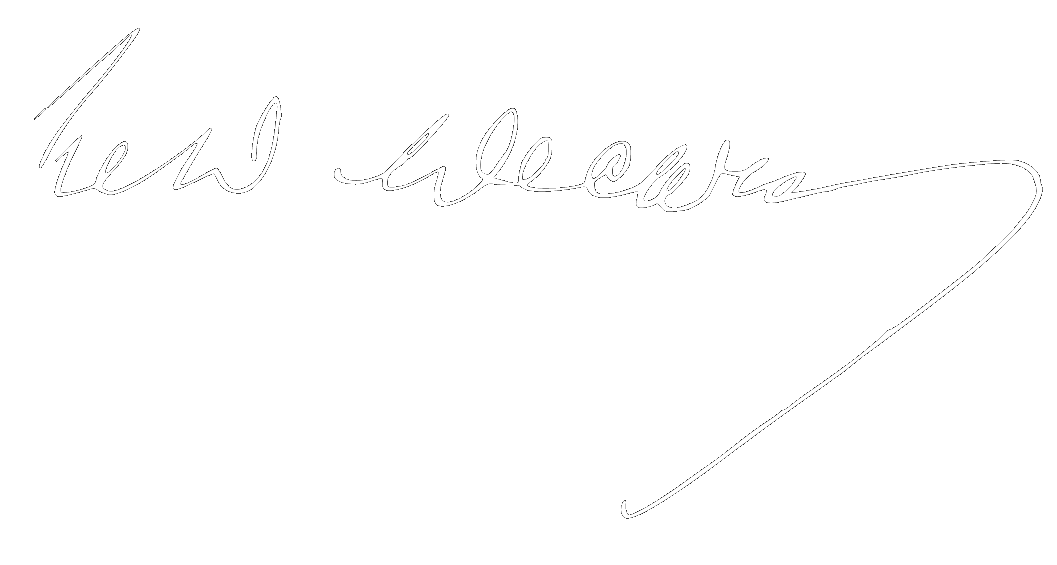
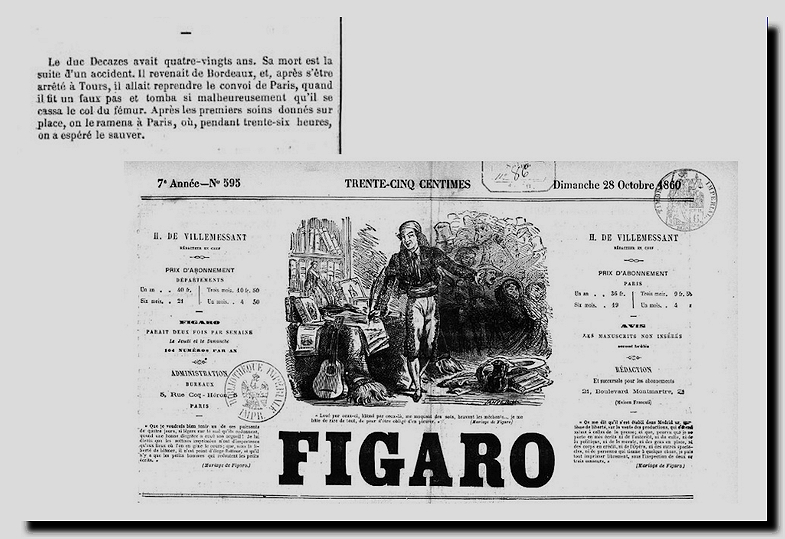
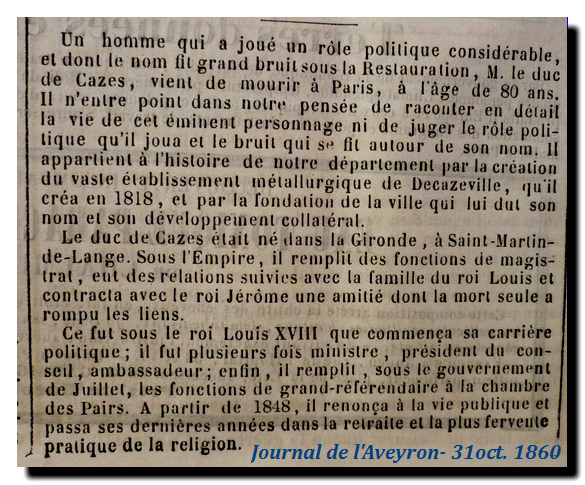
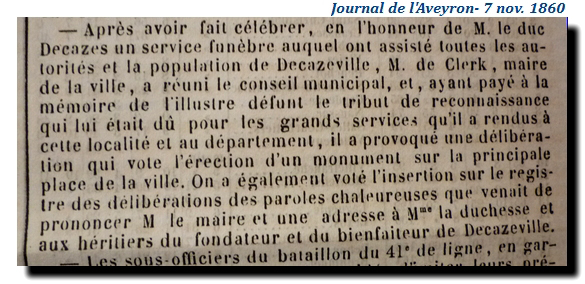
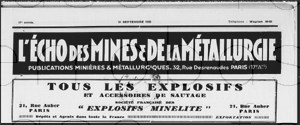
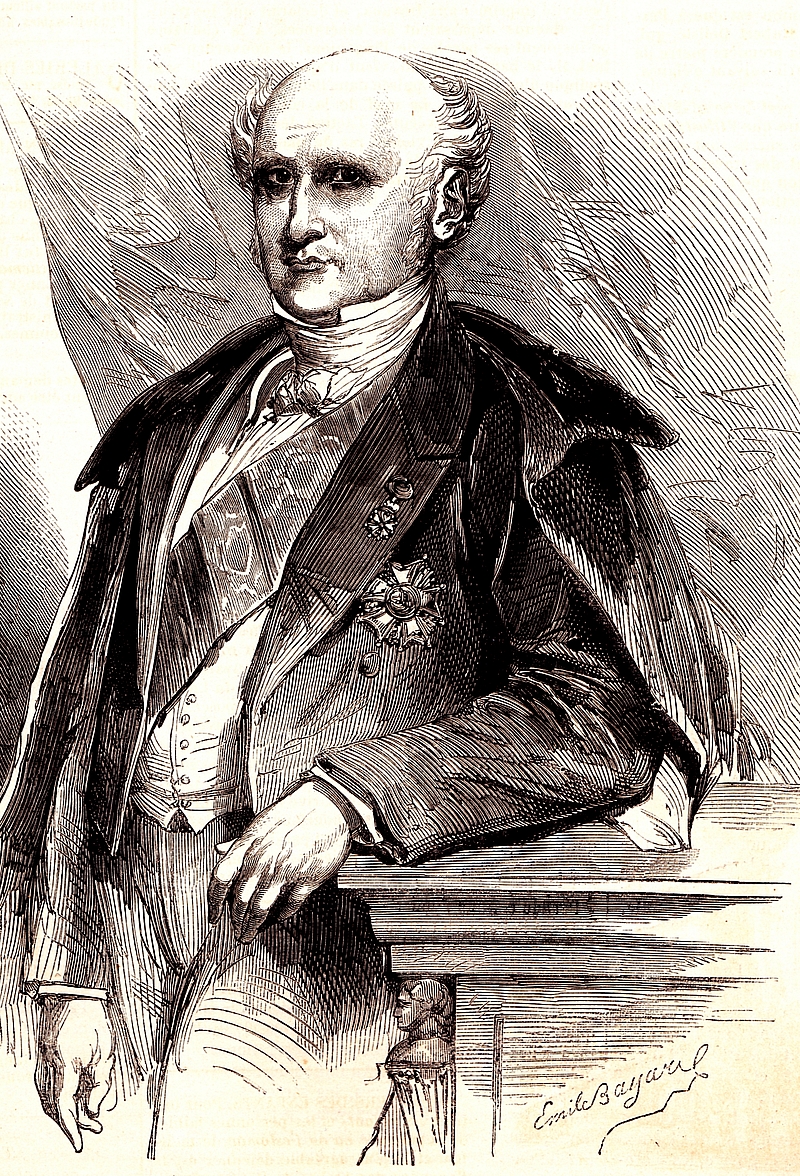
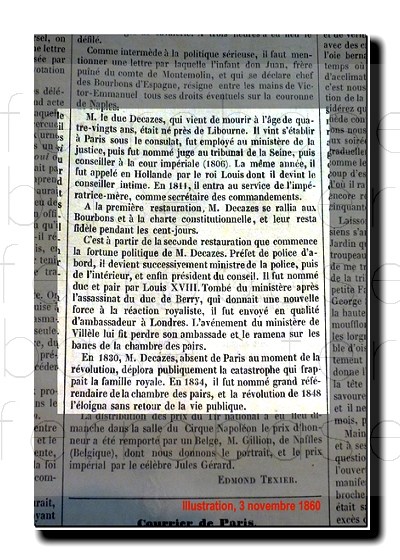
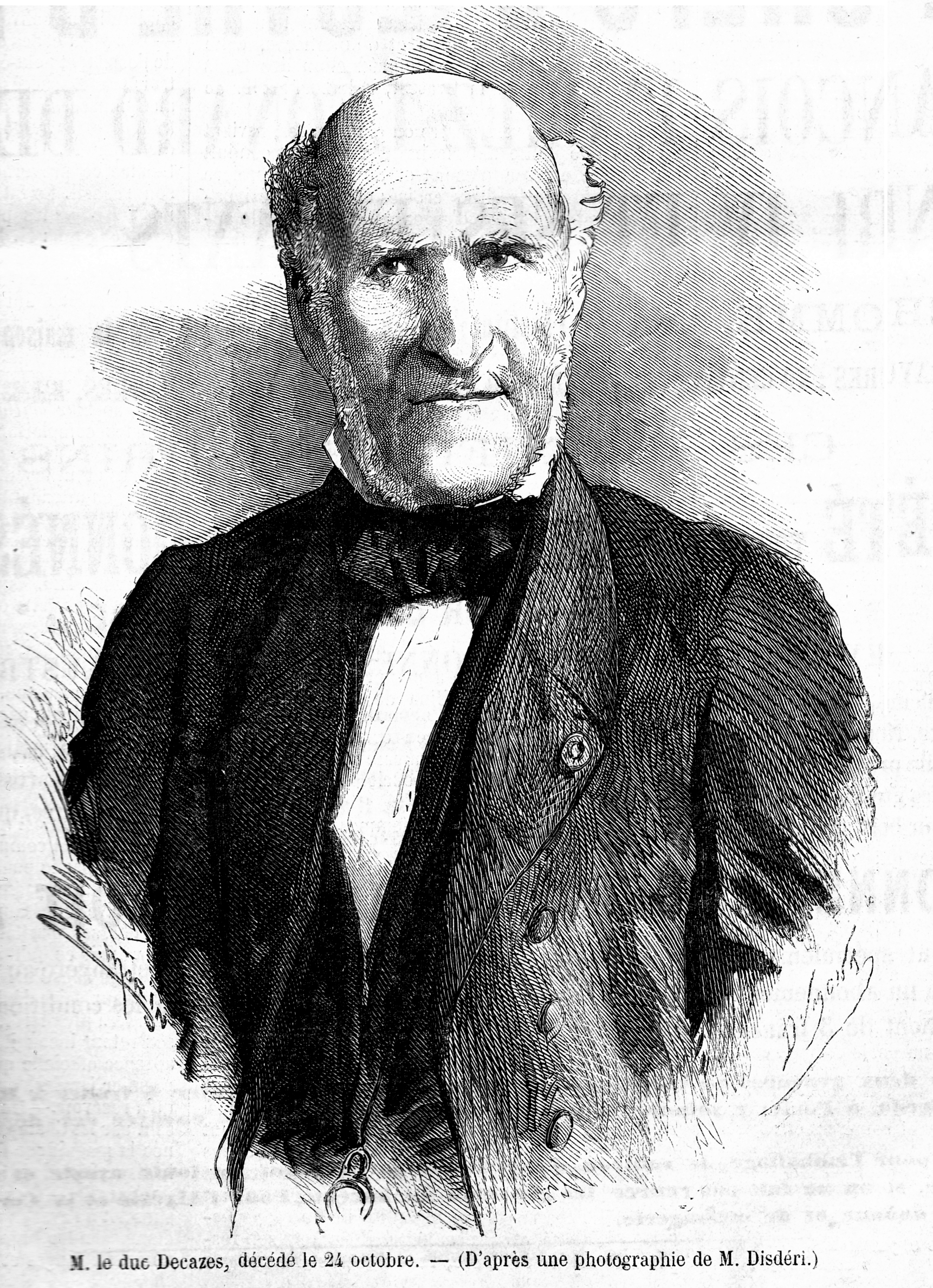
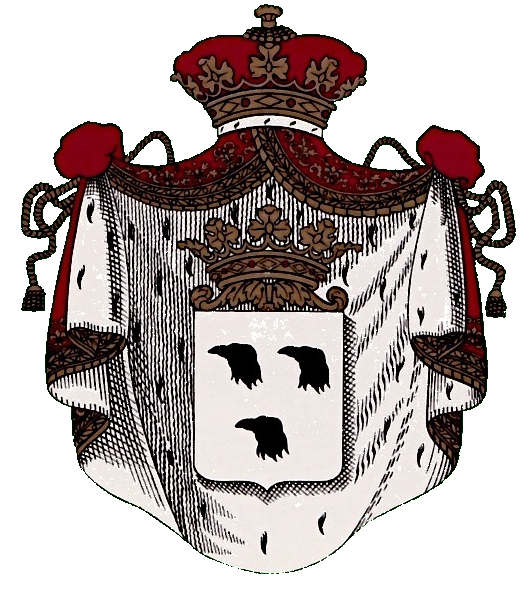
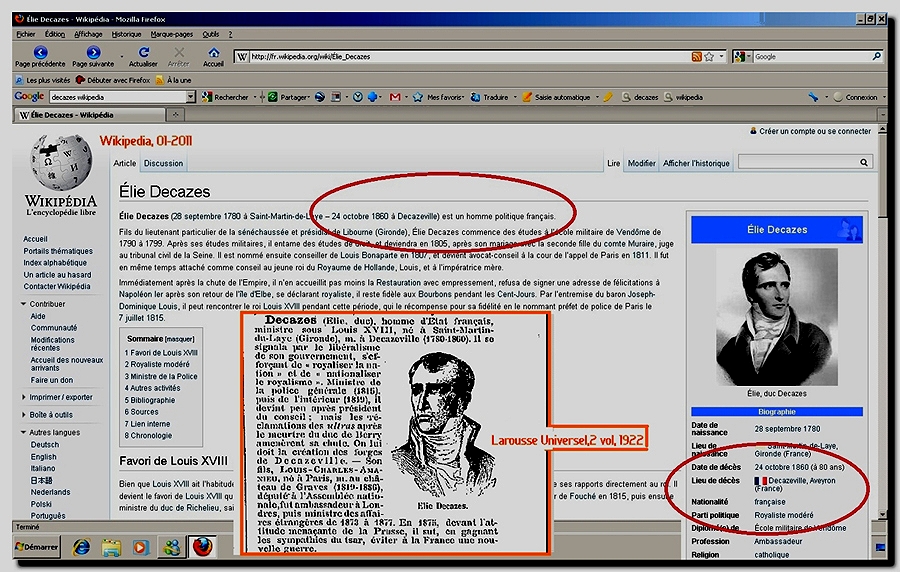

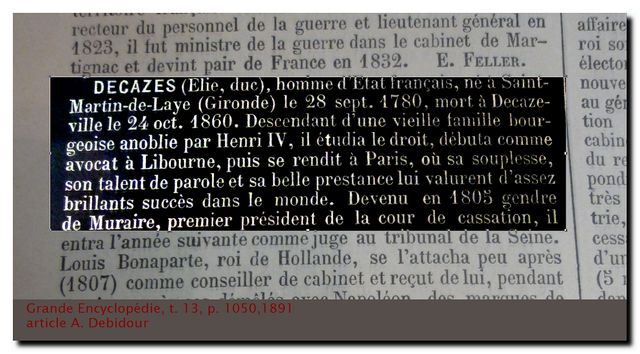
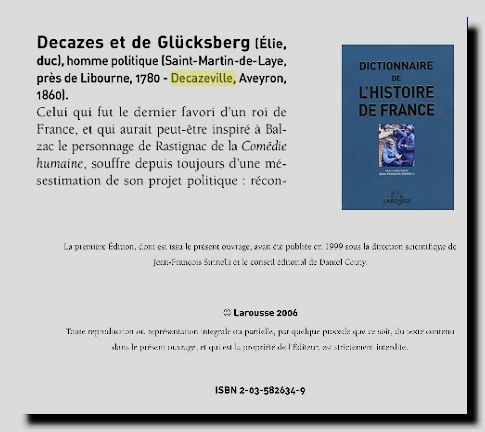
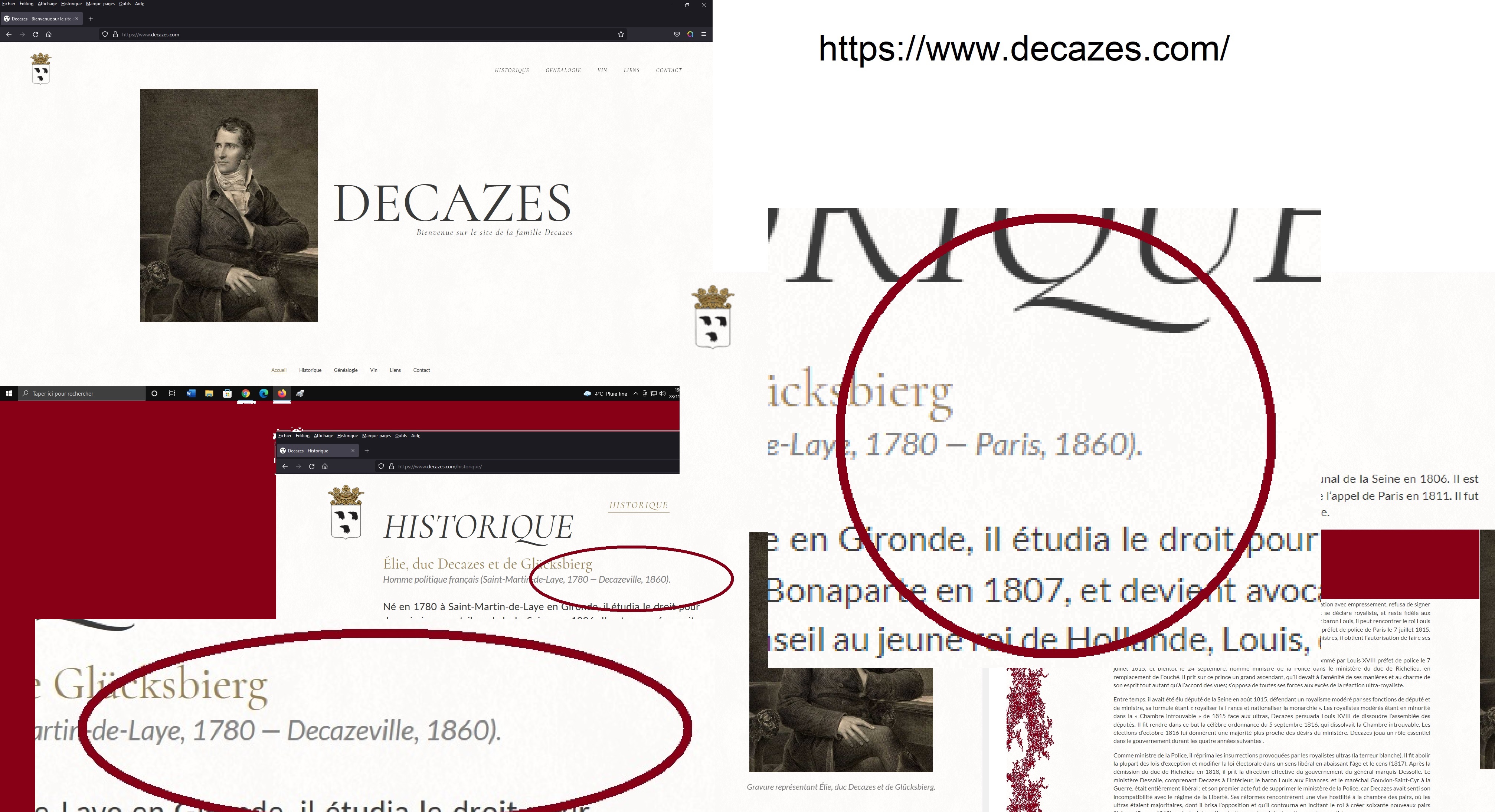
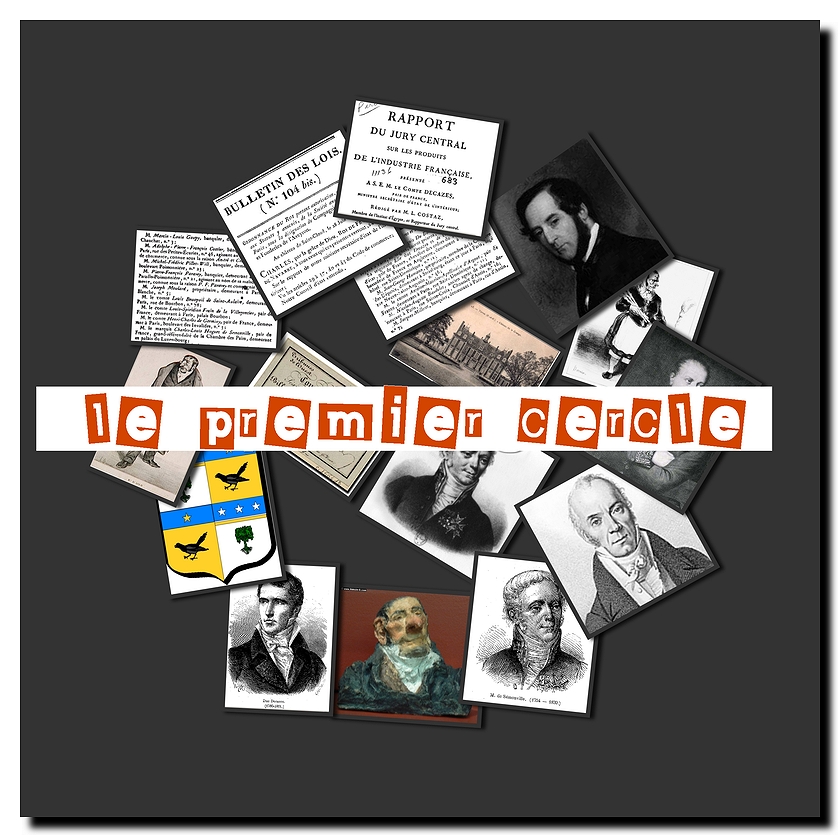

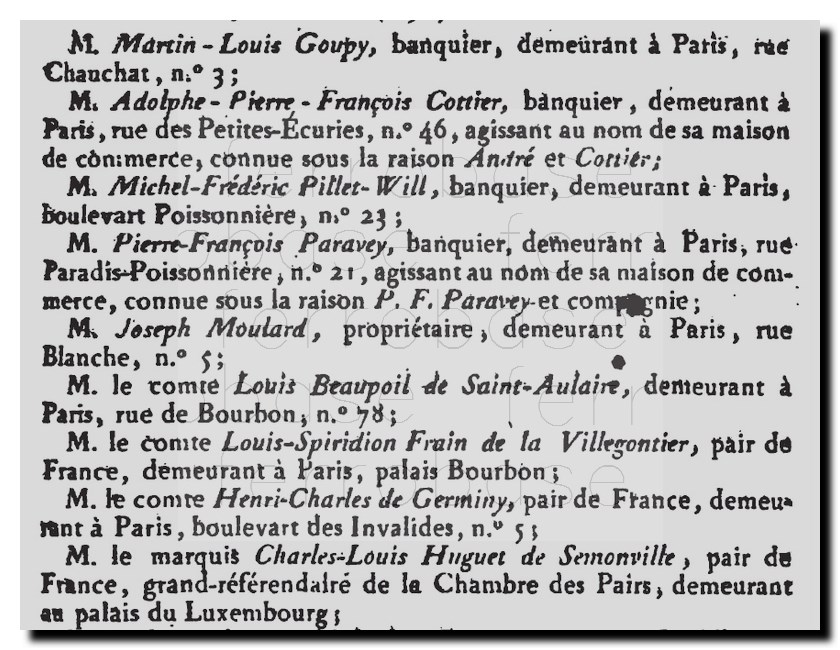
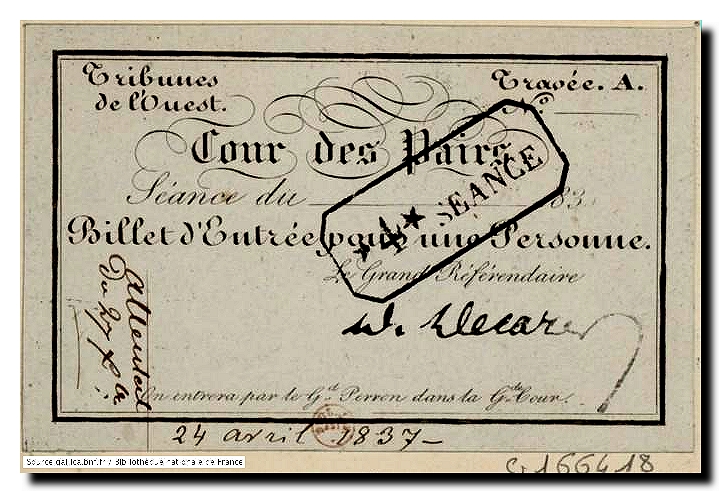 Parmi ces
quatorze fondateurs, la profession de banquier est parfaitement
explicite sur
les raisons d’être présent, en ce début d’industrialisation du dix
neuvième
siècle Mais il n’y a que deux banques présentes en tant que telles. Les
positions de pair et ou de préfet expliquent également les liens avec
le duc,
soit lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, soit en sa qualité de
pair, Grand
Référendaire. Nous avons donc treize bonnes raisons de rencontrer ces
fondateurs. Treize, et non quatorze ! En effet, le cas de Monsieur
Joseph
Moulard est une énigme, pour nous. Que pouvait donc faire ce
"propriétaire" et
quels étaient ses liens avec le duc ? Qui était-il ? Nous avons trouvé
la trace
d’un Joseph Moulard, commissaire général de la Monnaie en 1831, et
celle d’un
homonyme ou le même, intendant du roi de Wesphalie en 1813…
Parmi ces
quatorze fondateurs, la profession de banquier est parfaitement
explicite sur
les raisons d’être présent, en ce début d’industrialisation du dix
neuvième
siècle Mais il n’y a que deux banques présentes en tant que telles. Les
positions de pair et ou de préfet expliquent également les liens avec
le duc,
soit lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, soit en sa qualité de
pair, Grand
Référendaire. Nous avons donc treize bonnes raisons de rencontrer ces
fondateurs. Treize, et non quatorze ! En effet, le cas de Monsieur
Joseph
Moulard est une énigme, pour nous. Que pouvait donc faire ce
"propriétaire" et
quels étaient ses liens avec le duc ? Qui était-il ? Nous avons trouvé
la trace
d’un Joseph Moulard, commissaire général de la Monnaie en 1831, et
celle d’un
homonyme ou le même, intendant du roi de Wesphalie en 1813…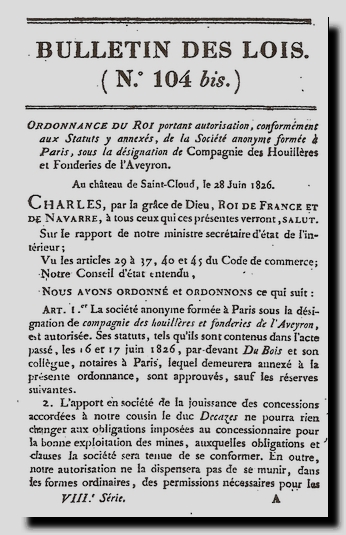
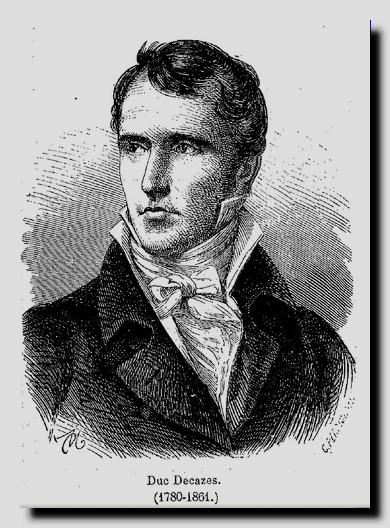


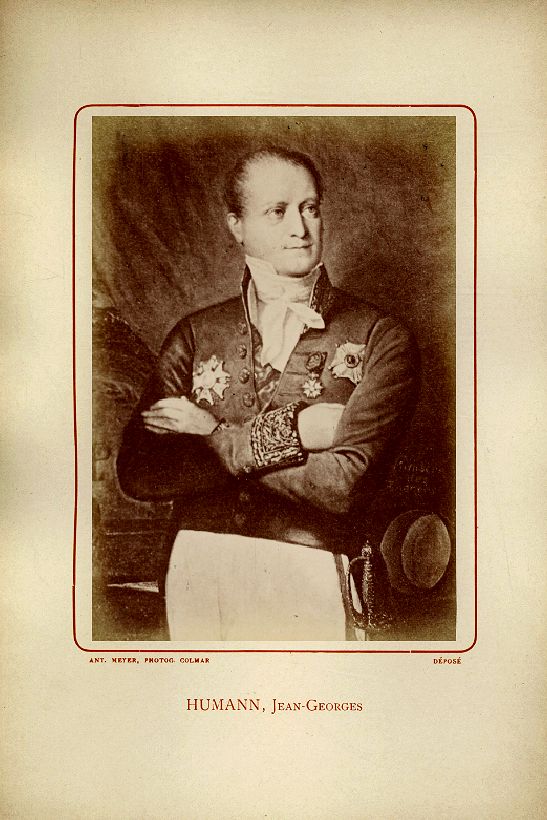
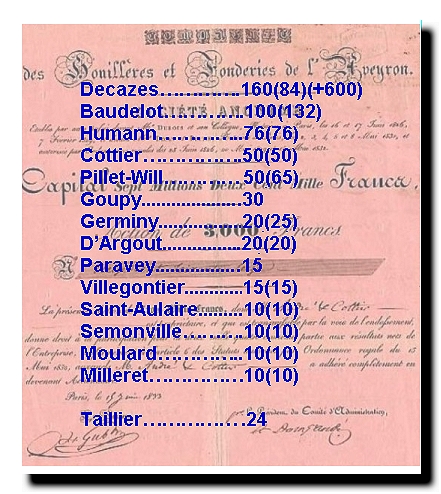
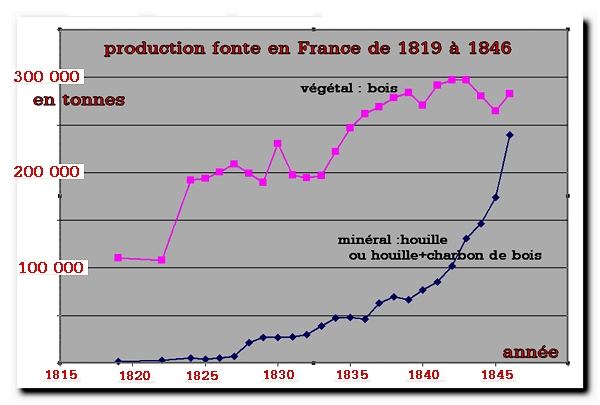
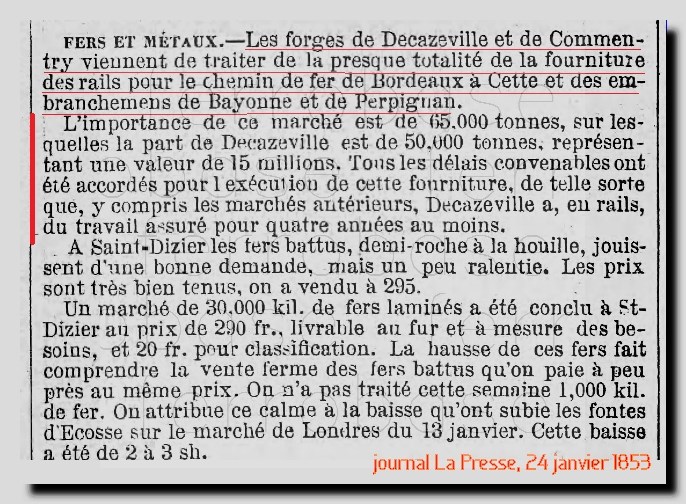
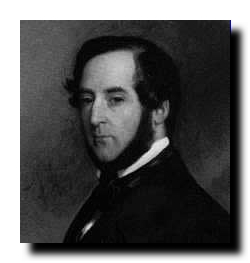

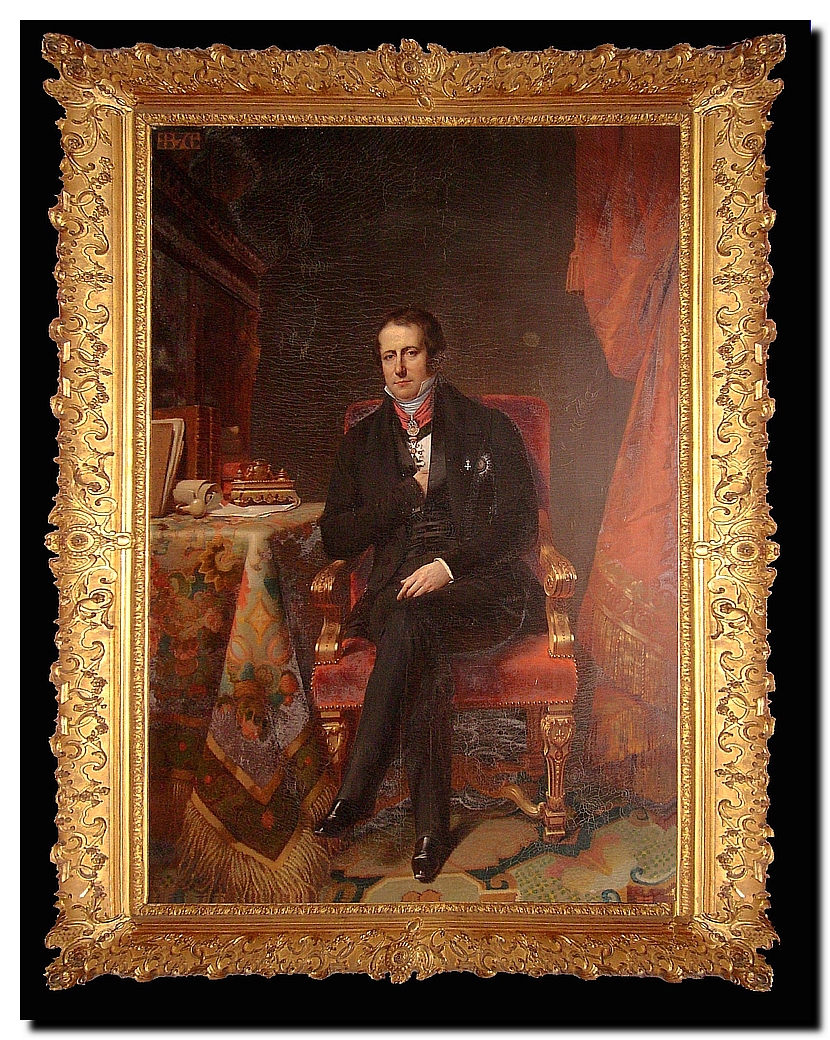
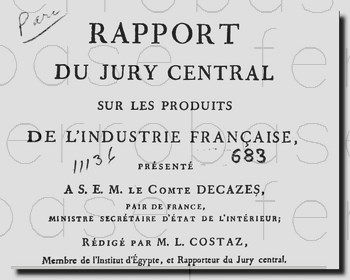 Les aspects
qui nous concernent débutent en 1817 lorsqu’il suit l’initiative de
Beaunier,
premier directeur de l’école des mines de Saint-Etienne, en fondant
l’usine de
la Bérardière à Saint-Etienne. Spécialisée dans le travail des aciers,
elle va
devenir rapidement une référence.
Les aspects
qui nous concernent débutent en 1817 lorsqu’il suit l’initiative de
Beaunier,
premier directeur de l’école des mines de Saint-Etienne, en fondant
l’usine de
la Bérardière à Saint-Etienne. Spécialisée dans le travail des aciers,
elle va
devenir rapidement une référence. 
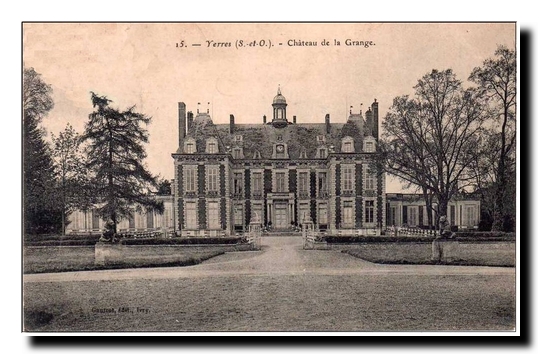
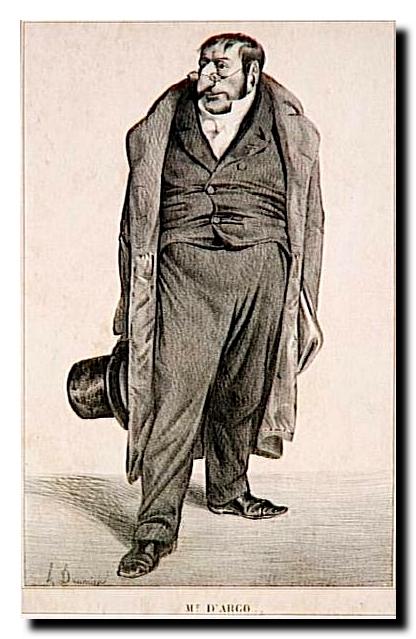

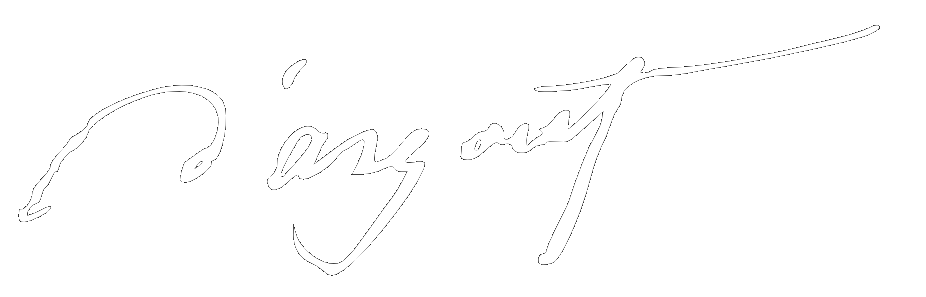

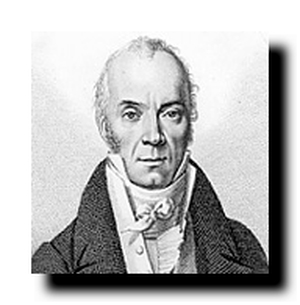
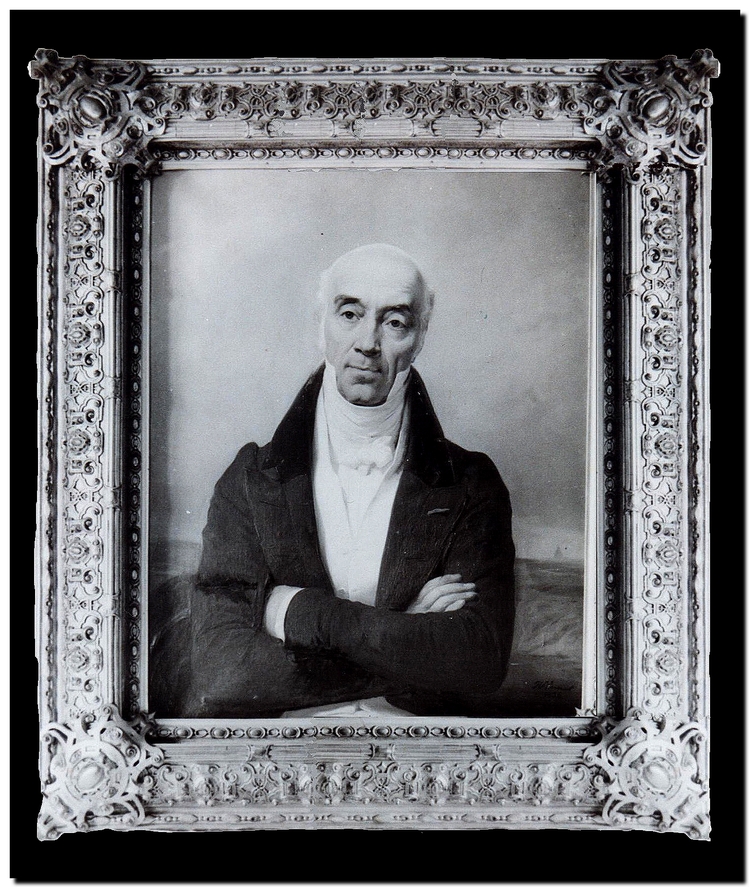
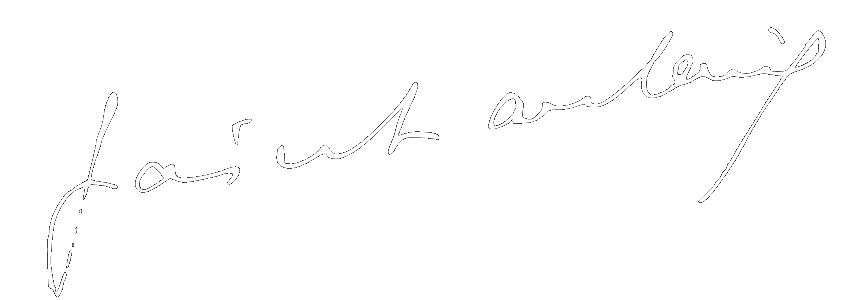

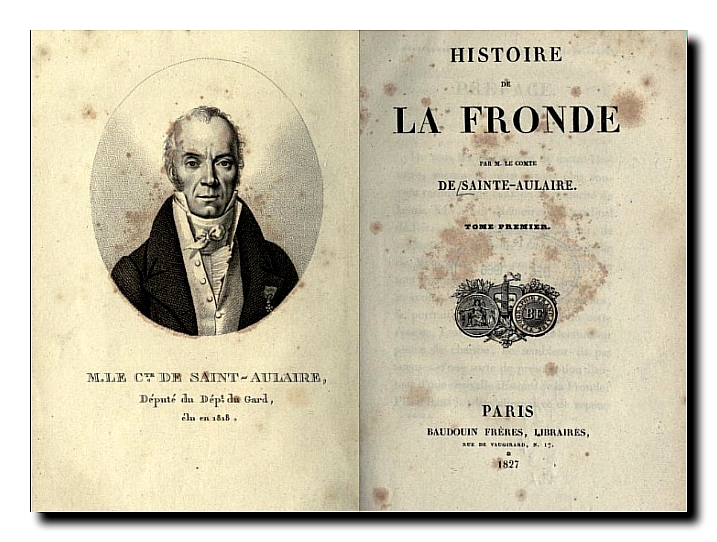
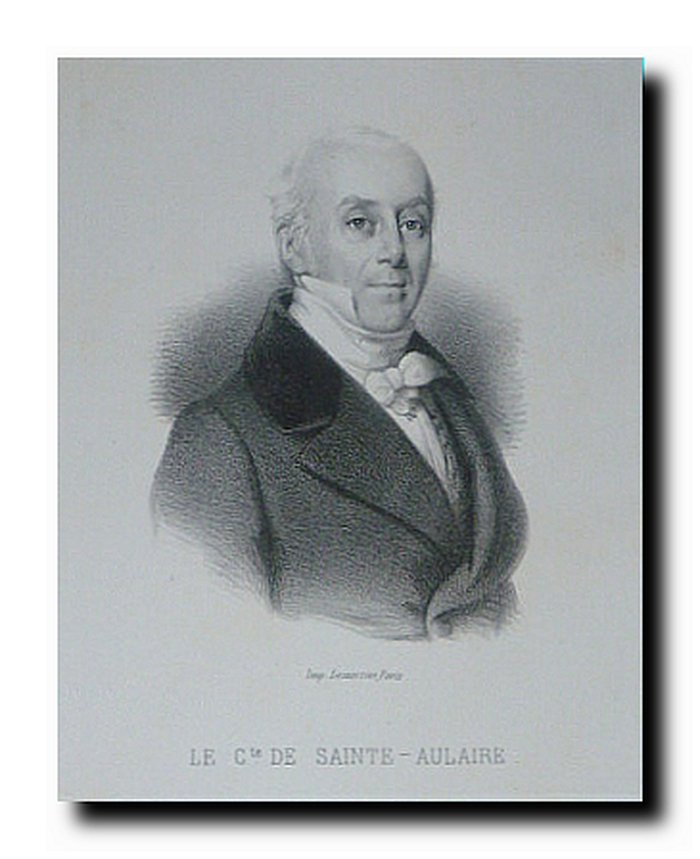

 L’arrivée
officielle de Elie Decazes
à Paris et dans les instances politiques est un mystère,
au moins sur un plan strictement administratif. Dès la
fin des Cent Jours, il retrouve Paris
après son exil à Libourne. Les
historiens, biographes et autres témoins des évènements de ce début
juillet
1815 soulignent unanimement les conditions,
disons pour le moins confuses, qui ont présidé à la formation du
premier
gouvernement de cette deuxième restauration. Monsieur
de Talleyrand, qui va être l’homme fort de cette équipe ne
connaît pas le vendredi 7 juillet Elie
Decazes ; et c’est pratiquement entre deux portes, dans la fièvre
des
consultations et de la distribution des postes entre monarchistes
constitutionnels que Decazes saisit l’opportunité de la vacance du
poste de
préfet de police de Paris. Il fallait être le bon jour, à
la bonne heure et au bon endroit,
c'est-à-dire dans les salons de M. de Talleyrand, et Elie Decazes avait
compris
que c’était là qu’allait se jouer l’avenir du pays. Le comité
Talleyrand, qui
faisait office de gouvernement sans avoir de nomination officielle
était le bon
rouage. Et dans ce comité, Decazes avait quelques connaissances et
appuis. Ses fonctions de président de la
cour
d’Assises l’avaient amené sur le devant de la scène. Au tout début de
1815,
lors de la première restauration, Elie Decazes avait même été pressenti
pour
être préfet de police. Il ne le fut point.
Et le comité officieux qui va se retrouver le lendemain
gouvernement
officiel se souvient sans doute de
cette proposition non aboutie. C’était pour Elie Decazes un premier
atout. Mais
selon les apparences et les récits des témoins, c’est vraiment le
hasard qui
place ce 7 juillet le poste de préfet
sous les yeux d’Elie. Le poste n’était pas d’ailleurs le seul problème
à
résoudre pour les futurs ministres. La
dissolution de la Chambre des représentans, comme on
l’écrivait, était
envisagée et crainte, car des manifestations hostiles pouvaient se
produire.
Elle ne présentait pas, aux yeux du futur préfet, de difficultés. Il
suffirait
d’une ordonnance de dissolution ; son ancienne qualité de
capitaine d’une
compagnie de la garde ferait le reste, Elie étant sûr de ses hommes qui
gardaient de lui une très bonne impression après le retour napoléonien
du 20
mars et son exil forcé à Libourne. C’est ce qu’il dit et soutint dans
les
salons.
L’arrivée
officielle de Elie Decazes
à Paris et dans les instances politiques est un mystère,
au moins sur un plan strictement administratif. Dès la
fin des Cent Jours, il retrouve Paris
après son exil à Libourne. Les
historiens, biographes et autres témoins des évènements de ce début
juillet
1815 soulignent unanimement les conditions,
disons pour le moins confuses, qui ont présidé à la formation du
premier
gouvernement de cette deuxième restauration. Monsieur
de Talleyrand, qui va être l’homme fort de cette équipe ne
connaît pas le vendredi 7 juillet Elie
Decazes ; et c’est pratiquement entre deux portes, dans la fièvre
des
consultations et de la distribution des postes entre monarchistes
constitutionnels que Decazes saisit l’opportunité de la vacance du
poste de
préfet de police de Paris. Il fallait être le bon jour, à
la bonne heure et au bon endroit,
c'est-à-dire dans les salons de M. de Talleyrand, et Elie Decazes avait
compris
que c’était là qu’allait se jouer l’avenir du pays. Le comité
Talleyrand, qui
faisait office de gouvernement sans avoir de nomination officielle
était le bon
rouage. Et dans ce comité, Decazes avait quelques connaissances et
appuis. Ses fonctions de président de la
cour
d’Assises l’avaient amené sur le devant de la scène. Au tout début de
1815,
lors de la première restauration, Elie Decazes avait même été pressenti
pour
être préfet de police. Il ne le fut point.
Et le comité officieux qui va se retrouver le lendemain
gouvernement
officiel se souvient sans doute de
cette proposition non aboutie. C’était pour Elie Decazes un premier
atout. Mais
selon les apparences et les récits des témoins, c’est vraiment le
hasard qui
place ce 7 juillet le poste de préfet
sous les yeux d’Elie. Le poste n’était pas d’ailleurs le seul problème
à
résoudre pour les futurs ministres. La
dissolution de la Chambre des représentans, comme on
l’écrivait, était
envisagée et crainte, car des manifestations hostiles pouvaient se
produire.
Elle ne présentait pas, aux yeux du futur préfet, de difficultés. Il
suffirait
d’une ordonnance de dissolution ; son ancienne qualité de
capitaine d’une
compagnie de la garde ferait le reste, Elie étant sûr de ses hommes qui
gardaient de lui une très bonne impression après le retour napoléonien
du 20
mars et son exil forcé à Libourne. C’est ce qu’il dit et soutint dans
les
salons. 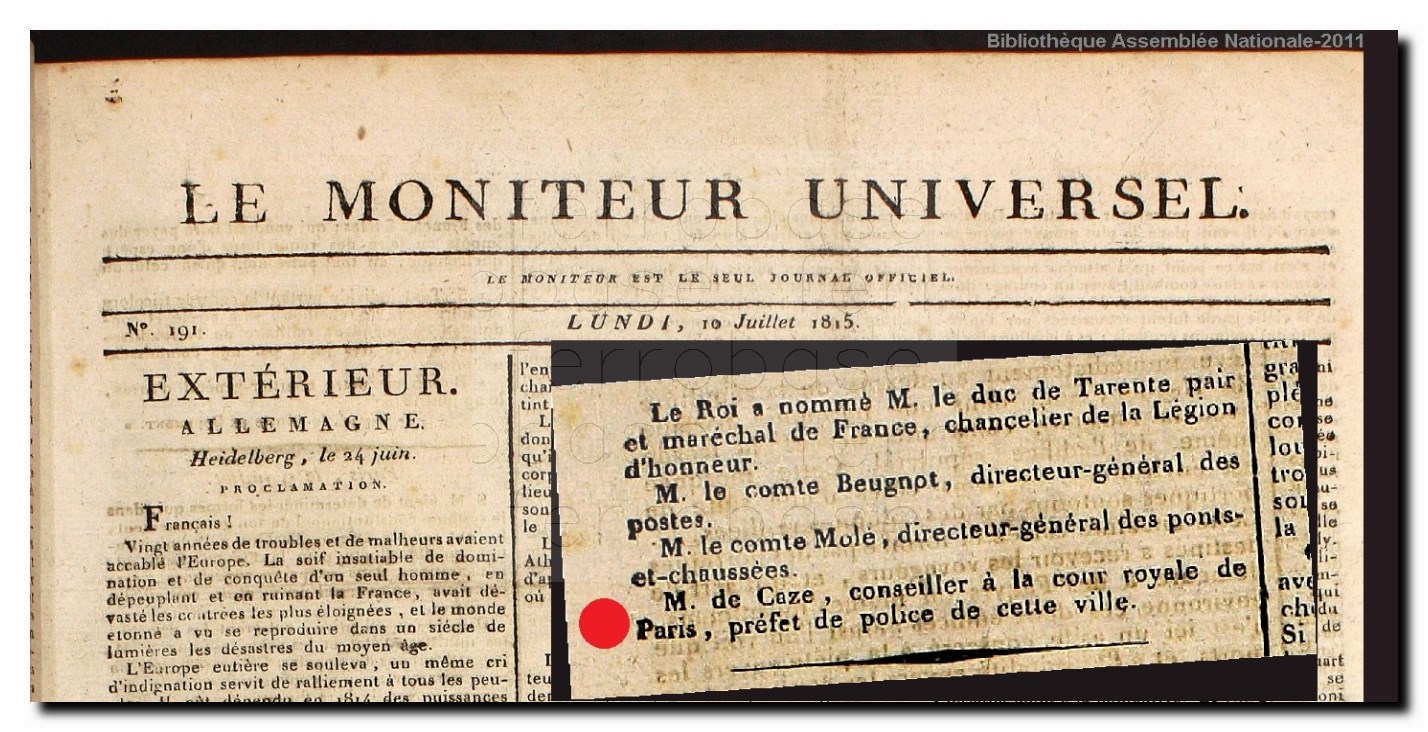
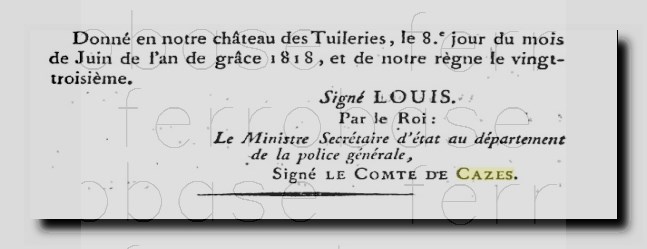
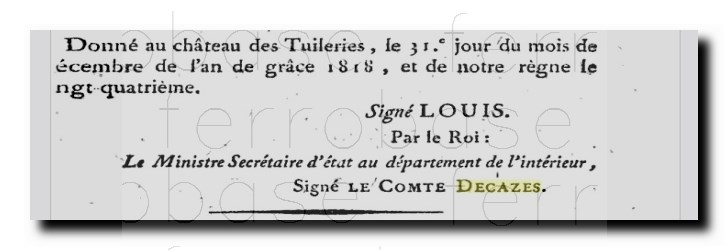
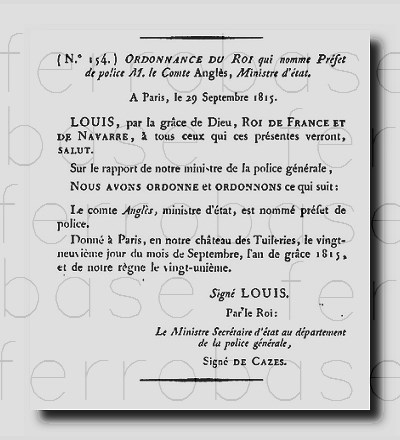 Le 29
septembre 1815, le BDL publie
l’ordonnance 154 : elle nomme un ministre d’état, le comte Anglès
préfet
de police. L’ordonnance est signée du
Ministre secrétaire d’état au département de la police générale,
DE
CAZES (en deux mots, sic ! ).
Cette ordonnance nous apprend donc à la fois le changement de préfet de
police
et la disparition du prince Fouché, dont ce sera la mort politique, et la nomination d’Elie Decazes à son poste
de ministre, qui nomme donc son successeur à la préfecture. Beaucoup d’informations dans une seule
nomination ! Il aura
suffit d’une dizaine de semaines pour voir
Elie Decazes passer d’une situation
parfaitement discrète à l’un des postes les plus exposés. L’intermède
préfet
est donc de courte durée. Elie Decazes aura su l’utiliser pour
conforter sa
position. Il a surtout
saisi l’incroyable chance d’approcher par
ses fonctions Louis XVIII. Faire quotidiennement son rapport au roi, un
peu
fatigué des hommes de sa cour, et pouvoir lui faire
entendre autre chose que des propos convenus n’était pas donné à
tout le monde.
Le 29
septembre 1815, le BDL publie
l’ordonnance 154 : elle nomme un ministre d’état, le comte Anglès
préfet
de police. L’ordonnance est signée du
Ministre secrétaire d’état au département de la police générale,
DE
CAZES (en deux mots, sic ! ).
Cette ordonnance nous apprend donc à la fois le changement de préfet de
police
et la disparition du prince Fouché, dont ce sera la mort politique, et la nomination d’Elie Decazes à son poste
de ministre, qui nomme donc son successeur à la préfecture. Beaucoup d’informations dans une seule
nomination ! Il aura
suffit d’une dizaine de semaines pour voir
Elie Decazes passer d’une situation
parfaitement discrète à l’un des postes les plus exposés. L’intermède
préfet
est donc de courte durée. Elie Decazes aura su l’utiliser pour
conforter sa
position. Il a surtout
saisi l’incroyable chance d’approcher par
ses fonctions Louis XVIII. Faire quotidiennement son rapport au roi, un
peu
fatigué des hommes de sa cour, et pouvoir lui faire
entendre autre chose que des propos convenus n’était pas donné à
tout le monde.