 A la une .....
A la une .....
 A la une .....
A la une .....
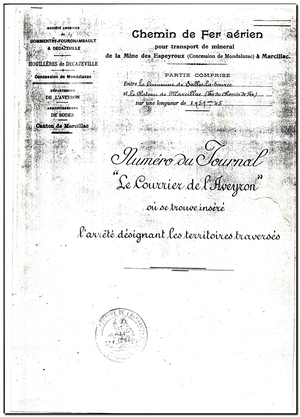
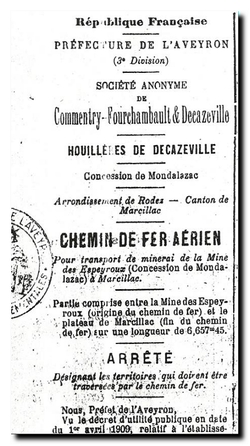
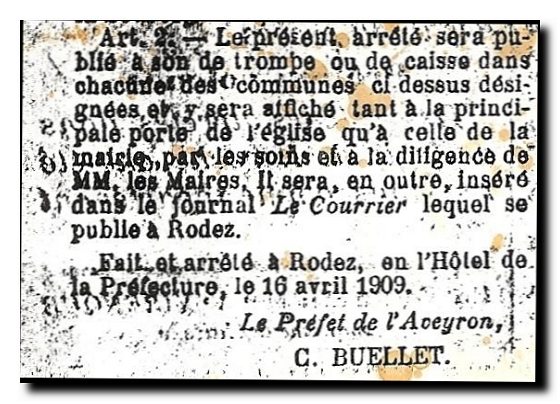
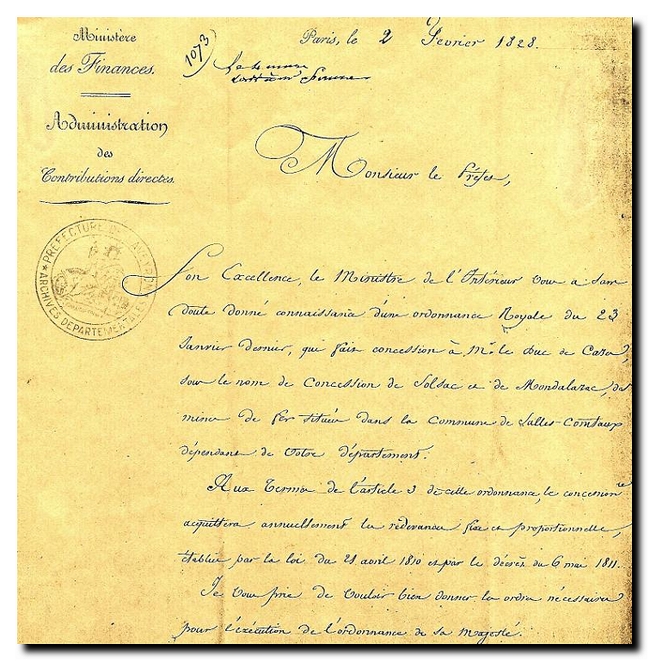
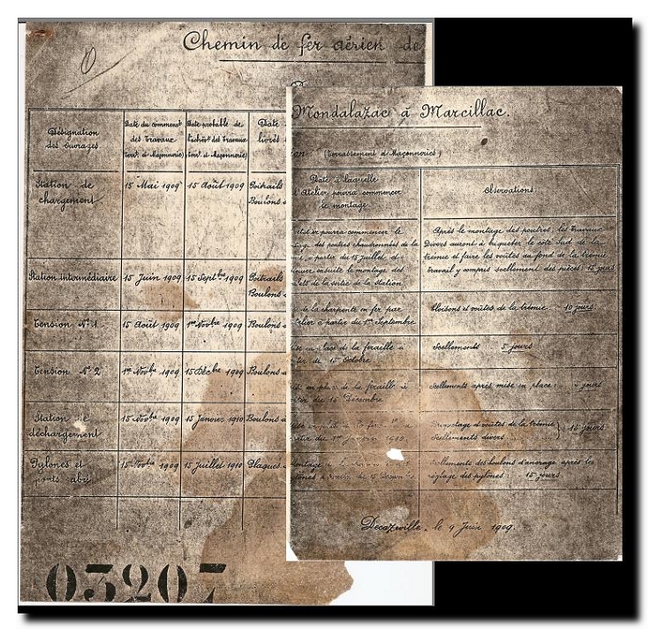
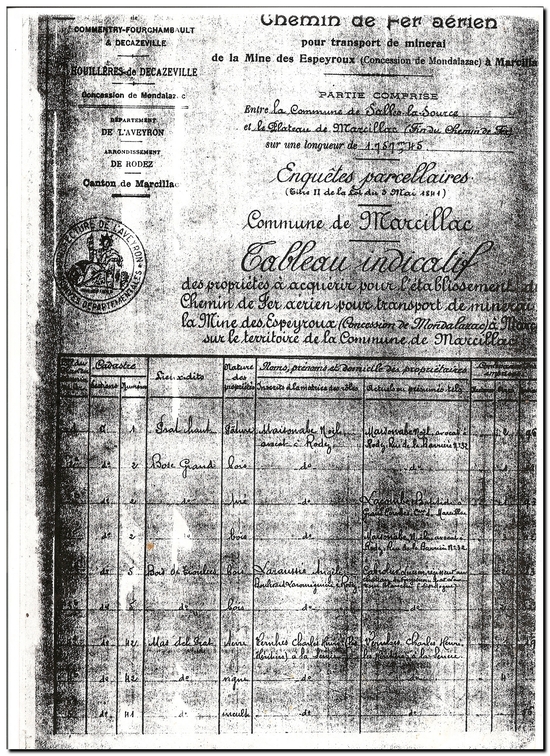
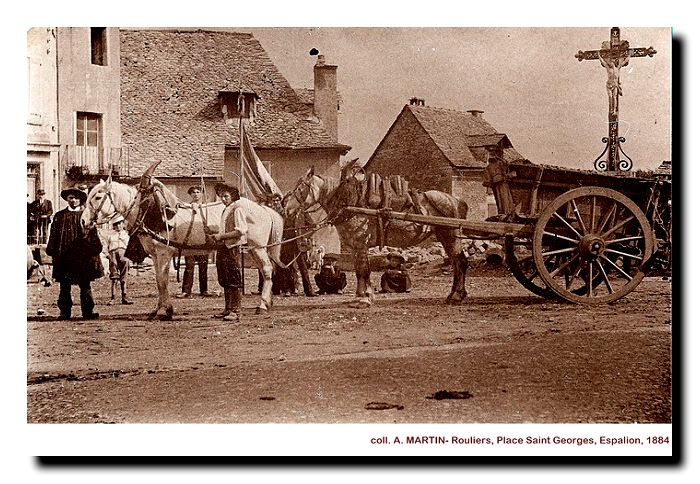
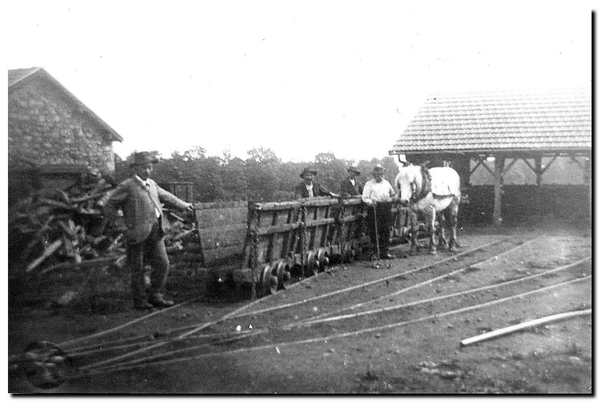

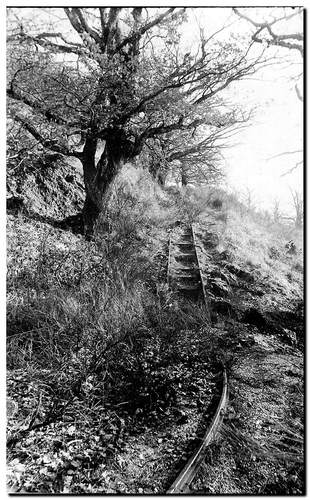

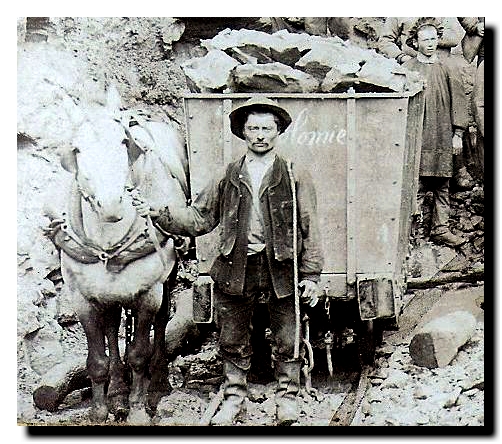

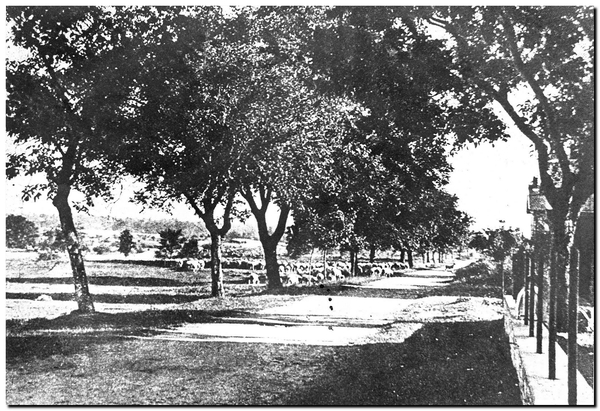

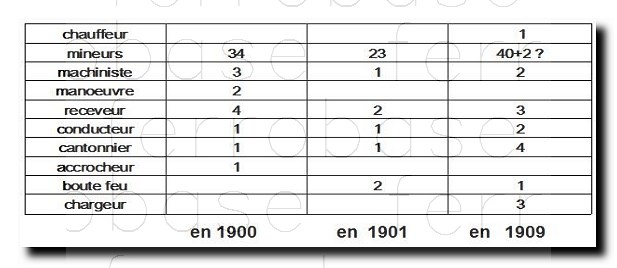
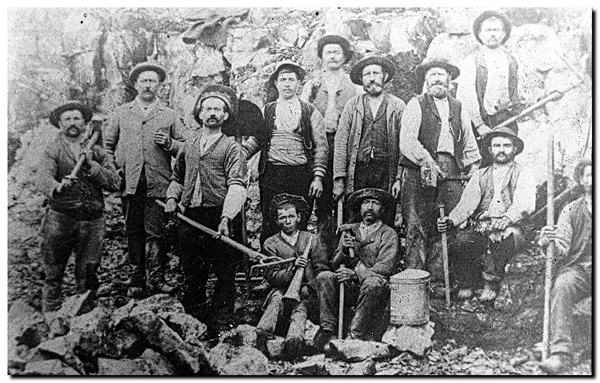
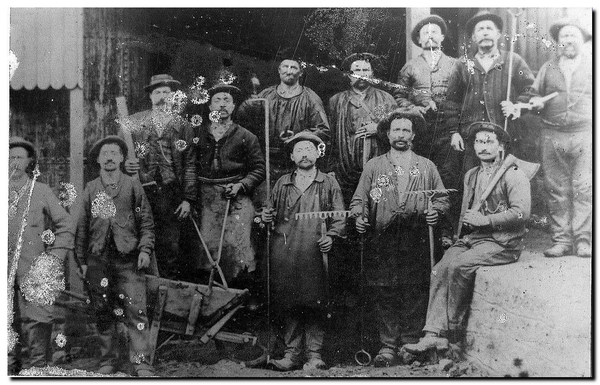
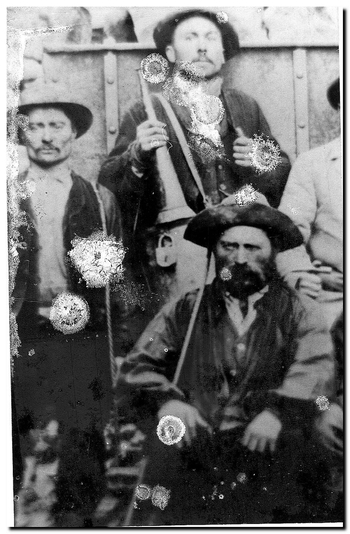



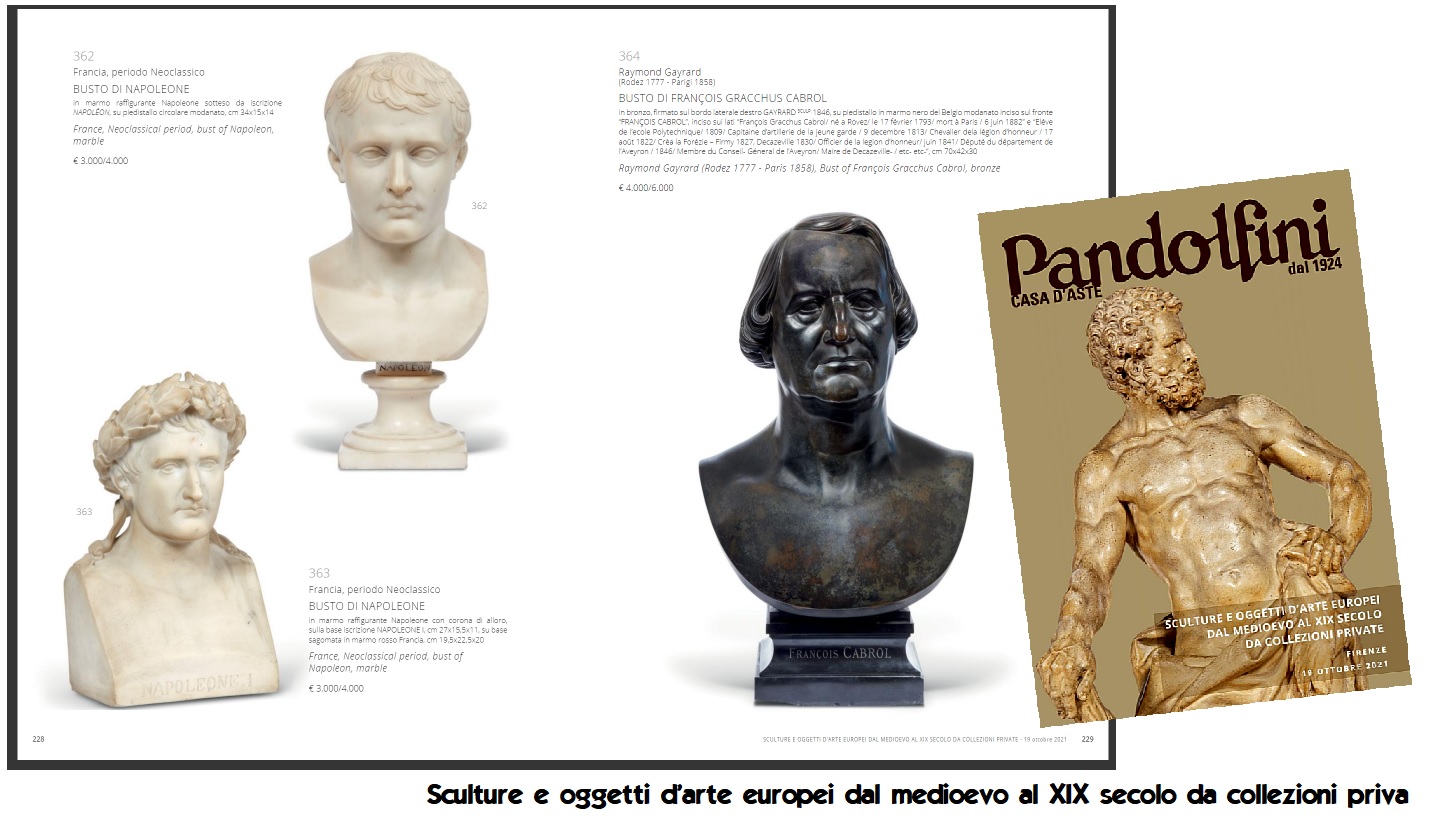
Raymond Gayrard (Rodez 1777 - Paris 1858) Buste de
FRANÇOIS
GRACCHUS CABROL en bronze, signé sur la tranche latérale droite GAYRARD
SCULP.
1846, sur socle marbre nero belgio noir mouluré gravé au recto «
FRANÇOIS CABROL », gravé
sur les côtés « François Gracchus Cabrol / né à Rodez / 17 février 1793
/ mort à
Paris / 6 juin 1882 » et « Elève de l’école Polytechnique / 1809 /
Capitaine
d'artillerie de la Jeune Garde / 9 décembre 1813 / Chevalier de la
Légion
d'honneur / 17 août 1822 / Créa la Forézie - Firmy 1827, Decazeville
1830 /
Officier de la Légion d'honneur / Juin 1841 / Membre de Parlement du
département de l'Aveyron / 1846 / Membre du Conseil- Général de
l'Aveyron /
Maire de Decazeville- / etc- etc-", cm 70x42x30 Raymond Gayrard (Rodez
1777 - Paris 1858), Buste de François Gracchus Cabrol, bronze
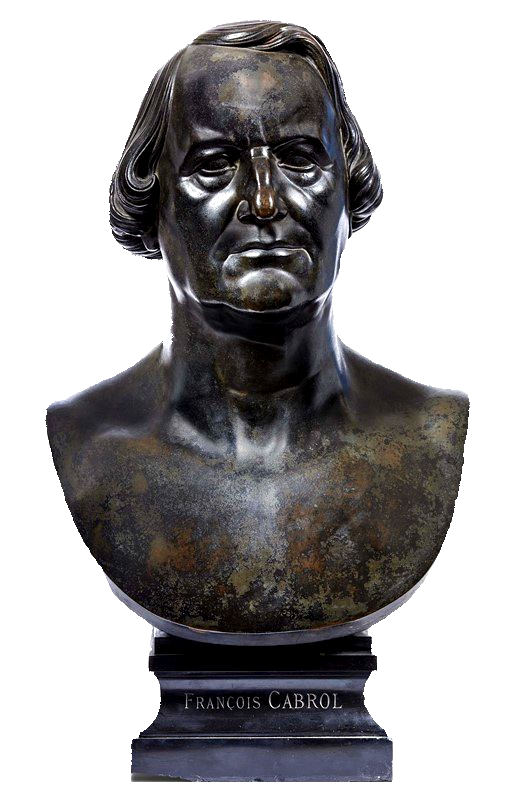

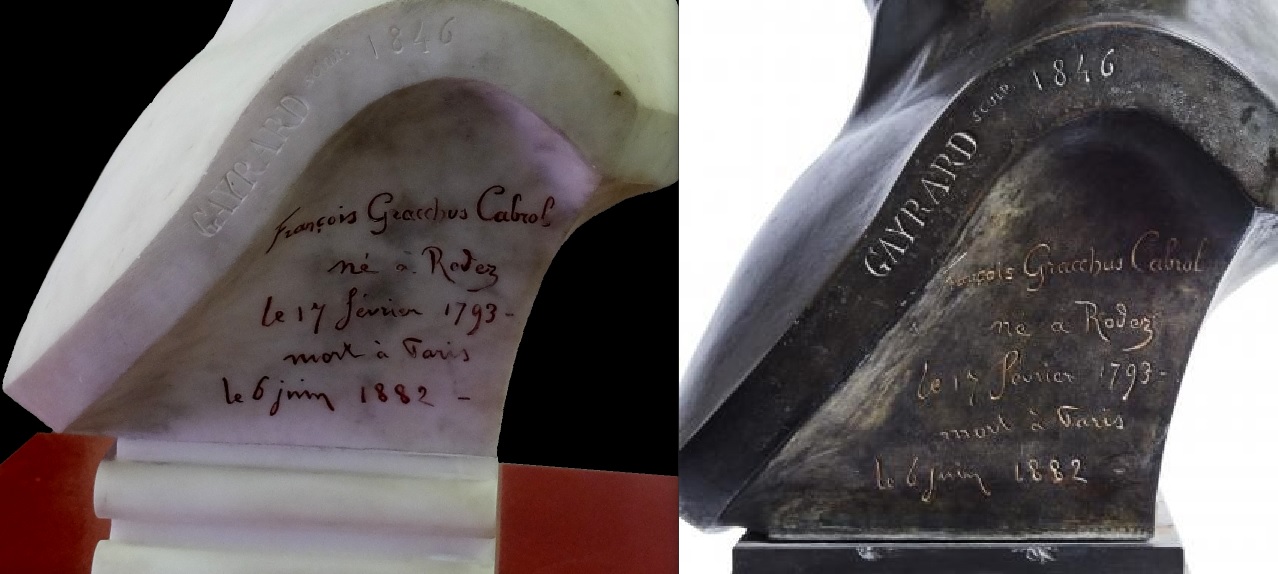
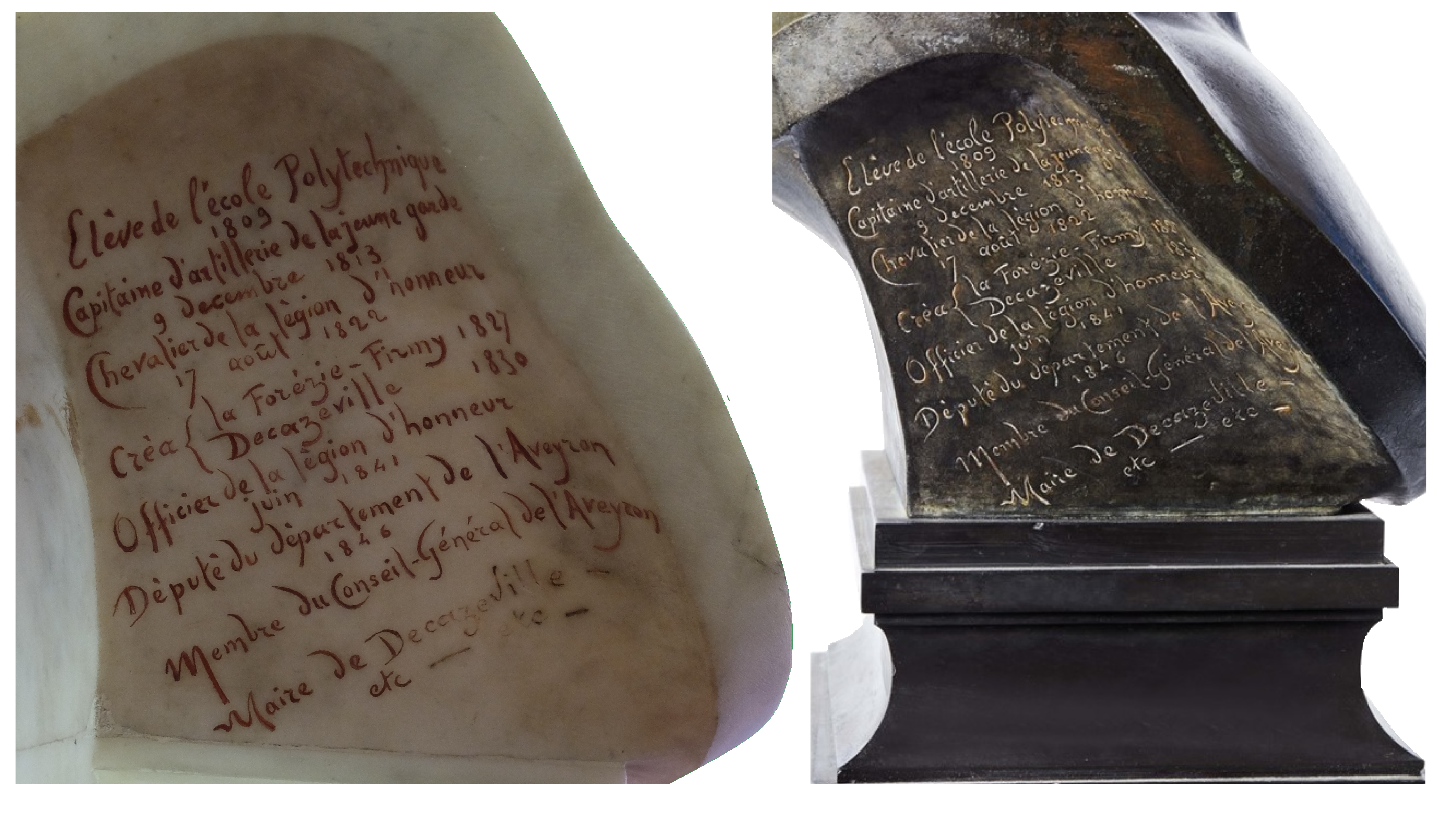
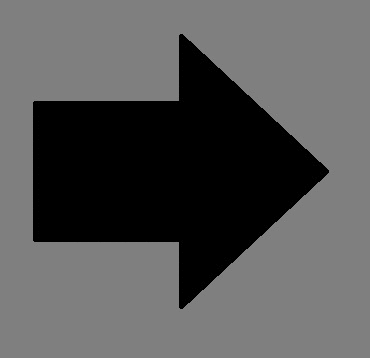 Malgré plusieurs (très
aimables) demandes, aucune information ne
nous est parvenue depuis Florence !?
Malgré plusieurs (très
aimables) demandes, aucune information ne
nous est parvenue depuis Florence !?


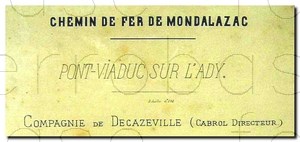
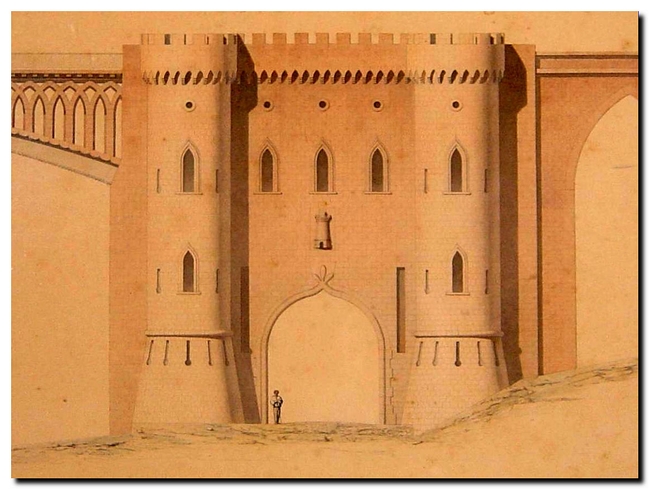
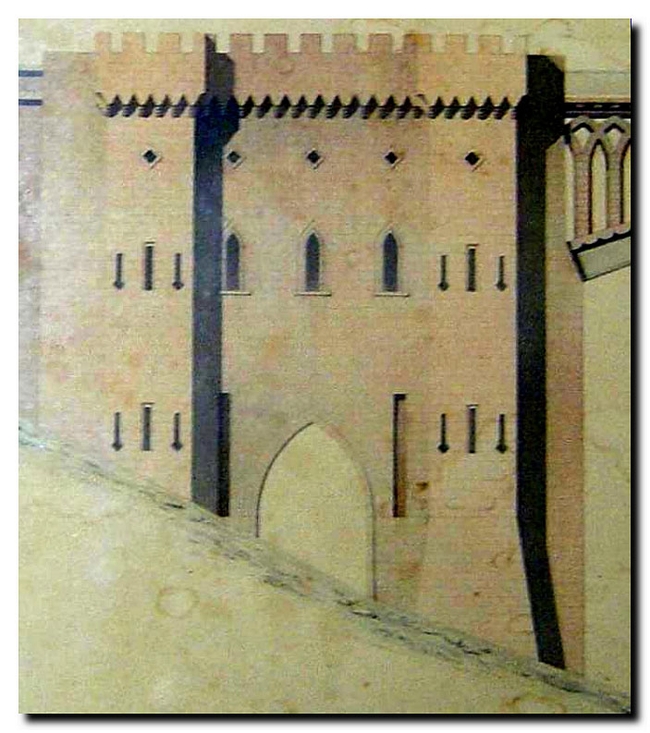
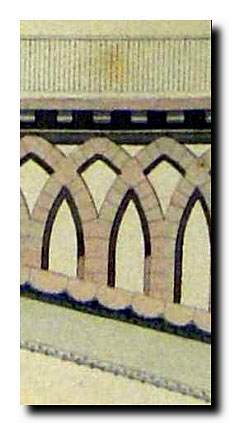
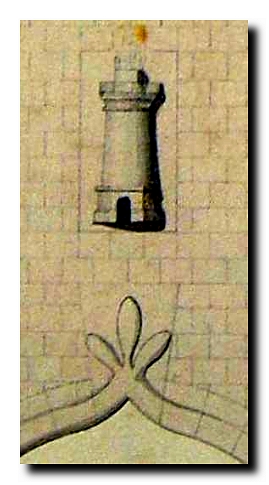

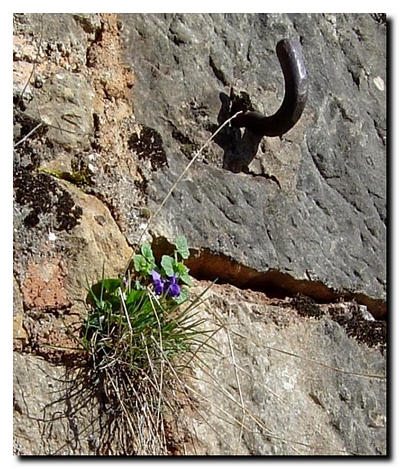
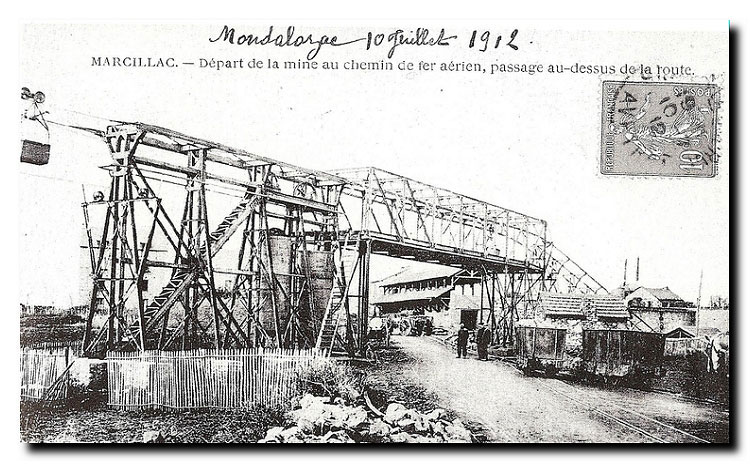
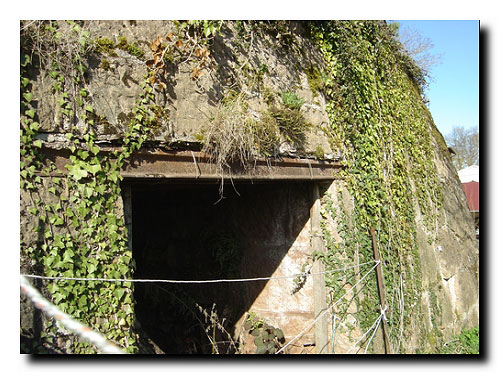
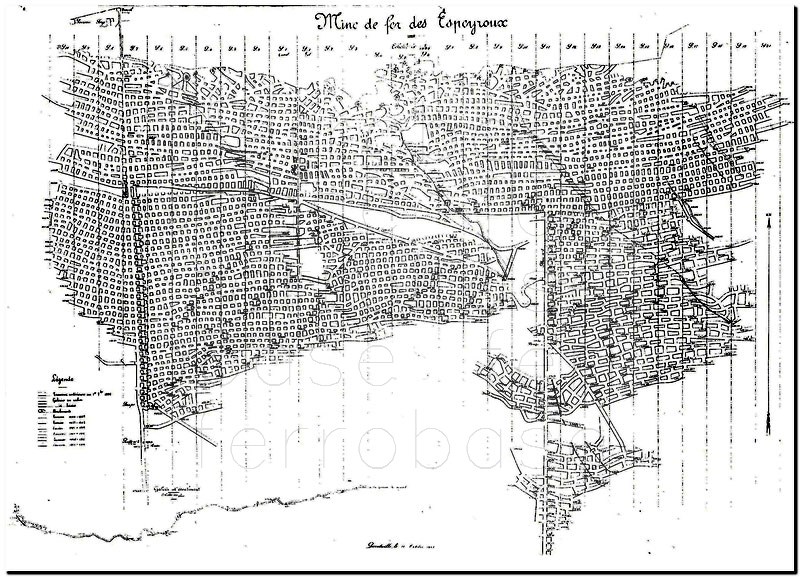
 Tout à droite,
mais pas sur ce plan, une sortie des eaux, réalisée en 1910, s'
effectuait au dessus du village de Muret Le Château, profitant d'une
profonde entaille dans le plateau pour le débouché de la galerie
d'exhaure. La photographie ci-contre montre cette galerie depuis
l'intérieur de la mine. Un autre cliché, dans les pages diaporama,
présente le débouché de la galerie au dessus de Muret. Plusieurs
puits sont enfin mentionnés sur ce plan. Il reste à mettre en place les
rails, wagons, minerai, mineurs et chevaux, les bruits, le café... Une
source d'inspiration inépuisable pour un réseau ! L'activité devait
être fébrile vers 1910. Près de 130 personnes trouvaient là l'assurance
de leur quotidien. Le second plan montre une vue globale des
concessions, reportée sur un fond d'état major. La localisation,
dont on ne recherchera pas l'extrême précision est cependant
parfaitement exacte. Ce graphique montre l'importante étendue des
concessions et localise les principaux sites d' exploitation.
Tout à droite,
mais pas sur ce plan, une sortie des eaux, réalisée en 1910, s'
effectuait au dessus du village de Muret Le Château, profitant d'une
profonde entaille dans le plateau pour le débouché de la galerie
d'exhaure. La photographie ci-contre montre cette galerie depuis
l'intérieur de la mine. Un autre cliché, dans les pages diaporama,
présente le débouché de la galerie au dessus de Muret. Plusieurs
puits sont enfin mentionnés sur ce plan. Il reste à mettre en place les
rails, wagons, minerai, mineurs et chevaux, les bruits, le café... Une
source d'inspiration inépuisable pour un réseau ! L'activité devait
être fébrile vers 1910. Près de 130 personnes trouvaient là l'assurance
de leur quotidien. Le second plan montre une vue globale des
concessions, reportée sur un fond d'état major. La localisation,
dont on ne recherchera pas l'extrême précision est cependant
parfaitement exacte. Ce graphique montre l'importante étendue des
concessions et localise les principaux sites d' exploitation. 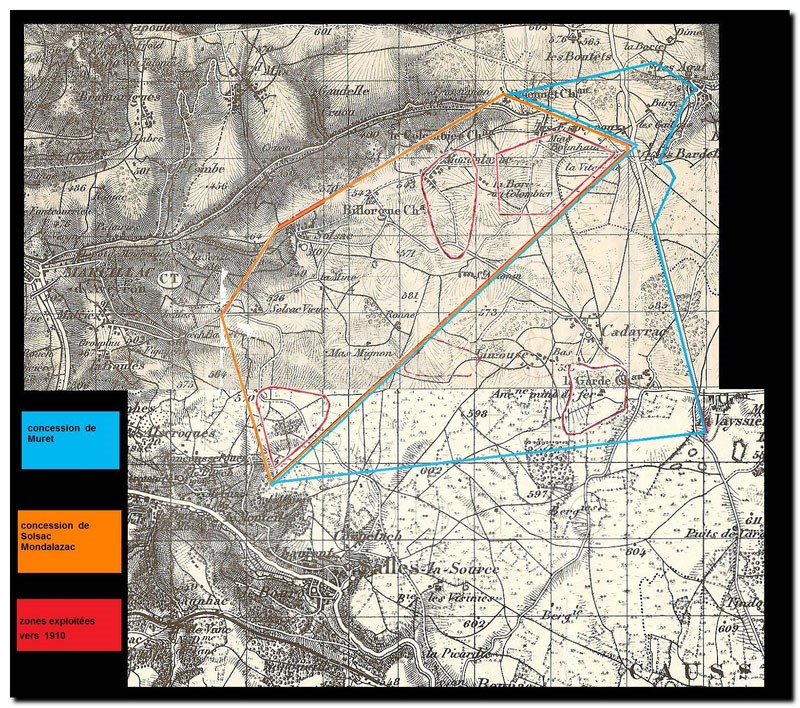
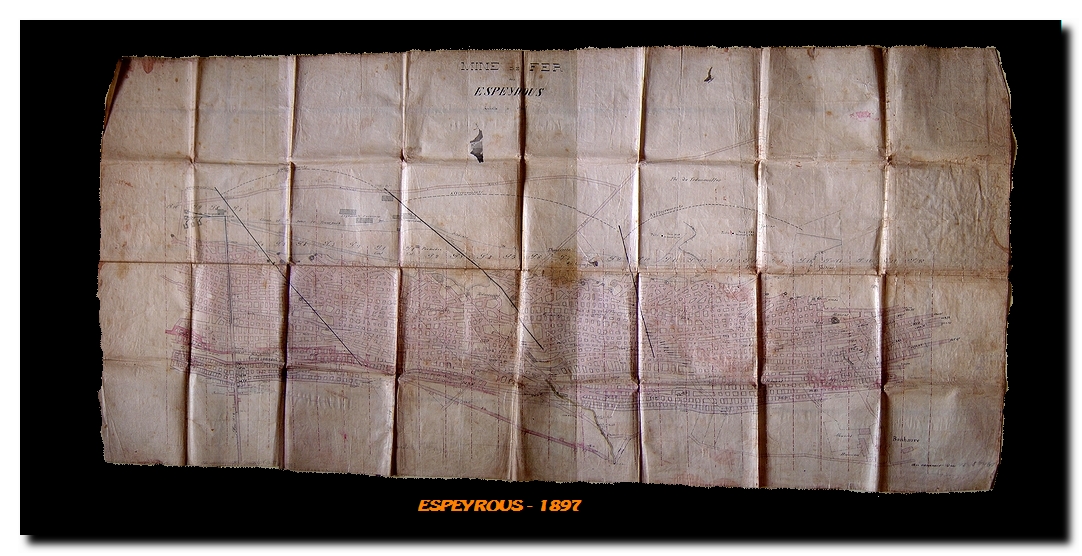

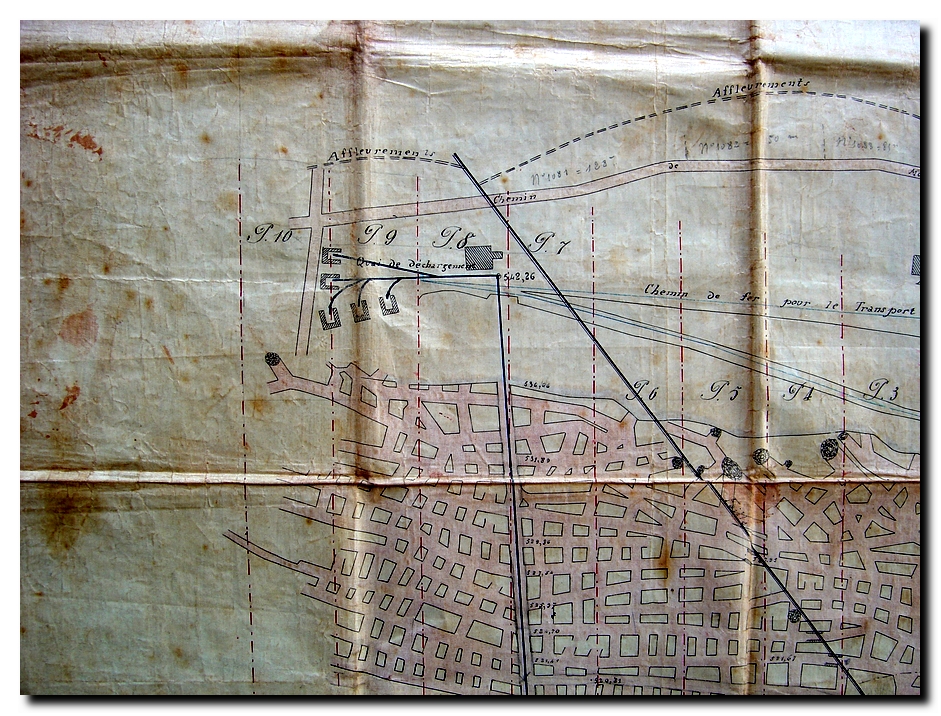
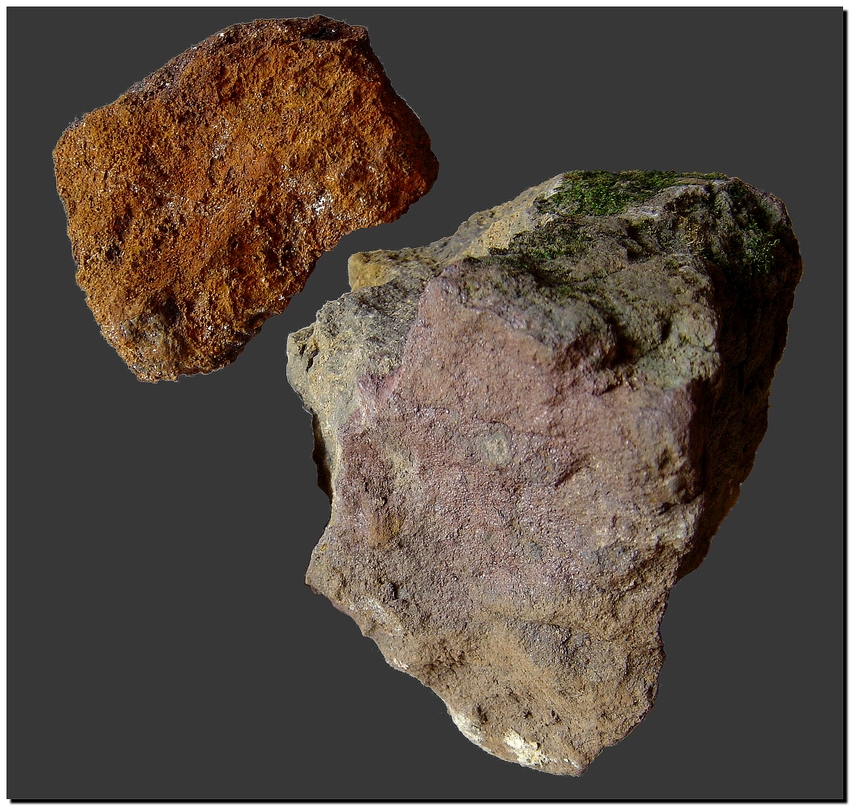

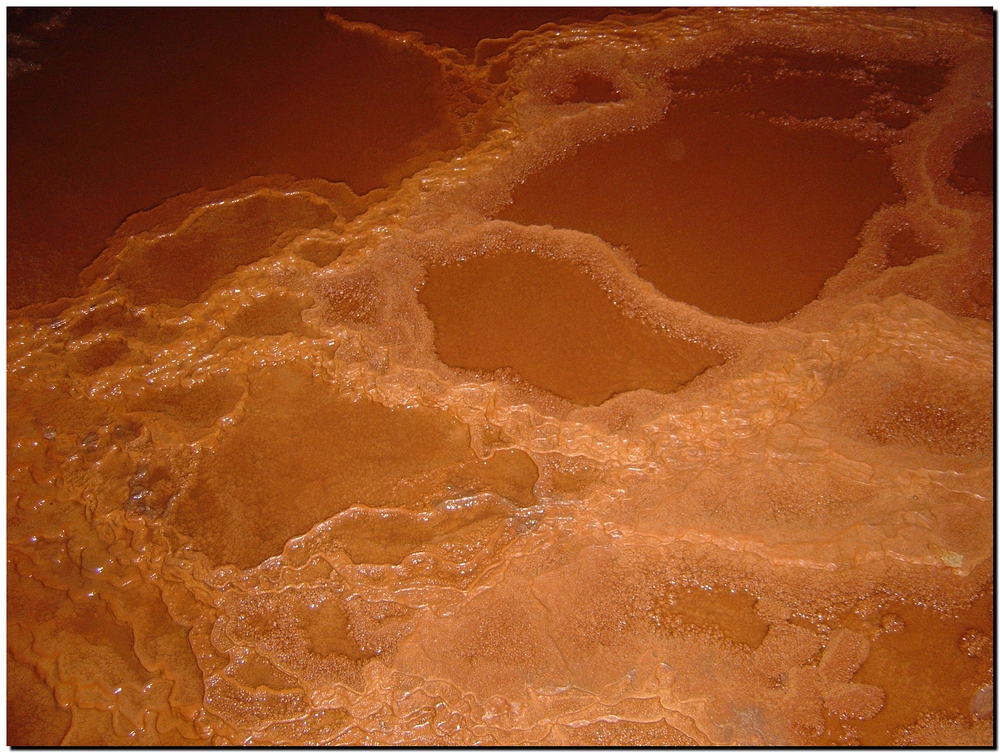




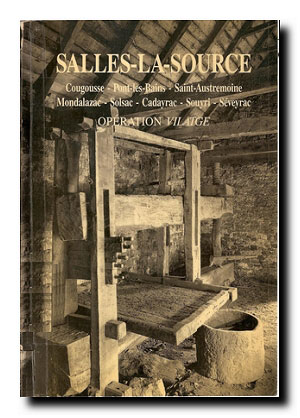
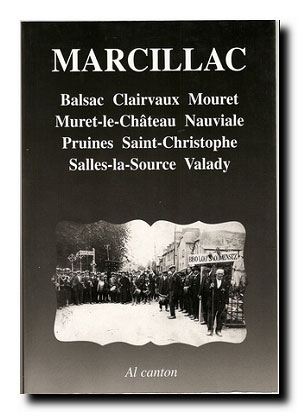
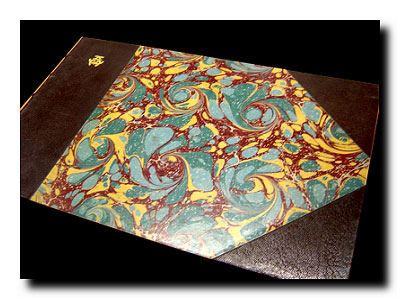
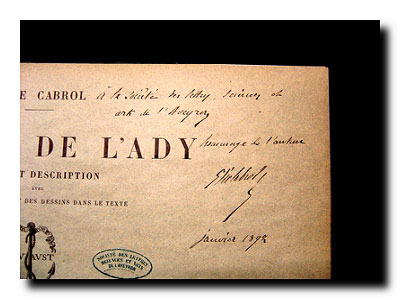
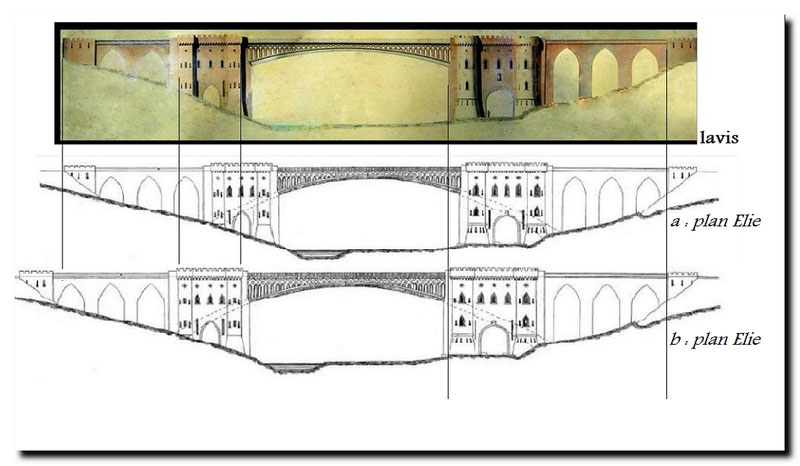
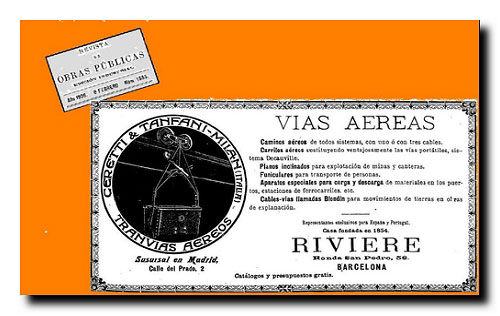 Cette publicité est
parue en 1906 dans une revue espagnole de travaux publics. Le wagonnet
ressemble fort à ceux de Richard, .....Bleichert. Il est signé Ceretti
Tanfani, à Milan. Alors quittons l'Espagne pour l'Italie
afin d'en savoir un peu plus.
Cette publicité est
parue en 1906 dans une revue espagnole de travaux publics. Le wagonnet
ressemble fort à ceux de Richard, .....Bleichert. Il est signé Ceretti
Tanfani, à Milan. Alors quittons l'Espagne pour l'Italie
afin d'en savoir un peu plus. 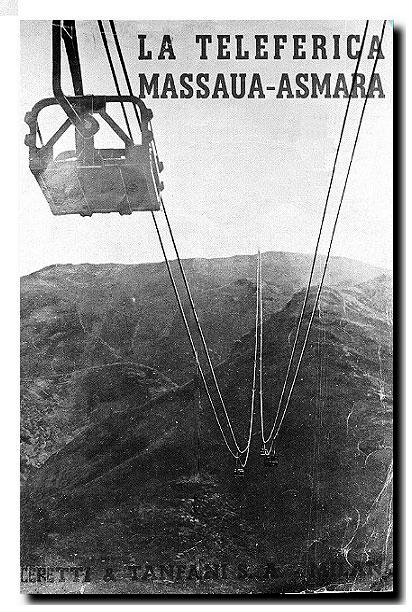
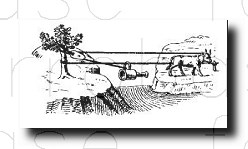 chemin faisait probablement le service
pour une forteresse, utilisé pour le transport de
mortier (grande arme à feu) voir figure 1. Le système était
simple. Les mortiers devaient franchir les douves de la
forteresse. Entre l'arbre sur un côté et une cheville (un piquet) fixée
dans le sol de l'autre côté une corde était attachée ; à cette
corde le mortier est accroché au moyen d'un anneau. À l'arbre un bloc
avec un rouleau a été fixé ; sur ce rouleau passe la corde tirante ;
une extrémité est liée à l'anneau du mortier ;
l'autre fin est liée à des chevaux ou des boeufs. Quand les
animaux iront vers l'intérieur, ils tirent sur l'anneau, par
lequel le mortier est suspendu.
chemin faisait probablement le service
pour une forteresse, utilisé pour le transport de
mortier (grande arme à feu) voir figure 1. Le système était
simple. Les mortiers devaient franchir les douves de la
forteresse. Entre l'arbre sur un côté et une cheville (un piquet) fixée
dans le sol de l'autre côté une corde était attachée ; à cette
corde le mortier est accroché au moyen d'un anneau. À l'arbre un bloc
avec un rouleau a été fixé ; sur ce rouleau passe la corde tirante ;
une extrémité est liée à l'anneau du mortier ;
l'autre fin est liée à des chevaux ou des boeufs. Quand les
animaux iront vers l'intérieur, ils tirent sur l'anneau, par
lequel le mortier est suspendu.
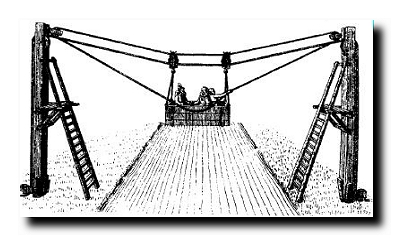
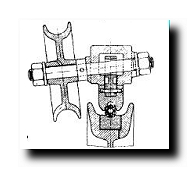 En
Angleterre, le système monocâble Hodgson est
continuellement en croissance.
En
Angleterre, le système monocâble Hodgson est
continuellement en croissance.
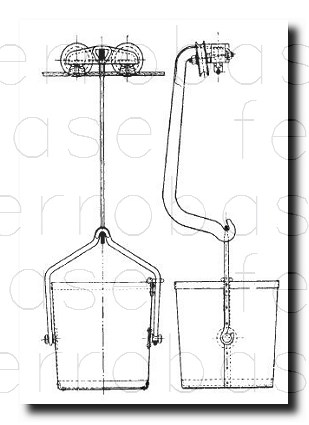
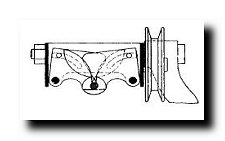
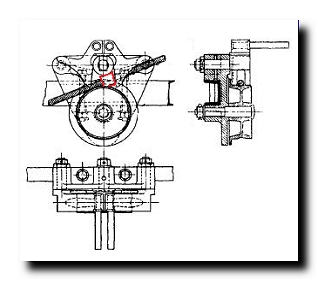
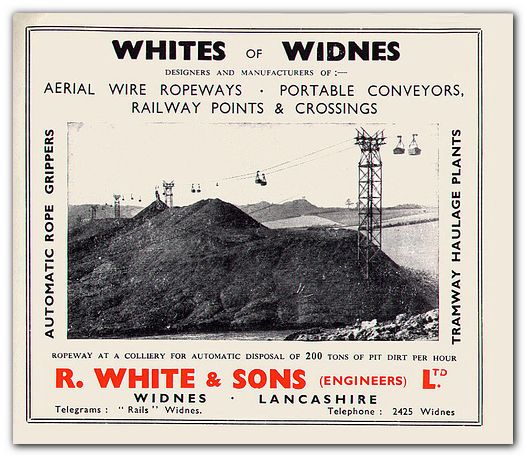
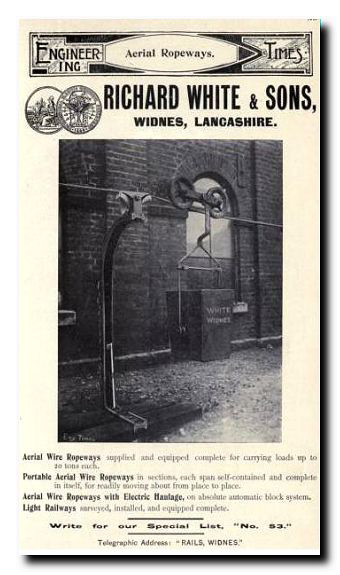 Les projeteurs et ingénieurs anglais de Meccano, pour réaliser leur
prototype, se sont inspirés de réalisations réelles, et très
précisemment de celles de l'industriel de Liverpool, R. White and
Sons. Il semble bien qu'en 1930, celui ci avait une grande notoriété.
De plus, Hornby, Franck, l'inventeur en 1901 du meccano, puis plus tard
des trains Hornby et voitures Dinky toys de notre enfance, était né à
Liverpool. Il connaissait donc parfaitement cet industriel et ce sera
donc un système White qui va être retenu. Ce système est un
aboutissement de ceux que nous connaissons déjà. Multicâbles, et
automatique, chargement et déchargement des wagonnets compris !
Quelques sources sur internet, dont celles du musée minier de
Durham,http://www.dmm-gallery.org.uk, présentent des réalisations de
White et fils.
Les projeteurs et ingénieurs anglais de Meccano, pour réaliser leur
prototype, se sont inspirés de réalisations réelles, et très
précisemment de celles de l'industriel de Liverpool, R. White and
Sons. Il semble bien qu'en 1930, celui ci avait une grande notoriété.
De plus, Hornby, Franck, l'inventeur en 1901 du meccano, puis plus tard
des trains Hornby et voitures Dinky toys de notre enfance, était né à
Liverpool. Il connaissait donc parfaitement cet industriel et ce sera
donc un système White qui va être retenu. Ce système est un
aboutissement de ceux que nous connaissons déjà. Multicâbles, et
automatique, chargement et déchargement des wagonnets compris !
Quelques sources sur internet, dont celles du musée minier de
Durham,http://www.dmm-gallery.org.uk, présentent des réalisations de
White et fils. 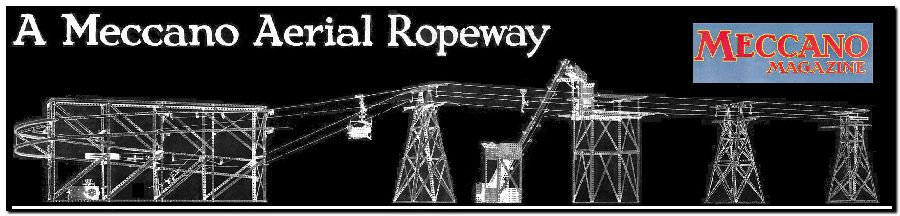
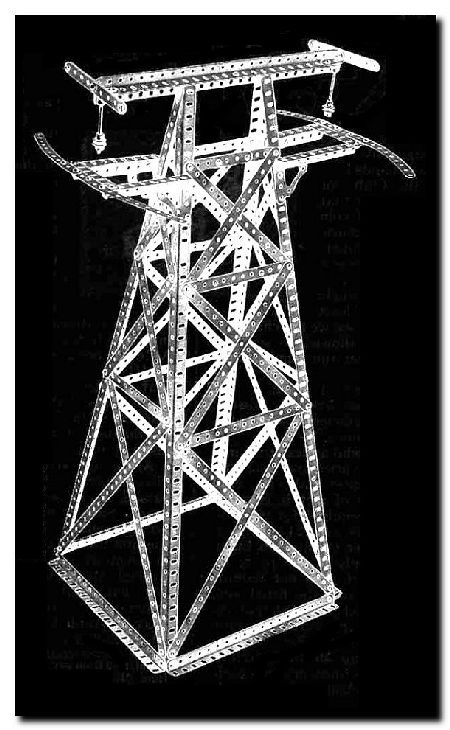
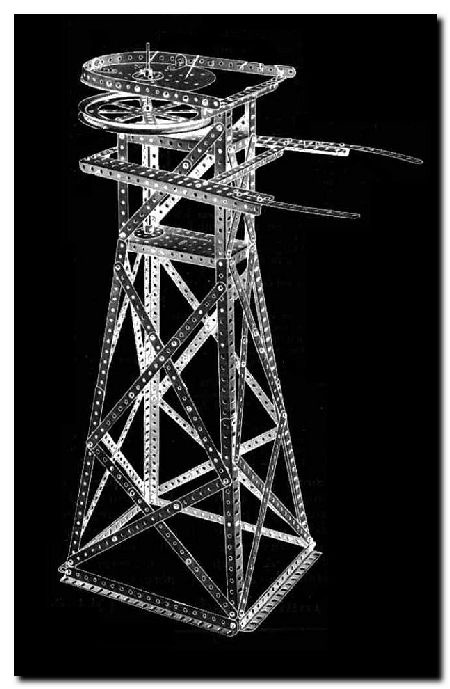
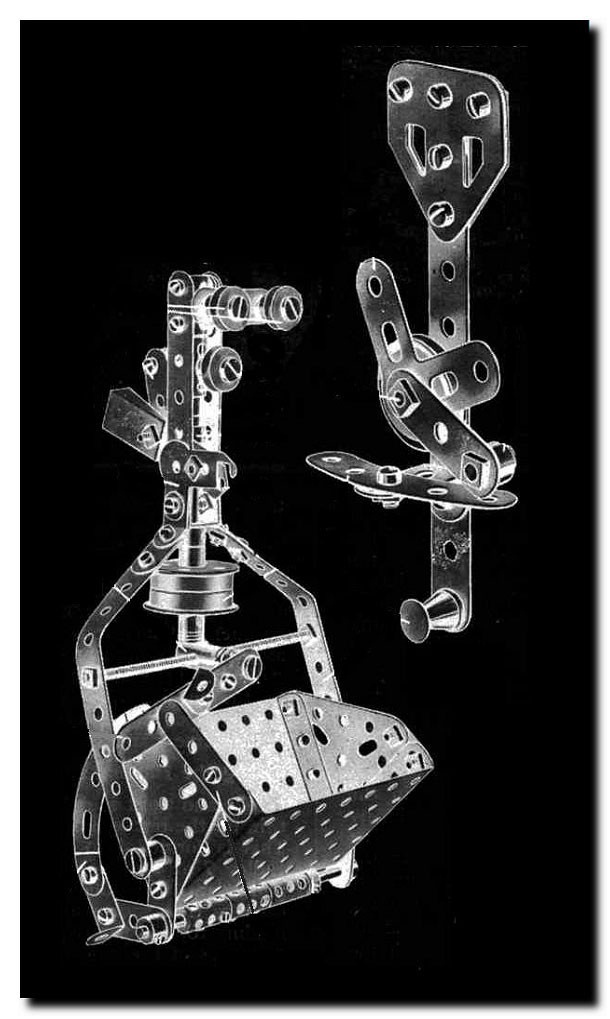
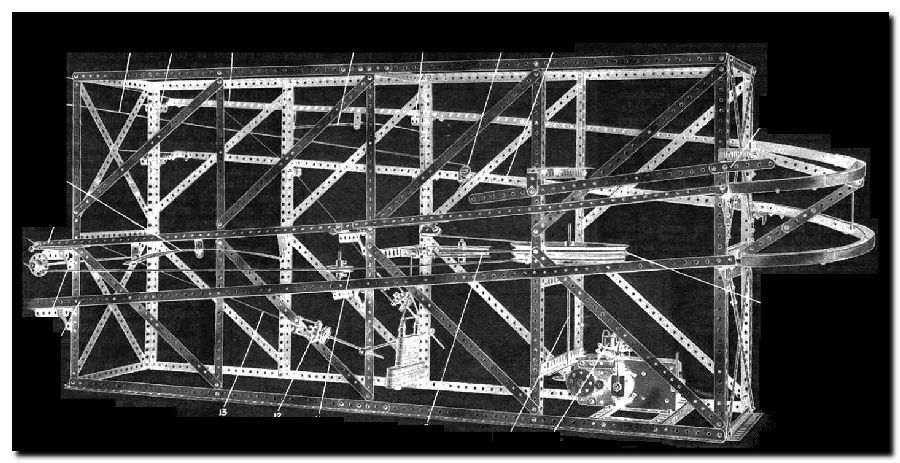
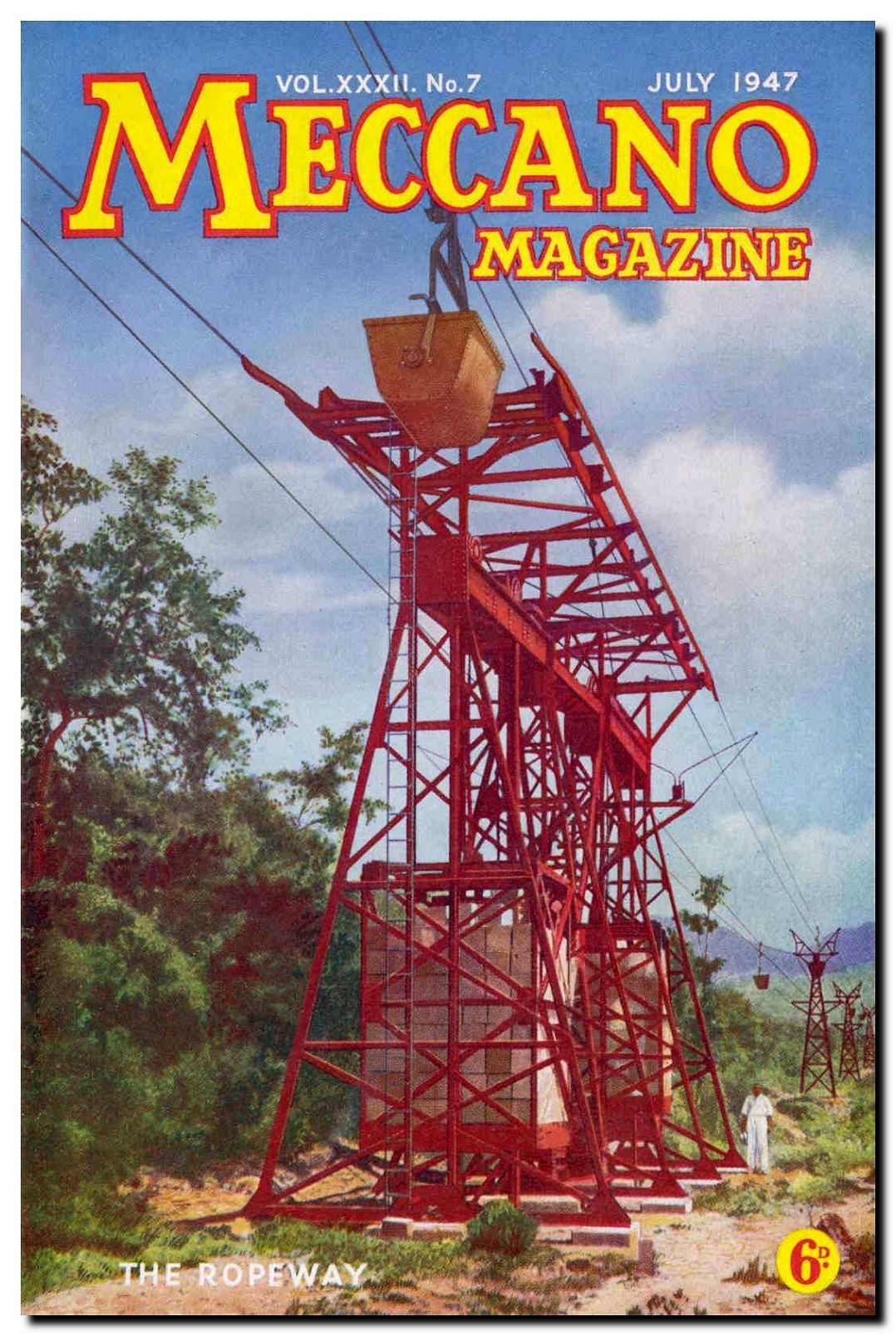
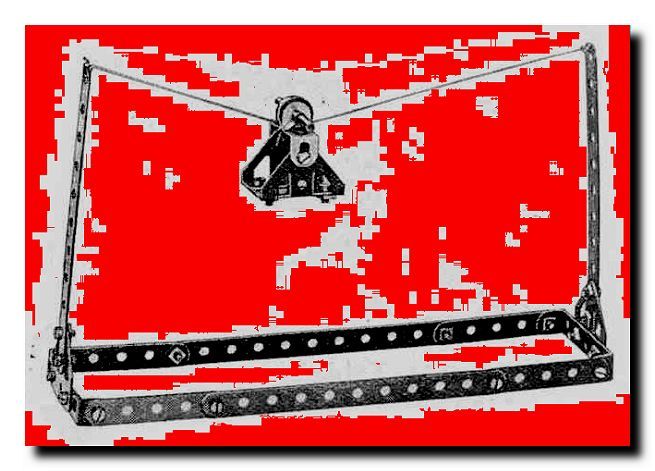
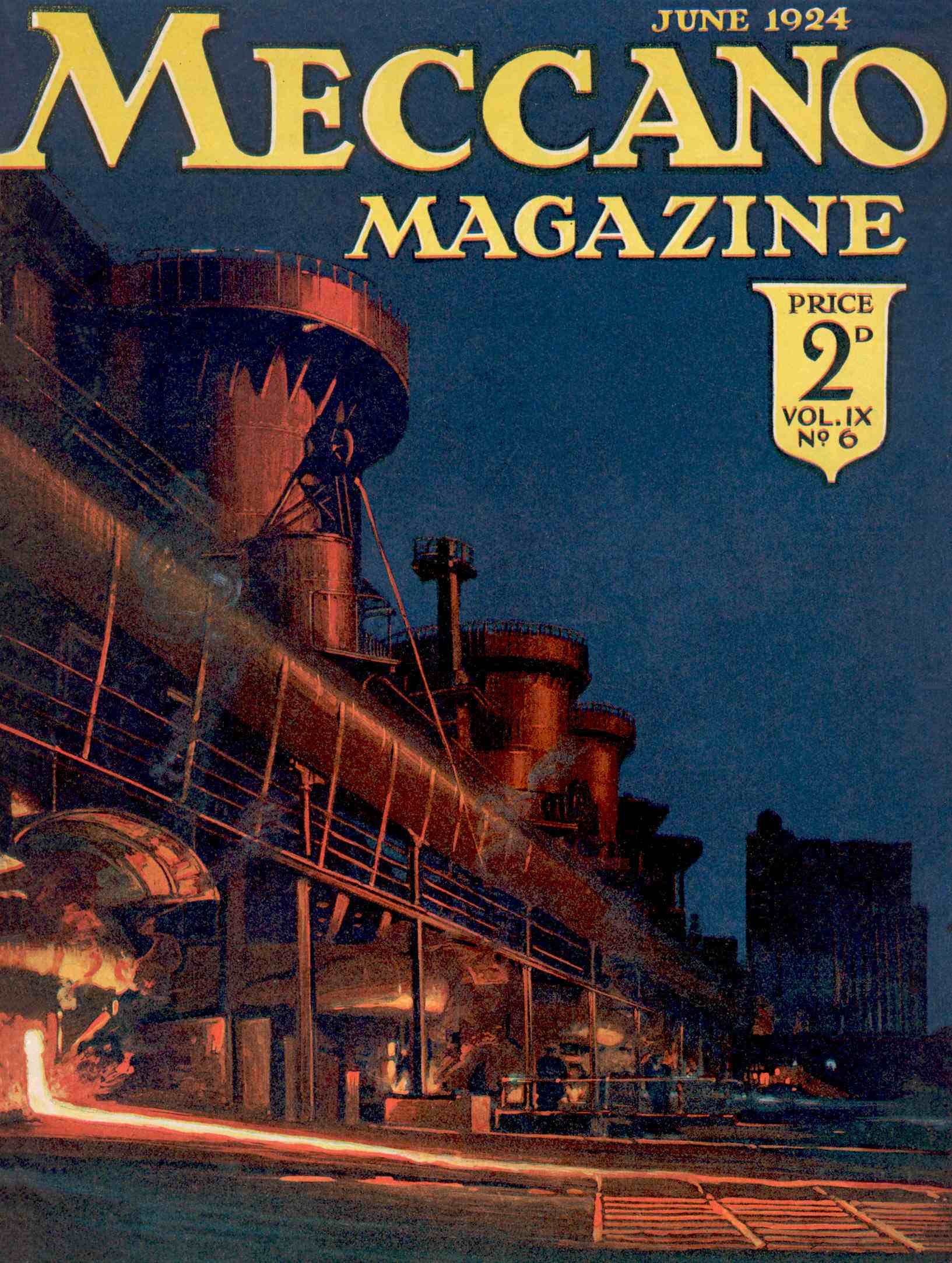 |
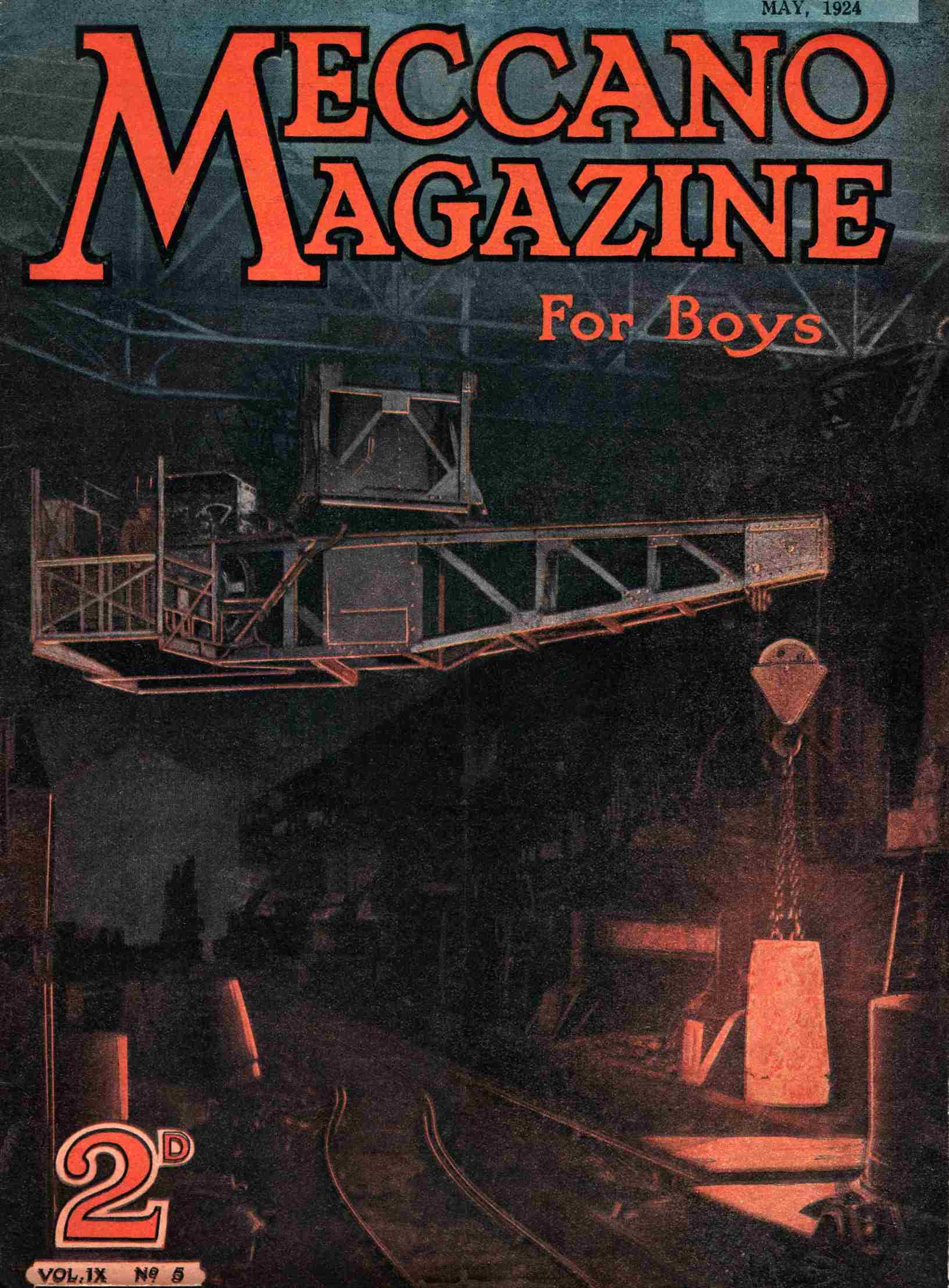 |
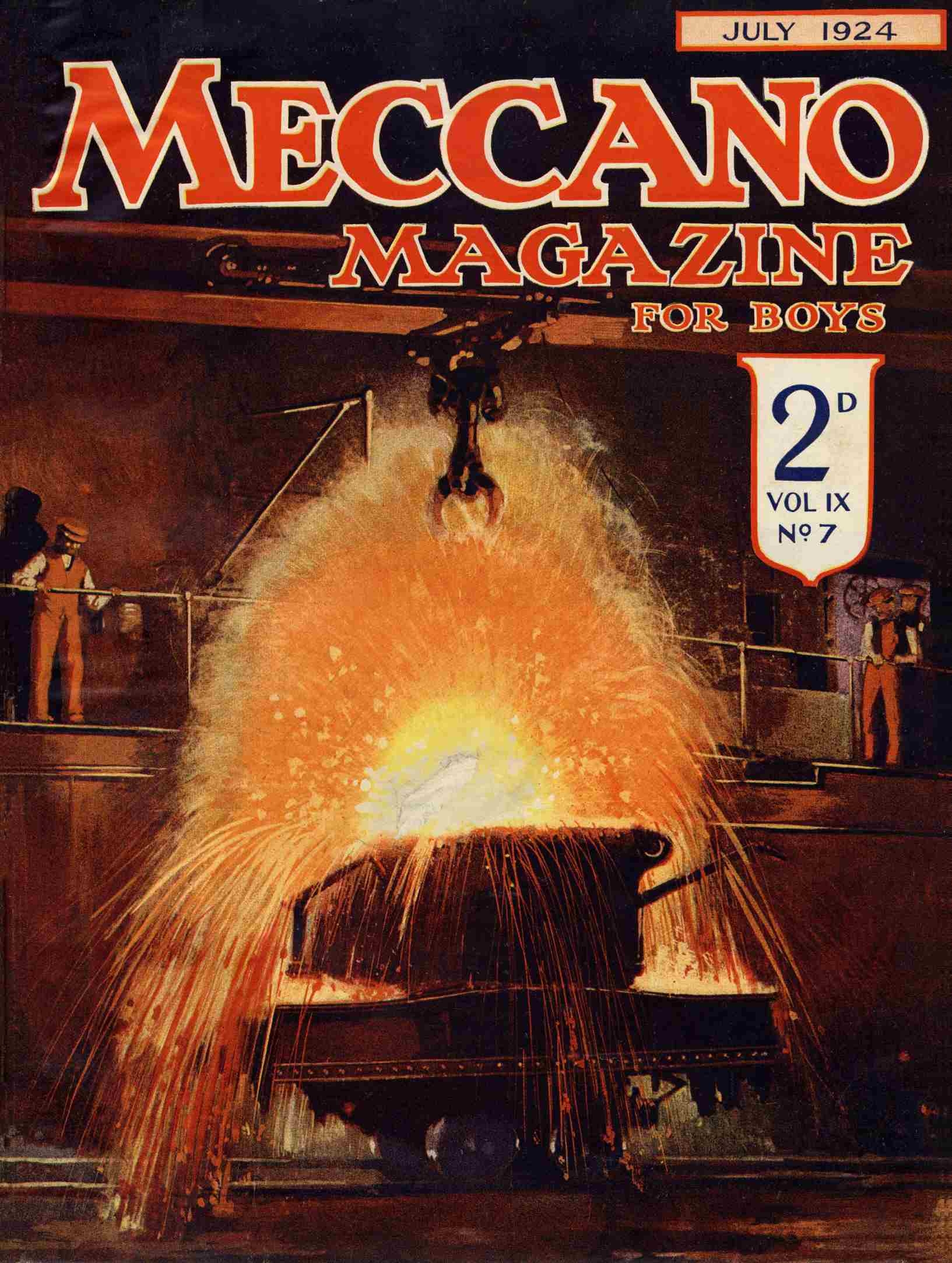 |
 |
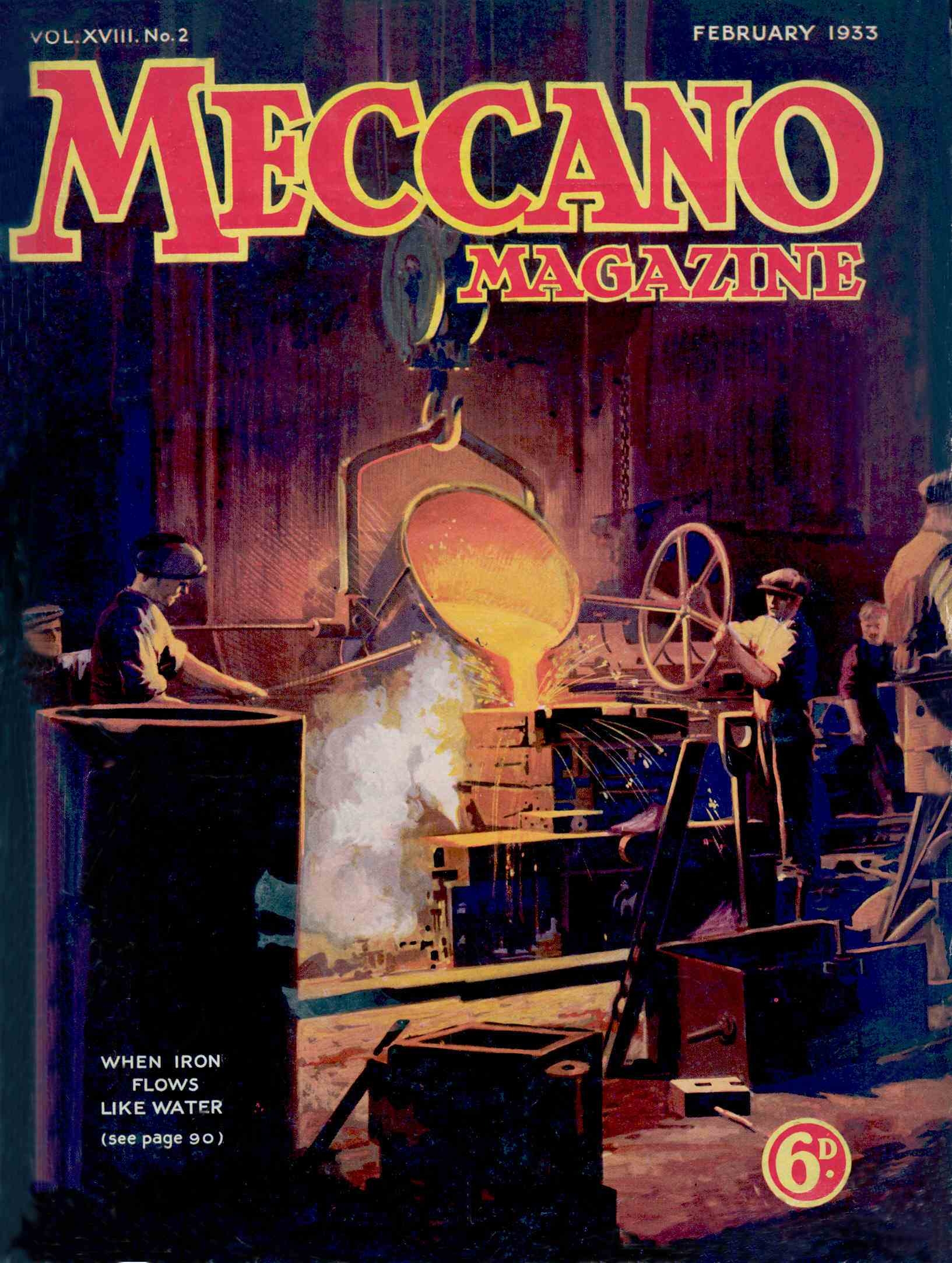 |
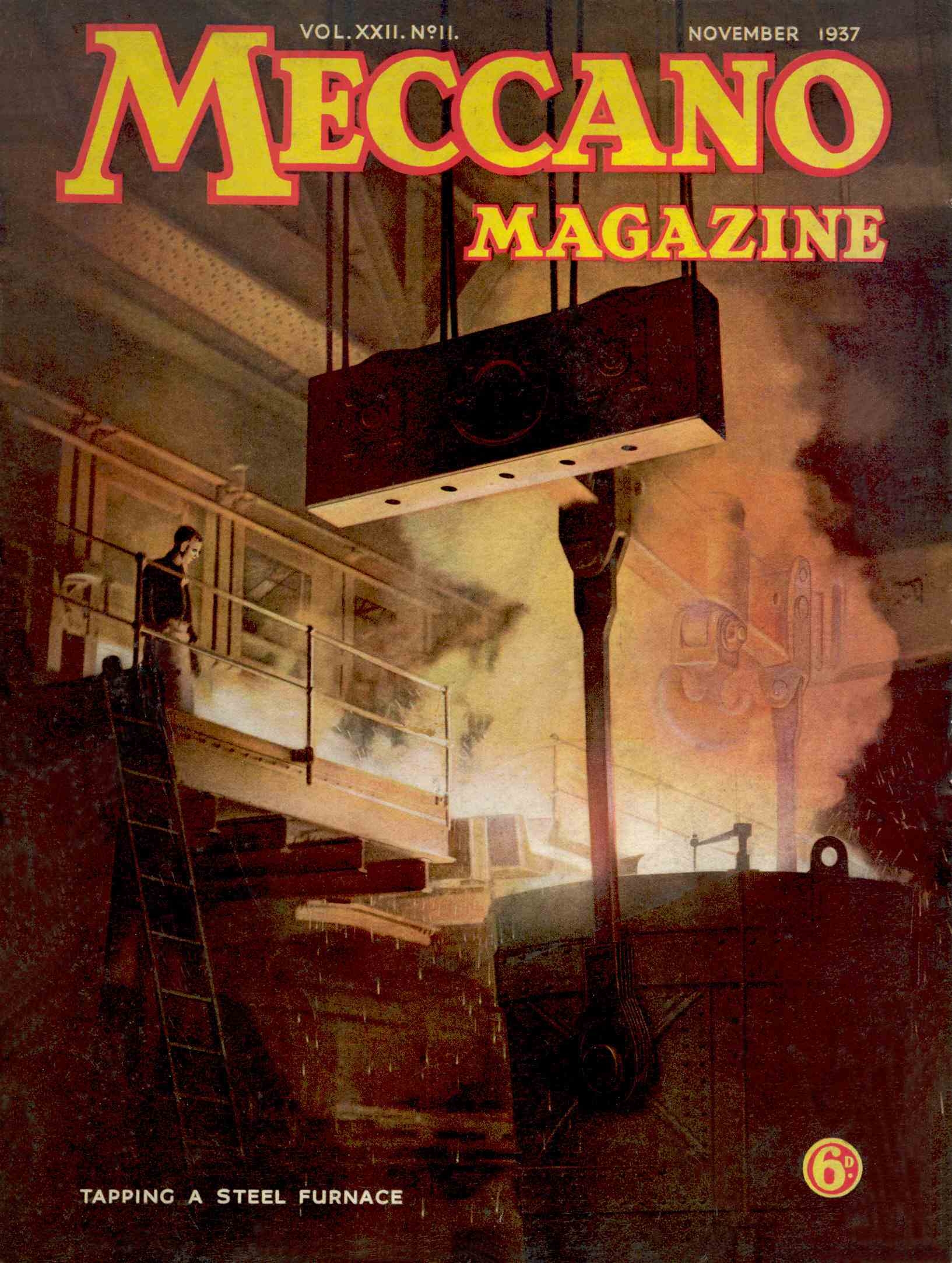 |
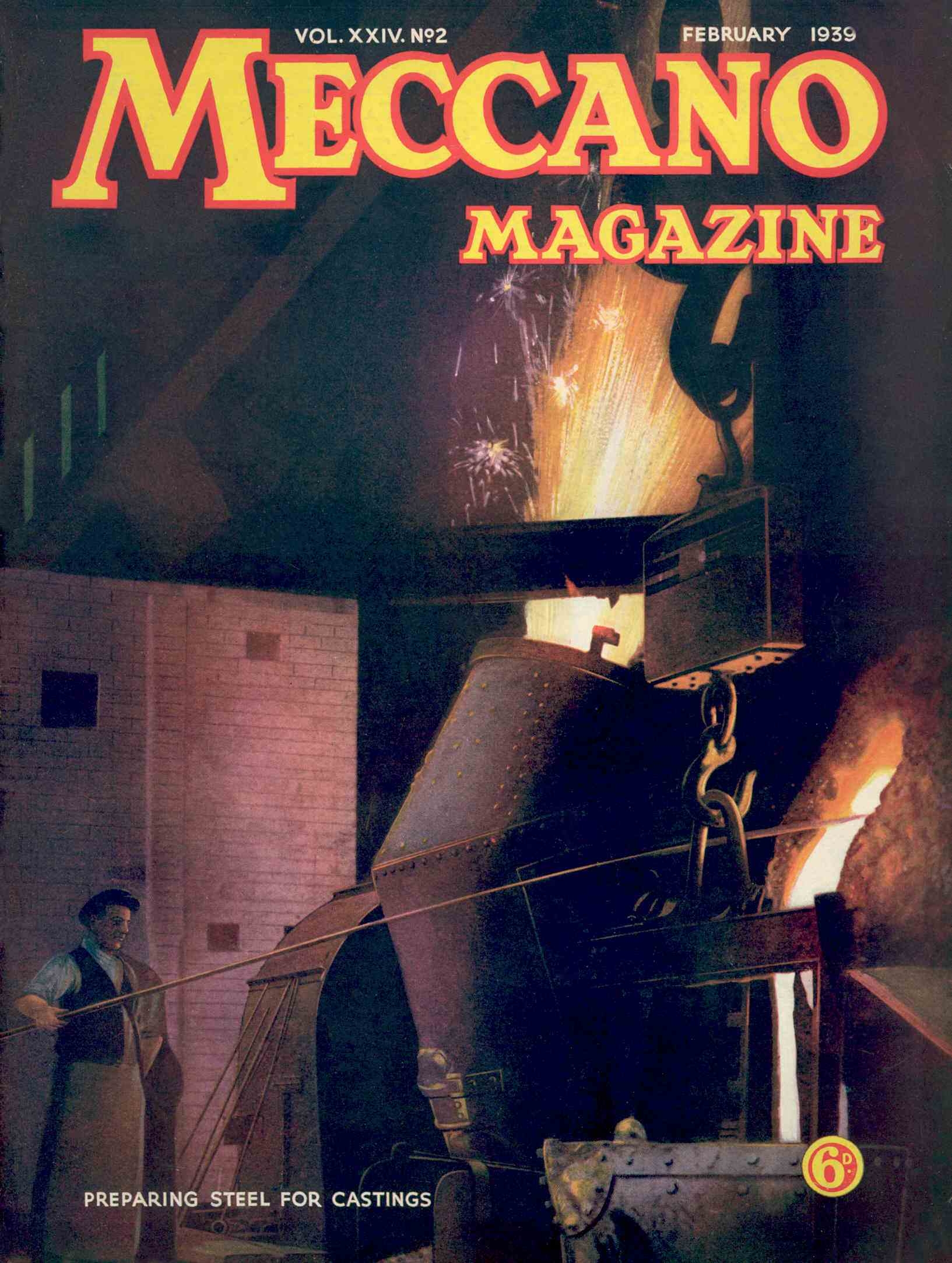 |
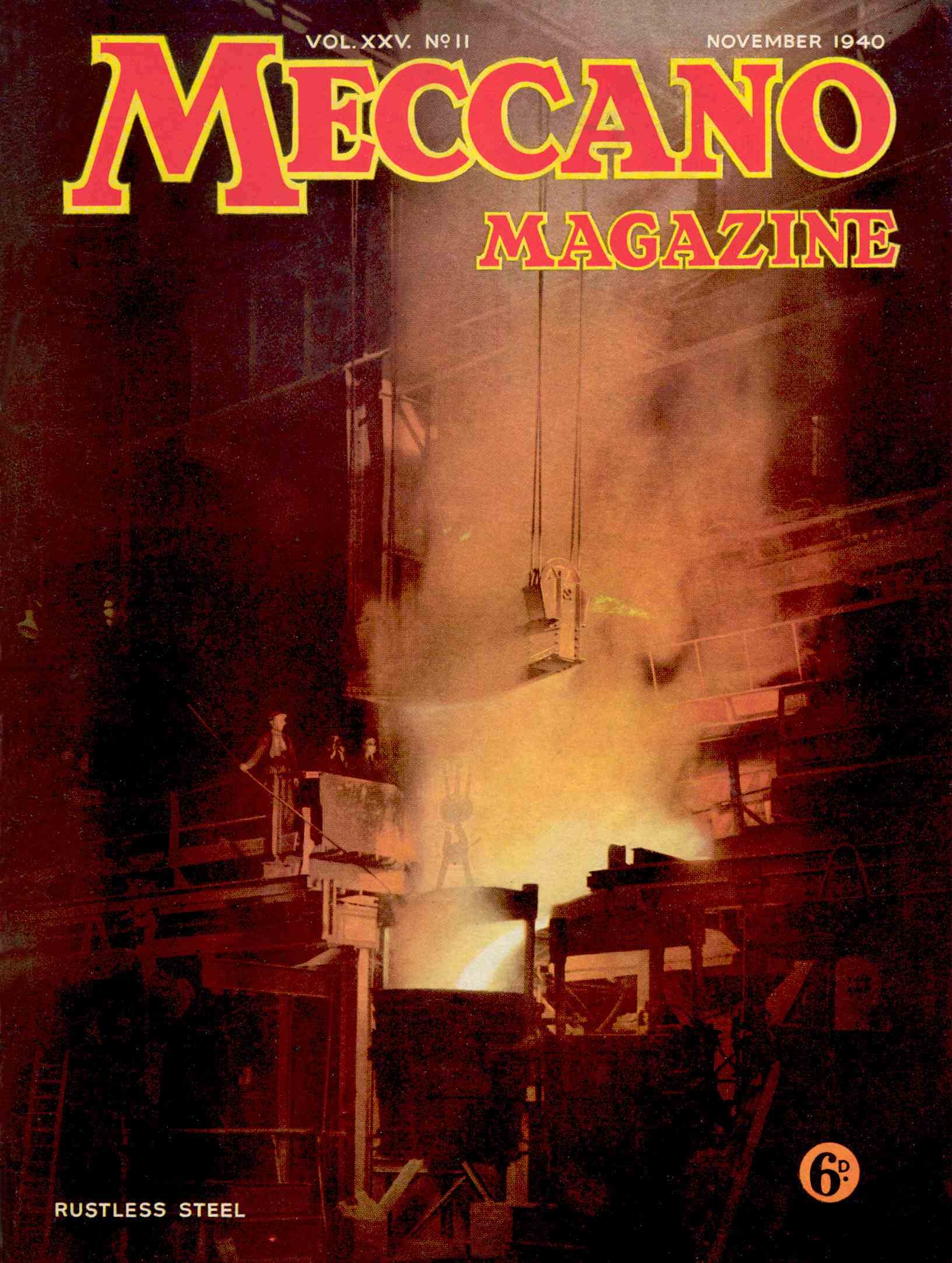 |
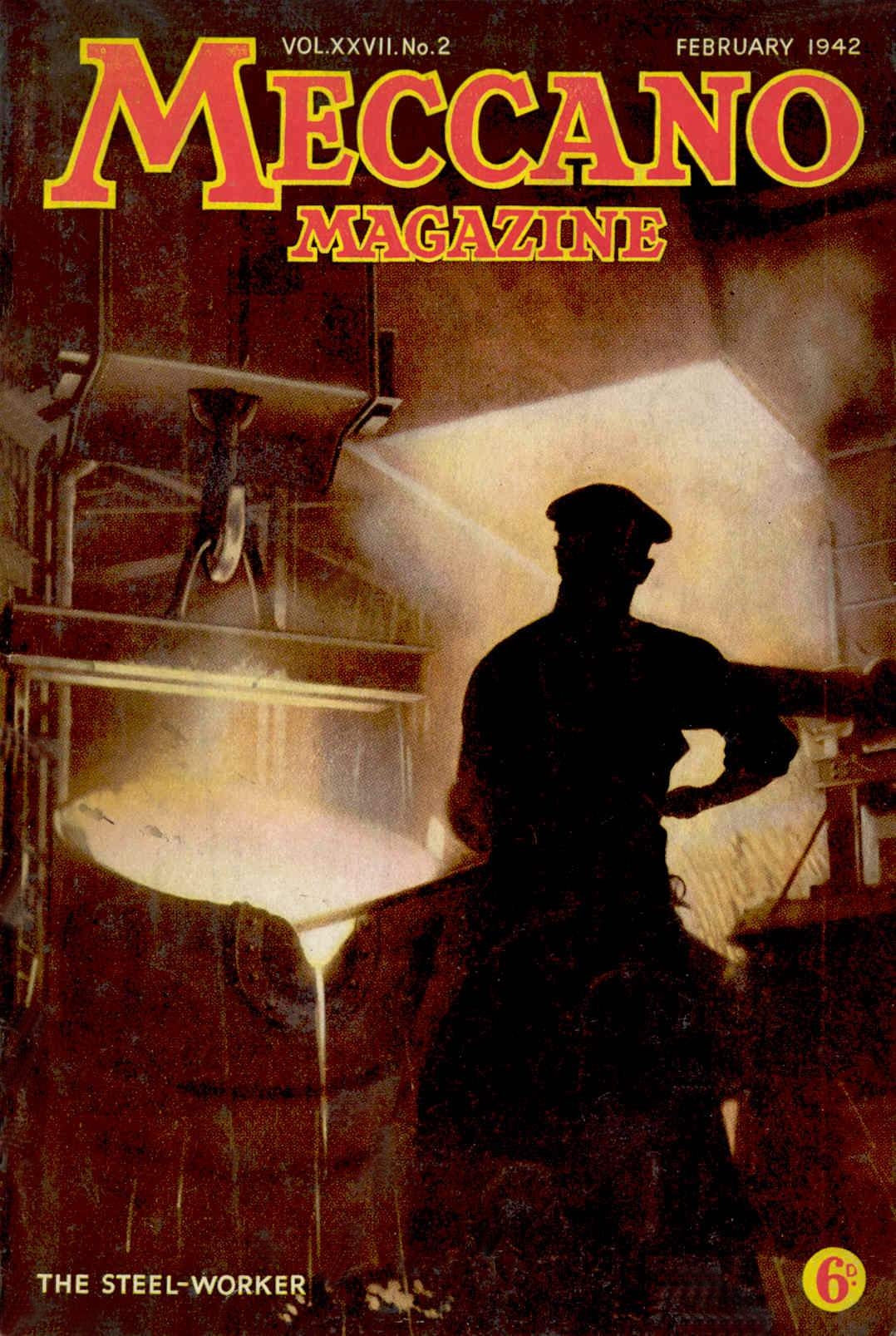 |
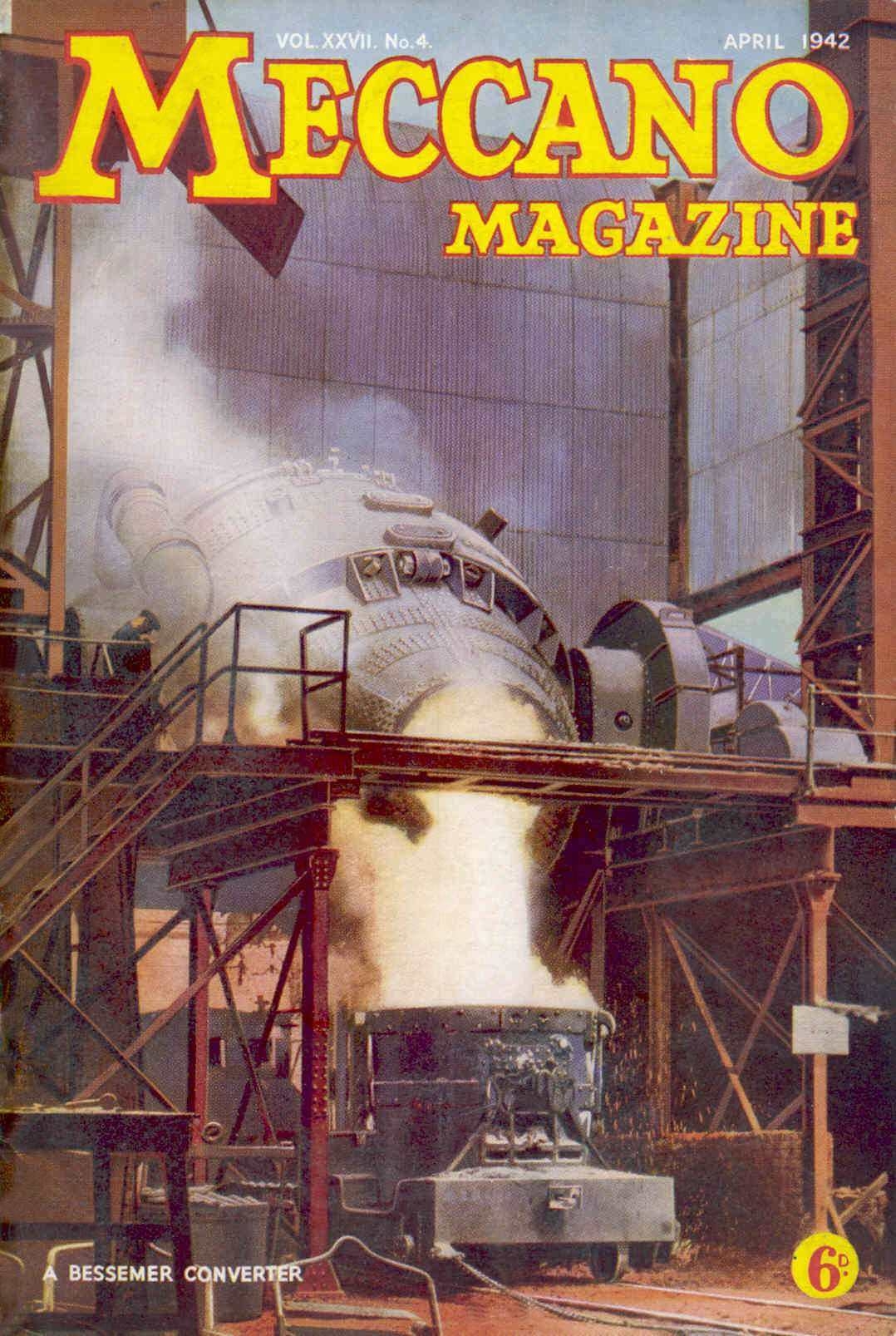 |
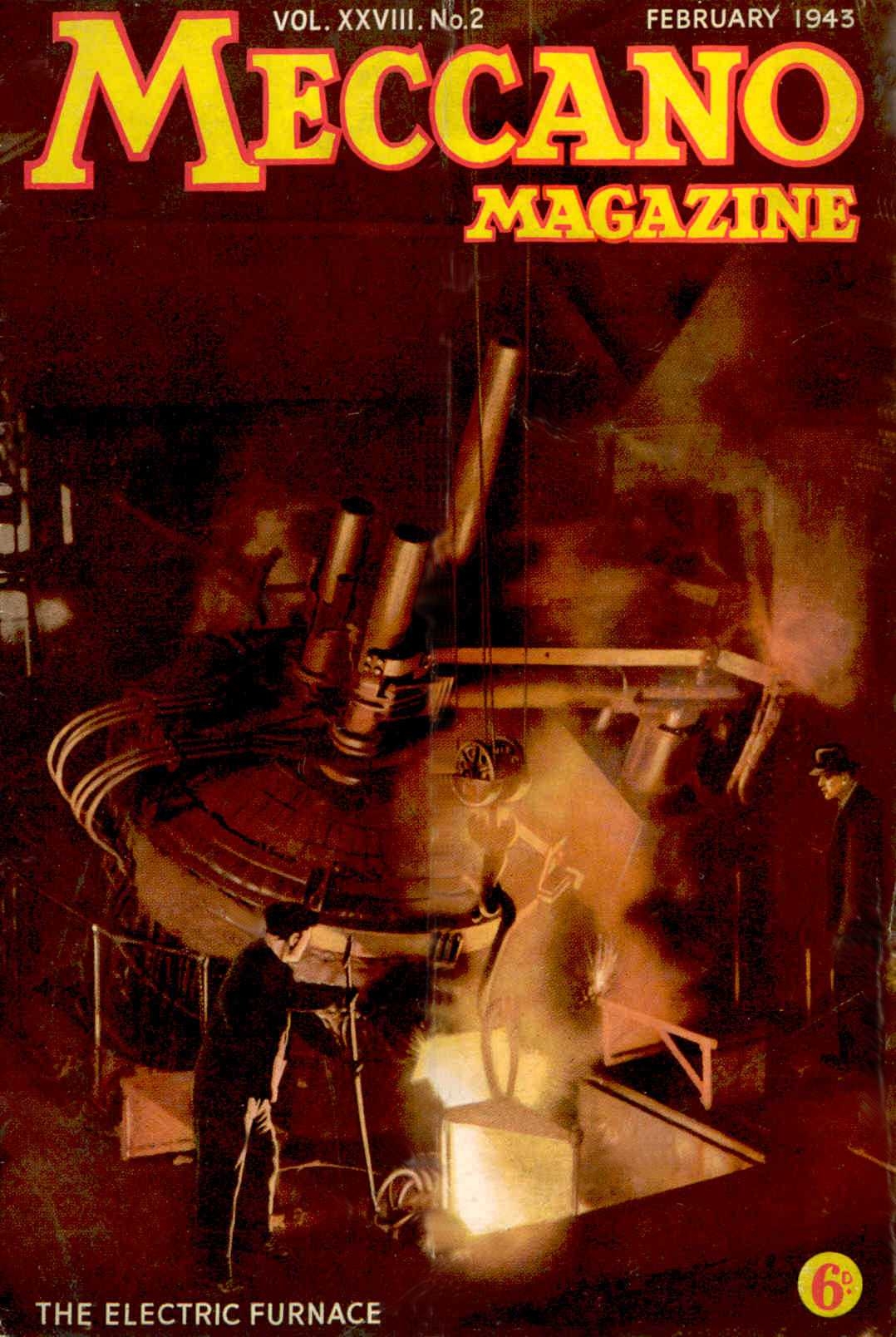 |
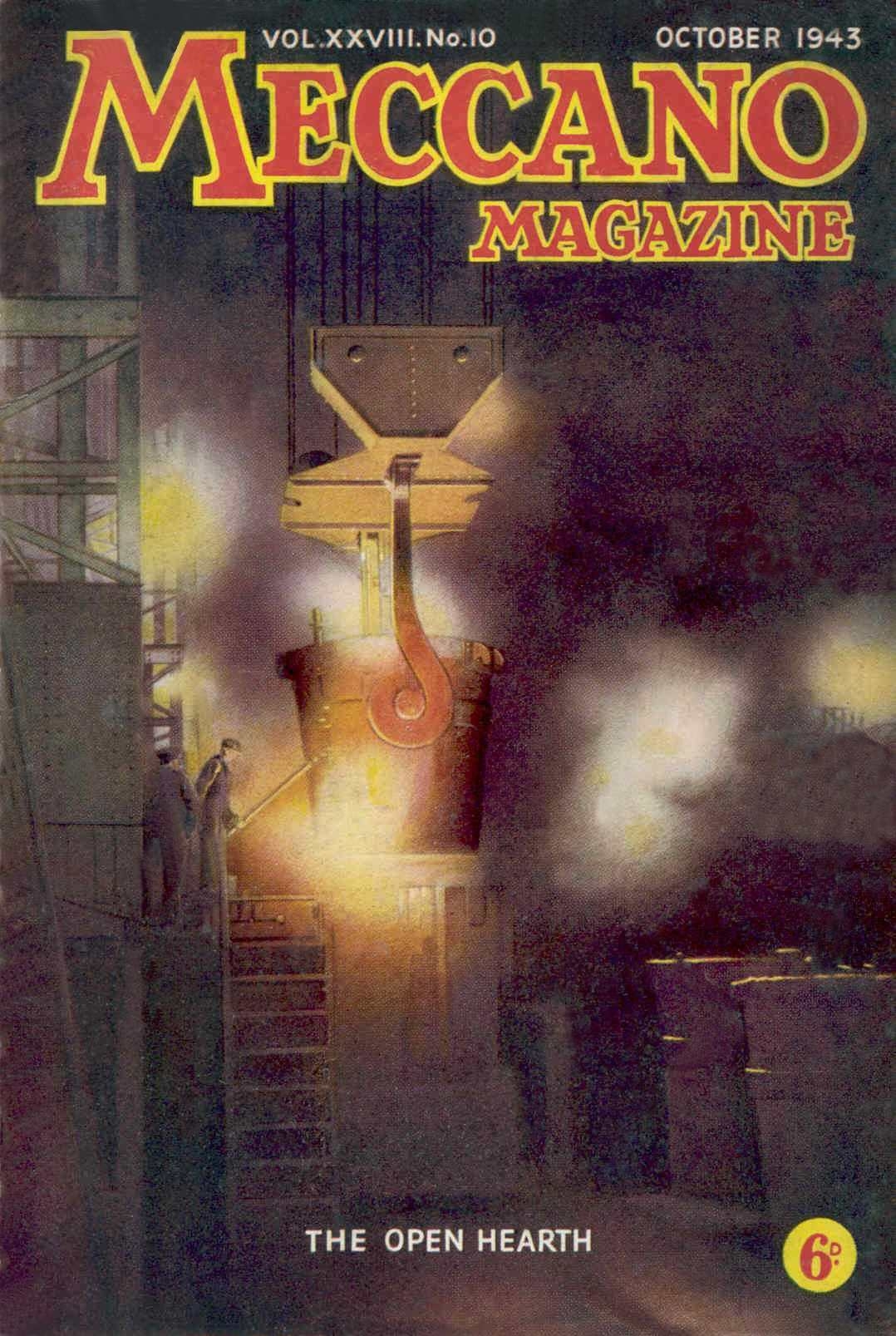 |
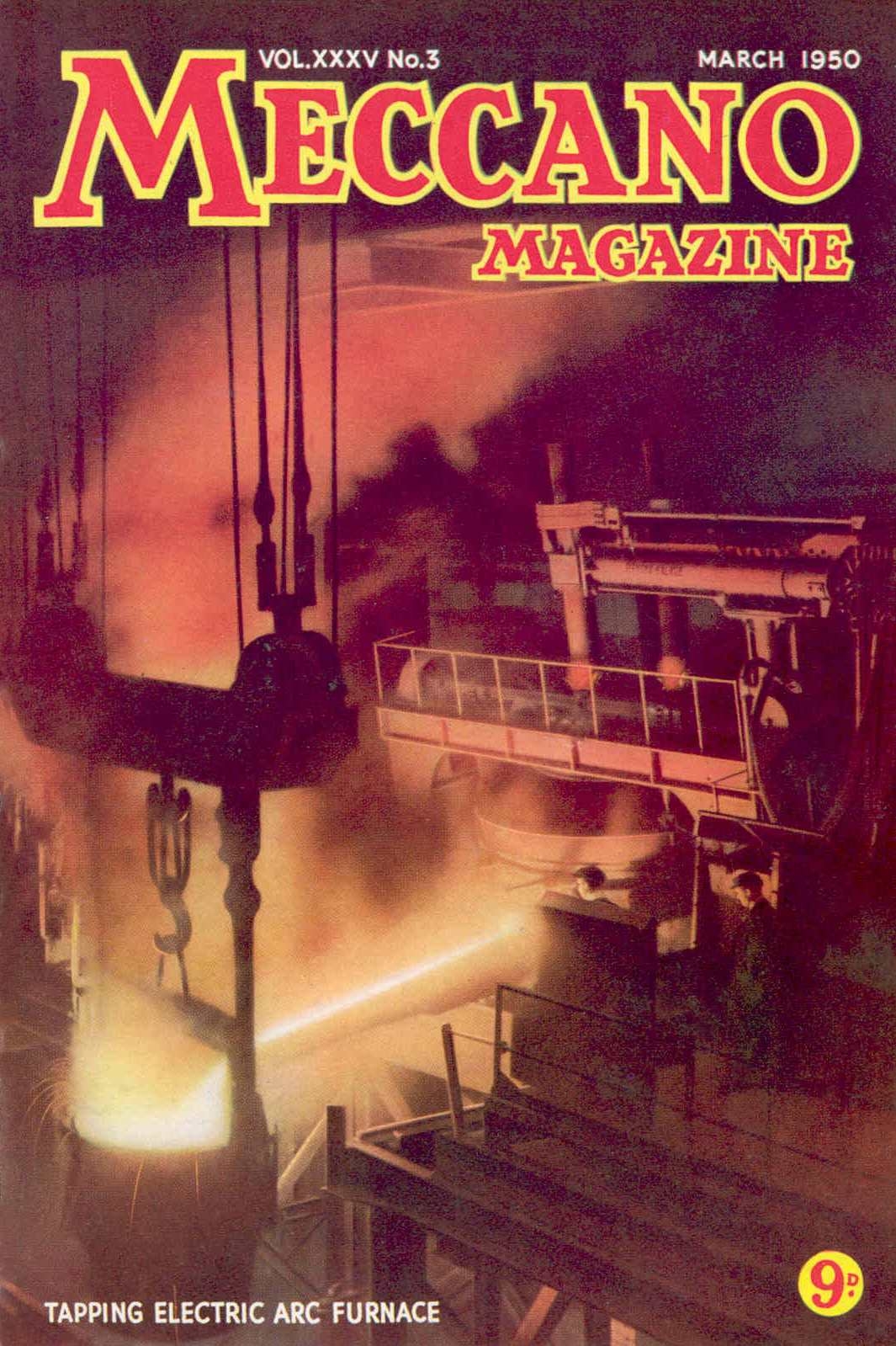 |
 |
 |
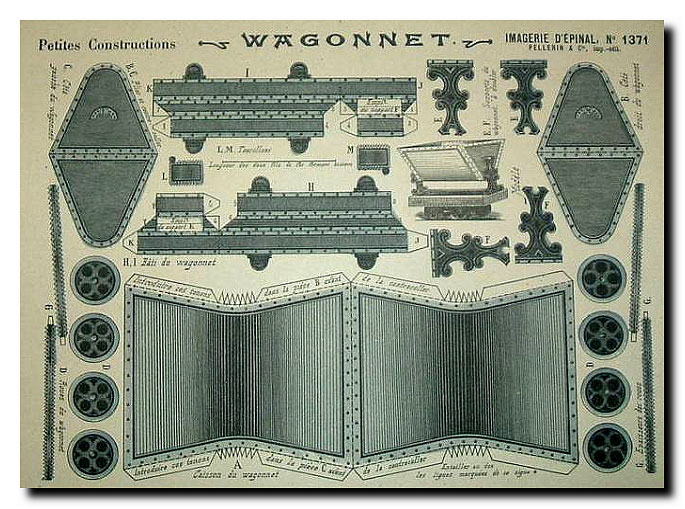

Le telphérage ou quand un jouet nous en apprend beaucoup !
Un jouet Brillié-Radiguet de 1895, le chemin de fer magnéto-électrique aérien
En découvrant le (beau) jouet de Brillié, vendu chez Radiguet à Paris dans les années 1880, nous ne pensions pas découvrir fondamentalement quelque chose de très nouveau ! Et pourtant !
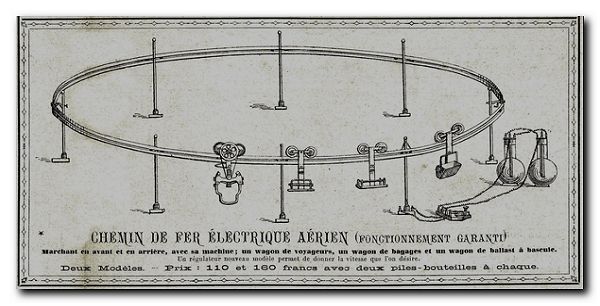
◄ in Le Paradis des enfants
(col. G. Vigneau, CFE)
Lorsqu'en
1911 le chemin de fer aérien du causse prenait son envol, il y avait
déjà quelques jouets pour permettre aux petites mains de faire comme
les grands, circuler dans le wagonnet par exemple. La maison Radiguet,
qui traversa tout le dix-neuvième siècle avec ses instruments d'optique
et d'électricité, avait à son catalogue de 1895, Prix-courant
illustré des appareils électriques quelques jouets. Un chemin de
fer magnéto-électrique terrestre (sic) est proposé à 60 francs. La
grande boîte est à 90 francs. La pile du jouet fait appel au
bichromate de potassium, permettant au passage une belle leçon de
chimie par l'usage d'eau bouillante, de bichromate et d'acide
sulfurique pour animer le tout, produits tous trois comme chacun sait à
mettre dans toutes les mains ! Mais il faut croire que les
installations de Bleichert et autres étaient bien d'actualité en cette
fin de siècle. Il y a en effet une page 121 du document qui présente le
chemin de fer magnéto-électrique aérien cette fois. La boîte riche et
gainée vaut 95 francs. Pour avoir les trois wagons, celui de
marchandises, celui de voyageurs (mais oui !) et le wagon déverseur, ce
sera 130 francs. Dans les deux cas le moteur aérien très astucieux est
fourni : il prend le courant par les deux rails aériens, placés
l'un au dessous de l'autre. C'est assurément un très beau jouet qui a
du faire des heureux ! Mettre par exemple les personnages dans le wagon
déverseur ?
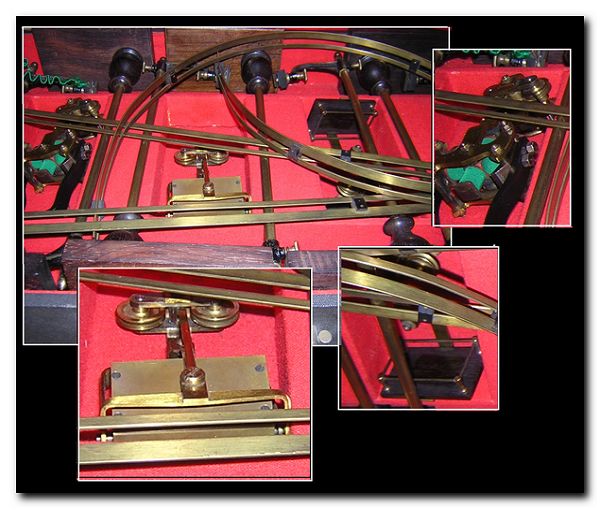
un très beau et rare coffret du jouet
Brillie Radiguet, construction soignée et matériaux nobles
Le principe du jouet est donc de faire mouvoir sur des rails aériens un moteur électrique, la locomotive, tirant des wagonnets de formes variées et adaptées au problème à résoudre : plateaux pour charges ou voyageurs, avec rampe de protection dans ce cas ( ! ), ou wagonnets basculeurs en tous points semblables à ceux de nos chemins de fer aériens. Les rails servent donc ici de conducteurs pour fournir l’énergie nécessaire au wagonnet moteur.
Ces jouets ne sont pas copiés des installations en service à cette époque de chemins aériens. Le principe est totalement différent. Le concepteur du jouet, Brillié, bien connu pour ses horloges de gare par exemple, avait dit-on trouvé son inspiration dans le système de Jenkin et le chemin de fer monorail Lartigue. Si la parenté avec le procédé Jenkin est évidente, il est plus difficile cependant de faire le rapprochement avec le monorail Lartigue, qui ne fut d’ailleurs pas une grande réussite.
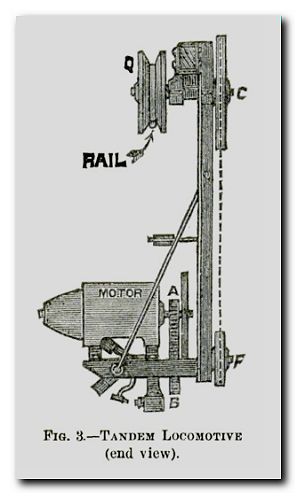
Pour les chemins aériens, un câble mobile se charge de faire mouvoir les charges. Dans le cas du jouet, le câble, barre ou rail, est parfaitement fixe. Il satisfait à deux fonctions : porteur, en permettant le roulement des wagonnets, et conducteur en laissant passer le courant électrique destiné au moteur mobile, la locomotive. Le système fut semble-t-il dû en partie à Flemming Jenkin, un anglais qui en déposa des brevets et fit de nombreux essais, et quelques réalisations, dont une au Pérou. C’était à la fin du siècle une application industrielle réussie de l’utilisation de l’énergie électrique, et un mariage tout aussi réussi de dynamo, moteur et mécanique. La première installation fut en service le 17 octobre 1885.
Ce jouet reprenant donc un système industriel novateur, et copiant dans pratiquement tous les détails son grand frère, copiait en fait un telphérage, nom français quelque peu barbare donné par Jenkin à son innovation, ou telpherage en anglais. On peut également trouver téléphérage, mais plus rarement. Les revues consacrées à l’électricité vont publier vers 1884 quelques articles sur le procédé, après les premières conférences que Jenkin va consacrer à son invention. Une Telpherage Company sera d’ailleurs créée.
Jenkin, après les premiers essais, va proposer de
multiples perfectionnements, des aiguillages….La complexité alors obtenue du système a peut-être
d’ailleurs été le début de la fin. Apparu
vers 1885, le telphérage ne sera plus en action vers 1920 : trente
ans de tâtonnements, mais d’installations
parfaitement opérationnelles également. Conçu pour des transports à
petite vitesse et bon marché des minéraux et autres marchandises, les
supports étaient espacés de
Nous n'allons pas ici entrer dans les détails de ces installations. Mais pour une bonne compréhension du sujet, et du jouet,précisons donc :
- la tension en service fournie par une dynamo au sol était de l'ordre de 500 volts ; nous sommes évidemment en courant continu.
-la dynamo est entraînée par une machine à vapeur
-parmi les avantages mentionnés, figurent le coût réduit, le passage facile sur des terrains accidentés ou au dessus des champs et pâturages
- possibilité d'utiliser la ligne comme source d'énergie : il suffit de se brancher dessus !
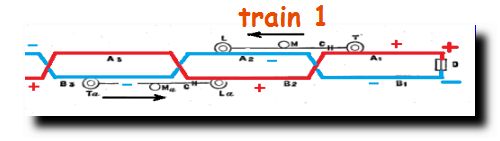
Pour ce qui est du fonctionnement de ces trains, le schéma montre une disposition de la ligne électrique, qui présente une succession de segments aux potentiels opposés. Les roues isolées extrèmes du train prennent donc le courant sur deux sections différentes, et ....le tout fonctionne ! Le mouvement du moteur de la locomotive (dynamo sur le schéma) est transmis à un système de galets qui par frottement viennent prendre appui sur le rail. La première version ci-dessous est différente dans son principe.
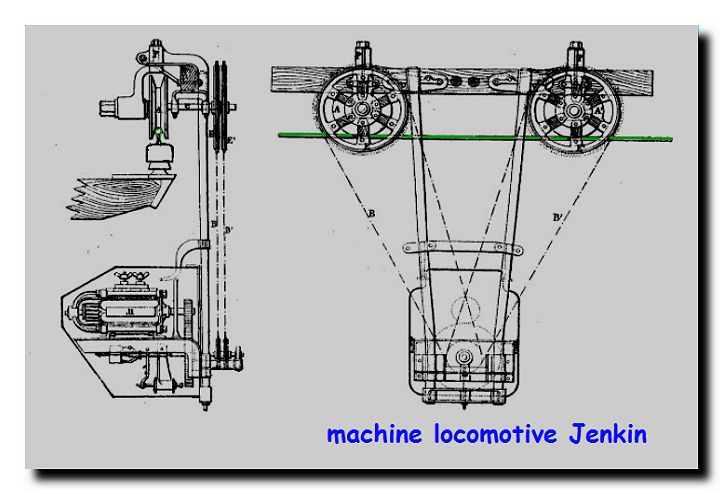
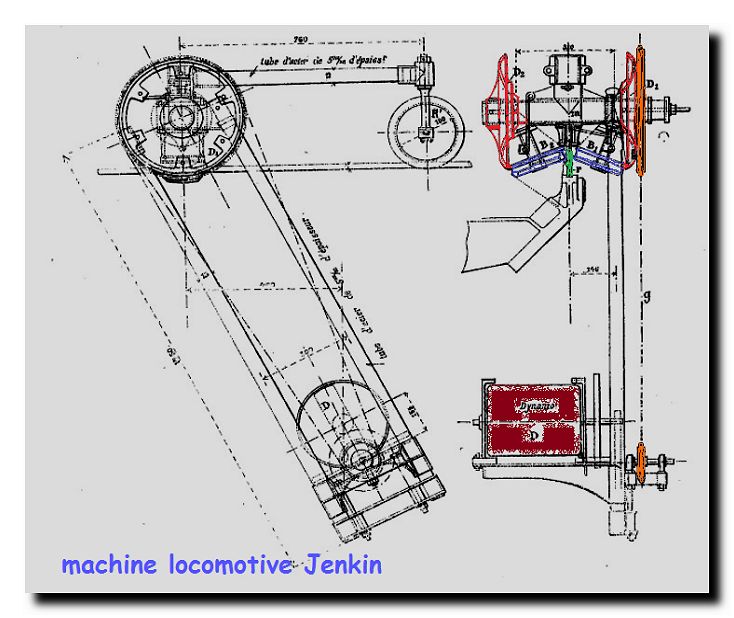
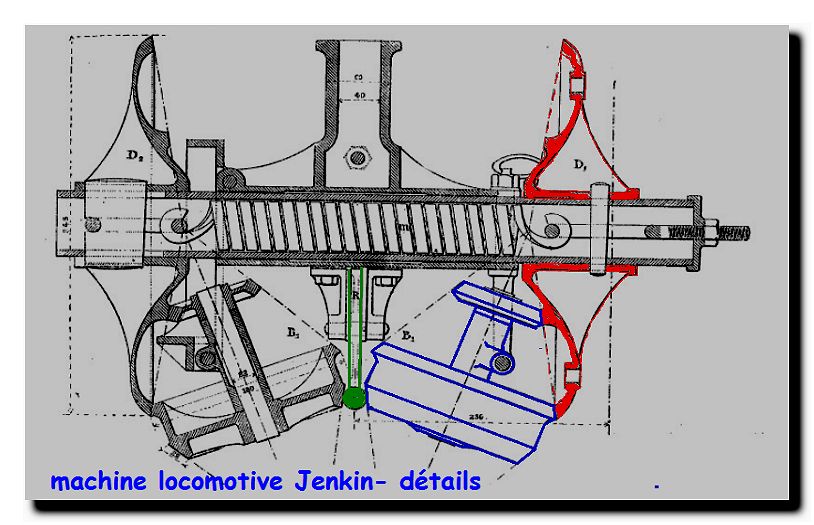
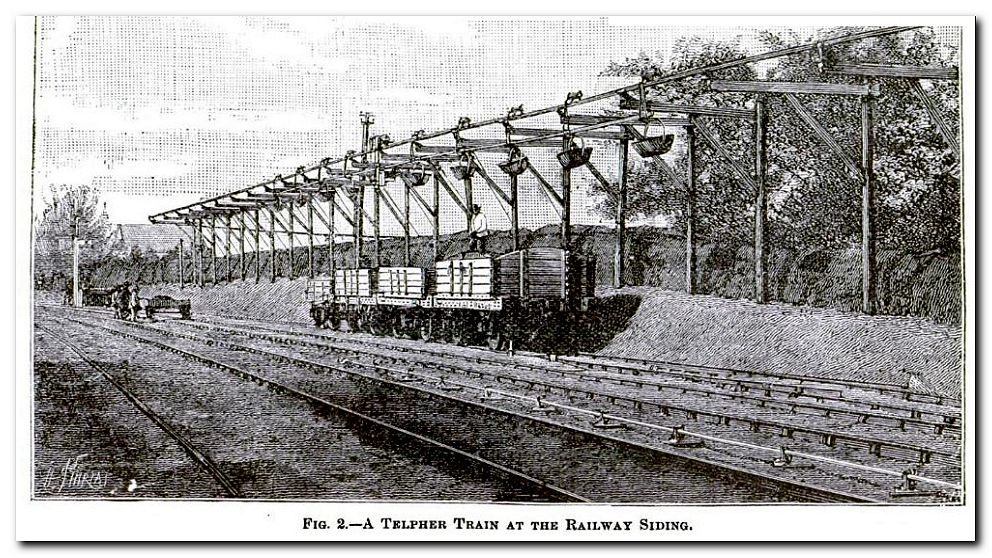
Bien que produit certainement à peu d’exemplaires, il
existe plusieurs versions de ce jouet, qui diffèrent par des points de
détails. Cela peut s’expliquer par la construction artisanale du jouet,
construction très soignée. La hauteur des
pylônes est de l’ordre de

Ce rapide écho d’une technique curieuse, mais qui avait l’énorme intérêt d’avoir été expérimentée, trouve son origine dans l’article de Guy Vigneau, paru dans le bulletin du CFE 105 de juin 2012, consacré aux premières sources d’énergie électrique pour trains jouets. Le Cercle Ferroviphile Européen (www.trainjouet.com, www.club-cfe.com, www.trainjouet.net) regroupe, comme son nom l’indique, les passionnés de trains jouets. Nous remercions nos collègues du CFE G. Vigneau pour ses gravures du jouet, et J.F. Guy, autre ferroviphile du CFE, pour ses belles photos du jouet Brillié-Radiguet.
Popular Science (vol 37, n°22, juillet 1890, p. 382), lisible sur Google Books a publié un article très complet sur le Telpherage, Telpherage in practical use. On lira également avec profit les références de La Lumière Electrique, sur le site du Cnum (Arts et Métiers).
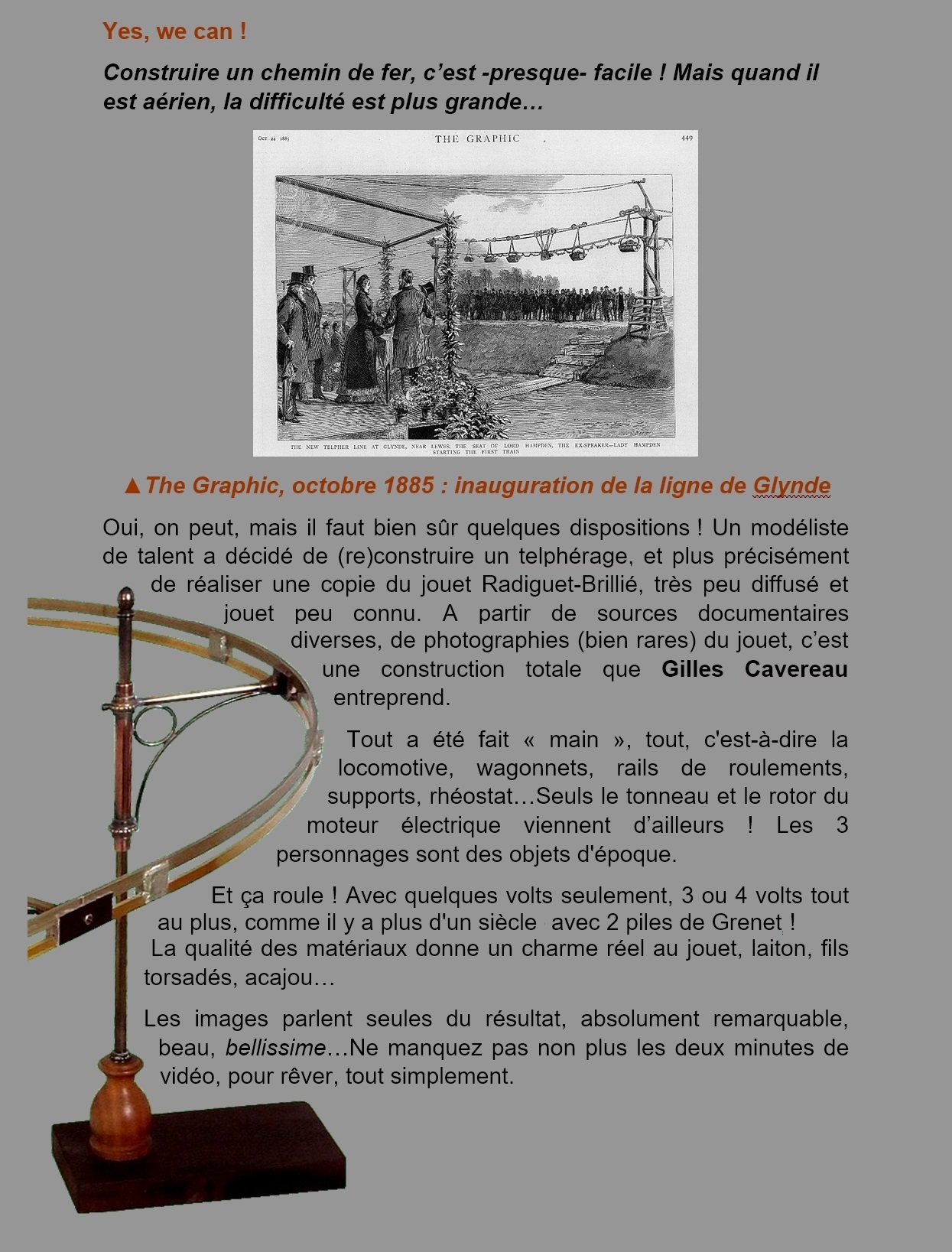
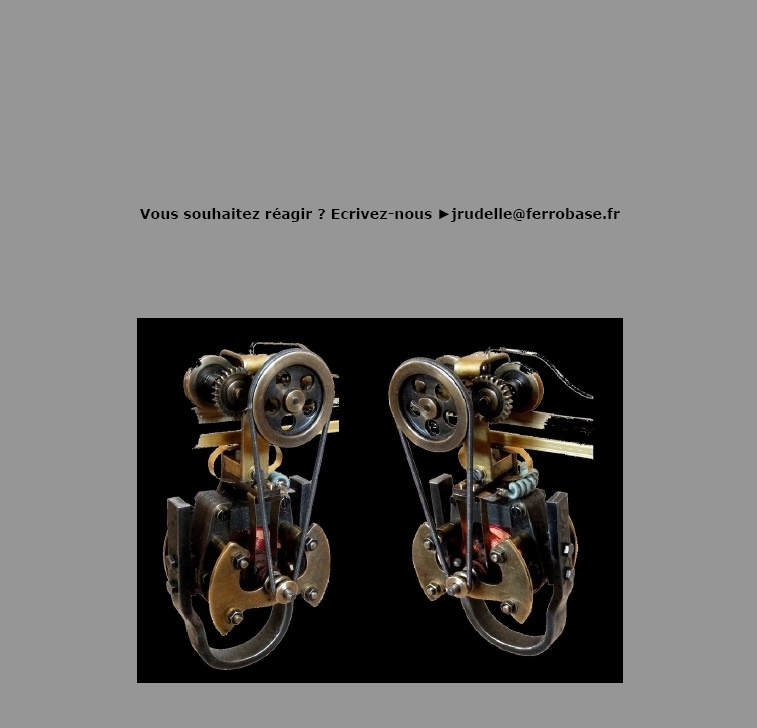

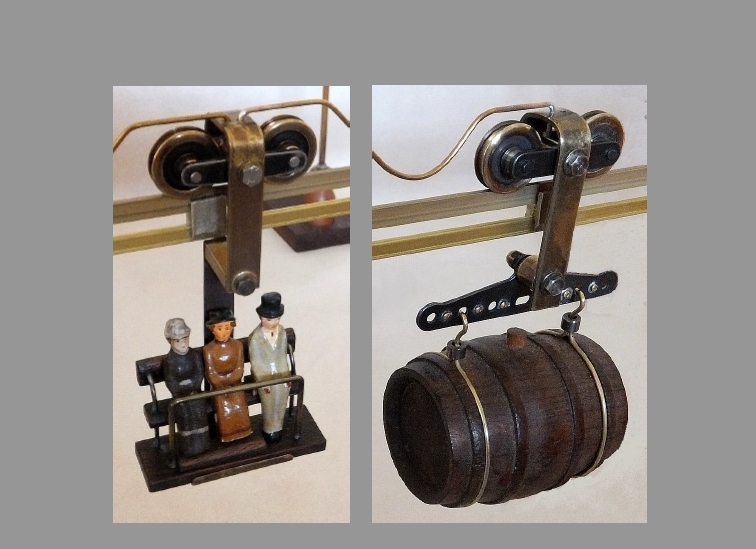
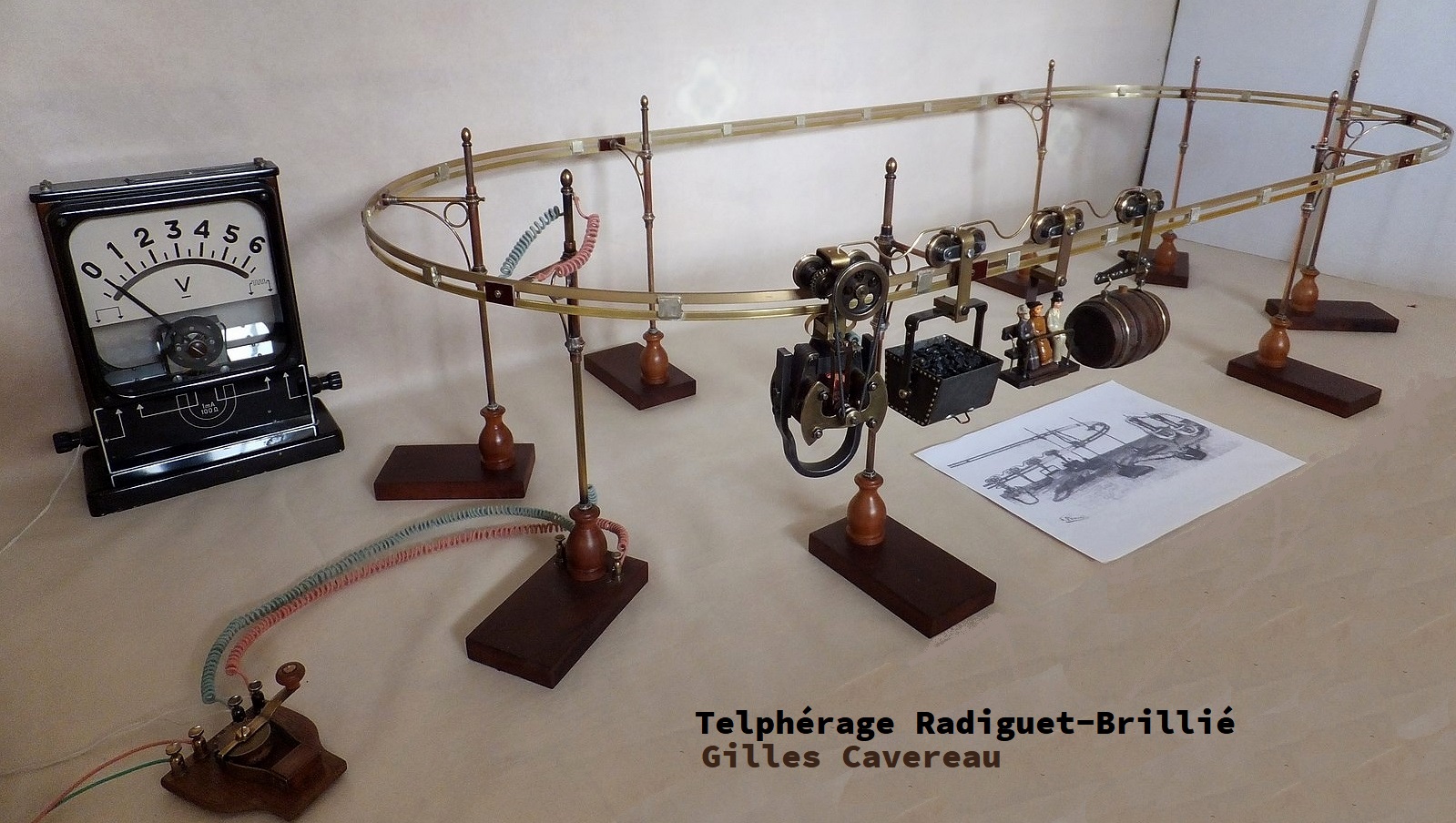
► un clic ici, et deux minutes pour rêver ◄
https://www.youtube.com/watch?v=sTT1N1eaHko

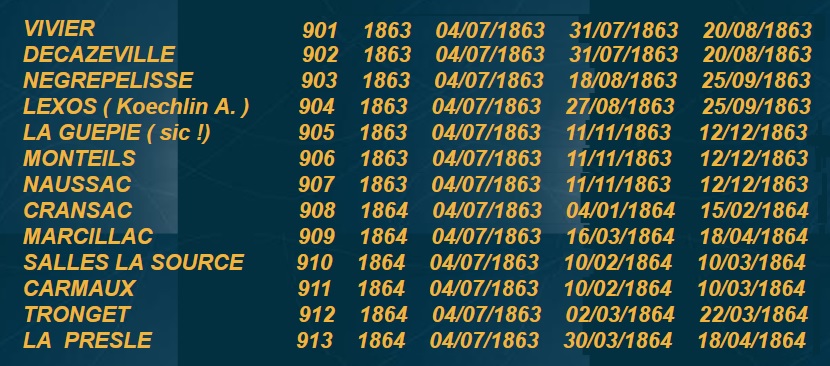


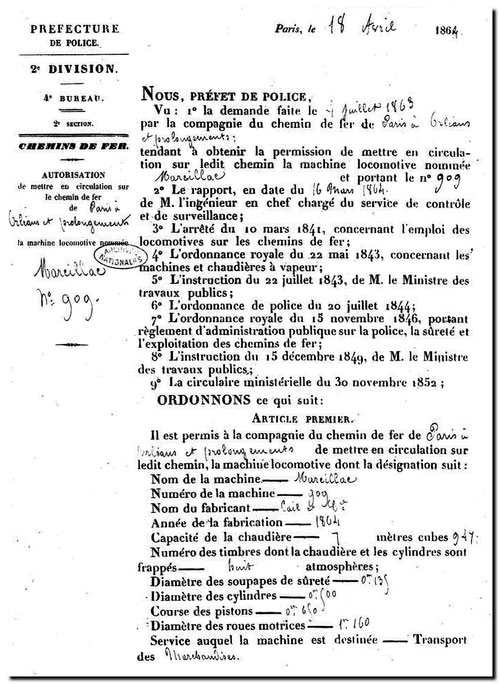
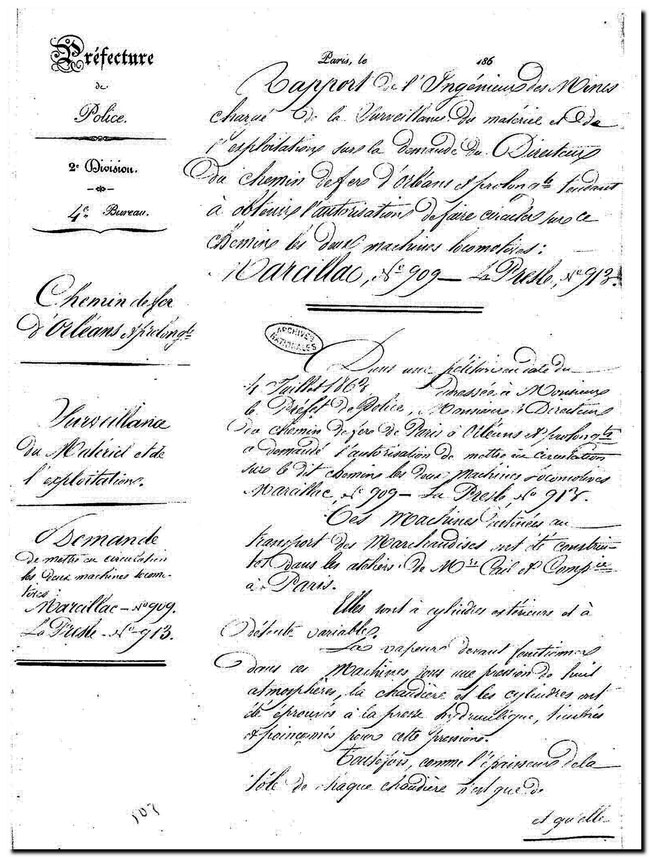 (re-sic)
(re-sic)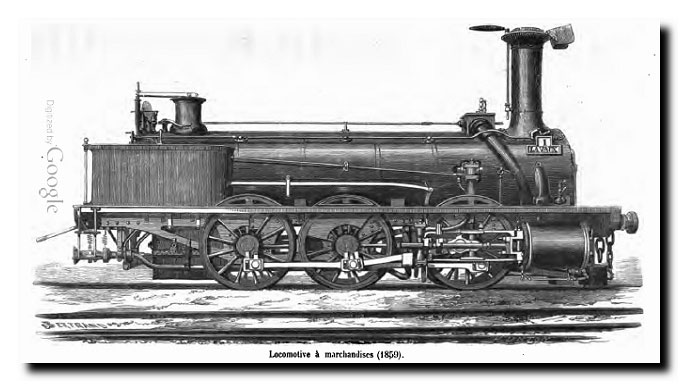
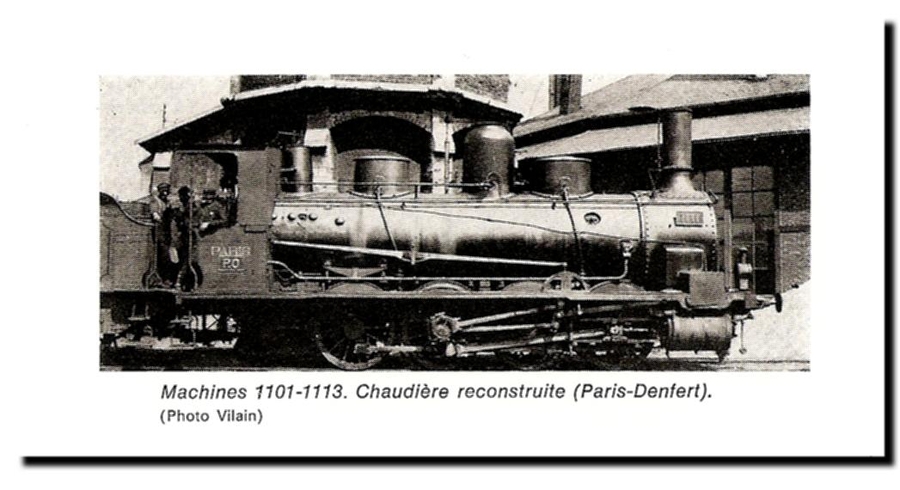
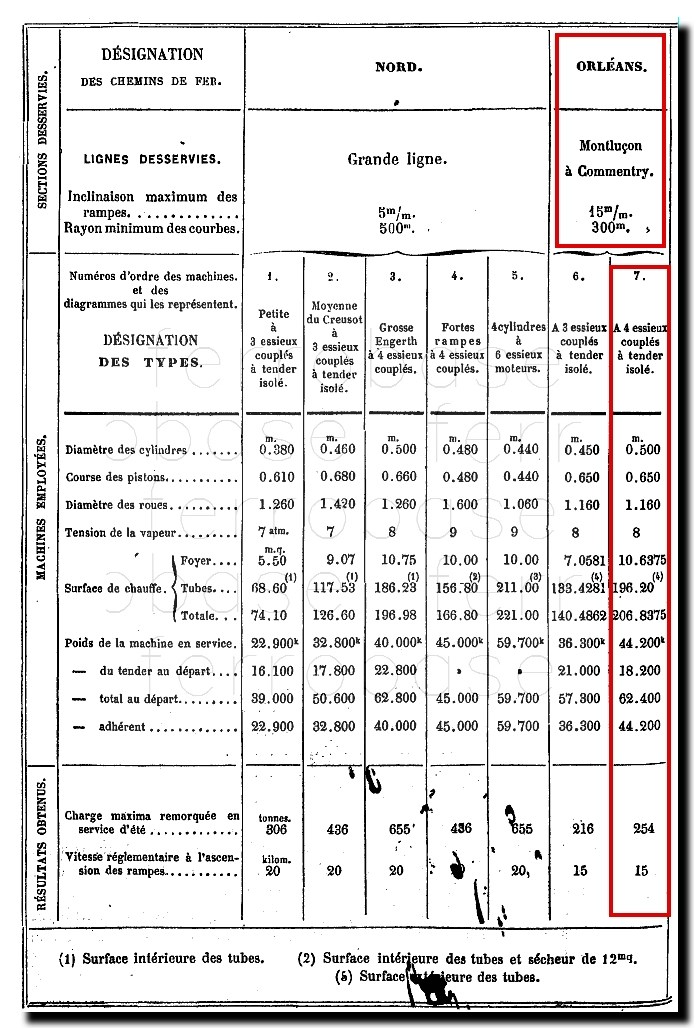
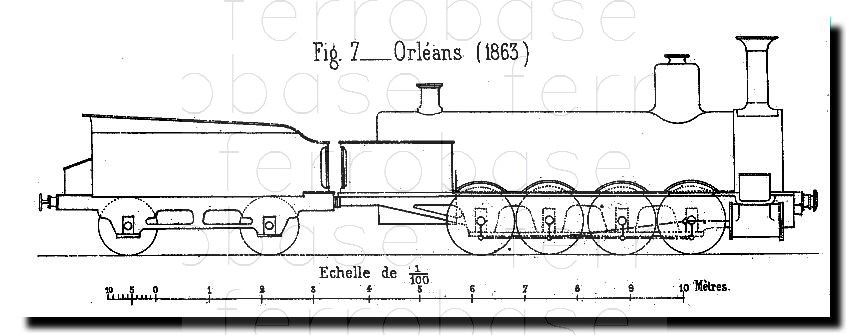
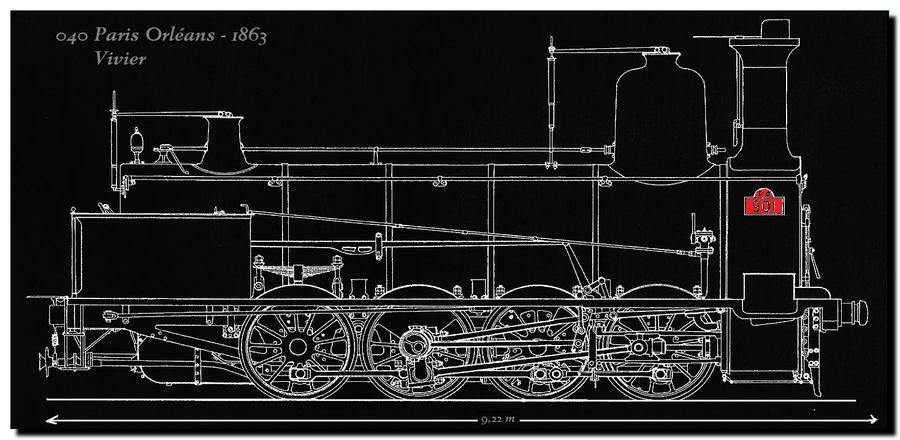
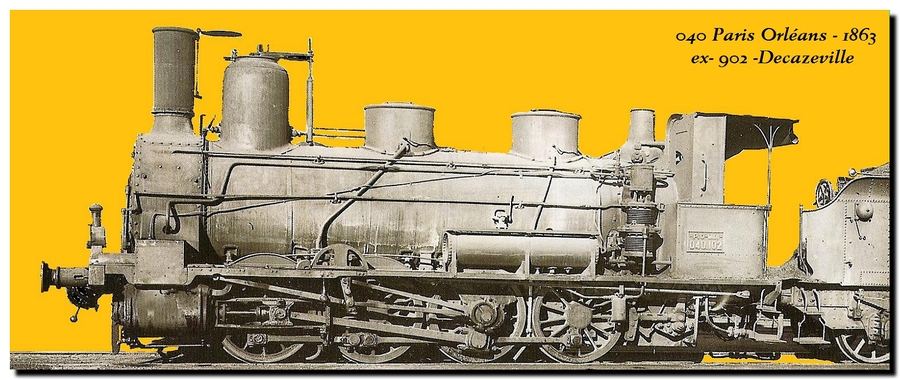
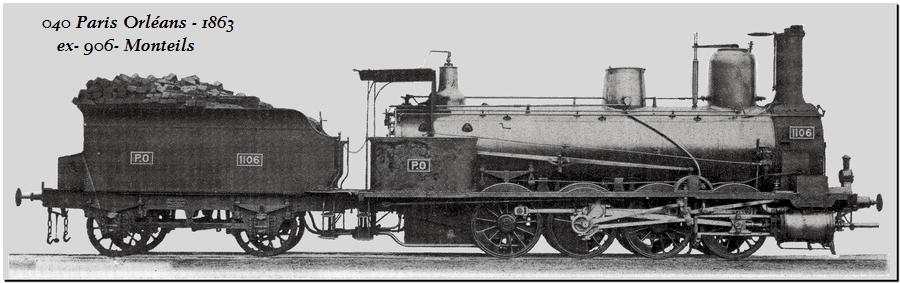
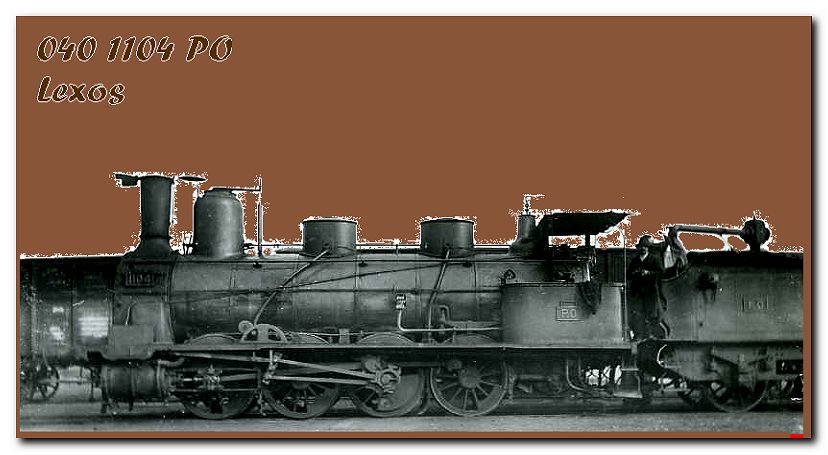

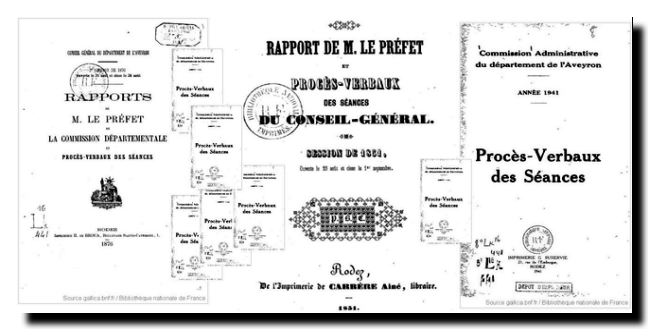 Long en effet : il s'étend du début du vingtième siècle à 1924, pour sa
période active. Vingt ans de rapports, discussions, projets,
délibérations, plans, et votes. Le seul problème de ce
travail effectif, c'est qu' il arrive un peu tard, et sera balayé par
la tourmente en 1914. Après la guerre, l'automobile aura fait son
apparition, et l'autocar va rapidement prendre le dessus. Des centaines
de pages ont été écrites par nos élus, et quelques francs dépensés en
études diverses. Ceux qui souhaitent connaître les détails de cette
réflexion pourront lire les rapports par eux -mêmes. Il n'y a pas
d'images ni de cartes, mais beaucoup de textes et de discours. Dans ces
textes, les préoccupations ont été celles que tous les départements ont
eues. Pourquoi un tel réseau, son utilité pour les cantons, pour le
département, pour les agriculteurs, pour les villes et villages...?
Tous les arguments possibles sont donnés, développés ou combattus
d'ailleurs! Au premier plan, il y a le budget d'une telle opération.
Pour l'Aveyron, le projet final, enfin le dernier proposé et non
réalisé, était estimé à 24.000.000 de francs en 1911. Pas
négligeable du tout pour les finances locales et les impôts qui en
découlent, mais apparemment pas irréaliste. Un certain consensus
s'était fait jour sur cette question financière, un pas important dans
la bonne direction. Il nous semble que les discussions ont plutôt
traîné sur le projet définitif à mettre en place. Les rapports montrent
à l'évidence une timidité, pour ne pas dire plus, et une réelle
impossibilité de conclure et de prendre une décision nette. Les
consultations sont multipliées, les demandes d'informations également.
C'est ainsi par exemple qu'on demandera leur avis à toutes les
communes, sans donner de détails précis des projets, et pour cause, car
il n'y en avait pas de détails à donner, faute d'accord des
conseillers. Les communes n'ont pas toutes parfaitement compris
le sens de la question...et puis certains conseillers ne cachent pas
que lorsqu'ils ont été élus, le problème des chemins de fer
départementaux ne se posait pas ; ils ne pensaient donc pas pouvoir
prendre position...
Long en effet : il s'étend du début du vingtième siècle à 1924, pour sa
période active. Vingt ans de rapports, discussions, projets,
délibérations, plans, et votes. Le seul problème de ce
travail effectif, c'est qu' il arrive un peu tard, et sera balayé par
la tourmente en 1914. Après la guerre, l'automobile aura fait son
apparition, et l'autocar va rapidement prendre le dessus. Des centaines
de pages ont été écrites par nos élus, et quelques francs dépensés en
études diverses. Ceux qui souhaitent connaître les détails de cette
réflexion pourront lire les rapports par eux -mêmes. Il n'y a pas
d'images ni de cartes, mais beaucoup de textes et de discours. Dans ces
textes, les préoccupations ont été celles que tous les départements ont
eues. Pourquoi un tel réseau, son utilité pour les cantons, pour le
département, pour les agriculteurs, pour les villes et villages...?
Tous les arguments possibles sont donnés, développés ou combattus
d'ailleurs! Au premier plan, il y a le budget d'une telle opération.
Pour l'Aveyron, le projet final, enfin le dernier proposé et non
réalisé, était estimé à 24.000.000 de francs en 1911. Pas
négligeable du tout pour les finances locales et les impôts qui en
découlent, mais apparemment pas irréaliste. Un certain consensus
s'était fait jour sur cette question financière, un pas important dans
la bonne direction. Il nous semble que les discussions ont plutôt
traîné sur le projet définitif à mettre en place. Les rapports montrent
à l'évidence une timidité, pour ne pas dire plus, et une réelle
impossibilité de conclure et de prendre une décision nette. Les
consultations sont multipliées, les demandes d'informations également.
C'est ainsi par exemple qu'on demandera leur avis à toutes les
communes, sans donner de détails précis des projets, et pour cause, car
il n'y en avait pas de détails à donner, faute d'accord des
conseillers. Les communes n'ont pas toutes parfaitement compris
le sens de la question...et puis certains conseillers ne cachent pas
que lorsqu'ils ont été élus, le problème des chemins de fer
départementaux ne se posait pas ; ils ne pensaient donc pas pouvoir
prendre position...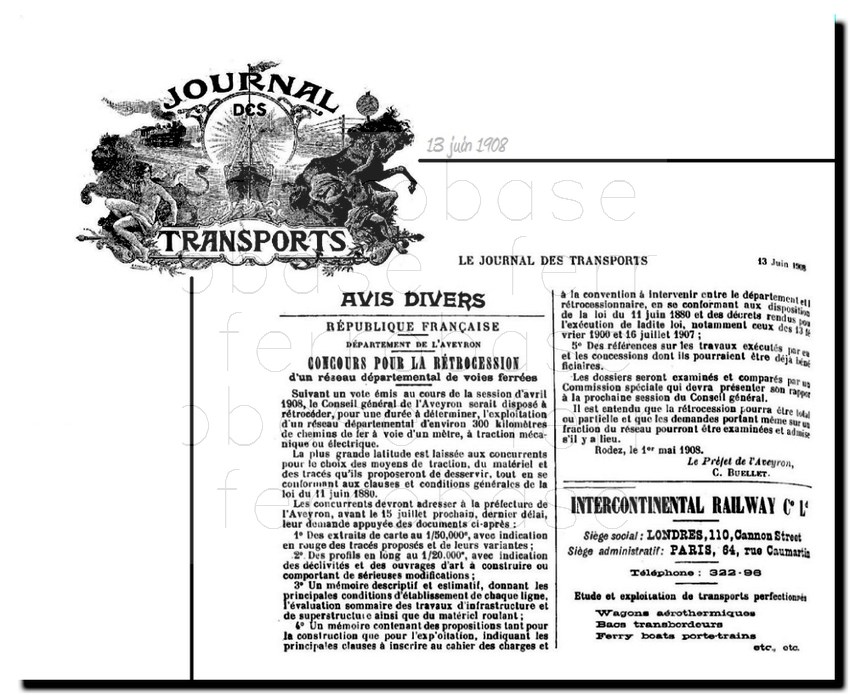
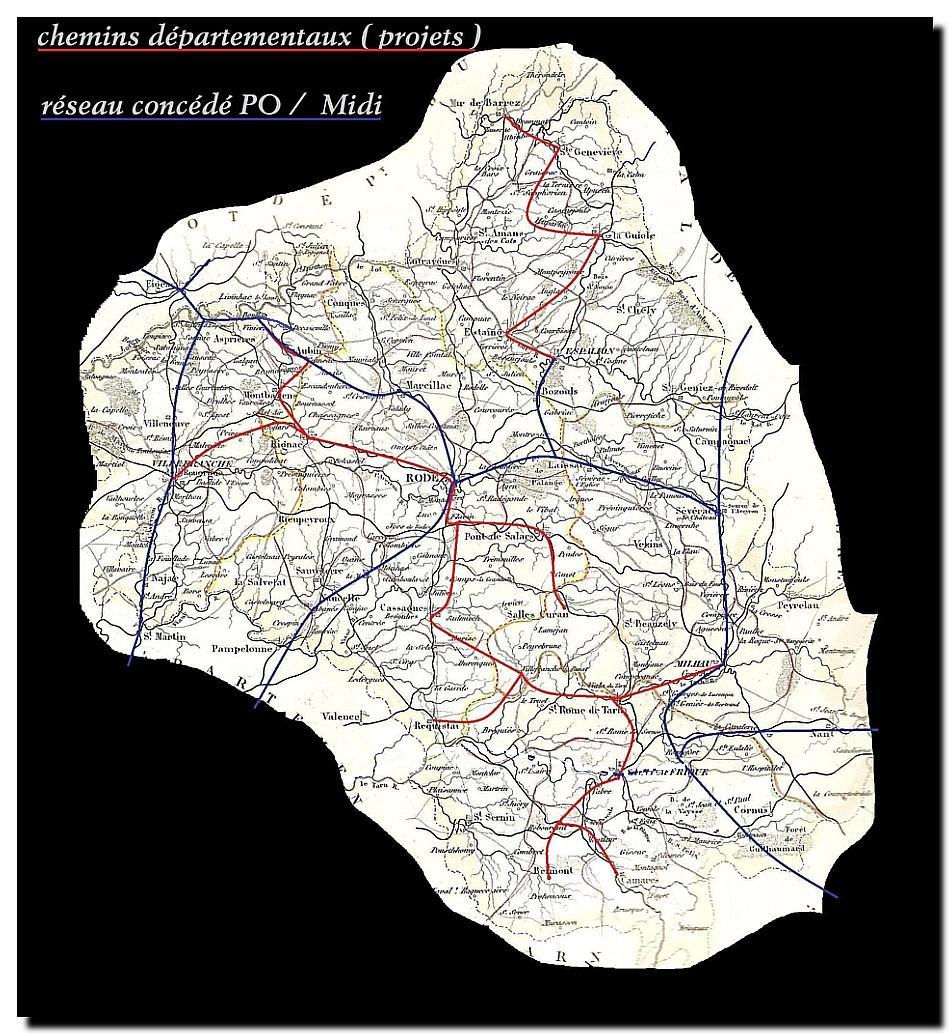
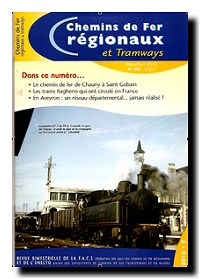
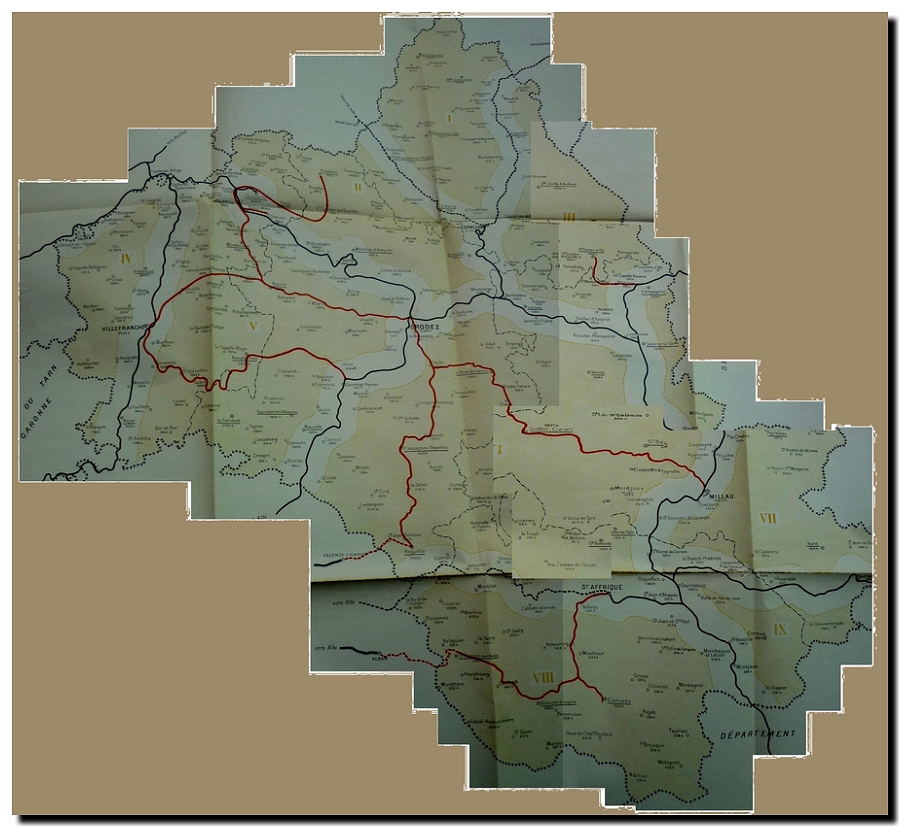
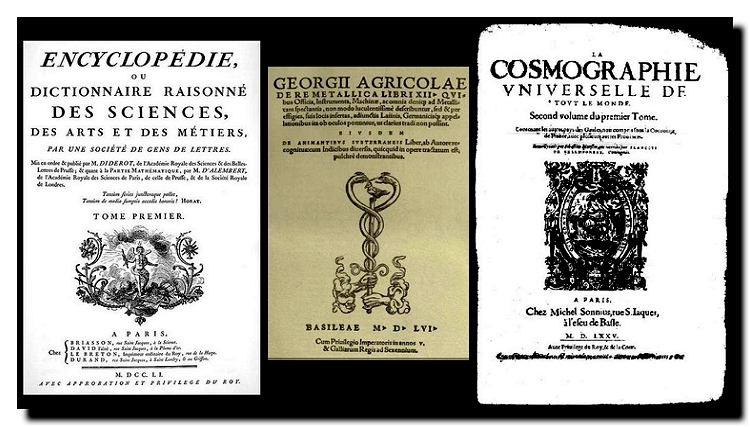
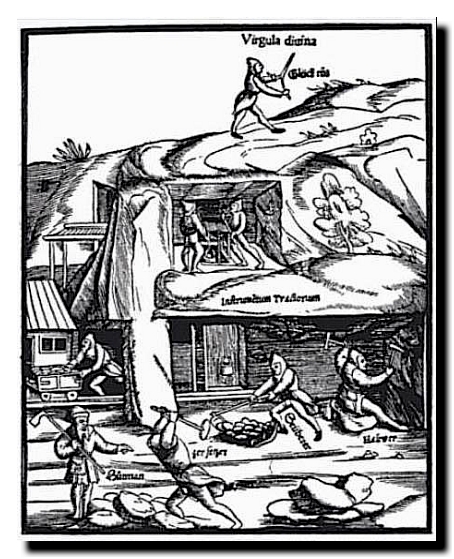
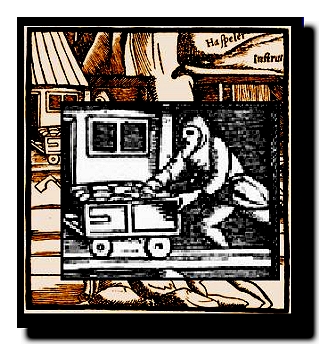

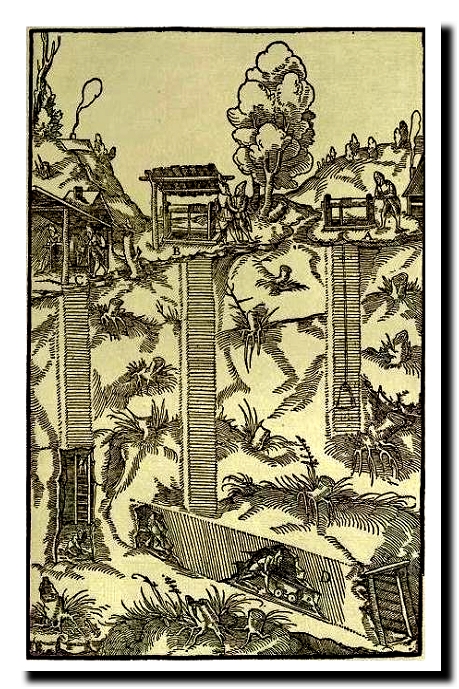 Une autre gravure montre en fond
de mine un chariot, mais ne roulant pas sur des voies en bois comme
dans le Munster. Il est curieux de constater que les voies en
bois, un principe à priori simple et évident, n'apparaît pas dans le de
re metallica. Agricola mit près d'un quart de siècle à écrire son
traité, et ne pouvait donc ignorer l'ouvrage de Munster paru en 1550.
Alors pourquoi pas de voies en planches ? Celles ci n'étaient peut être
pas aussi courantes que Munster ne l'évoque ? Bien possible, mais
il faut plaindre le mineur dans son dur labeur de pousseur, en fond de
mine, dans l'obscurité et l'humidité. Plusieurs planches du traité
montrent un tel chariot, mais toujours sans "rails". Sur ce
point Munster avait mis le doigt sur un détail plus fouillé. Par
contre, Agricola tend à l'exhaustivité avec une autre gravure.
Une autre gravure montre en fond
de mine un chariot, mais ne roulant pas sur des voies en bois comme
dans le Munster. Il est curieux de constater que les voies en
bois, un principe à priori simple et évident, n'apparaît pas dans le de
re metallica. Agricola mit près d'un quart de siècle à écrire son
traité, et ne pouvait donc ignorer l'ouvrage de Munster paru en 1550.
Alors pourquoi pas de voies en planches ? Celles ci n'étaient peut être
pas aussi courantes que Munster ne l'évoque ? Bien possible, mais
il faut plaindre le mineur dans son dur labeur de pousseur, en fond de
mine, dans l'obscurité et l'humidité. Plusieurs planches du traité
montrent un tel chariot, mais toujours sans "rails". Sur ce
point Munster avait mis le doigt sur un détail plus fouillé. Par
contre, Agricola tend à l'exhaustivité avec une autre gravure. 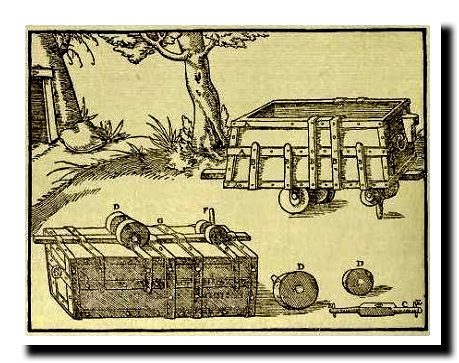
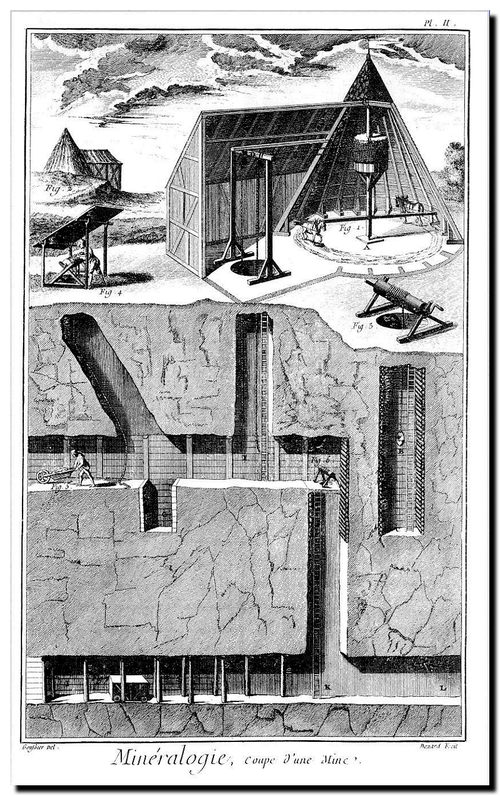 Partons vers le présent, deux siècles plus tard,
vers 1750 pour parcourir une autre somme, l'Encyclopédie, celle de
Diderot et d'Alembert, les deux principaux auteurs. Et disons le, une
grande déception. L'examen des 3192 planches montre en fait peu de
planches consacrées à notre thème, les mines. Et encore moins de
planches pour nous renseigner sur les transports. Nous avons seulement
déniché cette gravure. Le cheval, en surface, tourne dans son manège,
ce qui permet d'enrouler la corde qui va remonter le minerai. Mais pas
de détails de benne...Au dessous, dans la mine, la brouette est
similaire à celle de Munster, deux siècles plus tôt. Et tout en
bas, voilà notre chariot : très simplement représenté, trop simplement
figuré, un peu décevant ! Le dessinateur a vraiment dû
manquer de temps : l'intérieur du wagonnet n'est même pas évoqué,
un seul trait pourtant, et c'était bon ! Il doit bien transporter
le minerai ; alors comment va-t-il être remonté en surface ? Pas
de voies en planches pour faciliter le roulement, et arrivé en K, que
peut-il se passer ? Ce n'est pas le treuil, figure 6, qui va servir à
cette remontée ? Malgré tout le respect que nous avons bien sûr pour
Diderot et al, il faut bien constater que cette planche sensée nous
informer sur une coupe de mine, c'est son titre, est bien simple, pour
ne pas dire simpliste...Elle n'est pas très informative, mais elle
existe !
Partons vers le présent, deux siècles plus tard,
vers 1750 pour parcourir une autre somme, l'Encyclopédie, celle de
Diderot et d'Alembert, les deux principaux auteurs. Et disons le, une
grande déception. L'examen des 3192 planches montre en fait peu de
planches consacrées à notre thème, les mines. Et encore moins de
planches pour nous renseigner sur les transports. Nous avons seulement
déniché cette gravure. Le cheval, en surface, tourne dans son manège,
ce qui permet d'enrouler la corde qui va remonter le minerai. Mais pas
de détails de benne...Au dessous, dans la mine, la brouette est
similaire à celle de Munster, deux siècles plus tôt. Et tout en
bas, voilà notre chariot : très simplement représenté, trop simplement
figuré, un peu décevant ! Le dessinateur a vraiment dû
manquer de temps : l'intérieur du wagonnet n'est même pas évoqué,
un seul trait pourtant, et c'était bon ! Il doit bien transporter
le minerai ; alors comment va-t-il être remonté en surface ? Pas
de voies en planches pour faciliter le roulement, et arrivé en K, que
peut-il se passer ? Ce n'est pas le treuil, figure 6, qui va servir à
cette remontée ? Malgré tout le respect que nous avons bien sûr pour
Diderot et al, il faut bien constater que cette planche sensée nous
informer sur une coupe de mine, c'est son titre, est bien simple, pour
ne pas dire simpliste...Elle n'est pas très informative, mais elle
existe ! 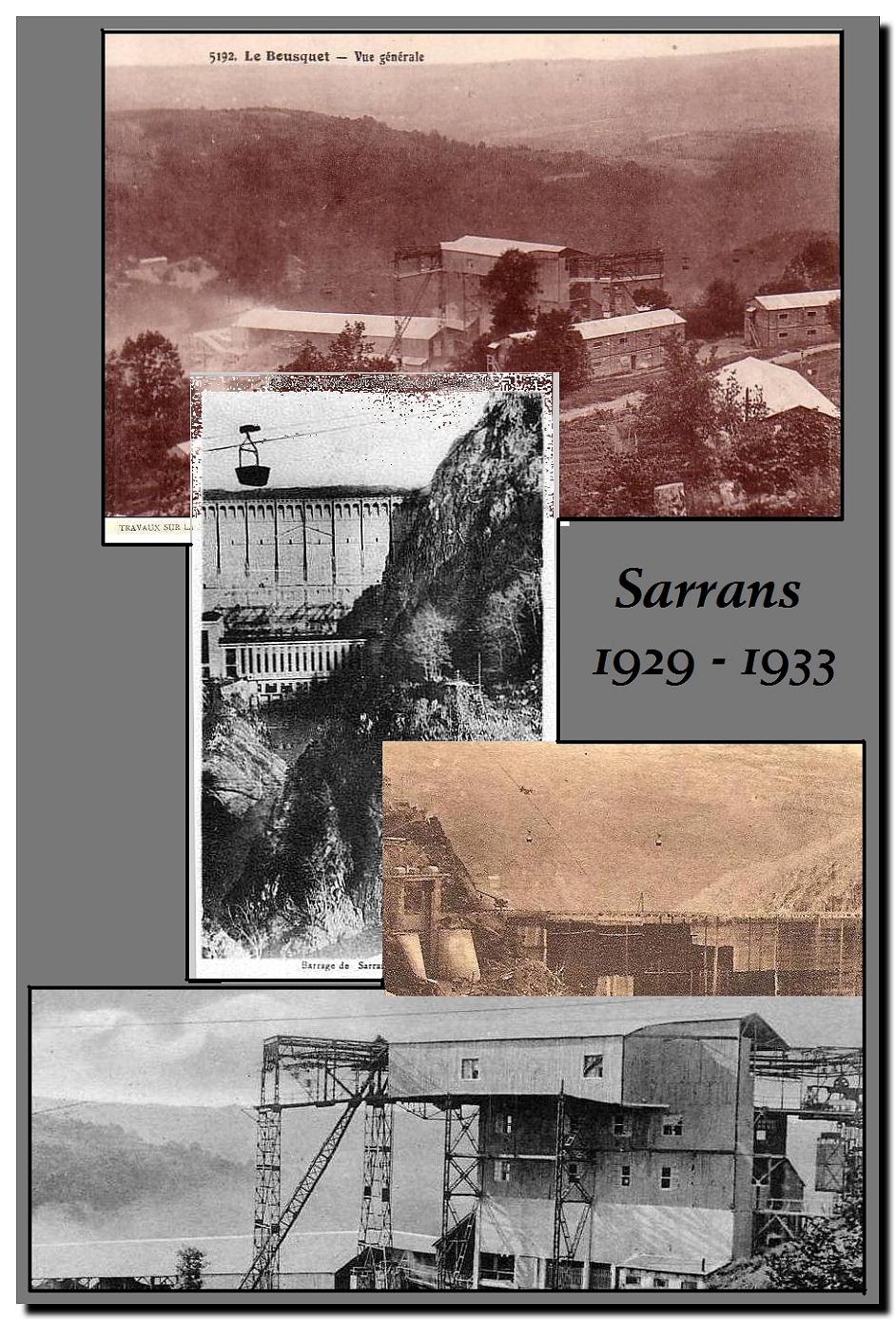
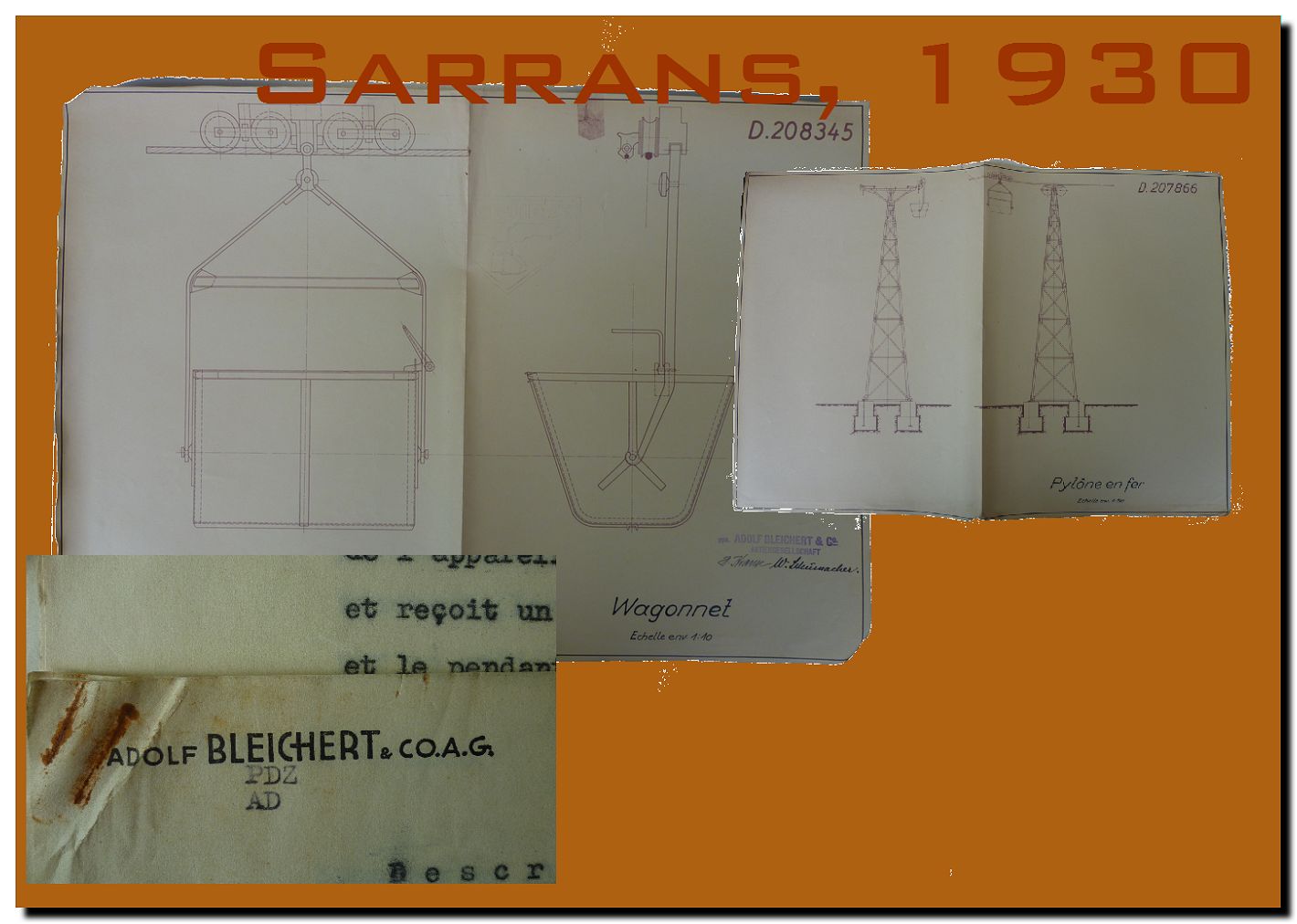
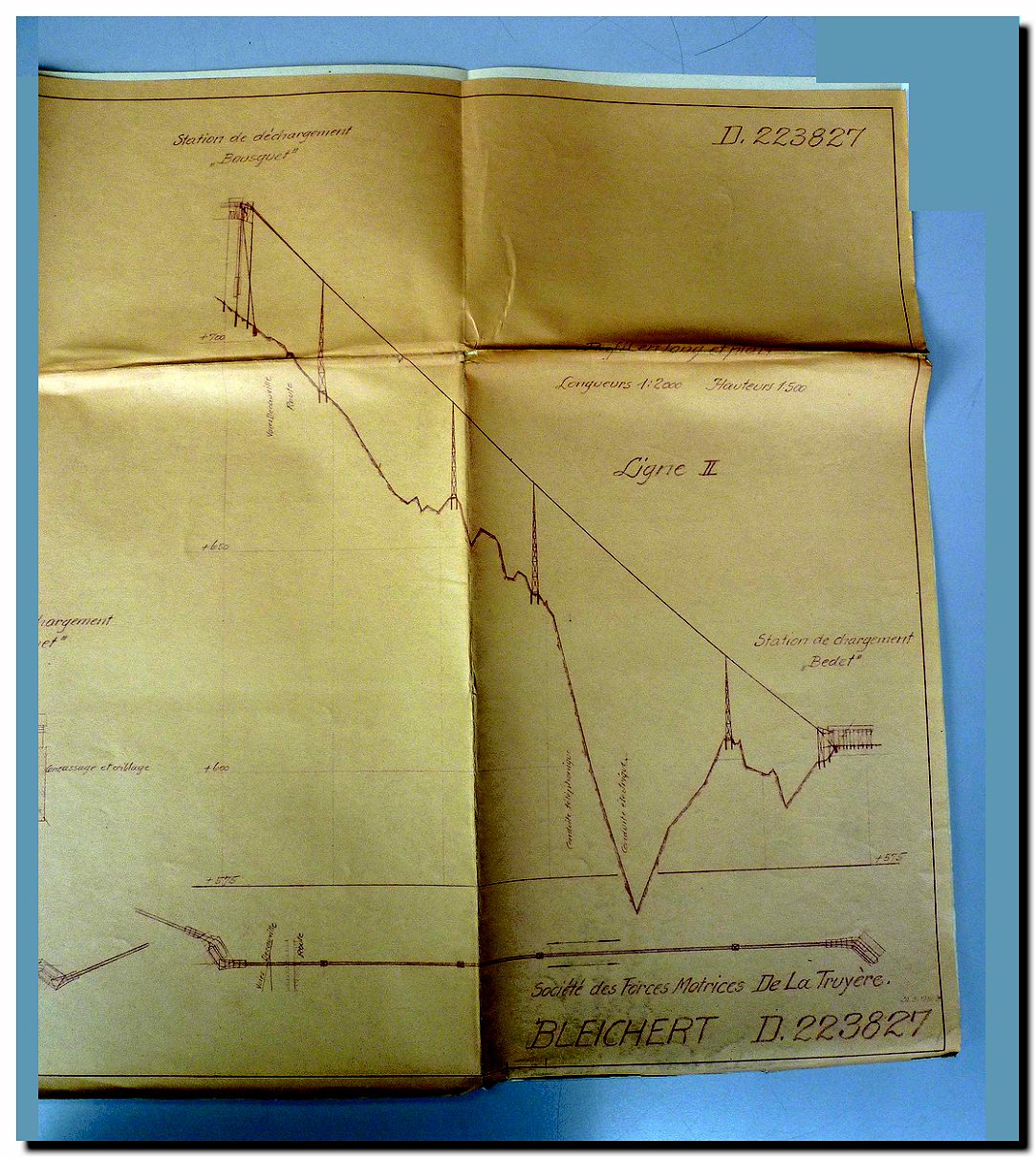
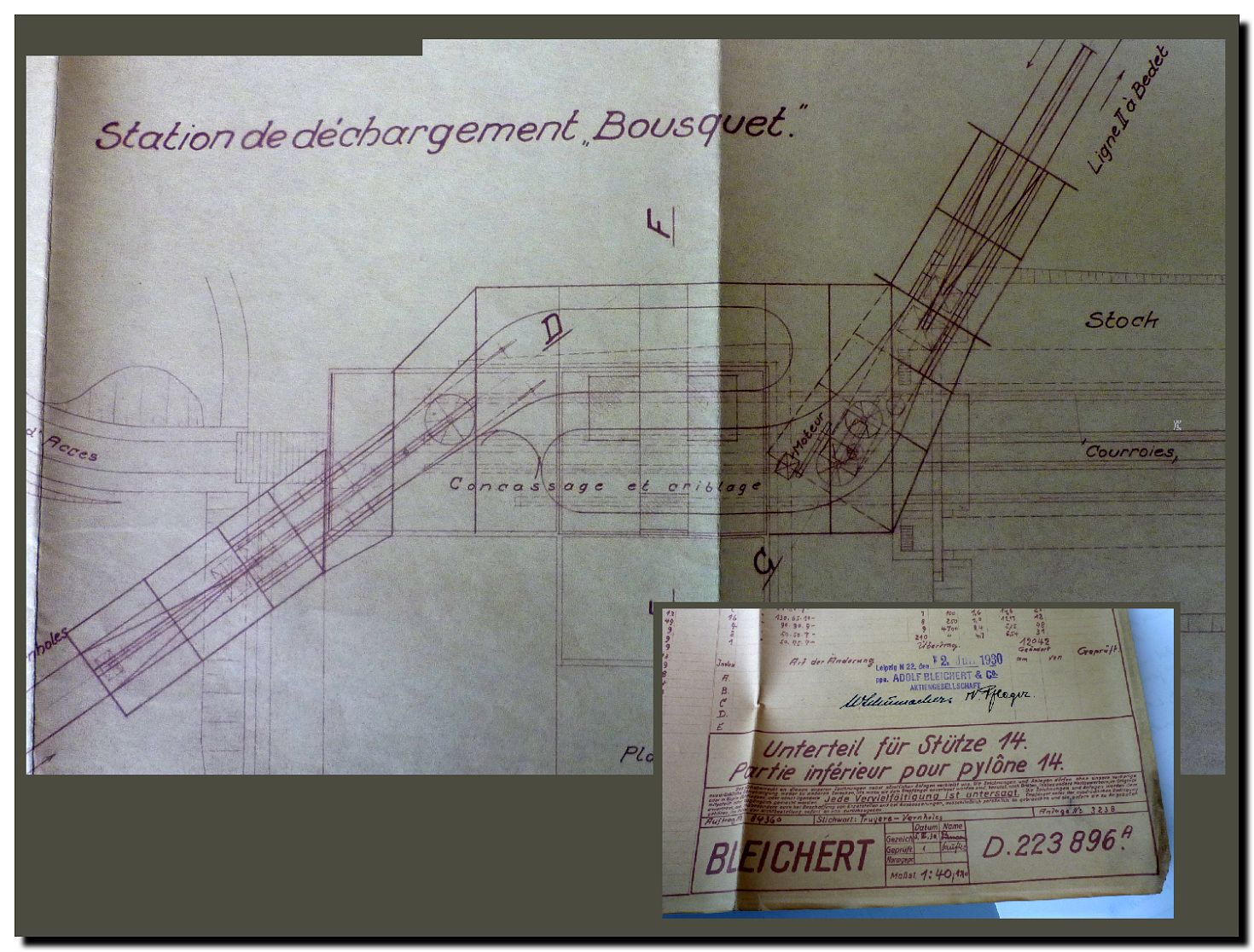

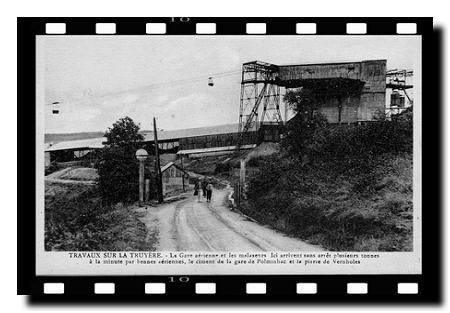
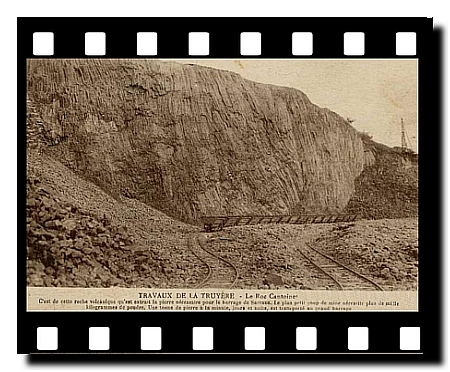
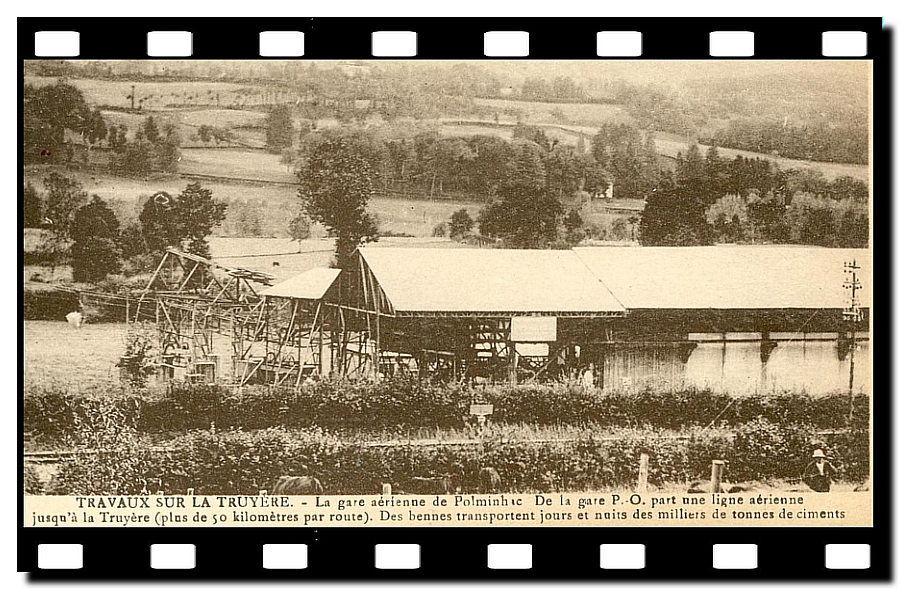

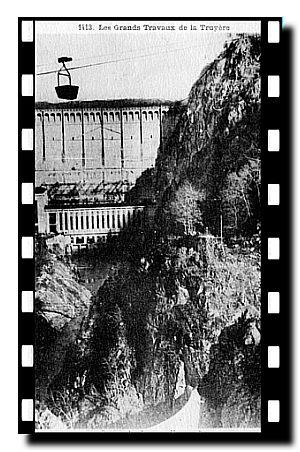
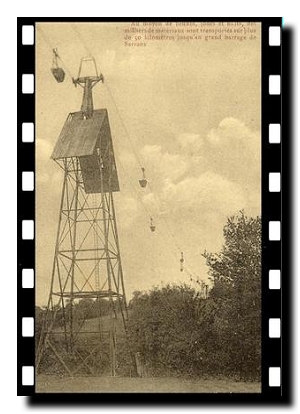
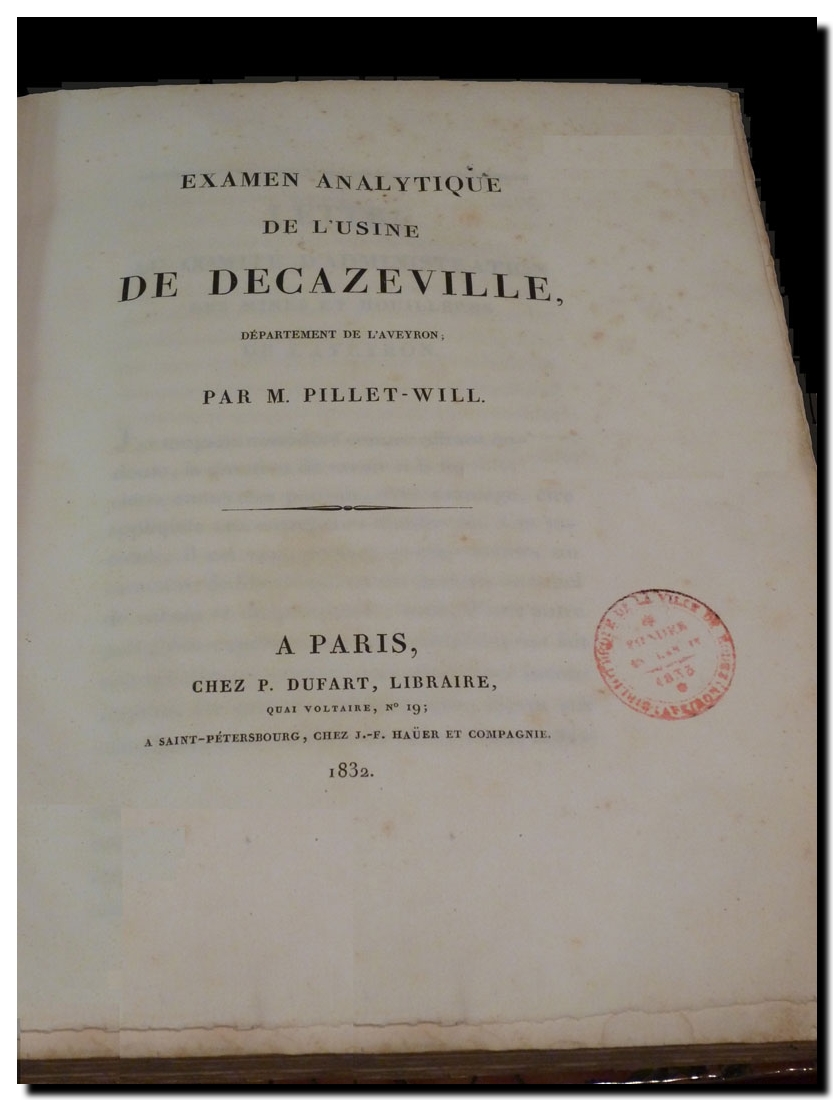
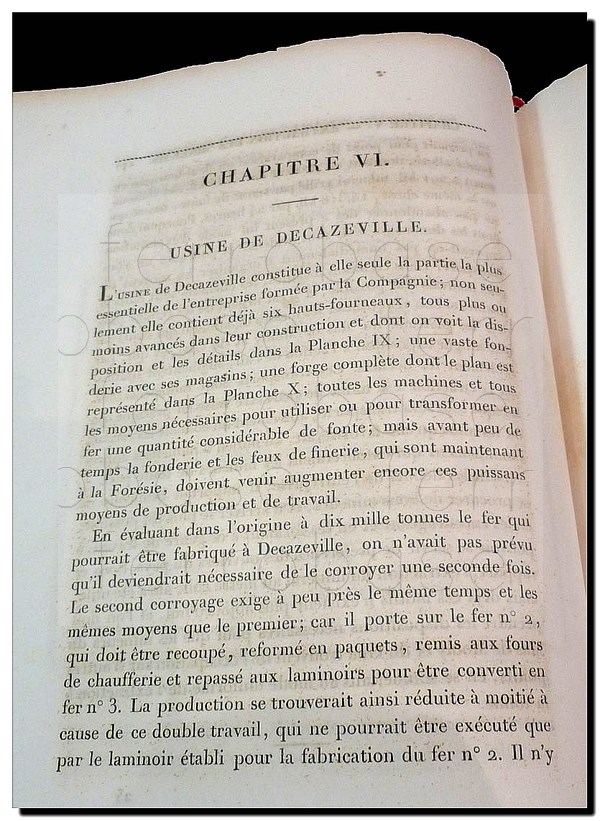
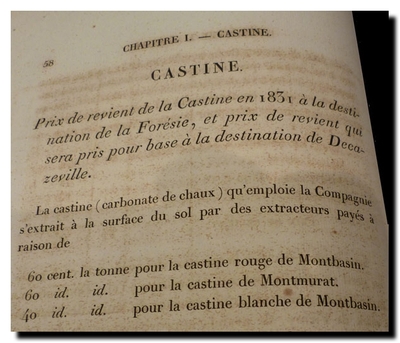
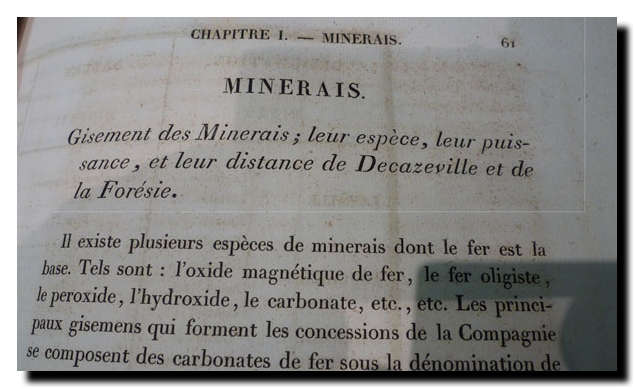
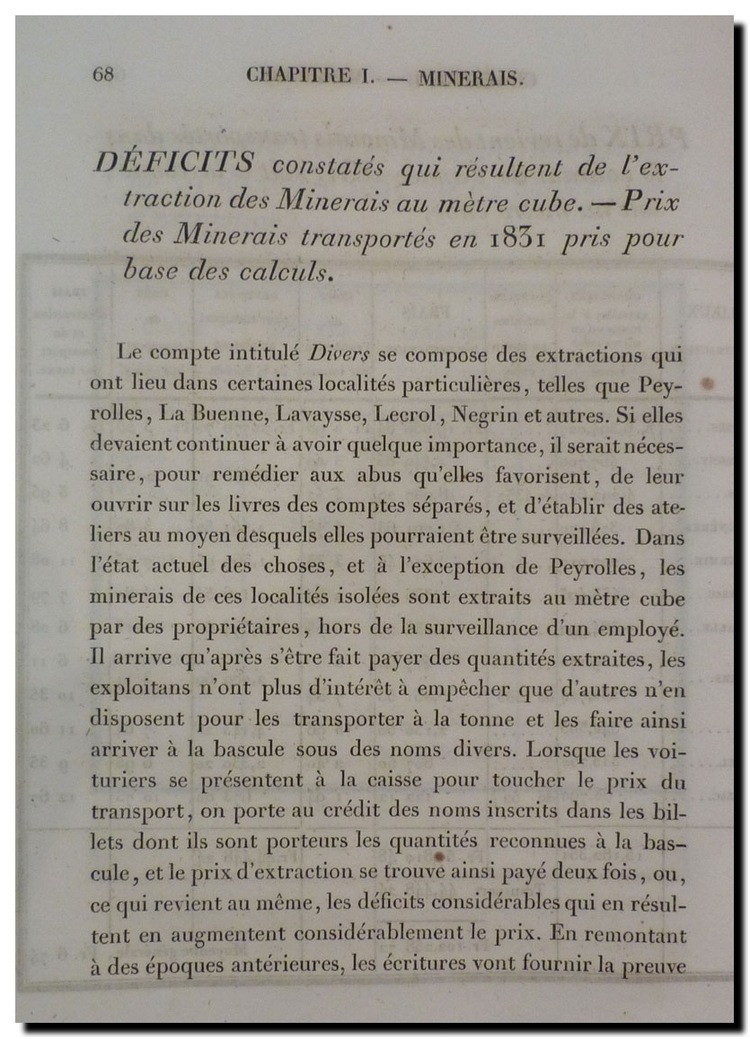
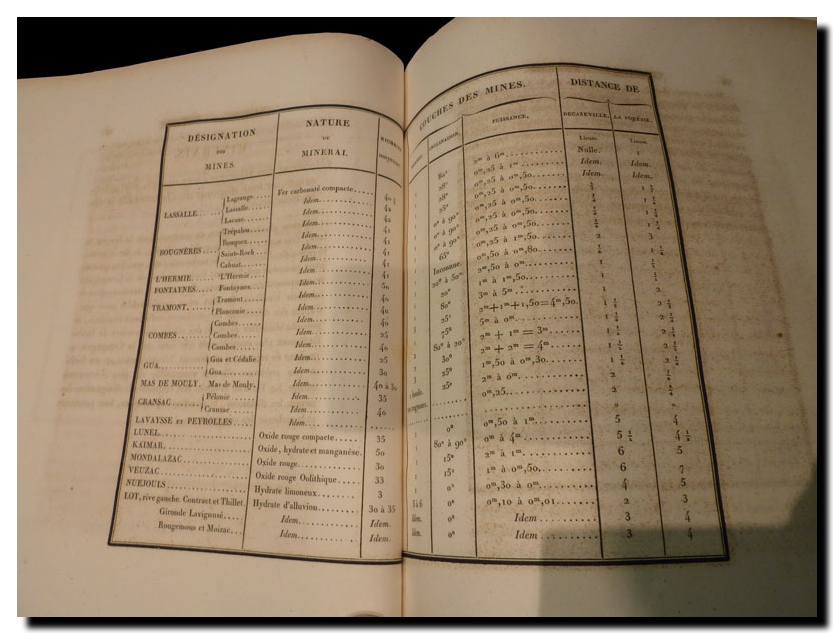
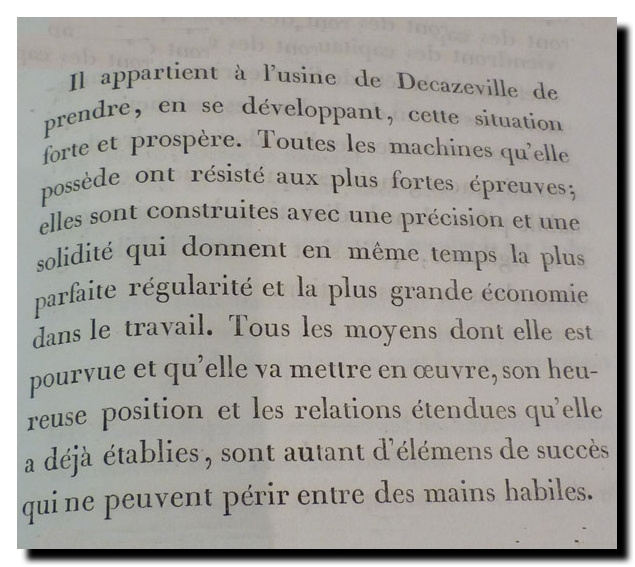
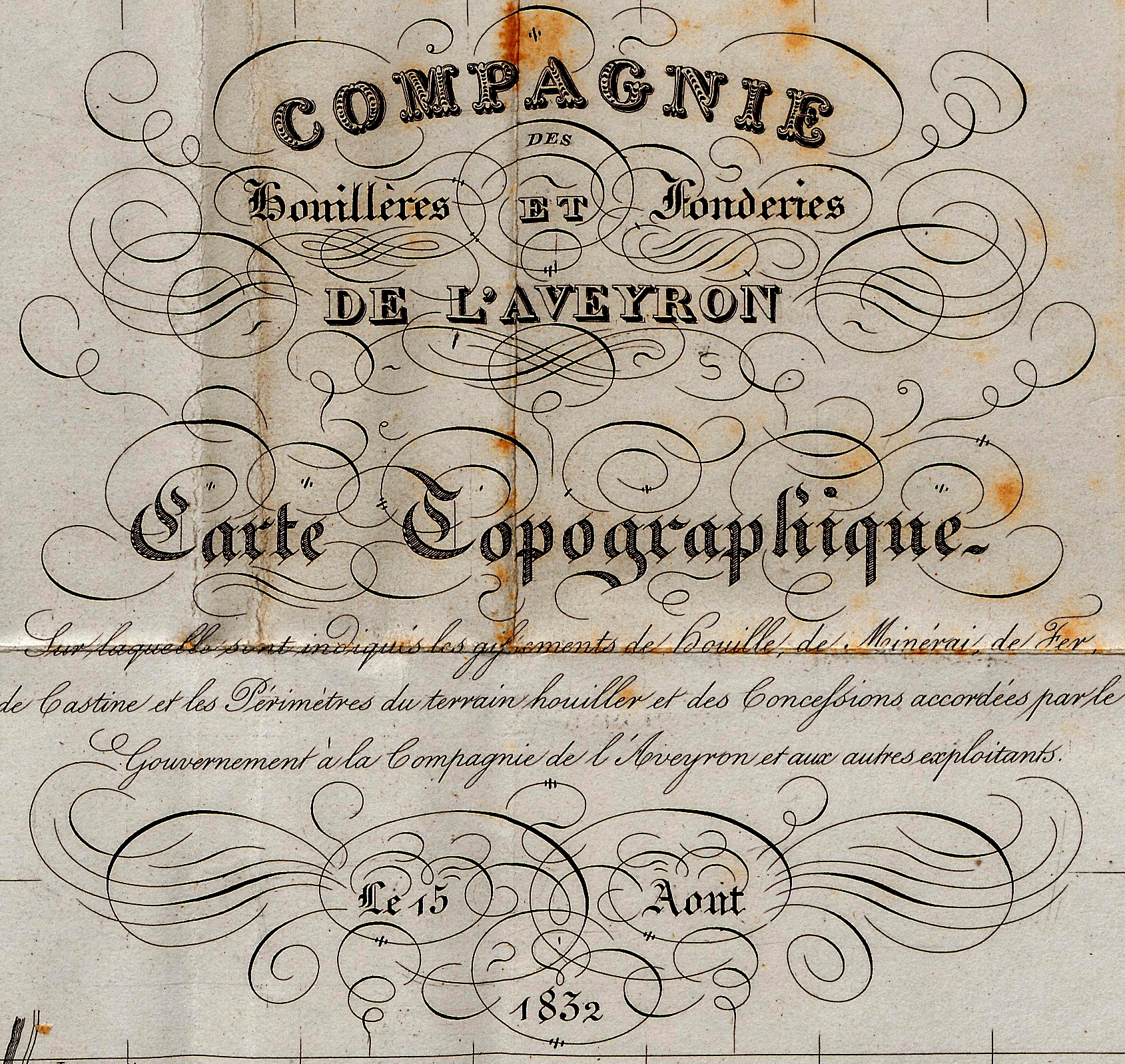
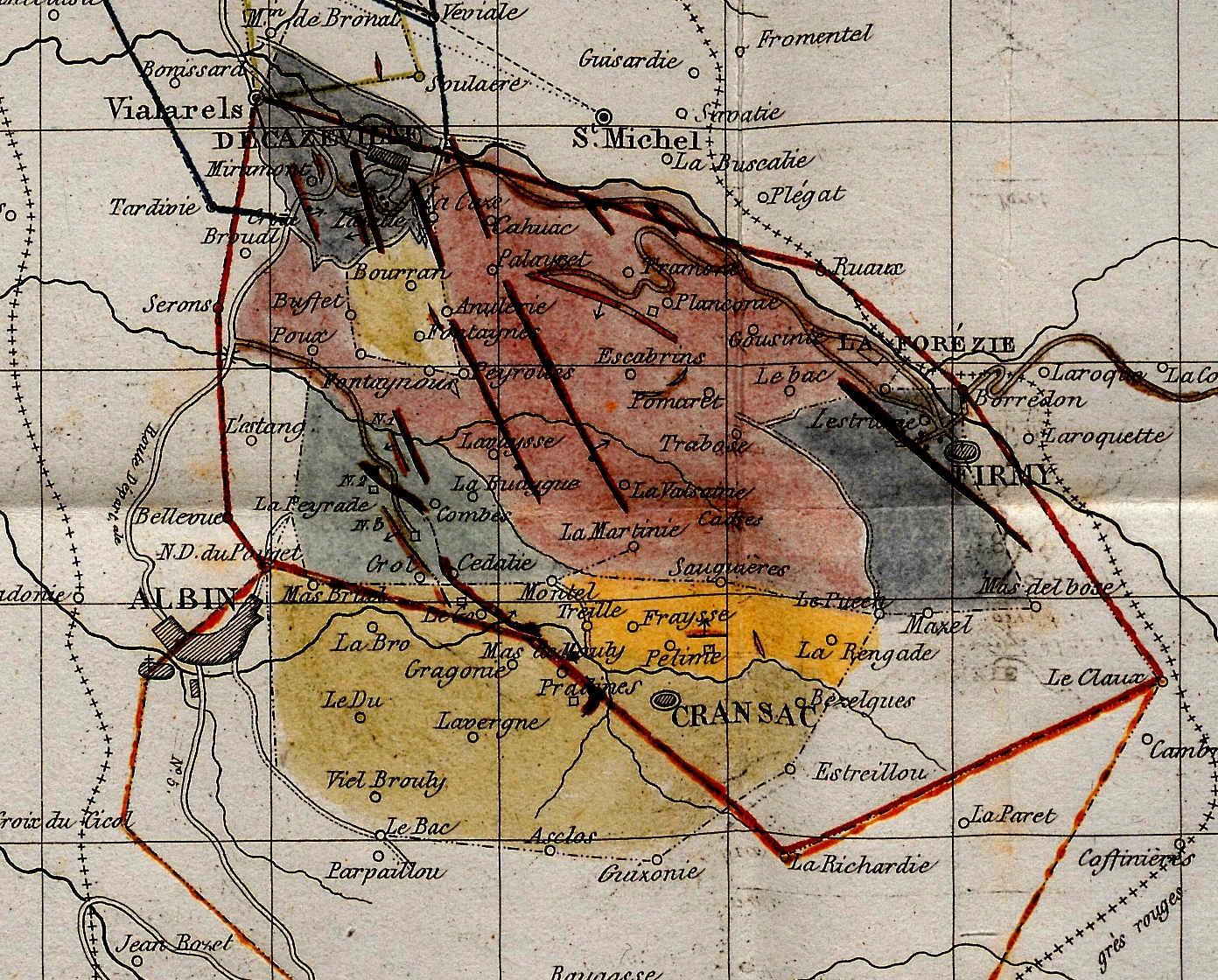
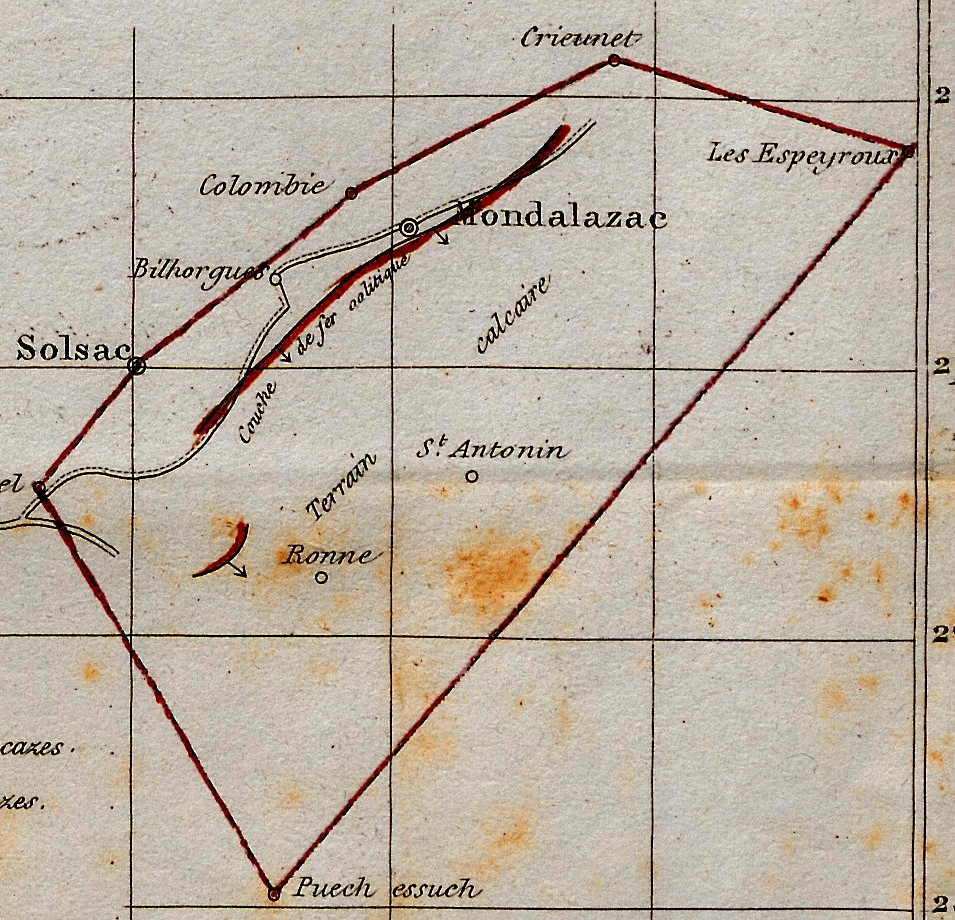
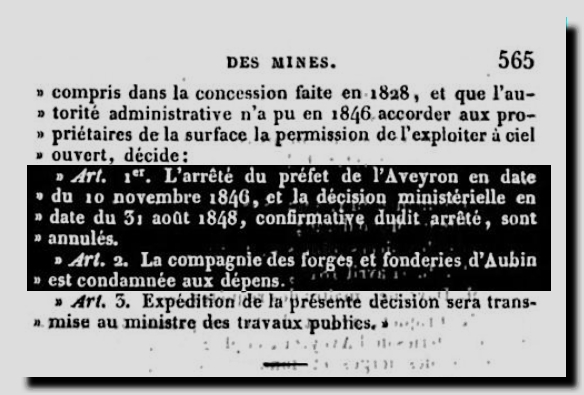
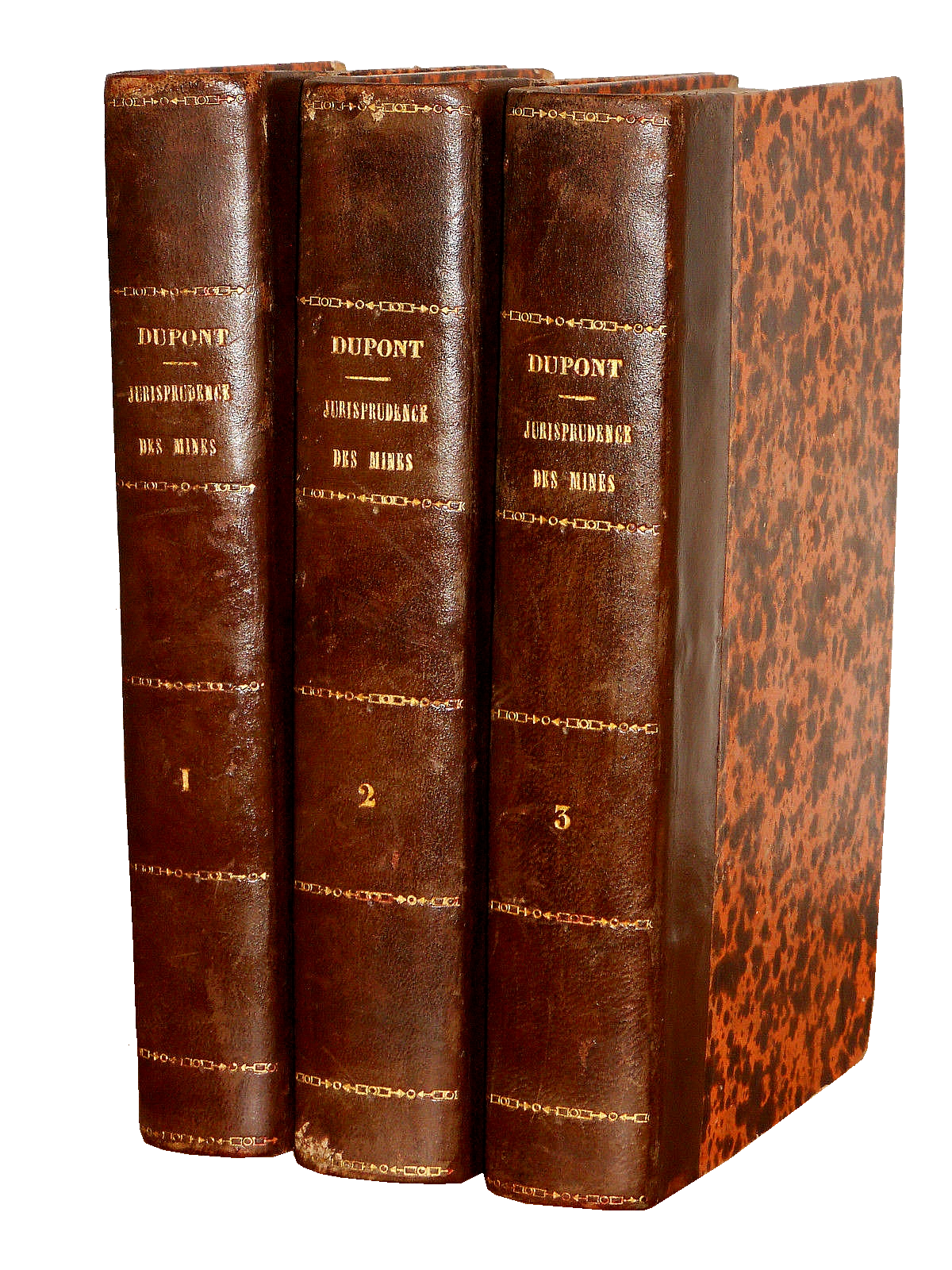

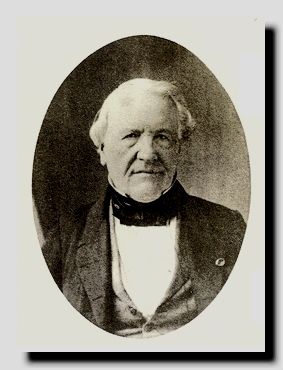 François Gracchus
Cabrol, est né à Rodez le 17 février 1793. Une rue, bien
modeste, rappelle son nom aux passants ruthénois. Polytechnicien,
promotion 1810, il sera artilleur, lieutenant puis capitaine. Il aura
par exemple au cours de sa carrière militaire, que nous ne
développerons pas ici, connu Waterloo et la guerre d'Espagne...
François Gracchus
Cabrol, est né à Rodez le 17 février 1793. Une rue, bien
modeste, rappelle son nom aux passants ruthénois. Polytechnicien,
promotion 1810, il sera artilleur, lieutenant puis capitaine. Il aura
par exemple au cours de sa carrière militaire, que nous ne
développerons pas ici, connu Waterloo et la guerre d'Espagne...

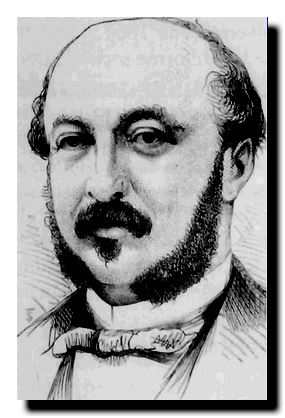
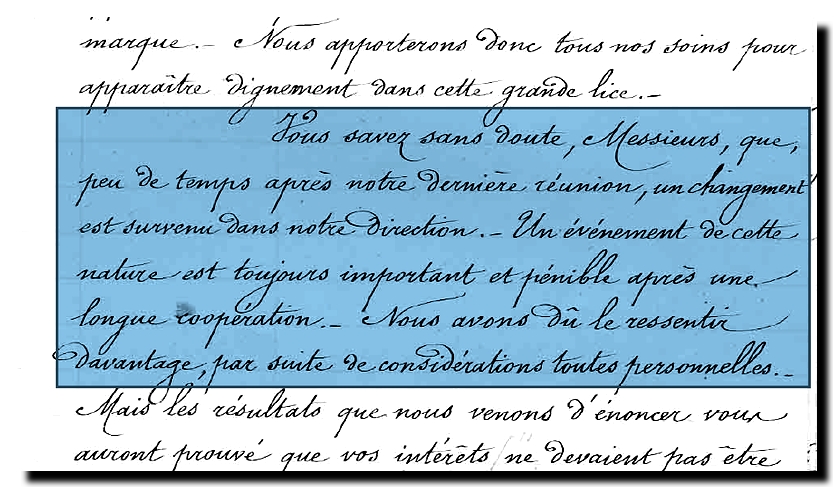
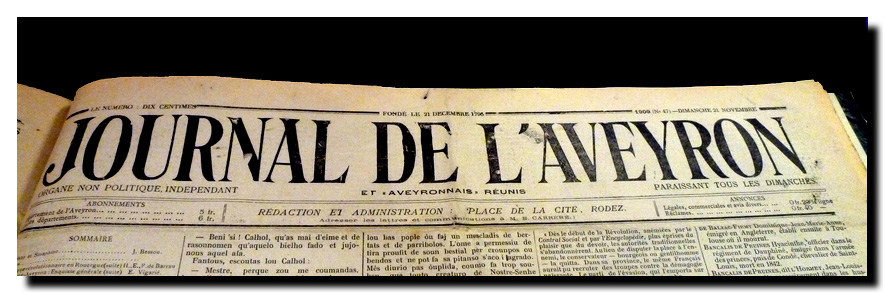
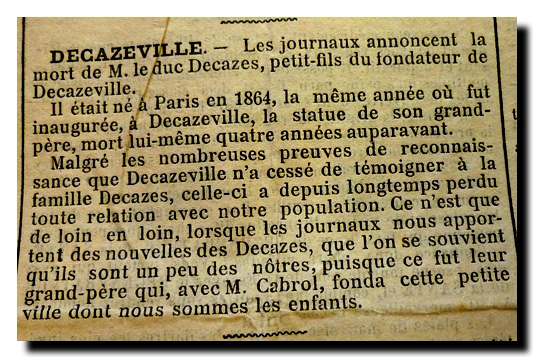





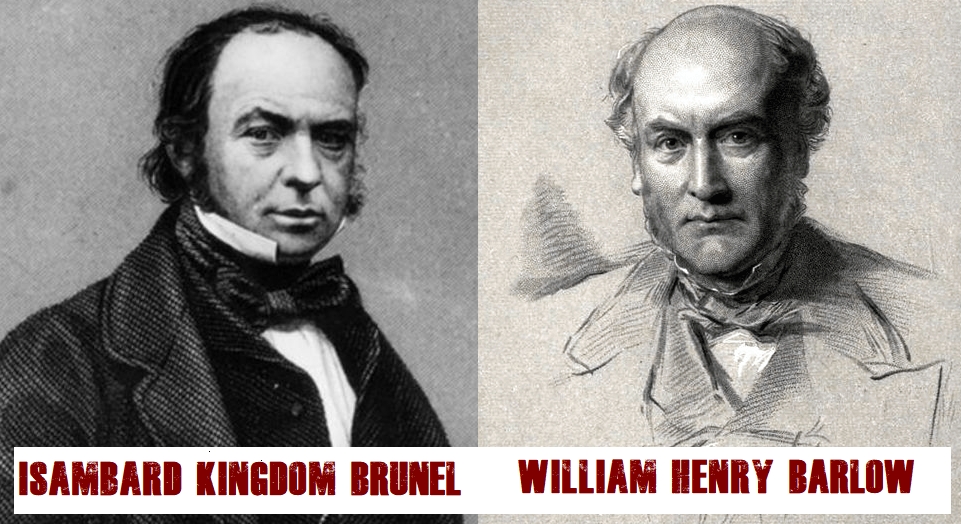
Avertissement
L'histoire que vous allez découvrir est remarquable et unique. Elle s'inscrit dans une parfaite logique, et dans la continuité d'essais, comme les traverses longitudinales à section triangulaire, celles de Reynolds, ou l'invention du rail Brunel. Le rail Barlow est une utopie devenue un temps réalité, mais qui n'aura pas de suite et ne connaîtra pas, hélas pour son inventeur, et accessoirement les forges de Decazeville, le succès attendu.
Son
auteur, William Barlow n'est pas un doux rêveur. Ingénieur reconnu en
Grande-Bretagne, il a réalisé des ouvrages importants, comme la gare de
Saint-Pancras. Pour ce qui nous importe, son fameux rail, il est
essentiel de comprendre tout de suite le but poursuivi : se passer des
traverses dans l'établissement de la voie. Mais attention ! Le mot
traverse représente ici, c'est essentiel de le comprendre, les traverses longitudinales
utilisées alors en 1850, qui avaient pris la place des appuis
historiques en pierre. Il ne s'agit en aucun cas des traverses telles
que nous les connaissons aujourd'hui, perpendiculaires à la voie et aux
rails. La confusion serait très malvenue ! Il n'y a pas dans le
vocabulaire technique un mot unique pour définir ces traverses
longitudinales, sur lesquelles les rails reposaient… Le renvoi plus bas au
livre de Andrew DOW, consacré au sujet ne permet aucun doute :
traverse peut donc indistinctement (en français comme en grand-breton…)
renvoyer à des éléments longitudinaux, longitudinal sleeper, ou
transversaux, transversal sleeper, pour le maintien de l'écartement des
rails, élément évidemment essentiel de sécurité. Barlow avait prévu
pour cette fonction, vous allez le découvrir, tous les

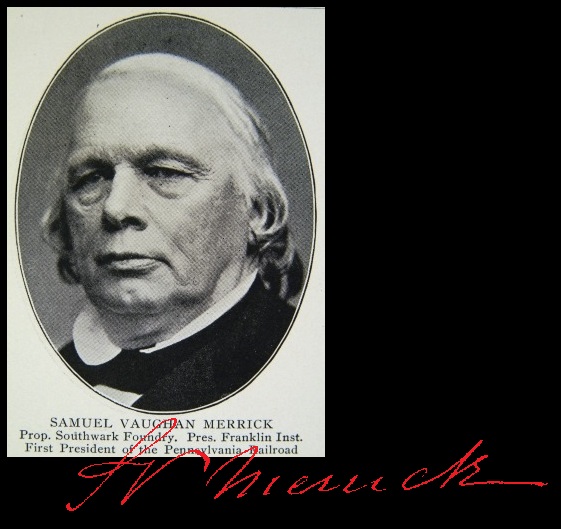 Et si c'était lui ? L'habitude, et
sans doute un chauvinisme européen compréhensible, attribuent à Brunel
et Barlow l'invention d'un rail très particulier. Pour la solution
Barlow, ce rail en U inversé économisait la mise en place de longrines
(longitudinales) sous le rail, mis en place donc directement sur le
ballast. Les brevets sont pris en 1849-1850.
Et si c'était lui ? L'habitude, et
sans doute un chauvinisme européen compréhensible, attribuent à Brunel
et Barlow l'invention d'un rail très particulier. Pour la solution
Barlow, ce rail en U inversé économisait la mise en place de longrines
(longitudinales) sous le rail, mis en place donc directement sur le
ballast. Les brevets sont pris en 1849-1850. 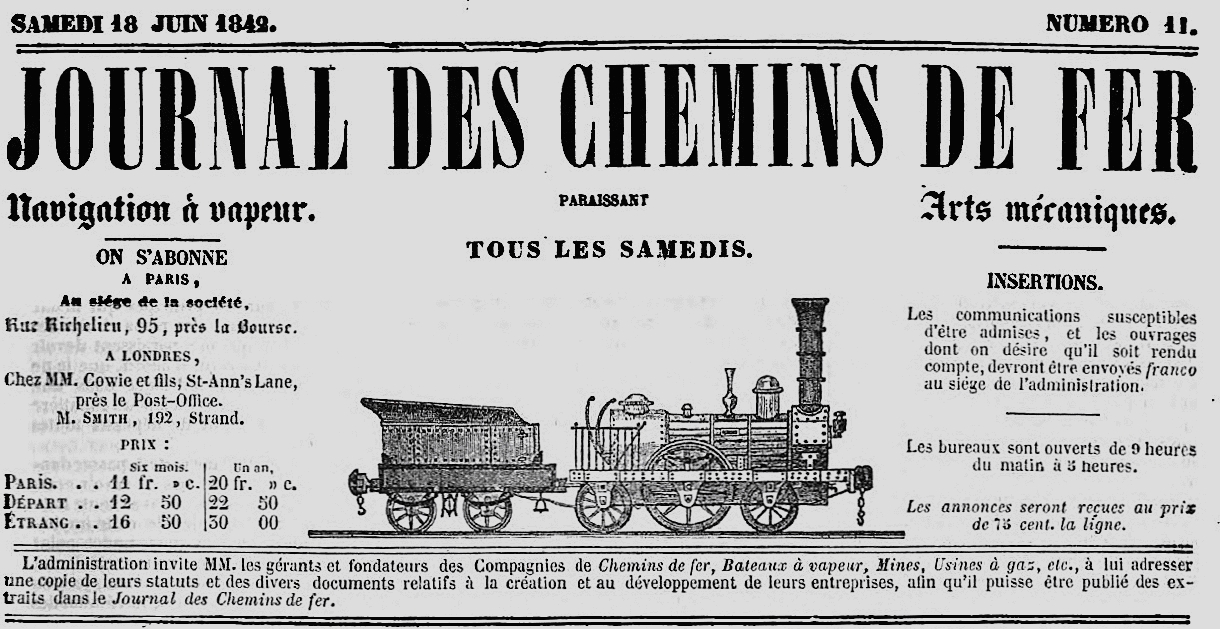
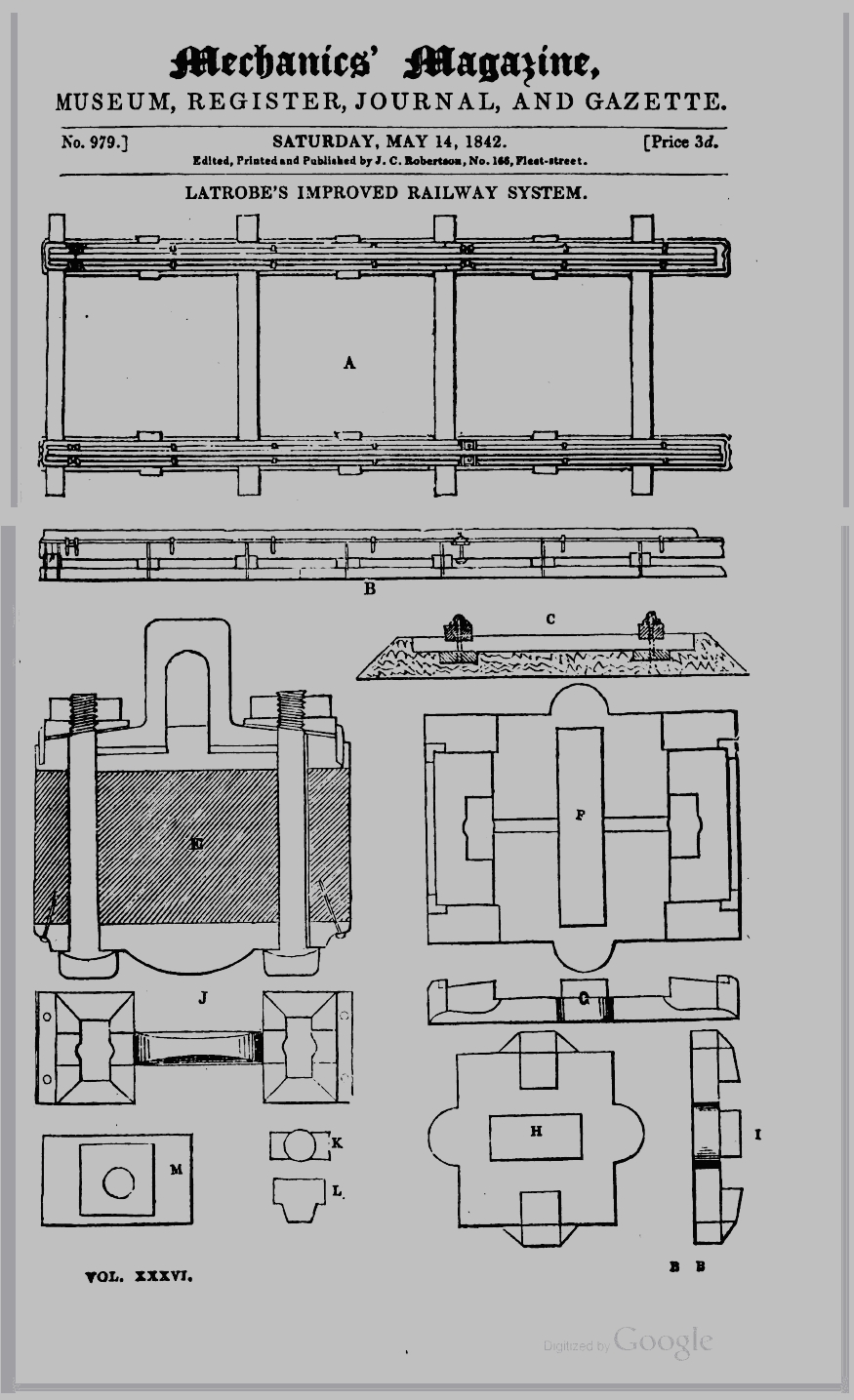 clic pour
agrandir
clic pour
agrandir 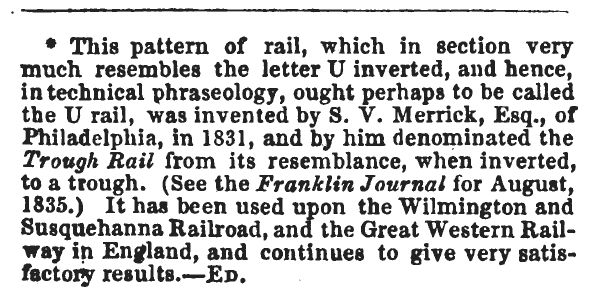



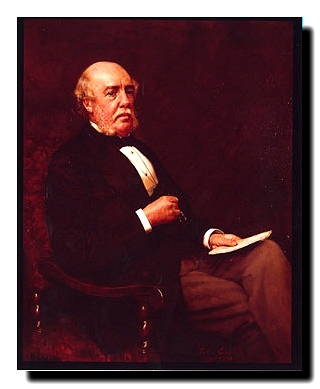
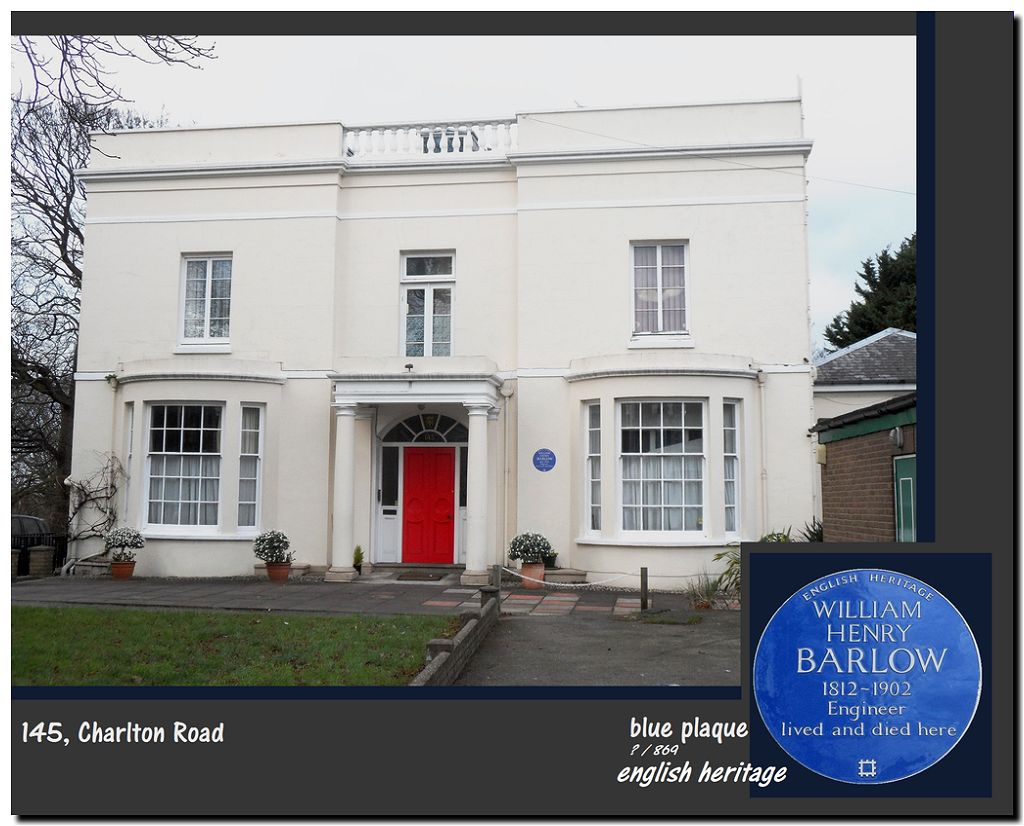

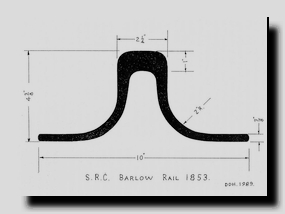
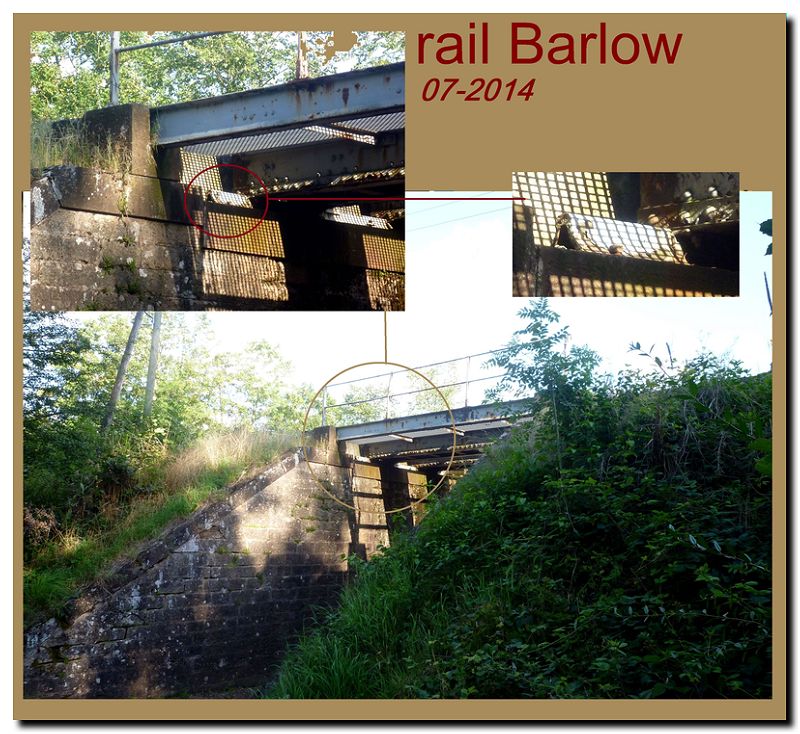
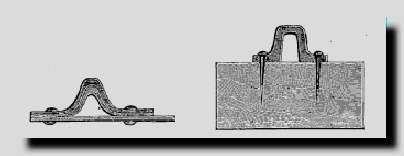 Parmi des solutions de voies sans traverses, deux sont
développées avec quelque succès, et ailleurs que dans la
France de 1850 : la voie Brunel et la voie Barlow,
Parmi des solutions de voies sans traverses, deux sont
développées avec quelque succès, et ailleurs que dans la
France de 1850 : la voie Brunel et la voie Barlow,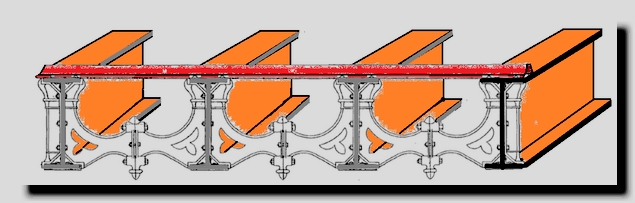
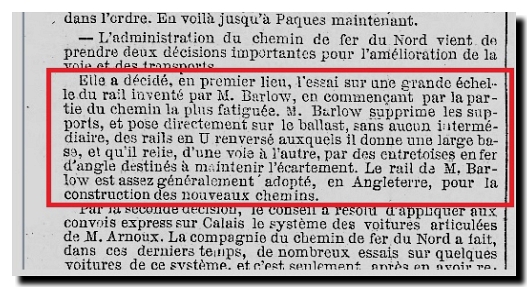
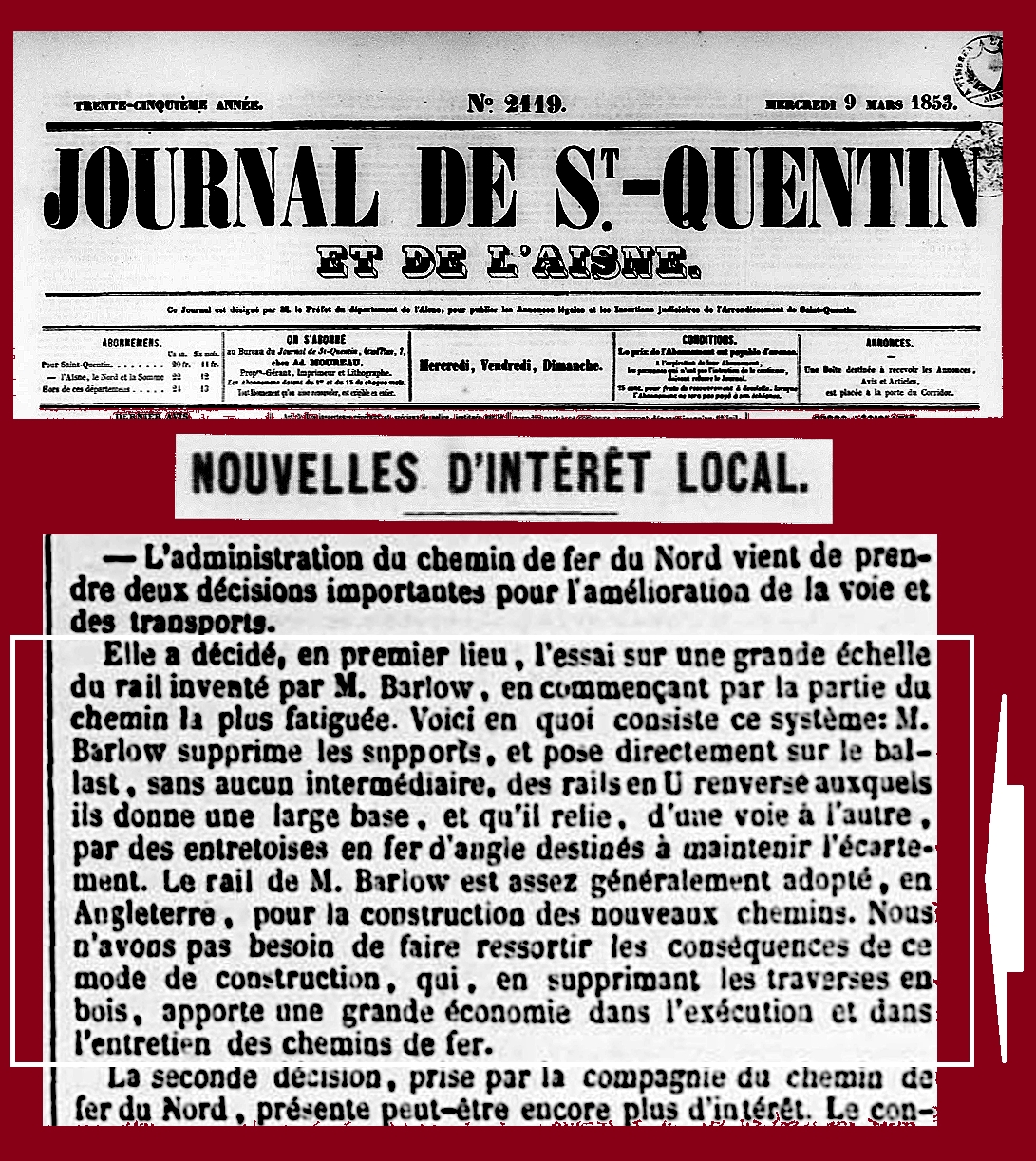
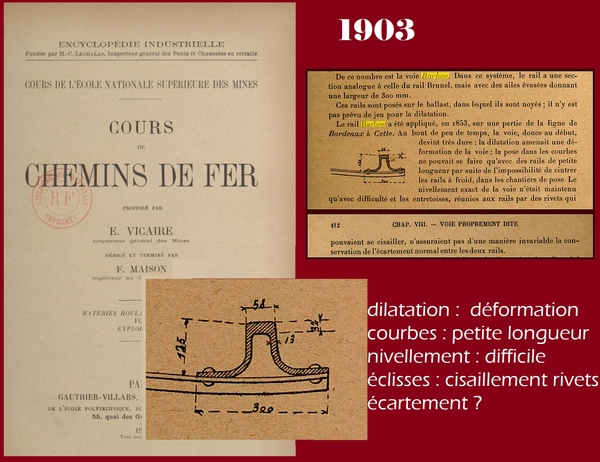
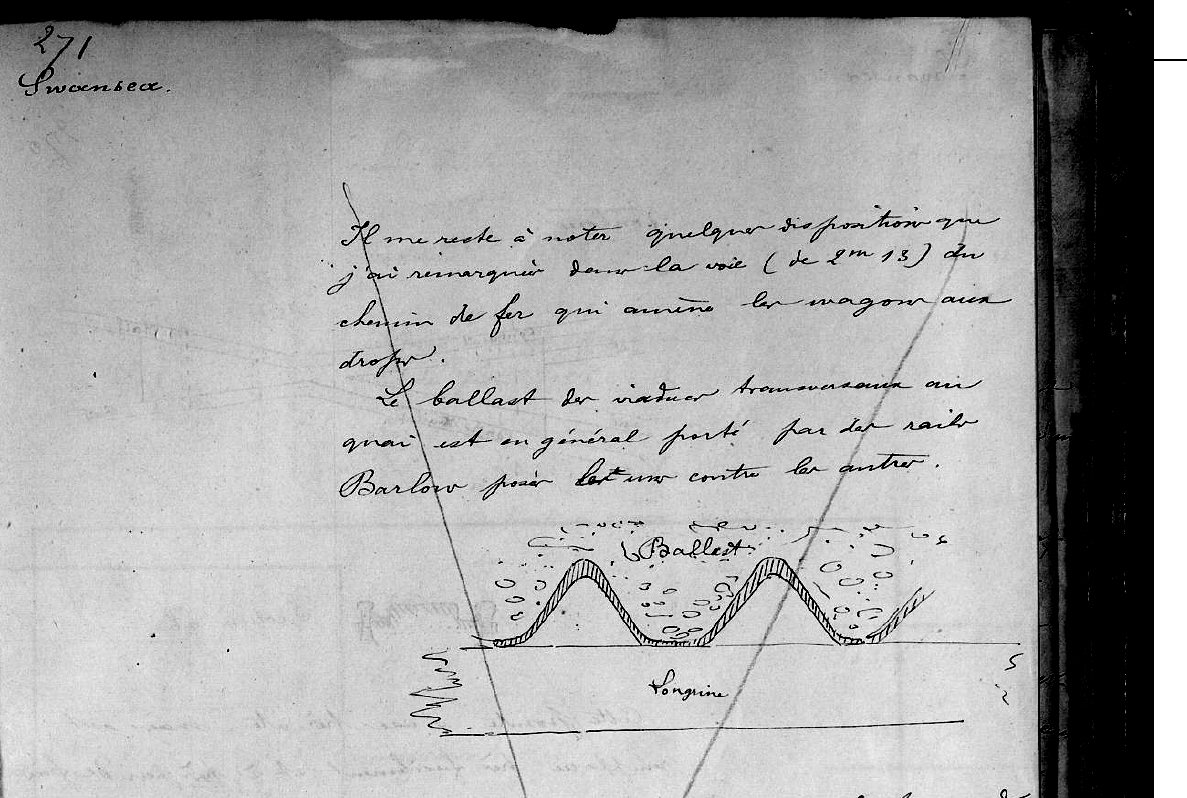



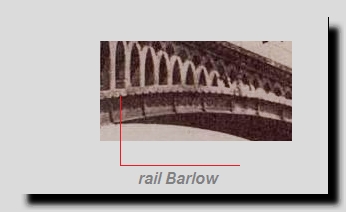
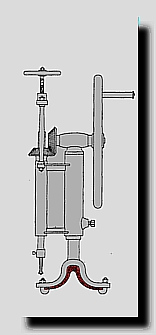 Ce
marché connut quelques difficultés. Si le Midi s'était en effet
adressé directement aux anglais, elle aurait eu des rails percés
à mettre en place. Ceux de Decazeville ne l'étaient pas, et la
difficulté pour le Midi était trop importante. Elle mit en cause
la qualité des premières livraisons et voulut annuler le marché.
Un compromis permis à Decazeville de garder la production, en
partie reconvertie en rails à double champignon, le Midi ayant très
rapidement abandonné le Barlow...La production locale de rails,
Barlow et autres, atteint un sommet avec 16 304 tonnes en 1856, année
faste, et... 2066 tonnes deux ans plus tard ! Le Midi est
servi et le Paris Orléans fait faire les siens à Aubin, c'est à dire
chez lui ! Les deux débouchés principaux de Decazeville
disparaissent. Cet épisode qui fut intense, mais très bref, n'a
donc pas satisfait tous les espoirs que Cabrol avait sûrement placés
dans ce train Barlow.
Ce
marché connut quelques difficultés. Si le Midi s'était en effet
adressé directement aux anglais, elle aurait eu des rails percés
à mettre en place. Ceux de Decazeville ne l'étaient pas, et la
difficulté pour le Midi était trop importante. Elle mit en cause
la qualité des premières livraisons et voulut annuler le marché.
Un compromis permis à Decazeville de garder la production, en
partie reconvertie en rails à double champignon, le Midi ayant très
rapidement abandonné le Barlow...La production locale de rails,
Barlow et autres, atteint un sommet avec 16 304 tonnes en 1856, année
faste, et... 2066 tonnes deux ans plus tard ! Le Midi est
servi et le Paris Orléans fait faire les siens à Aubin, c'est à dire
chez lui ! Les deux débouchés principaux de Decazeville
disparaissent. Cet épisode qui fut intense, mais très bref, n'a
donc pas satisfait tous les espoirs que Cabrol avait sûrement placés
dans ce train Barlow.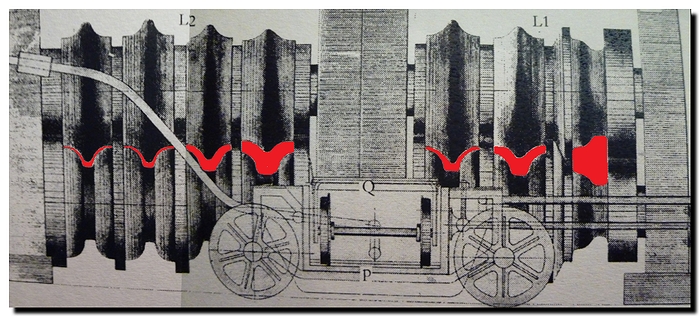
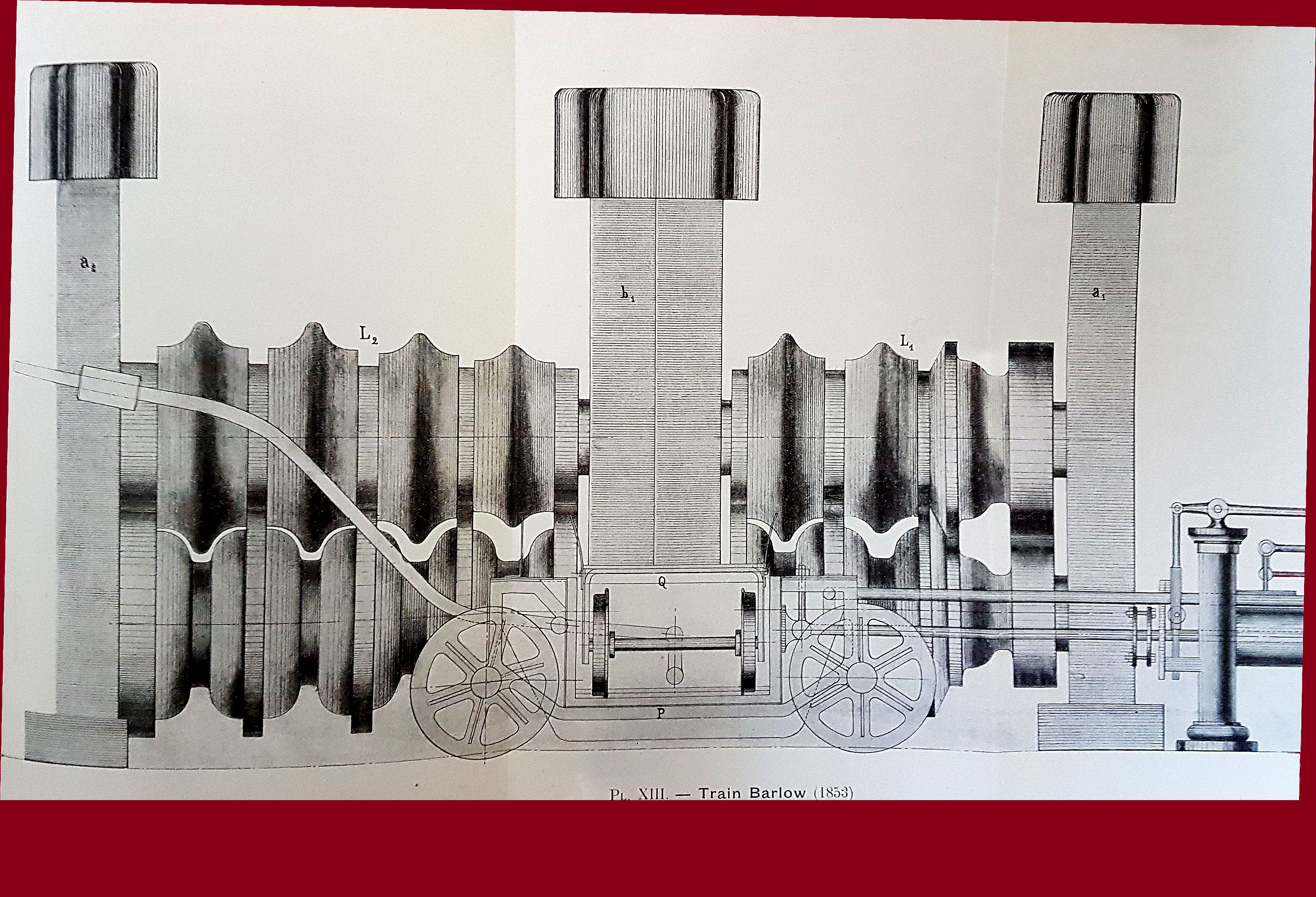
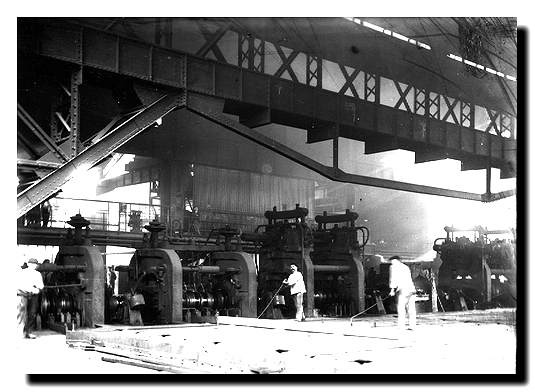
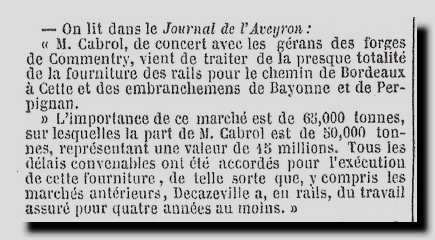
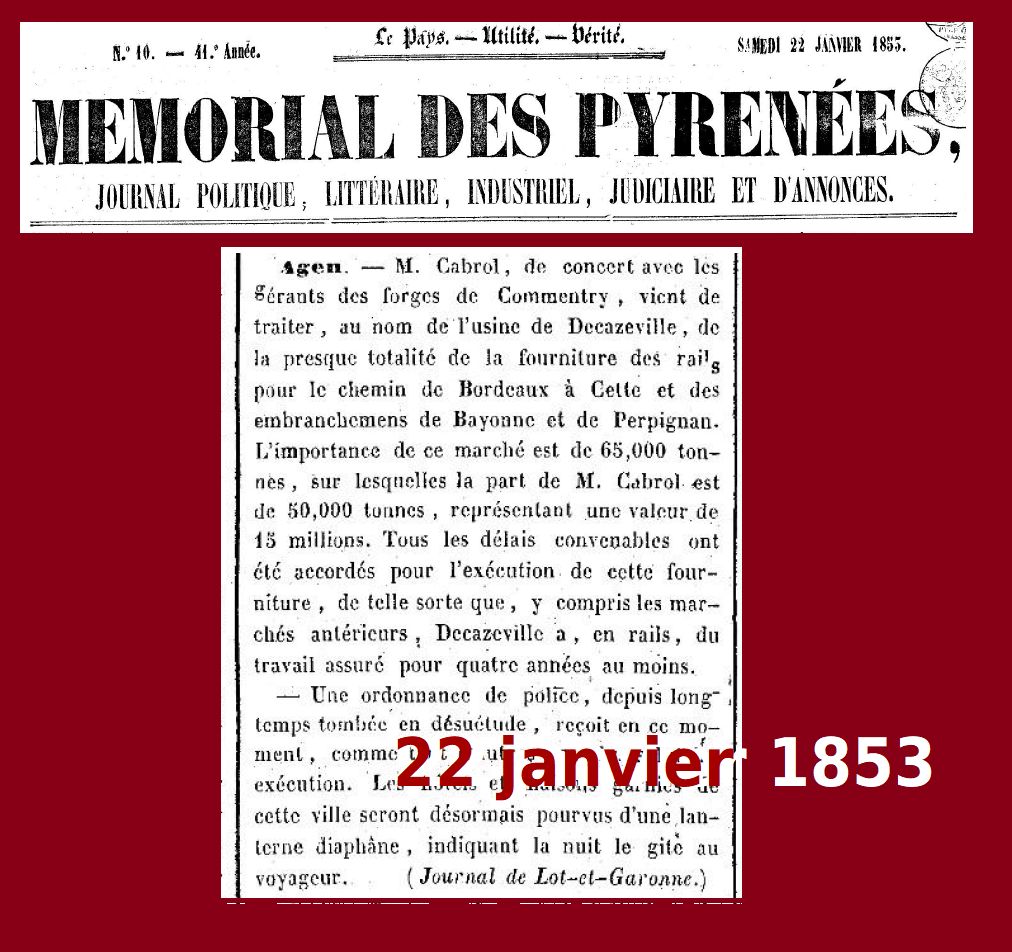
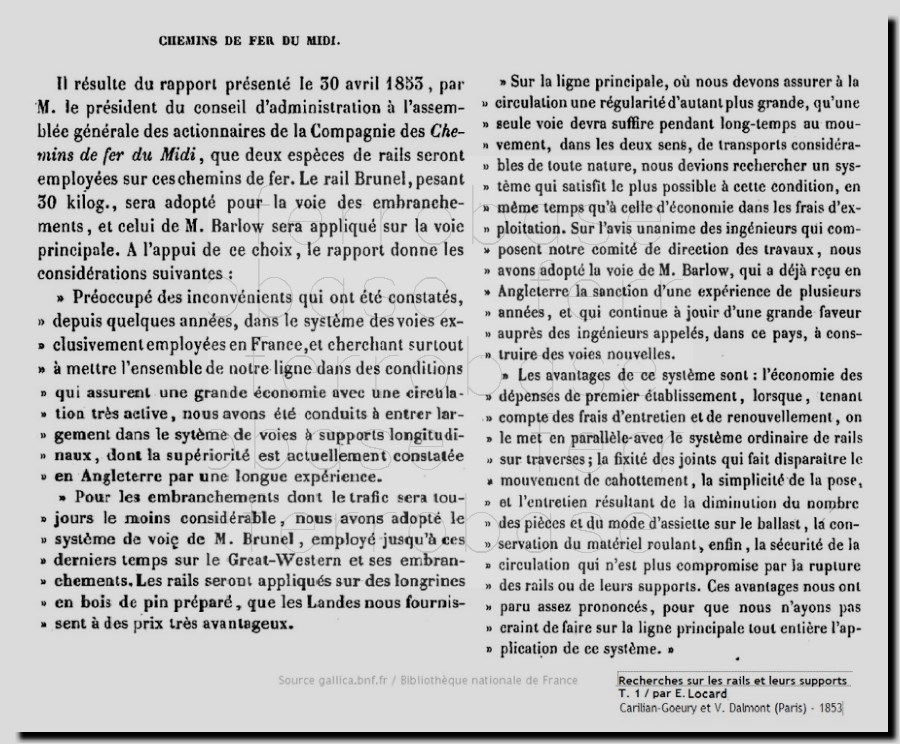
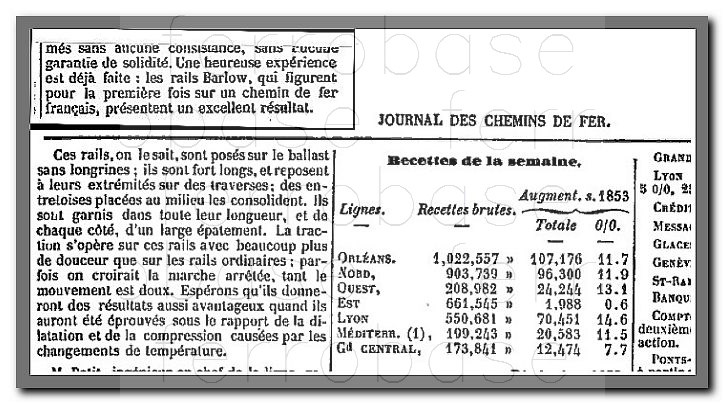
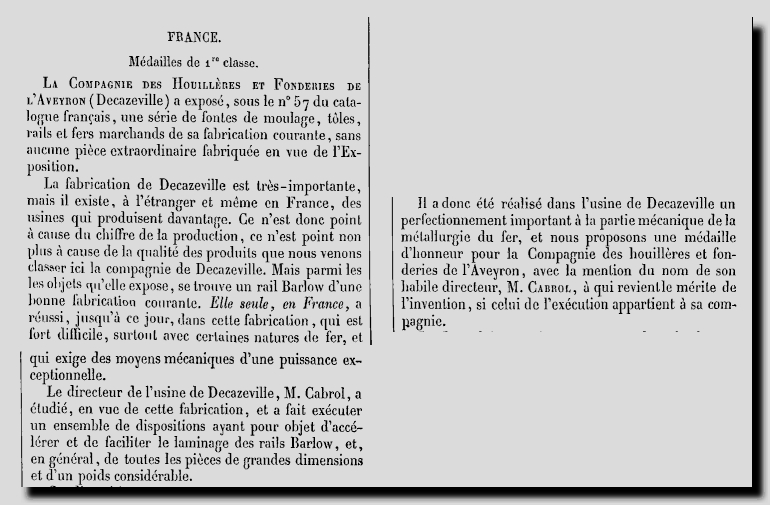
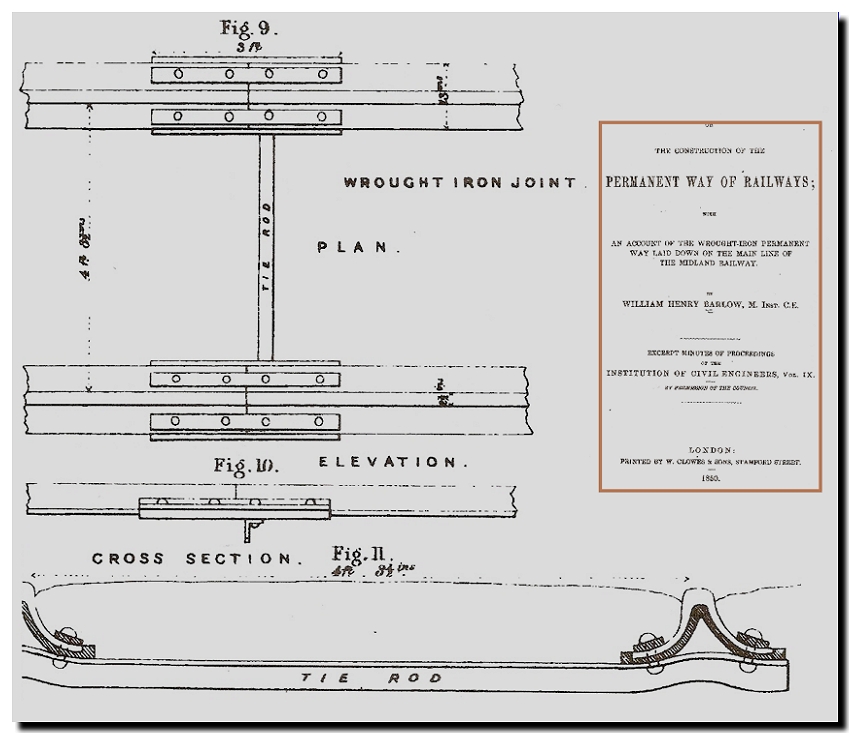



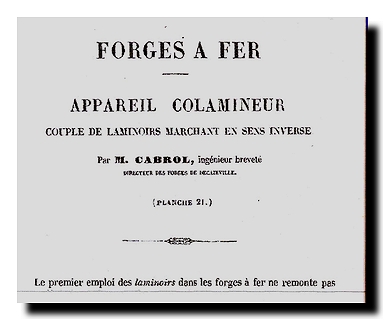 L'amélioration de
l'usine pour réaliser les rails Barlow a amené Armengaud Aîné à publier
un article dans sa Publication
Industrielle des machines
outils et appareils (tome 10, texte, p. 291 et suivantes,
et tome 10 planche 21, Europeana par exemple), en 1857.
L'amélioration de
l'usine pour réaliser les rails Barlow a amené Armengaud Aîné à publier
un article dans sa Publication
Industrielle des machines
outils et appareils (tome 10, texte, p. 291 et suivantes,
et tome 10 planche 21, Europeana par exemple), en 1857.
Cet article dont l'auteur affiché est F. Cabrol, est une présentation du train de laminoirs mis en place spécialement à Decazeville pour les rails. Armengaud et Cabrol décrivent les éléments de la machine dont l'originalité, et nouveauté, réside dans le couple de laminoirs marchant en sens inverse : le travail et la fatigue des lamineurs pour diriger les barres à laminer est moindre. François Cabrol a également mis en en place ce qu'il appelle des colamineurs. Il s'agit de deux caisses mobiles sur rails et comportant à l'intérieur un autre chariot mobile sur lequel le rail en formation d'étirage est conduit. Le déplacement et les efforts de manutention sont considérablement réduits et le temps de fabrication très court, pour ne pas laisser la barre se refroidir durant les sept opérations successives de va et vient de laminage. L'amélioration est l'objet d'un brevet de Cabrol. La très belle planche 21 du tome 10 de planches illustre l'ensemble de l'installation. Nous avons souligné en rouge les sept passes successives de laminage qui aboutissent au rail Barlow, le rail en formation étant conduit aux cannelures par le mouvement des caisses. Deux pistons permettent de déplacer rapidement les colamineurs. Il est possible donc pour le lamineur de manipuler des pièces lourdes. " C'est ainsi, dit M. Cabrol, qu'à Decazeville, au moyen du colamineur, le laminage des rails Barlow, qui présente, comme on sait, de si grandes difficultés, est devenu l'opération la plus facile et la plus courante ". Deux ouvriers lamineurs, un sur chaque caisse, et un enfant ( ! ) s'emploient à cette fabrication. Les colamineurs ont amené une économie importante de main d'oeuvre.
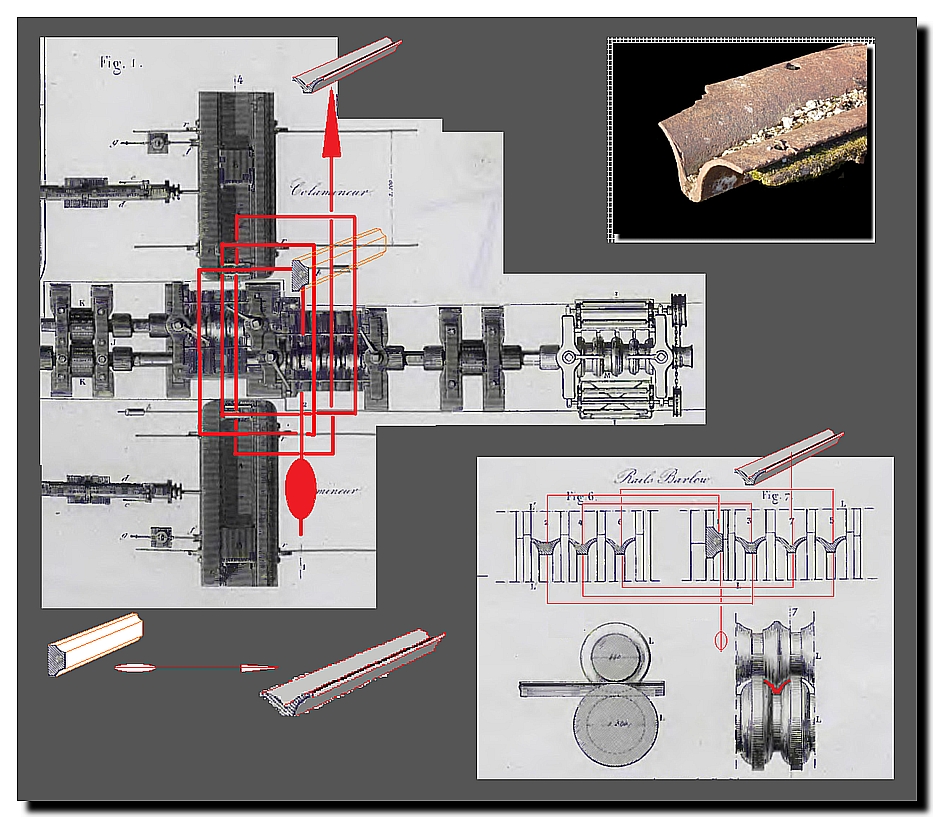
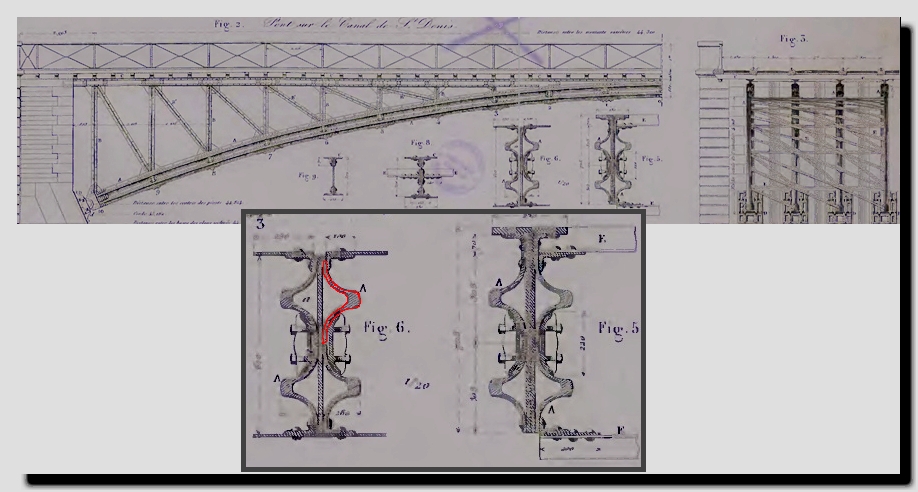



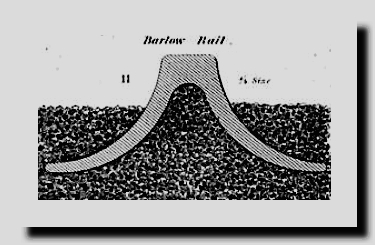
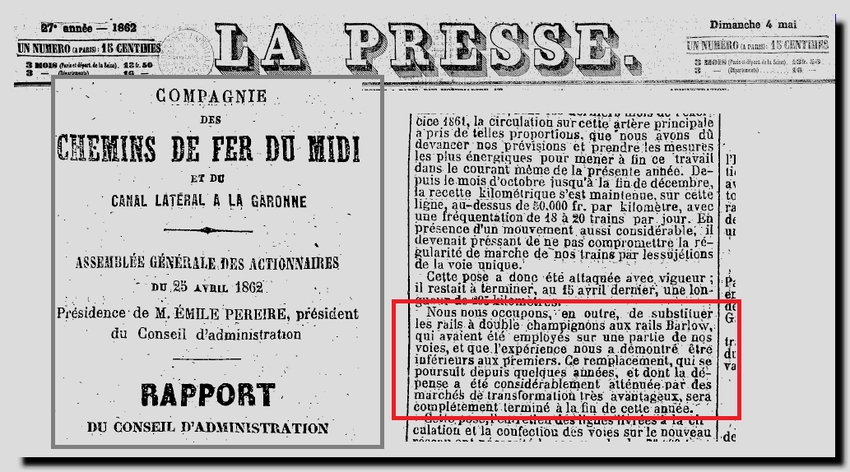
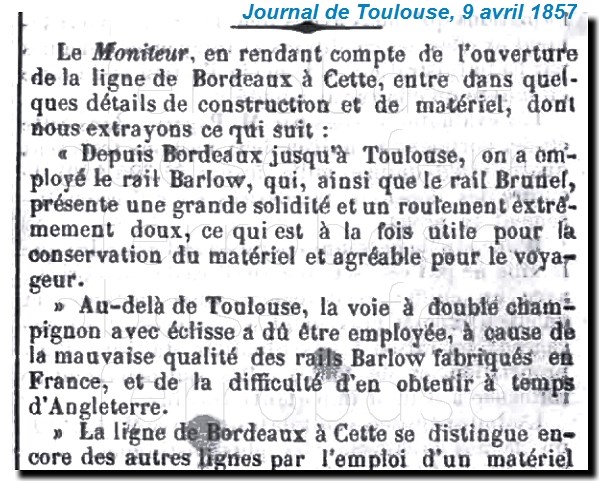
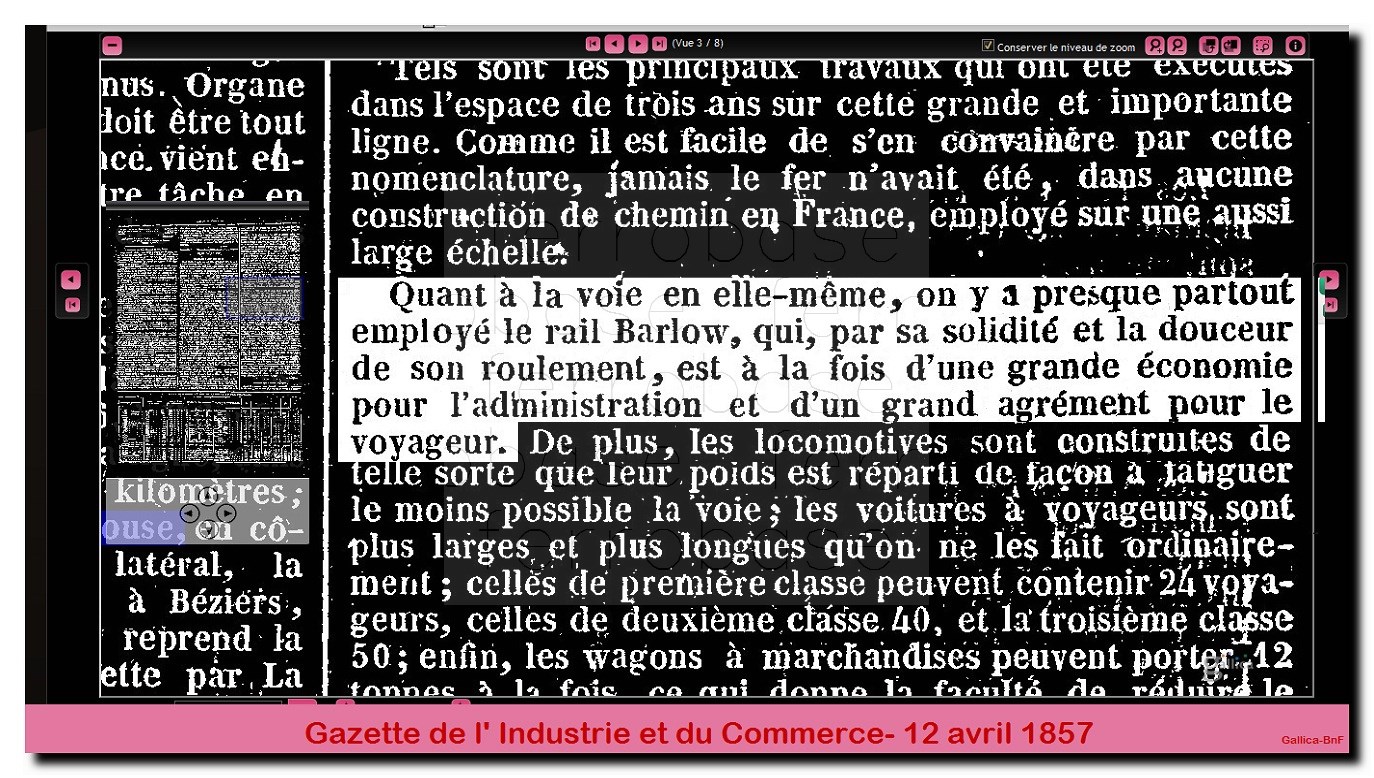 La
Gazette de l'Industrie et du Commerce rend compte dans son
édition du dimanche 12 avril 1857 de l'inauguration de la ligne
Bordeaux Sète. En gare de Toulouse, le jeudi 2 avril, deux trains
se sont rencontrés, venant des extrémités de la ligne. H. Larivière
signe un article à la gloire du fer dans le chemin de fer, en donnant
par exemple les tonnages employés en kg, ce qui évidemment permet
d'écrire quelques nombres impressionnants. Moins anecdotique, il
précise également l'utilisation du rail Barlow.
La
Gazette de l'Industrie et du Commerce rend compte dans son
édition du dimanche 12 avril 1857 de l'inauguration de la ligne
Bordeaux Sète. En gare de Toulouse, le jeudi 2 avril, deux trains
se sont rencontrés, venant des extrémités de la ligne. H. Larivière
signe un article à la gloire du fer dans le chemin de fer, en donnant
par exemple les tonnages employés en kg, ce qui évidemment permet
d'écrire quelques nombres impressionnants. Moins anecdotique, il
précise également l'utilisation du rail Barlow. 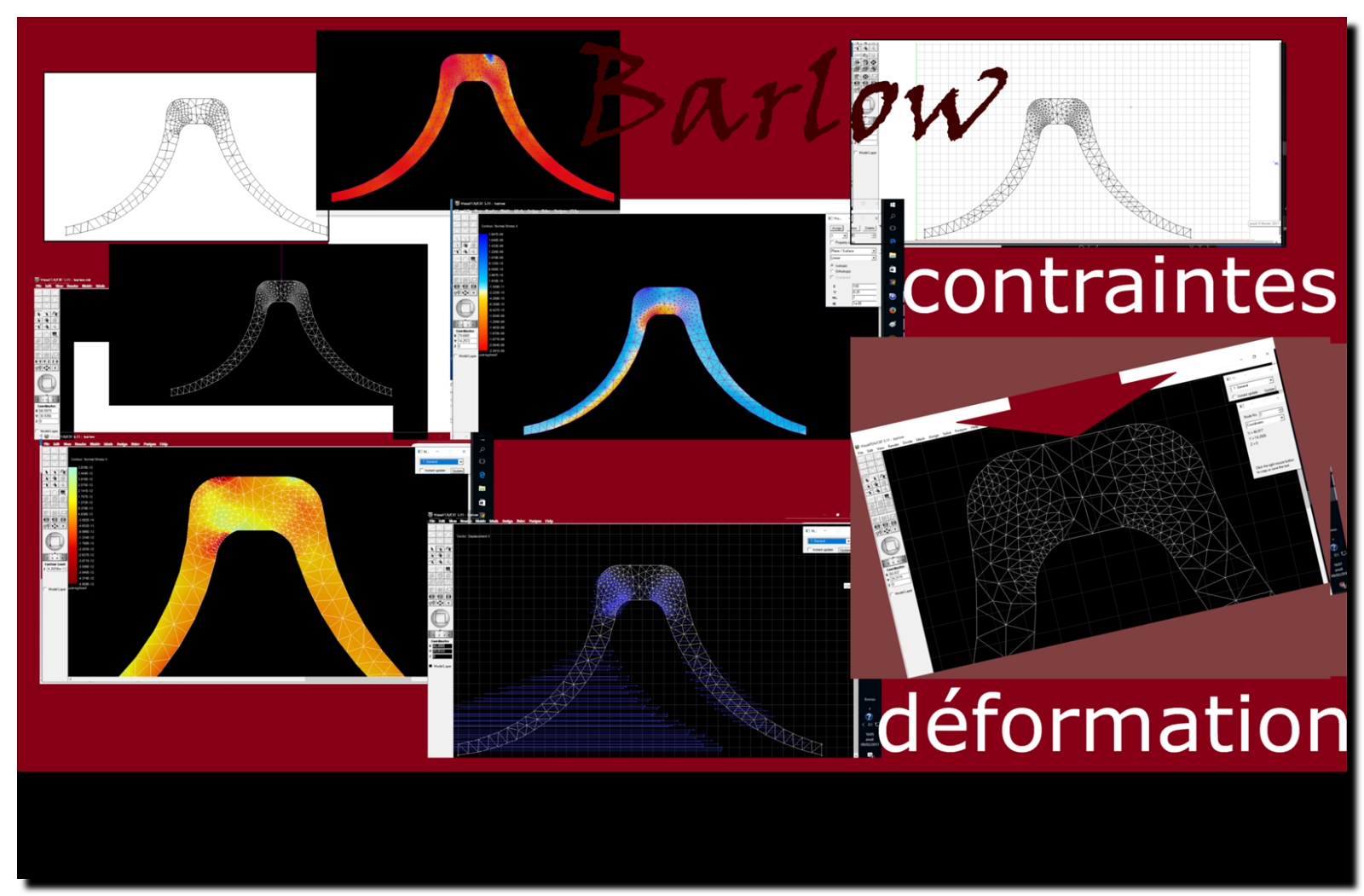 < clic
< clic


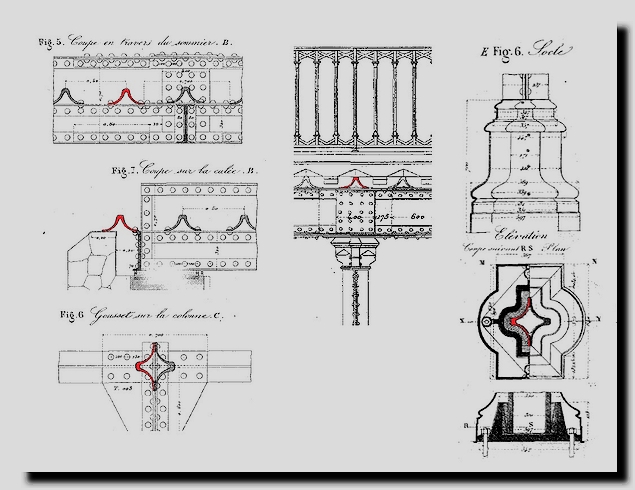


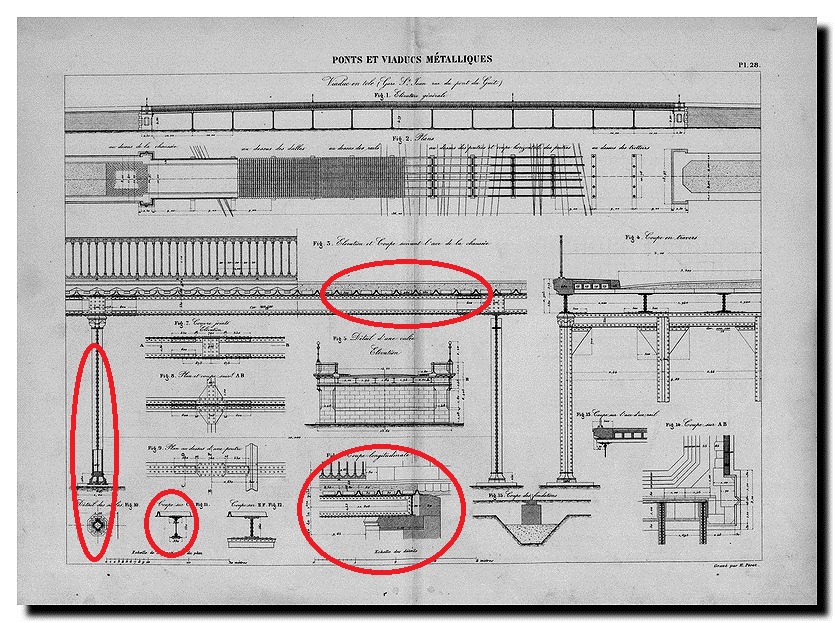
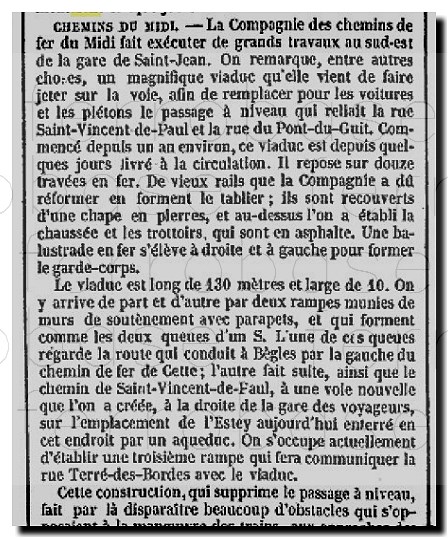
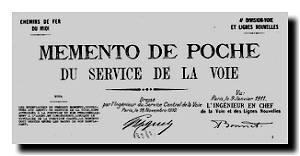 La
compagnie du Midi, en retirant les Barlow de ses voies n'a
pas pour autant totalement éliminé ces rails de ses paysages. Le Mémento de poche du Service de la voie,
dans son édition de 1911, ( Gallica BnF), les mentionne à plusieurs
reprises. Il s'agit par exemple de pièces spéciales de raccord Brunel
Vignole, le coussinet n° 35 de la nomenclature, ou le dispositif
d'arrêt sur voies Barlow. Il devait donc en exister en place, des voies
Barlow de débord. Le Midi a également prévu une utilisation
particulière pour les structures d'un gabarit, ou comme éléments
intégrés dans les structures des heurtoirs. Dans ce dernier cas, on
peut trouver réunis Brunel et Barlow dans le même appareil :
couleur rouge ici pour Barlow, et violette pour Brunel. En 2010, il
doit sûrement exister de tels heurtoirs dans les emprises... Les
illustrations suivantes montrent bien la présence opérationnelle des
rails ; les dimensions et caractéristiques sont données, y
compris les valeurs du I et du I/v, bien utiles aux projeteurs et
calculateurs !
La
compagnie du Midi, en retirant les Barlow de ses voies n'a
pas pour autant totalement éliminé ces rails de ses paysages. Le Mémento de poche du Service de la voie,
dans son édition de 1911, ( Gallica BnF), les mentionne à plusieurs
reprises. Il s'agit par exemple de pièces spéciales de raccord Brunel
Vignole, le coussinet n° 35 de la nomenclature, ou le dispositif
d'arrêt sur voies Barlow. Il devait donc en exister en place, des voies
Barlow de débord. Le Midi a également prévu une utilisation
particulière pour les structures d'un gabarit, ou comme éléments
intégrés dans les structures des heurtoirs. Dans ce dernier cas, on
peut trouver réunis Brunel et Barlow dans le même appareil :
couleur rouge ici pour Barlow, et violette pour Brunel. En 2010, il
doit sûrement exister de tels heurtoirs dans les emprises... Les
illustrations suivantes montrent bien la présence opérationnelle des
rails ; les dimensions et caractéristiques sont données, y
compris les valeurs du I et du I/v, bien utiles aux projeteurs et
calculateurs ! 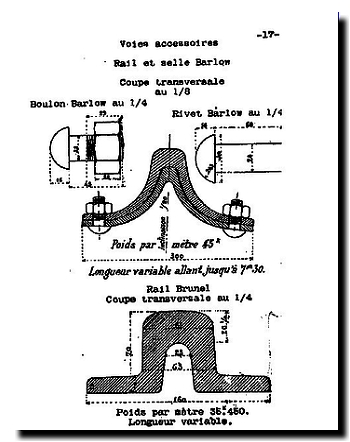
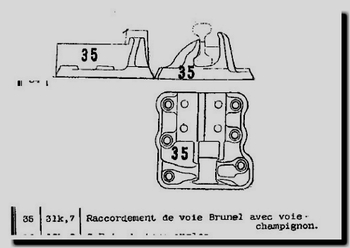
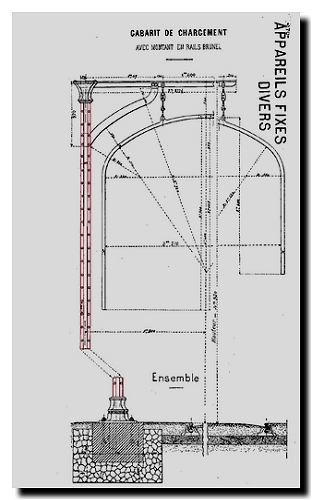
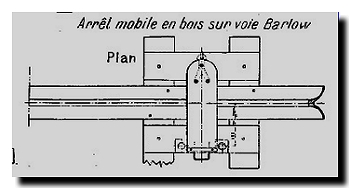
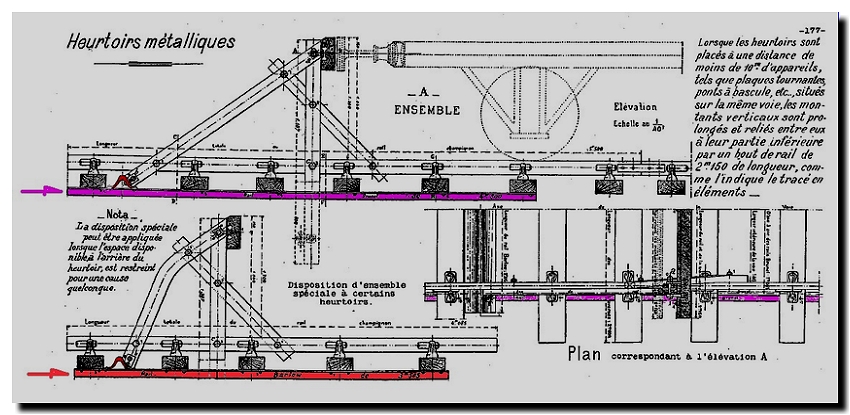


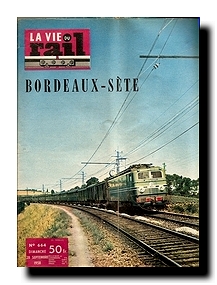
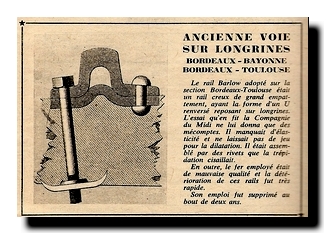
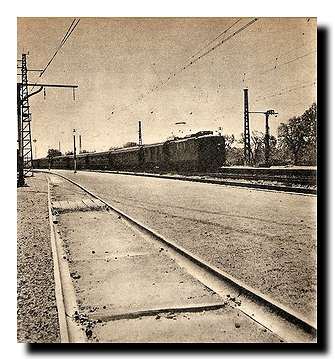




Les rails Barlow se sont installés en de nombreux pays, ou très exactement, auraient pu s’installer. Anglais et Français, qui les fabriquaient, les avaient dans leurs cartons lors de projets dans des contrées lointaines. En Inde par exemple. On connaît bien l’histoire des uns et des autres dans ce pays : la France y eut des comptoirs et territoires comme Pondichéry. En 1864, face à l’avancée des travaux d’infrastructures anglais, il était temps de réagir. Plusieurs projets de voies ferrées n’avaient pas connu de succès. Un nouveau projet est proposé. Il occupe les 114 pages d’une notice, Observations sur la priorité à accorder à Pondichéry pour l’établissement d’un chemin de fer, publiée par la Revue du Monde Colonial, à Paris ( lisible sur Gallica BnF). C’est une proposition calquée sur les « Light Railways » anglais, et ici baptisée « Chemin de fer de 2ème ordre » (sic ! ). L’auteur du projet, Ch. Ducos de la Haille détaille les données techniques que nous ne reprendrons pas. Sur les 170 km de ce projet en quatre sections, de Pondichéry à Samulputty, projet présenté dans une carte, le rail Barlow est à l’honneur. Il est très instructif de retenir le passage suivant qui décrit les dispositions constructives de la voie. Une analyse estimative figure également dans la brochure. A notre connaissance, ce projet, portant le n°1, n’a pas connu de suite. C’est en 1879 que la voie (normale ? ) reliera Pondichéry au réseau indien…L'intérêt d'utiliser ici ce rail réside dans l'absence d'éléments en bois, les traverses ; en pays humide, c'est effectivement un argument.
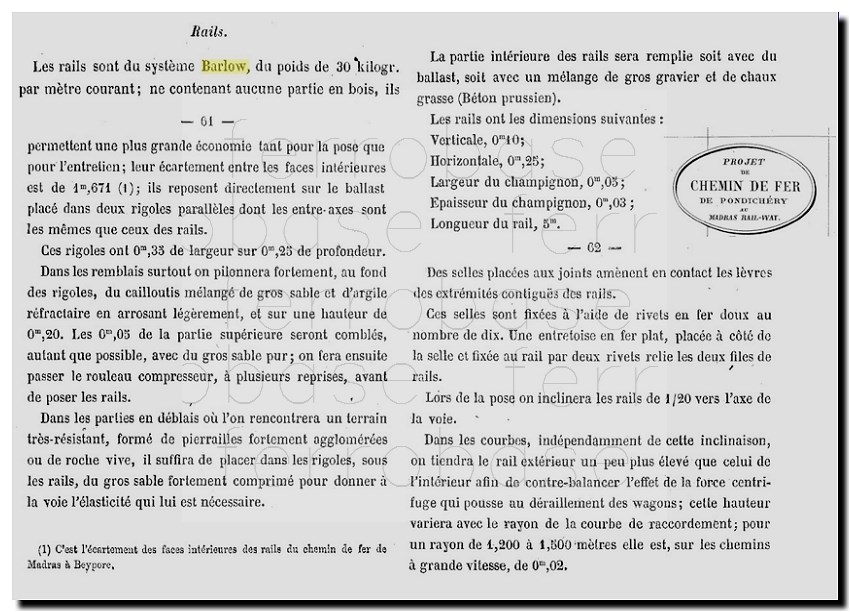



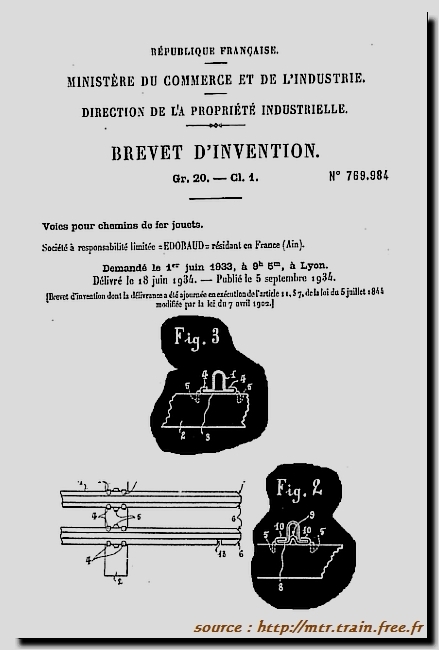 doute un réel
-petit- cousin de ses ancêtres, petit car réduit de près de 43 fois
dans ses dimensions. Nos remerciements vont à
http://mtr.train.free.fr pour avoir déniché et rendu accessible ce
brevet. D’autres brevets de constructeurs de trains jouets sont à
disposition sur le site.
doute un réel
-petit- cousin de ses ancêtres, petit car réduit de près de 43 fois
dans ses dimensions. Nos remerciements vont à
http://mtr.train.free.fr pour avoir déniché et rendu accessible ce
brevet. D’autres brevets de constructeurs de trains jouets sont à
disposition sur le site. 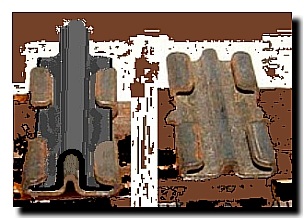








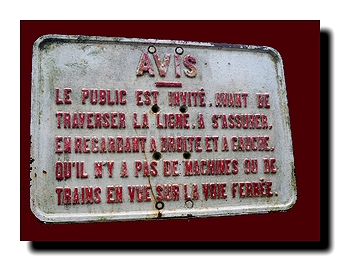 Nous
présentons chapitre
4 un diaporama consacré aux rails Brunel et Barlow en situation en
2010. Les photographies suivantes complètent cette présentation : un
portillon Brunel Midi sur les voies aveyronnaises de la compagnie,
portillon assez fréquent. Même si la plaque propose avec raison de
regarder à droite et à gauche, il ne vous est pas interdit de regarder
également le portillon de très prêt : les Brunel remplissent leur
fonction, et au vu de généreuse couche de peinture, ce sera le cas pour
quelques lunes !
Nous
présentons chapitre
4 un diaporama consacré aux rails Brunel et Barlow en situation en
2010. Les photographies suivantes complètent cette présentation : un
portillon Brunel Midi sur les voies aveyronnaises de la compagnie,
portillon assez fréquent. Même si la plaque propose avec raison de
regarder à droite et à gauche, il ne vous est pas interdit de regarder
également le portillon de très prêt : les Brunel remplissent leur
fonction, et au vu de généreuse couche de peinture, ce sera le cas pour
quelques lunes ! 
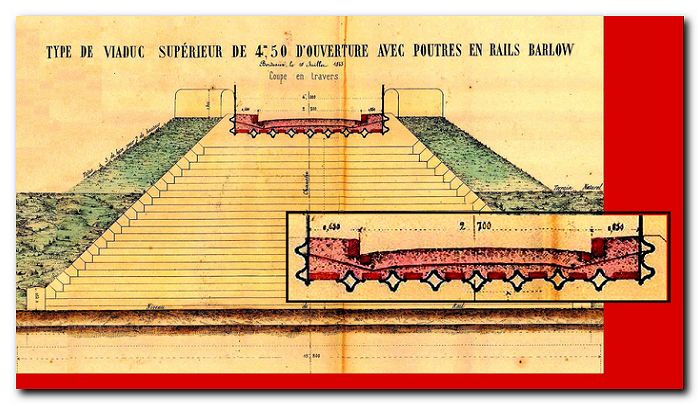

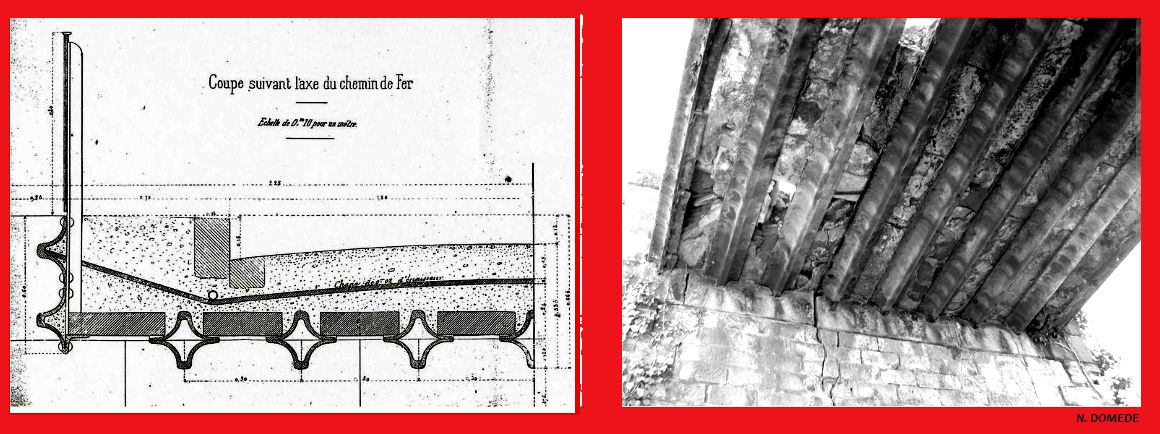
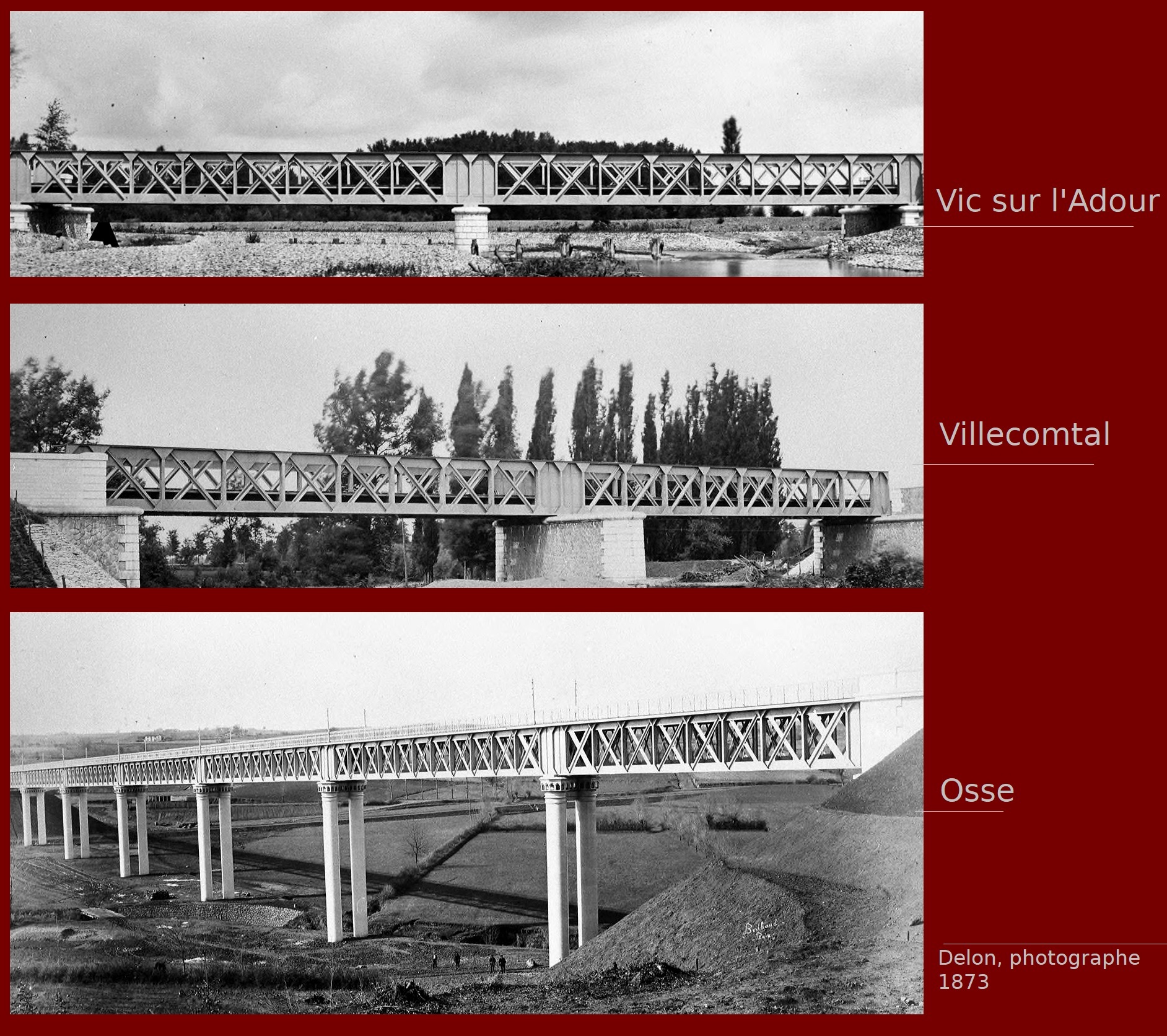
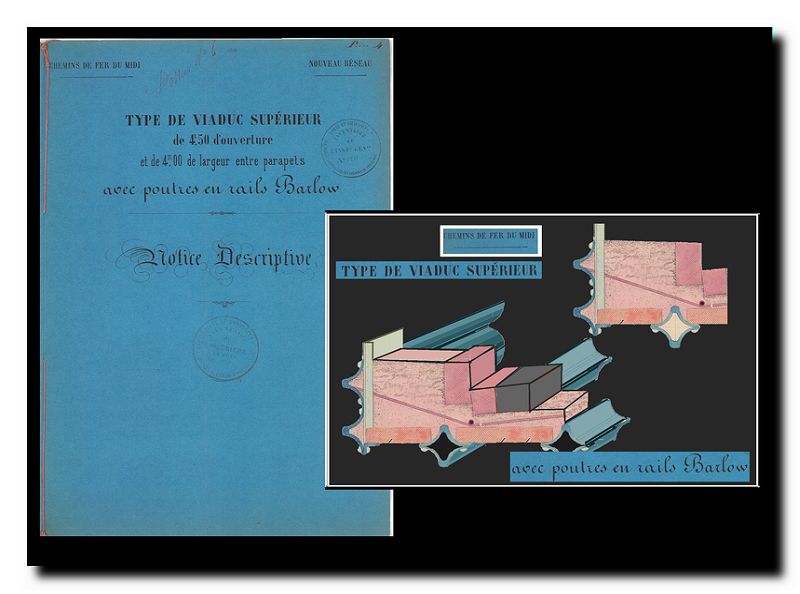
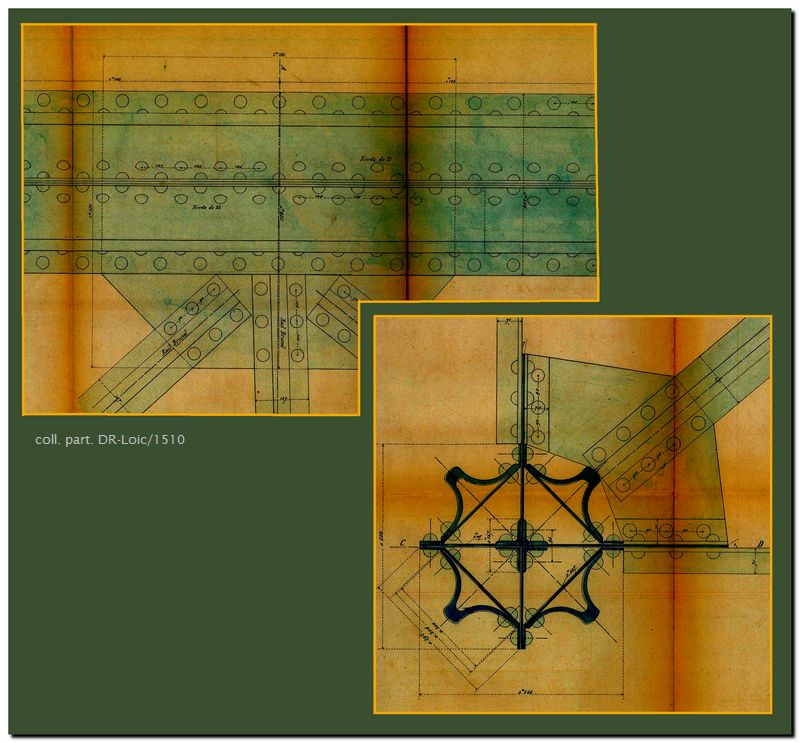
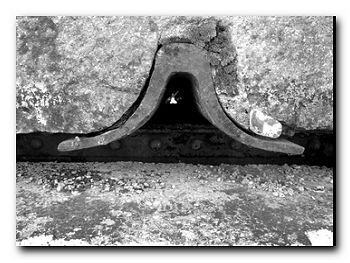



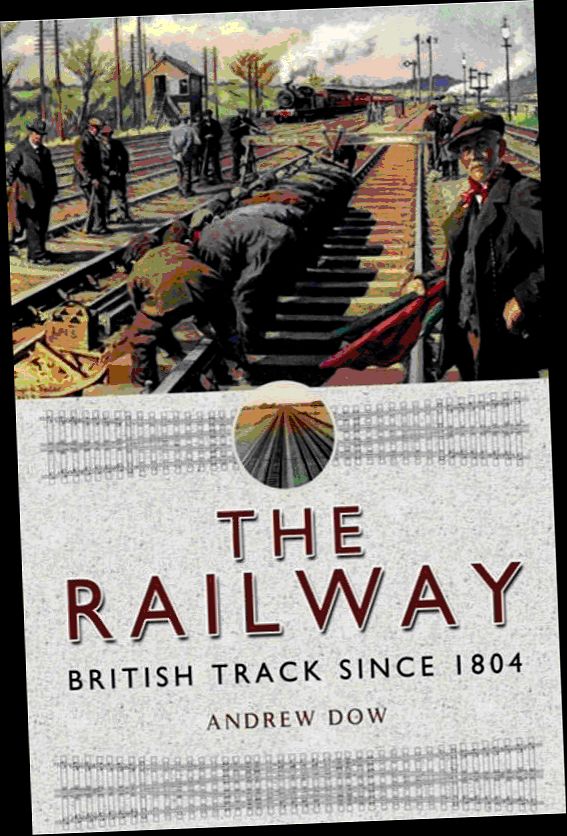


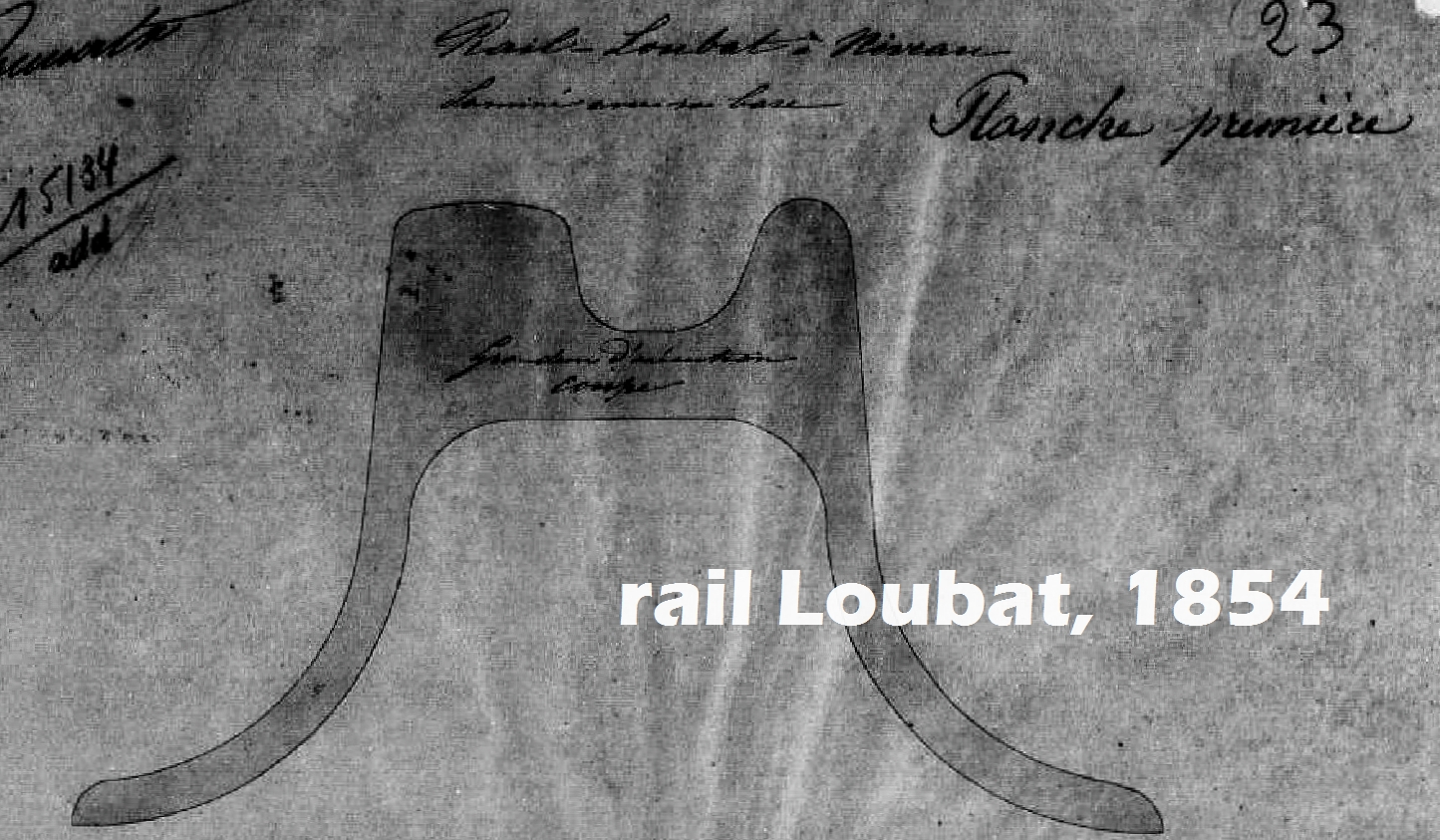 < clic
< clic
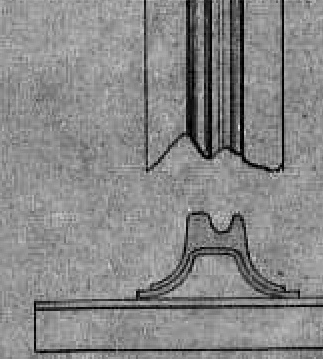



Sur la trace des BB du Midi, B and B, Barlow et Brunel...
Oui, vous avez bien lu ! Les BB du Midi ...Les locomotives ? Non, les rails !
Nous vous proposons de retrouver la trace de ces anciens rails, les Barlow et Brunel ou Barlow and Brunel, B and B, et qui furent les beaux rails du Midi, pour une période très courte on le sait ! Que sont devenus les duettistes du rail ?
Monsieur Barlow vous est bien connu. Monsieur Brunel était un camarade de jeux ferroviaires de M. Barlow. Isambard Kingdom Brunel avait un père français et une mère anglaise. Né en Angleterre il fut un des ingénieurs ferroviaires les plus en vue au XIX ème siècle pour ses trouvailles, dont quelques unes n’ont pas eu le succès attendu. La voie extra large du GWR, 2.14 m, et le rail sont deux exemples de ces échecs du grand ingénieur anglais, et un peu français quand même...Le rail Brunel, que les forges d’Aubin fournirent au Midi, le Barlow étant laminé à Decazeville, entre 1854 et 1858, était d’une hauteur plus faible que le Barlow et d’un poids donc également plus faible. Il avait son utilité sur les ponts. Après avoir pisté ce rail depuis les beaux arcs de Malakoff, il était logique de partir le rechercher sur les voies du Midi. Les découvertes proposées ici ont été faites début 2010, du coté de Bédarieux et en vallée de l’Orb.
Il n’y a pas bien sûr de voies B and B en service, ni en place, quoique les surprises peuvent être possibles...Mais à défaut de voies, les rails eux ont bien colonisé le Midi. Vous allez découvrir plusieurs exemples de reconversion des Brunel en poteaux de portillons d’accès ou en poteaux de soutien de barrières. Leur profil est parfaitement identifiable. En ouvrant l’œil, il est également possible d’en dénicher un peu partout, et pas seulement dans de « petites » stations.
Premier exemple de reconversion. Il n'y a pas ici les belles ogives du Midi, mais sous la surveillance du Brunel de service au portillon, les Barlow remplissent leur office : posés transversalement à la voie, ils supportent les poutres de quelques modestes ouvrages. Certains de ces rails montrent sur la partie supérieure les signes de fatigue, cause de leur dépose en tant que rail. Ces ouvrages de quelques mètres de portée ont pour la plupart été rénovés et les Barlow ont donc disparu, mais les TER de 2012 passent encore sur ces reliques, très beaux témoins d'une vraie utopie ferroviaire, celle de la voie sans traverses...Les trains passent donc dessus ! Enfin, sur l'ouvrage qui lui repose sur les Barlow...

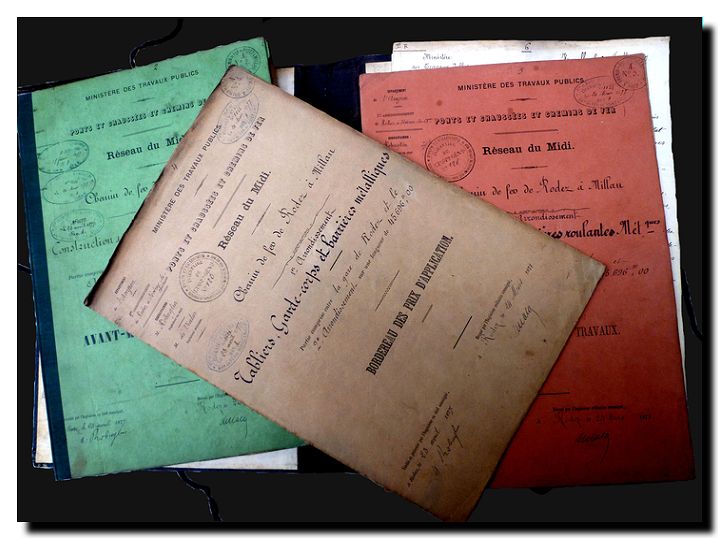
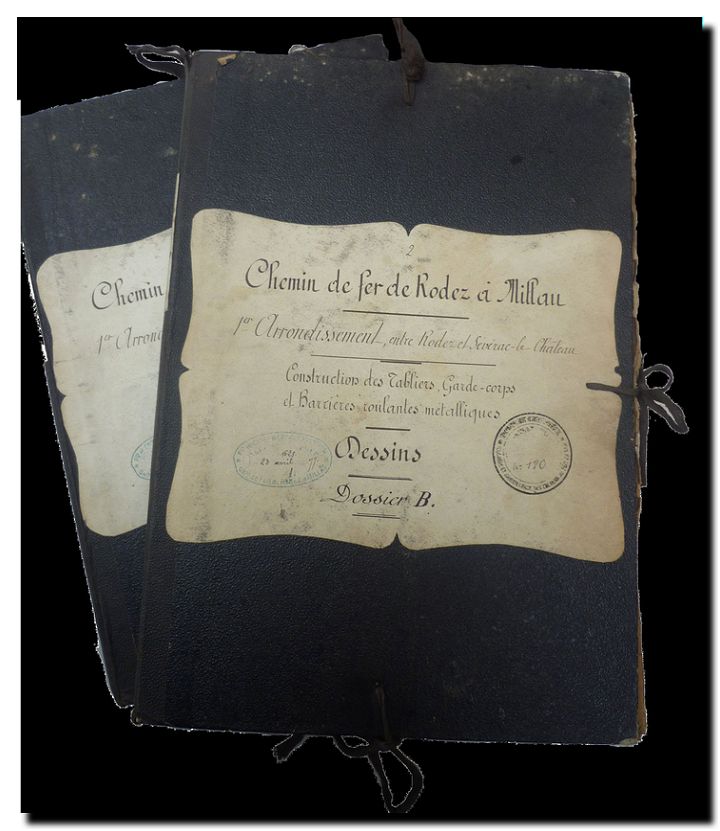
Une mine, les dossiers de construction du Midi !
La ligne de Rodez à Séverac
le Château fut ouverte en 1880, et très logiquement, dans les dossiers
techniques du Midi des années précédentes, figurent ceux des ouvrages
métalliques, notes de calculs des ouvrages et documents graphiques. En
1877 les Barlow sont très présents, pour les ouvrages modestes au
moins. Les pièces écrites des marchés détaillent les dispositions et
estimations. Les passages inférieurs, PI, de 2 et
Nous avons noté que le kg de Barlow est à 0,50 fr, pour
fourniture, forage des trous, transport, pose et peinture quatre
couches. Un rail de
Une cornière spéciale, dite cornière d’arrêt, bloque la poutre longitudinalement sur le rail, tout en permettant la dilatation. Ses deux ailes ne sont pas perpendiculaires pour épouser la forme particulière du rail. L’ingénieur du Midi souligne que le système nous parait excellent…et est employé couramment aujourd’hui par la Compagnie du Midi, c'est-à-dire en 1877. Les adjudications seront terminées fin juillet 1877.
Les Brunel font également partie du paysage : dans les poteaux de portillons et barrières, et comme rails de roulement, en position inversée. Les profils dans les deux cas sont différents. Le Brunel français est le plus connu, car visible en situation de poteau. Le gabarit anglais est utilisé en chemin de roulement.
Posés donc en 1877, et sans doute laminés 20 ans auparavant, ces Barlow
du Midi sont pour certains encore en place en 2013 : pourront-ils
fêter un 150 ème anniversaire en place ? On ne peut que remarquer
la beauté de ces documents. Encre et aquarelle font très bon ménage,
avec une précision du trait vraiment étonnante…Voici
donc quelques exemples, dans l'ordre suivant, (toutes photos JR, droits réservés,
documents A.D.A)
- une barrière du Midi et son portillon : Brunel en
poteaux
- un détail du portillon, et détail Brunel anglais en chemin de roulement, et Brunel français en poteau
- plan type pont, Barlow en appui latéral (cas des photos ci-dessus) : ils sont donc en place depuis 136 ans.
- idem, mais Barlow en appui central ; des cornières spéciales bloquent les poutres sur le rail d'appui.

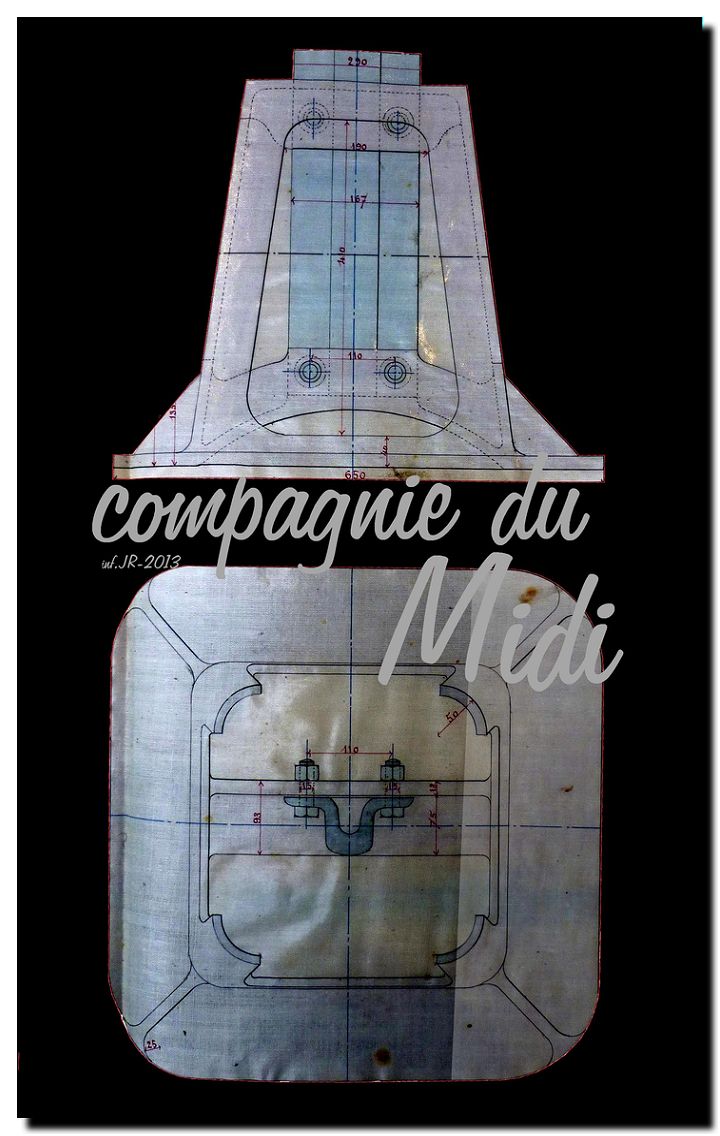
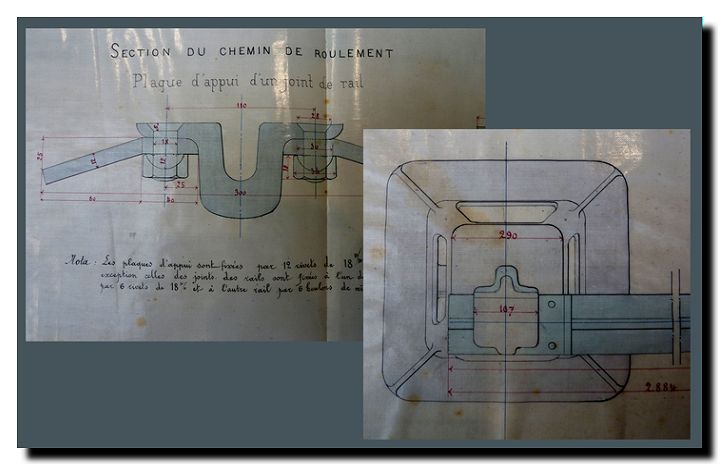
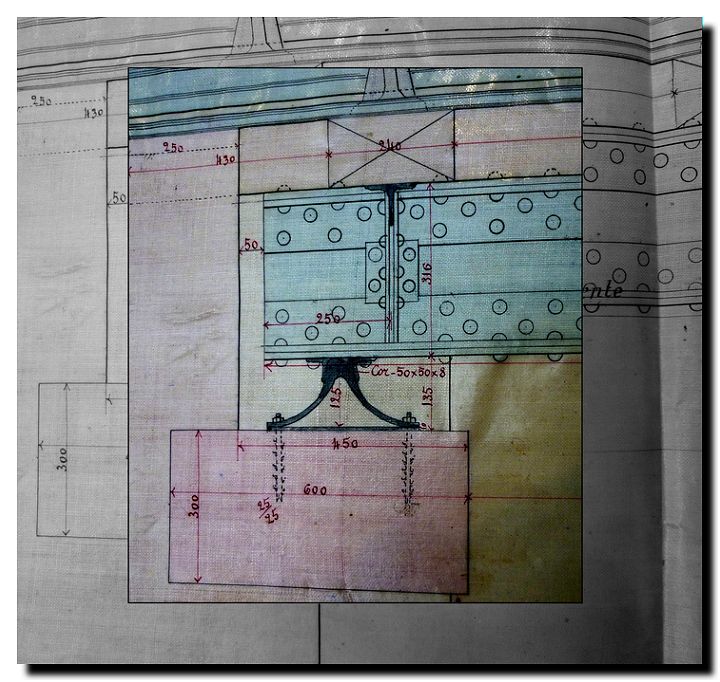
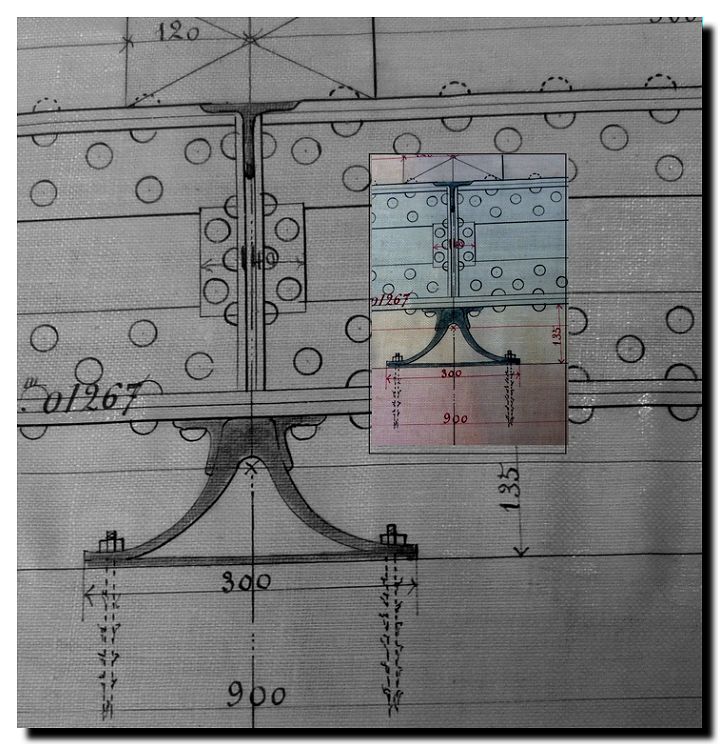
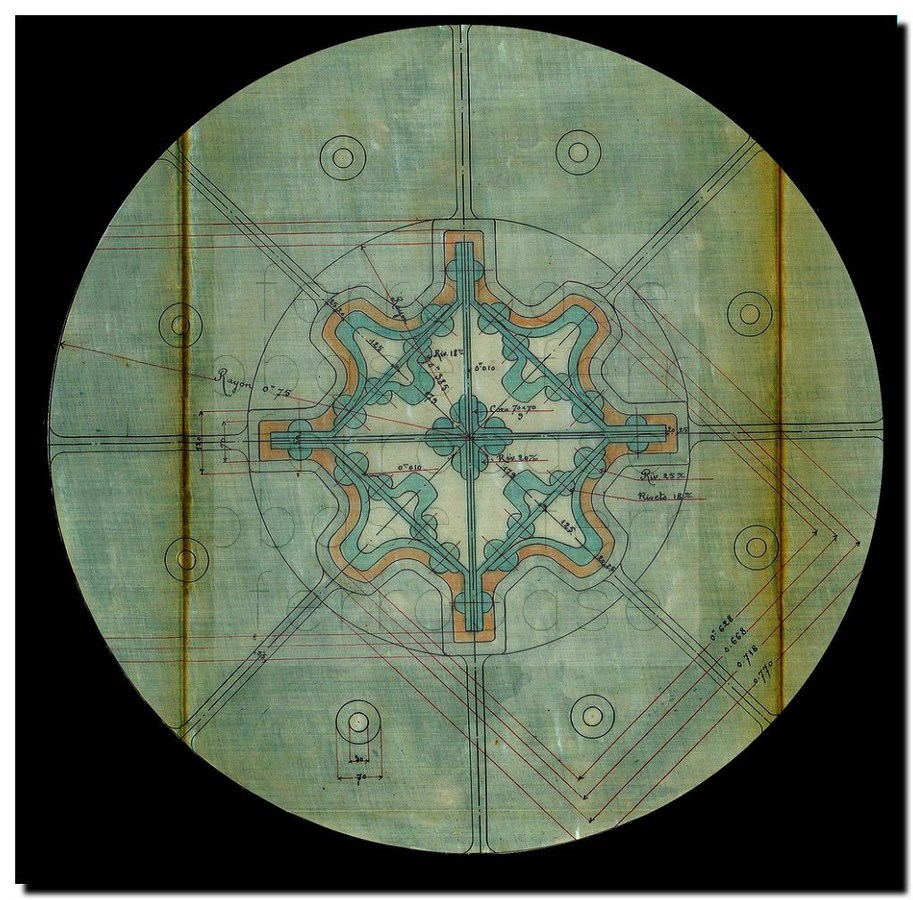
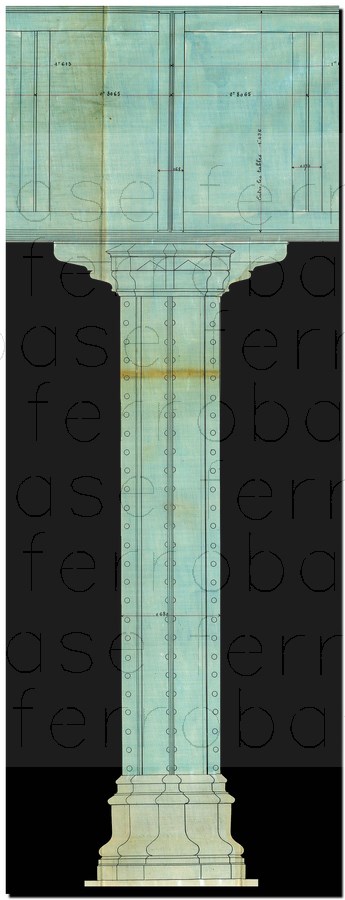
Les deux extraits de plans ci-dessus montrent une utilisation inédite Barlow+Brunel en colonnes, lors de travaux d'agrandissement de la gare de Carcassonne en 1878. Ci-dessous, extraits de plans du Midi, datés de 1883, mettant en évidence l'utilisation intensive ( ! ) de rails Brunel pour un tablier métallique de passage supérieur sur la ligne Béziers Graissessac; (doc Loic). La compagnie du Midi offrait gratuitement les rails à l'entrepreneur...
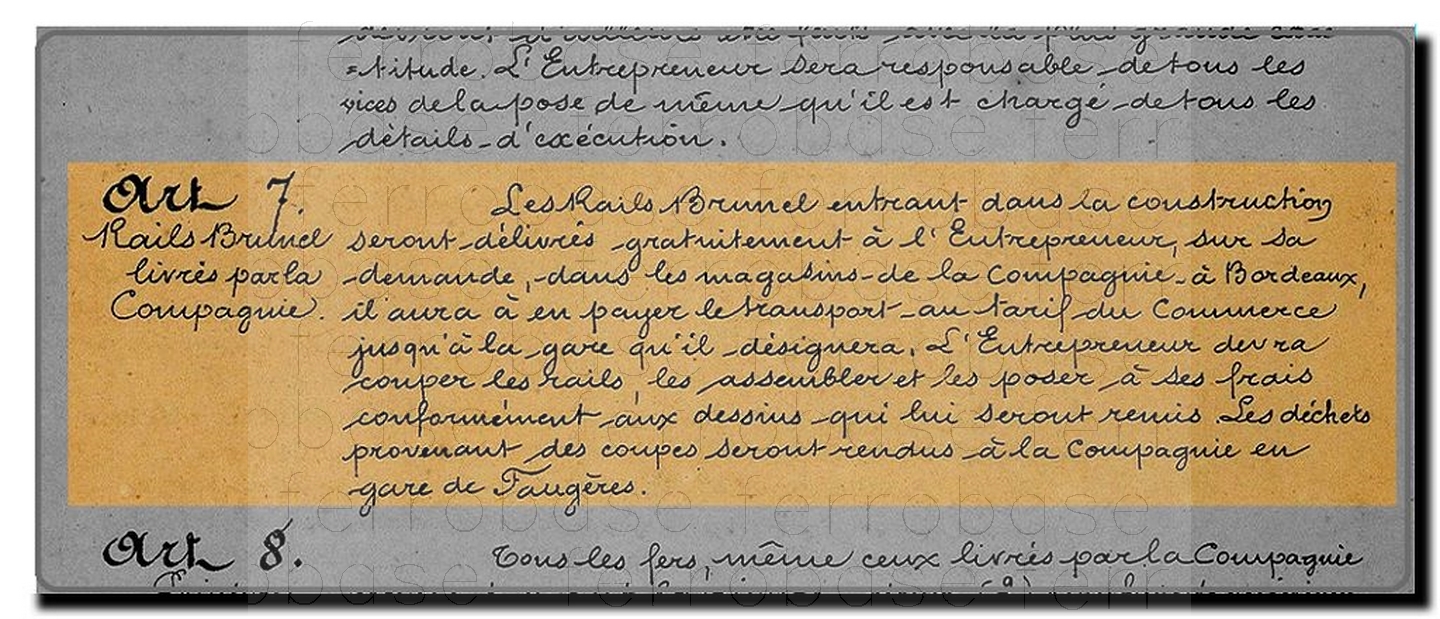
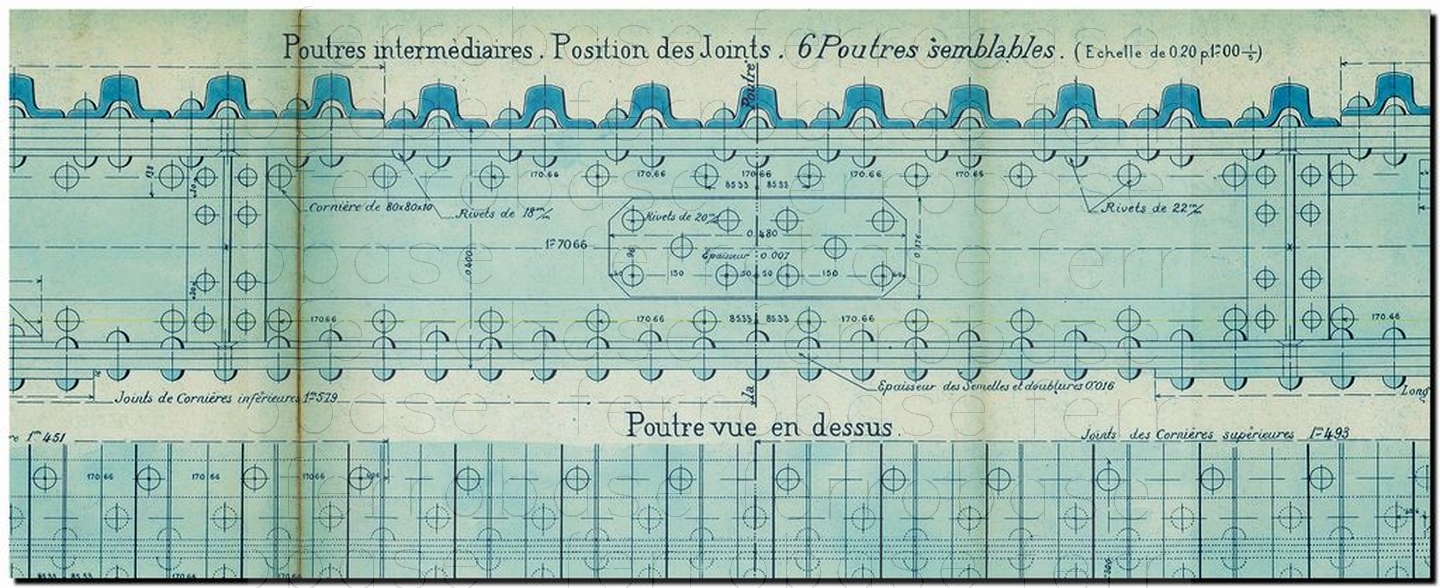
Toujours sur le Midi...une situation certainement unique en 2013 !

Nous avons détaillé dans la saga du Barlow comment ils furent reconvertis dans les ouvrages d’art. Ici, dame Fortune a manifestement voulu nous faire un grand plaisir. Au fond d’une de ces très belles vallées du haut pays de l’Hérault et en lisière des très grands causses du Rouergue, une station, Les Cabrils. C’est sur une des lignes du Midi. Autrefois les trains marquaient l’arrêt ; aujourd’hui aussi, ce qui est plus que surprenant, mais bien heureux ! A quelques dizaines de mètres, deux ponts routiers bien modestes sur un chemin qui l’est tout autant tiennent compagnie à la voie. On peut les rassembler sur la même image. Et ce rapprochement est vraiment historique et d’un intérêt patrimonial certain. L’un des ponts est une structure poutres métalliques sur laquelle des rails Brunel portent les blocs de pierre et le ballast du tablier. L’état de corrosion des poutres comme des rails est très avancé. Le pont permet le passage d’un canal d’amenée d’eau.
De l’eau, il en passe également sous l’autre pont, mais là c’est un joli ruisseau venant de la montagne voisine. Le pont est jumelé avec un pont ferroviaire du Midi. Celui-ci a été reconstruit et se présente maintenant avec une belle dalle en béton armé. Les constructeurs, qui ont sûrement pensé au patrimoine, ont donc démonté les Barlow qui avaient le même usage que les Brunel précédents et voisins. Et bien gentiment, ils ont permis de reconstruire le pont routier avec ces rails, astiqués et protégés des outrages du temps par une belle couche de peinture noire, avant réemploi, peut-être même le troisième : d’abord sur une voie du Midi, puis en usage de pont ferroviaire, et maintenant routier ! Nous leur souhaitons une très longue vie, car le trafic routier ne va pas les fatiguer...La structure est ici aussi portée par des poutres métalliques.
C’est ainsi que nous avons donc côte à côte ces deux témoignages de reconversion, Barlow et Brunel. Avouez que ce doit être bien rare ! De plus, l’un est très probablement d’Aubin, et l’autre de Decazeville ou alors ils sont anglais tous deux, mais comment le savoir ? Sur cette interrogation, voici donc deux images de ces duettistes de choc, retrouvés en Midi. Et pour voir les 33 images du thème, dont il serait dommage de se priver, vous devrez repasser par la page de menus et faire un clic sur le chapitre 4 : le diaporama est le quinzième de la liste. Vous y trouverez également, ce qui n'est pas surprenant, des coupons de rails double champignon, en situation de reconversion, aux Cabrils et ailleurs. Ils ont, croyons nous, toute leur place, dans la galerie des ancêtres.




Juin 2019, ci-dessous : au débouché nord du tunnel des Cabrils -ici photo du portail sud, avec des nuées de papillons blancs venus chercher le frais- et à une centaine de mètres de la station, les Barlow du pont routier -autrefois rails du Midi - regardent passer les trains...
▼
▼
▼
 |
Il est possible de suivre la trace des rails déposés. La Compagnie du Midi ne les a pas tous envoyés au feu pour se refaire une autre santé. Les Départements du sud-ouest ont rapidement compris l’intérêt de les utiliser dans des travaux divers. Voici quelques exemples de citation de rails Barlow et Brunel retrouvés dans les rapports des Préfets aux Conseils Généraux. Les rapports des départements montagnards des Pyrénées, curieusement, ne figurent pas dans les ressources de la Bibliothèque nationale (Gallica)...
Dans le Lot et Garonne, en 1863 :
"...d‘autres
améliorations ont marqué la période...Le remplacement des rails Barlow
et la pose de la double voie sont terminés depuis le 20 décembre 1862
sur la longueur totale de 476 kilomètres entre Bordeaux et Cette."
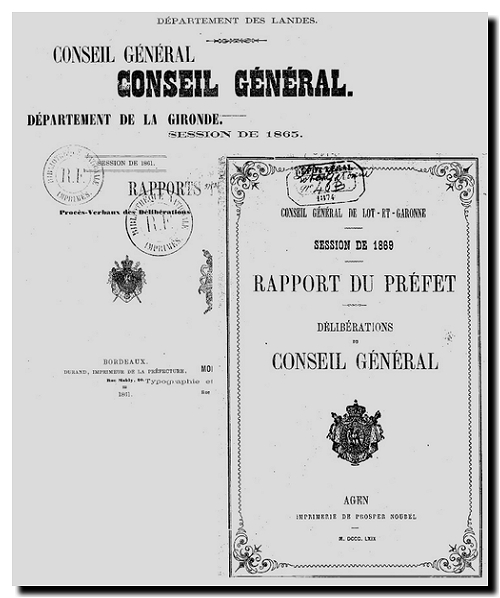 Dans ce même département ils vont donc être utilisés sur
les chemins vicinaux. Le service départemental a fait " l’étude d’un système de constructions
métalliques appropriées...pour l’établissement de ponts....J’ai repris (écrit
l'Agent voyer en chef) les
négociations avec la Compagnie des Chemins de Fer du Midi pour obtenir
la livraison à bon marché, dans les différentes stations de la ligne
ferrée, de rails Barlow hors d’usage pour le service de la voie, et
très propices pour l’établissement de tabliers de ponts sur les chemins
vicinaux."
Dans ce même département ils vont donc être utilisés sur
les chemins vicinaux. Le service départemental a fait " l’étude d’un système de constructions
métalliques appropriées...pour l’établissement de ponts....J’ai repris (écrit
l'Agent voyer en chef) les
négociations avec la Compagnie des Chemins de Fer du Midi pour obtenir
la livraison à bon marché, dans les différentes stations de la ligne
ferrée, de rails Barlow hors d’usage pour le service de la voie, et
très propices pour l’établissement de tabliers de ponts sur les chemins
vicinaux."
L’intérêt est économique: gain sur les matières et gain sur la
main d’oeuvre. Les ponts surbaissés en maçonnerie sont beaucoup plus
coûteux, de l’ordre de deux fois. « Le
Conseil d’Administration de la Compagnie, après en avoir délibéré, nous
a fait l’offre de la cession de ces rails au prix de 140 fr la tonne ou
0,14 le kilogramme " (1867).
En 1869 une brochure établie par l’agent
voyer Théodore Grimard d’Agen (Lot et Garonne) propose une méthodologie
: emploi des poutres droites en
tôle de fer et du rail Barlow à la construction des tabliers de ponts.
Cela souligne bien l’intérêt de cette utilisation détournée. Une
gratification de 500 fr à "titre de
témoignage de satisfaction" sera votée à son intention par le
Conseil Général en 1869. Cette publication de 88 pages et six
planches, (imp. Noubel à Agen ) est plus que confidentielle, rarissime
n'est même pas le terme exact ! Voici cependant quelques extraits
des Tabliers
métalliques dallés. L'essentiel du texte est à destination des
projeteurs, fournissant caractéristiques et méthodologie de calculs et
de réalisation. Pour les ouvrages modestes de peu de portée Grimard
propose les Barlow comme poutres principales, simples ou accouplées,
c'est à dire deux rails rivetés, pour une portée plus importante. Dans
les cas les plus conséquents, les Barlow sont utilisés transversalement
à l'axe de l'ouvrage, comme appui des poutres droites du tablier. Les
deux principes ont effectivement été utilisés. Ce dernier usage en
tablier fut celui du pont d'Arcole à Paris ou du viaduc de l'Ady en
Aveyron.
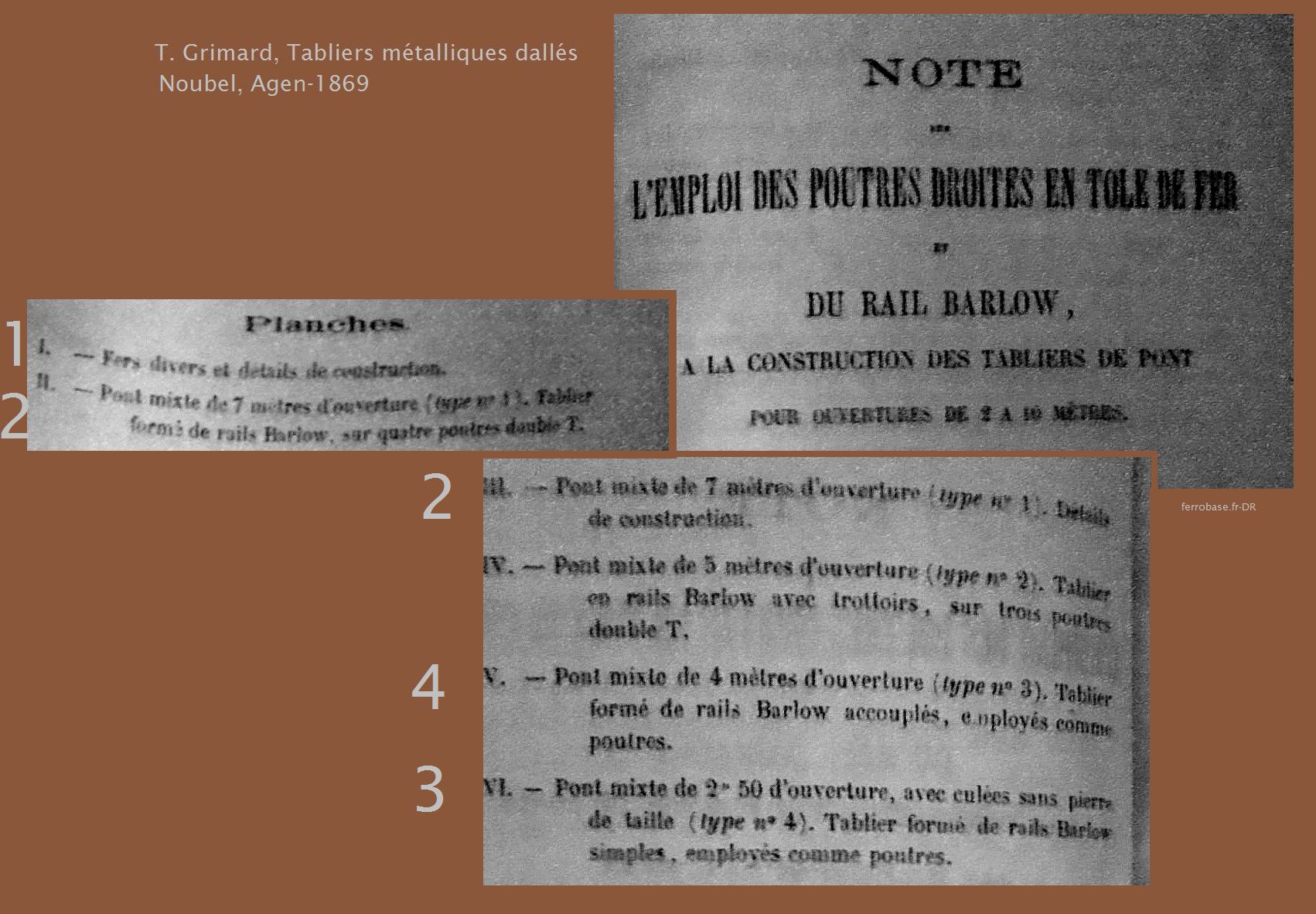
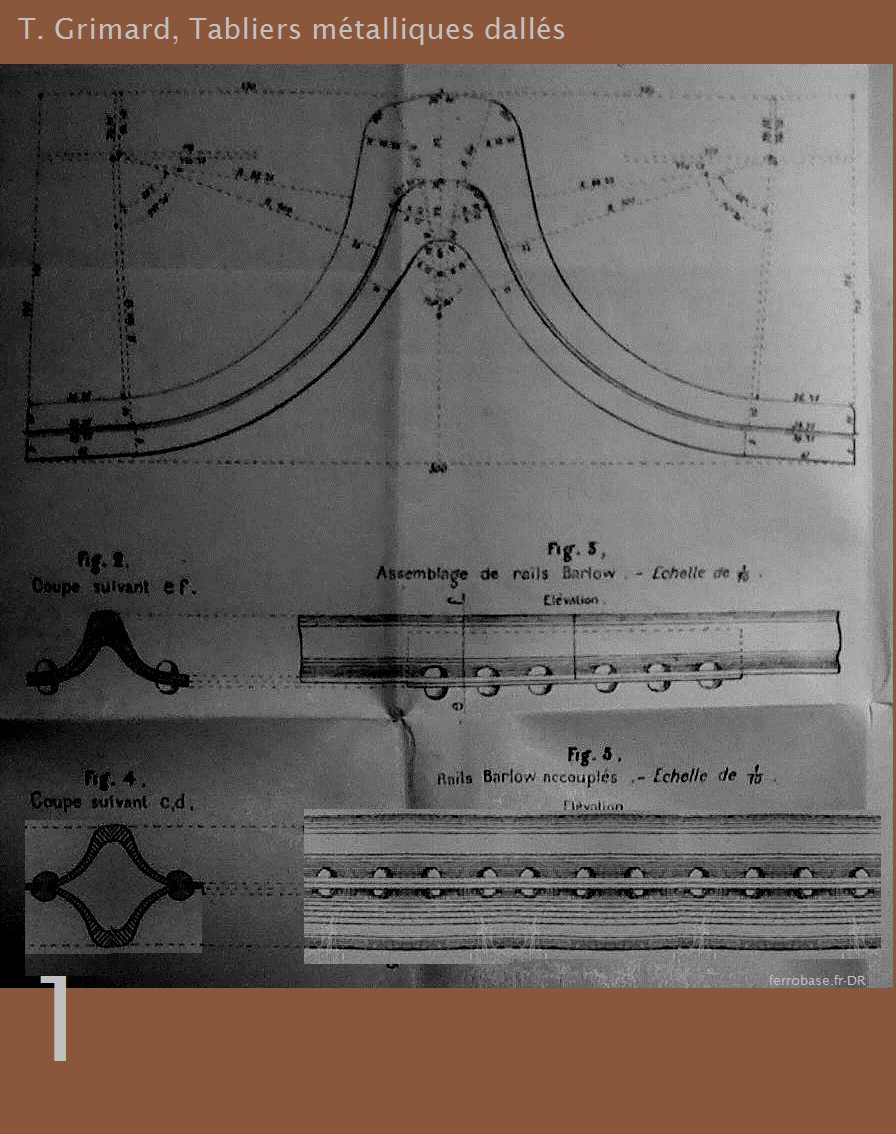
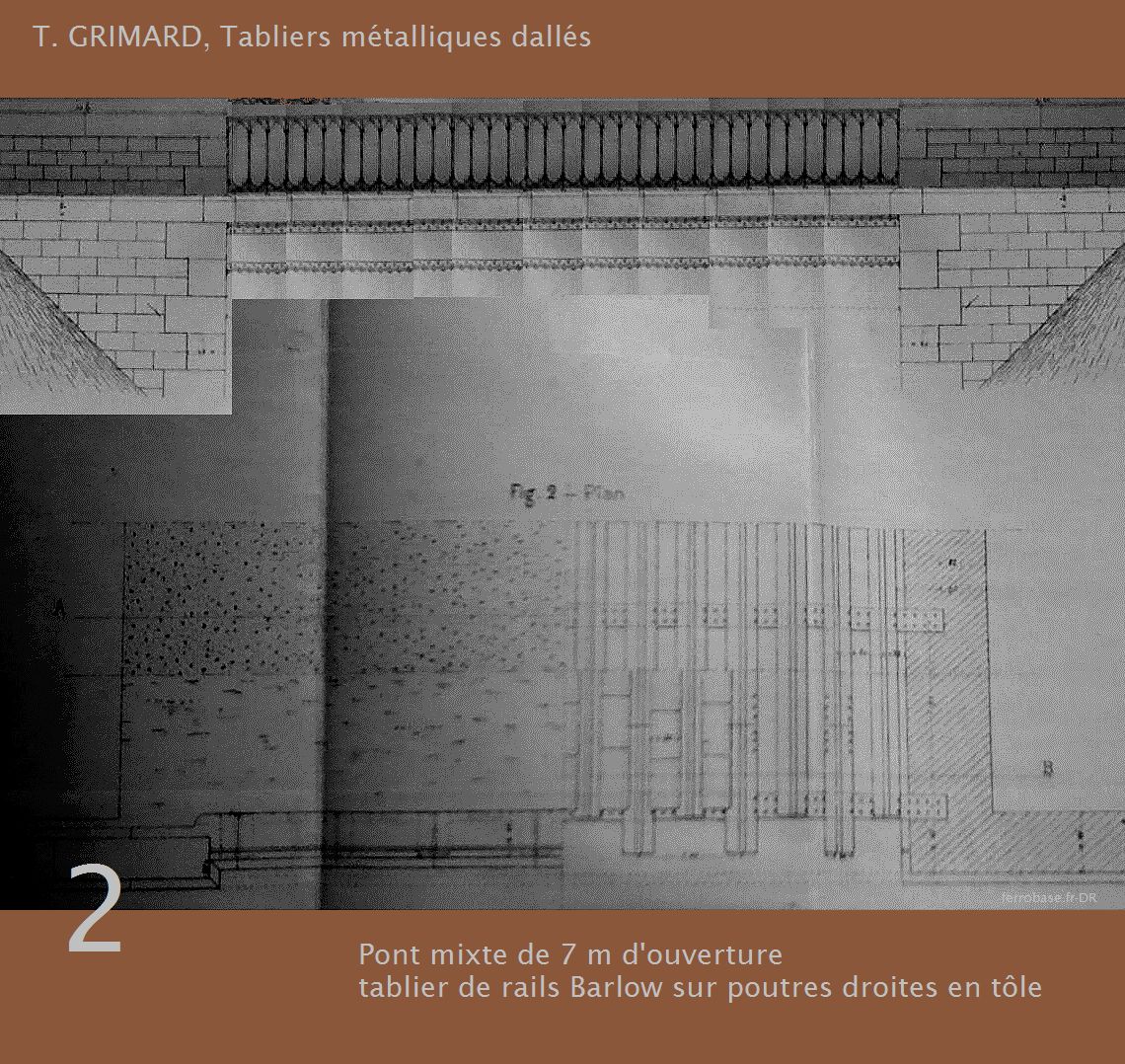
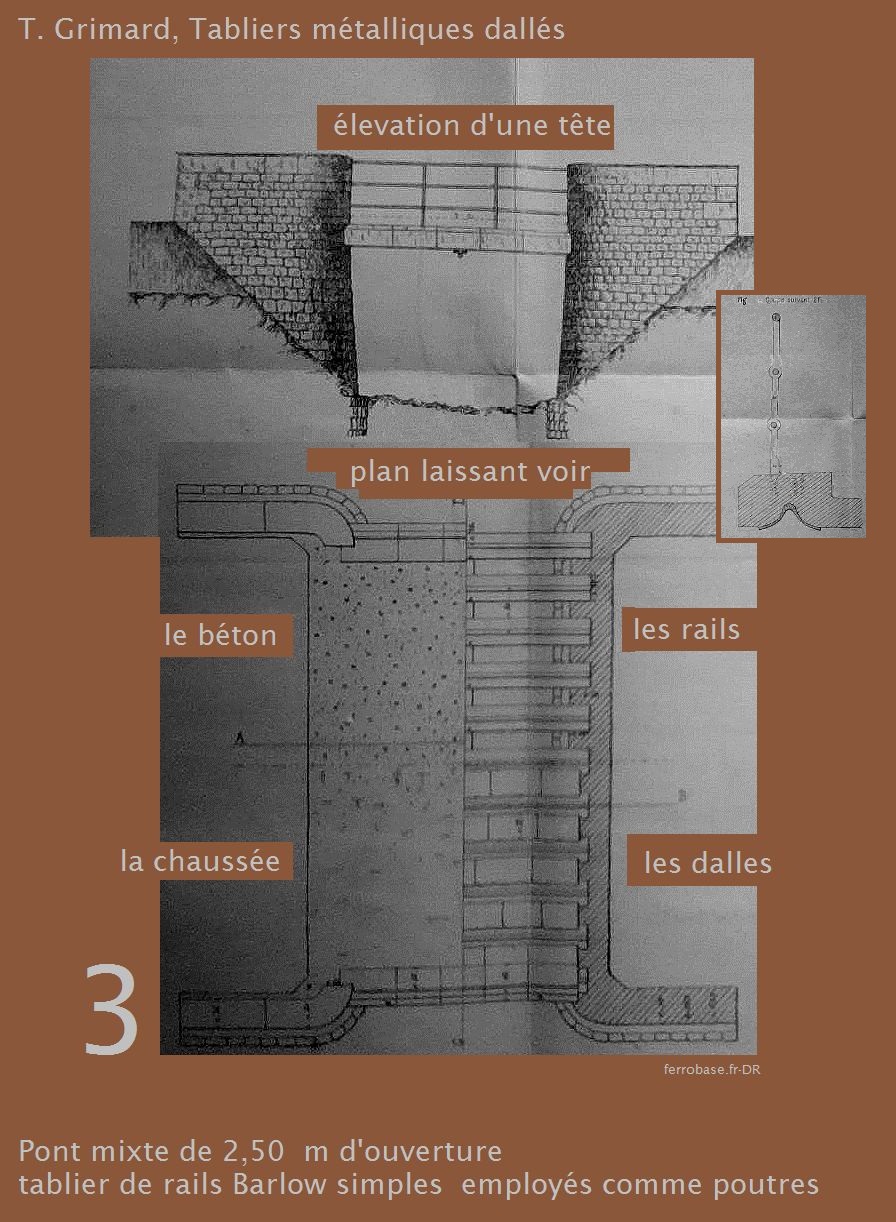
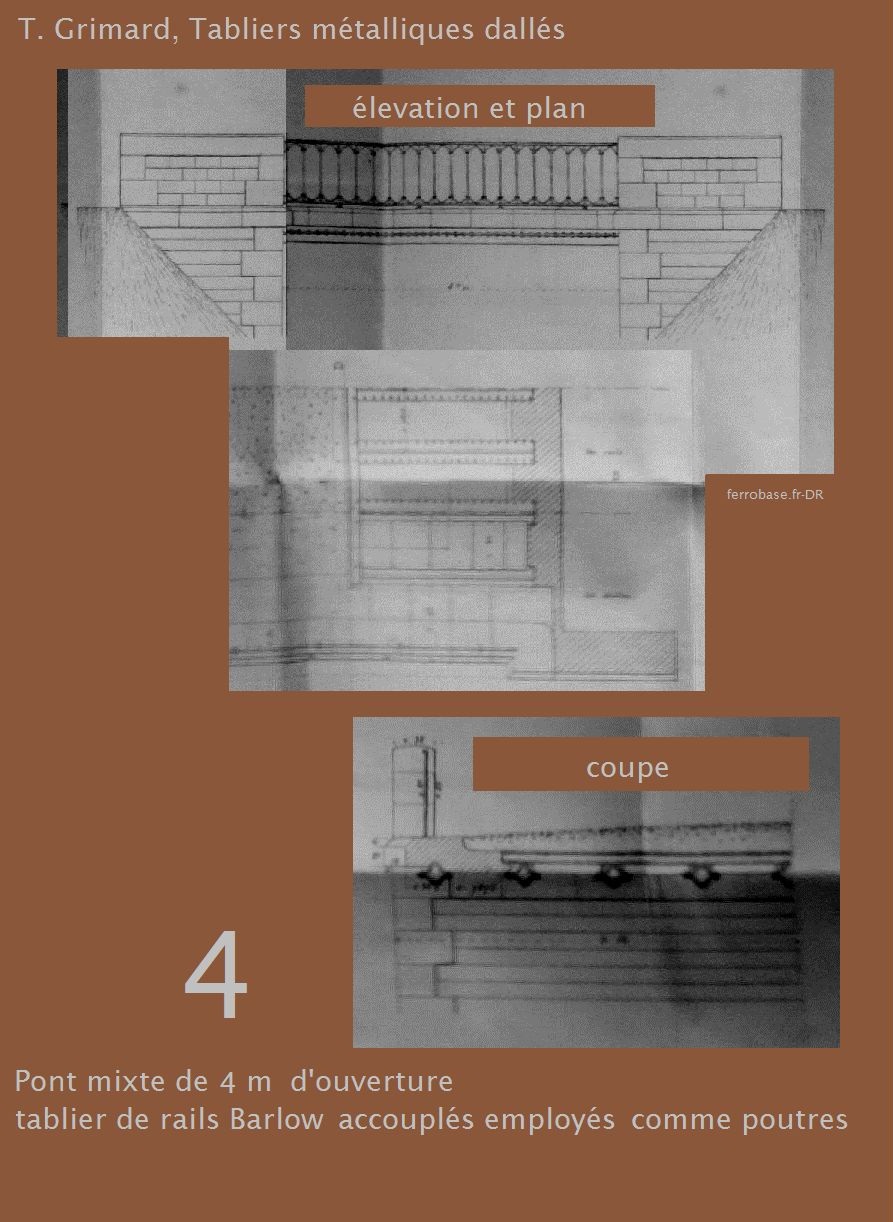
En 1871 le pont de Barnage sur le Dropt, pont en treillis, dallage sur rails Barlow et contreventement bas par rails Brunel pour les entretoises, d'une portée de 24 m, est réalisé. Un chapitre spécial du rapport est intitulé tabliers métalliques (p151, sqq), et rappelle à nouveau l’intérêt de ce type de ponts, dont l’utilisation est toutefois réservée aux chemins vicinaux. Plusieurs exemples sont cités.
Ces quelques années de construction fébrile d'infrastructures
Barlow vont connaître un coup d'arrêt en 1872. En 1871 le prix
des fers a augmenté de 40%, et celui de la main d'oeuvre a suivi. La
Compagnie du Midi a augmenté le prix à 18 fr les 100 kg (+28% )
et le prix des 100 kg de rails Barlow accouplés mis en place passe de
25 à 32 fr (28%) ; d’ou l’abandon du Barlow et substitution d’une
solution de dalles de schistes des Pyrénées, dalles schisteuses de
Lourdes : l’économie est de 27 % et correspond donc à peu près à
l’augmentation des Barlow. (rapport 1872,08).
Notre périple nous a donc conduit en Gironde,
Landes, et Lot et Garonne. Les rapports et délibérations du Gers et du
Tarn et Garonne sont muets sur ces termes de Barlow et Brunel...
Si vous nous lisez depuis ces départements du
sud-ouest, il est donc plus que probable que sur quelques chemins
vicinaux, subsistent quelques uns de ces modestes ouvrages. Les images
du diaporama montrent des exemples de tels détournements d’objets
ferroviaires en Hérault et Aveyron.
Dans le département des Pyrénées Atlantiques, une passerelle quai St Bernard utilisera les rails Barlow en 1869.
C'est dans un tout autre domaine, celui de constructions diverses, que vous pourrez découvrir deux applications insolites dans le diaporama consacré à "B and B". La première halte sera à Arcachon, sur les hauteurs. Au Belvédère très exactement, construit par M. Régnauld : vous ne serez donc pas surpris de retrouver des rails Brunel dans les montants et renforts de la structure. Une plaque d'information soulignant cette utilisation serait bienvenue...Un petit détail : ces rails ne portent aucune marque distinctive. Leur origine : anglais, Aubin, Decazeville, ou ailleurs ? Deuxième halte, sur l'autre rive de la Manche. Evidemment, les ingénieurs anglais ont eu à la même époque la même idée et ont utilisé Barlow et Brunel dans des situations tout aussi insolites ; par exemple, à Clevedon, au sud ouest de la grande île. Il s'agit ici d'une jetée, objet touristique ne menant nulle part, mais soigneusement entretenu, et montrant une utilisation des Barlow rarissime. A découvrir donc en images, chapitre 4.
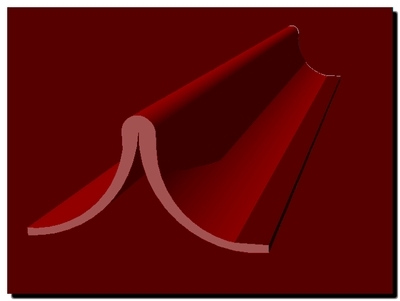
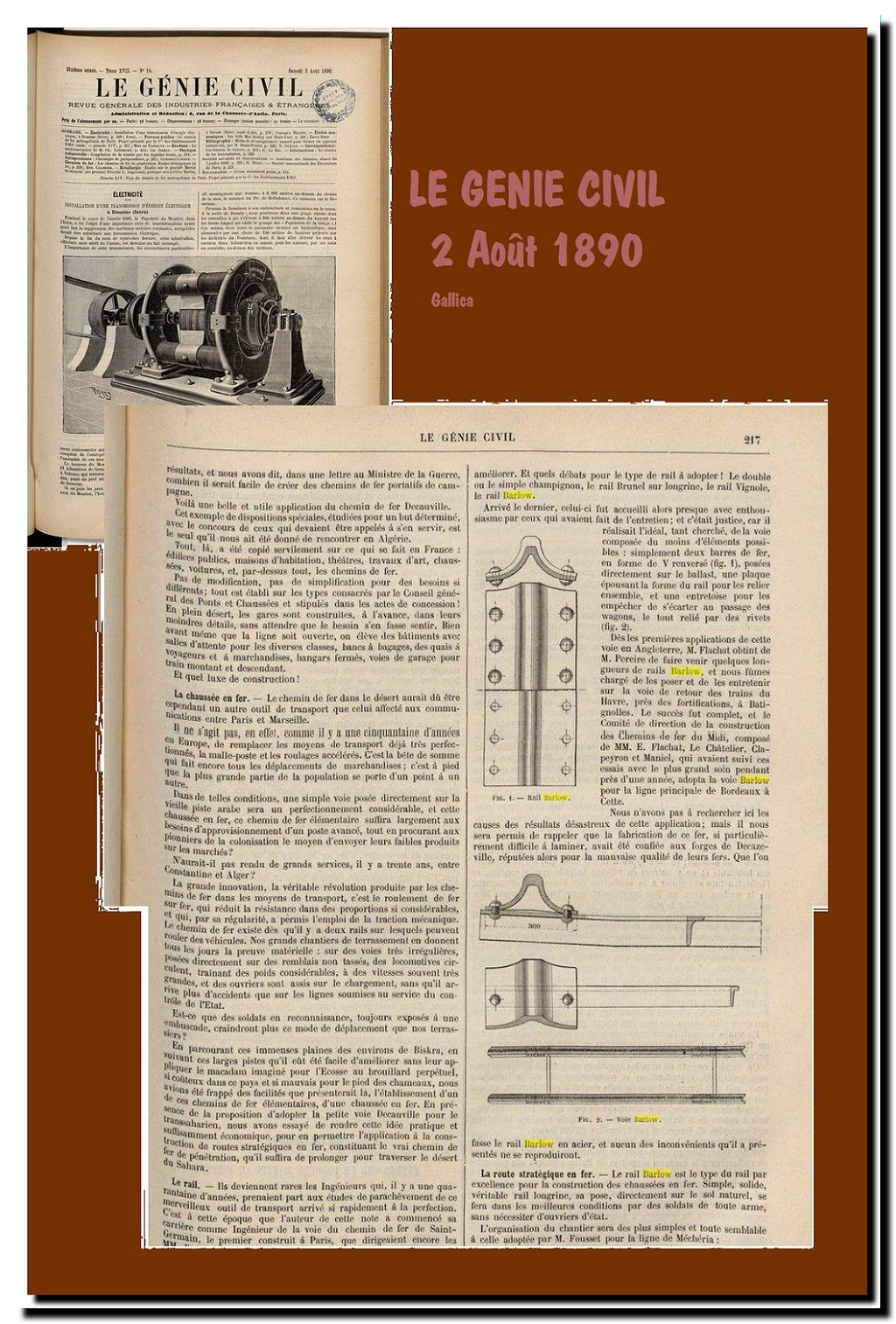 douter
( ! ), vers 1890, l'utilisation ferroviaire des rails Barlow est
toujours
d'actualité, ce qui ne peut manquer d'étonner : des projets français de
voie en Afrique du Nord évoquent très sérieusement son utilisation, en
évitant bien
sûr l'emploi de traverses, et leur entretien. La revue Le Génie Civil publiera plusieurs
résumés d'études. Et l'ingénieur de service soulignera les résultats désastreux anciens, dûs aux fers de
Decazeville, réputés mauvais....Les
aciers de 1890, meilleurs, devaient dit-on remettre cette utilisation
d'actualité. Il n'en fut rien.
douter
( ! ), vers 1890, l'utilisation ferroviaire des rails Barlow est
toujours
d'actualité, ce qui ne peut manquer d'étonner : des projets français de
voie en Afrique du Nord évoquent très sérieusement son utilisation, en
évitant bien
sûr l'emploi de traverses, et leur entretien. La revue Le Génie Civil publiera plusieurs
résumés d'études. Et l'ingénieur de service soulignera les résultats désastreux anciens, dûs aux fers de
Decazeville, réputés mauvais....Les
aciers de 1890, meilleurs, devaient dit-on remettre cette utilisation
d'actualité. Il n'en fut rien. 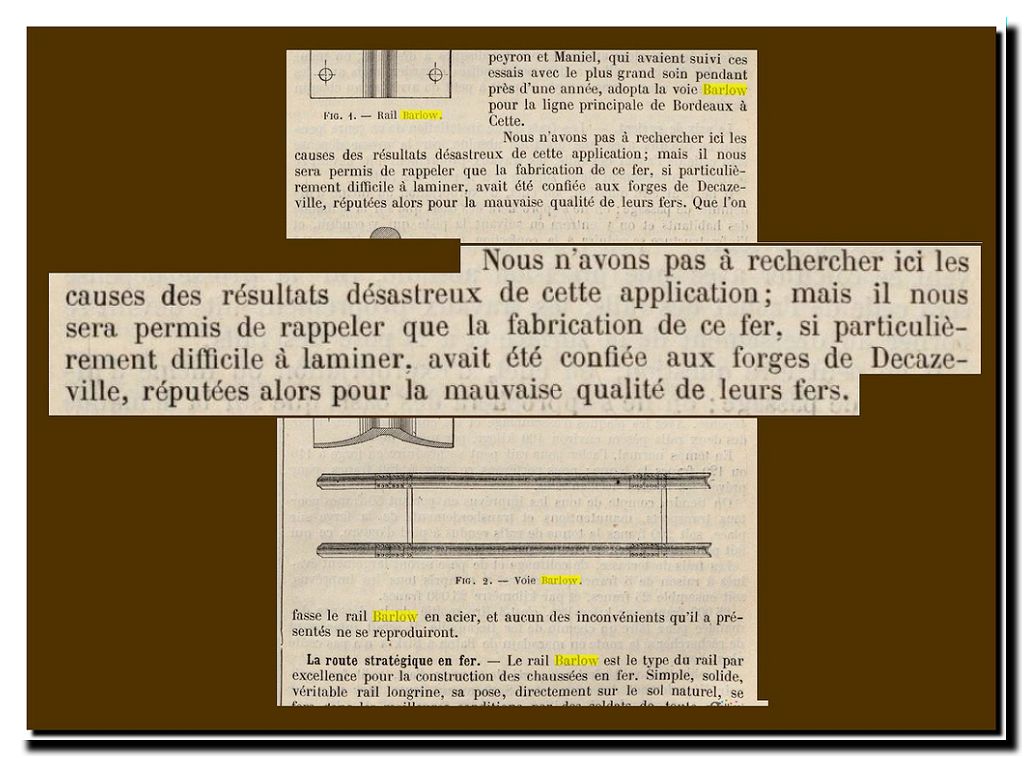
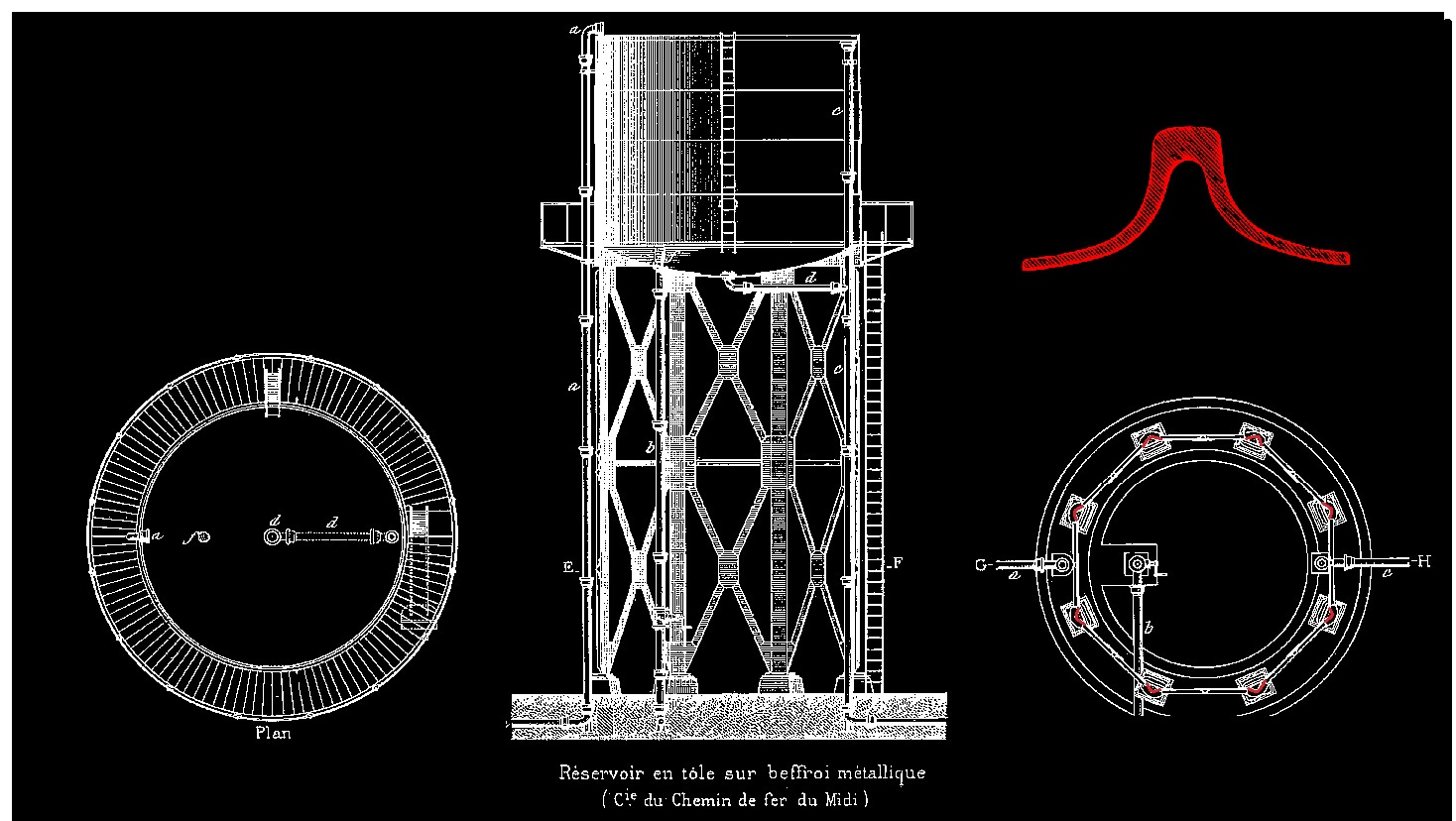
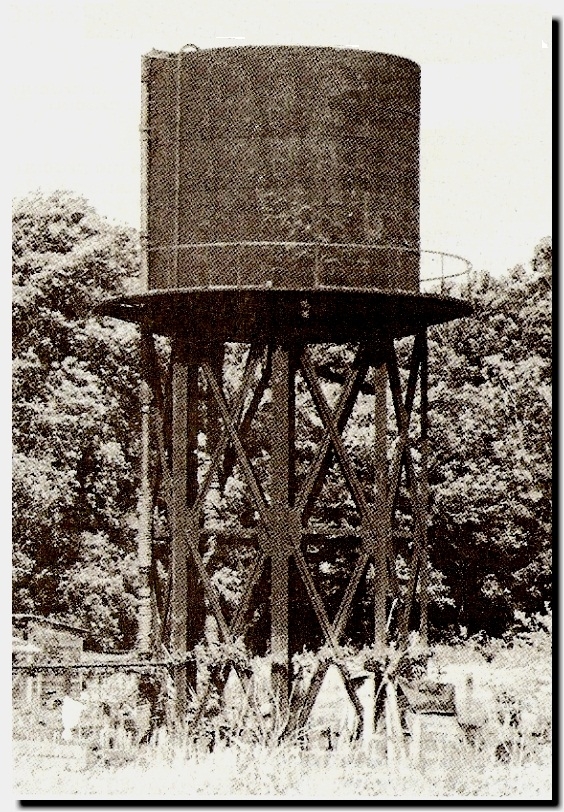


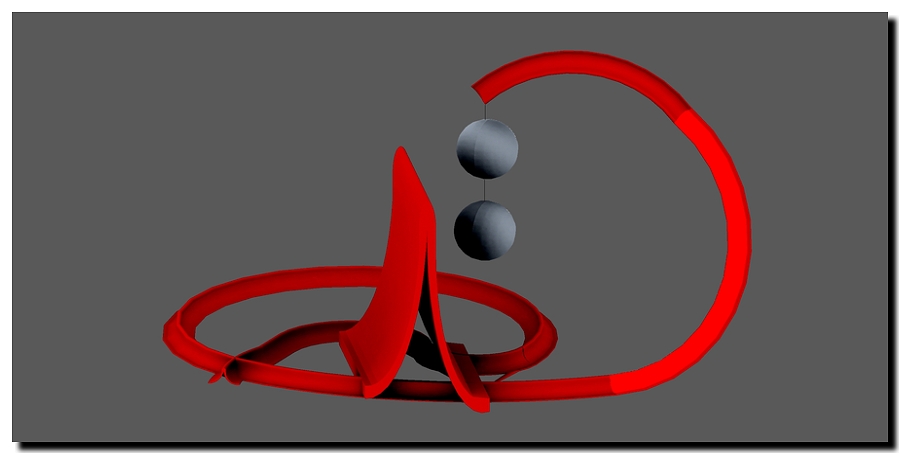
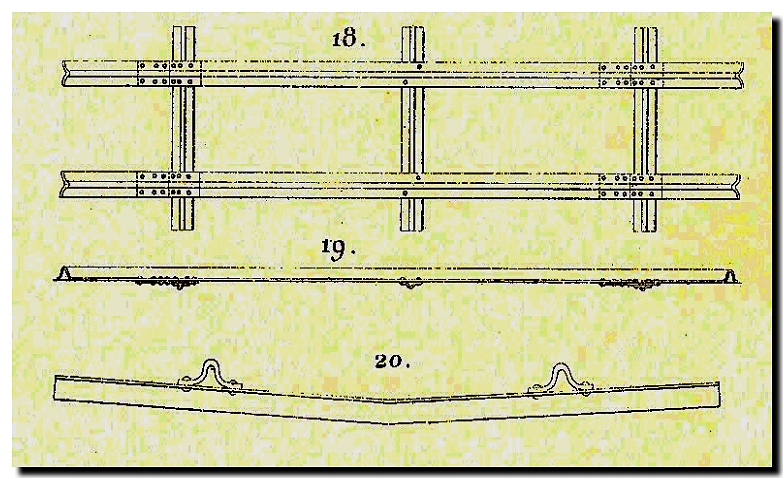
 < clic
< clic



Du causse à l’océan…

Le minerai du Comtal, après passage par Decazeville, devient fonte puis acier….et à l’occasion rail, rail Barlow par exemple, vers 1855. Parmi les multiples usages non ferroviaires, nous avons évoqué les reconversions dans des ouvrages de génie civil, comme poutres de ponts ou poteaux ou éléments d’appuis… Voici une utilisation différente. Un écho sur un forum (Trains du Midi) avait évoqué cette utilisation. De passage en pays basque, voici donc deux bollards.

Le printemps se fait attendre, et les couleurs sont très évocatrices du temps « humide ». Les Barlow sont donc rivetés par deux, et le vide est rempli de béton. Leur hauteur libre au dessus du quai est de l’ordre du mètre. Tous les autres bollards du quai ou du port sont différents, et la présence de ces antiquités attire l’œil. Bien sûr la mer a fait son travail : la rouille est bien présente, et la matière bien absente par endroits, ce qui doit évidemment interdire tout emploi de cordes, mais pas de chaînes... Si vous passez par là, ne manquez pas la visite ! C’est où ? Ah oui, c’est à Socoa, c'est-à-dire dans les faubourgs de Saint-Jean de Luz. Nos images datent de mai 2013, et ces Barlow devaient être passés par la gare voisine. Du causse à l’océan, un bel itinéraire...…

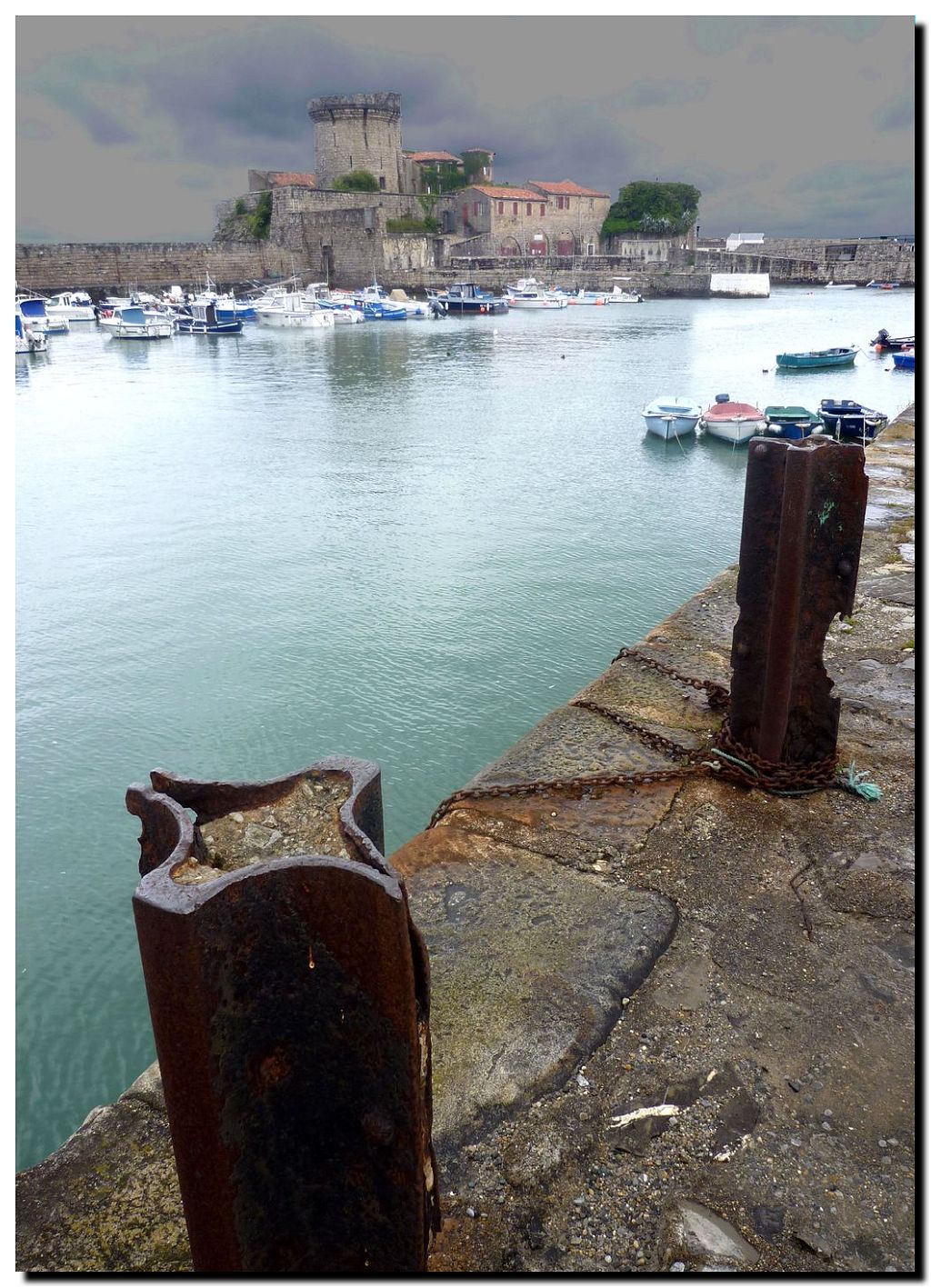






 ◄
clic
◄
clic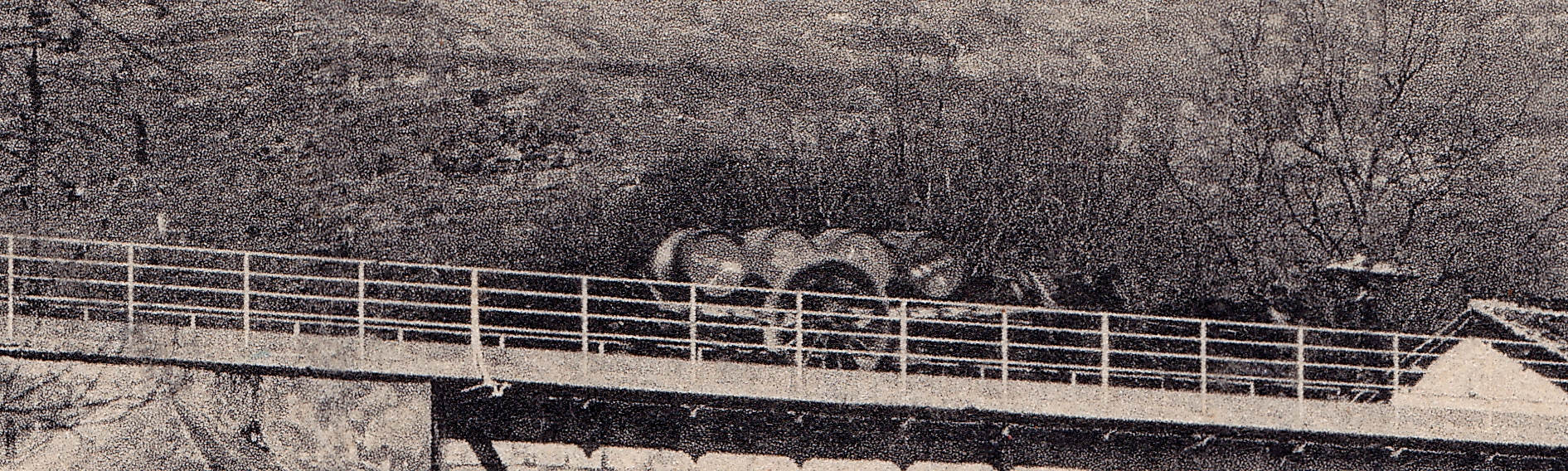






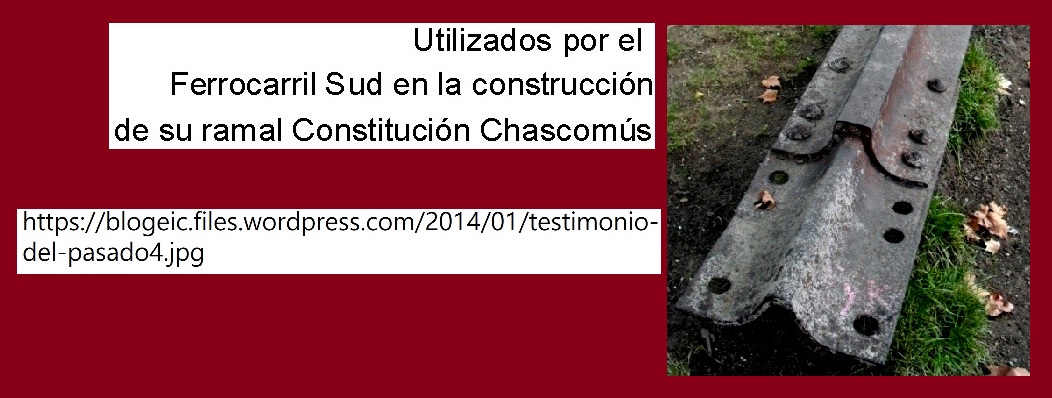

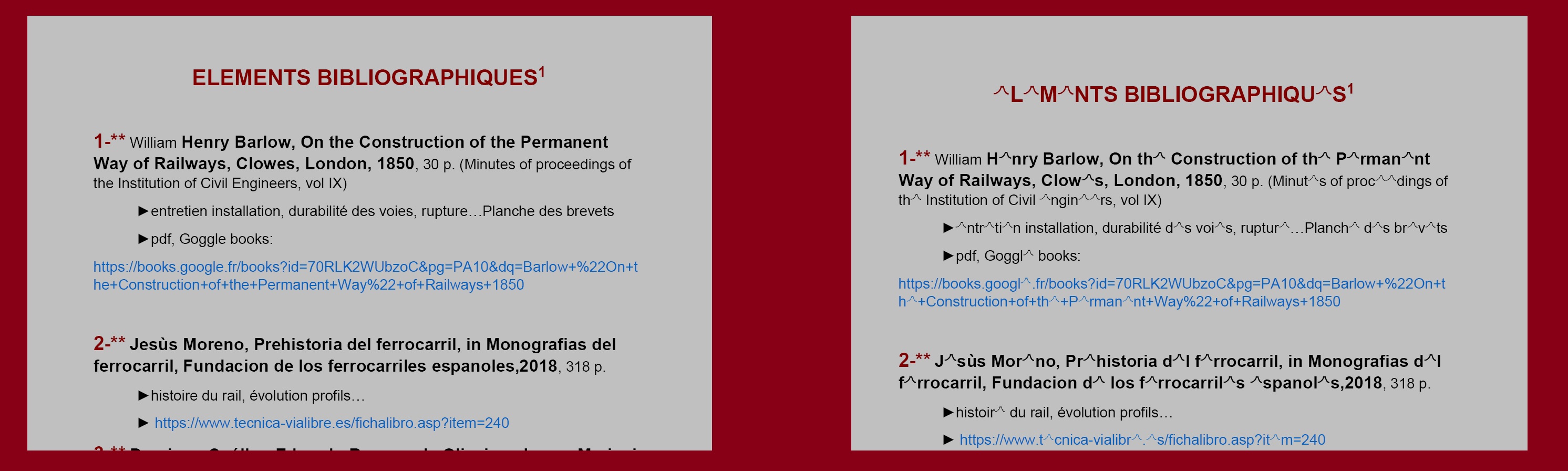









Nicolas Cadiat, d’Arcole à Malakoff, co-auteur du viaduc ?
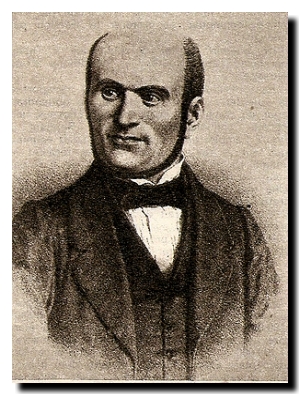
1796 : bataille d’Arcole, et 1855, celle de Malakoff.
Pour la vérité historique, il faut se souvenir que d’Arcole n’a peut être rien de commun avec Bonaparte ; le nom du pont lui fut donné après la mort d’un jeune républicain le 28 juillet 1830 ; son nom ? Il s’appelait d’Arcole…et le pont dont nous évoquons les caractéristiques est celui de Paris, premier pont parisien en fer d’une seule travée. C’est une des hypothèses, l’autre couramment admise, étant napoléonienne…
A l’époque où le viaduc de l’Ady voyait le jour, il y avait deux doctrines opposées sur la construction des ponts métalliques : l’emploi de la fonte, emploi traditionnel, s’opposait à celle de la tôle et du fer forgé. Pour la fonte, un des plus ardents ingénieurs adepte du matériau est Guettier ; pour la tôle, c’est sans aucun doute, Cadiat et son collègue Oudry. Nicolas Cadiat est ingénieur des arts et métiers, tout comme Oudry, qui se destinera aux ponts et chaussées. Le parcours de Nicolas Cadiat va le conduire à fréquenter et diriger de grandes installations métallurgiques, et son succès lui vaudra d’être remarqué et appelé par François Cabrol à Decazeville, pour y être l’ingénieur en chef de la société, de 1842 à 1848. Il poursuivra ensuite à Paris une activité de concepteur de grands ouvrages. En 1855, inauguré le 15 octobre, il réalise le pont d’Arcole, une véritable prouesse, en fer, et non en fonte, et le premier pont parisien d'une seule portée.
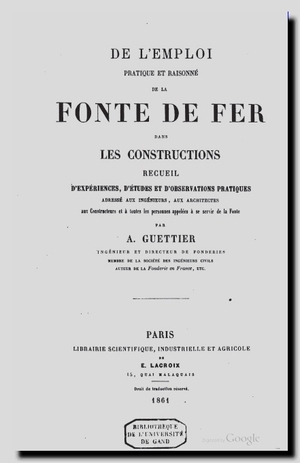
A une échelle moindre, Cabrol, pour le viaduc de l’Ady, ne pouvait que suivre l’exemple de celui qui avait été son ingénieur durant sept ans, ayant sous les yeux un véritable succès de génie civil : réaliser un pont en arc, solution parfaitement efficace, pour faire travailler au mieux la structure, en toute prudence. Les deux arcs de Malakoff non concentriques, l’épaisseur de 70 cm à la clef, différente des 1,10 m à la naissance, sont des caractéristiques parfaitement prônées par Cadiat et Oudry : 0,38 m à la clef et 1,10 m à la naissance pour les arcs d’Arcole. Britannia et Conway, dont alors on parle beaucoup utilisent également la tôle pour base des éléments tubulaires. Le principe tubulaire est d’ailleurs parfaitement rejeté par Cadiat, (Notice sur l'emploi de la tôle du fer forgé et de la fonte dans les ponts,1853, dans Bulletin du musée de l’Industrie, J.B.A.M. Jobard, tome 19, .p210 et suivantes, Bruxelles, 1851, Google books) : « quant aux poutres rectangulaires employées à former des ponts, sans le concours d’arcs placés en dessous, en manière de voûte, nous nous permettrons de les signaler comme de très mauvais modèles à suivre ».
Et, pour ce qui est de la ressemblance, il n’y a pas que cela !
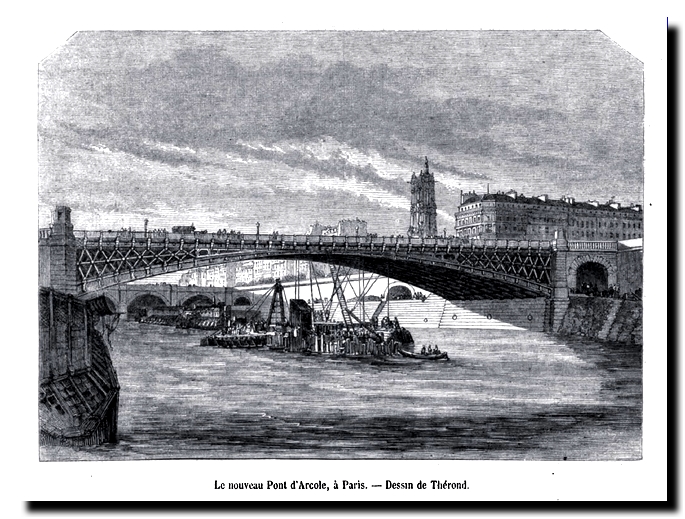
Pont
d'Arcole, Magasin pittoresque, vol 25,p4,1857 (Google books)
D’autres similitudes existent entre ce pont d’Arcole de 80 mètres de portée, et Malakoff. Ces deux ouvrages sont similaires : des poutres en double T forment les arcs, raidis transversalement. L’espacement est de 1,26 m entre arc à Malakoff, et 1,30 m pour Arcole. De plus, sur les arcs, dans les deux cas, un platelage de rails Barlow vient trouver place ! Similitude et identité : l’un est absolument identique à l’autre, et réciproquement, à l’échelle près. Le plancher de rails Barlow est parfaitement décelable sur les photographies et dessins de Malakoff, les rails étant, nous l’avons expliqué, rivés sur les arcs. Pour le pont d’Arcole, les photos actuelles ne permettent pas de les repérer : absents sur les arcs, ils avaient en fait leur place en partie supérieure, pour réaliser le tablier de circulation, soutenant le ballast ; ont-ils disparus après l’accident de 1888, un affaissement du pont qui a nécessité sa restauration ? Oui, car cette restauration s’est soldée, on le sait, par un allègement de l’ouvrage et du tablier. Et les Barlow, c’est du lourd ! Actuellement le tablier est constitué par une dalle en béton. Les Barlow ont donc disparu de Paris !
Le beau dessin ci-dessus montre le pont dans sa phase terminale de construction : les arcs sont en place, les tympans également. Il s'agit donc de finir le tablier, le ballast. Et il n'est pas impossible que la pièce qui est levée depuis la barge soit un rail Barlow qui va donc servir de plancher à ce ballast.
François Cabrol a donc parfaitement suivi les préconisations de Cadiat et Oudry, comme le conseil de ne pas réaliser de poutres droites, un mauvais principe pour les ponts, avec un travail en compression et flexion des poutres. L’avenir sera pour la tôle, aux caractéristiques mécaniques nettement plus favorables que la fonte. La Notice de Cadiat et Oudry détaille les rôles respectifs des arcs, tympans, et tabliers dans le comportement de l’ouvrage. La nécessaire rigidité du tablier, importante pour l’avenir du pont, est démontrée. Seuls les schémas et figures ne sont pas accessibles, mais vous les trouverez plus bas, parus dans un article des Annales de la Construction. On notera enfin que les rails Barlow, utilisés pour renforcer la rigidité, ne sont pas évoqués dans le texte de Nicolas Cadiat : l’ouvrage est paru en 1851, et les Barlow ont connu un succès ferroviaire modeste quelques années plus tard, ce qui a permis à Cadiat de les incorporer à l’ouvrage parisien, en les détournant de leur usage premier. Le rail dont nous offrons la photographie est bien de Decazeville ; compte tenu des liens de Cadiat avec Cabrol, et comme Decazeville était le constructeur français unique, en 1855, de ces rails, il est bien probable que ceux du pont d’Arcole étaient des décazevillois, recyclés eux aussi dans le génie civil, puisque les marchés ferroviaires, ceux du Midi par exemple, ne les préconisaient plus, et que le stock de François Cabrol devait avoir quelques difficultés de commercialisation…
Il apparaît donc que François Cabrol, dans la construction du viaduc de l’Ady a réalisé une parfaite synthèse technique en utilisant au mieux les derniers progrès des matériaux et de la construction, au moins trois nouveaux concepts pour un seul ouvrage :
- le principe constructif de Britannia et Conway, préfabrication en place, et montage des arcs
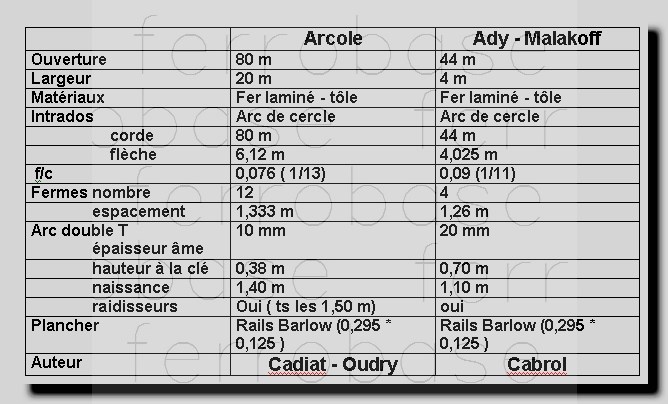
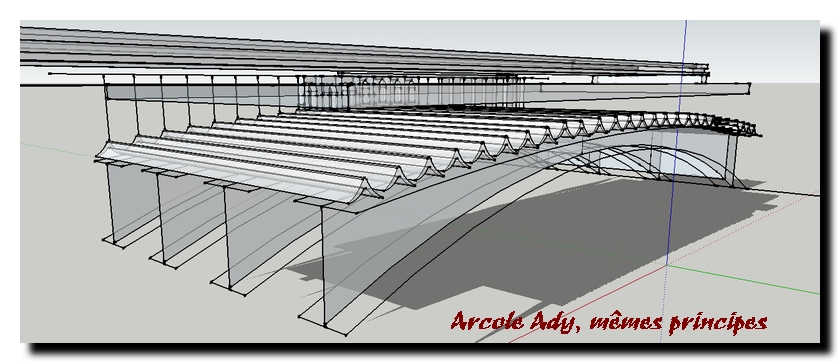
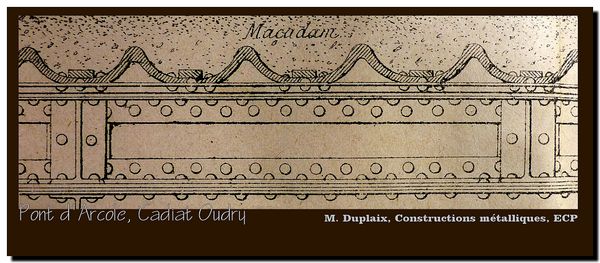
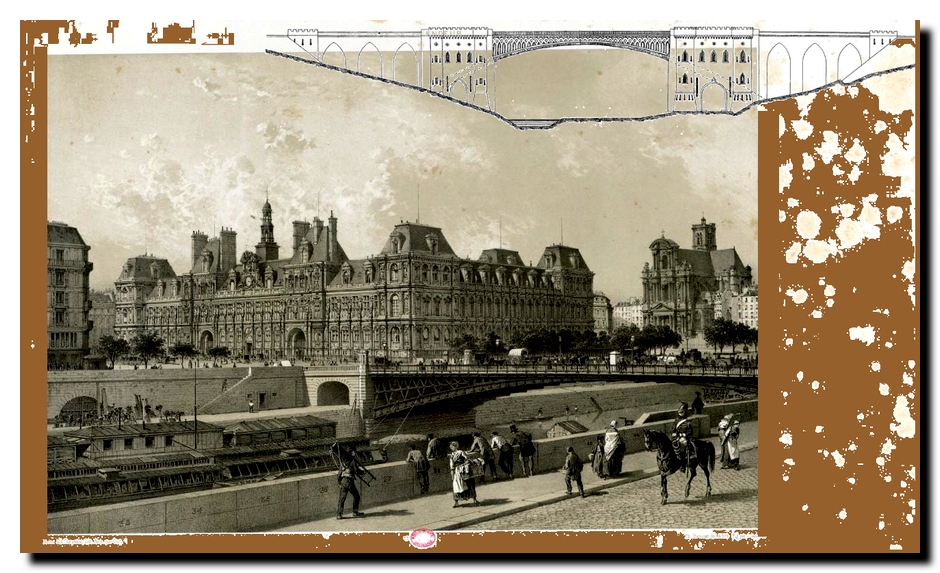
Nous avons évoqué dans ces pages l’avenir très compromis en 1940 du viaduc de l’Ady. Lorsque en 1940, le 8 juin, Monsieur Ramadier, membre du Conseil Général, évoque le caractère novateur de l’ouvrage, il est parfaitement dans le vrai, à la précision près que le pont d’Arcole, 1855, vient avant Malakoff, 1856. Il rappelle, près d’un siècle plus tard, ce que peu de personnes avaient en mémoire, que la technique de l’emploi des arcs en tôle était bien une réelle nouveauté en 1856. François Cabrol méritait bien de la patrie, et l’appel ne fut pas entendu ! On sait comment l’offre de cession gratuite du viaduc Malakoff au Département de l'Aveyron qui était alors discutée fut rejetée.
Pour prolonger la connaissance de ces hommes, La Revue du Rouergue, n° 35, 1993, a publié une biographie de la famille Cadiat, par P. Bourdoncle. La même Revue, n° 26, 1991, sous la signature de J.M. Teyssère, avait présenté l’itinéraire de François Cabrol.
En 1855, dans une de ses livraisons des Nouvelles annales de la construction, numéro 9 de septembre, ( Gallica BNF), Oppermann publie un article de M. Oudry, l'ingénieur concepteur du pont d'Arcole, avec N. Cadiat comme constructeur. Dans le numéro 12 de la même année, malgré l'erreur d'impression de la page de présentation, figurent les belles planches 35, 36, 37 et 38 des dessins de l'ouvrage. Les dessins reprennent les originaux d'Oudry. Les extraits ci-dessous présentent l'allure générale et les seuls détails concernant l'utilisation des rails Barlow. Pour Arcole, ils sont utilisés en partie haute, sous la chaussée, alors que F. Cabrol les a mis en place directement sur les arcs. Le détail du cours de constructions métalliques de Desaix reprend en fait le dessin d'Oppermann. On remarquera simplement le figuré différent de la brique posée à cheval sur les rails. Elle servait à masquer l'espace laissé entre deux rails pour faciliter l'écoulement des eaux infiltrées.
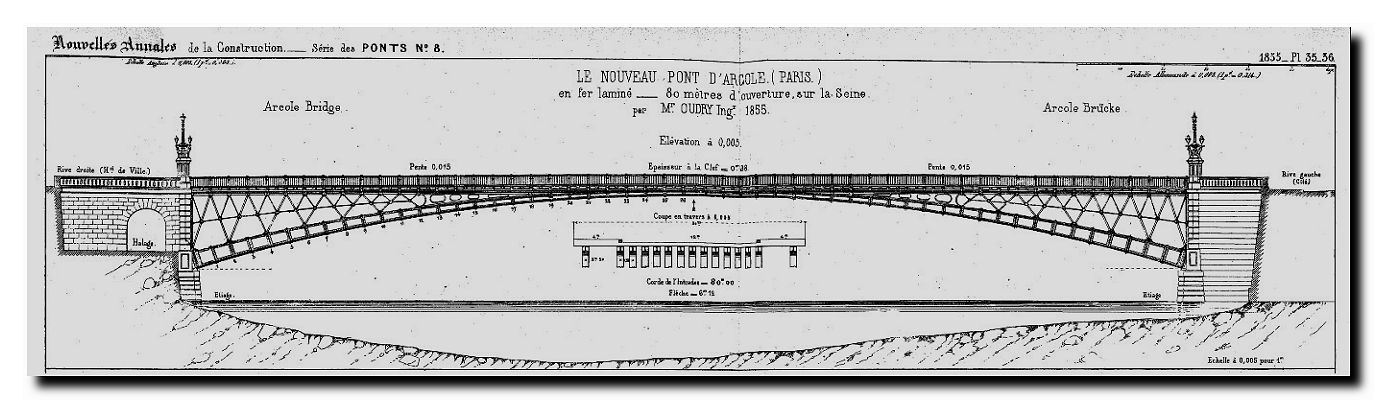
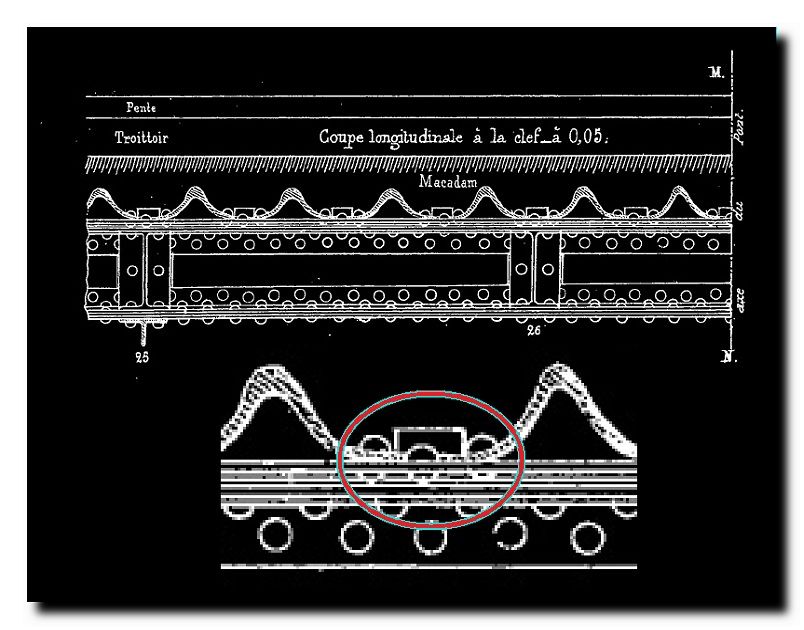
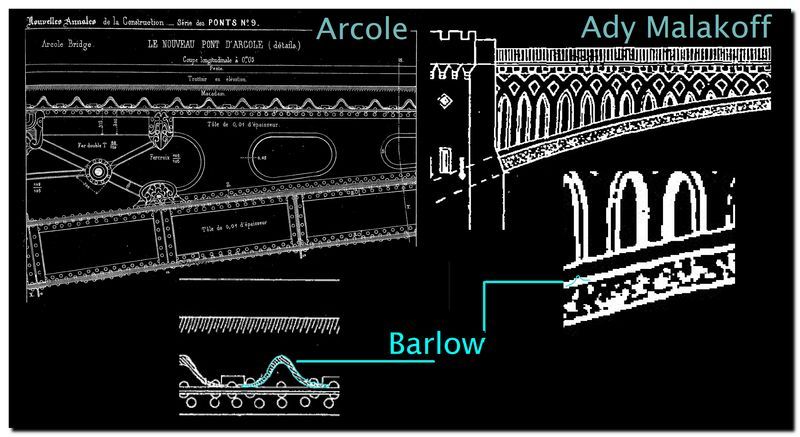
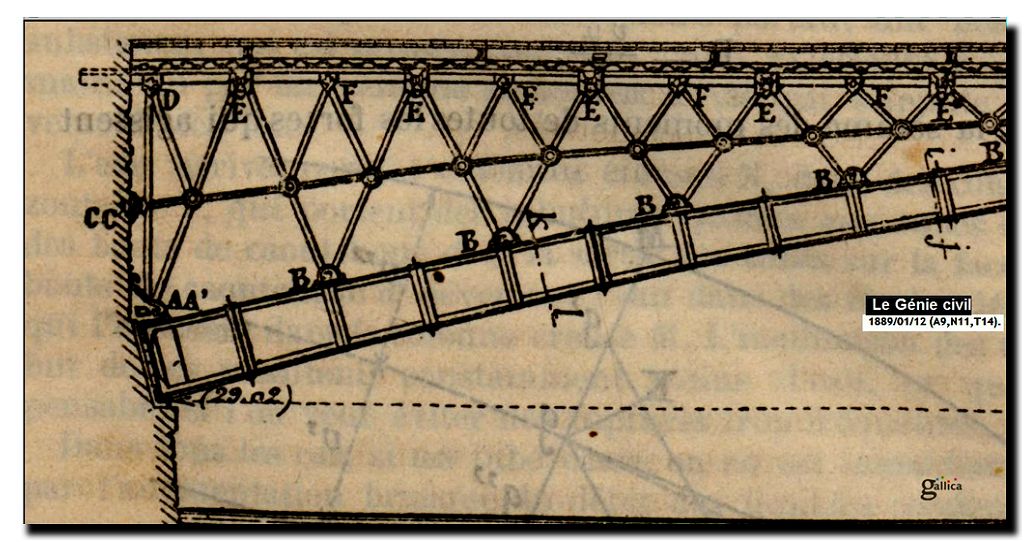

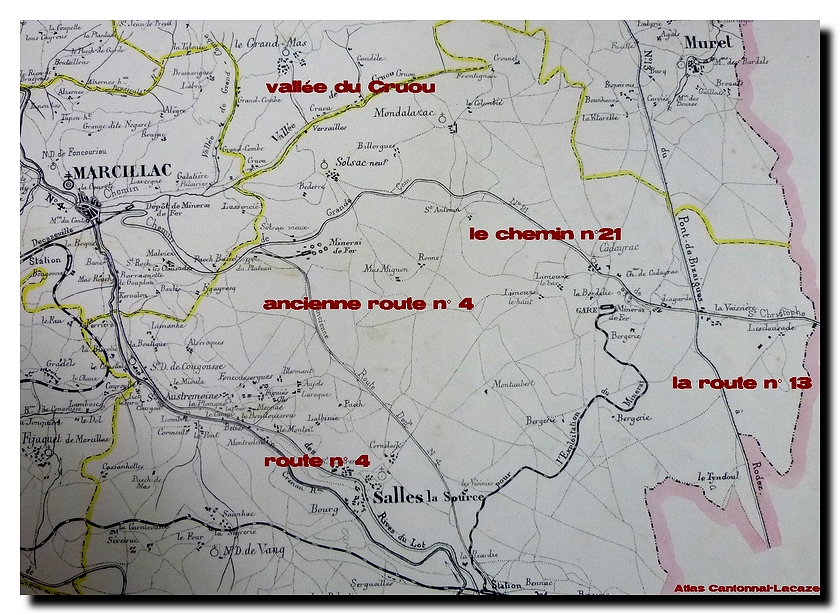
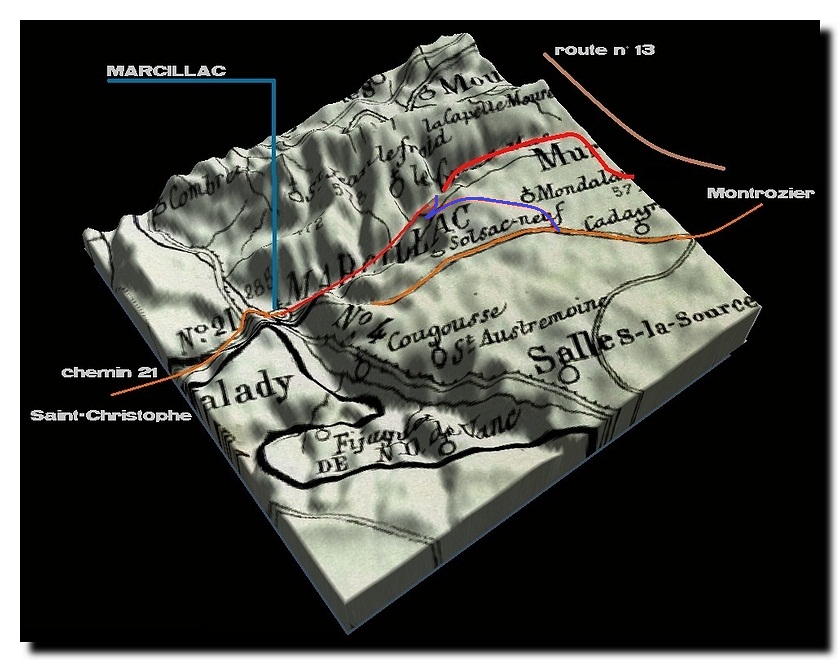
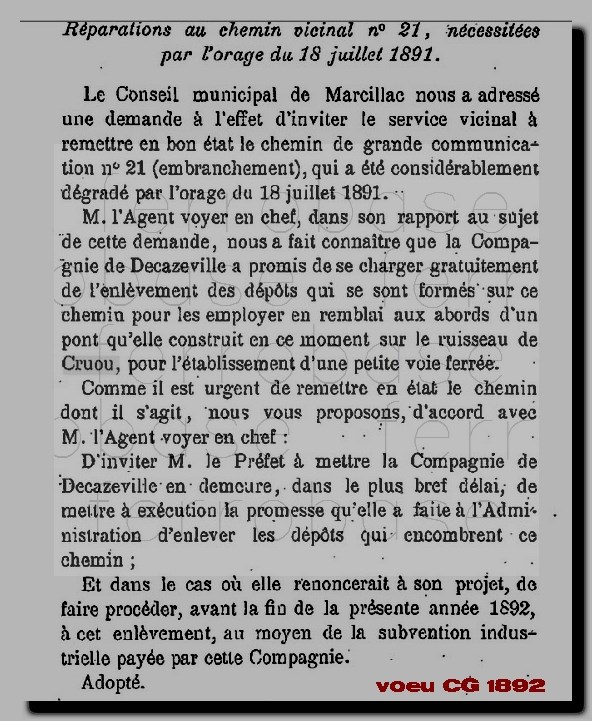 A
compter de cette date, et seulement maintenant, en 1891 donc,
nous pouvons envisager la pose de la voie ferrée de 66. Ce à quoi va
s’activer la compagnie de Decazeville. En 1891 un orage, le 18
juillet, est très destructeur. Lors de sa session d’été, le Conseil
emploie les termes de trombe et d’ouragan. Terres et graviers venues
très probablement des coteaux encombrent le sol. Une subvention de 1000
francs est octroyée à la commune de Marcillac. Un an plus tard le
problème revient au Conseil. Et nous allons apprendre à cette occasion
que la Compagnie va se montrer solidaire…Le vœu du Conseil général
témoigne.
A
compter de cette date, et seulement maintenant, en 1891 donc,
nous pouvons envisager la pose de la voie ferrée de 66. Ce à quoi va
s’activer la compagnie de Decazeville. En 1891 un orage, le 18
juillet, est très destructeur. Lors de sa session d’été, le Conseil
emploie les termes de trombe et d’ouragan. Terres et graviers venues
très probablement des coteaux encombrent le sol. Une subvention de 1000
francs est octroyée à la commune de Marcillac. Un an plus tard le
problème revient au Conseil. Et nous allons apprendre à cette occasion
que la Compagnie va se montrer solidaire…Le vœu du Conseil général
témoigne. 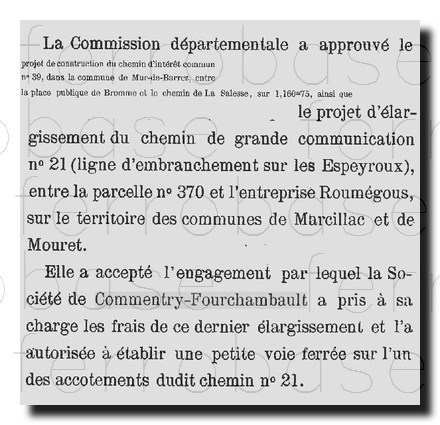
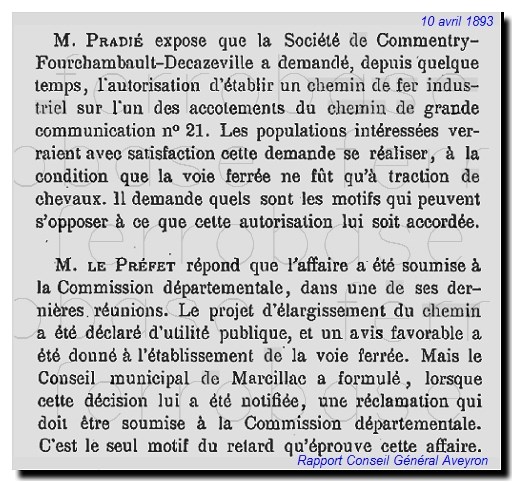
Les dernières années de la première société des Forges et Houillères de Decazeville furent tourmentées et un peu tristes. Les évènements politiques et économiques des années 1860, un peu avant et quelques années après vont amener la disparition de la société qui verra sa remplaçante se mettre en place en 1868.
Le duc Decazes décède en 1860 et François Cabrol abandonne cette même année la direction des forges aveyronnaises, tout en restant membre du conseil d’administration de la société. Il a été maître des forges de 1840 à 1860, 20 ans sans interruption, et 7 ans avant 1840, avec la parenthèse due à l’audit de Pillet-Will comme nous l’avons évoqué ailleurs sur ce site. Mais il n’a plus de pouvoir réel. C’est une plainte d’administrateurs qui va lui valoir, ainsi qu’à quelques autres administrateurs de réels soucis judiciaires, une condamnation, un appel victorieux, et ramener François Cabrol sur le devant de la scène économique, ce dont il se serait sûrement bien passé !
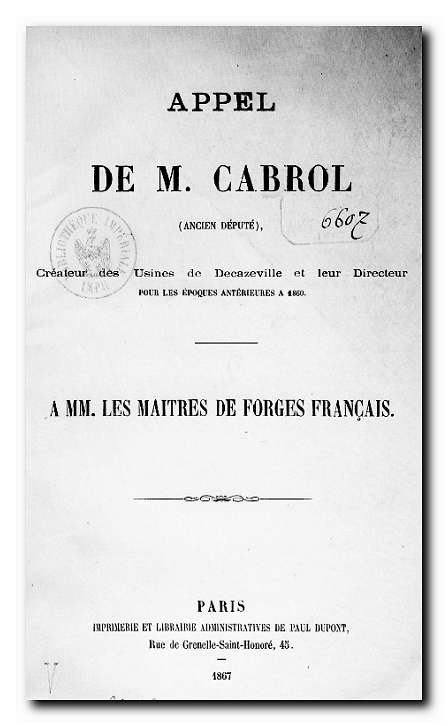
Nous ne reviendrons pas ici sur cette fin judiciaire, sauf qu’elle a fourni au Directeur de Decazeville une occasion d’écrire. François Cabrol a peu écrit : pas d’œuvres particulières, pas de biographie, pas de souvenirs de sa main ( enfin pas à notre connaissance …mais il est possible que des archives nous contredisent…). Les rares occasions de lire François Cabrol sont quelques catastrophes économiques, à son point de vue. La réduction des droits de douane par exemple, lui donne l’opportunité d’écrire tout le mal qu’il voyait dans cette mesure ; introduire plus facilement les fers anglais en France lui paraissait être le comble de la catastrophe. Ses débats publics et donc écrits avec quelques économistes en vue ont marqué l’époque. Il a mené campagne, électorale s’entend, sur ce thème.
La création de la société concurrente d’Aubin lui permit aussi de faire savoir aux lecteurs anglais de la presse parisienne que le Times avait mal fait en publiant un appel à investisseurs émanant de quelques aventuriers, français et anglais, promettant bien plus que ne pouvait le faire Decazeville… Là, ce fut le comte de Morny, qui fut pris à partie, comte un temps collègue d’Assemblée de Cabrol.
Le marché absolument inouï des rails Barlow passé par les frères Péreire, de l’ordre de 40.000 tonnes, et leur compagnie du Midi à Cabrol donne de même une occasion au Directeur rouergat de mettre en place de nouveaux trains de laminage et de nouveaux procédés industriels. Il fera une communication, technique cette fois, sur ce sujet. Son colamineur reste célèbre.
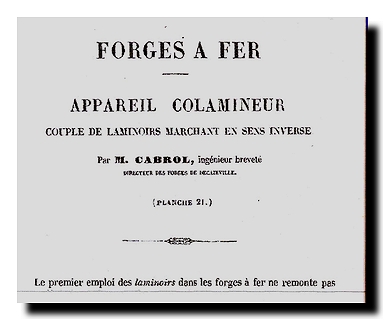
Et c’est à peu près tout ce que nous connaissons des écrits de François Cabrol. Sauf que la fin de la société, après 1860 va donc l’amener à écrire un appel aux maîtres des forges français, cherchant un appui dans son monde industriel, face aux attaques de malversations portées contre quelques administrateurs, dont lui, attaques presque colportées également dans le monde politique et à l’Assemblée. On devine que le capitaine, pas seulement d’industrie devait et allait réagir.
Cet Appel amène Cabrol à mettre sur la place publique des chiffres, et le débat devient alors assez remarquable. L’opposition entre Decazeville et le Creusot (M. Desseligny qui sera en poste à Decazeville pour le compte de la Nouvelle Société est le gendre de M. Schneider), est feutrée dans les premières lettres ; F. Cabrol cherche bien un appui. Cet appui ne viendra pas. François Cabrol met alors en avant ses propres résultats de gestion, de 1840 à 1860, période où il était seul aux commandes, avec son Conseil présidé par le duc.
Le document, l’Appel, est imprimé en 1867, et son auteur ne manque pas de rappeler ses fonctions de député, de créateur et de directeur des Forges, 72 pages pour répondre au ministre Rouher, lorsque celui-ci, le 17 avril 1866, à la tribune de l’Assemblée s’en prit donc à Decazeville et sa gestion passée.
Le débat que soulève Cabrol n’est pas, pour notre objet, important. Il réside dans des accusations de distribution de bénéfices prétendus fictifs, ou la distribution de dividendes au moyen d’emprunts par obligations, tout cela n’étant évidemment pas de la meilleure orthodoxie financière… Pour nous, le plus important réside dans la suite de chiffres que Cabrol expose pour faire prévaloir sa bonne gestion. Et quelques surprises vont se faire jour…
Lorsque nous avons développé l’histoire économique de la société avant 1860, sur la foi des commentateurs économiques de l’époque et de ce qu’on pouvait lire dans les rapports aux conseils d’administration, il apparaissait que pendant plus de 15 ans, la société n’avait dégagé que de très faibles bénéfices. La bonne volonté des administrateurs est souvent soulignée à cet égard, ainsi que leur foi, le mot est le seul exact !, en l’avenir de la fonte à la houille. La fabrication de rails, spécialité principale locale, devait, c’est sûr, amener la prospérité, pas seulement évidemment pour les populations locales. Ce credo, martelé très souvent auprès des investisseurs n’est peut-être pas exactement une stricte expression de la situation.
Parmi les chiffres que Cabrol avance, il souligne, plusieurs fois, que parmi les grandes entreprises de forges, en y comprenant même Le Creusot, « y en a t il beaucoup qui, de 1840 à1858, aient donné dix-sept millions quatre cent mille francs de bénéfices et qui aient triplé leurs moyens de production avec une augmentation de capital immobilisé de quatre millions seulement » ? Et même si Cabrol prenait la peine de découper les articles du Moniteur ou du Droit pour les coller dans ses lettres à Schneider, le maître du Creusot ne prenait pas la peine, ou très peu, ou très tard, de répondre…
La deuxième partie de l’Appel de Cabrol consiste donc à présenter des tableaux et chiffres, présentation identique qu’il souhaiterait connaître de ses ex-collègues de Forges, qui ne lui fourniront pas leurs chiffres.
Parmi ces chiffres, on apprend que le coût de la voie minière de Decazeville à Marcillac sera de 2.177.000 francs. A ce sujet il souligne l’obligation coûteuse d’établir cette voie, alors que bien d’autres forges utilisaient des voies économiques comme des canaux ou des chemins de fer publics. Lorsqu’on prend conscience du soin et des particularités apportés à construire des ouvrages, des tunnels ou les ponts de Malakoff ou Rouge, 155 mètres pour le premier cité, le souci d’économie n’est pas évident... François Cabrol regrettait-t-il son investissement ?
La production des forges va tripler de 1840 à 1855.
Les bénéfices évoqués vont évidemment suivre une voie parallèle. En mettant en graphique les chiffres de production de houille, de fer, et ceux des bénéfices et dividendes distribués, pour la période « Cabrol » de 1840 à 1860, on ne peut qu’être frappé du quasi parfait parallélisme des courbes.
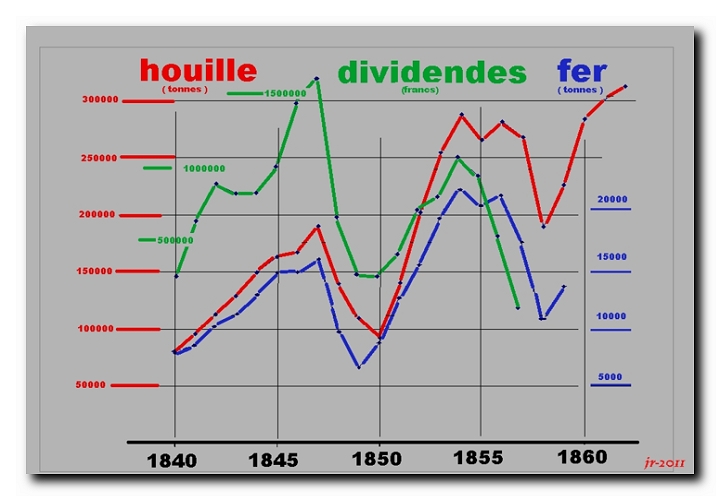
Quelle conclusion peut-on tirer de cet Appel ? Que Decazeville n’était pas, de 1840 à 1860, une forge dans une plus mauvaise situation que les autres, et qu’elle aurait pu résister au désastre que le libre échange de 1860 allait provoquer ? Certainement !
Après avoir « réglé »ses comptes avec ses successeurs, les ingénieurs impériaux des mines en situation de Directeurs à Decazeville de 1860 à 1868, François Cabrol va évoquer ses relations avec le duc Decazes. C’est rarissime de le lire sur ce sujet.
Le ministre Rouher avait en 1866 évoqué la mémoire et l’action du duc, laissant comprendre une opposition entre Elie Decazes et François Cabrol. Evidemment le duc, décédé en 1860 ne pouvait prendre part au débat.. .
« …vous seul pouvez mettre notre barque à flot par votre constance et votre habileté ; personne ne le croit et ne s’en réjouit plus que votre ami », écrit par exemple le duc en novembre 1858. De toute évidence, les deux hommes s’estimaient !
« On m’écrit que dans la crise financière, je pourrai peut-être être utile à la Compagnie. Je ne l’espère guère ; j’essayerai. Mais votre présence serait probablement bien plus efficace…. », lettre du duc à Cabrol, un an plus tard, en 1859, avec les « hommages à Madame Cabrol et mes amitiés à Elie, signé votre ami » . Le duc est alors fatigué, souffrant de goutte, et va quitter la présidence. Son décès se produit en 1860.
La compagnie sera officiellement déclarée en faillite le 12 mai 1865. La première chambre de la cour impériale a infirmé le jugement pris en première instance par un arrêt en date du 30 juillet 1867.
Elle ….
…..« Met les appellations et le jugement dont est appel à néant ;
Emendant, décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées »….
Etait-ce le dernier combat de François Cabrol ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Le Conseil Général des Mines (CGM) est au début du XIX ème siècle une autorité administrative consultative. Ce conseil de neuf personnalités est ainsi appelé à donner son avis sur les affaires minières. La consultation du Registre des Procès verbaux des séances du Conseil (fonds ancien, site de l'ensmp Mines Paris) permet de prendre connaissance, avant que les ordonnances royales ne soient rendues, de l'avis de ces sages. Cet avis souvent très motivé donne de précieuses indications sur la validité des dossiers examinés. A partir de l'inventaire " enrichi " de Lionel Latty (2004, IDHE, Paris X Nanterre, cotes F/14-17920 à F/14/17944) nous vous proposons une lecture détaillée de ces avis du CGM concernant la société du duc Decazes. Ces avis, analysés ici de janvier 1811 à septembre 1830, concernent donc pour la société la période des débuts. Avant le premier avis analysé ci-dessous, les seuls avis rendus pour le département de l'Aveyron, se rapportent tous à des mines de houille, dans les bassins de Rodez et d'Aubin, et ne concernent en rien le fer et M. Decazes. Par contre, dans le département du Tarn, où vont se rencontrer vers 1815 Joseph et Robert, respectivement frère du duc Decazes et de François Cabrol, le fer et ses concessions de mines apparaîssent dès septembre 1812...
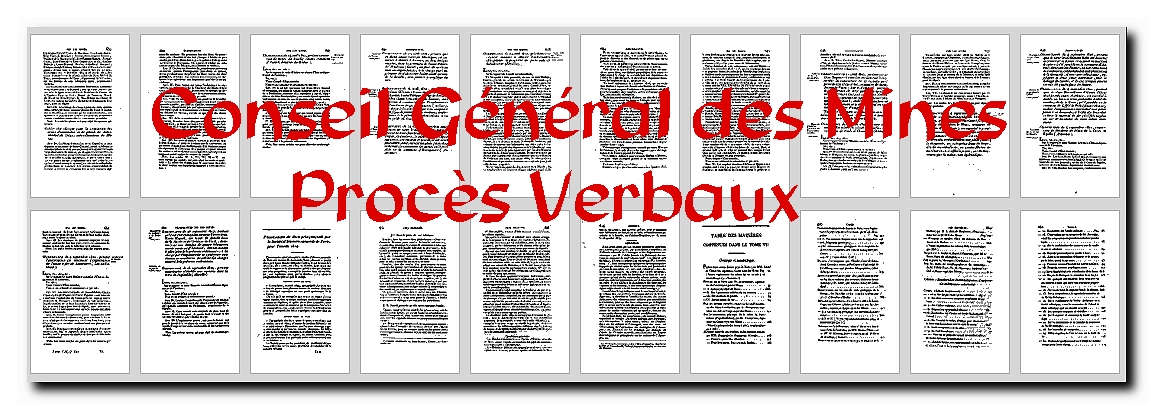
Le premier avis impliquant notre Route du Fer est
ainsi donné le 27 février 1826 et concerne les statuts des
Houillères et Fonderies de l'Aveyron signés le 17 janvier précédent. La
précision sur la date est importante, car
ce n'est que six mois plus tard, en juin 1826, que
les statuts définitifs ont été établis comme le mentionne l'ordonnance de Louis XVIII, fondatrice de
l'entreprise, parue dans le bulletin des Lois 104 bis. On peut donc
comparer cet avis
du 27 février, communiqué ensuite au Conseil d'Etat avant parution,
avec le texte définitif. Les principaux associés sont nommés : duc
Decazes, Humann, Baudelot et Milleret, ce qui est tout à fait conforme
aux listes mentionnées, voir le chapitre 7 du site
par exemple. Avant cette création en Rouergue,
MM. Humann et Milleret avaient des
participations financières dans des mines et usines métallurgiques et
apparaissent plusieurs fois dans les avis concernés du Conseil.
Le rapporteur remarque d'abord qu'il " est impossible de déterminer si
(le) capital de 1.600.000 F sera suffisant, le capital réel pourrait
n'être que 1.200.000 F si le duc Decazes ne fournissait pas réellement
400.000F avec ses 80 actions " . Cette information contredit les statuts définitifs : capital de
1.800.000 F et actions de 3.000F, au lieu de 5.000 F comme envisagé.
L'investissement direct du duc sera de plus porté à 480.000 F en juin,
au lieu de 400.000 F envisagé en janvier...La remarque du rapporteur
(un ingénieur des mines) traduit-elle quelques doutes sur la solidité
financière de l'opération, et du duc ? Le
capital initial sera donc - un peu - augmenté de 200.000 F, et l'action
diminuée - fortement - à 60 % de son nominal prévu. On peut conclure
que la vision première était à la fois trop optimiste sur le montant de
l'action, d'où peut-être quelques difficultés de souscription, et trop
pessimiste sur le capital à mobiliser. Nous avons déjà rappelé que le
capital initial de 1.800.000 F n'avait d'ailleurs pas été intégralement
souscrit en juin 1826.
Une
deuxième remarque du rapporteur suit : il
propose, et sera suivi par ses collègues,
de supprimer l'article 13 des statuts
" stipulant que chaque action portera intérêt de 350F par an ".
L'action prévue étant de 5.000 F, un calcul sommaire semble donc
indiquer que les promoteurs de Decazeville escomptaient un rendement
(brut) de 7 % de leur investissement. Le
rapporteur indique que " ces
allocations d'intérêts annuels sont peu en accordance avec les
principes des sociétés anonymes, surtout s'agissant d'activités
aléatoires ". Cette dernière précision est curieuse...Pensait-on
que la société n'aurait pas une longue vie ?
Le CGM approuvera ces modifications en ajoutant quelques autres
clauses en respect avec la loi d'avril 1810 sur les mines. Le
rapporteur était M. Brochant de Villiers.
Le 27 août
1827, le quatrième point de la réunion du CGM concerne un avis sur
l'implantation de quatre hauts-fourneaux au coke à Firmi ; l'avis est
favorable, et le procès verbal ajoute :
" affaire aussi simple que son but est important, ressources minérales
immenses, capitaux considérables, industrie nouvelle et féconde "
. Le rapporteur, Cordier, également président du Conseil n'est pas le
même que précédemment...L'ordonnance royale relative à cet avis sera
datée du 26 décembre 1827.
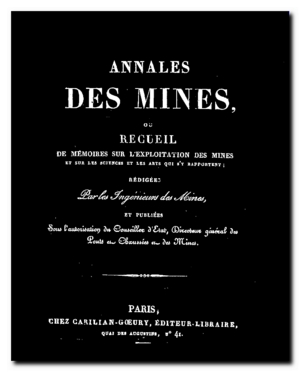
26 novembre 1827 : avis favorable du Conseil pour
les concessions de Mondalazac et Solsac, ainsi que le Kaymar. Les
ordonnances seront respectivement prises les 23 janvier 1828 et 13
février 1828. Une remarque du CGM est à noter : " ...mais en respectant les droits
d'approvisionnement en minerai de fer pour les Ht.F établis avant 1810 ".
Le rapporteur Cordier précisait donc qu'il existait avant 1810 des
hauts-fourneaux utilisant le minerai de ces concessions...Leur
existence ne nous était pas connue....Ces actes de concessions sont
semble-t-il les premiers documents
administratifs faisant mention des ressources de Mondalazac et Solsac.
La Route du Fer est maintenant tracée !
Le 3 novembre 1828 le troisième point de
l'ordre du jour concerne "
Aubin,
au lieu dit Lagrange près de Lasalle ", autrement dit
actuellement Decazeville. Le rapporteur est le même que ci-dessus. Il
s'agit de l'établissement de "
hauts fourneaux au nombre de quatre, affinerie à mazer la fonte au
nombre de quatre, dix fourneaux à pudler, huit fourneaux de chaufferie ".
L'ingénieur des mines de l'Aveyron précise
que " le fer marchand pourra être
produit à 23 F/qxm et s'il se vend 40 F/qxm le bénéfice serait de
1.300.000 F/an " . Il n'y a aucune opposition du Conseil, et la
motivation suivante : " on ne peut
vraiment pas préciser où s'arrêteront les progrès de ce genre
d'industrie dans le département et le développement de toutes les
industries secondaires " . Il est
difficile d'être plus optimiste...Ces chiffres amènent deux
constatations : la production de " fer marchand " est estimée à 7600
tonnes par an, ce qui semble raisonnable ; la deuxième remarque sur un
bénéfice escompté de 1.300.000 F par an, laisserait donc espérer une
rentabilité... plus que remarquable...On sait qu'il n'en a pas été
ainsi durant les premières années de la société.
Le rapporteur Cordier propose de compléter
le cahier des charges avec quatre obligations : " utiliser la houille
exclusivement, approvisionnement de minerais seulement auprès
d'exploitations légalement autorisées, les constructions de l'usine
seront exécutées sous surveillance de l'Ingénieur des Mines et après
leur achèvement il en sera dressé un PV, le permissionnaire tiendra son
usine en activité constante " . Le Conseil et le rapporteur
donnent un avis favorable. L'ordonnance royale sera prise le 21 janvier
1829.
Que peut-on retenir des ces avis, dont quelques uns
non repris ici, et qui officialisent par
exemple des concessions de mines de fer ? Certainement un grand
optimisme sur le devenir de la métallurgie
rouergate . La difficulté de l'heure, vers
1830, semble bien être de trouver du minerai de fer. On peut comprendre
également à la lecture de ces PV que le duc ne connaîtra que peu de
difficultés sur ses recherches de concessions, même quand un " petit " est en place avant lui.
Le CGM va par exemple contribuer, pour la société,
à " son développement et son
succès ", comme indiqué dans un PV du 4 janvier 1830.
Les 28 décembre 1829, 4 et 11 janvier 1830,
au cours de trois séances consécutives, le Conseil va traiter d'un
dossier important, celui de la concession de mines de fer carbonaté
(Trépalon ) sur les communes d'Aubin,Flagnac, Livinhac et Saint-Santin.
Le 4 janvier le CGM adopte les conclusions favorables du rapporteur
(Cordier) par quatre voix contre trois, et
renvoie au 11 janvier pour la rédaction des motifs. Ce jour là, une " longue discussion " est-il
indiqué précèdera la rédaction du PV. Il semble que la position
prédominante, pour ne pas dire hégémonique, du duc Decazes pose
quelques problèmes, et pas seulement de pure forme administrative. Dans
les considérants et avis, on relève d'abord que " les concessions de minerai de fer
déjà accordées au duc Decazes pour alimenter les 9 Ht.F (Firmy et La
Salle) ne vont pas suffire... ". Cependant il y a " lieu de protéger l'entreprise par tous
les moyens....sans blesser les droits acquis... ". Il y a par
exemple le cas de Miquel, concessionnaire à Saint-Santin et Livinhac,
qui n'a pas " été mis en demeure de
s'expliquer sur ses intentions d'exploiter ces minerais de fer ".
La concession lui avait été accordée par une OR du 25 septembre 1822.
La place semble donc déjà occupée... Le Conseil va
alors souligner la nécessité de faire des travaux d'exploitation
souterrains et se permettra d'ajouter que ceux qui sont déjà
concessionnaires " ne
pourraient pas exploiter d'une manière aussi utile que ne le peut la
Cie à laquelle le gouvernement a accordé la permission d'établir neuf
Ht.F ... ". Il y aura finalement dans le projet du cahier des
charges une clause pour " garantir d'une manière suffisante
exploitation et intérêts ". L'ordonnance royale approuvant ces
concessions sera datée du 25 mars 1830,
mais on retient que trois membres sur les
sept votants du Conseil n'avaient pas suivi l'avis du rapporteur...
L'ensemble de ces avis du Conseil Général des Mines
rendus sur cette période qui voit la création de la société du duc
Decazes montre bien la préoccupation première des investisseurs, la
fonte à la houille. Dans plusieurs autres avis concernant
mines et usines de fer, le Conseil aura l'occasion de souligner
l'intérêt pour le pays de cette nouvelle technique. Il faudra cependant
attendre 1846 pour voir la production nationale de fonte à la houille
concurrencer sérieusement celle au bois. La société de Decazeville
pourra alors connaître une période de forte activité jusqu'en 1860.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Joseph Leonard DECAZES, actionnaire ET concessionnaire…
La présentation du frère du duc Elie Decazes, Joseph Decazes, l’ingénieur préfet et député a été faite dans le chapitre 7 du site. Nous avons insisté sur la présence constante de ce frère lors de la création des forges aveyronnaises. Un récent travail sur des archives familiales (Archives départementales du Tarn, 42 J 124 à 127) permet de découvrir plusieurs aspects de l’action de Joseph Decazes, qui se révèle actionnaire, ce qui est connu, fondateur de société, un peu moins connu, mais également concessionnaire en titre en 1831, ce qui l’est beaucoup moins !

Ses études terminées, l’itinéraire hollandais de l’ingénieur peut évidemment trouver une explication dans la présence dans ces plaines de son frère Elie aux cotés du roi Louis dont il est un des secrétaires. Et si l’un se consacre à quelques activités administratives plus ou moins obscures, le second s’investit avec application : « Le nouvel ingénieur ne faillit pas à sa tâche ; il s’y livra avec entraînement ; avec persistance, avec succès ». Le chroniqueur de L’Aigle du Tarn, qui écrit une biographie de Joseph sur plusieurs numéros en 1868, après son décès, ajoute également que Joseph Decazes eût rapidement « la conviction que sa nature intellectuelle pouvait et devait s’appliquer à un objet plus large, plus vital, plus difficultueux, plus important qu’à l’art de faire creuser des fossés, planter des pieux et échafauder des fascines » (numéro du 19 juillet 1868, AD Tarn, 43J 127). Et c’est probablement le départ du roi qui va orienter alors cette carrière. Louis, roi de Hollande, frère de Napoléon, ne s’entend guère avec ce frère conquérant, au point de s’opposer très ouvertement à lui. Fin 1809, le conflit éclate et Louis quittera définitivement son pays de Hollande, celui qu’il avait fait sien, en juillet 1810. Evidemment, ce départ amène celui d’Elie, secrétaire. Joseph reste alors en Hollande. Mais nommé auditeur au Conseil d’Etat en mars 1810, il est alors auprès d’un maître des requêtes chargé de la mise en place d’un service cohérent des ponts et chaussées. Très appliqué, il rédigera un rapport, présent dans les archives, sur ce travail. C’est en 1814 que nous le retrouvons à Castres, sous préfet. Ses compétences techniques et administratives trouvent là un meilleur terrain d’exercice. Elie était homme de droit, Joseph sera administrateur et technicien, dès cette époque. Nous laissons passer les années de restauration pendant lesquelles son frère sera « vice roi ». La troisième décade du siècle, 1820-1830, est décisive. Le préfet s’investit par exemple dans le Tarn, à Ambialet : mines de fer, projet d’usines. Pour ce qui est de l’Aveyron, c’est à la fin de cette décade que nous allons le découvrir, concessionnaire caché.
Le 28 février 1831, une concession est faite à un monsieur Louis Cibiel de Villefranche de Rouergue. Négociant, L. Cibiel se voit attribuer des mines de houille sur la commune d’Aubin, sous le nom de concession de Lavergne. Cette concession touche à celle du duc Decazes. Qu’a donc de particulier pour nous ce Monsieur Cibiel ? Une qualité très curieuse : M. Cibiel dans cette opération est en fait le prête-nom du vicomte Joseph Decazes.
Et c’est M. de Seraincourt qui nous l’affirme ! L’ennemi de François Cabrol, et son partenaire en duel ! Le perdant de cet épisode était en 1847 locataire de cette concession, louée à Joseph Decazes. Un différent apparaît entre eux en 1848 et va se terminer devant le tribunal. Dans un mémoire, M. de Seraincourt va alors rappeler que le vicomte était donc le véritable entrepreneur de cette concession, sous le nom de Cibiel, qu’il n’y fit pas grand-chose, et que d’ailleurs « elle n’a pas produit en moyenne plus de 6000 francs par an ». Dans un nota, M. de Seraincourt précise que ce fut un « don de Louis Philippe » à Joseph Decazes, que c’est une « des trois plus belles concessions du bassin, et qu’elle n’a coûté à son possesseur que 1210 frs, c’est à dire les frais de l’acte par lequel M. Cibiel, concessionnaire nominal, déclare que M. Decazes est bien le seul et réel propriétaire de la mine de Lavergne et qu’il n’est que son prête-nom ». La suite nous montrera que tout cela était bien exact, et n’était pas quelques propos approximatifs tenus à un adversaire pour le bénéfice d’un procès.
Pourquoi donc Joseph Decazes se cachait-il derrière M. Cibiel ? Une raison de circonstance. Le préfet du Tarn devait laisser sa place comme bien d’autres après les journées de juillet 1830. Charles X est remplacé par Louis Philippe, et notre préfet est plus légitimiste qu’orléaniste. C’est d’ailleurs son étiquette lors des élections de novembre 1830. Le nouvel élu ne soutient pas particulièrement le nouveau roi. Et on peut évidemment supposer qu’une demande de concession ne serait pas peut-être bien reçue en cour, d’où l’emprunt d’une identité autre ; ce fut donc Louis Cibiel le 28 février 1831. Celui-ci ne restera pas longtemps dans cette position. Il y a peut-être une autre raison à cette discrétion : ne pas afficher ouvertement le monopole des frères Decazes sur les ressources locales du bassin houiller pour ne pas provoquer une opposition trop forte. Cette discrétion trouve également une justification dans la position de Joseph qui peut alors bloquer tout développement de la vallée d’Aubin au profit de la société de son frère, ou au contraire peut envisager de réunir ce patrimoine à celui du duc…
Près d’un quart de siècle plus tard, en 1855, la position locale de Joseph Decazes en 1831 devient publique.
En
1855 en effet, une compagnie des mines de Lavergne est officialisée. Un
livret imprimé présente cette compagnie. Les statuts font apparaître
Joseph Leonard Decazes, rentier, et M. de Carbonel, receveur général
des finances à Toulouse comme seuls fondateurs d’une société civile
avec chacun 3000 parts de
Il n’est pas sans importance de mentionner que l’article 6 des statuts de la compagnie de Lavergne mentionnait aussi le maintien des « droits du duc Decazes d’extraire ou de faire extraire » dans le périmètre de la concession. Joseph Decazes intervenait donc, en 1831, comme véritable entrepreneur dans cette vallée d’Aubin, concurrente de Decazeville. Il y sera donc concessionnaire, fondateur de société, et actionnaire. Le propos simplement manuscrit de M. de Seraincourt est donc pleinement confirmé, montant des frais compris.
Ne peut-on pas voir dans cette présence une volonté des frères Decazes de bâtir à deux un empire des forges et houilles commun ?
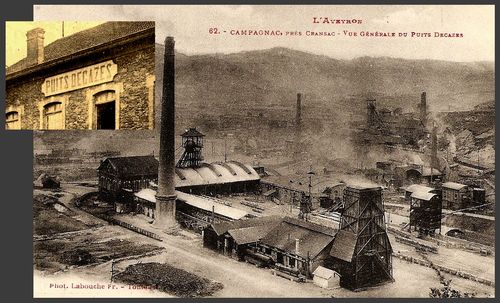
Le 22 septembre 1862, la compagnie des mines de Lavergne est vendue à la compagnie des mines de Mazel. Ces deux compagnies vont à leur tour fusionner et deviennent la compagnie des mines de Campagnac en 1863. La première Assemblée Générale se tiendra le 30 mai 1863. Nous arrêterons là notre déroulé historique en indiquant que si le duc Elie Decazes a bien donné son nom aux usines puis à la commune qui sera formée autour de celles-ci, il existait dans la vallée d’Aubin, un puits Decazes, aux mines de Campagnac…Deux frères, deux vallées, deux présences, mais la mémoire n’en retient qu’une, bien à tort !
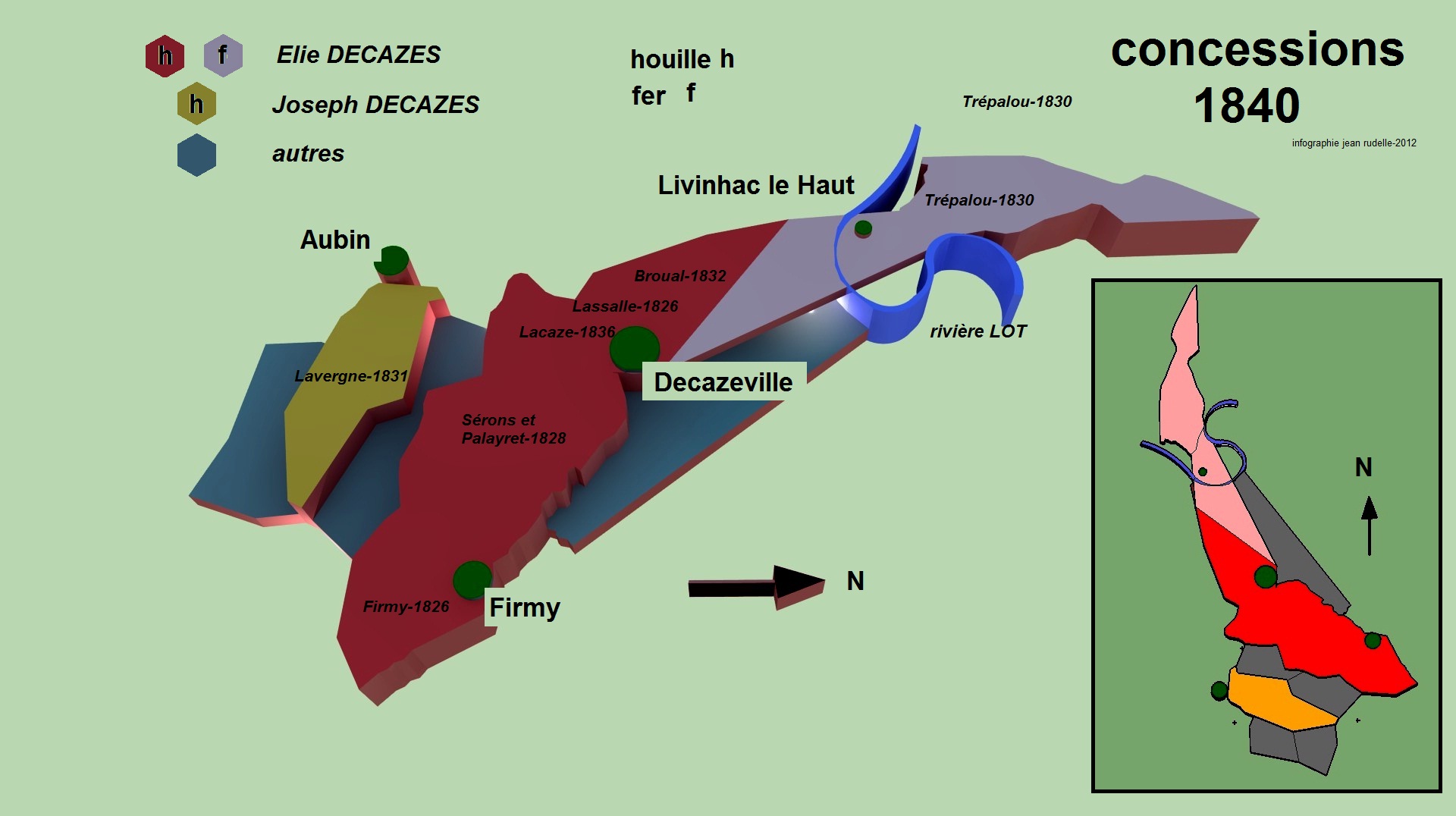 Pour clore
cette évocation du frère du duc et de son implication rouergate, nous
vous proposons le croquis suivant. Il montre les concessions, une
dizaine, présentes vers 1840, concessions de houille et de fer.
Construit avec les données d’une carte d’époque d’un ingénieur des
mines, Senez, ce document montre les propriétés du duc, en rouge et
mauve, et celle de son frère en jaune. A eux deux, les frères Decazes
sont à la tête d’un véritable empire local ; bien plus de la
moitié de la surface est concernée. Ce sont les concessions les plus
productives. De plus, le droit minier étant ce qu’il est, en un même
lieu il peut évidemment y avoir superposition de concessionnaires,
houille et fer par exemple. Ainsi la concession de fer du Trépalou,
attribuée au duc en mars 1830 se superpose à une concession de houille
autre, ainsi qu’à celle de houille du même duc….Une concession étant
cessible, l’exploitant réel peut également ne pas être l’attributaire
initial. Le changement de mains est une affaire de droit privé, et les
conditions financières sont tout autant du domaine privé.
Pour clore
cette évocation du frère du duc et de son implication rouergate, nous
vous proposons le croquis suivant. Il montre les concessions, une
dizaine, présentes vers 1840, concessions de houille et de fer.
Construit avec les données d’une carte d’époque d’un ingénieur des
mines, Senez, ce document montre les propriétés du duc, en rouge et
mauve, et celle de son frère en jaune. A eux deux, les frères Decazes
sont à la tête d’un véritable empire local ; bien plus de la
moitié de la surface est concernée. Ce sont les concessions les plus
productives. De plus, le droit minier étant ce qu’il est, en un même
lieu il peut évidemment y avoir superposition de concessionnaires,
houille et fer par exemple. Ainsi la concession de fer du Trépalou,
attribuée au duc en mars 1830 se superpose à une concession de houille
autre, ainsi qu’à celle de houille du même duc….Une concession étant
cessible, l’exploitant réel peut également ne pas être l’attributaire
initial. Le changement de mains est une affaire de droit privé, et les
conditions financières sont tout autant du domaine privé.
Sur cette Route du Fer en Aveyron, Joseph Decazes mérite donc sa place tout autant que son frère Elie.
A titre documentaire voici un tableau des concessions principales des frères Decazes en 1840, nom de la concession, date d’attribution, objet, titulaire et surface.
Bassin d’Aubin
Concession de Lassale-Miramont-Lagrange, 12 novembre 1804, 10 novembre 1819, houille, acquise par Elie de Lassale frères
Concession
de
Broual (ou Debroual), 2 janvier 1832, houille, duc,
Concession
de
Lacaze, 8 mai 1836, houille,
Concession de Sérons et Palayret, 9 janvier 1828, houille, duc
Concession de Firmy, 14 décembre 1863, réunissant les concessions du Rial, 6 mai 1818, houille, et du Rieu Mort, 21 août 1832, houille. En 1826, lors de la création de la compagnie, le duc amène en propriété une concession de Firmy, acquise de M. Fualdès.
Concession
de
Trépalou, 25 mars 1830, fer, duc Decazes,
Concession
de
Lavergne, 28 février 1831, acquise par Joseph de M. Cibiel,
Autres
Concession
de
Kaymar, 13 février 1828, fer, duc,
Concession
de
Solsac et Mondalazac, 23 janvier 1828, fer, duc,
Ne sont pas ici reprises les possessions autres, par exemple Veuzac, fer, à proximité de Villefranche.
En
1853, Joseph Decazes est toujours très présent en Aveyron. Voici une
carte qui témoigne de cet intérêt. Etablie par un concurrent en
concession, elle mentionne expressément Joseph Decazes.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Le ruisseau du cuivre …un martinet du Lézert
Le martinet du cuivre …le ruisseau du Lézert
Evidemment
c’est un clin d’œil à la Route du Fer. Et le sujet n’est pas
totalement différent du nôtre. D’abord, cet objet, le marteau,
un bon mètre et 210 kg : il pourrait très bien avoir été
forgé à Decazeville, et être issu du minerai du causse. 
Ensuite, nous sommes toujours en Rouergue, en Aveyron. Enfin même si le sujet concerne le cuivre, les hommes du fer, Elie Decazes en tête, s’étaient préoccupés de ces ressources près de Villefranche de Rouergue, au point d’avoir des concessions. C’est donc cet affluent de la Route du Fer que nous allons suivre pour découvrir dans un site, où beauté et poésie sont au menu, une technique que les hommes du fer utilisaient depuis bien longtemps. Les forges dites à la catalane ne sont pas différentes et une magnifique leçon de technologie se déroule ici. Depuis le caillou et le minerai fondu, ou plus exactement en utilisant les vieux cuivres locaux qui arrivaient ici avec des lingots allemands, il est possible de suivre le processus jusqu’à sa forme finale, du creuset de fusion du cuivre à la coupe froide. La suite de ce travail de forges, ce sera l’objet non plus du moulinaire mais des ouvriers du cuivre de Villefranche de Rouergue, ils étaient plus de mille, qui formeront pairols, casseroles et autres ustensiles.
Historiquement, le cuivre avait précédé le fer sur notre Route. En 1806 en effet, voir Blavier opus ci-dessous, il existait par exemple une mine de cuivre proche de Saint-Christophe, à la cime de la montagne située au nord du Bousquet. Le concessionnaire, M. Campergue, possédait au moulin du Comte sur le Créneau à Marcillac une fonderie de cuivre. La présence du ruisseau permettait le lavage du minerai avant le passage en fonderie. Un four à réverbère est mentionné comme opérationnel en 1826 par Blavier dans sa Statistique. En 2012, le moulin est toujours là, même si les modifications et reconstructions sont bien visibles. La fonderie de cuivre était donc en place avant la Route du Fer, à quelques dizaines de mètres seulement. Très curieusement une rue prend le nom de rue du compte (sic) ! A la même époque, en 1806, un martinet à fer s’activait à Muret, en lisière du causse Comtal, tout près des futures exploitations de Ferals, utilisant le minerai de fer local. Le minerai de fer de Solsac était également connu et exploité en 1806, précise l’auteur. La Route du Fer a donc parfaitement cohabité un temps avec celle du cuivre. Et dernier clin d’œil de la toponymie, il existe un hameau de Ferrière près de ce moulin du Comte…
Pourquoi Comte ? C'est au XV ème siècle que le Comte de Rodez cède au sieur Périé de la Roque, meunier, le moulin, comme en attestent quelques papiers de famille cédés par la famille Campergue à la Société des Lettres Sciences et Arts de l'Aveyron en 1919. Plus tard, en 1868, Jules Verne, dans sa Géographie, mentionne une mine de cuivre à Marcillac ainsi que des fonderies...Cuivre et fer se sont donc bien rencontrés ici. Le moulin conserve dans sa partie basse une physionomie agréable. Et le bâtiment voisin pourrait bien être la fonderie...Une meule subsiste à proximité, ainsi...qu'un rail de notre Route du fer !

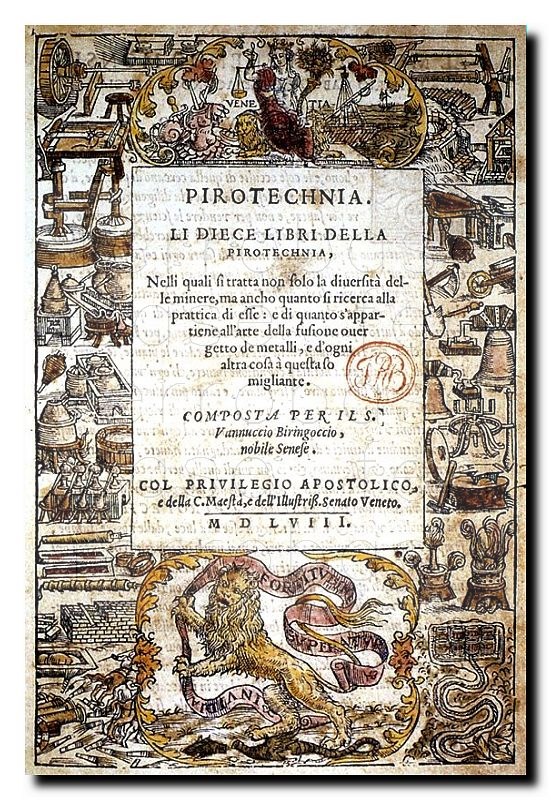
Retour au Lézert, et au cuivre. Et pour une fois la simplicité est de mise : tout est dit dans cette gravure. Elle apparaît dans le Pirotechnia de Vanoccia Biringuccio, en 1540. Paru avant le célébrissime de re metallica d’Agricola (vers 1555), l’ouvrage présente cette vignette. Enfin, une version du Pirotechnia présente cette vignette, car les impressions ont été multiples, tout comme les traductions ; les variantes sont évidemment nombreuses, et la vignette n’est pas présente dans toutes les versions…
(vignette présentée par Francis Dabosi, dans son article publié sur http://www.cadrescatalans.com/toulouse/article/culture/forge_catalane.pdf)
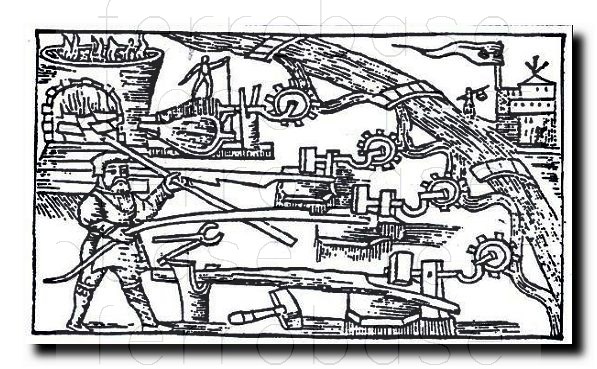
M. Blavier, ingénieur des mines note en 1806 cette activité du Lézert et la présente dans sa Statistique minéralogique du Département de l’Aveyron (Annales des Mines, 1806- annales.ensmp.fr). La configuration du ruisseau avec une pente rapide permet l’établissement de chutes (de l’ordre de quatre mètres) propices aux moulins : 12 martinets sur quelques kilomètres troublaient ainsi la quiétude des gorges, établis vraisemblablement à la suite de l’exploitation d’anciennes mines.
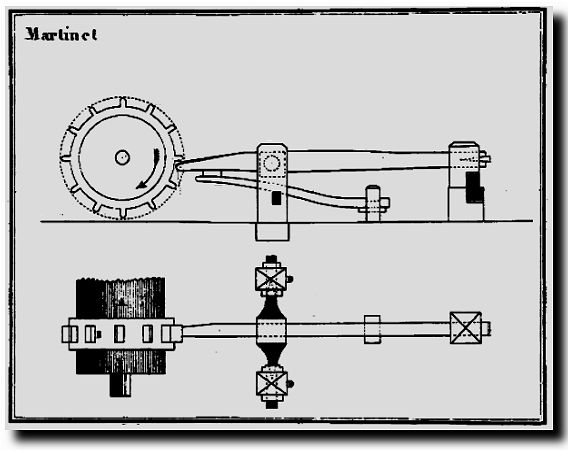
Cette vignette date de 1828. Elle figure dans le Dictionnaire technologique de Francoeur et Lenormand (Thomine, Paris, 1828-t13, PL 38). Le martinet est figuré dans toute sa simplicité et efficacité. La pièce de bois courbe au dessous du bras du martinet joue un rôle de ressort pour faire redescendre plus rapidement le marteau. Cette pièce n'existe pas ici à la Ramonde, où la frappe était relativement lente.
Tout, absolument tout de ce qui est sur le Lézert, le ruisseau d’ici, figure sur la vignette de 1540 : l’entraînement du soufflet par une roue à aubes mue par la chute de l’eau. Et l’eau entraîne évidemment par une seconde roue l’axe, un très robuste et imposant tronc de chêne, qui va mettre en mouvement le marteau avec l’action des cames. Le marteau frappe ensuite sur l’enclume, insérée dans un bloc rocheux de plus d’un mètre cube, et entre les deux le servant va dans un mouvement mécanique précis de rotation tourner la masse métallique chaude issue du creuset pour former la coupe froide, sous les chocs répétés du marteau. Il n’y a pas beaucoup plus à ajouter, les images parlent toutes seules. Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour faire renaître ce martinet : reconstruction totale, murs de pierres, toitures et autres mécanismes d’un ensemble disparu et pillé. Mais ce n’était pas dans les temps géologiques : des témoins sont encore très présents, et ils ont pu guider cette renaissance.
L’adresse ? Bien sûr ; c’est donc proche de la Route du Fer, un tout petit mais combien magnifique affluent : le martinet de la Ramonde, près de Labastide-L’Evêque. Les chocs du marteau ne vont pas vous rendre sourd ; bien au contraire ils éveillent notre imaginaire au-delà de ce qu’on pouvait espérer…N’oubliez pas de retrouver ces images et bien d’autres au chapitre 4 : un diaporama présente le martinet de la Ramonde. Un lien vers le site dédié est également présent sur la page des liens.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Muret le Château, ou Muret le Fer ?
Nous n’avons que peu évoqué Muret le Château sur ce site. C’est un tort, que nous allons réparer !

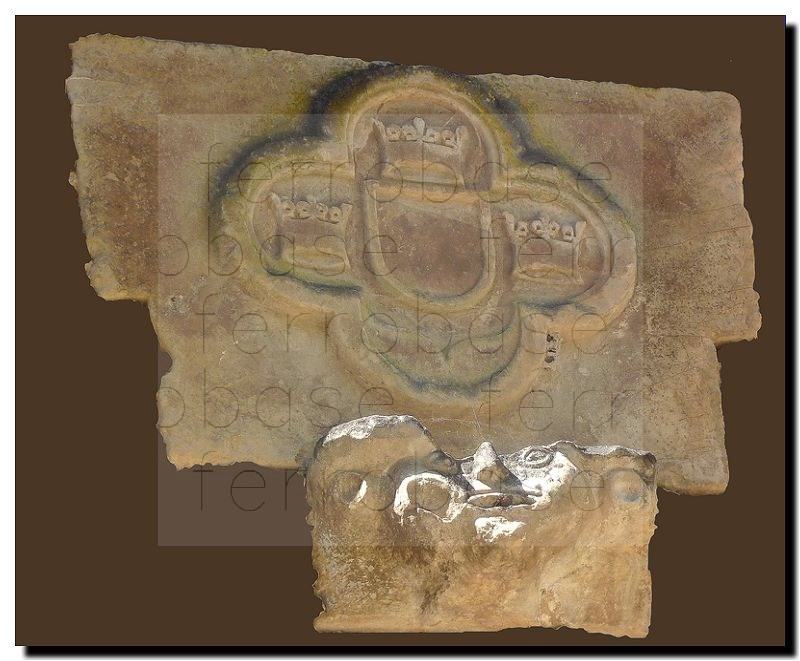 Muret
le Château est situé tout au bord du causse Comtal, juste après la mine
de Ferals, mine principale. Un très beau village, dont il faut
absolument avoir parcouru les abords et ruelles. Il est alors possible
que vous rencontriez cette beauté : couronne, écu et tête… Un
emprunt ancien au château ?
Muret
le Château est situé tout au bord du causse Comtal, juste après la mine
de Ferals, mine principale. Un très beau village, dont il faut
absolument avoir parcouru les abords et ruelles. Il est alors possible
que vous rencontriez cette beauté : couronne, écu et tête… Un
emprunt ancien au château ?
Une singularité géologique fait qu’il existe là, au dessus de village, une reculée. C’est une profonde entaille du causse que les mineurs vont rapidement utiliser. Le niveau bas de cette entaille est en effet plus bas que le niveau bas des galeries de la mine voisine. Il y a donc une magnifique possibilité de creuser depuis le point bas de la mine une galerie jusqu’à cette reculée. Et vous aurez compris qu’un problème essentiel et très présent dans les mines, dont celle d’ici, est résolu : cette galerie va servir bien sûr d’exhaure, pour évacuer les eaux de la mine. Muret est donc à proprement parler au tout début de la Route du Fer, qui se termine vers Decazeville et Aubin, à une vingtaine de kilomètres de là.
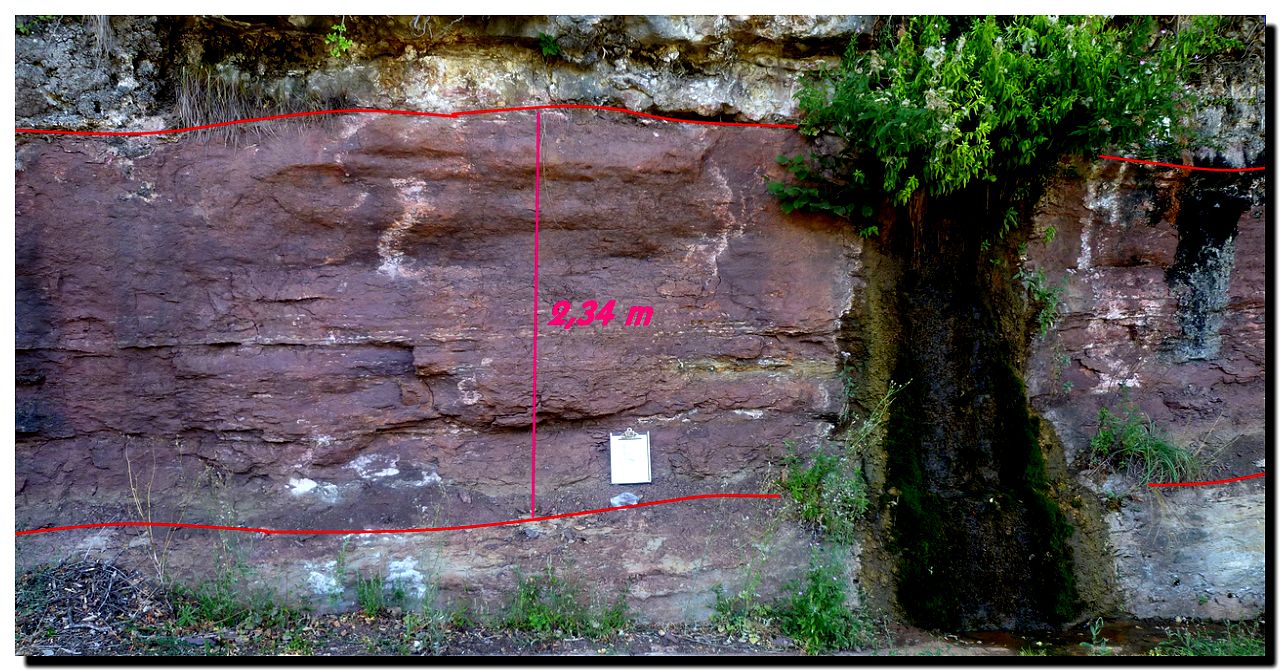
Un autre intérêt de Muret réside dans la leçon de géologie à
ciel ouvert qu’il serait vraiment dommage de laisser de côté. Les deux
cotés de la reculée présentent la roche du causse, à nu, sur plusieurs
dizaines de mètres d’épaisseur. Par endroits, c’est une véritable coupe
géologique qui se montre, sans efforts particuliers pour la contempler.
Et contempler est bien le mot juste. La couche de calcaire à oolithes
ferrugineuses affleure sur la bordure nord du causse et va ensuite en
s’enfonçant dans le causse. Ici, à Muret, on trouve une couche
parfaitement repérable. Sa couleur et sa nature ne laissent aucun
doute, c’est bien la couche de Ferals qui débouche ici. 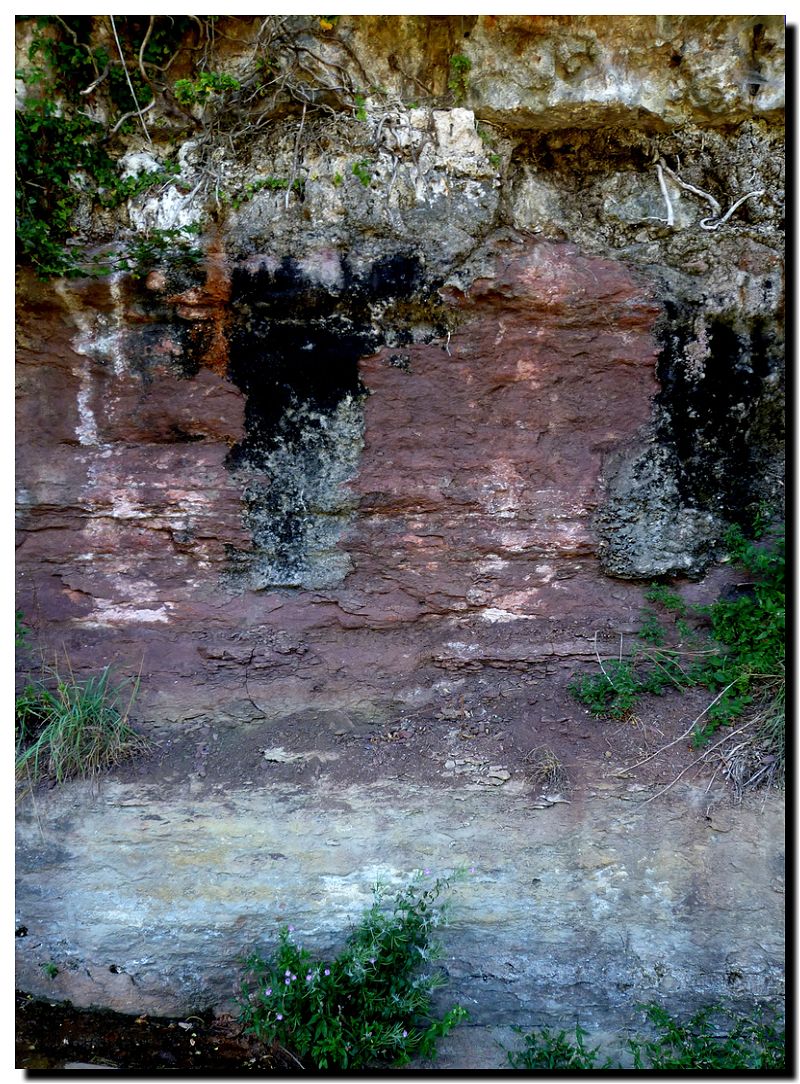 Elle
fait un à deux mètres d’épaisseur, puissance diraient les géologues,
est pratiquement horizontale, et contraste violemment avec ce qui est
au dessus ou au dessous, du calcaire de couleur évidemment bien
différente. Voilà sous nos yeux la richesse du causse que les mineurs
vont exploiter tout au long du XIX ème siècle. La couche se situe ici à
une cinquantaine de mètres sous la surface du causse.
Elle
fait un à deux mètres d’épaisseur, puissance diraient les géologues,
est pratiquement horizontale, et contraste violemment avec ce qui est
au dessus ou au dessous, du calcaire de couleur évidemment bien
différente. Voilà sous nos yeux la richesse du causse que les mineurs
vont exploiter tout au long du XIX ème siècle. La couche se situe ici à
une cinquantaine de mètres sous la surface du causse.
Y avait-il une exploitation à Muret ? C’est dans le domaine du possible...Ce qui est par contre absolument certain, c’est qu’en 1806 Blavier, pour son travail de Statistique minéralogique du département de l’Aveyron, Journal des Mines, n° 109,1806, p. 25-66, évoque un projet de martinet à fer, outil qui n’était pas incongru dans ce pays de fer ! Pour la description du martinet, dont il ne reste plus trace, nous renvoyons à celle du martinet de la Ramonde ; au métal près, la technologie était identique.
Muret le Château, c’est donc parfaitement sur la Route du Fer, et même une belle leçon de géologie minière pour les nuls ! (ce que les lecteurs de ce site ne sont évidemment pas, faut-il le préciser ? )
Donc, sans fatigue aucune, bonne découverte !

Les origines de la Route du Fer ?
Muret le Château pourrait bien avoir été le premier établissement industriel sur cette Route du Fer. Le premier à tous les sens du terme. Géographiquement, nous sommes ici le plus à l'est des futures concessions du causse, et donc au point le plus éloigné des usines, à l'origine donc de la Route. Historiquement, ce que Blavier, voir plus haut, évoque a bien une réalité. Le 12 novembre 1804, Jean-Antoine Passelac obtient l'autorisation d'implanter aux Bardels, dans le bas de Muret une forge à la catalane, véritable usine, avec haut fourneau et martinet. On en trouve la trace dans les Archives Nationales (F/14/4311, Aveyron), même si dans ce cas le lieu dit est Bardets. L'autorisation publiée dans le Bulletin des Lois décrit très précisemment les conditions : forge à la houille (déjà, et vingt ans avant le duc Decazes) par exemple, et obligation de replanter tous les ans un hectare de bois...Dans le temps et dans l'espace, cette forge mérite toute sa place sur notre Route.
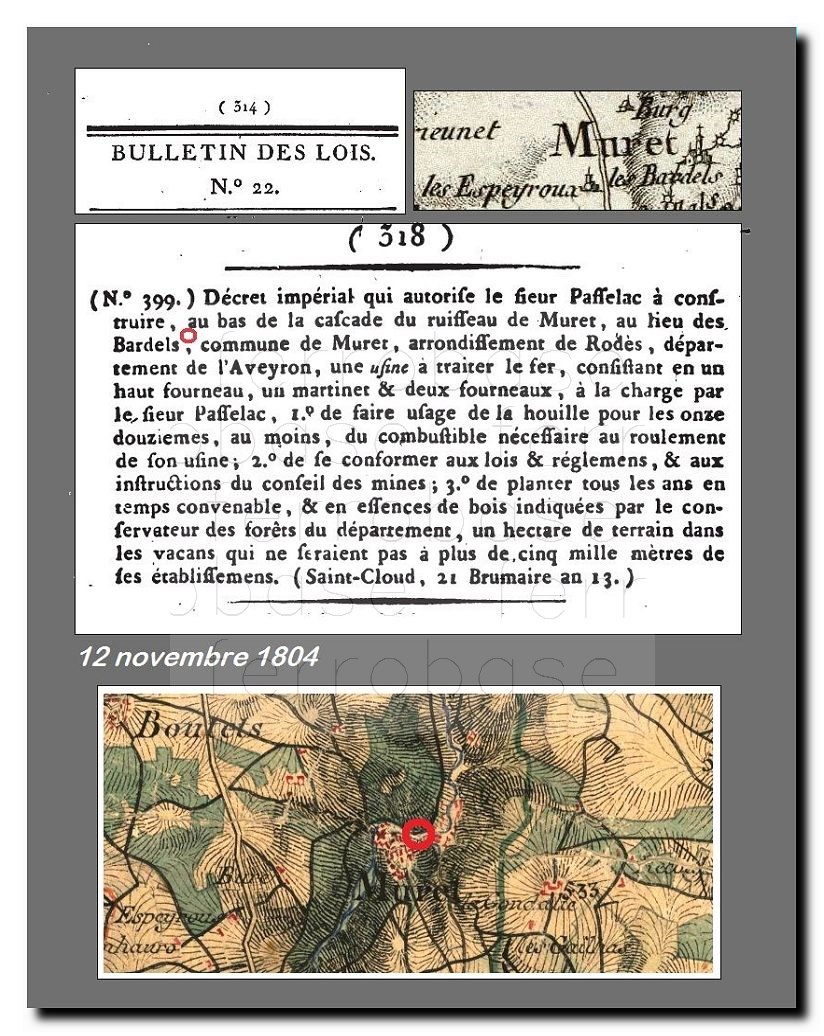
L'histoire est belle, trop belle pour être vraie ? L'usine à fer autorisée en 1804 a-t-elle vraiment vu le jour ? Sur place, aucun élément ne peut témoigner de cette présence. Blavier en 1806 reprend, mais pour le futur, les termes du projet : martinet avec deux marteaux, à construire précise-t-il rive droite du ruisseau immédiatement au dessous de la cascade. Pour qui connait le site, rive droite c'est plus qu'étroit...Il évoque également le second établissement à former, un haut-fourneau, toujours au dessous de la cascade, mais rive gauche cette fois, dans le local même appartenant à la compagnie déjà existante. Le martinet évoqué, à construire donc en 1806, devient indispensable à ceux qui voudront poursuivre le travail de la forge. Un marteau servirait à parer le fer de rebut, et l'autre pourrait être appliqué à une clouterie fabriquant par jour 1200 clous environ.
Notre conclusion est donc qu'il existait bien une forge à Muret, au bas
de la cascade, rive gauche du ruisseau. Il n'y a aucune raison de ne
pas croire Blavier pour cette présence. Pour le reste ?
Le destinataire de l'autorisation de 1804, Jean-Antoine Passelac est né (et mort en 1848) à Bozouls. Il fut baptisé en 1767 dans la belle église Sainte Fauste. Vous pouvez découvrir cette beauté architecturale sous la neige au début de la troisième partie du chapitre 1 de ce site. Nous n'avons que peu d'informations sur celui qui demeurait en 1848 à Aubignac, une grande ferme proche de Bozouls, et aucune permettant d'affirmer s'il a donné suite à son projet... Ni forge ni martinet sur les cartes : aux Bardels, seul un moulin figure sur le cadastre de 1813, parmi les 12 moulins ( ! ) qui se succèdent sur à peine deux kilomètres de ruisseau. Cinquante ans plus tard la carte de l'Atlas cantonal ne mentionne que des moulins... La feuille Rodez de la carte de Cassini, levée de 1766 à 1768, qui ne manque pas habituellement de figurer les martinets avec cette indication martinet, ne fait non plus pas apparaître une semblable installation ici... Aucune Fge (forge) n'est indiquée..
Mais même avec une modeste forge, en faisant confiance à Blavier, nous pouvons dire que la Route du Fer avait une origine dans cette très belle vallée : il y avait une forge, et les eaux de la mine de Ferals vont y couler.
► A suivre, un clic ici, la très belle carte de 1804 de la Compagnie Passelac.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Etablie par ordre du
Ministre de l’Intérieur,
cette carte qui présente donc un caractère officiel a été mise à jour en
septembre 1897. Le tirage en nos mains date de 1898. L’échelle est le
1/100.000, et il s’agit précisément de la feuille XVII-31, RODEZ,
Aveyron, publiée par Hachette et Cie.
Pourquoi s’intéresser à celle-ci ? Son graphisme est agréable et la typographie particulièrement soignée. Mais c’est le contenu qui nous a accroché : beaucoup d’éléments miniers, et de plus beaucoup (trop) d’approximations ! Il est vrai que les deux agents-voyer en chef qui ont participé à la rédaction n’étaient pas de l’Aveyron. L’un d’eux officiait dans l’Orne, et le second dans le département des Côtes du Nord, ce qui peut expliquer cela. Leurs noms figurent en tout petit, avec la mention « pour le département de l’Aveyron… ». Ils n’ont pas de toute évidence dû parcourir le département avec trop d’attention pour ce travail.
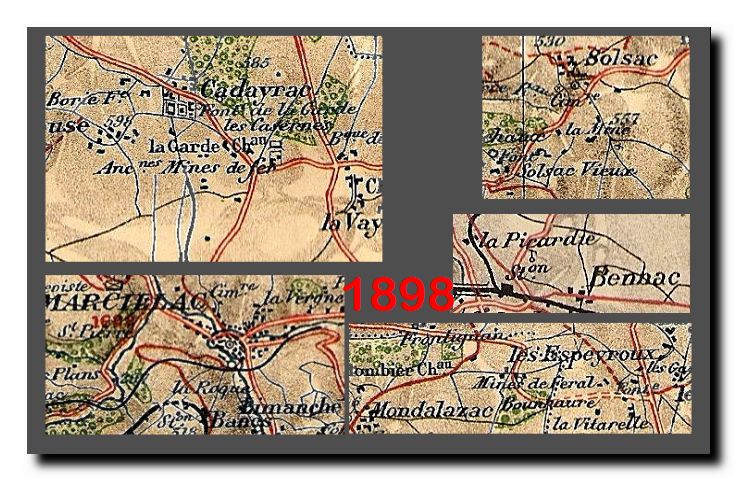
A la Garde comprendre Cadayrac, les anciennes mines de fer sont indiquées. On sait qu’elles ont cessé leur activité en 1881-1882, après leur vente par la Compagnie d’Orléans. Deux bâtiments sont gravés sur la carte, dont celui connu pour être la « gare », c'est-à-dire la remise des deux locomotives de l’exploitation, dont il ne reste que quelques ruines.
Le tracé de la voie ferrée minière figure. Oui, le tracé !
Et cela, c’est une vraie curiosité, car aucune autre carte officielle n’en fait mention…Si ce
tracé est indiqué, comme voie étroite bien sûr, il
ne faut cependant pas lui accorder trop de confiance. Il semble assez
schématique : des courbes sont totalement gommées, ou au mieux
lissées, comme au passage du grand remblai de Puech Hiver. Le dessin de
l’arrivée à la mine ne correspond pas non plus avec les données de
terrain, le crochet terminal étant parfaitement absent…A l’autre
extrémité, un dessin rapide montre à tort une jonction entre les deux
voies ferrées, d’écartements différents. La traversée de la route, en
milieu d'image, près de la bergerie est totalement fantaisiste et ne
correspond en rien à la réalité, ainsi que la suite du tracé vers La
Picardie !
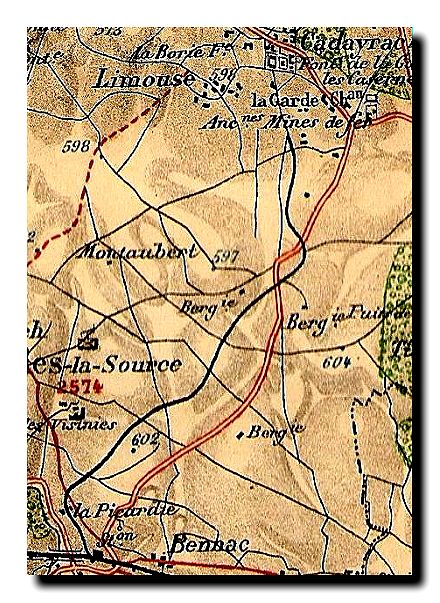
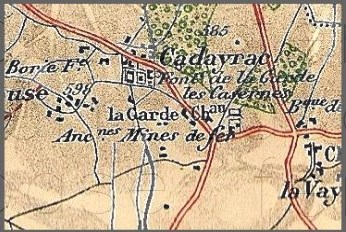
Toujours à la Garde, une mention de lieu dit apparaît : les Casernes, juste au nord du château. Existe-t-il une relation entre ce lieu dit et l’activité minière ? On sait que les bâtiments où logeaient les mineurs de Ferals, qui n’étaient pas construits à la date de la carte, portaient, et portent toujours, ce nom.
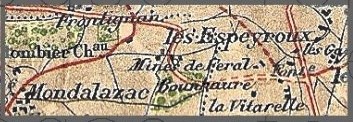
Aux Espeyroux, les mines de Feral sont indiquées, et quatre bâtiments, deux par deux de part et d’autre de la route vers le Cruou sont dessinés. On constate également que cette route du Cruou, qui est donc toute jeune en 1897, elle vient d’être réalisée avec l’apport financier de la compagnie de Decazeville, est à l’état de « lacune », comme dit la légende, pour sa jonction à l’est vers la route qui traverse le causse et vers Muret.
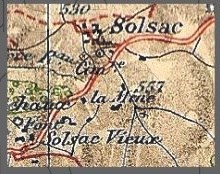
A Solsac, le lieu dit la Mine, entre Solsac vieux et Solsac témoigne des activités passées.
C’est à Marcillac que
nous allons terminer cette analyse, et les constatations sont
curieuses. La voie ferrée minière de la compagnie de Decazeville est
évidemment dessinée, et correctement indiquée voie étroite par son
graphisme. Depuis le pont Malakoff,
schématisé correctement, la voie rejoint donc le plateau de la gare
minière de Marcillac. Celui-ci n’est pas indiqué, comme on aurait pu
s’y attendre, et de plus les deux tunnels terminaux, dont un frôle le
kilomètre, et le second les
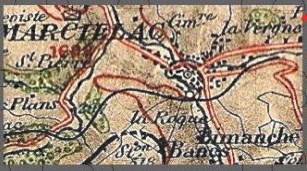
Le tampon à empreinte sèche Ministère de l’Intérieur, service vicinal, donne à cette carte officielle une authenticité qu’elle n’a donc pas…Même gravée, l’information n’est donc pas toujours absolument certaine…Par contre des éléments absents ailleurs sont ici indiqués.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Comte, duc, droits et devoirs : le majorat
La Charte Constitutionnelle, voulue par Louis XVIII, verra le jour en juin 1814. Parmi les innovations, nous pouvons relever celle de la mise en place de la Chambre des Pairs, une chambre haute, prenant la place du sénat précédent, et appelée à jouer auprès de la Chambre des Députés un rôle politique majeur. Ce n’est pas cet aspect qui nous importe. La dignité de pair, héréditaire, décernée par le roi, et par lui seul, devait à terme mettre en place un contre pouvoir. On n’était pair que si on était noble. Et donc, un titre de noblesse était obligatoirement attaché à celui de pair : baron, vicomte, comte, marquis, et duc. Noble pair a un sens, mais pair et noble n’en a donc pas.
▲
le sceau de Louis XVIII, vert. Il est attaché aux attributions de titres
Celui de Charles X est identique, au
nom du roi près.
Représentant de la noblesse, le pair se devait d’avoir un certain statut. Le majorat était là pour cela. Un majorat, c’est un ensemble de biens, propriété du futur pair, inaliénables, échappant au partage successoral, condition nécessaire du maintien du titre, et transmis avec le titre de noblesse. Le revenu procuré par le majorat varie avec le titre. On se doute bien que des règles très précises régissaient tout cela, pair, majorat et titre. C’est ainsi qu’il fallait justifier d’un majorat procurant un revenu d’au moins 20.000 francs pour être pair et comte ou marquis, de 30.000 francs dans le cas du titre de pair et duc. 10.000 francs de revenu étaient suffisants pour un vicomte ou un baron. C’est une ordonnance de Louis XVIII du 25 août 1817 qui institue ces précisions. (BdL, CLXXI, n° 2686, du 4 septembre 1817)
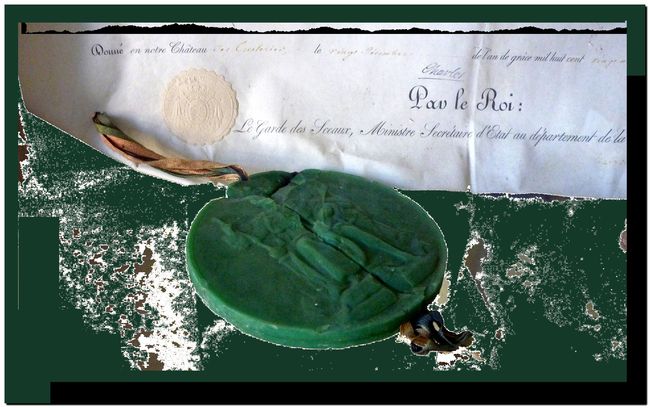 Ces
indications de majorat faisaient, entre autres l’objet d’une
publication au Bulletin des Lois. Elle prenait la forme très officielle
et pompeuse de lettres patentes du roi, faisant ainsi connaître
publiquement la bonne nouvelle, et la rendant de ce fait opposable à
tous, en authentifiant le titre décerné. Le sceau apposé sur les
lettres à caractère perpétuel était d’une jolie couleur verte, le jaune
étant réservé aux lettres plus « courantes ».
Ces
indications de majorat faisaient, entre autres l’objet d’une
publication au Bulletin des Lois. Elle prenait la forme très officielle
et pompeuse de lettres patentes du roi, faisant ainsi connaître
publiquement la bonne nouvelle, et la rendant de ce fait opposable à
tous, en authentifiant le titre décerné. Le sceau apposé sur les
lettres à caractère perpétuel était d’une jolie couleur verte, le jaune
étant réservé aux lettres plus « courantes ».
Les dites lettres patentes, rédigées sur parchemin,
mentionnaient date, motifs de la nomination de pair, ainsi que le titre
affecté à la pairie. Elles donnaient enfin la concession
du droit exclusif de placer leurs armoiries sur un manteau d'azur
doublé d'hermine, et de les timbrer d'une couronne de pair ou bonnet
d'azur cercle d'hermine et surmonté d'une houppe d'or (Ordonnance
du Roi sur la délivrance des lettres-patentes portant
collation des titres de Pairies (VII, BUll. CLXXI, no 2687.)) mêmes
dates.
La pratique des majorats sera progressivement abandonnée à
partir de 1835.
Le majorat obligatoire avant toute dignité de pair et sa
publication officielle nous permettent donc d’en savoir un peu plus sur
la fortune d’Elie Decazes en 1826. En 1826, année où les forges de
l’Aveyron connaissent un début de réalité, le majorat du duc est
précisé par des lettres patentes de Charles X (bulletin 99, n° 3279)
signées le 9 mars 1826.
Quelques chroniqueurs avaient fait état de cette fortune, et certains avaient même souligné qu’après son départ en 1820 du premier plan de la scène politique, le duc était notablement ruiné : "Rappelé de Londres, (il) se retira donc dans ses terres, où il chercha à se consoler de sa chute en jouant le rôle de grand seigneur protecteur de l'agriculture et de l'industrie; rôle qui lui coûta fort cher et qui lui réussit assez mal, puisqu'il était notoirement ruiné au moment où éclata la révolution de Juillet" (Dictionnaire de la Conversation).
Ruiné ? Vraiment ? En 1830 ? Aurait-il complètement dilapidé son patrimoine en quatre ans ? Car en 1826, ce patrimoine était fort conséquent !
Le majorat du duc est donc basé par exemple sur le domaine de La
Grave. Son revenu est de 25052,40 francs, mais insuffisant donc à lui
seul pour établir le majorat de duc. Le domaine s’étend sur
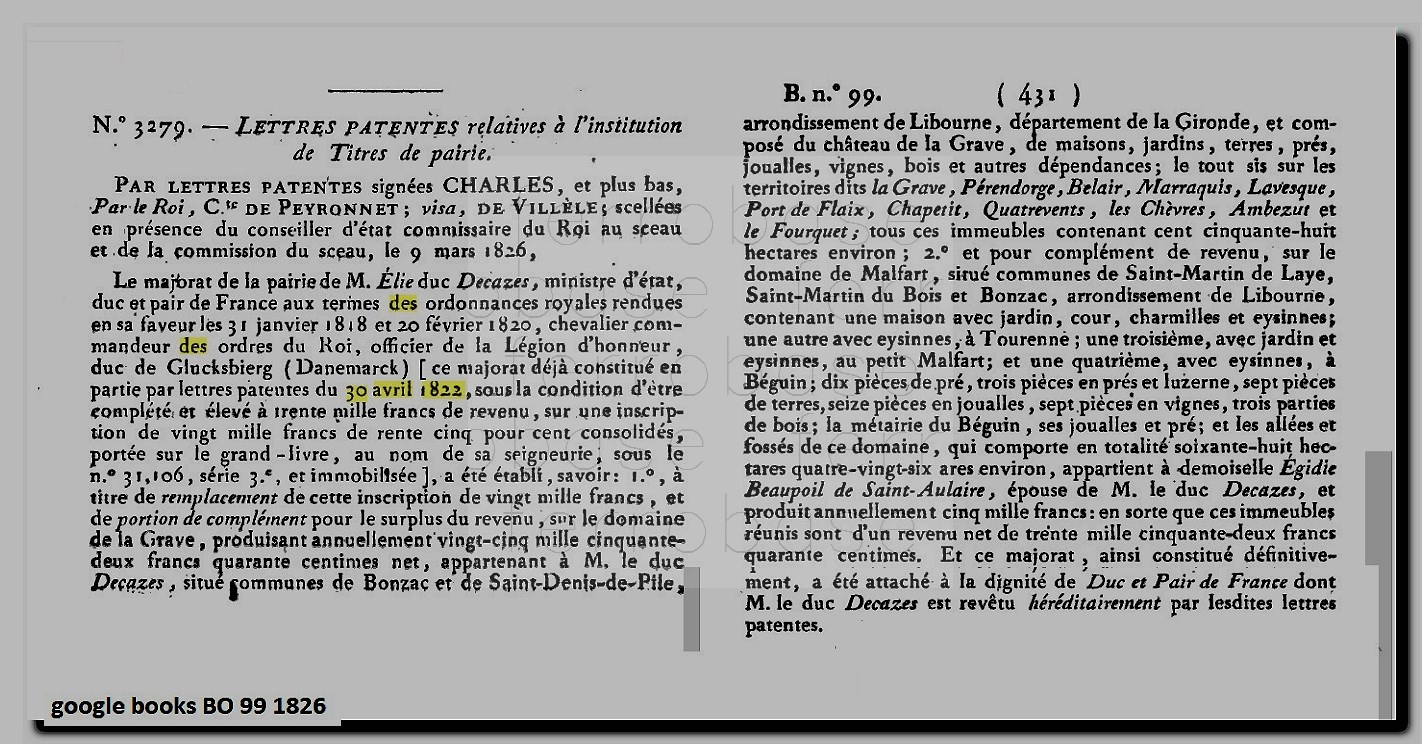
▼ la lettre de LOUIS XVIII
c'est aussi "l'officialisation" des armoiries, les trois corbeaux, signe de longévité...
(archives senat.fr depuis Archives Nationales)
▼ la lettre dans son intégralité
son étui très
singulier
protège également le sceau
Les armoiries sont toujours d'actualité...▼
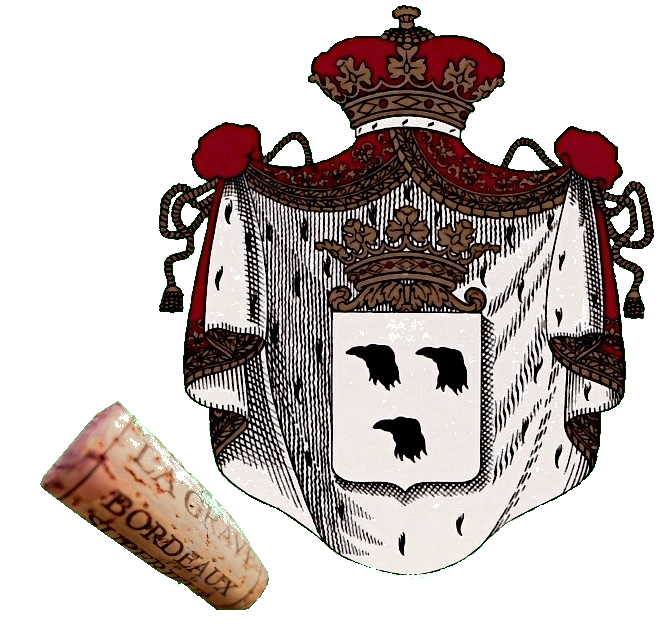
"D'argent à trois têtes de corbeau arrachées de sable, posées deux et un,
sur un manteau d'azur doublé d'hermines et de les timbrer d'une couronne de pair au
bonnet d'azur cerclé d'hermines et surmonté d'une houppe d'or"
lettre patente, Louis XVIII,
30 avril 1822
Livre de la pairie, Archives Nationales,
salle des inventaires
virtuelle, CC/961, p 67,68,69 ici
Contrairement à ce que pouvait laisser penser le Dictionnaire de la Conversation, on imagine donc mal le duc ruiné quatre ans plus tard…
Et c’est d’autant plus improbable, qu’Elie Decazes avait évidemment d’autres biens, non inclus dans ce majorat. On sait que la position d’entrepreneur du duc s’étendait à une activité agricole importante. Il fut très impliqué dans ce domaine. Peut-être davantage que dans « ses forges ». Il possédait pour cela des propriétés conséquentes, à la Grave et ailleurs, et ses connaissances en ce domaine étaient sans doute plus étendues et plus accessibles que celles nécessaires à la conduite de hauts fourneaux… Prenons le seul exemple d’un domaine, celui du Gibaud.
Ce domaine de
En
1831 le duc participe à un concours national pour l’établissement de
sucreries sur des exploitations agricoles. Il rend compte dans un
rapport publié en 1831 des résultats sur son domaine de Gibaud,
mentionné comme étant de
En 1849, le duc propose le domaine au Conseil Général des Charentes Maritimes pour l’établissement d’une école régionale d’agriculture. Le duc précise dans sa lettre que « la totalité de la propriété contient environ cinq cent hectares… »...Quelle que soit la centaine retenue, c’est donc important.
Le Bulletin des Lois avait fait part en 1818 et 1822 des majorats du duc. En 1818, il s'agissait du majorat attaché au titre de comte, sous la forme d'une rente. En 1822 il s'agit du titre de duc, avec deux lettres patentes, signalées pages 228 et 230.. On constate que la transmission du titre était celle de comte, sauf à constituer un majorat de duc pour attendre la fameuse limite des 30.000 francs de revenus, condition indispensable, qui sera donc remplie en 1826, et rendra ainsi le titre de duc transmissible héréditairement (Remarque hors sujet : pourquoi donc Gallica n'offre-t-il pas TOUS les Bulletins des Lois ? Ceux présentés ici ont été dénichés dans des bibliothèques universitaires américaines...)
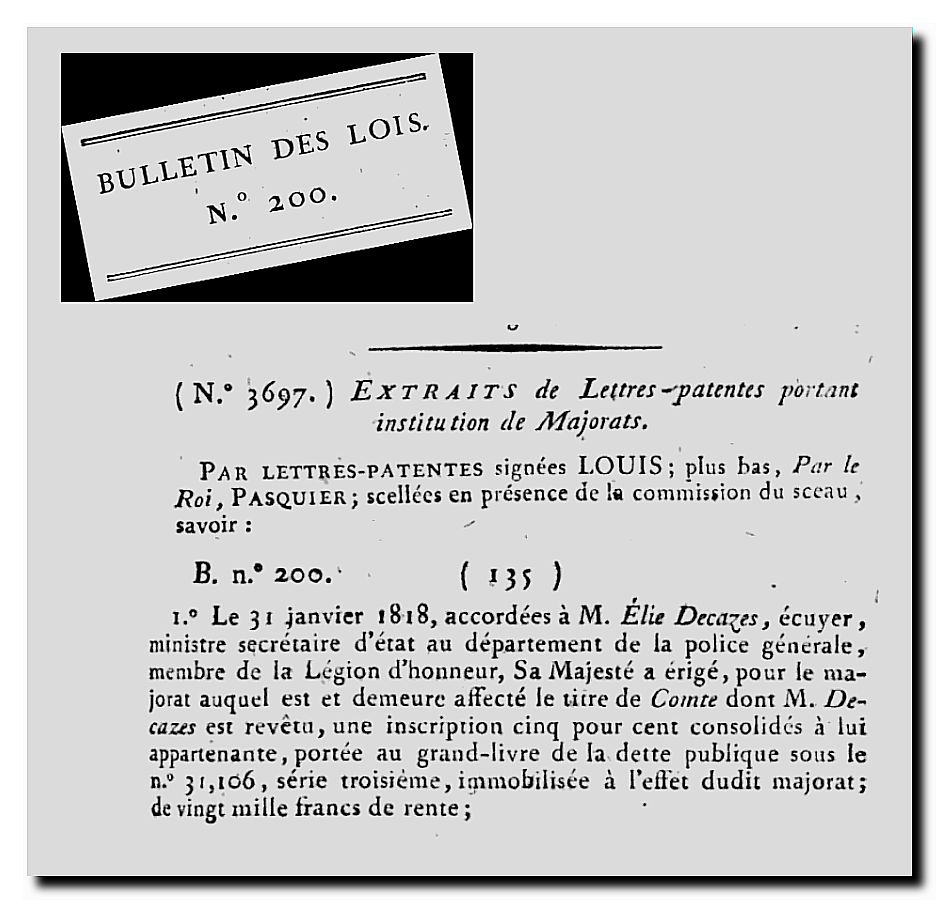
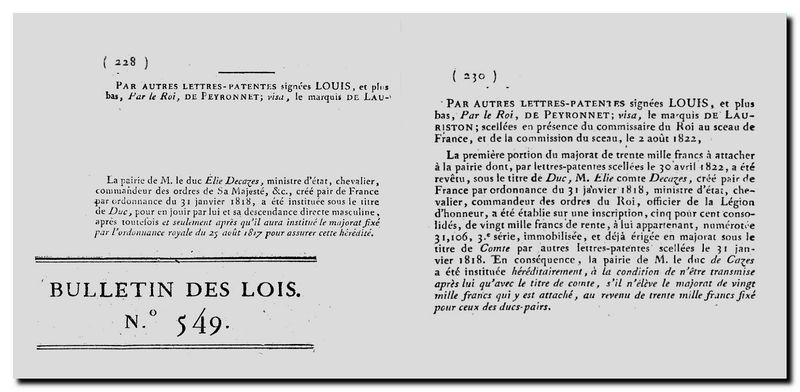
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Une pépite ?
Assurément, même si elle n'est pas en or. Sa valeur
est pour nous inestimable : précurseur dans l'histoire mondiale de la
photographie, ce document est très probablement l'une des plus
anciennes images de l'Aveyron, réalisée en 1845. Son intérêt réside par
le site immortalisé : c'est la première photographie connue des usines
de Decazeville. Le château de
1845 : Choiselat est chimiste. Stanislas Ratel, qui sera son beau-frère quelques années après ce cliché, est ingénieur, des mines, ingénieur civil, c'est à dire élève externe. Une fois diplômé, il fut ingénieur de la compagnie d'Orléans, celle qui s'investira dans la vallée voisine vers 1860, et sur le causse Comtal, pour la mine de Cadayrac. Les deux, originaires de Touraine, sont passionnés d'une nouvelle technique, le daguerréotype. Née vers1839, cette technique permet de fixer une image sur une plaque sensible, au prix d'une manipulation chimique qui serait aujourd'hui absolument hors de propos. La manipulation des sels de mercure pour la fixation de l'épreuve relève du laboratoire….
En 1845 le daguerréotype est presque commun, en tout
cas presque parfaitement maîtrisé par nos deux photographes, qui sont
d'ailleurs connus pour leurs succès et perfectionnements divers. C'est à l'automne 1845 qu'un périple dans le
midi de
Le cliché que nous présentons est aujourd'hui loin du Rouergue, au Canada, pour être précis. Acquis par une institution de Montréal en 1984 auprès d'un collectionneur européen, il fait donc partie des collections du Centre Canadien d'Architecture, CCA.
Pour le retrouver, nous avons comme souvent
bénéficié d'informations diverses. C'est un passage par
Au Canada, il est, pour son propriétaire, légendé inconnu, daté vers 1850, et situé en Allemagne :
Unknown, unidentified industrial site
with large smoke stacks, probably Germany.
ca. 1850
Depuis le 18 février 2014, il est donc légendé ainsi :
Choiselat et Ratel
Vue des installations de l'usine
sidérurgique de Decazeville, Aveyron
1845
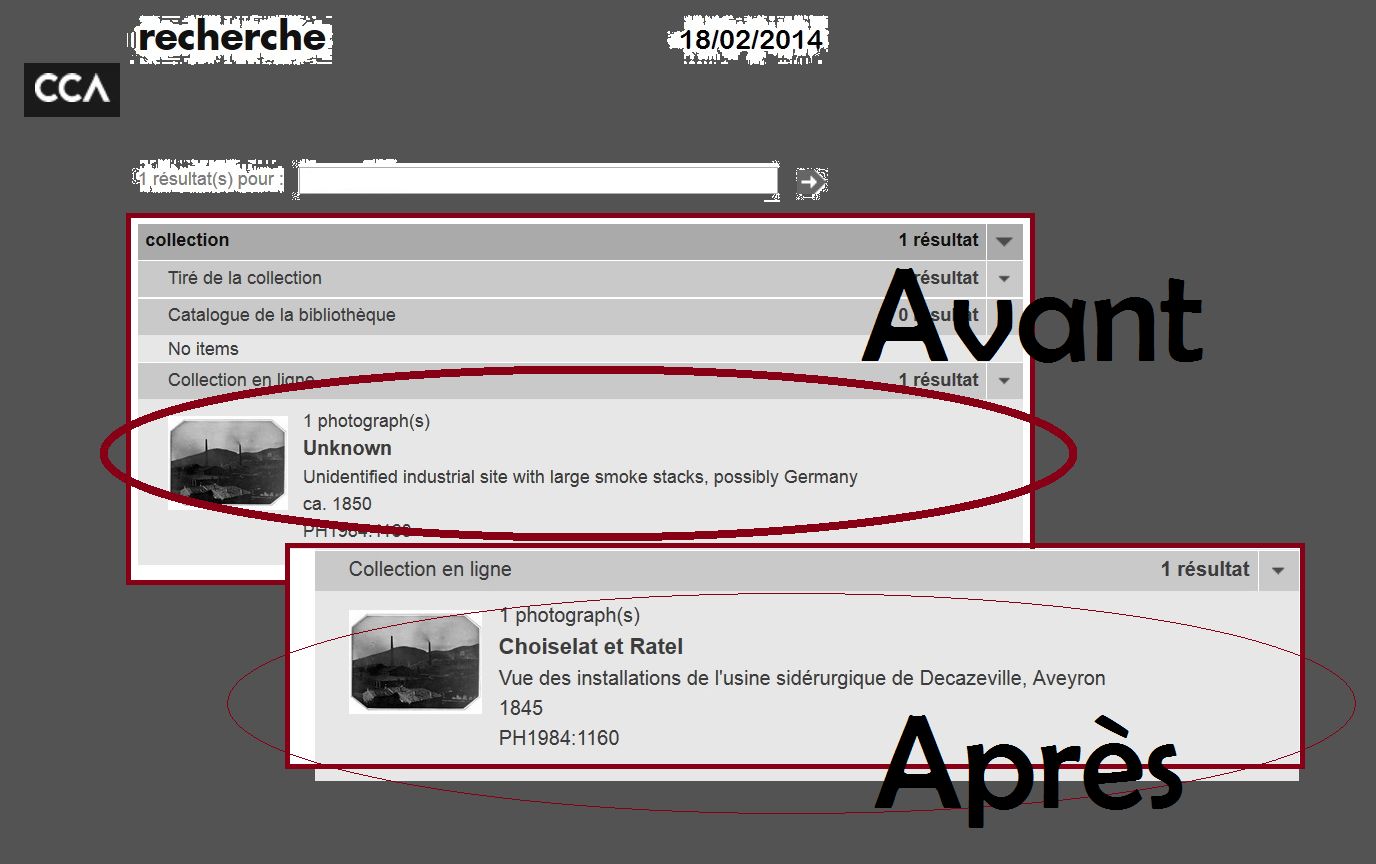
Pour restituer les origines, et convaincre donc nos cousins canadiens, nous avons rapproché plusieurs documents en recherchant une période aussi étroite que possible, vers 1845 donc. Il y a des plans, dans les archives de l'ASPIBD, à Decazeville, et des gravures. Parmi celles-ci, celle de l'Illustration de 1846 permet un recoupement d'indices particulièrement intéressant. En voici quelques uns :
- la situation géographique générale, le cliché est pris vers le sud-est et la topographie actuelle est en accord.
- la position des bâtiments, forges et constructions. Elles correspondent en tout point aux plans des usines
- la position du mur des hauts-fourneaux, et la géométrie particulière de ceux-ci
- les travaux de la découverte naissante à l'arrière plan
- le plan d'eau au premier plan, près d'un lavoir
- les constructions sur la colline, présentes sur les plans
Nous pourrions ainsi multiplier ces indices, dont un, au moins, mérite une mention particulière : sur le bâtiment des forges, avec sa toiture à quatre pans, au premier plan, on distingue parfaitement des cheminées. Elles sont doubles, et sont toutes surmontées d'un très curieux volet permettant des les occulter. Ce volet se commande depuis le sol à l'aide d'une corde. Ce dispositif est exactement semblable à celui dessiné par Forest dans l'Illustration. La géométrie particulière des cheminées et ce dispositif sont semblables sur le dessin et la photographie.

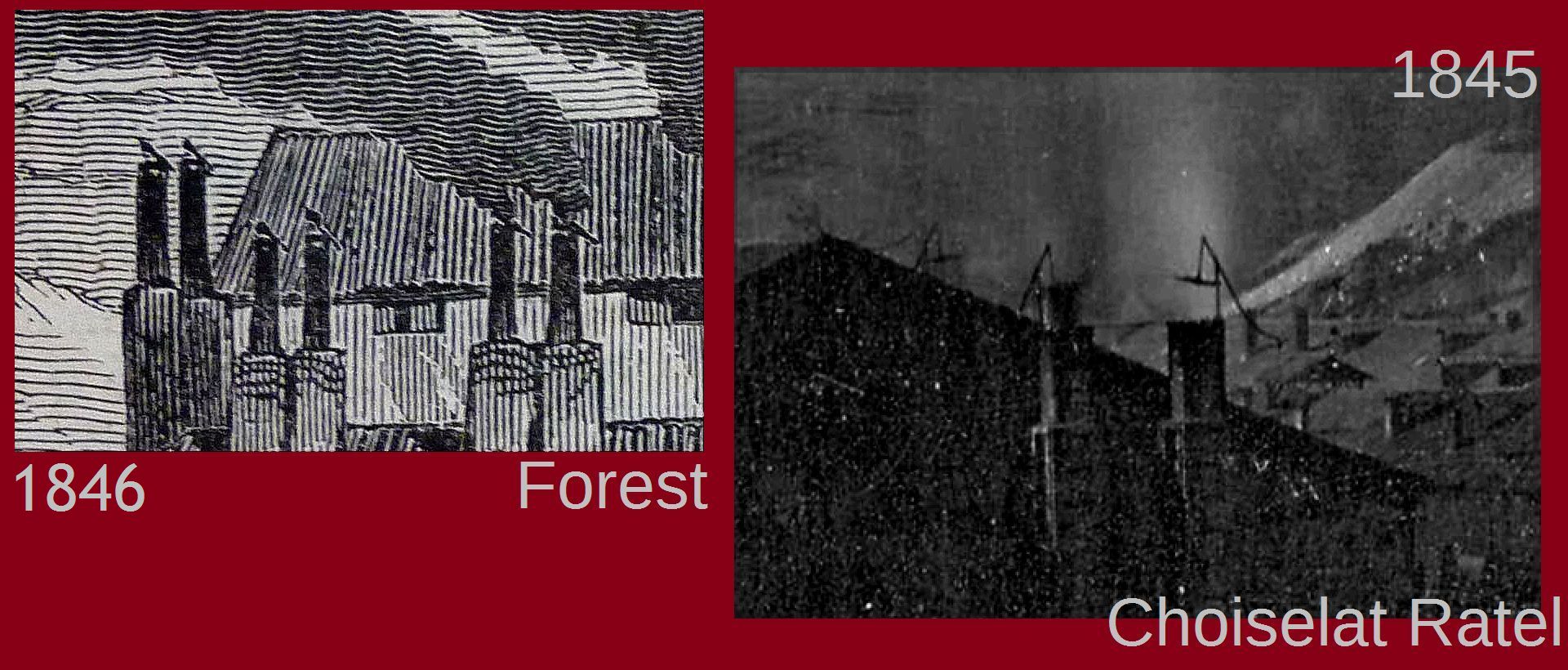
Cette simultanéité d'indices ne permet pas de laisser place à un doute sur la situation exacte du daguerréotype de Choiselat et Ratel.
Il y a enfin, pour ceux qui auraient une inquiétude
un dernier élément. Ceux qui ont parcouru notre site connaissent un
précurseur industriel, les frères de Lassalle, Joulia de Lassalle
exactement. Ils étaient présents dès 1804 sur cette terre, et
propriétaires du château éponyme. Quand il est dit château, c'est en
fait une imposante bâtisse, construite à flanc de colline, et dominant
la vallée. Sur ce point tout le monde s'accorde. On ne connaît aucune
photographie de ce bâtiment, devenu propriété de
Un grand merci donc au Centre Canadien
d'Architecture, pour avoir compris par son acquisition de 1984 que ce
pouvait être là un document intéressant, et pour l'autorisation
accordée de le présenter sur notre site. Leur disponibilité et
réactivité à reprendre la légende est un bel hommage à
A observer, détailler sans modération : l'une des premières photographies -daguerréotype- de l'Aveyron. Elle mérite bien son rang de pépite, non ?
14,7 x 20,5 cm
PH1984 : 1160
Collection CCA
>>>> Si vous souhaitez réagir : jrudelle@ferrobase.fr
Pour information, voici un détail du cadastre de 1835, montrant le château de la Sale
En faisant figurer le Nord en haut du plan, le cliché de Ratel est donc orienté Nord-Est vers Sud-Ouest.
Les deux
bâtiments sont bien présents sur le cliché,
ainsi que
la "tour" qui se devine à gauche -à droite sur le plan- du bâtiment
principal...
Notes complémentaires
Stanislas Ratel, né en 1824, est ingénieur civil des mines. Son collègue, en photographie, Charles Marie Isidore Choiselat, né également à Paris en 1815 ne l'est pas, contrairement à ce qui est souvent écrit. Un peu plus âgé que Stanislas, dix ans de plus, et sûrement plus expert en chimie, il se joint au groupe des trois ingénieurs élèves : Jules-Marie Victor Fournier, Charles Nicolas Jules de Montaignac et Stanislas Ratel. Leur voyage d'études, 100 jours minimum, nécessaire pour valider leur formation et diplôme d'ingénieur a été évoqué plus haut. Un "Journal de voyage" est rédigé ; son coefficient, important, est de 7. Victor Fournier sera plus tard un temps directeur d'un établissement de la société Commentry-Fourchambault. Nous n'avons aucune information sur le parcours de Charles de Montaignac. Le passage par l'Aveyron avait peut-être été proposé et discuté avec Elie de Beaumont par un des enseignants de l'École, Dufrénoy, hypothèse tout à fait personnelle…. Nous avons souligné l'implication du géologue dans la création de Decazeville, ses attaches avec le duc Decazes, et ses travaux de 1825-1826 sur les ressources rouergates. Dufrénoy sera Directeur de l'École des mines en 1848. Il est attesté que c'est début octobre 1845 que le passage en Aveyron aura lieu. Le quatuor était-il alors complet ? La consultation de leur mémoire manuscrit, conservé, pourrait nous informer sur ce point. Rédigé en trois parties, le chapitre troisième concernant le Rouergue est rédigé par de Montaignac (de Gap à Murat), Ratel étant l'auteur du premier chapitre, de Paris à St-Etienne. Victor Fournier rédige le mémoire de Lyon à Gap. Le 9 janvier 1846, Arago, au nom de Choiselat et Ratel, présentera une communication à l'Académie des Sciences en faisant part des vues prises lors de ce voyage. Decazeville est nommément cité. L'auteur de la communication (Ratel ? Choiselat ?) précise en outre dans son manuscrit que de nombreuses vues ont été faites.
Page des menus, après un clic sur le bouquet de bienvenue, vous pourrez lire l'arrivée à Decazeville des futurs ingénieurs, sous le titre le soupirail de l'enfer, le terme employé par de Montaignac. Il n'y a pas toutes les réponses à nos interrogations, mais la description du site et des mines mérite la lecture.
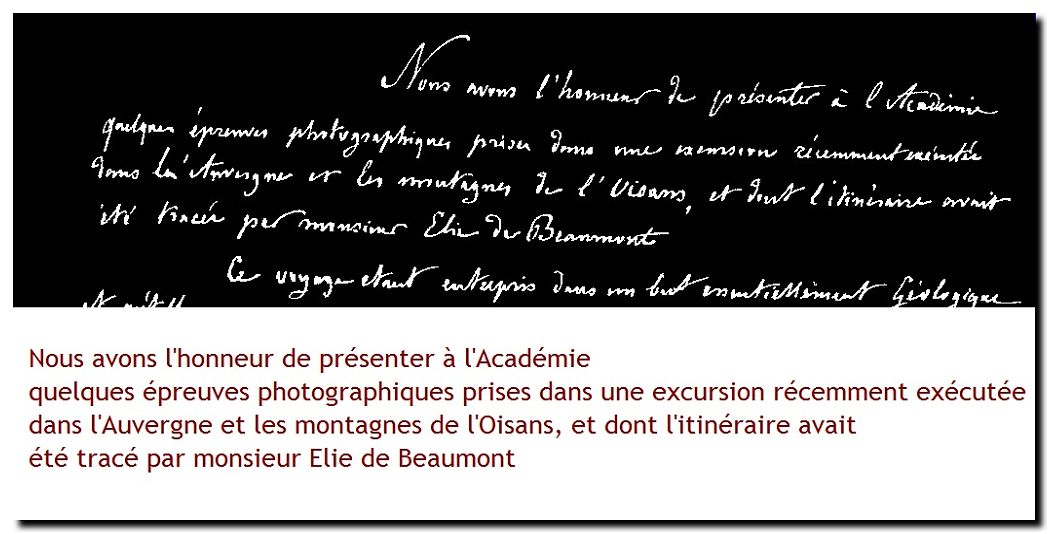
Afin de compléter les premières recherches, nous avons parcouru quelques sources fiables, dont celles écrites par Q. Bajac, conservateur du Patrimoine. Il fut à l'origine de l'exposition sur le daguerréotype français présentée à Orsay en 2003. Sur ce sujet il a publié un article (Revue de l'Art, n° 141, 2003) et une remarquable analyse dans le catalogue de l'exposition (2003, RMN). Nous avons également pu prendre contact avec un proche parent de Stanislas Ratel, qui nous a très aimablement communiqué quelques détails essentiels. La cité de l'Architecture Chaillot a été mise à contribution ainsi que d'autres sources comme des sites de ventes aux enchères ou des auteurs de publications.
Au terme (mais la recherche n'est évidemment pas définitivement
close…) de ce travail, nous pouvons avancer quelques autres
informations. Sur la forme, le document de 1845 est du même format,
13x18 cm environ, que deux autres images
de Ratel qui montrent globalement et de loin le site de Decazeville.
Ces deux images se situent l'une au Getty Museum de Los Angeles, et
l'autre fut vendue à Paris. Elles ne diffèrent que par un détail
amusant : les fumées des cheminées se dirigent vers la gauche pour
l'image désormais américaine, et vers la droite pour la seconde, le
vent a tourné ! Cette similitude de format pour ces trois images est
soulignée par Q. Bajac, ainsi que les tonalités générales des
photographies, très proches. Nous avons également pu être assuré d'un
détail de dates : le cliché ci-dessus de 1845, évidemment unique de
part la technique employée, fut acquis en 1984 par le Centre Canadien.
Or c'est cette même année que le collectionneur européen qui était
alors en possession de plusieurs images de Ratel en vendit certaines.
Les autres furent ensuite l'objet de litiges et se trouvent
actuellement en majorité dans des collections françaises publiques,
comme Orsay. L'image très connue de Ratel de la cathédrale de Rodez,
possession du Centre Canadien d'Architecture, est d'un format
semblable, 13x18 cm. L'auteur de l'image présentée est donc pour nous
Stanislas Ratel, et au vu du périple de 112 jours, ce site ne peut être
donc que Decazeville où il séjourna quatre jours avant de rejoindre le
Cantal. Il y aurait -au moins- trois images de cette étape finale de
Au-delà bien sûr des éléments d'identification évoqués ci-dessus, on a donc des éléments historiques, de format et de technique qui viennent conforter notre hypothèse. Sans être dans le domaine de la certitude, nous en sommes proche !
Une mention très particulière, pour remercier Monsieur Emmanuel Boëlle, parent de Stanislas Ratel ; nos courriers échangés ont permis de préciser quelques points essentiels de cette recherche. Nous lui devons également copie de cette lettre de Stanislas Ratel, présentant, via Arago, son travail à l'Académie des Sciences : Decazeville est mentionné !
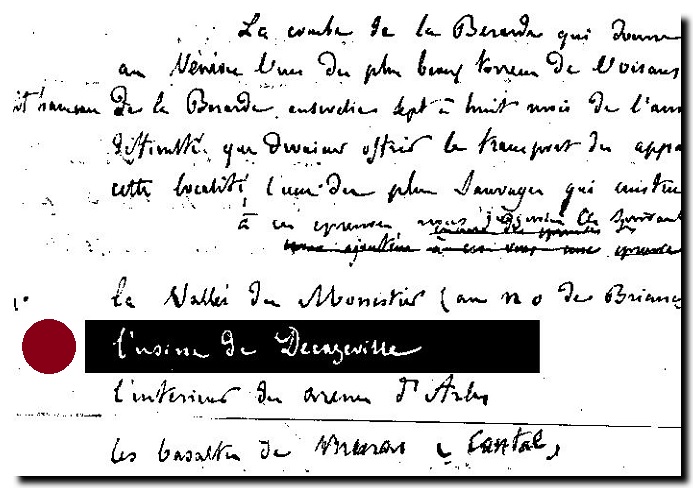
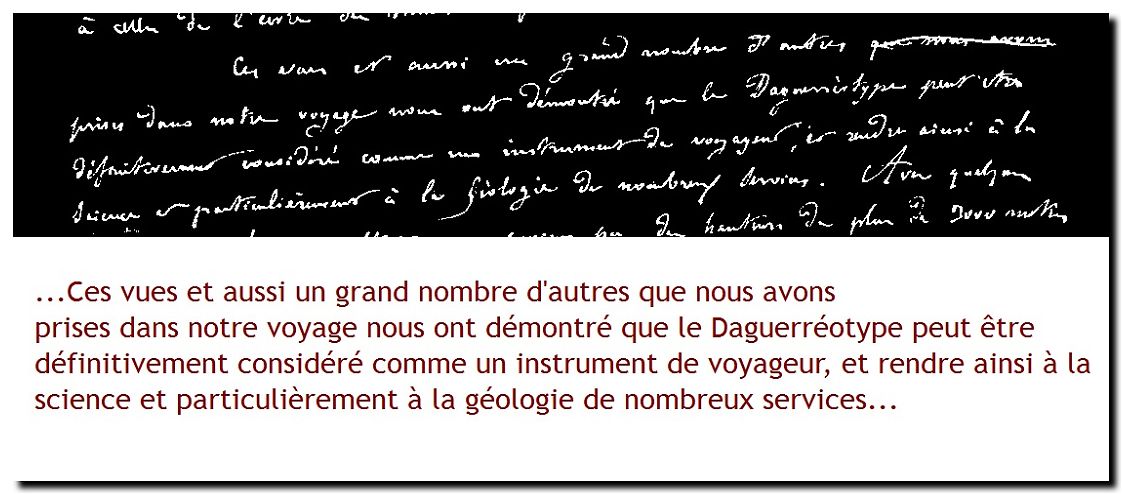
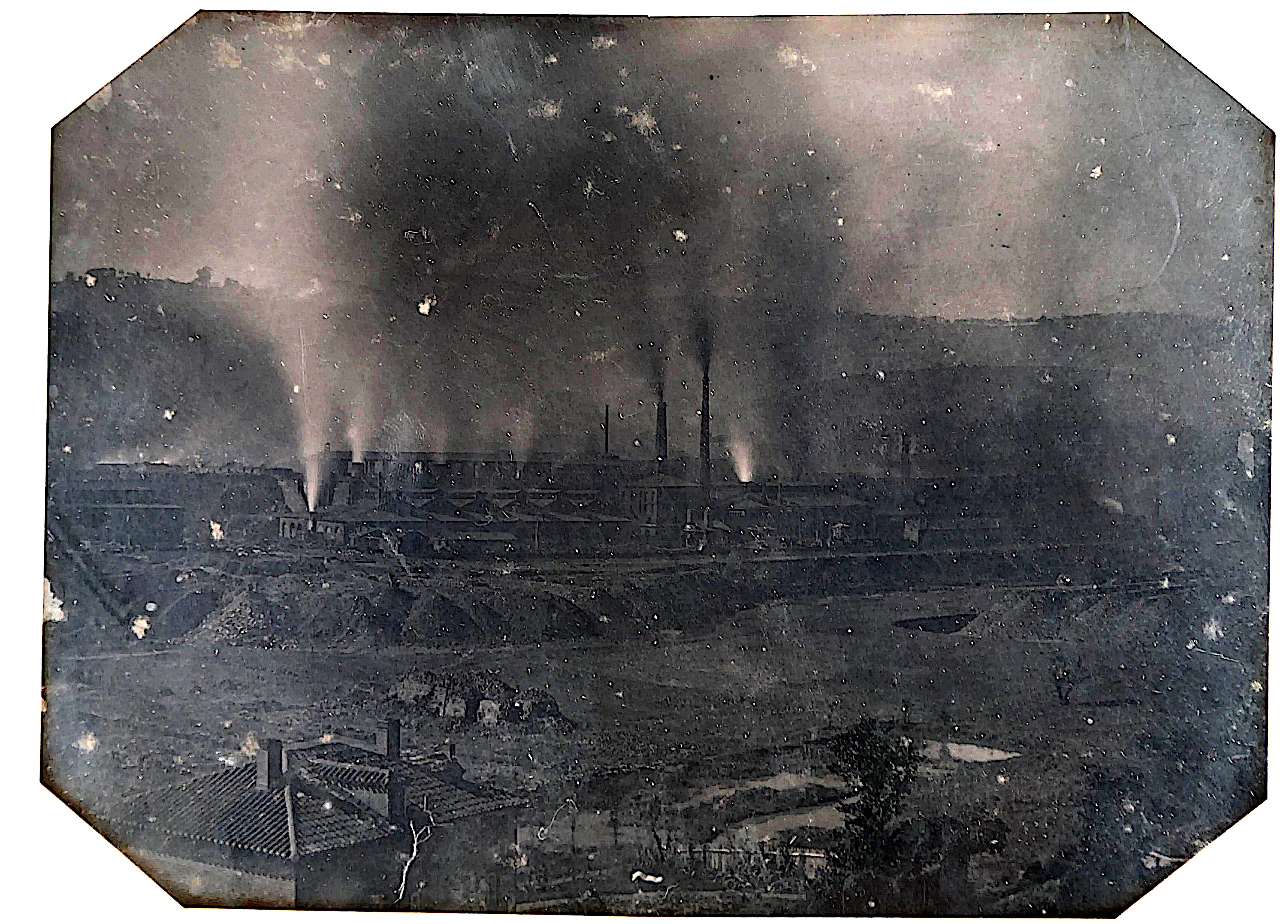
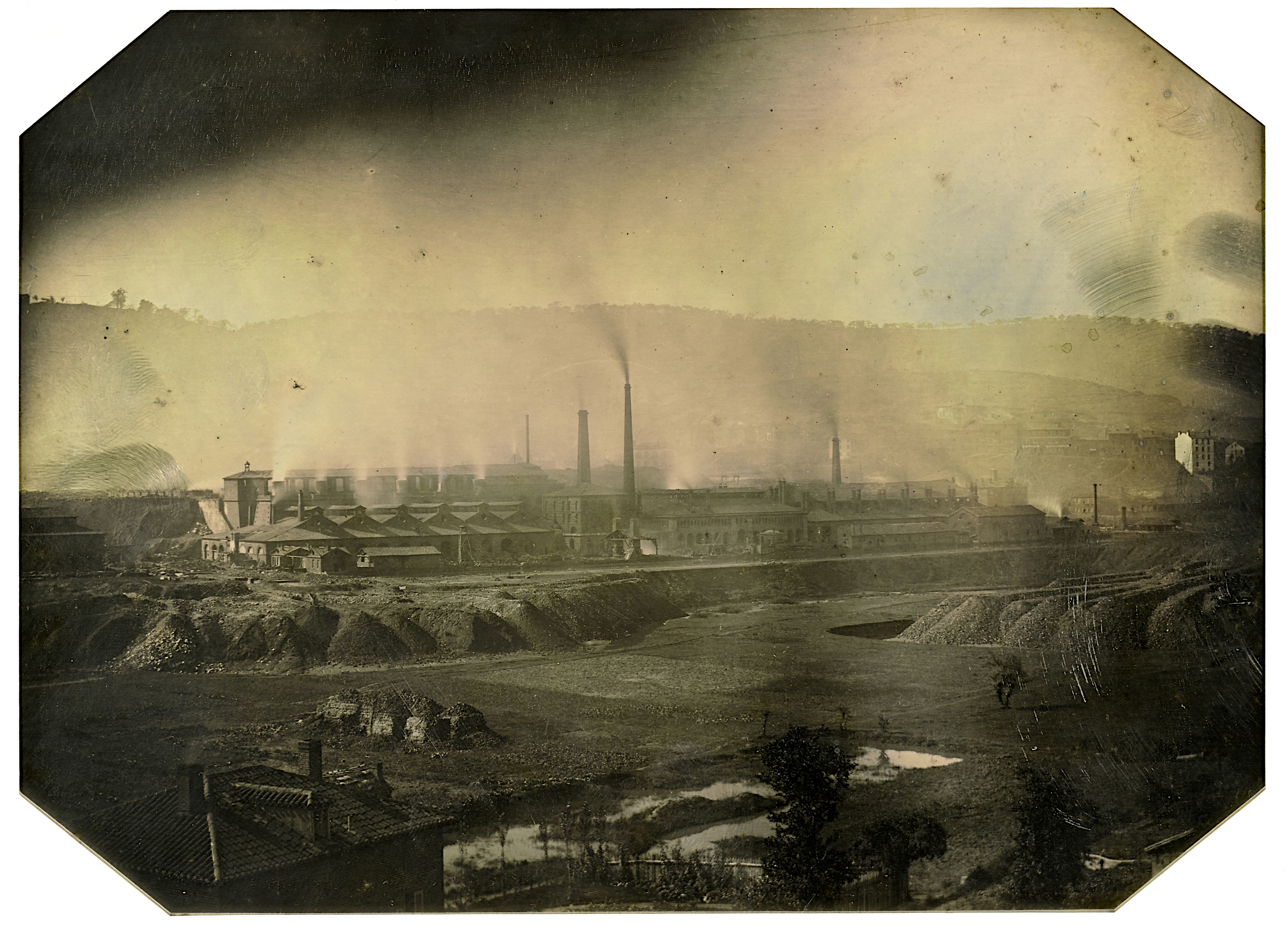
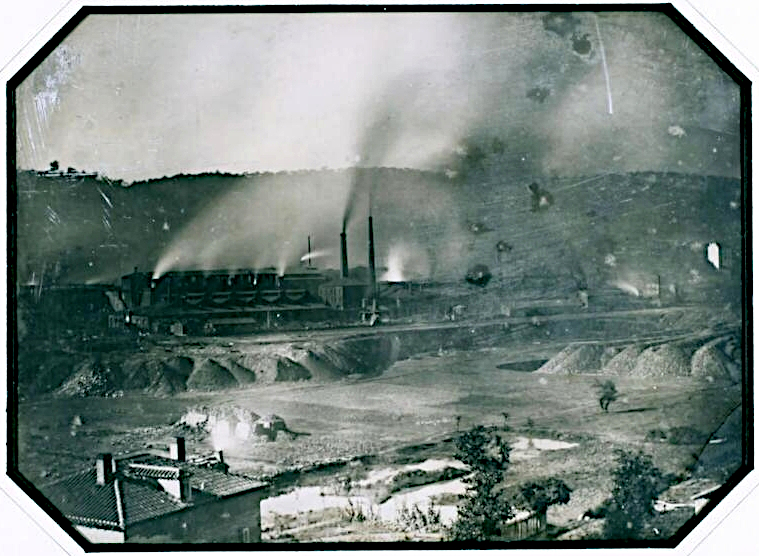
Surprenant ! Inattendu ! Curieux…et amusant ! *

En 1609, le 15 mars, Villefranche-de-Rouergue avait dans ses murs une confrérie de plus, celle des Pénitents bleus de St Jérôme. Celle des noirs sera créée 94 jours plus tard, sans que nous sachions bien pourquoi ces noirs ne se reconnaissaient pas dans les valeurs des bleus…Les bleus, d'inspiration franciscaine suivent l'exemple de celle de Toulouse, avec sac et capuche bleus, tendant vers le violet pour être très précis. A la date de cette création, il y avait parmi ces bleus 14 gens de robe, 3 prêtres et 8 marchands. Ils seront 38 à la création **. En Aveyron des Pénitents furent par exemple blancs et bleus à Rodez, gris à Millau, blancs et bleus à Espalion et bleus et noirs à Villefranche. Il y a eu ailleurs des rouges, des violets, des marrons, roses et verts. Malgré cette variété de tons, leur ambition est commune, essentiellement faire la charité envers les plus démunis. Les statuts de ces confréries se ressemblent beaucoup.
Les Pénitents bleus
La confrérie des pénitents bleus de Villefranche, dévolue à St Jérôme aura sa déclinaison féminine en 1682.

Pourquoi donc s'intéresser à eux ? A leur tête les Pénitents élisent tous les ans des officiers chargés de veiller aux intérêts communs et responsables de l'administration de la confrérie. Parmi ces officiers, le premier d'entre eux est le Prieur. Il est secondé par un sous-prieur. La lecture de la liste des Prieurs des Pénitents bleus de Villefranche réserve quelques surprises, comme celle d'ailleurs de leurs confrères noirs.
Pour être précis, il semble bien qu'au fil des ans, et tout particulièrement vers 1825, l'élection laisse la place à une cooptation, ce qui donne quelques clés de compréhension pour la suite...
La chapelle des Pénitents bleus de Villefranche-de-Rouergue,
actuelle médiathèque
En 1826 le comte Ricard est Prieur. Celui-ci est Pair de France, ayant été fait Pair le 17 août 1815 et élevé comte en 1817. Ce général né à Castres et décédé au château de Varès ne doit donc rien par exemple à Elie Decazes, qui en août 1815 s'activait dans ses toutes fraîches fonctions de préfet de police de Paris. Et c'est même peut-être une situation opposée qui fait qu'Elie Decazes, devenu comte puis duc, est élu Prieur en 1827. Le comte Ricard est-il donc à l'origine de cette élection ? Quelle signification donner à ce rapprochement ? Pourquoi donc Elie Decazes tenait-il à devenir Prieur ? Etre Prieur c'est bien évidemment être disponible pour la confrérie et s'acquitter des obligations du poste, obligations que le duc en 1827 doit être bien incapable d'assumer : il ne réside pas à Villefranche, n'y passera que rarement, et s'acquittera donc de ses obligations par leur contre partie financière, faire des dons. Cette proximité des Pairs au Luxembourg de Ricard et Decazes peut expliquer pourquoi le duc se tourne vers les bleus et non vers les noirs…
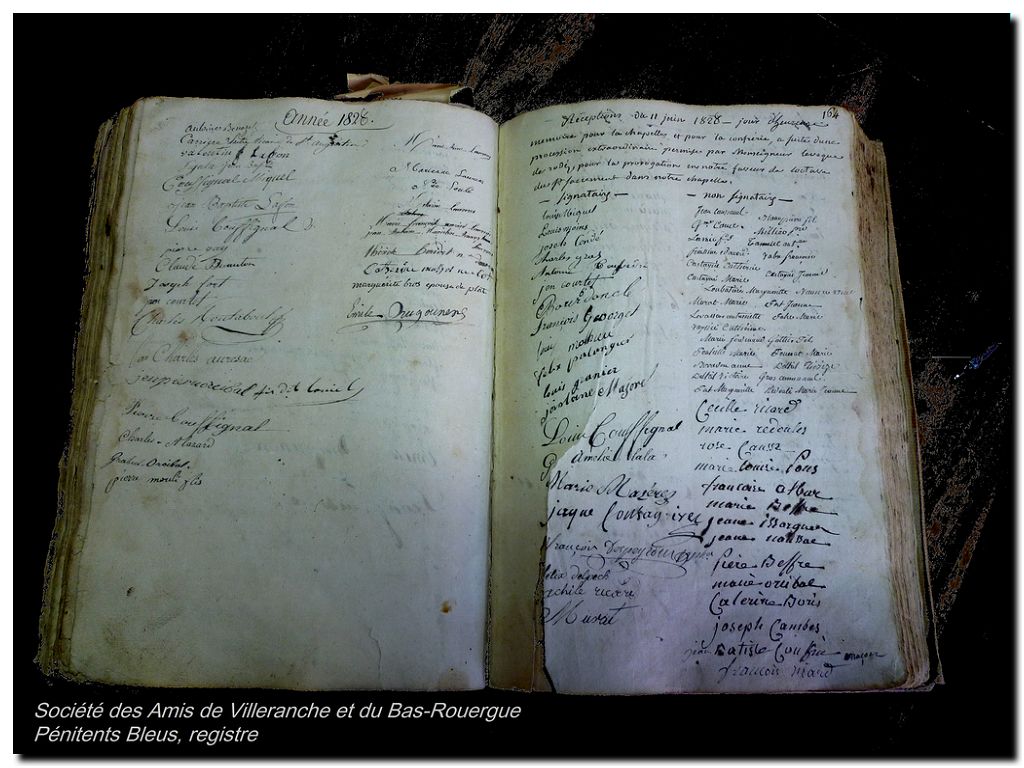 Une autre question méritera d'être soulevée : pourquoi devenir
Prieur ? Qu'attendait Elie Decazes de cette distinction, somme toute
assez modeste vue depuis les couloirs dorés du palais du Luxembourg ?
Peut-être une nécessité pour le duc de se faire connaître et surtout
reconnaître et soutenu par une population qui ne fut pas toujours
favorable en 1826-1827 à ses appétits d'industriel. La mainmise du duc
sur les concessions de l'arrondissement a soulevé, nous l'avons évoqué
par ailleurs, quelques oppositions. Alors devenir Prieur semble être
une position permettant d'obtenir la sympathie et l'appui si besoin est
des notables locaux, et avec eux, sympathie et appui de la population.
Le Prieur sera donc celui qui fera le succès industriel du pays.
Une autre question méritera d'être soulevée : pourquoi devenir
Prieur ? Qu'attendait Elie Decazes de cette distinction, somme toute
assez modeste vue depuis les couloirs dorés du palais du Luxembourg ?
Peut-être une nécessité pour le duc de se faire connaître et surtout
reconnaître et soutenu par une population qui ne fut pas toujours
favorable en 1826-1827 à ses appétits d'industriel. La mainmise du duc
sur les concessions de l'arrondissement a soulevé, nous l'avons évoqué
par ailleurs, quelques oppositions. Alors devenir Prieur semble être
une position permettant d'obtenir la sympathie et l'appui si besoin est
des notables locaux, et avec eux, sympathie et appui de la population.
Le Prieur sera donc celui qui fera le succès industriel du pays.
On peut également inverser les termes du problème : les
Pénitents Bleus ont évidemment besoin de reconnaissance, surtout après
les tragédies de
On peut à ce stade se demander pourquoi les villefranchois ne se sont pas tournés vers Joseph Decazes, le frère du duc. Ce frère ingénieur, préfet du Tarn, est assurément venu à Villefranche plus souvent que son duc de frère, ayant même un temps été élu député de la circonscription. Il fut également à l'origine des implications industrielles rouergates du duc...
Si nous reprenons la liste des Prieurs des Pénitents bleus, M. de Richeprey succède au duc en 1828. En 1829 ce sera M. Humann. Nous connaissons bien M. Humann. Cet alsacien est un des premiers actionnaires aux côtés du duc. Il sera même le premier Président du Comité d'Administration des Houillères et Fonderies de l'Aveyron. Et Villefranche n'oublie pas non plus qu'il fut un éphémère député aveyronnais. Cette présence comme Prieur suit à n'en pas douter celle du duc Decazes, et comme pour le duc, nous pouvons faire les mêmes observations sur le pourquoi de cette élection. Ici aussi, les dons auront sans doute pallié à l'impossibilité de pratiquer quotidiennement les obligations de la charge. Parmi les Prieurs suivants on relèvera M. de Seraincourt en 1839. Le futur industriel d'Aubin a donc lui aussi droit à la reconnaissance des villefranchois bleus. En 1840 ce sera le tour de l'ingénieur des mines M. de Hennezel, un proche de M. de Seraincourt. En 1850 un autre ingénieur des mines que nous avons rencontré sur notre Route du Fer officie comme Prieur, M. Senez.
D'illustres personnalités furent membres de la confrérie : le comte d'Arros, Préfet de l'Aveyron de 1820 à 1828, Monseigneur Fraissinous, Louis XIV et Louis XV…
Dans un texte de 1715, (Ev. Rodez), on peut lire " (la) Compagnie des Pénitens bleus de Villefranche, composée de ce qu'il y a de plus distingué dans l'Eglise, dans la Noblesse, et dans le Tiers-Etat...." ; cette description peut donner un éclairage sur la différence locale entre les deux confréries des noirs et des bleus.
La date de fin des activités de la confrérie ne semble pas connue…
Le Registre
des Pénitents bleus
Le Registre, conservé par les Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue conserve la mémoire de la Confrérie. C'est ainsi qu'une page donne le compte rendu de la réunion du Bureau de la Confrérie Royale tenue le 2 janvier 1827. La liste des nouveaux officiers pour cette année 1827 est annoncée et a été écrite sur une feuille de papier mais tenue secrète...pour être publiée dimanche prochain...
Les Pénitents noirs

La chapelle des Pénitents noirs,
Villefranche-de-Rouergue
Autre couleur, et donc première interrogation, sans réponse assurée : pourquoi cette création simultanée ? Quelle pouvait-être la différence essentielle entre ces deux confréries ? Le recrutement des bleus était-il plus "choisi" ?? Il y avait chez les noirs, une soixantaine au début**, des gens de robe, d'église et de riches marchands, tout comme chez leurs confrères bleus. Ici aussi les statuts prévoient l'élection annuelle des officiers et donc celle du Prieur. En 1827, parallèlement donc au duc, le Prieur des noirs est M. Auguste de Cardonnel, receveur général des finances d'Albi. Faut-il voir là un rapprochement avec Joseph Decazes, le préfet tarnais de l'époque ? M. de Cardonnel connaissait évidemment son préfet…
Parmi les personnalités qui occupèrent le poste on relève Jean Louis Cibiel en 1822, Vincent Cibiel son fils en 1839. En 1848 Madame de Seraincourt épouse de l'élu Prieur bleu de 1839 est à son tour Prieure…noire.
Les relations entre bleus et noirs ne nous sont pas connues. La
confrérie des Pénitents bleus reste présente par sa chapelle à
Villefranche-de-Rouergue, siège de
Le travail d'archives reste donc largement à poursuivre. Parmi celles de l'Evêché de Rodez *** voici l'affiche de présentation de l'année 1839. Les années antérieures à 1837 sont absentes...Le format est un A2, conséquent et impressionnant. Le graphisme varie dans le siècle, devenant nettement plus sobre vers 1900. En 1840, M. de Seraincourt sera vice-prieur.
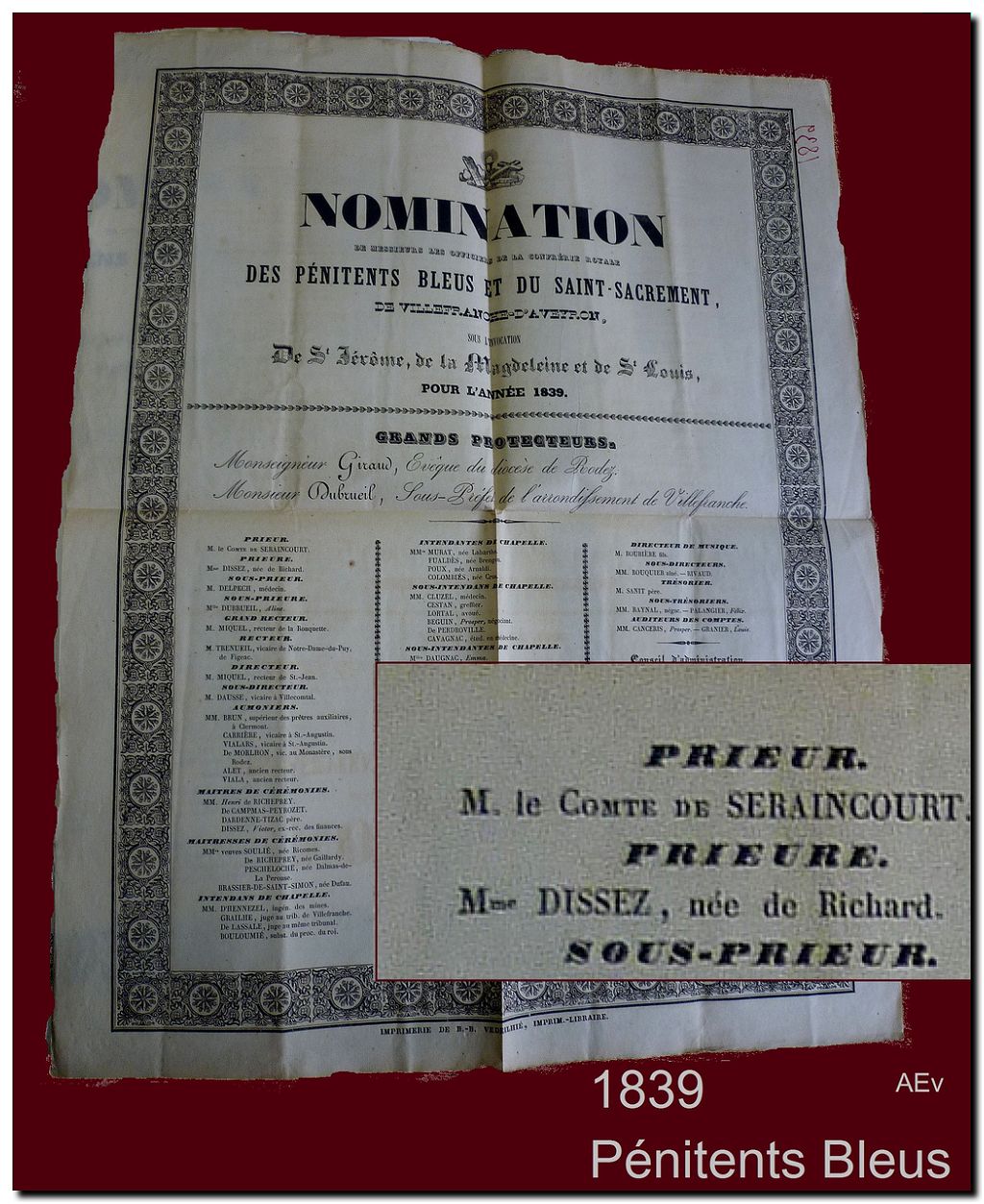
Petits papiers…****
Nous avons parcouru le Registre de la confrérie des pénitents bleus. Rédigé et tenu assez maladroitement, voir plus haut, il nous a cependant permis de rencontrer quelques notabilités en sacs. Cette fois nous allons parcourir celui des noirs.
registre Pénitent noir,
vol 2, 1740-1904
Contrairement à leurs confrères bleus, les pénitents noirs, de 1609 à 1904, ont très scrupuleusement consigné leur activité. Deux volumes, très épais en témoignent. Celui qui nous intéresse est évidemment le second. Il concerne les années 1740 à 1904. Sans ratures, ou exceptionnellement, il reprend les comptes-rendus des deux réunions annuelles : en début d'année, pour l'élection des officiers, et en milieu d'année, pour régler les affaires de la confrérie.
En 1827, le Prieur est M. de Cardonnel, receveur général des finances à Albi. Il sera fait prieur honoraire le 3 juillet 1827, et ce pour "tout le temps qu'il vivra".
En 1838, parmi les maîtres d'honneur, figure M. Senez, ingénieur des mines. Cette rencontre avec celui qui nous a laissé une carte du bassin d'Aubin en 1840, mérite quelques détails.
M. Senez est originaire de Douai, né en 1809. Après Polytechnique en 1827, il entre à l'Ecole Royale des mines, et sera nommé ingénieur en 1833. Son mémoire de fin d'études est daté de 1831. On le retrouve aspirant en 1836 à Villefranche. Il fera là un long parcours : il y sera ingénieur ordinaire en 1846 et promu ingénieur en chef en 1852. Il quitte alors le Rouergue pour Nantes. Il décède quelques années plus tard, en 1859. Il a eu (au moins) une fille, née à Villefranche en 1845, et qui se maria à Villefranche en 1869. Il a donc connu quelques belles années d'activité de la Compagnie de Decazeville. François Cabrol était évidemment un familier.
La position de maître d'honneur nous semble être purement honorifique, sans fonction bien opérationnelle au sein de la confrérie. Elle devait permettre de lier les maîtres à la confrérie en apportant à celle-ci le prestige de l'élu, et réciproquement. Ce grade n'était pas historique ; en 1824, par exemple, il n'existait pas. Il n'existait pas non plus chez les confrères bleus, l'affiche de publication de 1839 peut en témoigner.
L'année suivante, 1839, un des maîtres d'honneur sera M. le comte de Hennezel, ingénieur des mines est-il précisé sur le registre. Cette nomination (élection ?) est évidemment en lien avec celle de Senez l'année précédente.
M. de Hennezel n'est pas un inconnu pour la Route du Fer. Nous l'avons ainsi rencontré dans les affaires d'Aubin. Il est proche de M. de Seraincourt. Né en 1807 à Francfurt am Main, il a donc à peu près le même âge que Senez. Comme lui, il va suivre le parcours classique Polytechnique (1826) Ecole des Mines, dont il sort ingénieur en 1832. Les deux ingénieurs se sont bien sûr côtoyés à Paris. Mais le parcours de Hennezel diffère : il quitte l'administration pour l'entreprise, et vient prospecter en Aveyron en 1838, concurrent donc de Cabrol. Après une faillite, il retournera en 1845 dans son corps d'origine. Ingénieur en chef des mines en 1848, il travaillera au Mans et à Paris. Il n'oublie pas la région, car on le retrouve vers 1858 comme ingénieur conseil à Carmaux.
M. le comte devait tenir vraiment au Rouergue. Car après son passage d'honneur en 1839 chez les pénitents noirs, il sera prieur en 1840 … des pénitents bleus : changement de couleur et de grade !
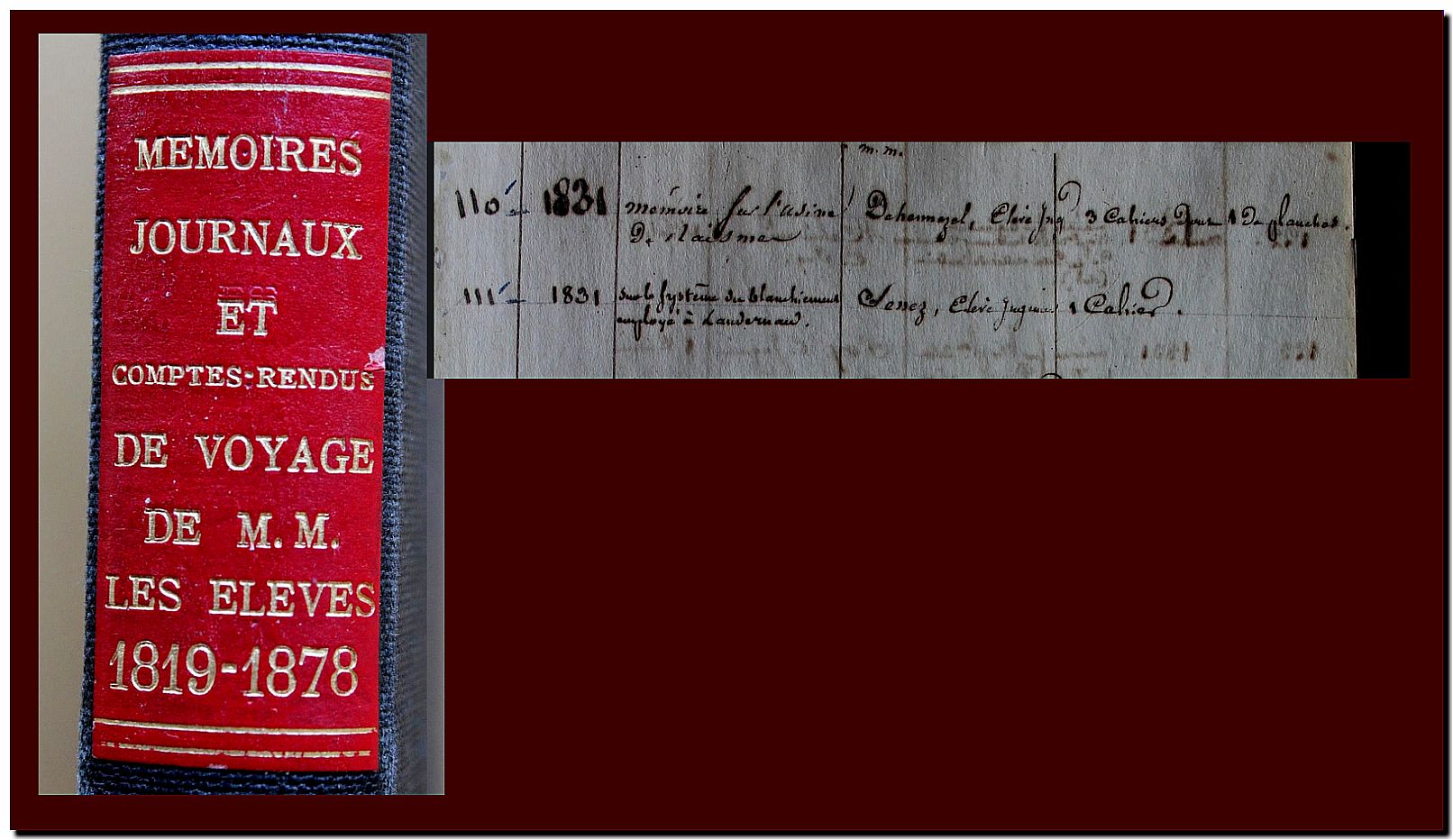
Bibliothèque, Ecole des Mines, Paris
fonds patrimoine
Les deux mémoires de voyages de Hennezel et Senez sont enregistrés en 1831. Ils figurent l'un à la suite de l'autre, N° 110 et 111.
En 1844, chez les dames, la comtesse de Seraincourt sera maîtresse d'honneur. Il en sera de même en 1846, et en 1848 elle devient Prieure, puis sera à nouveau maîtresse d'honneur en 1854.
Cette même année, 1844, fait mention d'un ingénieur du Grand Central, Cousin, comme maître d'honneur. La fonction était décidemment attractive pour nos techniciens…
En 1857, Senez est à nouveau maître d'honneur, il l'avait été en 1838.
Cette lecture du Registre permet de mieux comprendre l'implication dans la société locale de quelques élites industrielles. L'appartenance à l'une ou l'autre des prestigieuses confréries était en soi une opportunité importante pour être connu et reconnu, et le titre de maître d'honneur semble assez explicite. Un autre point est plus curieux. Les relations entre noirs et bleus n'ont pas toujours été (jamais ?) très étroites. Pour les années qui nous concernent, nous avons par exemple noté en juillet 1840 un conflit de préséance lors des processions : les noirs étaient traditionnellement les derniers, et les bleus contestaient cette habitude. L'évêque appelé en arbitre proposera une alternance en 1841, ce que les noirs ont très tièdement accueilli…Par contre, il n'y avait pas de rancune à accueillir comme pénitent bleu un pénitent après son passage en noir…Ce fut donc le cas, au moins, de deux de nos ingénieurs, MM. Senez et de Hennezel. Pour sa part M. de Seraincourt resta bleu, aux cotés de son épouse, noire…Ce passage des noirs vers les bleus est pourtant formellement interdit dans les statuts des Pénitents bleus de Toulouse (les statuts de Villefranche sont une reprise). L'article 6 de la version des statuts de 1824 ne laisse aucun doute :
Il est expressément défendu de présenter ni recevoir tout individu qui aurait été reçu dans une autre Confrérie de Pénitens établie dans cette ville.
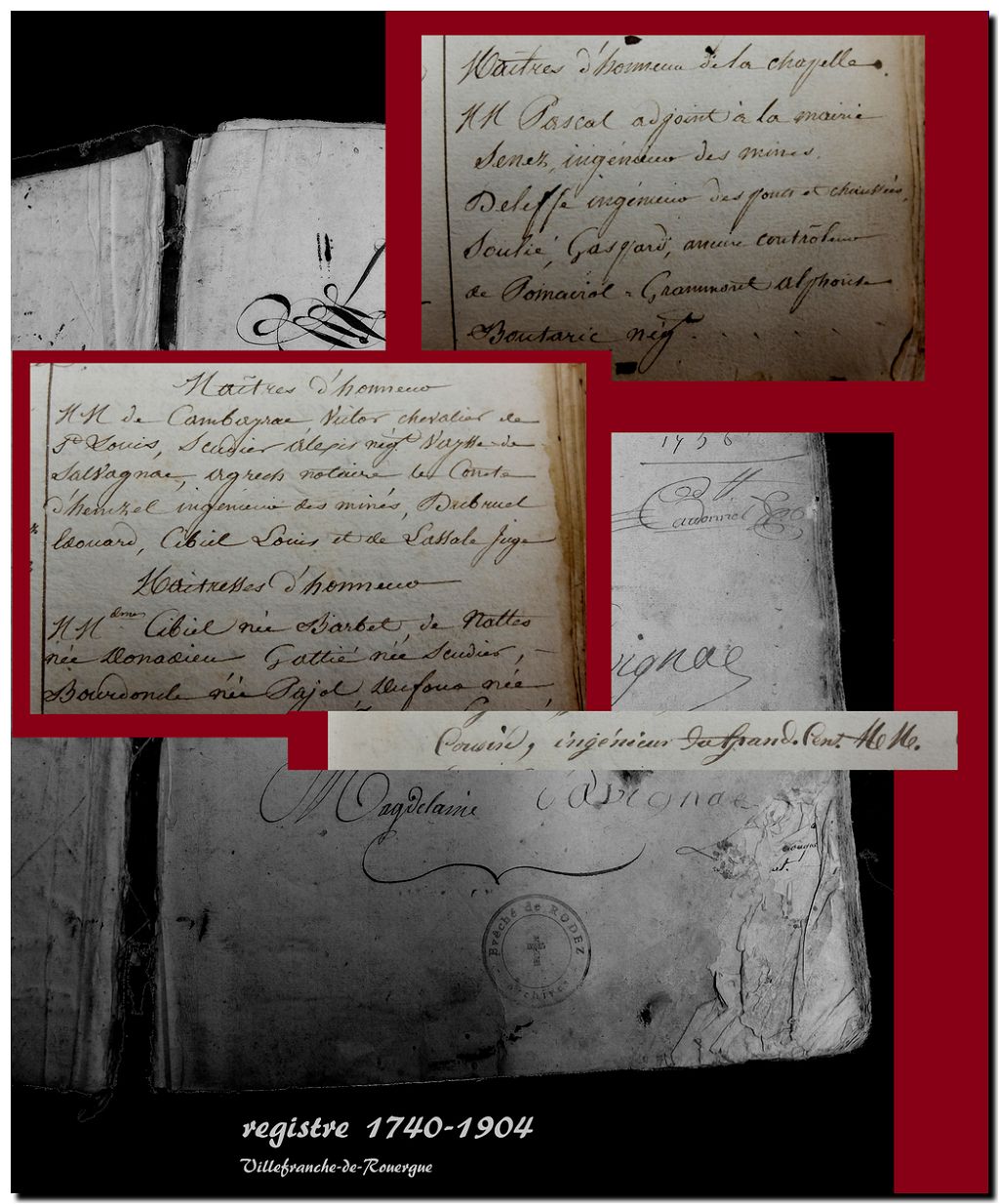
Pénitents de la Route du Fer : Cibiel, de Seraincourt, Senez, de Hennezel, Cousin....
(à suivre…)

Suivez donc les Pénitents ! Avez-vous reconnu le duc ou Monsieur Humann sous leur cape et capuche ?
_________________________________________
* L'origine de
cette note doit son existence à Bruno
Muratet. Erudit villefranchois,
c'est lui qui nous a mis sur cette piste qui reste bien évidemment à
parcourir, avec beaucoup de questions et peu de réponses assurées !
** Etienne Cabrol, Annales de Villefranche-de-Rouergue, imp Cestan 1860, tome II
*** Merci à M. Andrieu, archiviste de l'Evêché de Rodez pour son accueil
**** Avec nos remerciements au Service des Archives, mairie de Villefranche-de-Rouergue
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
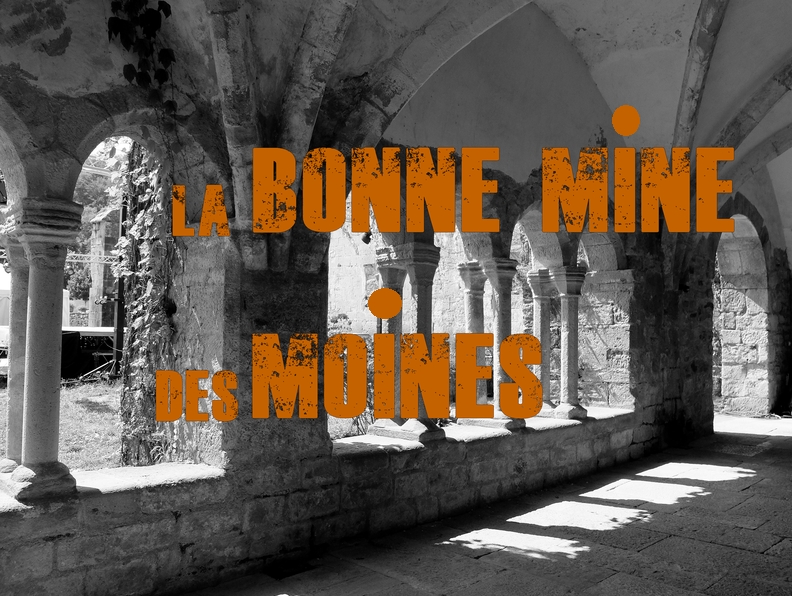
Chemin de (très grande)
traverse, en sud-Aveyron à Sylvanès
Si le minerai de fer du causse a fait la
fortune de quelques duc, comtes, pairs de France et autres capitalistes
du XIXe siècle, un millénaire plus tôt, en chiffre rond, des moines
feront des ressources minières locales un élément essentiel
pour la réussite de l’abbaye. Les moines avaient bonne mine !
Le rougier de Camarès, en sud-Aveyron, est un
cousin de celui du causse Comtal. Et un Dourdou coule aussi en
sud-Aveyron. Ces deux éléments de parenté nous amènent à délaisser le
fer pour un écart vers l’activité industrielle qui a marqué l’histoire
du monastère de Sylvanès.
La richesse en argent des cuivres gris de
Bouco-Payrol (commune de Brusque, Aveyron) donnera lieu à une
exploitation de mines, y compris aux époques préhistoriques. Les
romains furent ensuite présents dans cette activité. Et plus près de
nous, les moines de Sylvanès se faisaient donc volontiers
mineurs en exploitant les richesses minérales présentes sur leur
domaine. Les Cisterciens vont ainsi poursuivre cette exploitation
jusqu’à la fin du XIII e siècle. Plus récemment, des minerais,
différents, du sud-Aveyron prenaient la route pour Viviez, capitale
locale du zinc.
Sur ce chemin, à Sylvanès, un magnifique ensemble architectural se laisse découvrir. On peut donc imaginer, sans risquer le contresens, rencontrer dans le scriptorium un moine faisant l’inventaire des minerais extraits durant l’année…Il compte, ne le dérangez pas ! Le mur d’images vous permet de découvrir quelques beautés du site. Ligne 2, à droite, le vitrail central dont les motifs sont colorés date des débuts du monastère, seul témoin encore présent...
En savoir
plus ?
► Pour une première approche, Le Magazine cantonal de Camarès, 2011, a publié un important dossier, Mines et grottes, p. 9 et suivantes, signé Nathalie Roussel :
► Bernard Lechelon, archéologue : c’est au Moyen Âge que l’exploitation devient plus importante. L’extraction se fait sous le pouvoir de cisterciens qui utilisent les frères convers, main-d’œuvre indispensable pour leurs besoins. Le minerai est alors un enjeu économique et social. Il devient source de conflits et force de pouvoir. Il est à l’origine, au XII e siècle, de la réussite économique de l’abbaye de Sylvanès, liée à l’essor du marché des métaux précieux de Montpellier et à l’atelier monétaire de Melgueil. Cet argent est utilisé pour la construction de l’abbaye entre 1138 et 1185 (https://patrimoinedudauphine.fr/?portfolio=une-mine-dinformations-sur-lhistoire-du-minerai-camares-a-wealth-of-information-on-the-history-of-ore-camares).
► Le
temps des moulines : fer, technique et société dans les Pyrénées
centrales ...
La faillite de la Compagnie est évoquée par le Journal de Villefranche
à plusieurs reprises, en 1867 par exemple, et le journal publiera un
supplément listant les actifs de la société mis en vente, à Decazeville
et Bordeaux, la liste des mines en activité ou abandonnées, la liste des concessions....A lire ici. Le
Journal de Villefranche est également disponible sur le site des
Archives Départementales de l'Aveyron. Une page spéciale de ferrobase
est consacrée à ce Journal, voir page menus onglet Narrateur. La version proposée ici
est celle numérisée par Gallica.