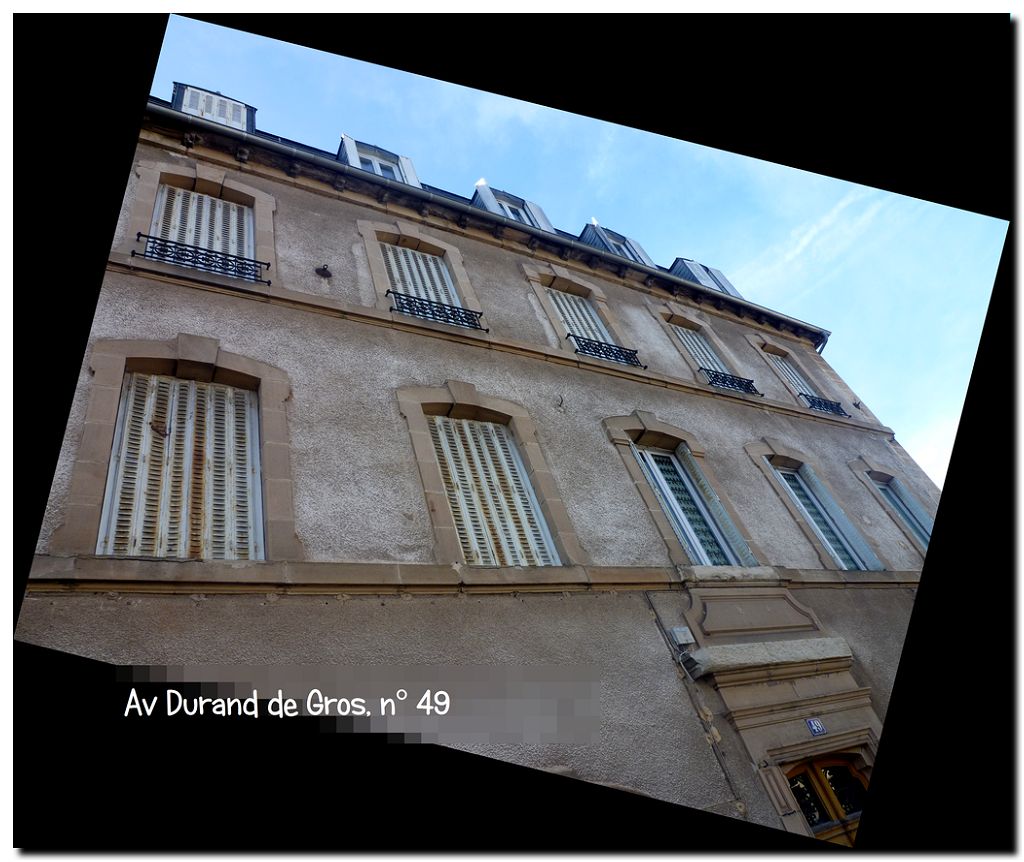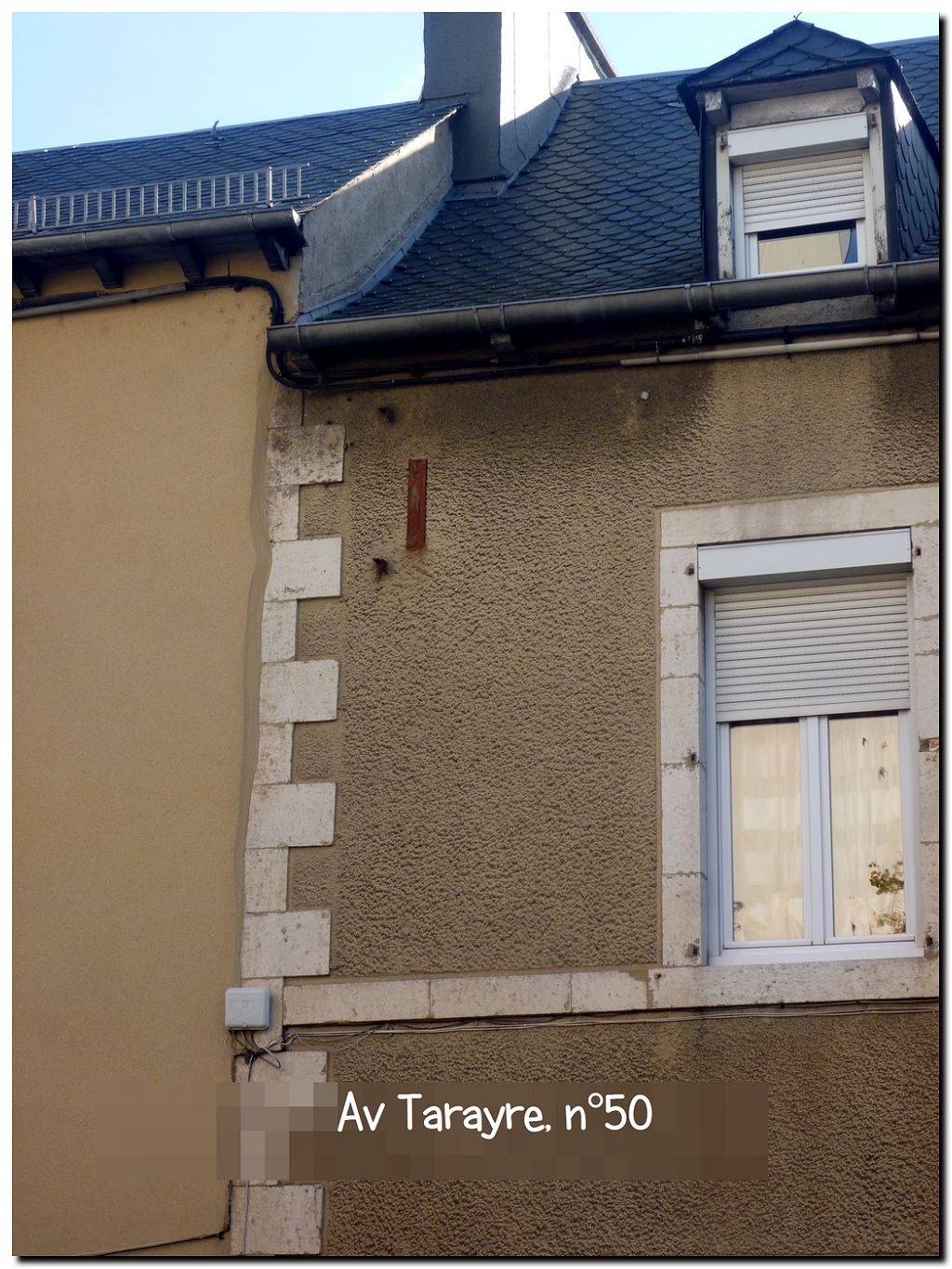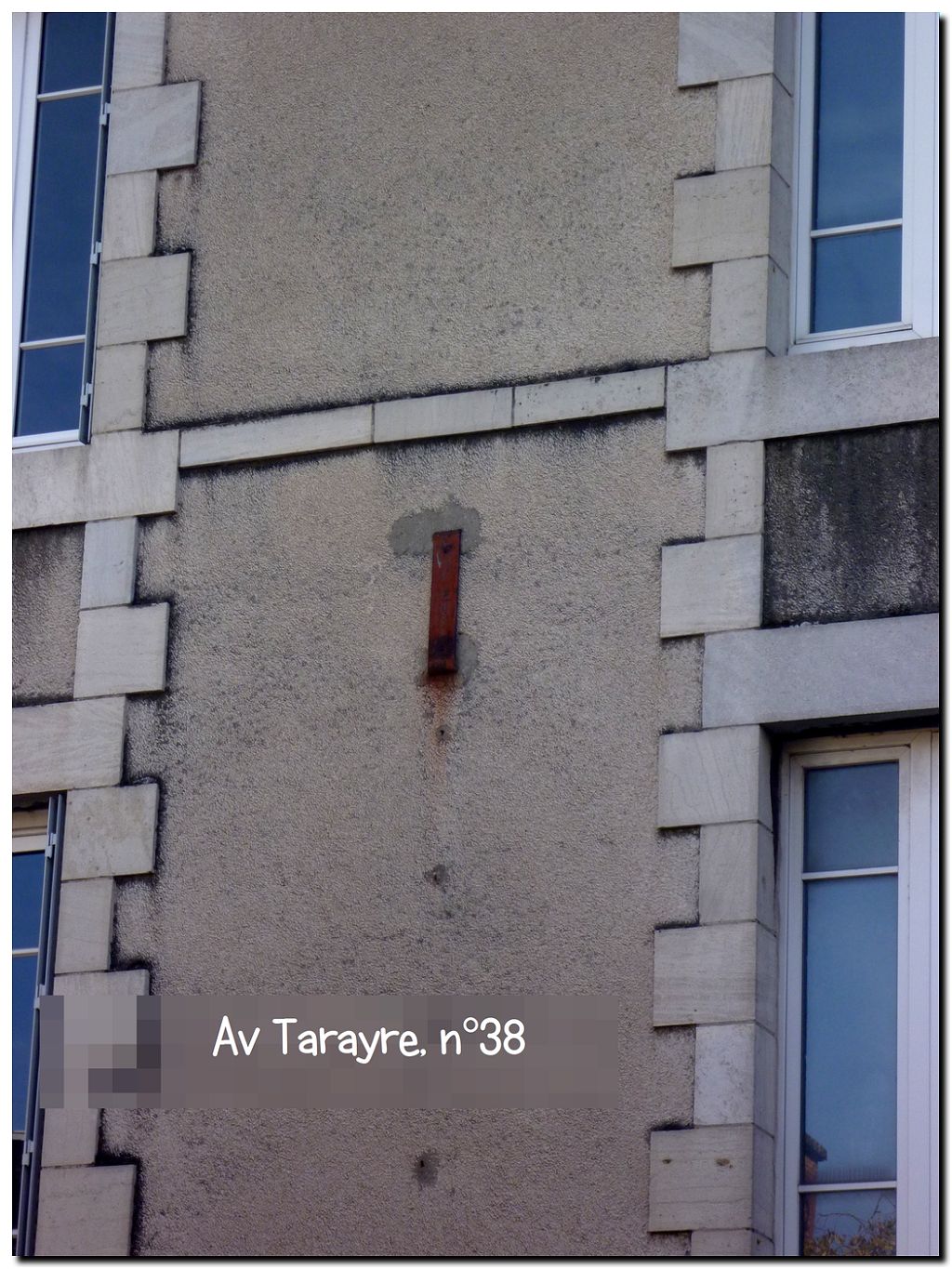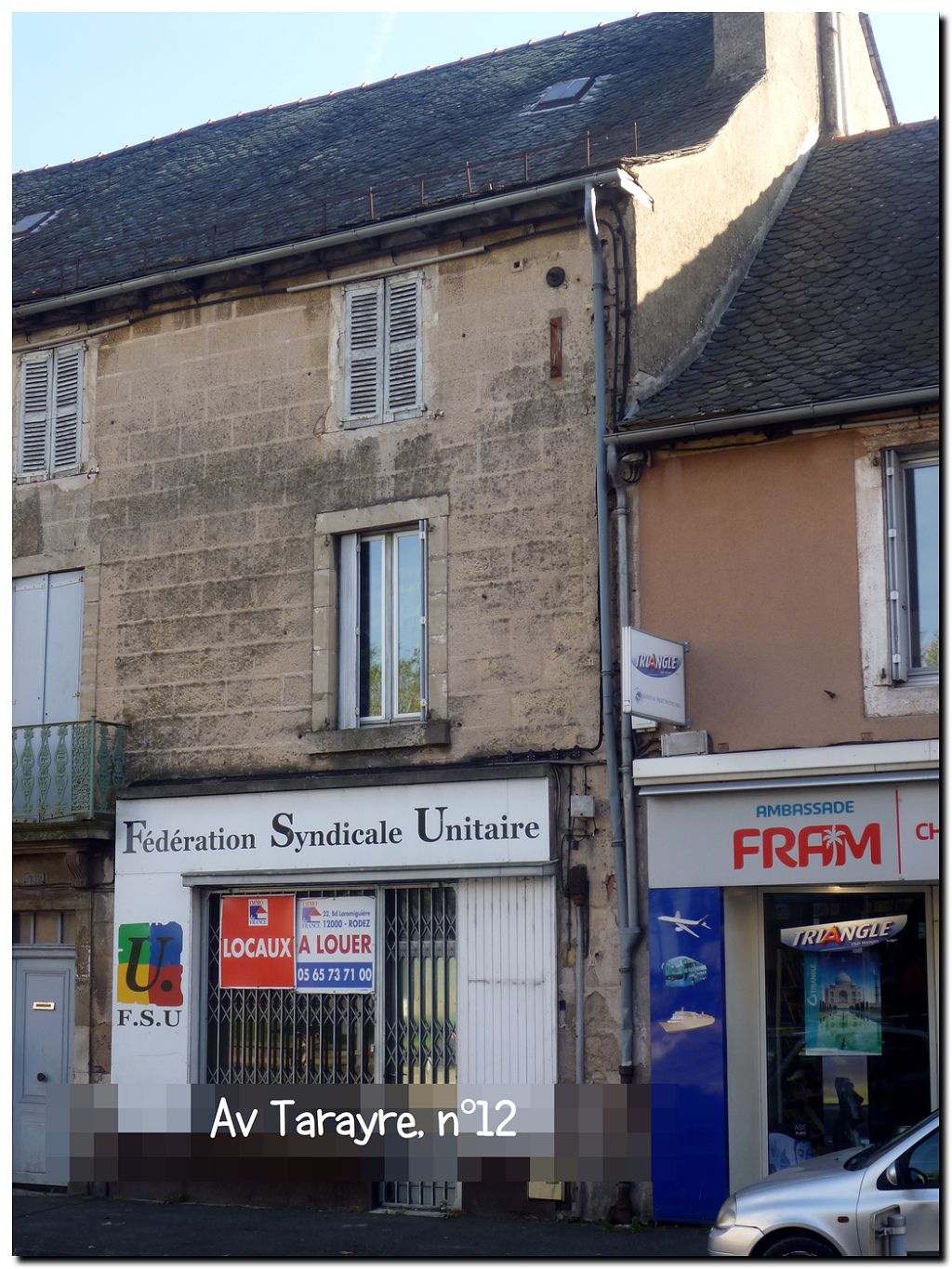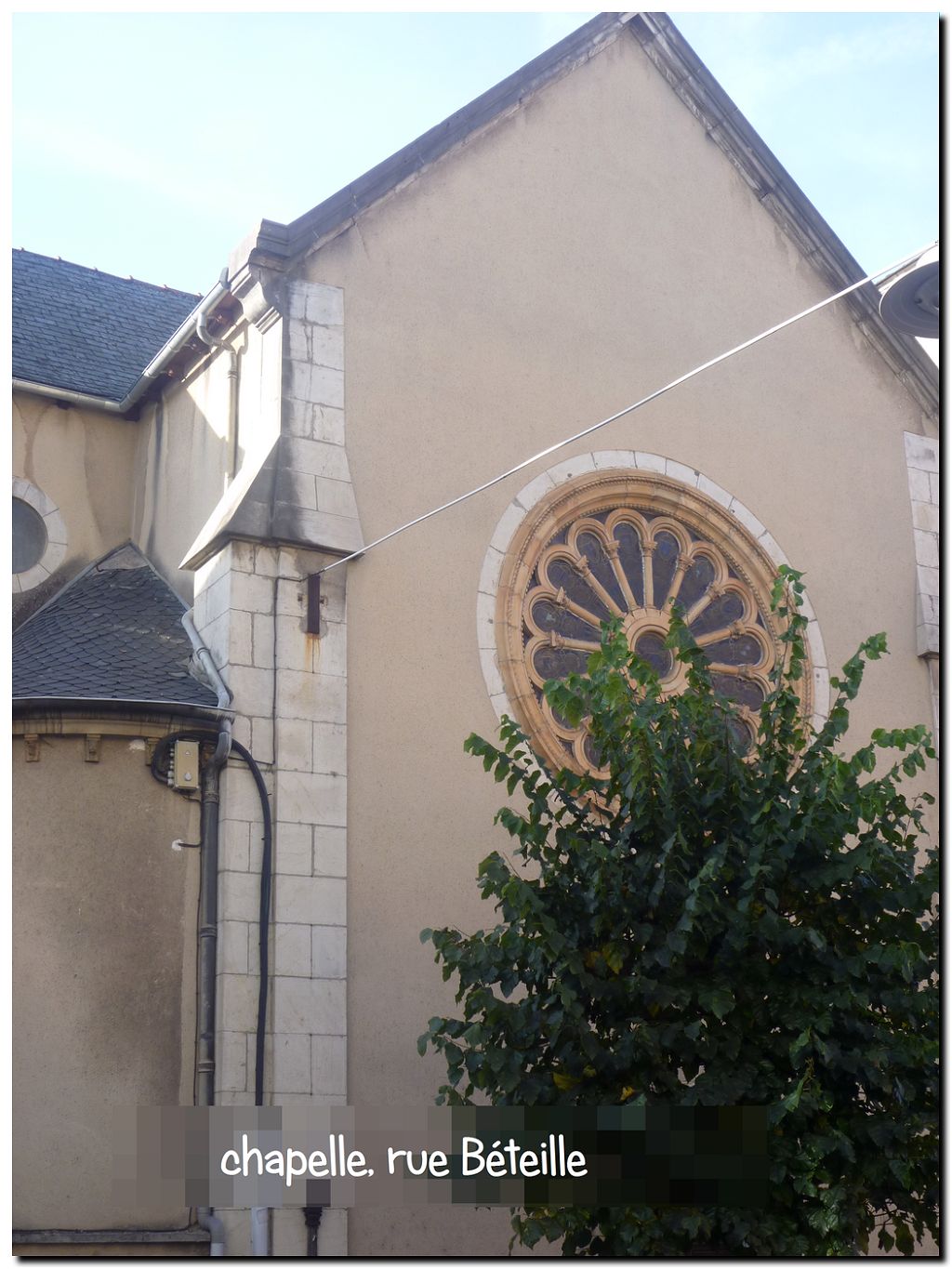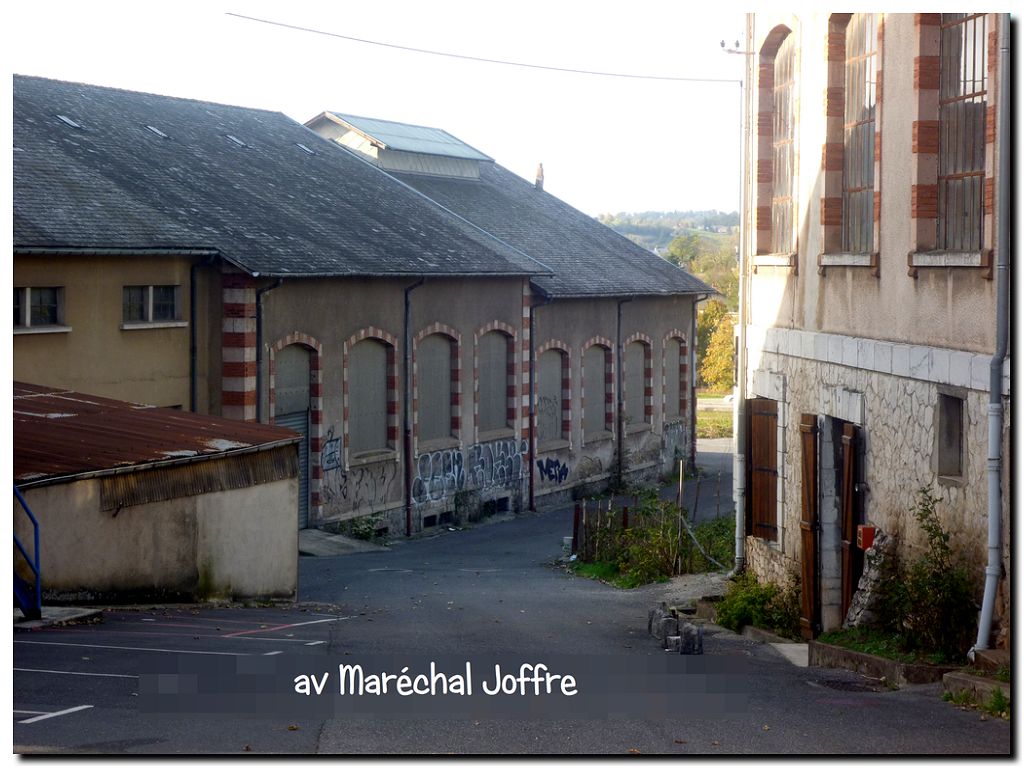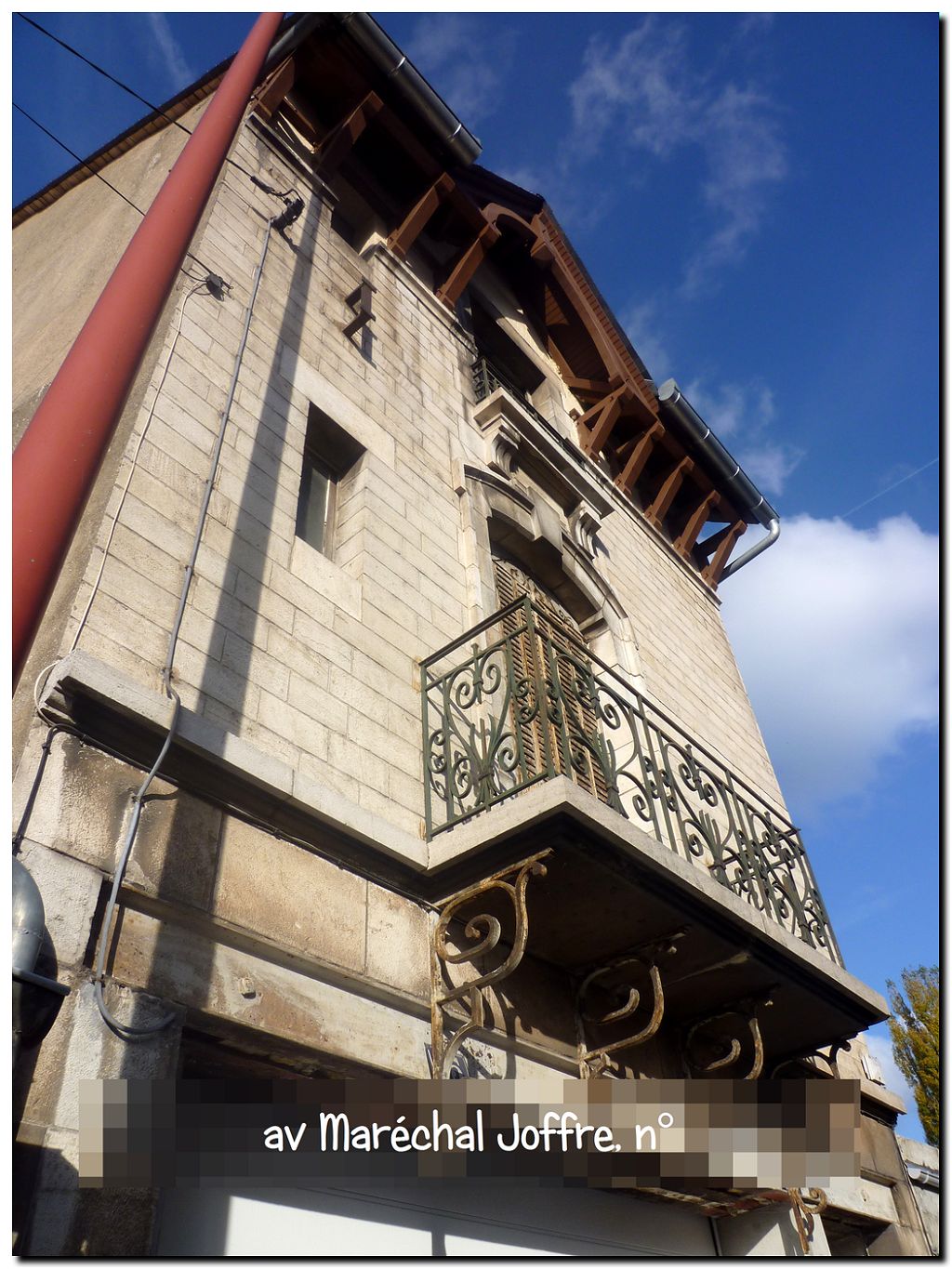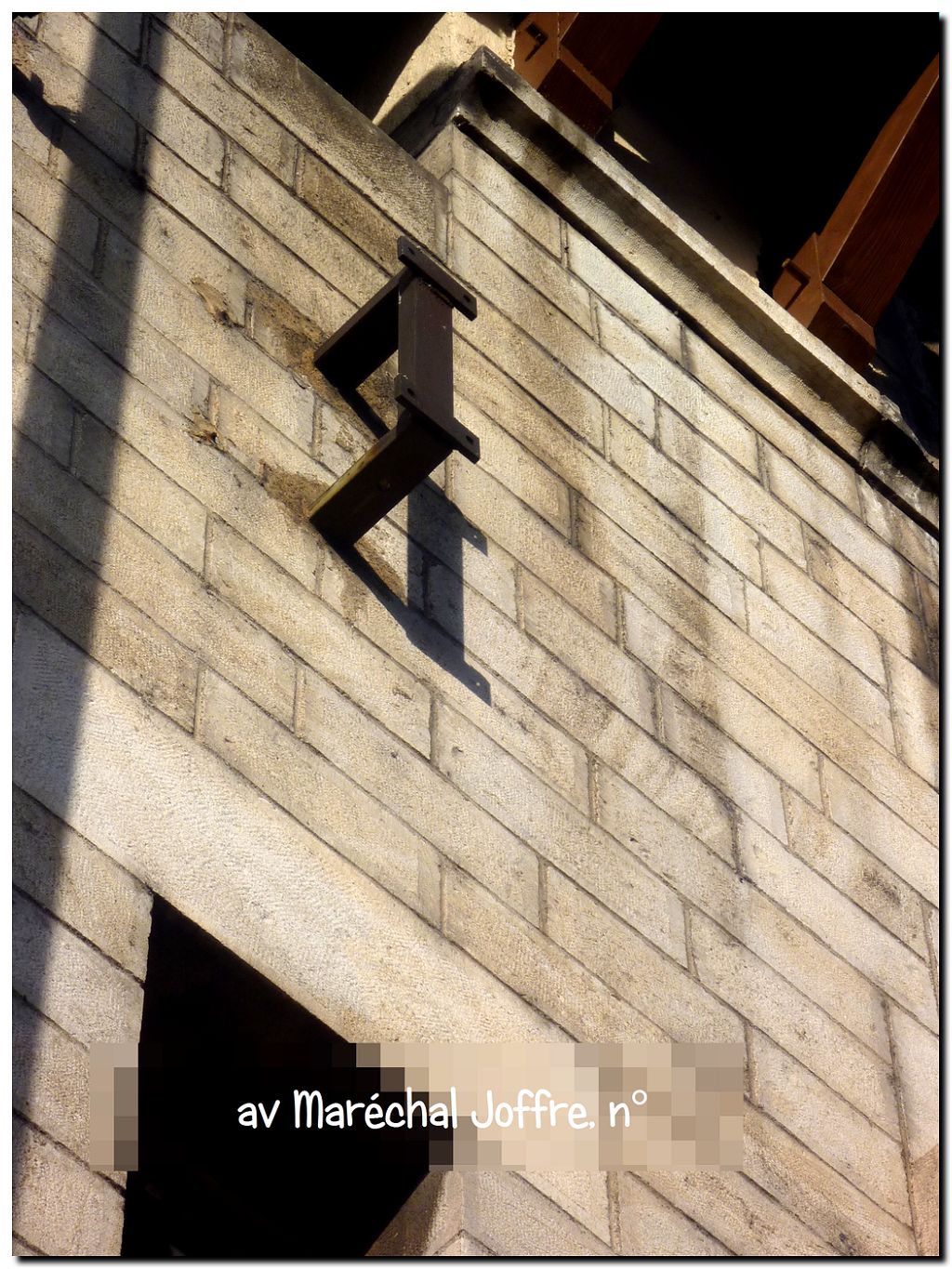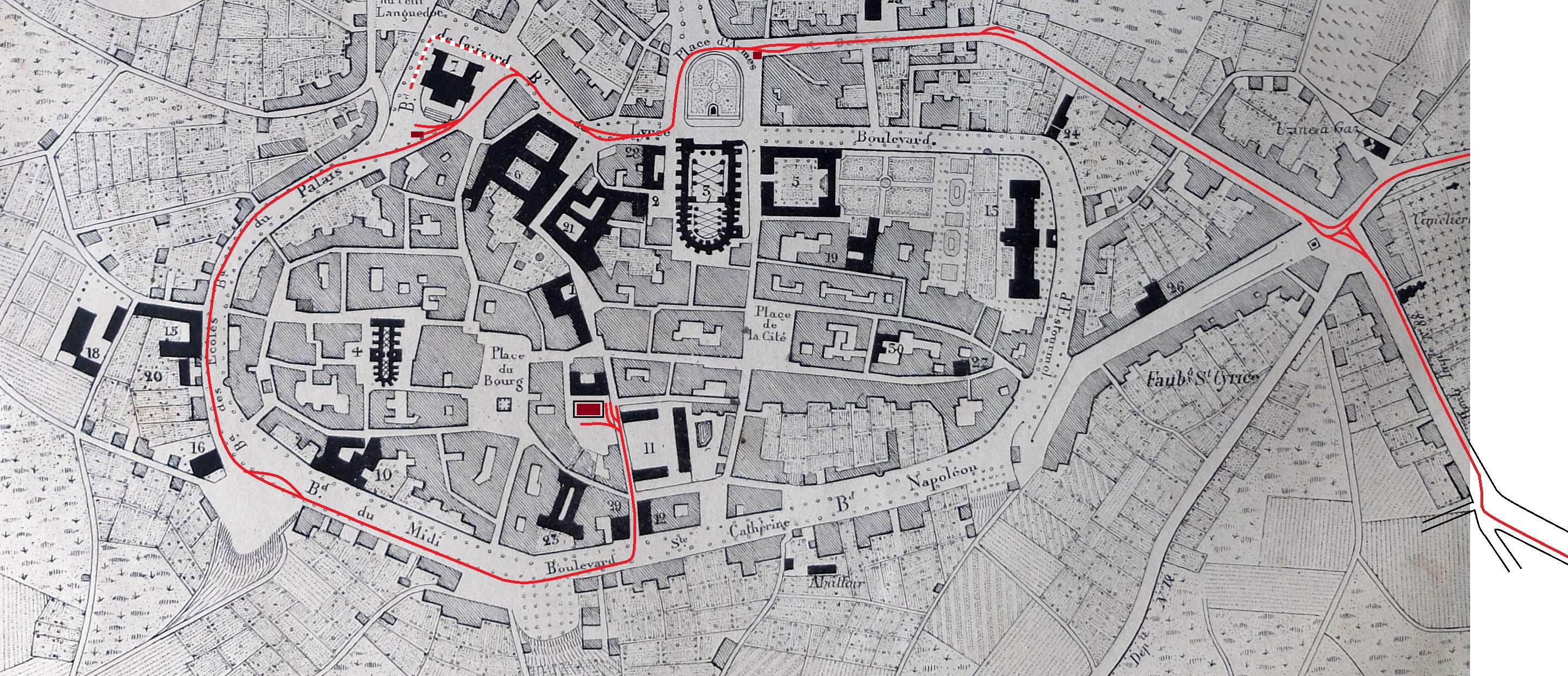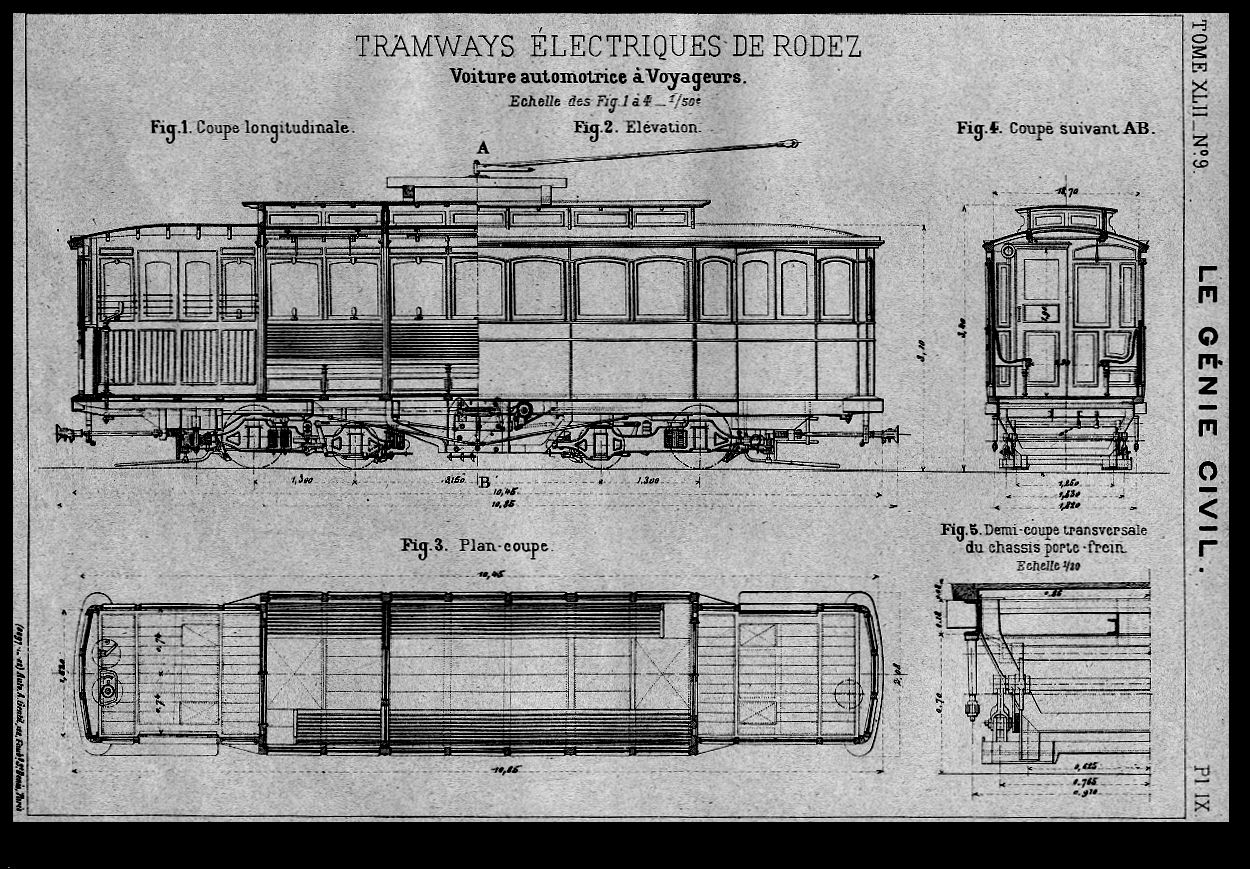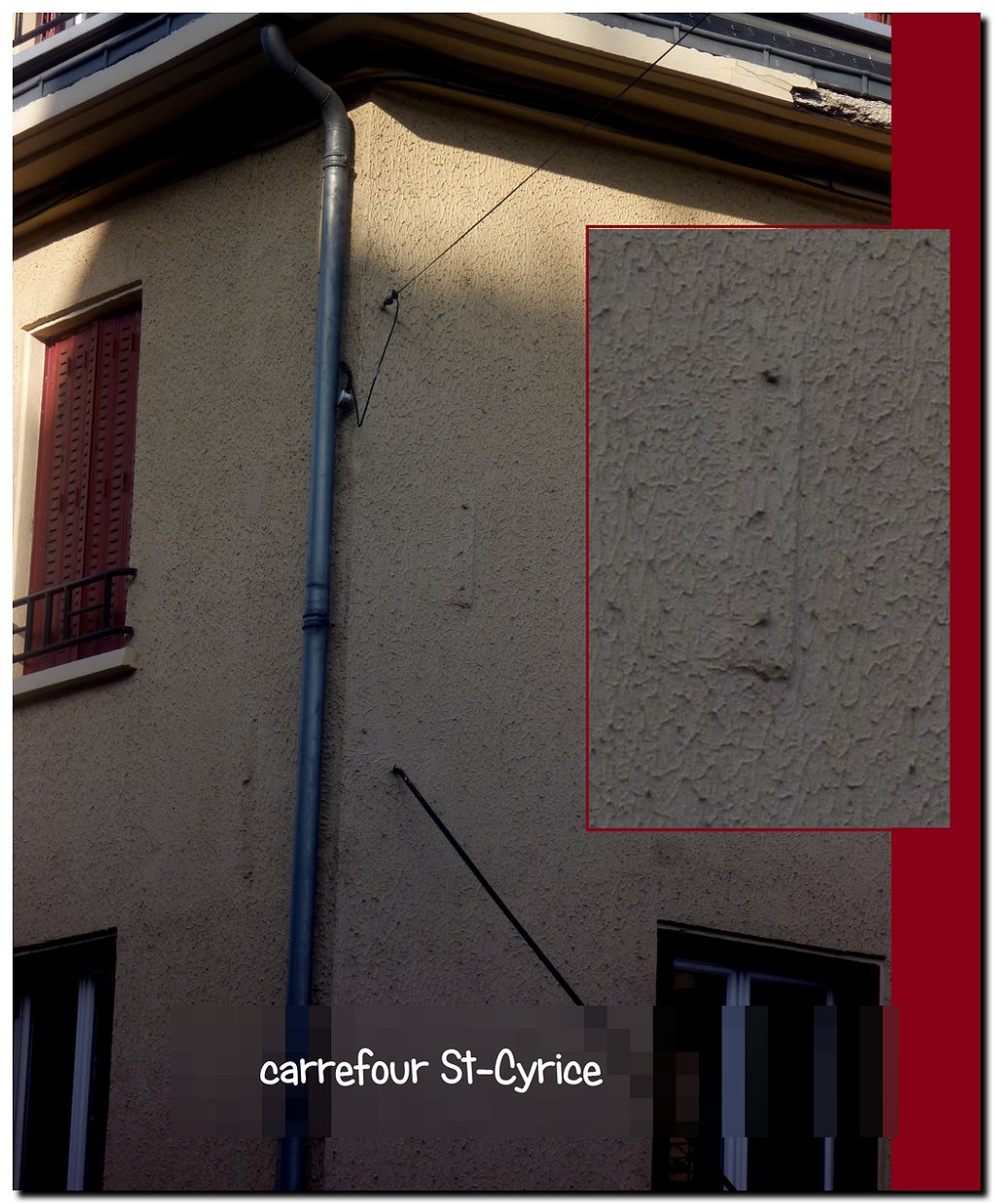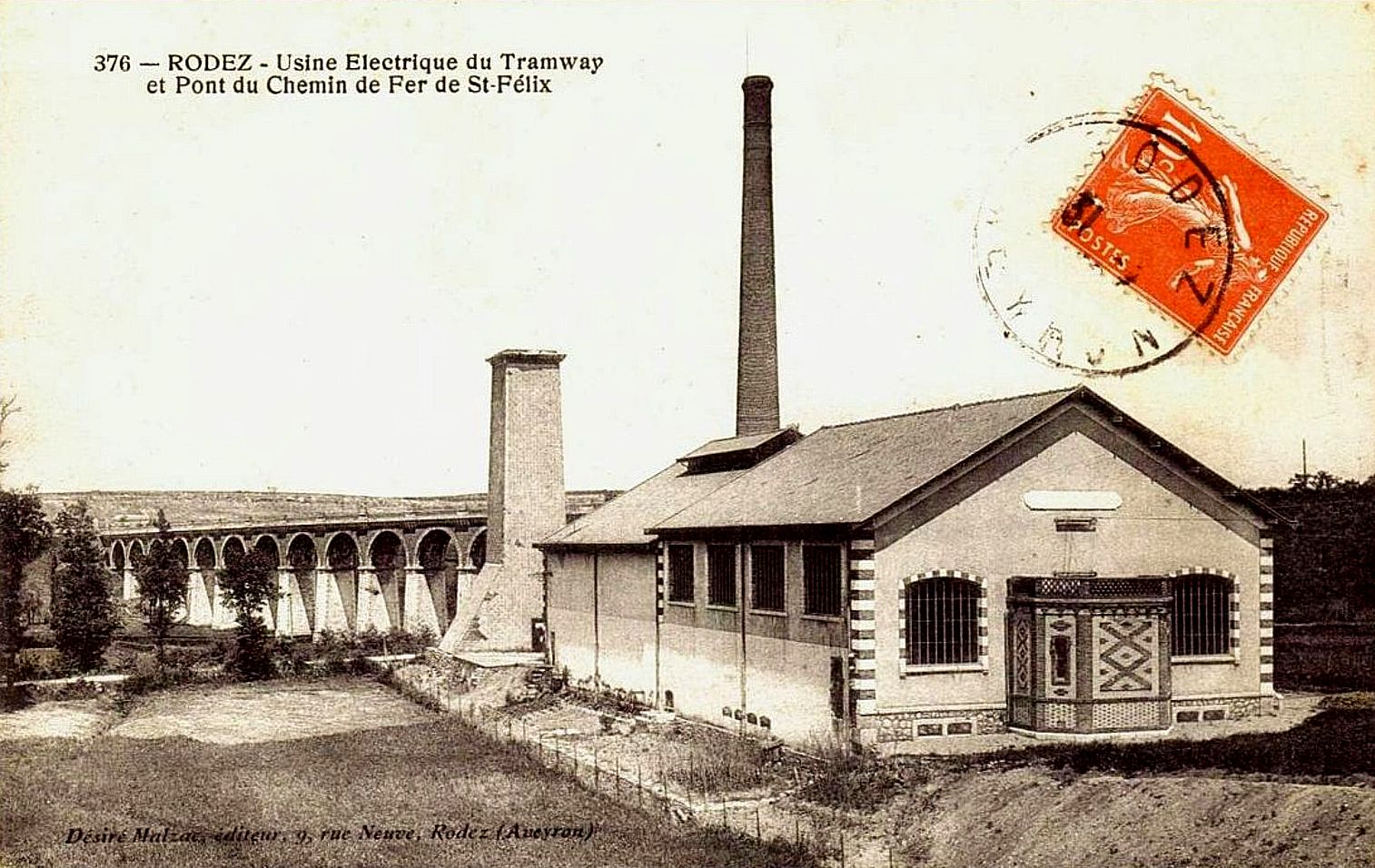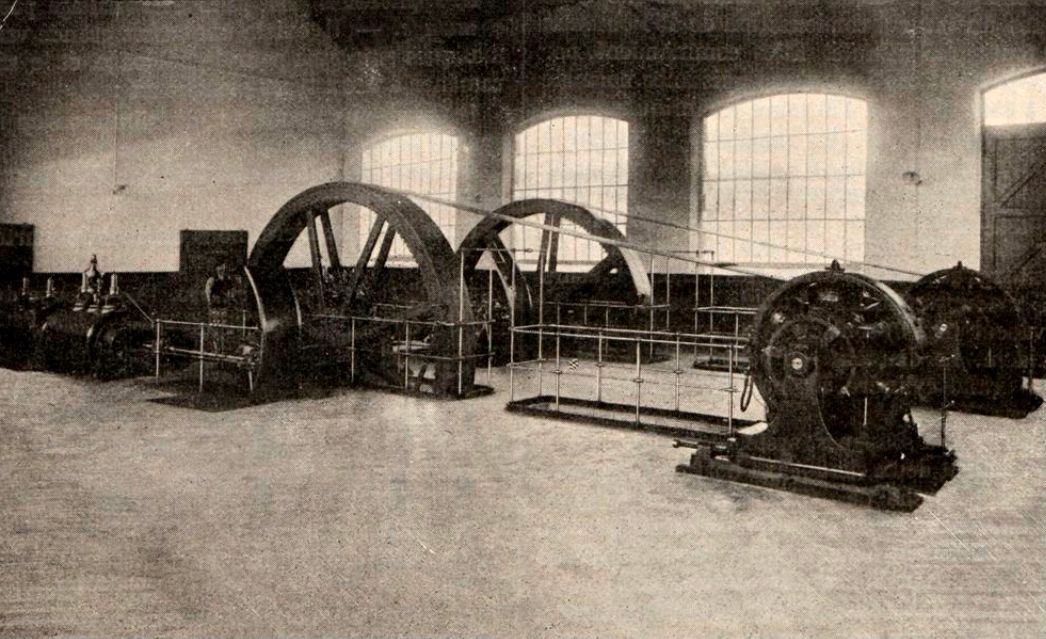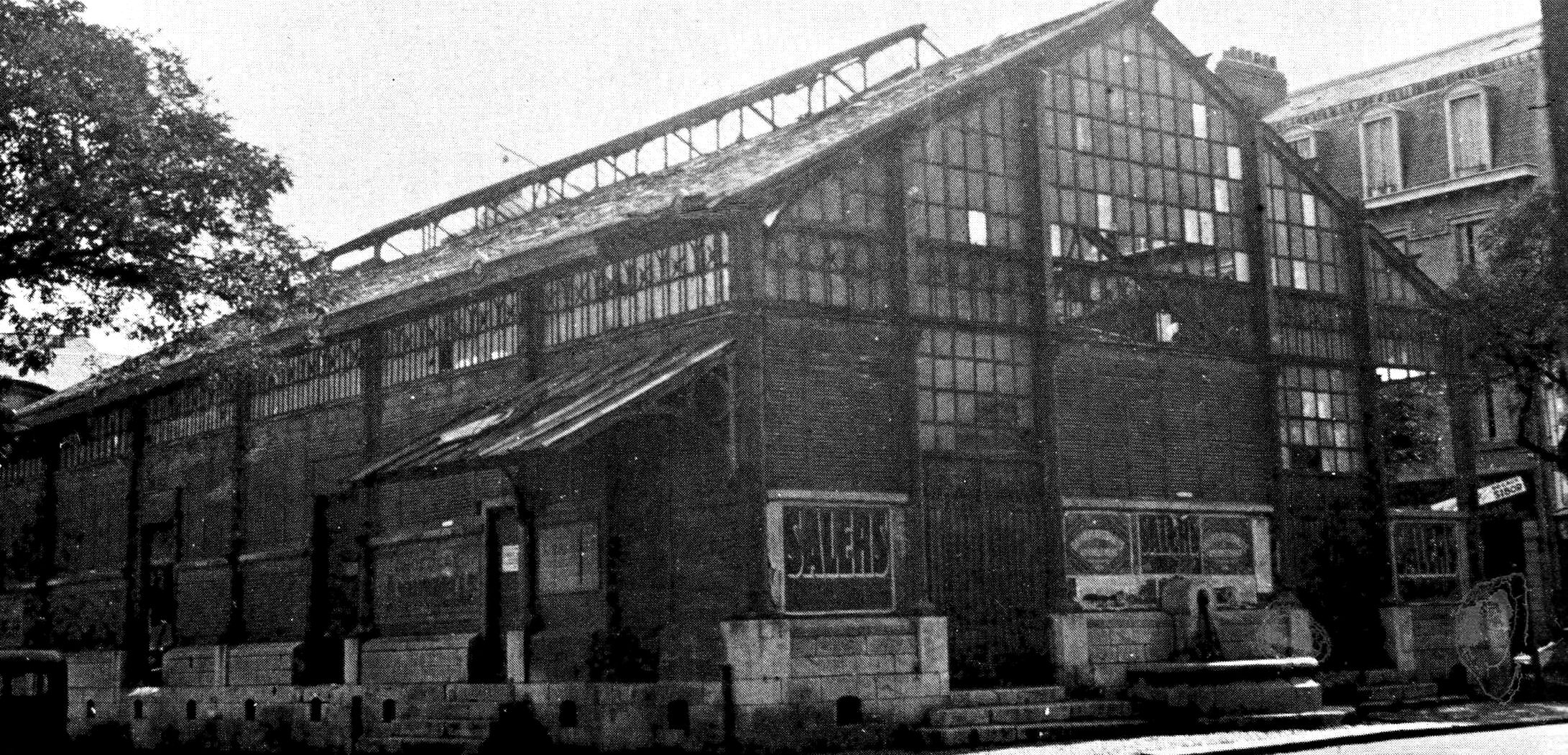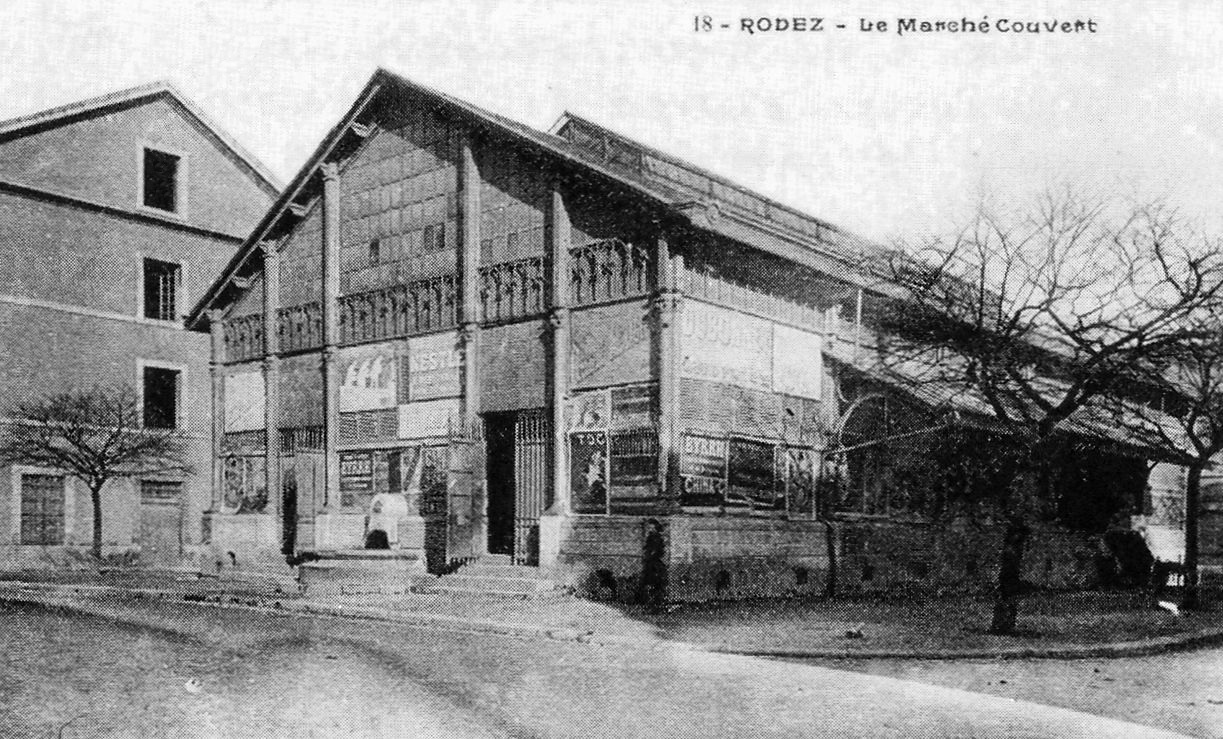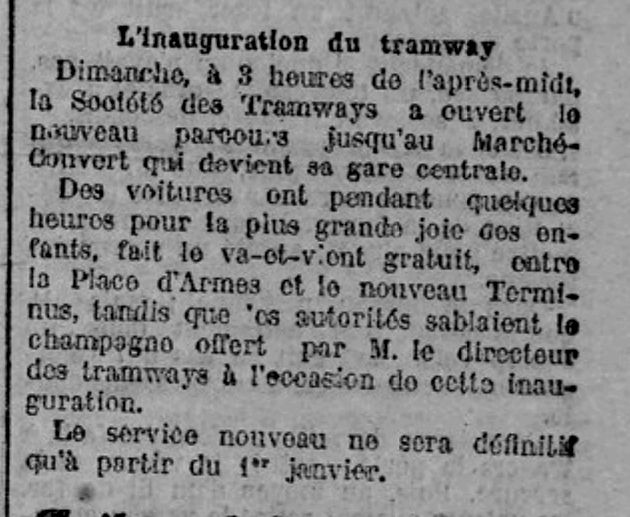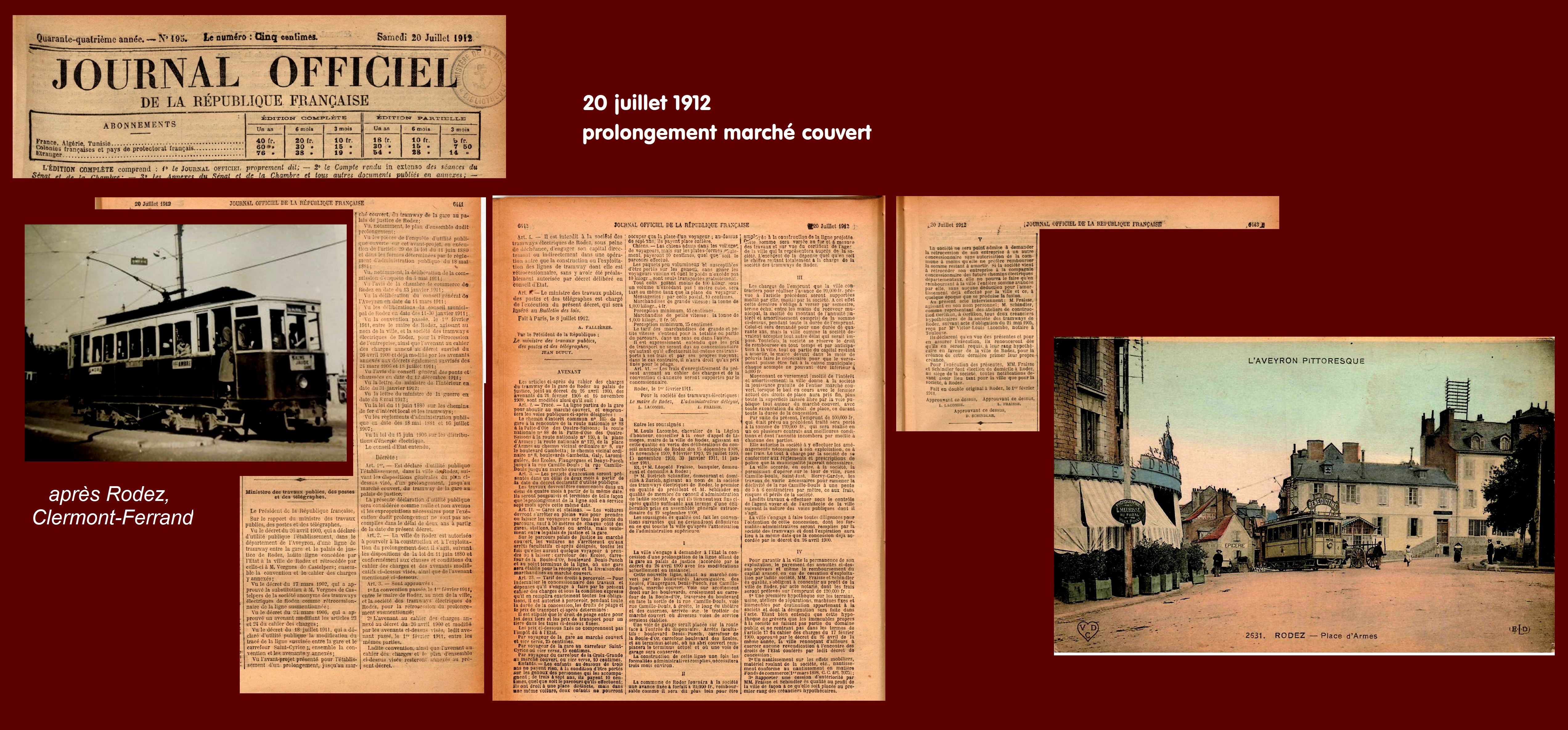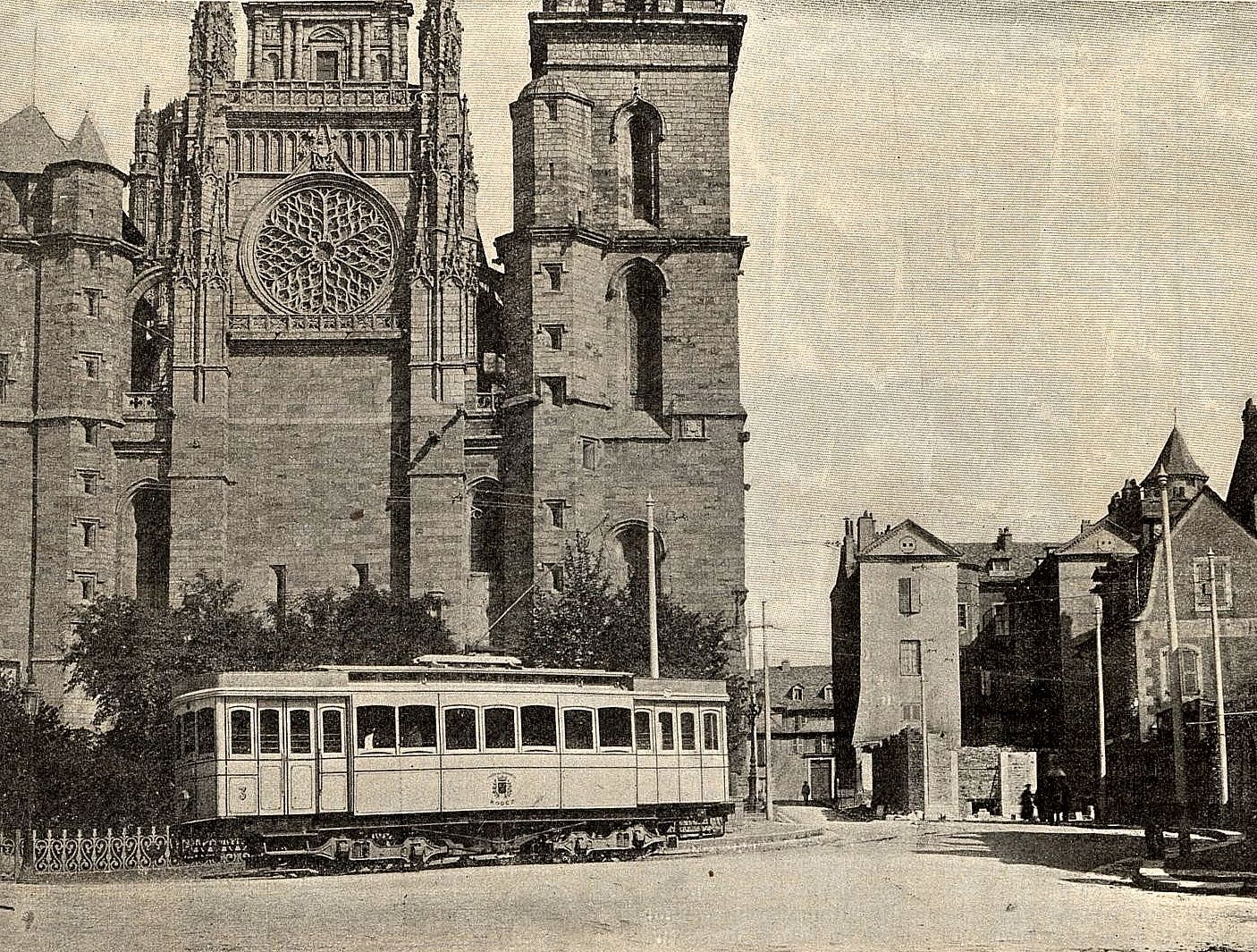RETOUR page menu RETOUR page accueil
chemin de traverse :
le tramway de Rodez
maj 01/2024
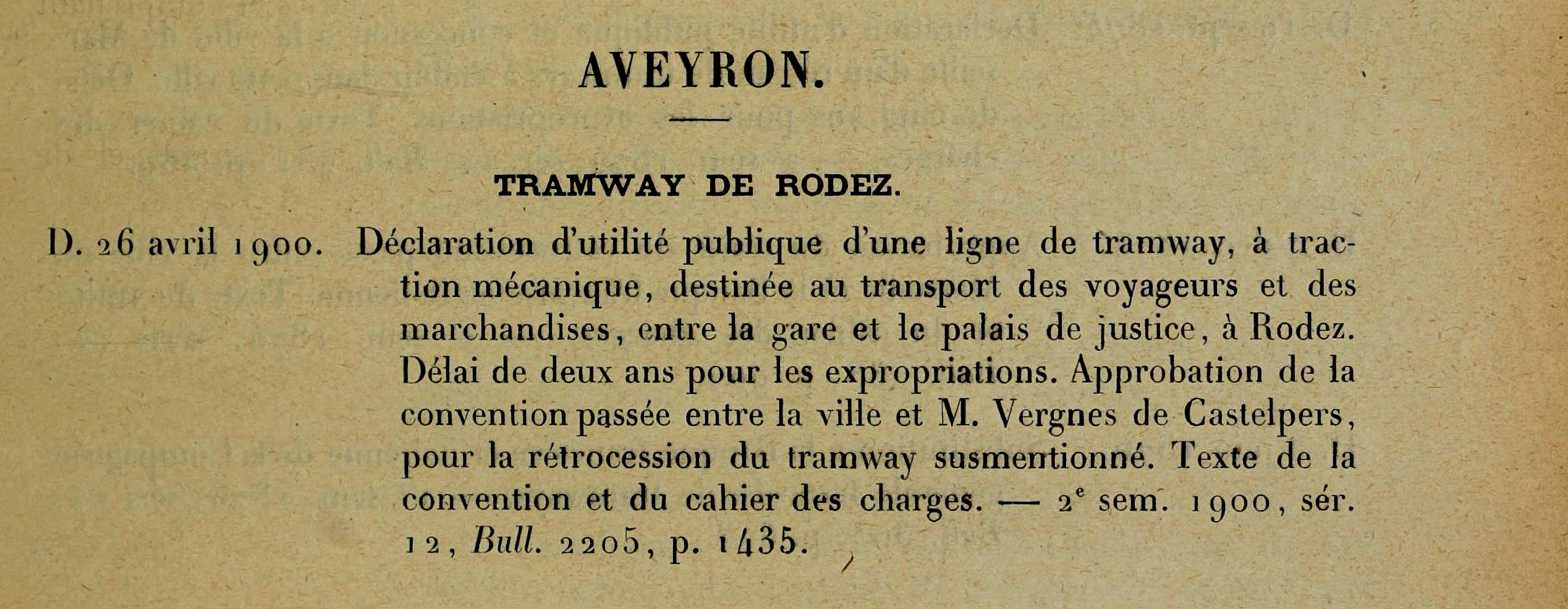
▲ Rodez ville moderne !
le roulement de tambour est ici ! ►◄
Année européenne du Patrimoine industriel et technique
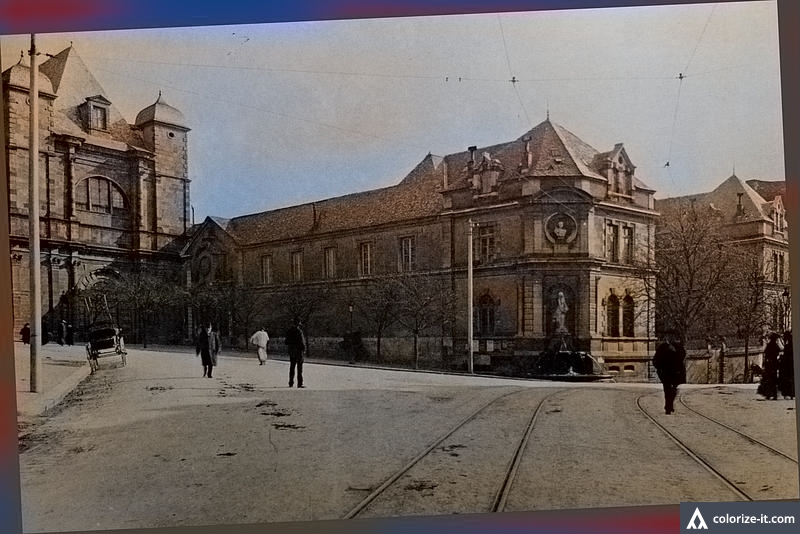
Voici une page
spéciale, dans la
série des pages
2015
qui sont consacrées au patrimoine industriel et
technique.
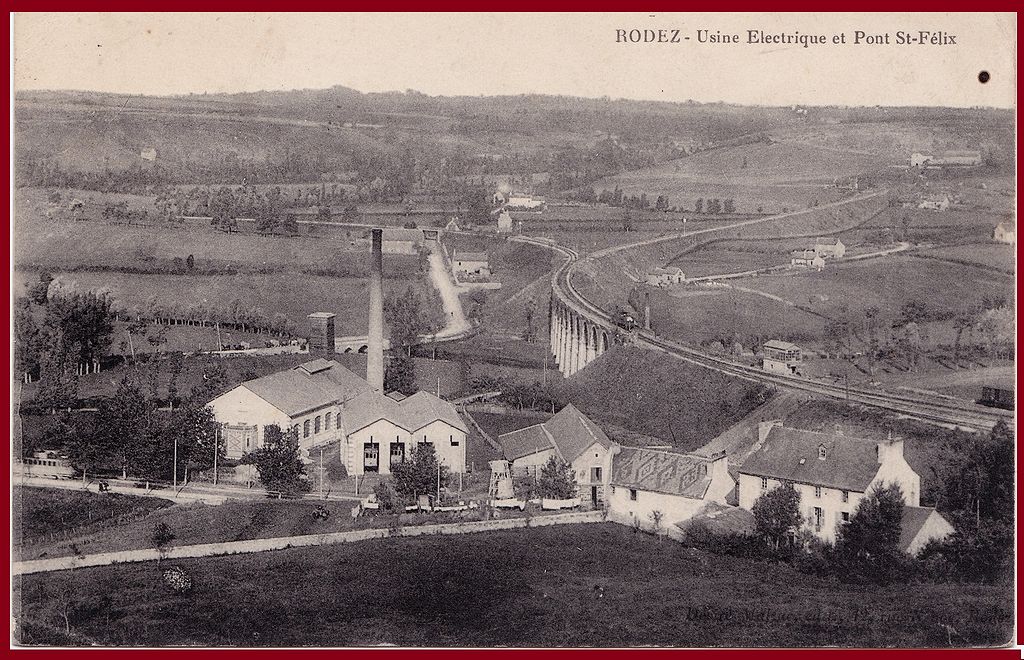
Gare des tramways de Rodez, ateliers (postée octobre 1914)
Un pont transbordeur (mal visible ici) permet le mouvement des motrices et remorques depuis la voie principale
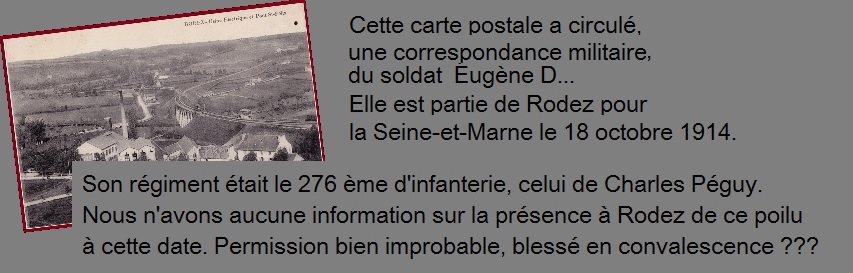
Place d'Armes, Rodez, vue plongeante sur les rails et la place (postée mai 1912)
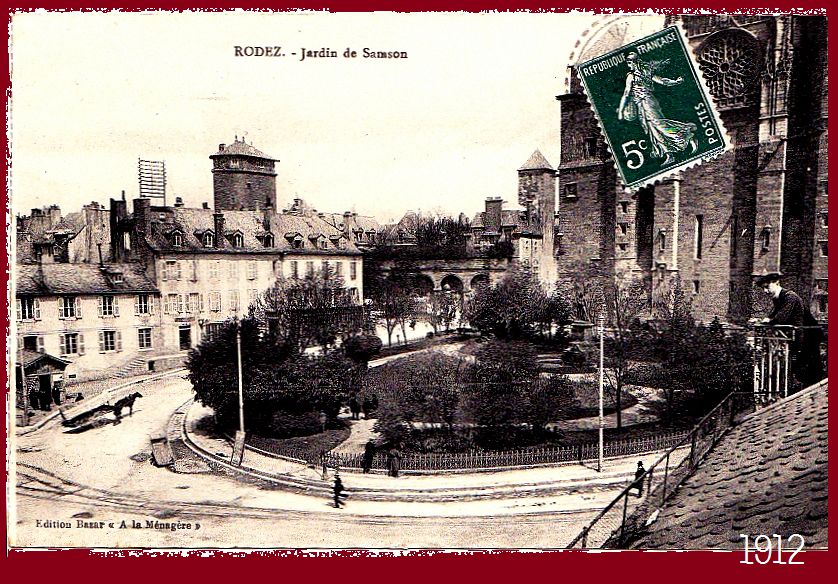 Le
tramway de Rodez
fut actif au tout début du
siècle, le précédent, de 1902 (à partir du 15 août) à 1920 (5
juillet). Un
pari très audacieux lorsqu'on connaît la topographie du piton ruthénois
: faire circuler un tramway sur des pentes voisines de 100 ‰
relève en
effet d'une volonté forte de surmonter les obstacles ! Des sources
diverses, certaines accessibles sur le net, permettent de découvrir ce
réseau éphémère. L'article de M. Jacquot, (Bulletin Facs, voir
bibliographie en fin d'article), est certainement le plus
fouillé à
tous points de vue. Pour notre part, notre apport sur cette page
va être
d'évoquer une des particularités du réseau et de son matériel, et
surtout de
proposer ce qu'il est encore possible, près d'un siècle plus tard, de découvrir. Pour cela il faudra
lever les yeux et marcher sur les traces de l'ancêtre...
Le
tramway de Rodez
fut actif au tout début du
siècle, le précédent, de 1902 (à partir du 15 août) à 1920 (5
juillet). Un
pari très audacieux lorsqu'on connaît la topographie du piton ruthénois
: faire circuler un tramway sur des pentes voisines de 100 ‰
relève en
effet d'une volonté forte de surmonter les obstacles ! Des sources
diverses, certaines accessibles sur le net, permettent de découvrir ce
réseau éphémère. L'article de M. Jacquot, (Bulletin Facs, voir
bibliographie en fin d'article), est certainement le plus
fouillé à
tous points de vue. Pour notre part, notre apport sur cette page
va être
d'évoquer une des particularités du réseau et de son matériel, et
surtout de
proposer ce qu'il est encore possible, près d'un siècle plus tard, de découvrir. Pour cela il faudra
lever les yeux et marcher sur les traces de l'ancêtre...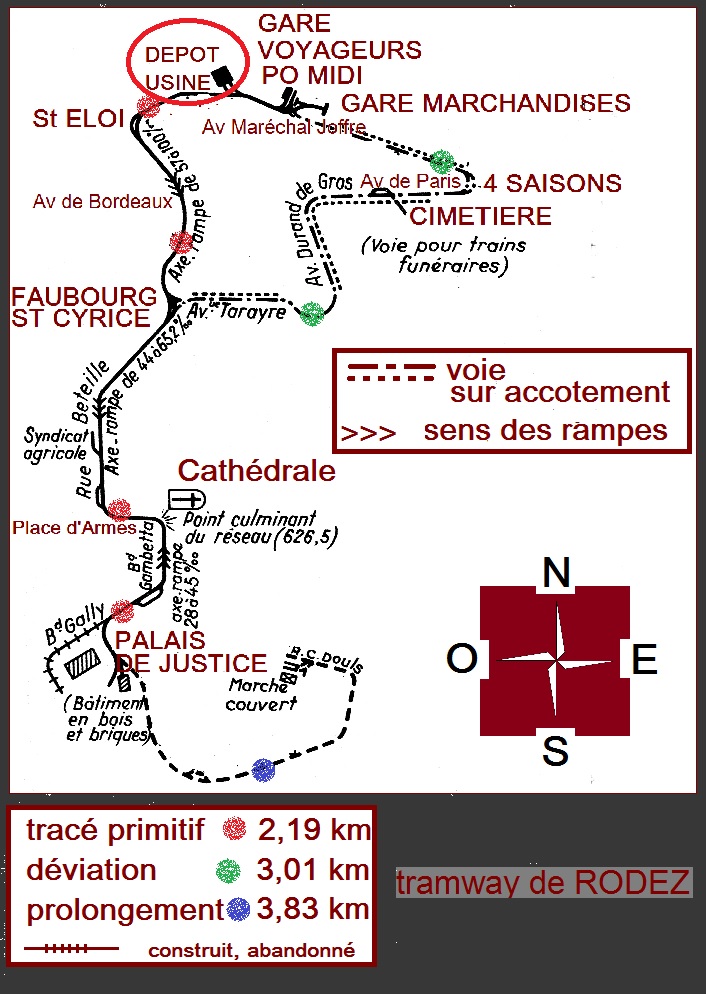
▲ Plan des lignes, modification et complément, d'après LVDR
▼Partie urbaine, report du tracé* sur plan Romain de 1856
* sources : croquis in Jacquot, FACS, 1968 n° 85,
origine dossier Archives Départementales Aveyron, cote non précisée
origine dossier Archives Départementales Aveyron, cote non précisée
▼ devant l'ancien lycée Foch (postée 19?6)
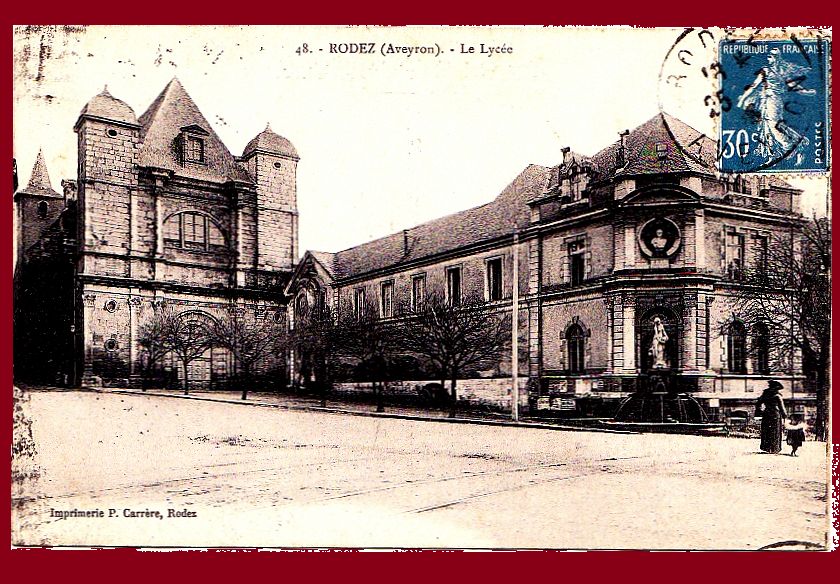 Le but
principal
du réseau est de joindre deux pôles
: la gare, celle des réseaux PO et Midi qui cohabitent ici, en un point
frontière, et le centre ville un à deux kilomètres plus loin, et
surtout un peu plus haut, 92 mètres exactement, pour un peu plus de
1500 m, avec une pente moyenne de 60 ‰ et même 100 ‰ sur un court
passage
de 20 m ! La ligne principale, en axe de chaussée, après quelques
centaines de mètres,
emprunte une très sévère montée, l'avenue de Bordeaux, ou côte St-Eloi,
vers le Faubourg. Un changement de direction à 90° lui permet alors
d'emprunter la rue Béteille pour rejoindre la Place d'Armes, itinéraire
légèrement moins pentu. Une fois cette place traversée, le tramway se
dirige sur les boulevards de Rodez vers le palais de justice, qui fut
le point terminal originel du réseau.
Le but
principal
du réseau est de joindre deux pôles
: la gare, celle des réseaux PO et Midi qui cohabitent ici, en un point
frontière, et le centre ville un à deux kilomètres plus loin, et
surtout un peu plus haut, 92 mètres exactement, pour un peu plus de
1500 m, avec une pente moyenne de 60 ‰ et même 100 ‰ sur un court
passage
de 20 m ! La ligne principale, en axe de chaussée, après quelques
centaines de mètres,
emprunte une très sévère montée, l'avenue de Bordeaux, ou côte St-Eloi,
vers le Faubourg. Un changement de direction à 90° lui permet alors
d'emprunter la rue Béteille pour rejoindre la Place d'Armes, itinéraire
légèrement moins pentu. Une fois cette place traversée, le tramway se
dirige sur les boulevards de Rodez vers le palais de justice, qui fut
le point terminal originel du réseau. 
photo Carrère : des rails...

La gare, station de départ et d'arrivée
- traction par moteurs électriques et fils aériens (art. 1)
- écartement intérieur des rails 1 m (art. 4), rails noyés dans la chaussée
- par voyageur, droit de péage, 20 centimes (art. 23) de la gare au palais de justice
- par colis de voyageur, 100 kg maximum, 20 centimes de la gare au palais (gratuit si moins de 10 kg)
On voit que certains voyageurs n'hésitaient pas à transporter du lourd !
Par ailleurs, le tramway peut assurer du transport de fret, de dépêches...
Ces obligations diverses vont conduire à la définition d'un matériel éprouvé. La firme suisse Oerlikon étudiera le réseau et va fournir le matériel électrique. Les ateliers de Schlieren contribueront à ce marché pour le matériel roulant. Les premières motrices, élégantes, étaient à bogies. D'autres à deux essieux, plus légères suivront. Un constructeur de Lyon, Weitz fournira en 1917 deux remorques. Les deux entreprises principales suisses sont proches de Zurich. La crémaillère n'étant pas retenue, la circulation par adhérence fera appel à des tramways sur bogies. Chaque élément (voyageur) est d'une longueur hors-tout de 10,85 m. Le problème le plus important sera évidemment celui des rampes à gravir et inversement à descendre. Nombre de ruthénois ont dû se poser la question et connaissaient-ils la (les) réponse(s) ?
La montée de l'avenue de Bordeaux, avec son passage à 100 ‰ (!) et celle de la rue Béteille n'ont apparemment pas été cause, au début des activités de difficultés particulières. Si elles ont existé, elles n'ont pas été particulièrement soulignées dans les descriptions d'époque et si un patinage apparaissait, des sablières pouvaient l'enrayer. Il en est tout autrement de l'opération inverse, descendre vers la gare. Pour sécuriser l'activité, le matériel était muni de deux dispositifs de freinage. Le premier, utilisé habituellement consistait en un freinage électrique. Les moteurs devenaient alternateurs et le courant était dissipé dans les résistances de démarrage. Classique dans son principe ce frein électrique donnait satisfaction. Au cas où, un second frein mécanique pouvait être mis en oeuvre sur huit sabots.
Mais si un enrayage survenait ? La solution, préconisée, consiste à desserer le frein, rendre aux roues la possibilité de retrouver leur rotation, puis de freiner progressivement. On comprend bien sûr l'angoisse du mécanicien de service devant couper le freinage dans cette situation d'urgence pour mieux ensuite arrêter son convoi ! Un seul cas de dérive, sans accident de personne est relaté...
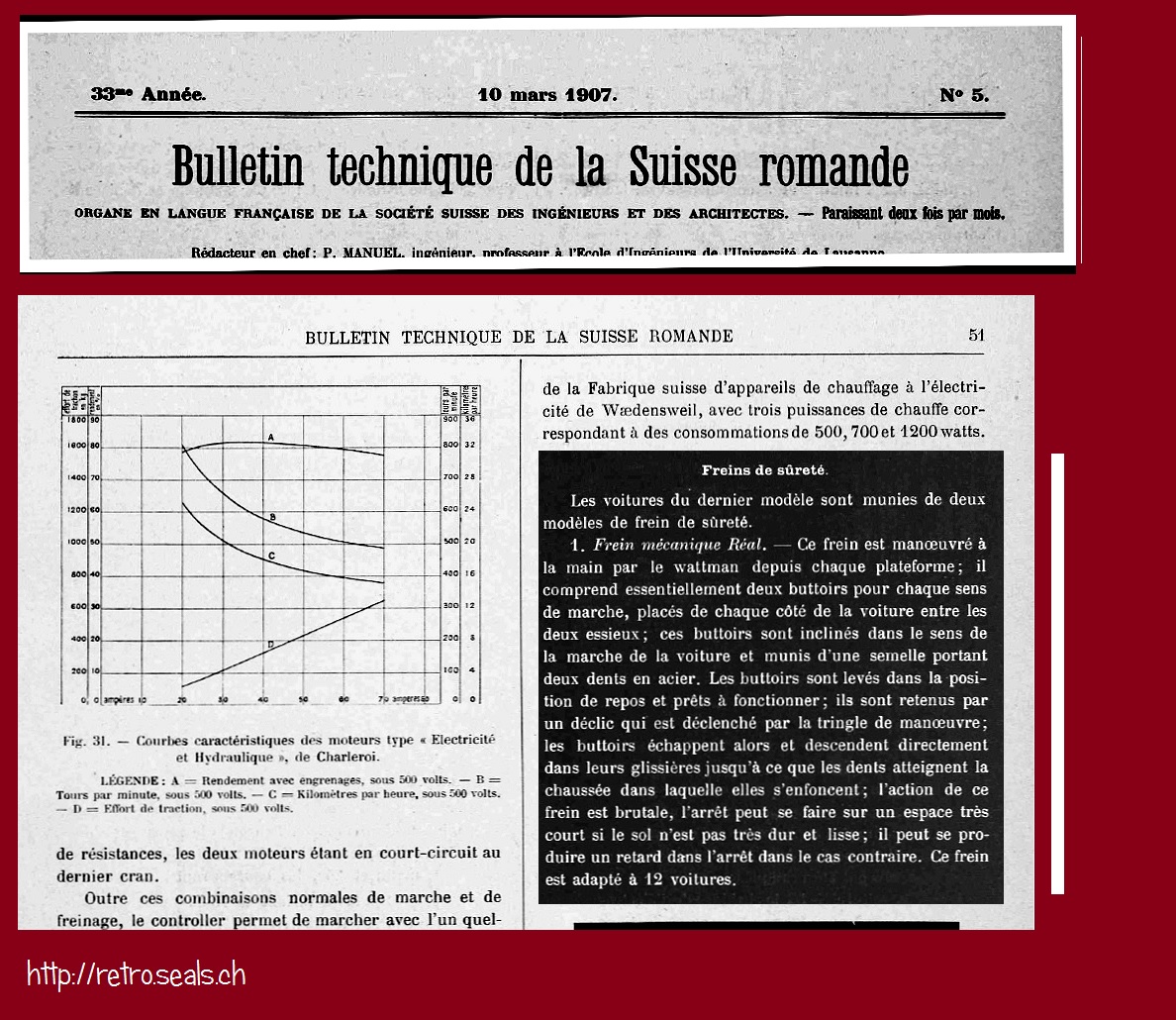
freins de sûreté Réal, tramway de Lausanne
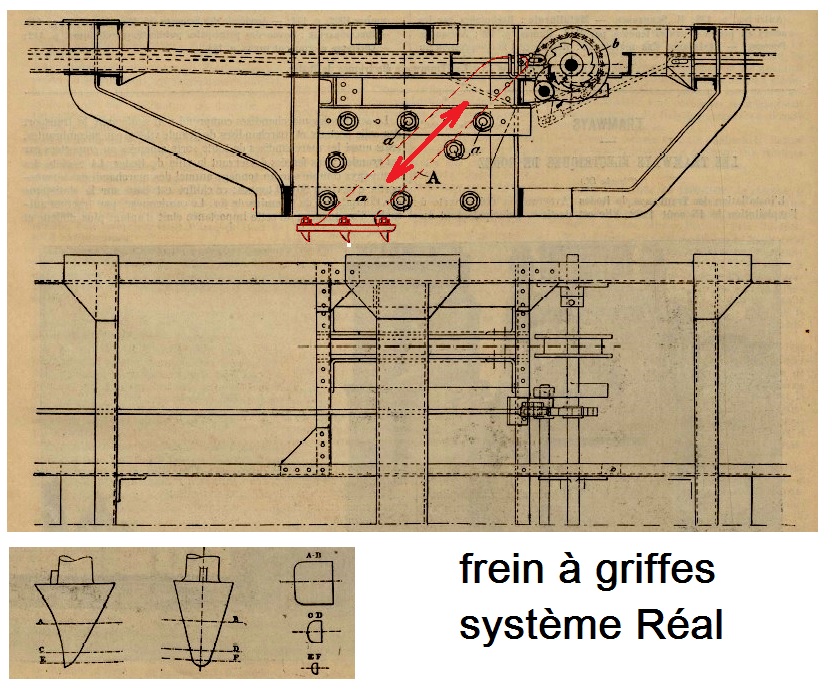
Frein à griffes, Le Génie Civil
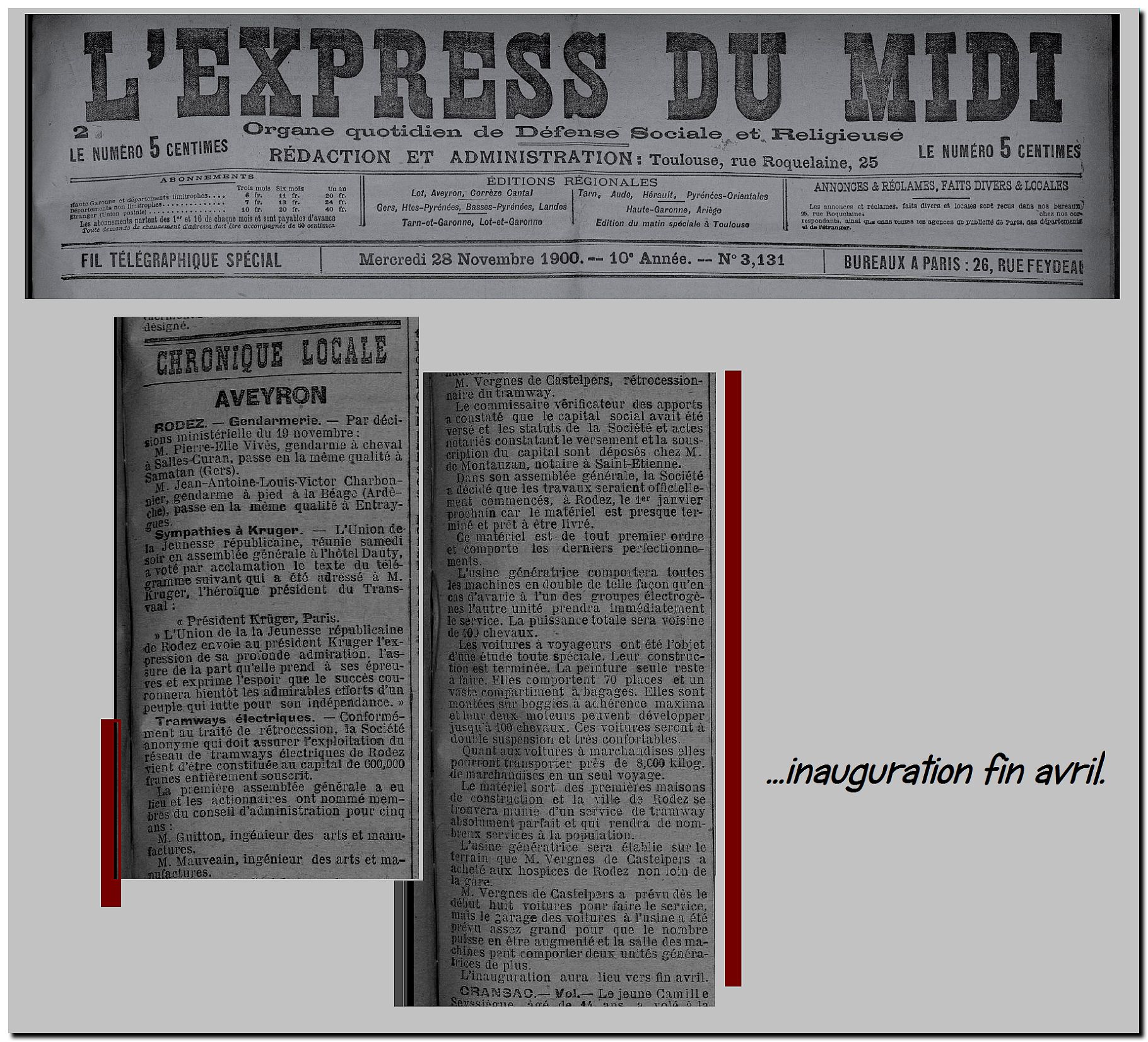
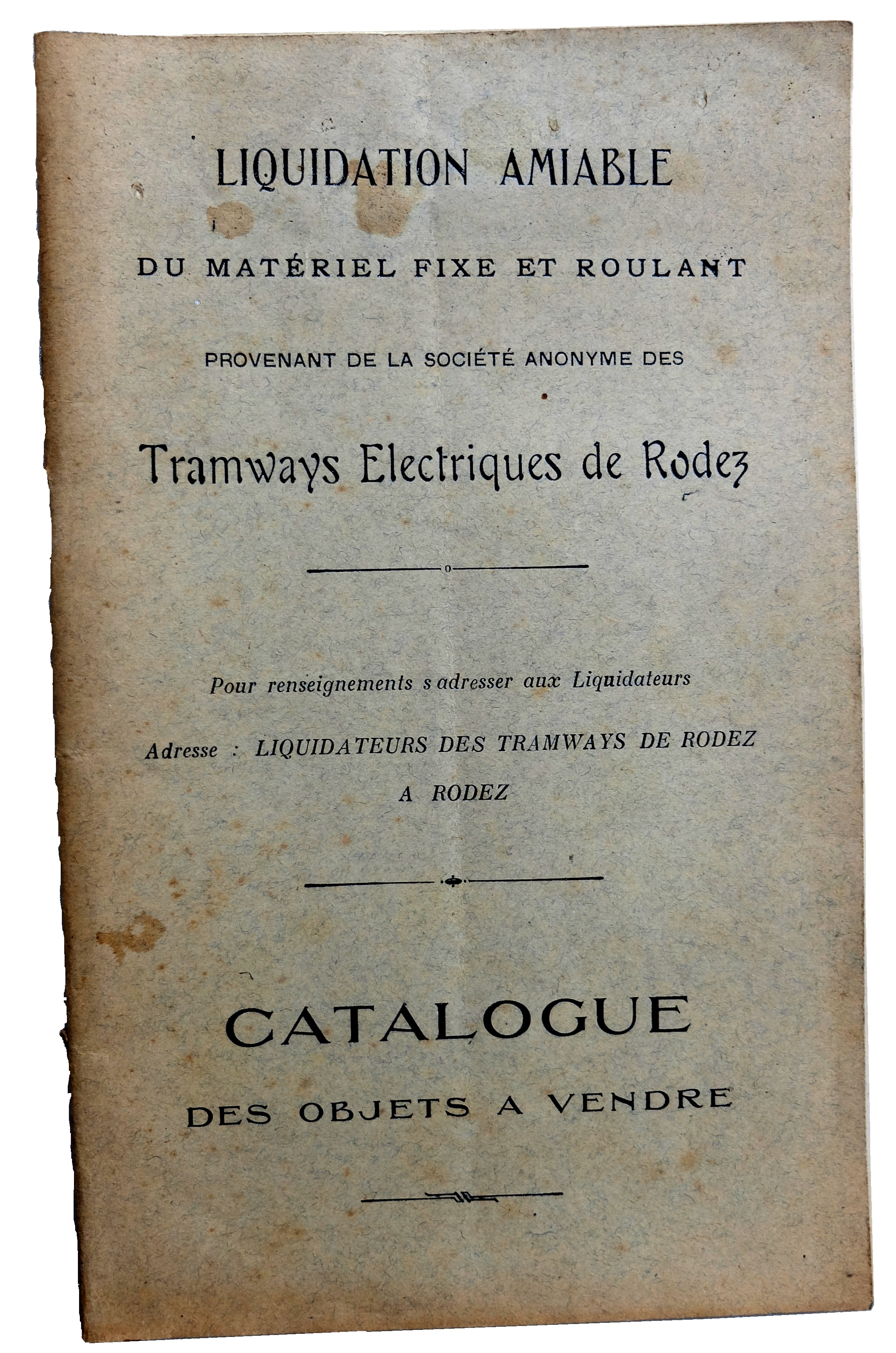 clap
de fin, 1922, ADA
clap
de fin, 1922, ADAEt maintenant, que reste-t-il de ce tramway ?
Planche,
motrice 1, Le Génie Civil
 Il a
disparu victime de son non succès, d'une faible fréquentation de
voyageurs, et des conditions économiques très bouleversées de cette
époque. Les calculs des gestionnaires furent rapidement mis en défaut.
Evidemment, aucune trace (locale...) du
matériel roulant, parti vers d'autres réseaux, comme Clermont-Ferrand.
Des motrices "Rodez" y étaient semble-t-il actives en 1953 !
Pour les
installations fixes, les ateliers de St-Félix et le garage des rames
sont encore des bâtiments faisant partie du quotidien. Reconvertis pour
diverses activités, leur architecture industrielle, mais soignée, les
signale sans difficultés aux promeneurs. Le grand bâtiment existant
était celui de l'usine électrique. La cheminée de la machine à
vapeur n'est plus là... Une prise d'eau existait depuis le ruisseau
voisin. Et il y
a également, en cette fin d'année 2014 d'autres témoins. La ligne
d'alimentation électrique installée pour l'activité était constituée de
fils de contacts soutenus par une kyrielle de supports. Il y avait des
poteaux, tous les 40 m en ligne, bien visibles sur les photos
d'époque ; ils ont totalement
disparu du paysage urbain. Mais là où il n'était pas possible de mettre
en place un poteau de soutien, trottoir trop étroit par exemple, une
potence, ou une agrafe était fixée dans le mur de l'habitation voisine.
En levant les
yeux, on retrouve une bonne quantité de ces restes métalliques à
6 m de hauteur sur les façades : plaques métalliques, potence avec
déport de la plaque, ou, mieux pour l'environnement, des éléments
moulés, un peu art-déco, des rosaces, qui devaient à leur tour
reprendre les
fixations des câbles. Il en reste un bon nombre, la plupart sans
utilité
actuelle, et certains reconvertis en supports de câbles de maintien de
lampadaires centraux. Les reconversions urbaines ont été très
nombreuses, les crépis refaits ou faits, et des habitaions et immeubles
nouveaux remplacent ceux du siècle passé. Cela est surtout vrai en
centre ville, sur les boulevards, où on ne retrouve presque plus ces
témoins d'un patrimoine technique oublié. Par contre, près de la gare,
et le long des premières avenues en montant vers le centre ville, on
peut parfaitement mettre le doigt (enfin, pas tout à fait ! ) sur ces
reliques. Il y a même des entrepreneurs qui en refaisant les crépis les
ont simplement noyés sans les retirer, mais la surépaisseur trahit bien
leur présence ! La galerie de photos que nous vous proposons reprend
presque la totalité des témoins, mais quelques uns ont échappé à notre
APN le jour du reportage, le 2 novembre 2014.
Il a
disparu victime de son non succès, d'une faible fréquentation de
voyageurs, et des conditions économiques très bouleversées de cette
époque. Les calculs des gestionnaires furent rapidement mis en défaut.
Evidemment, aucune trace (locale...) du
matériel roulant, parti vers d'autres réseaux, comme Clermont-Ferrand.
Des motrices "Rodez" y étaient semble-t-il actives en 1953 !
Pour les
installations fixes, les ateliers de St-Félix et le garage des rames
sont encore des bâtiments faisant partie du quotidien. Reconvertis pour
diverses activités, leur architecture industrielle, mais soignée, les
signale sans difficultés aux promeneurs. Le grand bâtiment existant
était celui de l'usine électrique. La cheminée de la machine à
vapeur n'est plus là... Une prise d'eau existait depuis le ruisseau
voisin. Et il y
a également, en cette fin d'année 2014 d'autres témoins. La ligne
d'alimentation électrique installée pour l'activité était constituée de
fils de contacts soutenus par une kyrielle de supports. Il y avait des
poteaux, tous les 40 m en ligne, bien visibles sur les photos
d'époque ; ils ont totalement
disparu du paysage urbain. Mais là où il n'était pas possible de mettre
en place un poteau de soutien, trottoir trop étroit par exemple, une
potence, ou une agrafe était fixée dans le mur de l'habitation voisine.
En levant les
yeux, on retrouve une bonne quantité de ces restes métalliques à
6 m de hauteur sur les façades : plaques métalliques, potence avec
déport de la plaque, ou, mieux pour l'environnement, des éléments
moulés, un peu art-déco, des rosaces, qui devaient à leur tour
reprendre les
fixations des câbles. Il en reste un bon nombre, la plupart sans
utilité
actuelle, et certains reconvertis en supports de câbles de maintien de
lampadaires centraux. Les reconversions urbaines ont été très
nombreuses, les crépis refaits ou faits, et des habitaions et immeubles
nouveaux remplacent ceux du siècle passé. Cela est surtout vrai en
centre ville, sur les boulevards, où on ne retrouve presque plus ces
témoins d'un patrimoine technique oublié. Par contre, près de la gare,
et le long des premières avenues en montant vers le centre ville, on
peut parfaitement mettre le doigt (enfin, pas tout à fait ! ) sur ces
reliques. Il y a même des entrepreneurs qui en refaisant les crépis les
ont simplement noyés sans les retirer, mais la surépaisseur trahit bien
leur présence ! La galerie de photos que nous vous proposons reprend
presque la totalité des témoins, mais quelques uns ont échappé à notre
APN le jour du reportage, le 2 novembre 2014. Un souhait ? Etre lu, compris et que ces témoins restent en place ; même si le tramway de Rodez ne fut pas une opération financière réussie, l'effort à le réaliser, et la nouveauté des voitures avec leur plateforme fermée par exemple, une première en France, méritent ce petit effort de sauvegarde. Prenez votre APN (appareil photo numérique), et partez donc à la découverte du tramway de Rodez !
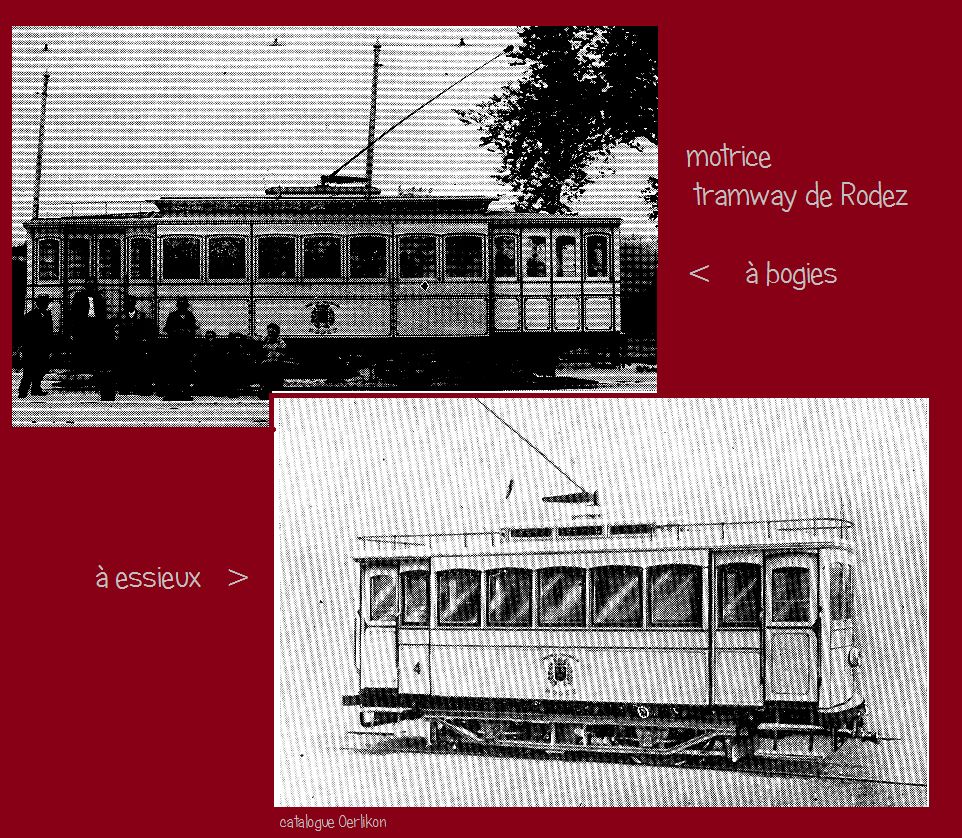
Catalogue Oerlikon, la décoration des motrices reprend les armoiries de rodez
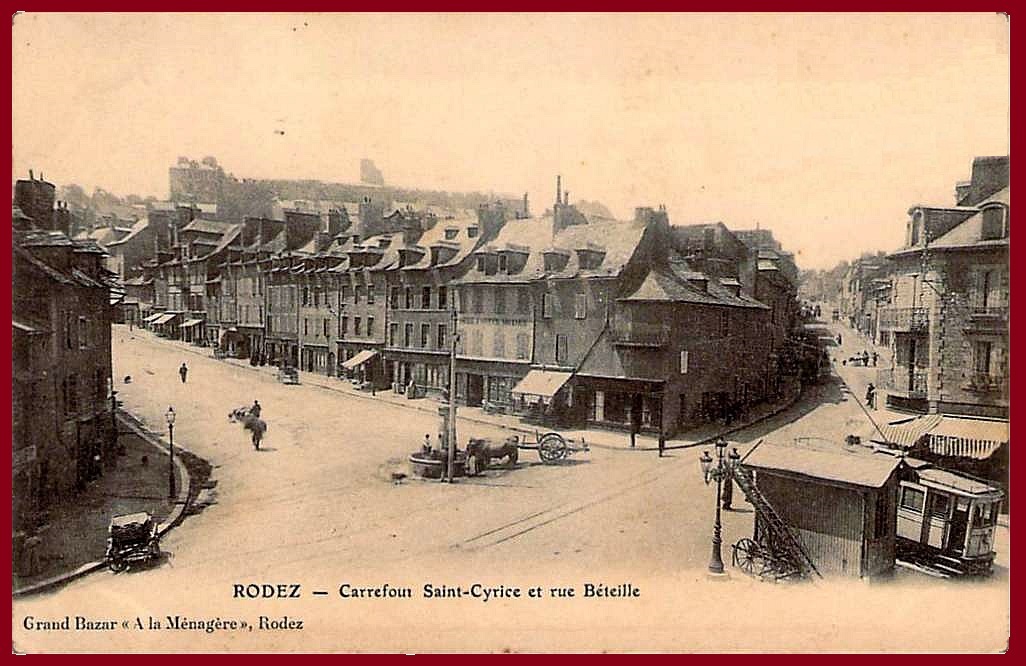
1906 : une carte et toute la poésie du tramway de Rodez, l'édicule, le matériel, la pente...
(▲ postée octobre 1906)
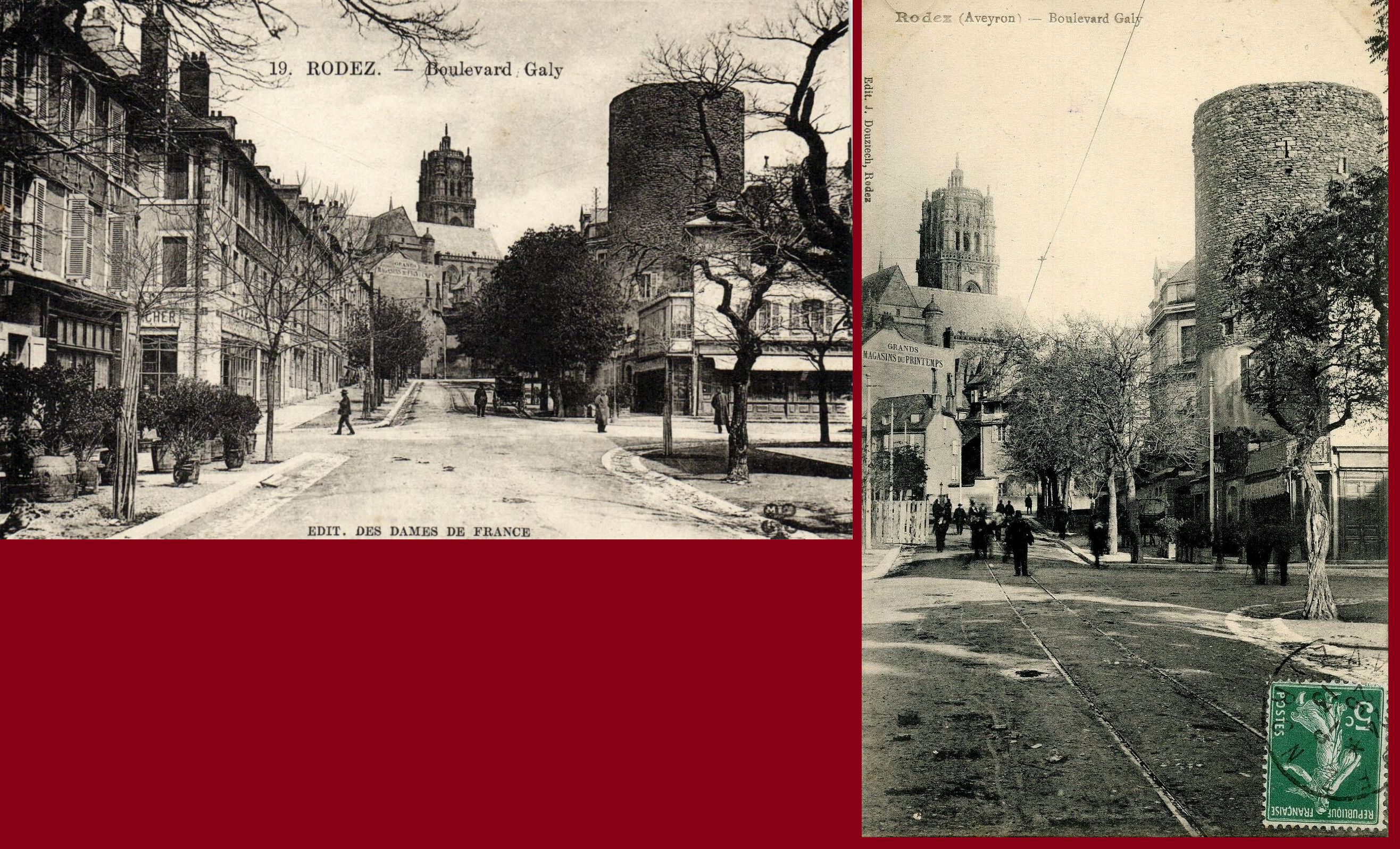
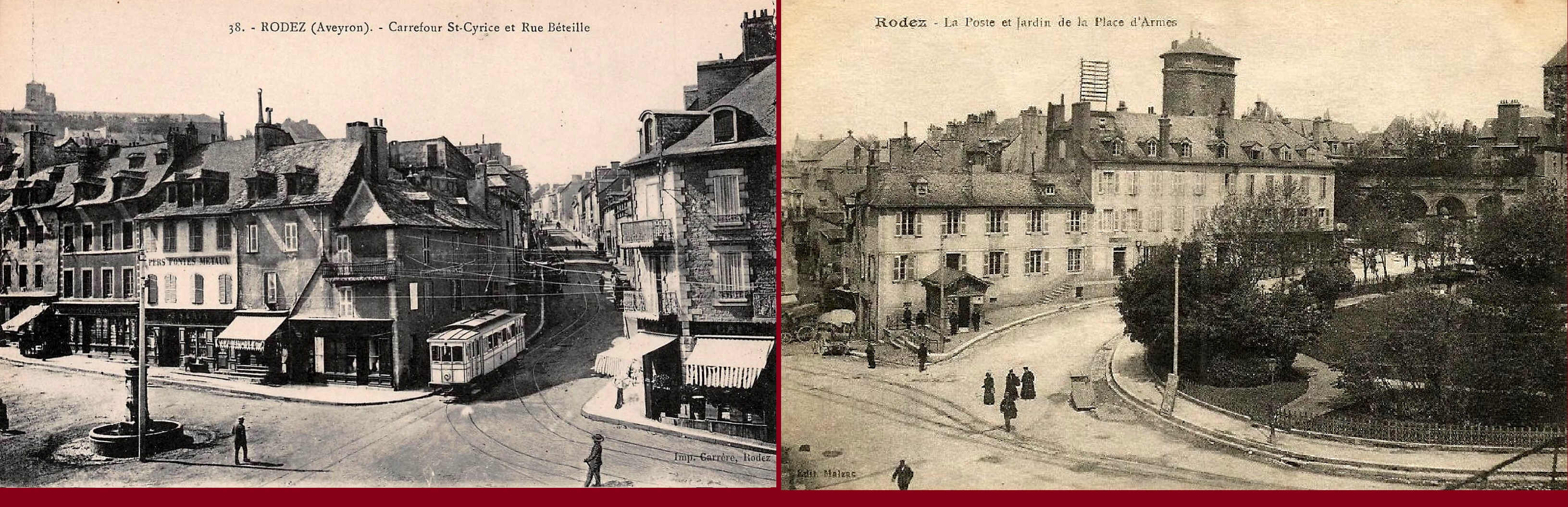
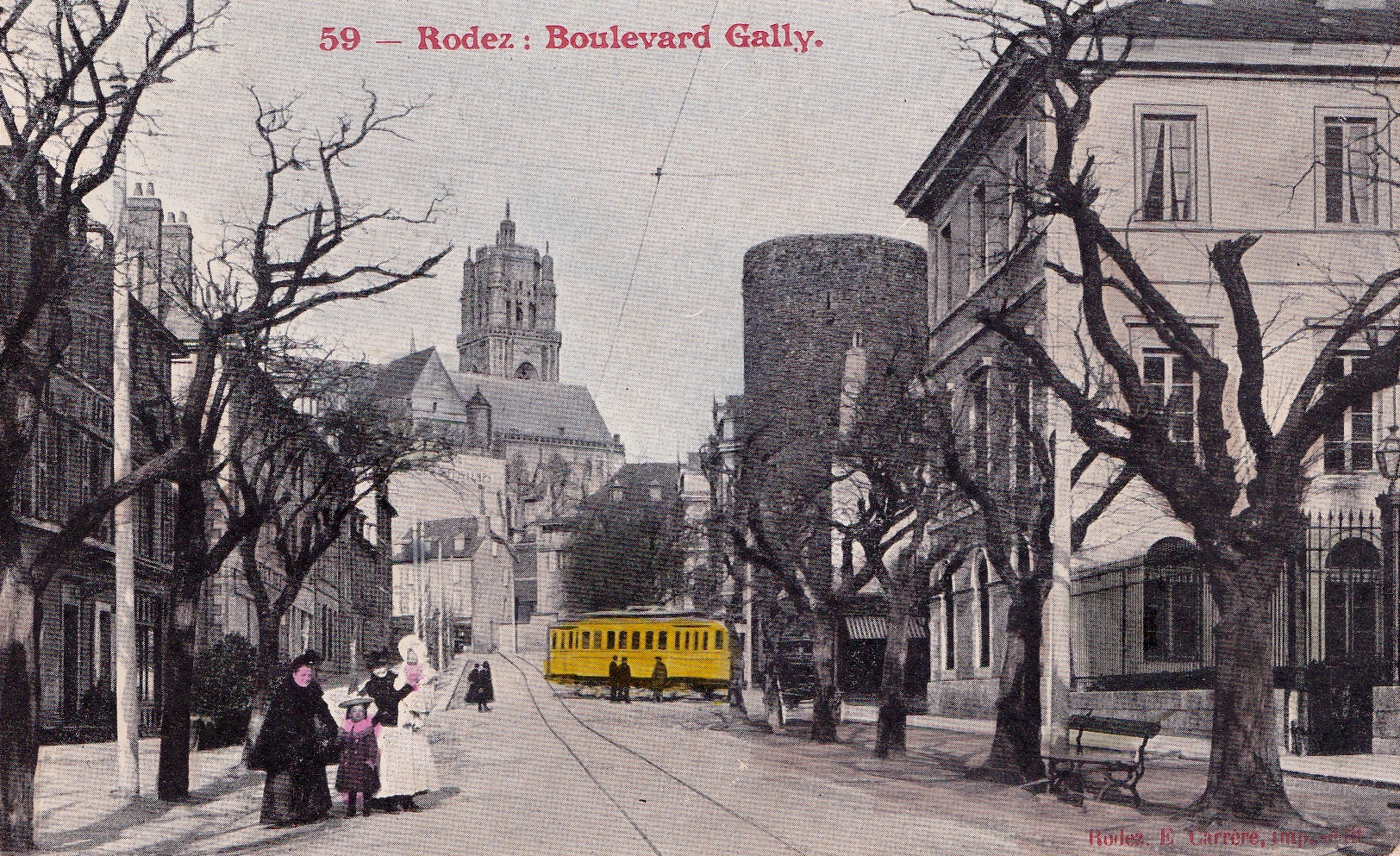
un déraillement, carte très partiellement colorisée pour souligner l'évènement !
Le Génie Civil, n° 1072, 27 décembre 1902, pour une description générale
Le Génie Civil, n° 1089, 25 avril 1903, pour la planche de matériels signalée dans le n° 1072
Bulletin officiel, n° 2205, décret 33685 du 26 avril 1900, pour le cahier des charges et le décret de concession
La Vie du Rail, n°1233, 1 mars 1970, une courte synthèse
FACS, bulletin n°85, 1968, un article très complet signé M. Jacquot, p. 3-26
Bulletin technique de la suisse romande, 1907, (http://retro.seals.ch)
La
visite, c'est ici. Cliquez sur l'image pour afficher un grand format,
ou laissez le diaporama se dérouler tout seul par un clic ICI
► Les photos rue Béteille du n°54 deviennent historiques ! Les immeubles sont démolis en février 2019...
Prises de vue novembre 2014 (Guizard 2024)
Les platines sont le plus souvent "en l'état", rarement peintes, ou demeurent sous une (mince) couche de crépi ou d'enduit...
ou laissez le diaporama se dérouler tout seul par un clic ICI
► Les photos rue Béteille du n°54 deviennent historiques ! Les immeubles sont démolis en février 2019...
Prises de vue novembre 2014 (Guizard 2024)
Les platines sont le plus souvent "en l'état", rarement peintes, ou demeurent sous une (mince) couche de crépi ou d'enduit...