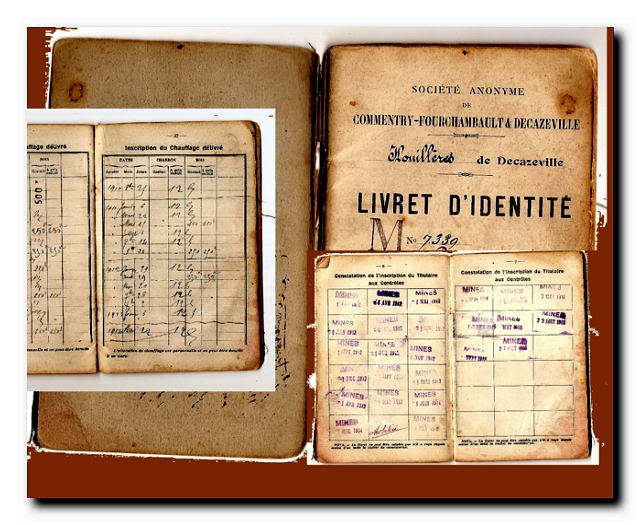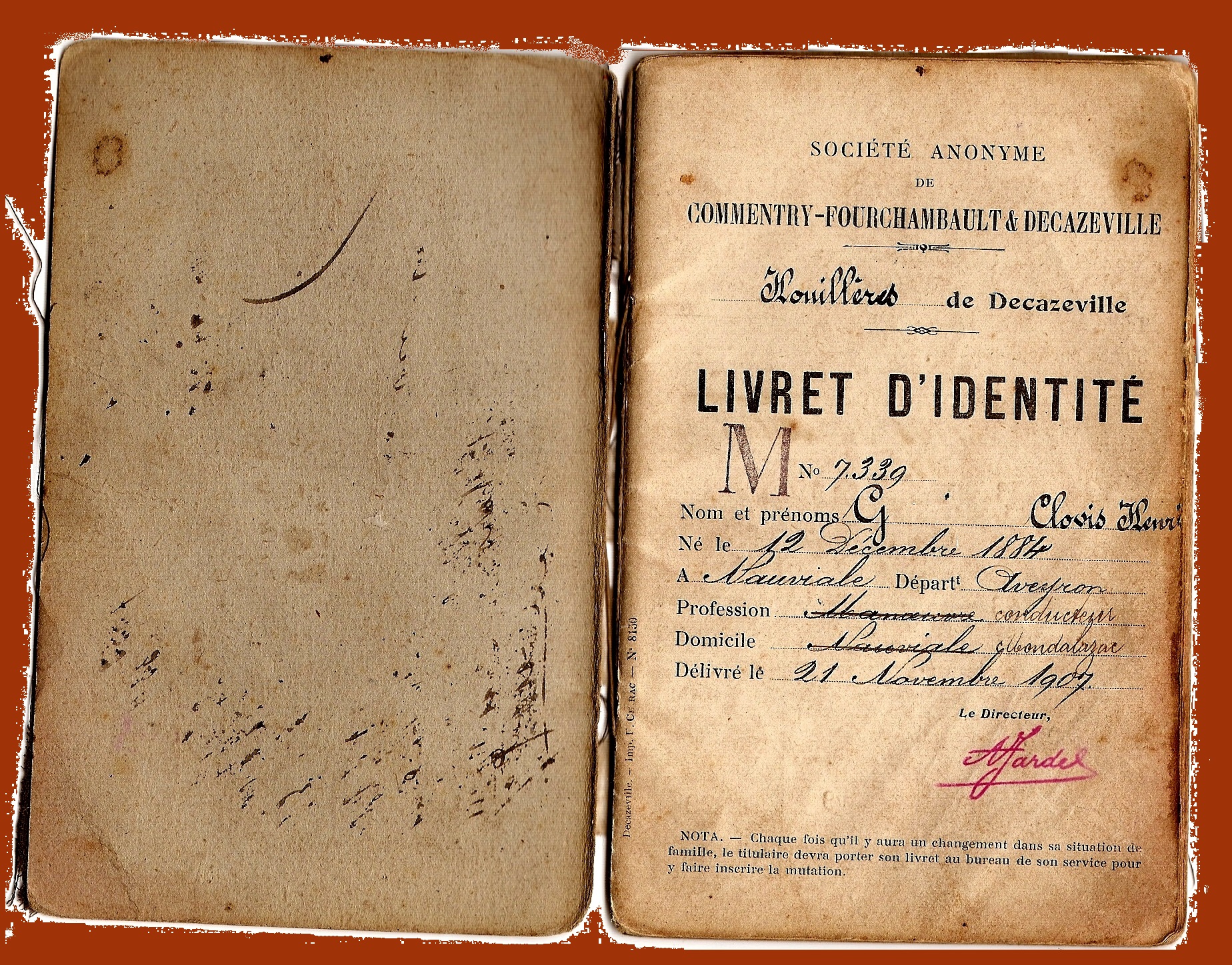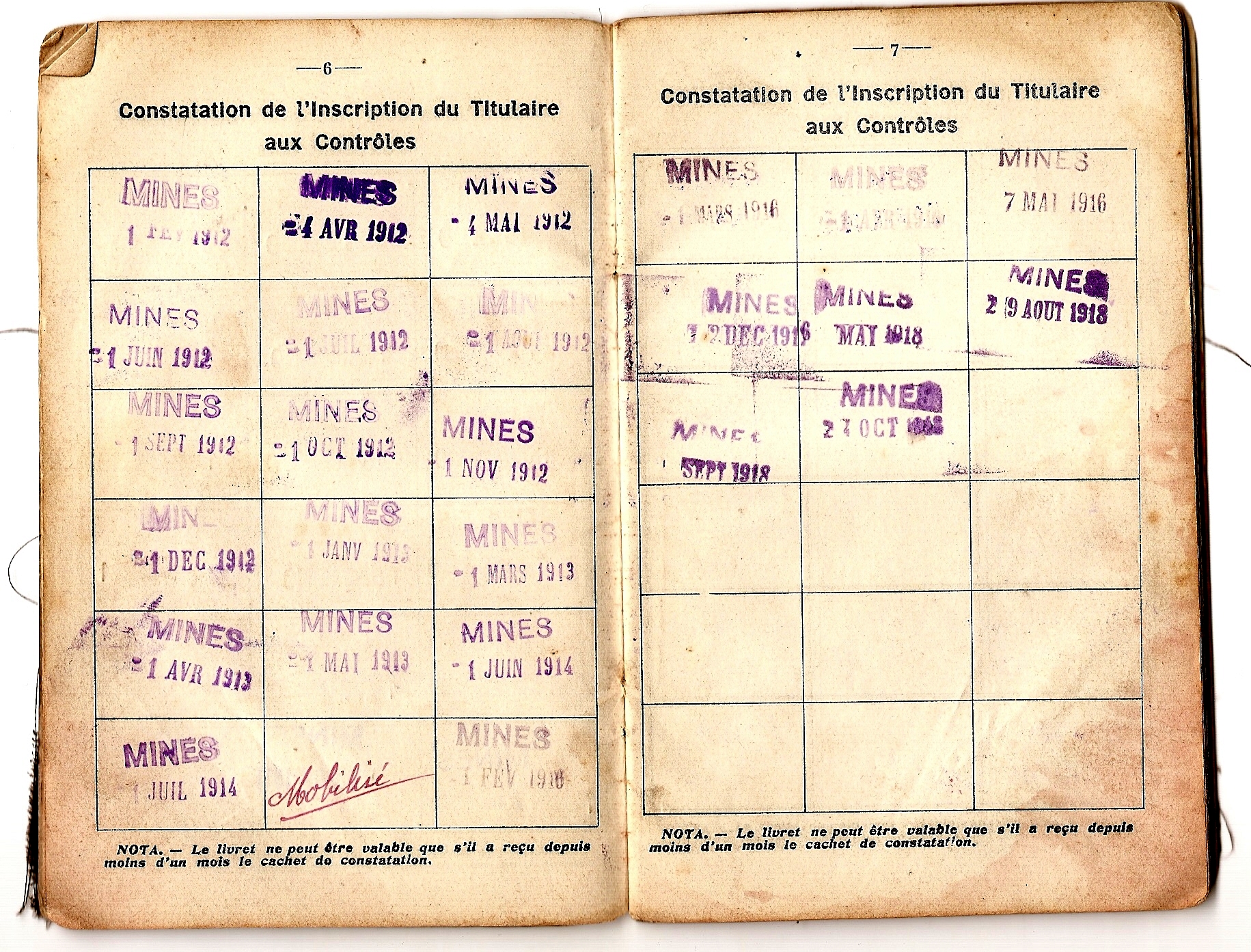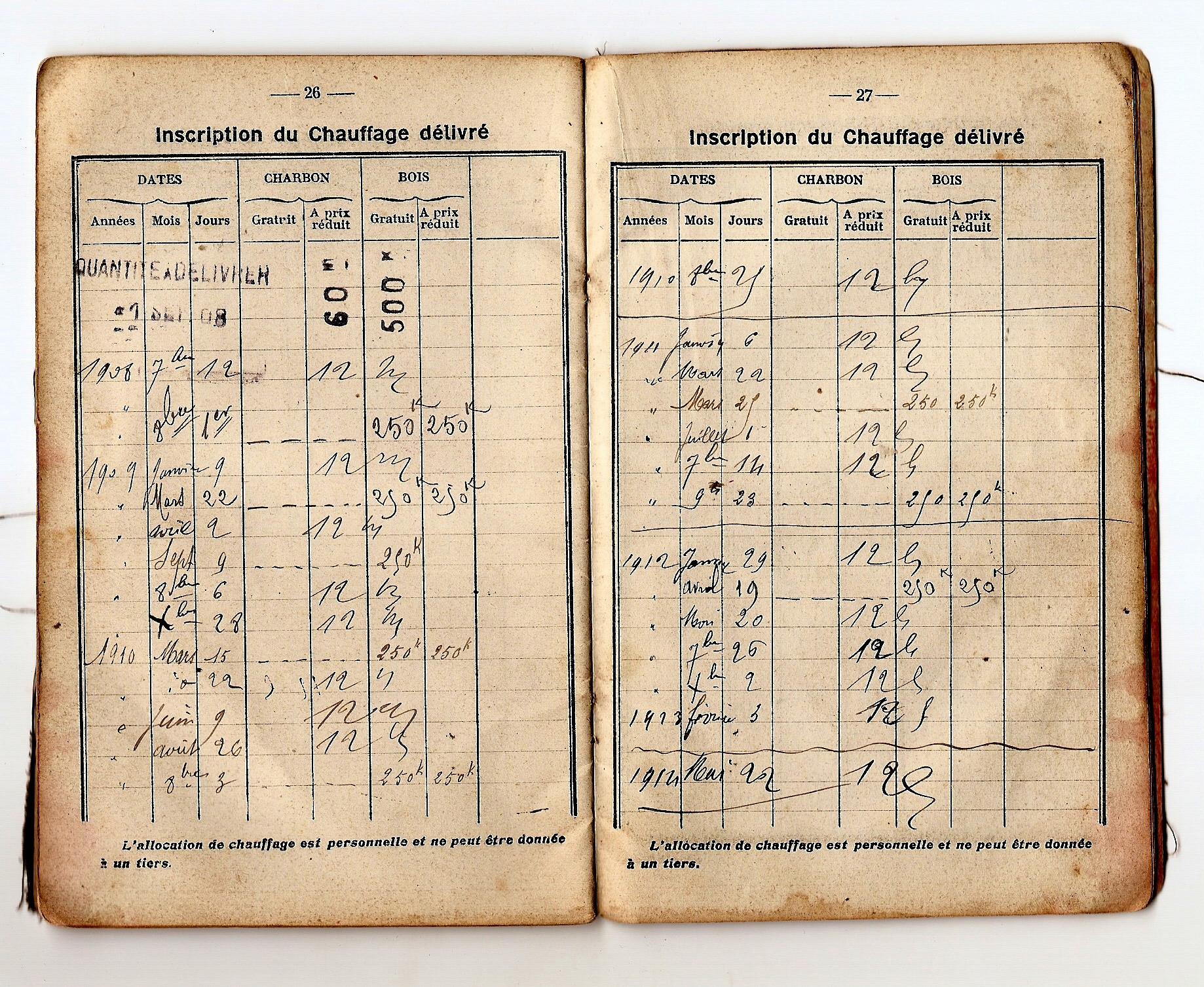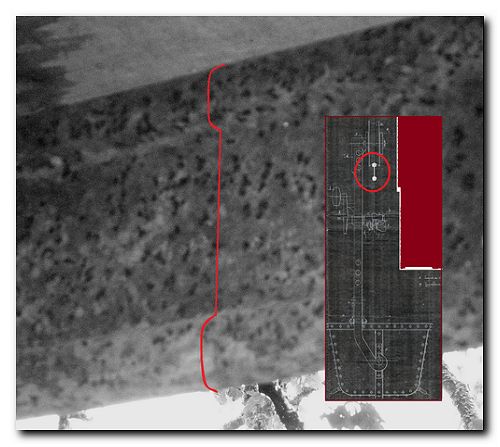La
voie minière de 66 qui passait dessus se poursuit vers Firmi et
Decazeville et fournit l'occasion de profiter d'une pause et de la
complicité des mécaniciens pour monter sur la loco, le rêve de tous les
enfants ! Mais le temps du minerai est bien révolu : la photographie
est prise vers 1950, et le terminus sera au plateau d'
Hymes, depuis Decazeville.
(photo jlc)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Hervé Vernhes, sculpteur de Malakoff ?
Oui, non, enfin presque…
La triste fin du viaduc de l’Ady, le pont Malakoff, vous est
connue. Nous l’avons retracée pour l’essentiel dans le chapitre 3 du
site. Dans les sixième et douzième chapitres vous
avez pu lire quelques compléments, et peut-être avez-vous téléchargé le
découpage du chapitre 11 ? Tout cela pour souligner une nouvelle
fois l’intérêt patrimonial de cet ouvrage. Mais 1940 fut une année
terrible pour l’ouvrage, puisque, ce fut
cette année là que le Conseil Général de l’Aveyron ne se sentit pas
concerné par l’offre, pourtant gratuite, faite par la
Société des mines de Decazeville. Un an plus tard, après un
nouveau refus, la Société le vendra comme carrière…Une triste fin donc,
mais il reste quelques pépites de cet ouvrage. Vous pouvez découvrir
ainsi en parcourant nos pages un rail
Barlow, unique rescapé de cette démolition. Il y a également les
pierres. Un diaporama du chapitre 4, Viaduc
Malakoff, pierres et restes ferrés vous les fait découvrir. Nous
avons retrouvé ces pierres, en l’état ou retaillées dans quelques
constructions, à Saint-Christophe, Saint-Cyprien ou Capdenac par
exemple. Certaines coulent des jours heureux sur un autre pont, le
vieux pont d’Espalion, ou sur un pont du Dourdou près de Saint-Cyprien.
On les retrouve en 1947 dans la restauration de l’église Sainte Fauste
de Bozouls. Il faut prendre le temps de scruter les blocs, comprendre
leur nuance de couleur ; les rouges
foncés de l’Ady contrastent avec les autres coloris. Même travail de
restauration à Rodez cette fois, à peu près à la même époque, pour la
chapelle du Collège jésuite, ou Collège Royal, ou lycée Foch (ancien).
Ce remarquable ensemble doit donc un peu de sa superbe à l’Ady, à
François Cabrol, et aux premiers tailleurs de pierre qui furent à
l’ouvrage pour les mines de fer. (Merci
Annie Jammes-Bories pour cette information).
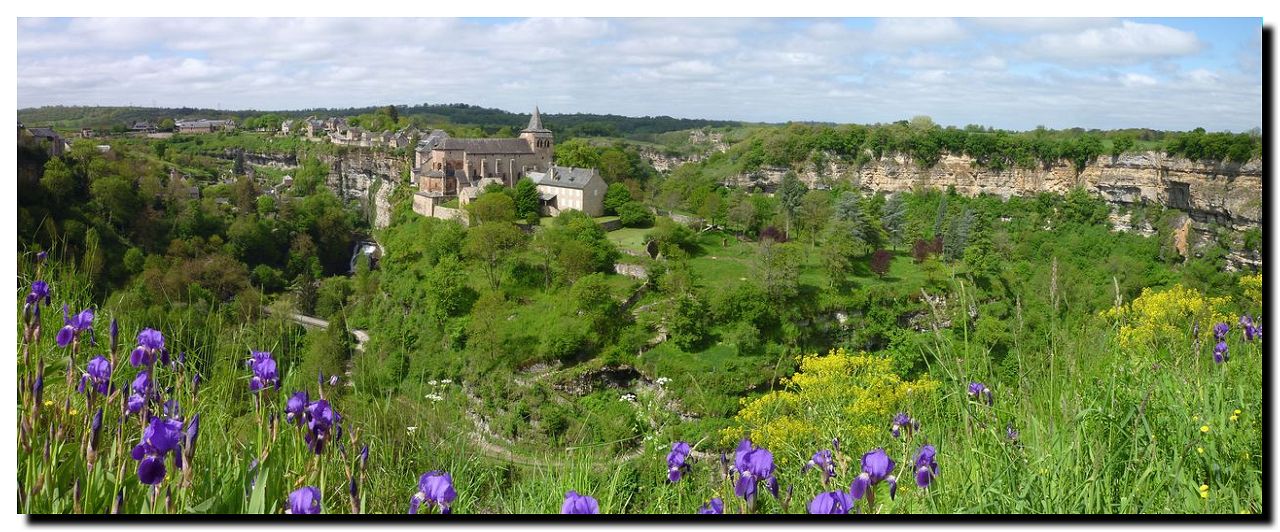
Sainte-Fauste,
Bozouls.

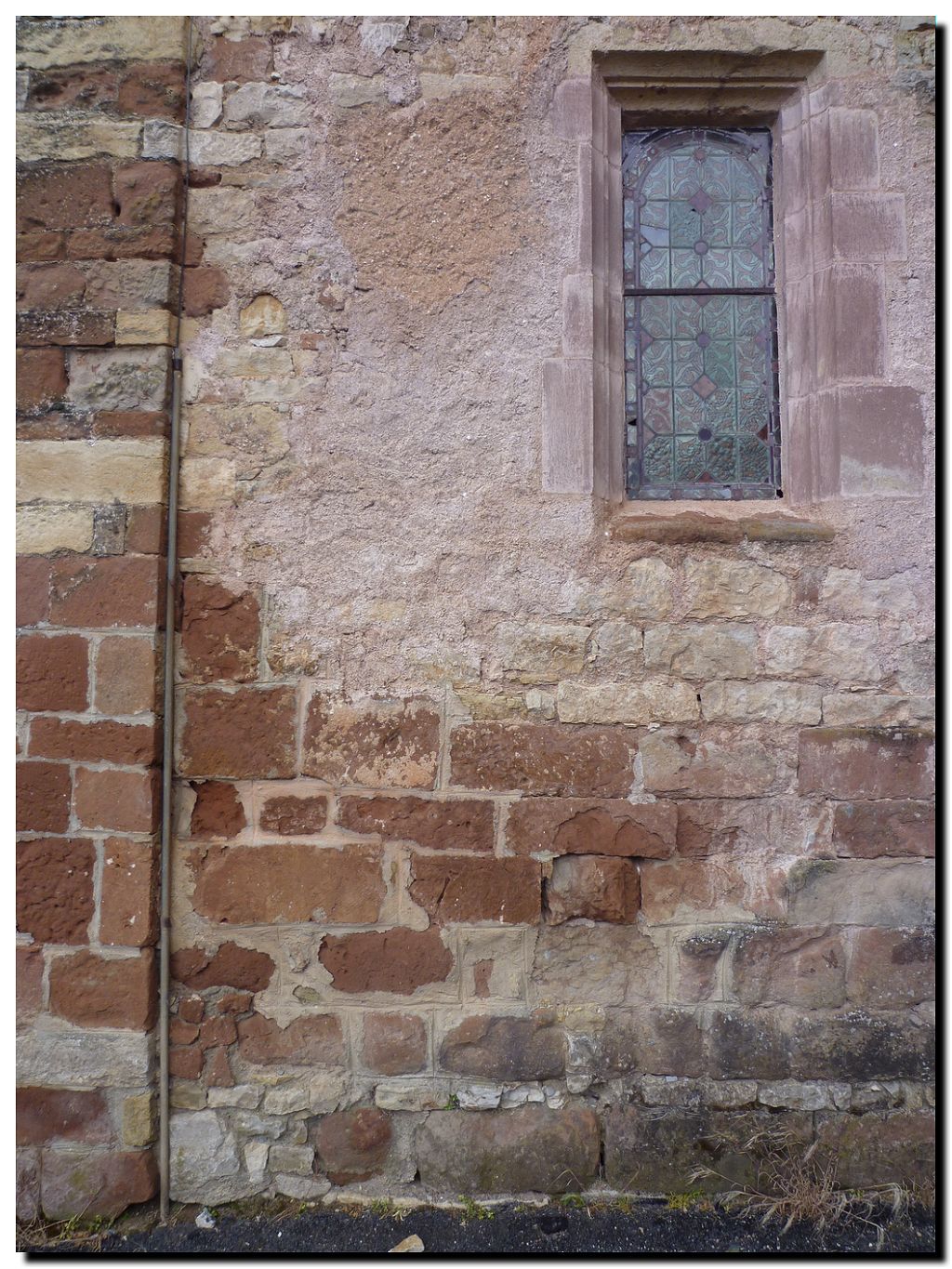
La rénovation
utilisera des pierres du viaduc de l'Ady, vers 1946-1947. Les nuances
de rose sont bien visibles.
Rodez,
Collège Royal


Ici aussi, la restauration ne peut cacher les
origines différentes des blocs

◄
Ce pont, construit vers 1950, utilise les pierres de Malakoff.
Retrouvez-le en images ICI
Hervé Vernhes est sculpteur,
peintre, poète, place des
Treize-Vents à Peyrusse-le-Roc pour ses séjours rouergats. Tous les
Aveyronnais, et bien d’autres, connaissent
quelques unes de ses œuvres. Pour n’en citer qu’une, à Aubrac, sur le
chemin de Saint-Jacques, la fresque monumentale est incontournable.
Mais
il y a plus. Hervé Vernhes reçoit en 1995 le prix Elie Cabrol, décerné
par la Société des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron. Elie Cabrol
était le fils du maître des forges François, et ne serait-ce que ce
lien avec notre Route du Fer, nous vous le communiquons avec plaisir.
Les hasards de rencontres nous ont également permis, non seulement une
rencontre avec l’artiste, mais une découverte : Hervé Vernhes a
sculpté le viaduc de l’Ady, ou plus exactement a utilisé les belles
pierres rouges du pont pour se les approprier et par une nouvelle
taille, leur donner une nouvelle vie, une vie d’artiste cette fois.
François Cabrol doit en être ravi !
Après sa démolition et reconversion en carrière, le sculpteur a
eu ainsi l’opportunité dans les années
1960, d’utiliser des blocs de Rougier pour les façonner à sa volonté.
Parmi eux, certains sont rouergats, et d’autres sont désormais à
plusieurs milliers de kilomètres, sur des rivages méditerranéens. Très
belle destinée de ces pierres. Pourraient-elles nous raconter leur vie
passée ? Leur première taille et pose dans un ouvrage d’art, les
deux millions de tonnes de minerai de fer qui les firent vibrer, leur
fin mouvementée, rejetées, puis leur nouvelle vie, à nouveau taillées,
sculptées, sous les doigts d’un
artiste ? En offrant ces images, c’est un peu cette histoire qui
se présente et émerge des brumes quelquefois bien épaisses de l’Ady.

 photographie JR
photographie JR
Hervé Vernhes,
sculptures
Ne manquez pas de faire un détour par www.herve-vernhes.fr,
un chemin de traverse remarquable sur cette Route.
Elles étaient
sculptées ou incorporées dans des ouvrages prestigieux. Mais les
pierres de l'Ady pouvaient rendre d'autres services. La -belle- grange
ci-dessus, réalisée avec soin, les utilise pour l'encadrement du porche
d'entrée, un plus architectural évident, colorant quelque peu la pierre
du Cantal. Un malheur a voulu que l'incendie détruise presque tout,
mais les murs résistent, et avec eux les pierres de Malakoff ! La
grange est située dans le département du Cantal.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Les
hommes du premier cercle...
Les visiteurs de septembre 2011 ont découvert des documents
inédits. Voici deux portraits qui comptent !
Joseph
Decazes
On sait que Elie Decazes, voir par exemple le
chapitre 7 correspondant, a très certainement "bénéficié" de
conseils éclairés pour son implantation rouergate. Son frère
Joseph, était préfet du Tarn. Sa formation d'ingénieur l'avait
rapproché d'un autre ingénieur, Robert Cabrol, de la même école,
Polytechnique, et ingénieur des ponts et chaussées à
Albi. Pour nous, c'est probablement cette rencontre, vers 1815,
qui amènera plus tard, en 1825-1826, Elie Decazes et François Cabrol,
les frères des précédents, à s'intéresser aux ressources du
causse...Ils étaient donc quatre pour promouvoir les ressources du
causse ! Les portraits de Joseph sont rares et ceux de Robert très très
rares (pour nous inconnus)...Voici Joseph Decazes. Il doit évidemment
exister d'autres portraits de
cette personnalité...Ce tableau, par Ginain, est
présenté dans le chapitre 7 et montre Joseph Decazes, jeune, dans sa tenue de préfet du Tarn. (DR, collection
particulière, infographie JR)
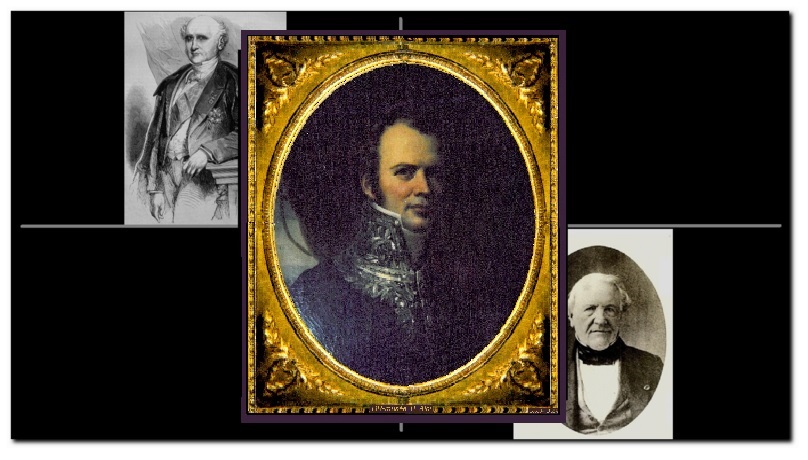
Le
comte Muraire
En
1804 Elie Decazes, ni comte, ni duc, était juge à Paris. Il va épouser
Mademoiselle Muraire, fille du premier président de la cour de de
cassation. Nous avons évoqué ce mariage et la disparition de Madame
Decazes après quelques mois de vie commune. Elie Decazes restera
veuf jusqu'en 1818 et son remariage avec Egédie de Sainte-Aulaire.
Le père de la première madame Decazes, Monsieur Honoré Muraire,
était une personnalité de Draguignan et fervent partisan de
Napoléon. Sa position de premier président sera pour Elie Decazes
un atout certain pour entreprendre une vie professionnelle de juge et
se retrouver au premier plan...
Les siècles passent, mais les portraits restent... Une gravure le
figurant dans ses attributions de président est présentée
ailleurs sur ce site. Dans le tableau suivant, de G. Cain, le
comte Muraire, un des premiers soutiens donc pour Elie
Decazes, regarde toujours l'avenir depuis les murs de la Cour de
cassation, galerie de la Première chambre. Il est possible de retrouver
Monsieur le comte sur bien d'autres peintures historiques de cette
époque, comme celle montrant l'empereur remettant les premières légions
d'honneur. Le manteau très particulier de premier président ne peut
passer inaperçu. Il en est de même dans quelques uns des
tableaux du sacre. Un premier président est toujours présent...(avec
nos remerciements au Secrétariat Général de la Cour de cassation )
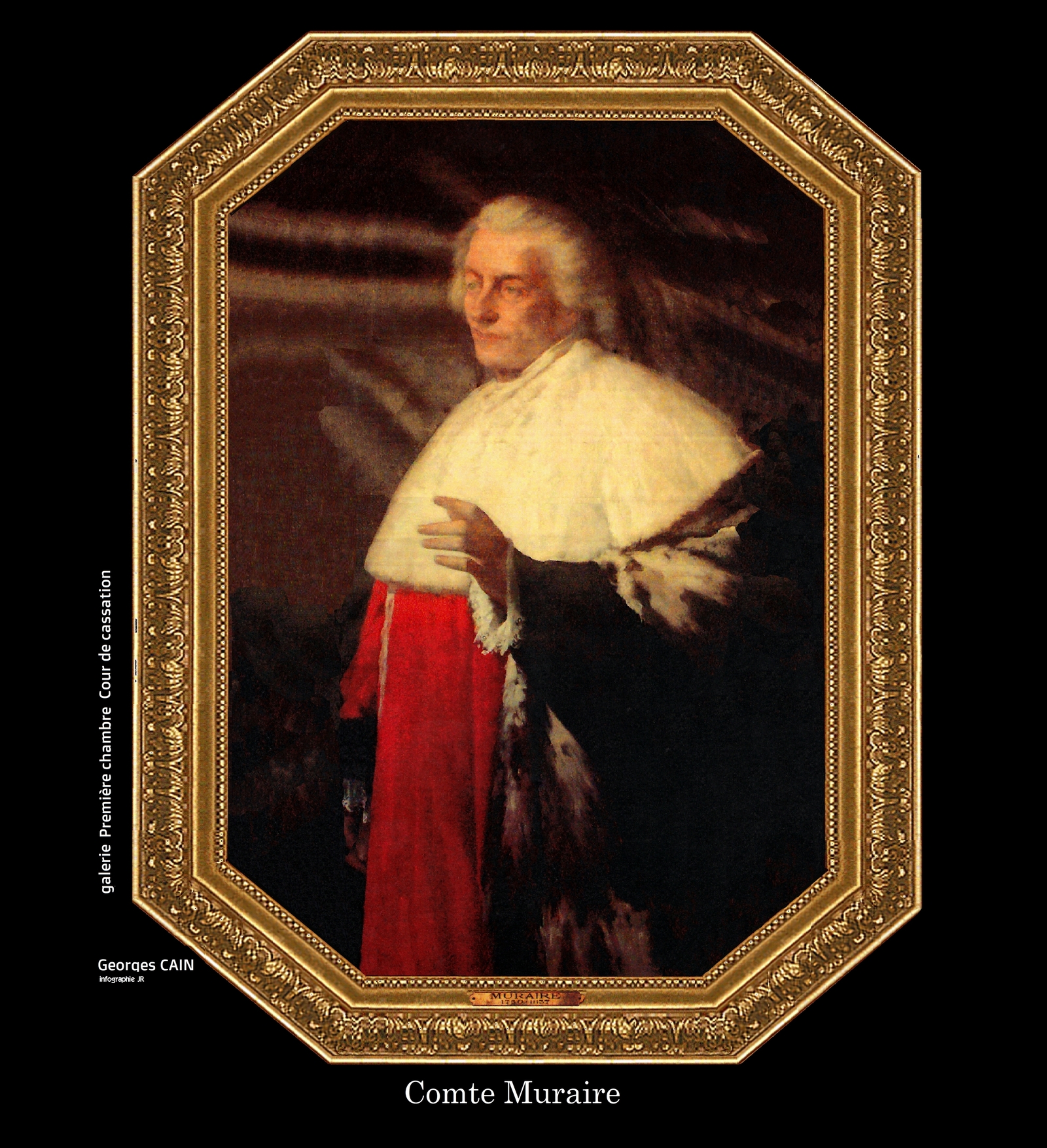 DR, Cour de
Cassation, Secrétaire Général
DR, Cour de
Cassation, Secrétaire Général
infographie Jean Rudelle
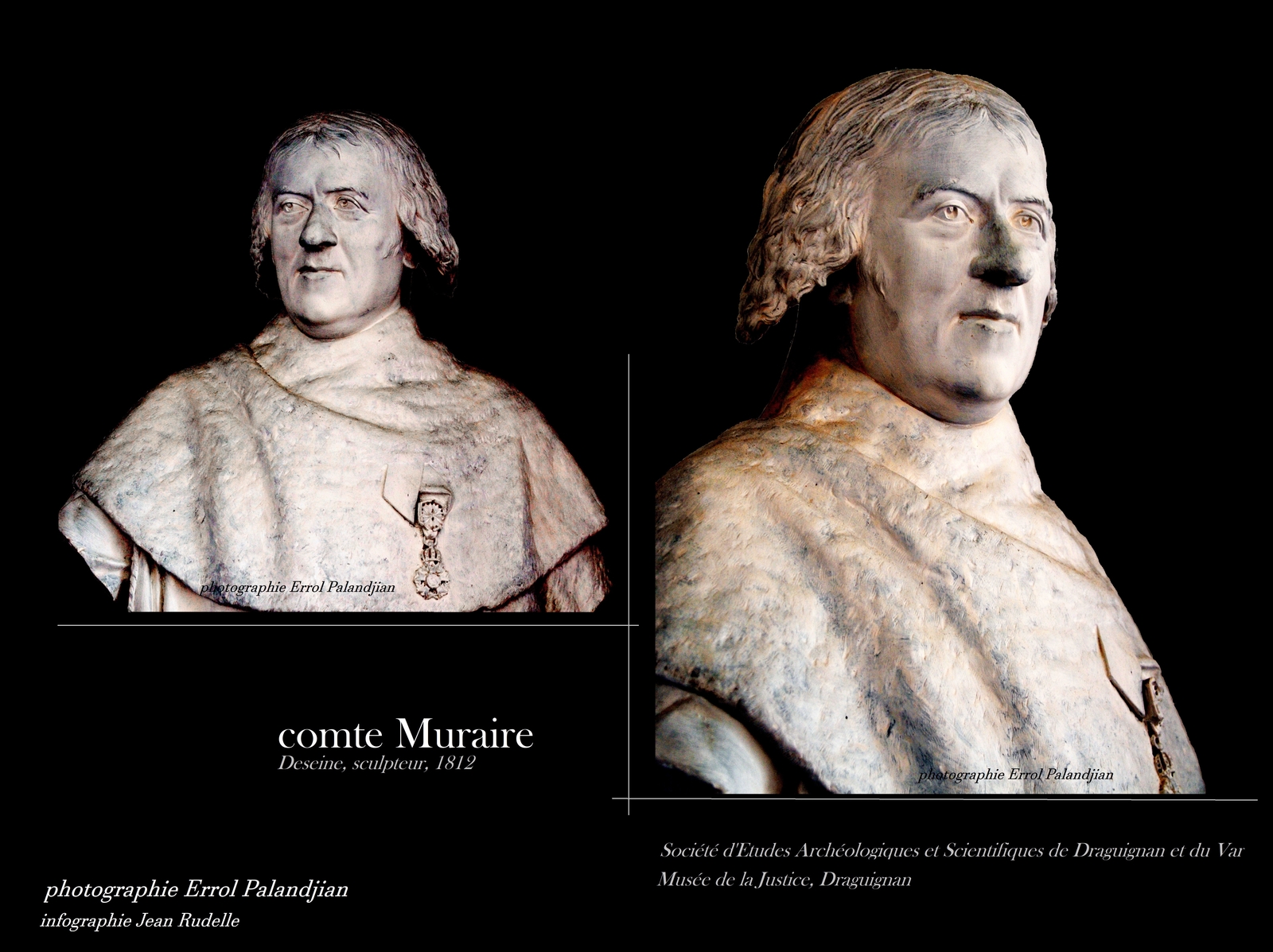
▲
Buste plâtre du comte Muraire, par Deseine, 1812. Une présentation plus
complète est faite ICI.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
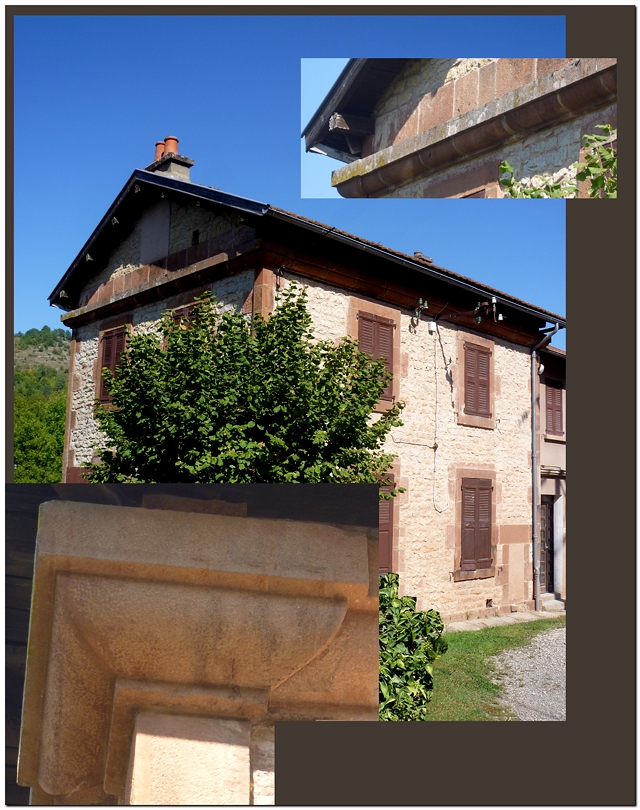 Les
Journées du Patrimoine sont souvent une occasion de mettre en
lumière des pépites architecturales. Il y a bien sûr de telles pépites
sur la Route du Fer. Voici par exemple un détail qui passe très
inaperçu. A quelques dizaines de mètres de la gare minière de
Marcillac, sur le site que les locaux connaissent sous le nom de plateau, ce qui montre bien l'usage
de dépôt qui fut le sien, on trouve cette maison. Rien de bien
particulier, et pourtant !
Les
Journées du Patrimoine sont souvent une occasion de mettre en
lumière des pépites architecturales. Il y a bien sûr de telles pépites
sur la Route du Fer. Voici par exemple un détail qui passe très
inaperçu. A quelques dizaines de mètres de la gare minière de
Marcillac, sur le site que les locaux connaissent sous le nom de plateau, ce qui montre bien l'usage
de dépôt qui fut le sien, on trouve cette maison. Rien de bien
particulier, et pourtant !
Son nom ? Pour certains, ils nous l'ont dit en
septembre 2011, c'est encore la gare
: on ne peut pas mieux conserver le souvenir de cette gare minière !
Elle a été modifiée, mais conserve
globalement son architecture d'origine, une solide bâtisse sans caractère comme
le précise le dictionnaire. Mais en levant les yeux, les encadrements
de fenêtres ne sont pas quelconques. Et encore moins le chaînage
supérieur, avec ses belles pierres d'angle. Le soin très particulier
apporté à une telle construction s'explique sans doute par son
emplacement, qui la rend très visible. Les constructeurs de la ligne
avaient de réelles préoccupations environnementales...
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Souvenirs, souvenirs...
Sur cette Route du Fer, il est encore possible de découvrir quelques
restes ferrés. La gare minière évoquée ci-dessus cessa, nous l'avons
souligné, ses activités dès la fin de la Grande Guerre. On imagine
évidemment que le démontage n'a pas tardé, plusieurs centaines de
tonnes de fer étant à récupérer, 326.348 kg exactement, hors bennes et
câbles ). Et si les wagonnets de l'aérien furent pour la plupart
évacués vers d'autres installations minières - mais quelques uns sont
bien ancrés dans le pays ! - le paysage conserve la trace d'éléments
divers. En voici deux, dont la provenance ne souffre d'aucune
contestation !

Ce câble pourrait passer pour un
bout de câble quelconque, ce qu'il n'est pas : c'est un câble clos. Ce type de câble était une
nouveauté au début du XX ème siècle, et fut employé sur l'installation
locale. Sa durabilité était bien supérieure à celle d'un câble normal,
et on sait que Richard, le concepteur parisien du chemin aérien local
avait proposé l'emploi de câbles porteurs clos, prenant même en compte
une partie du surcoût en diminuant de moitié ( ! ) ses
frais
d'honoraires. Exposé à toutes les intempéries possibles, le câble de la
photographie et de la coupe suivante, a probablement plus de cent
ans...et se trouve dans un état quasi-parfait ! Une démonstration
parfaite de l'intérêt de ce type de câbles. Un autre intérêt réside
dans sa surface extérieure lisse, favorisant le roulement. Le câble
clos devient rapidement très demandé et son utilisation est croissante
pour les transporteurs aériens utilisés par l'industrie minière.
La coupe ci-dessous montre ce câble clos, ici de 49
mm de diamètre. Son usage ? Peut-être le câble porteur
descendant, le plus chargé, de la mine vers Marcillac. Il se trouvait à
proximité de la
poulie qui suit, et sa présence ici n'est donc pas fortuite. C'est un
bel exercice de mécanique, avec ses 60 brins. Pour information, le
diamètre des câbles porteurs se trouve habituellement dans une
fourchette de 28 à 35 mm en se basant sur nos propres observations et
lectures. Un détail "accroche " : dans un courrier du 6 août
1907, le directeur de Decazeville, M. Jardel, contacte sa
direction générale de Paris pour donner les derniers détails du
projet du chemin aérien. Il donne un croquis de câble clos qui ne fait
apparaître qu'une rangée de fils profilés, et non deux comme sur cette
coupe. Ce câble fut pourtant d'usage minier dans les mines du
causse...Dans un de ses ouvrages, l'ASPIBD à Decazeville mentionne un
câble identique de 46 mm de diamètre comme étant le câble porteur
chargé du chemin aérien.

 ▲
En 1925, choix et variétés !
Pour
information, le câble clos est une invention anglaise, en 1884, de
Telford Clarence Batchelor
▲
En 1925, choix et variétés !
Pour
information, le câble clos est une invention anglaise, en 1884, de
Telford Clarence Batchelor
L'entreprise est toujours active en 2020

La poulie que montre le document suivant est
également une relique ! Très directement liée au chemin aérien, elle
permettait le passage d'un câble tracteur. Elle se montre ici après
avoir été montée dans un bâti qui n'est pas de l'époque de
l'aérien, les soudures en témoignent. S'il fallait une certitude, le
moyeu porte en lettres moulées, le nom de Richard-Mourraille,
constructeur de l'aérien. Son diamètre est de 45 cm et sa largeur hors
tout 5,5 cm. La gorge du câble laisse un passage intérieur de 40
mm, donc inadapté pour le câble clos précédent -qui n'était pas mobile-
mais adapté pour un
câble de traction ou le câble porteur de retour. Elle fut récupérée en
1935 probablement à Jogues, là où était la station d'angle. Il y avait
aussi en ce lieu un atelier de réparation des matériels. On peut
remarquer également son blocage par une clavette sur l'axe rainuré.


Sur les étagères locales il est
possible de retrouver quelques autres pièces, comme l'appareil de
roulement suivant. Une poulie est absente, et on distingue sans
difficultés la marque de fabrique, J. Richard - Paris, sans Mourraille.
Le profil de la poulie, en V, montre un souci de minimiser les
frottements sur les câbles porteurs...L'ensemble est lourd ! (diamètre
poulie 34 cm).

Il y a aussi sur notre route quelques tiroirs, et dans ces tiroirs, la
mémoire d'un pays de mineurs, de vrais
mineurs ! Mineurs de fer, et mineurs ! Mineurs sur le causse, ce qui
n'est pas très connu... Leurs papiers professionnels prouvent bien
cette appartenance. Le carnet dont nous vous montrons quelques pages
est celui d'un conducteur
de Mondalazac. Le carnet, outre les données d'état-civil, porte
les tampons de présence, avec une lacune pour cause de mobilisation.
Figurent aussi les mentions de délivrance de charbon et de bois, un avantage acquis du mineur...
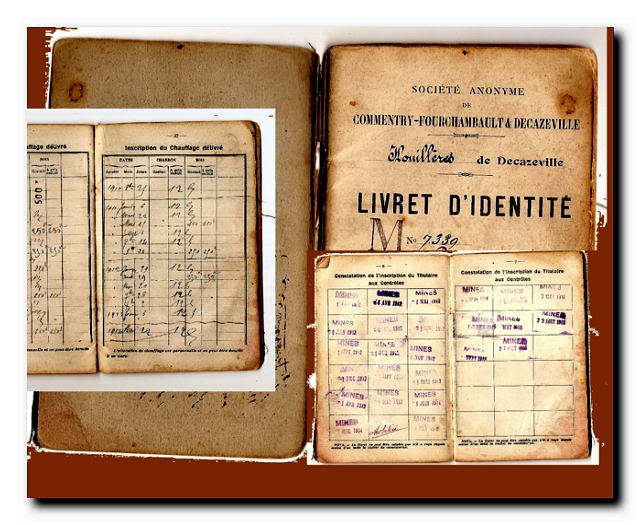
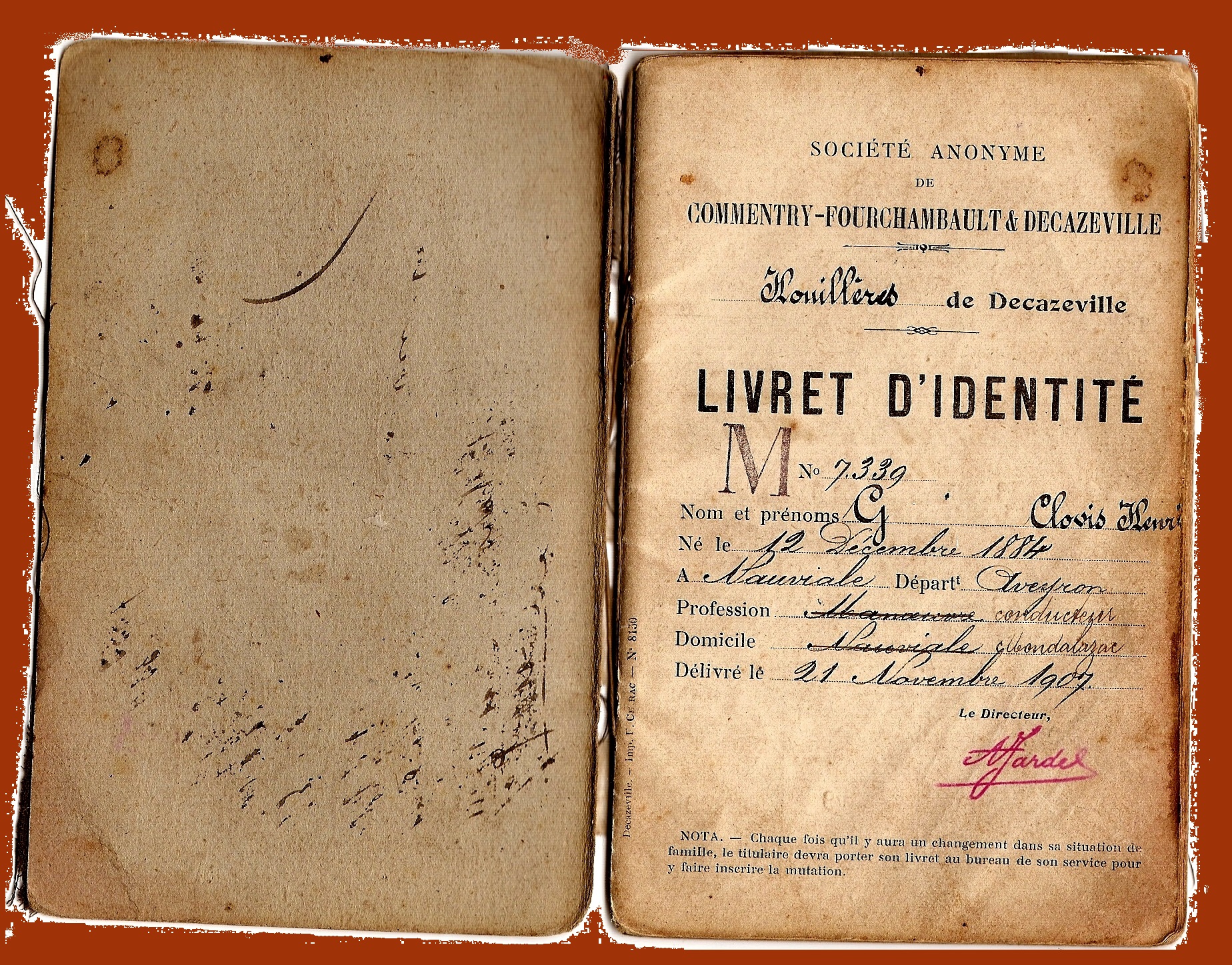
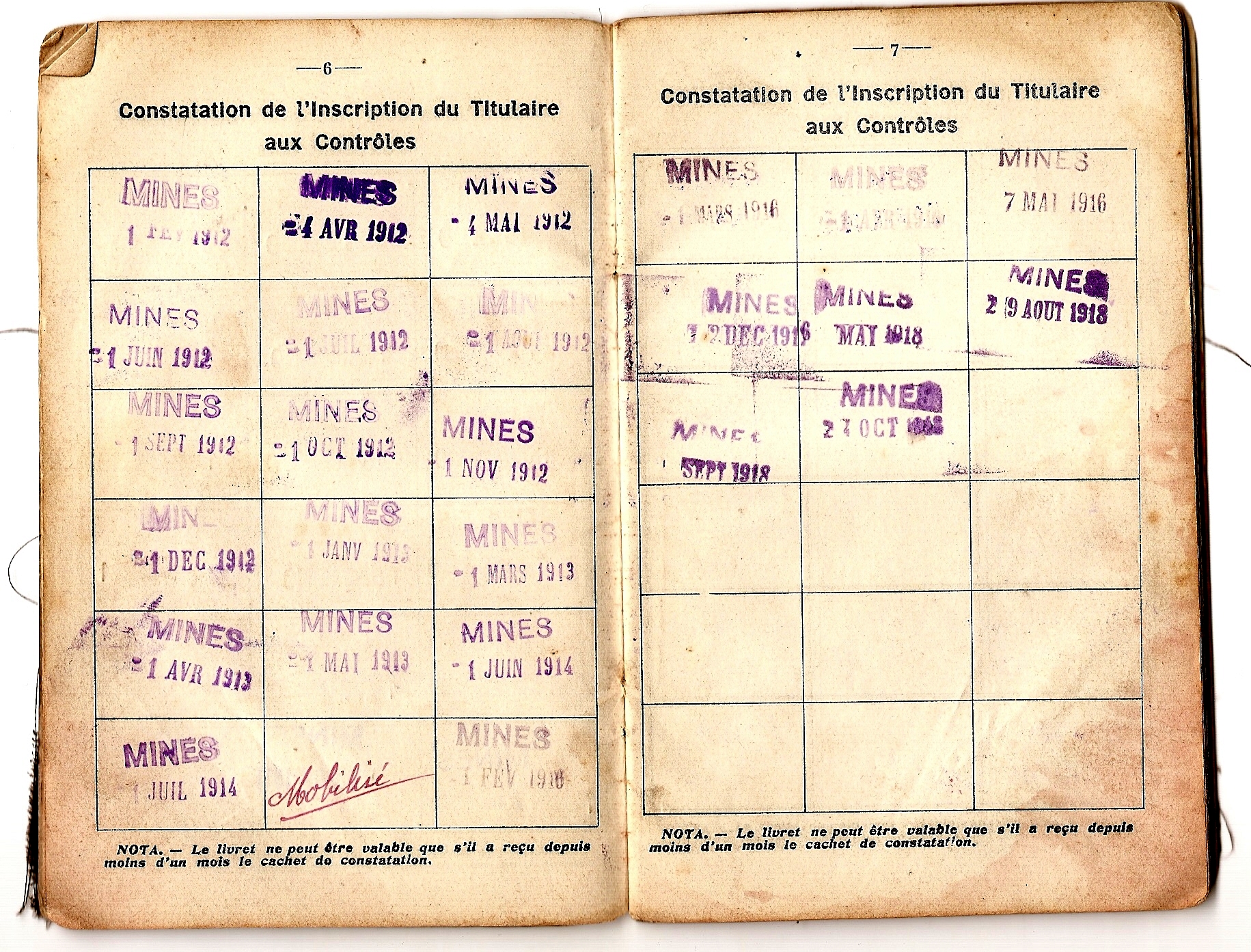
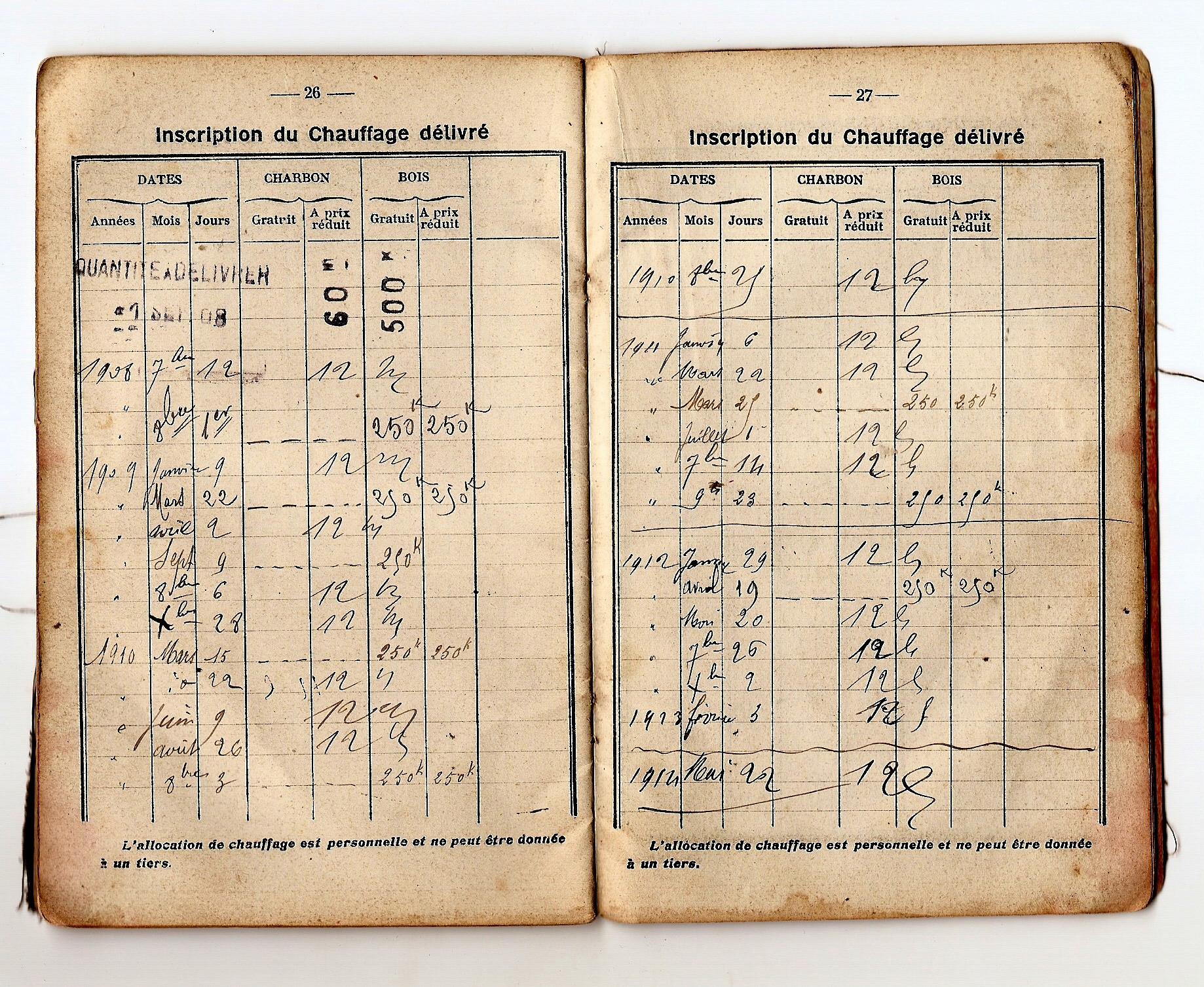

L'itinéraire
suivi par l'élément suivant est un peu curieux, mais pour son
propriétaire, on disait toujours dans la famille, " c'est un reste de l'aérien de Mondalazac", du chemin de fer
aérien du causse bien sûr. Donc aucun doute sur sa provenance. C'est
l'élément de structure auquel était attaché le wagonnet aérien, et le
présenter ici complète bien l'image précédente, puisque maintenant on
peut au moins par la pensée mettre l'équipage de roulettes, ici absent,
au bon endroit. Nous avons également grossi quelques détails : l'axe de
fixation des roulettes, celui de l'élément de prise de câble
tracteur, élément ici absent, mais que nous avons espoir de retrouver,
et le détail de la "main" de sécurité, qu'il fallait soulever avant de
pouvoir accéder à l'élément de verrouillage du wagonnet.
 ►
A savoir ! Cet élément de structure et son wagonnet sont en situation
de présentation au
musée
du patrimoine ASPIBD à Decazeville.
Une
longueur de câble clos est également présentée.
►
A savoir ! Cet élément de structure et son wagonnet sont en situation
de présentation au
musée
du patrimoine ASPIBD à Decazeville.
Une
longueur de câble clos est également présentée.
 me revient....
me revient....  me revient....
me revient.... 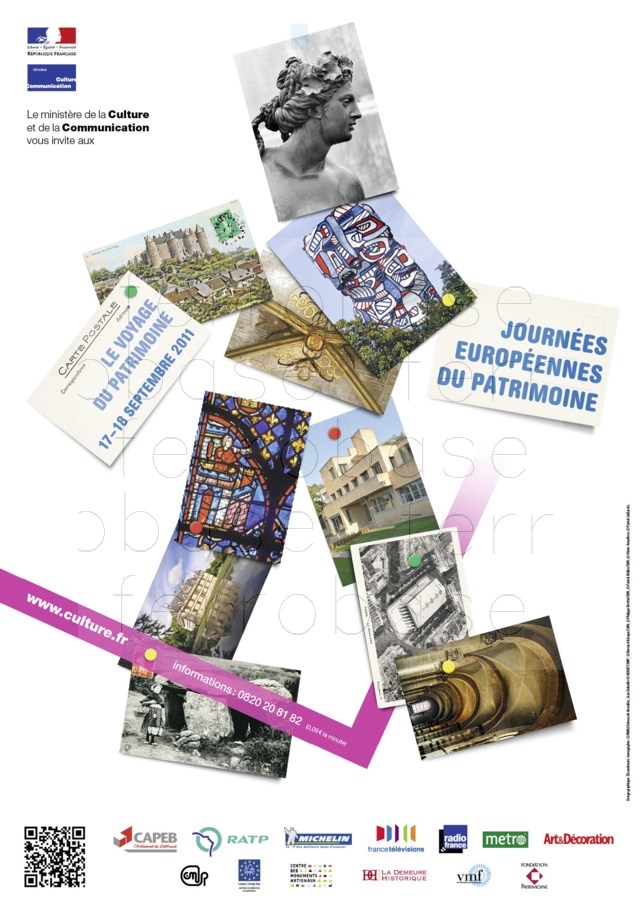
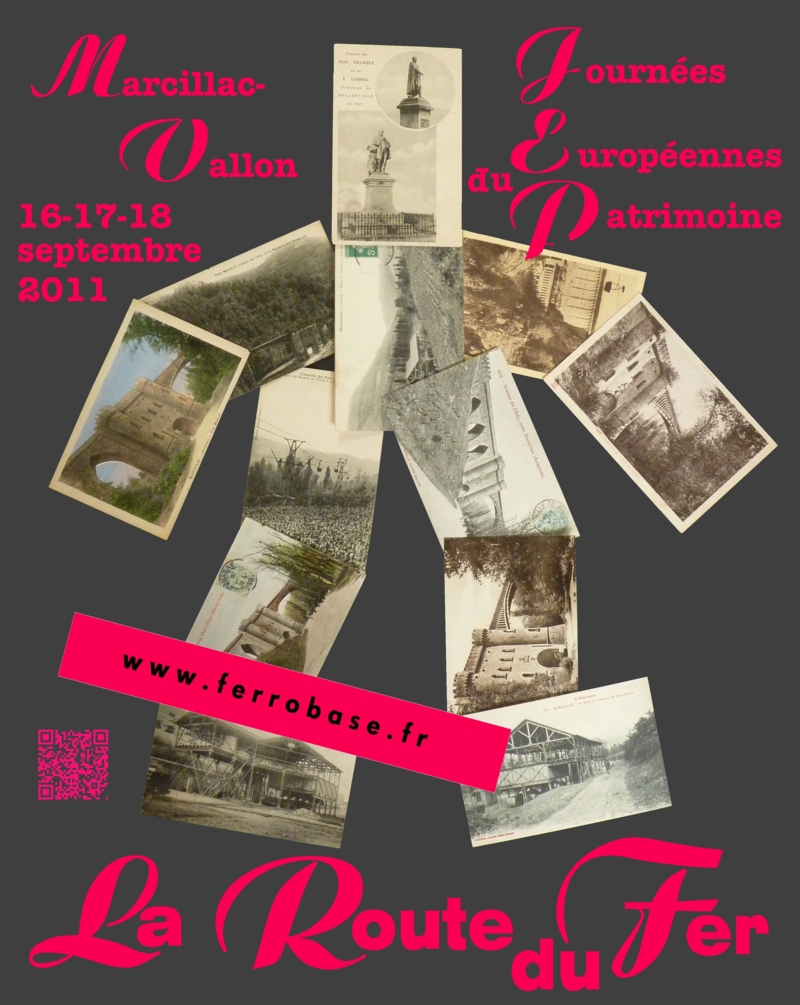
 Un taste vin
Un taste vin Le pont Malakoff, toujours vivant !
Le pont Malakoff, toujours vivant ! Hervé
Vernhes, sculpteur de Malakoff ?
Hervé
Vernhes, sculpteur de Malakoff ? Les hommes du Premier Cercle, Joseph Decazes, le comte
Muraire
Les hommes du Premier Cercle, Joseph Decazes, le comte
Muraire Quelques documents et restes ferrés
Quelques documents et restes ferrés



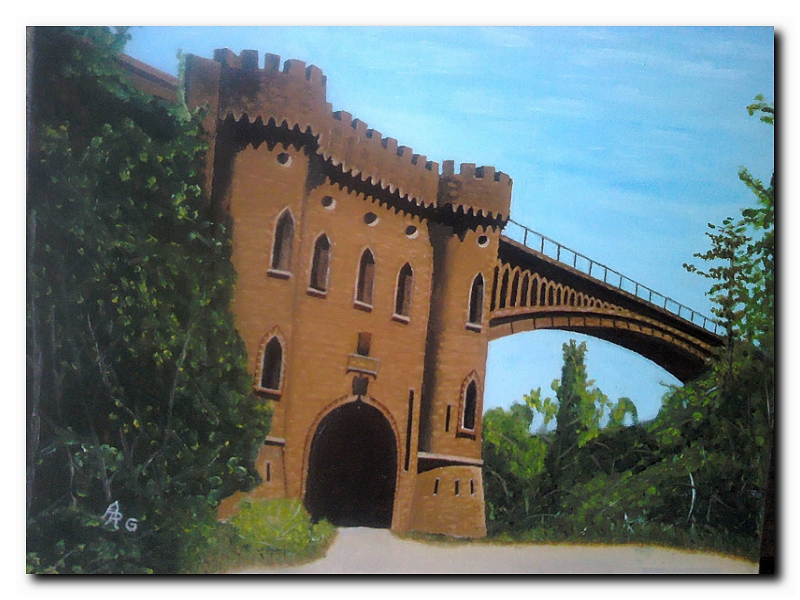

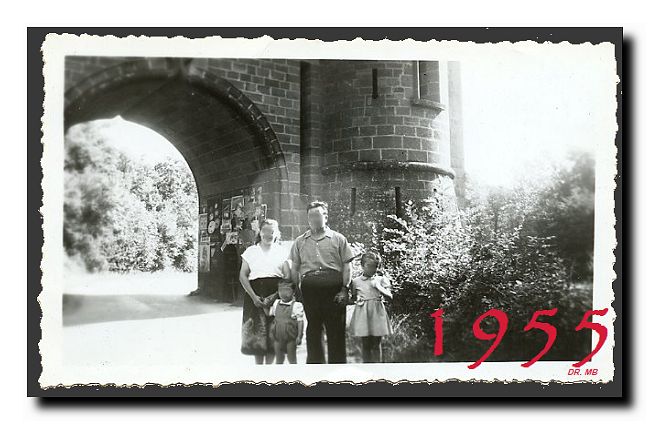





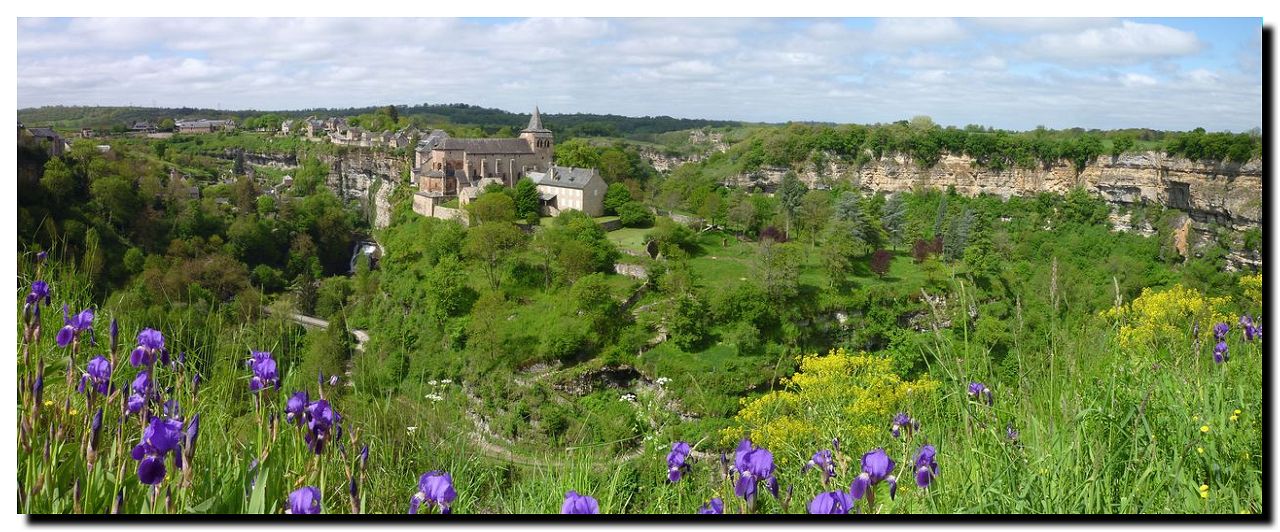

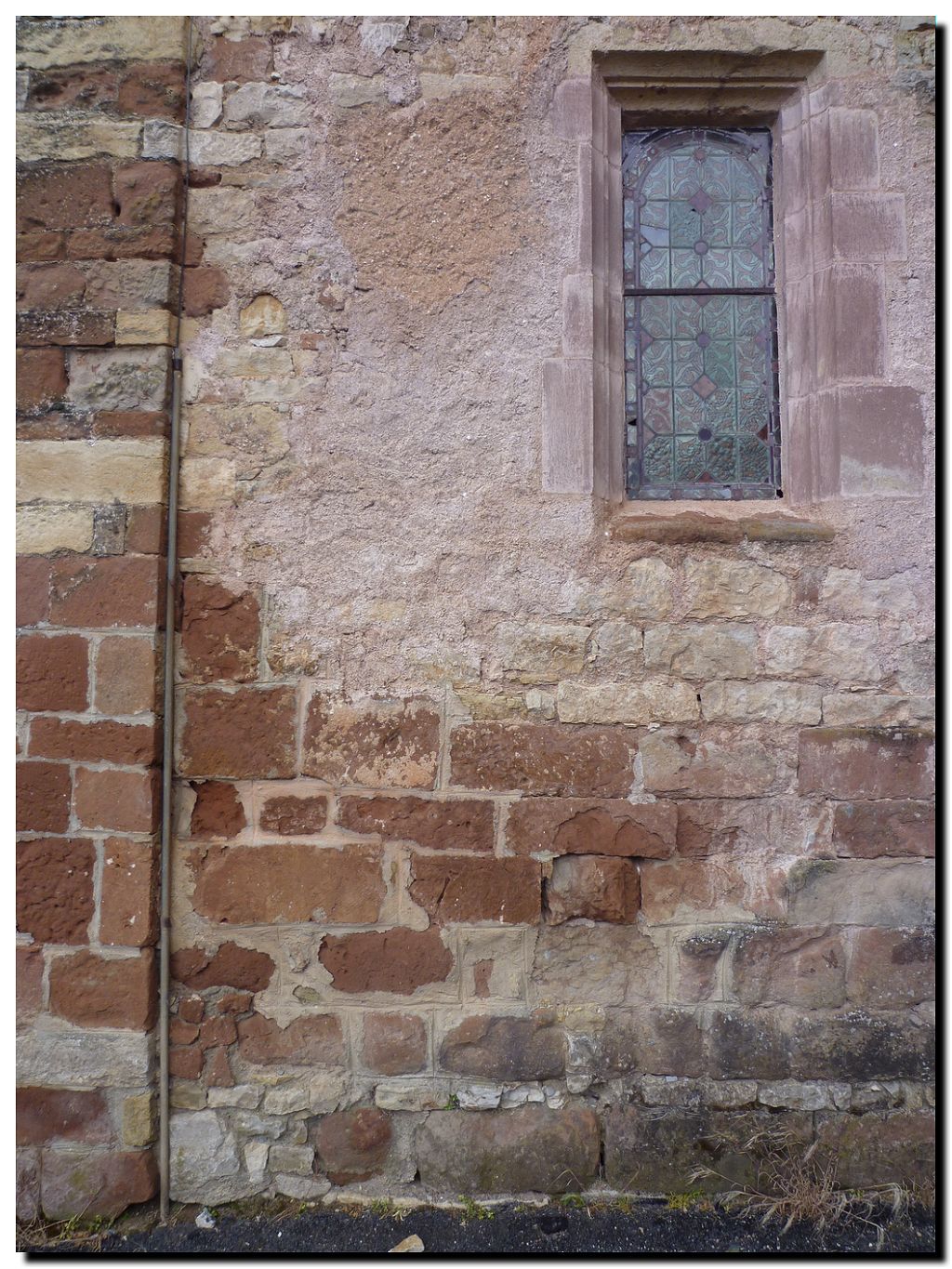




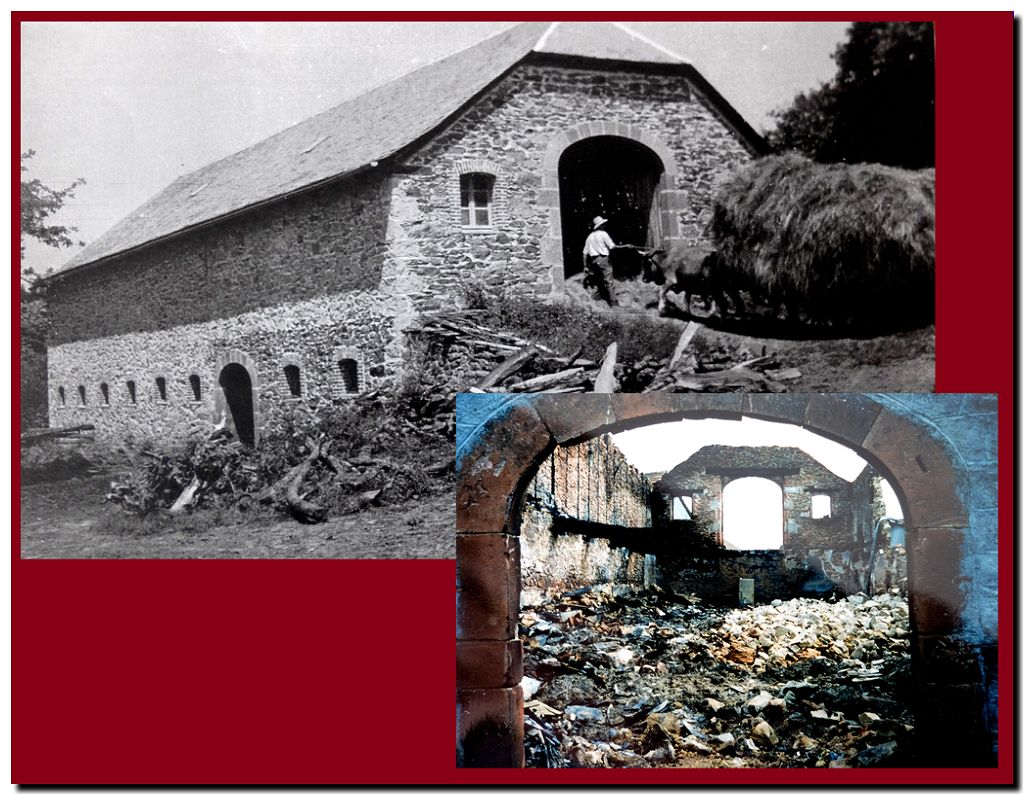

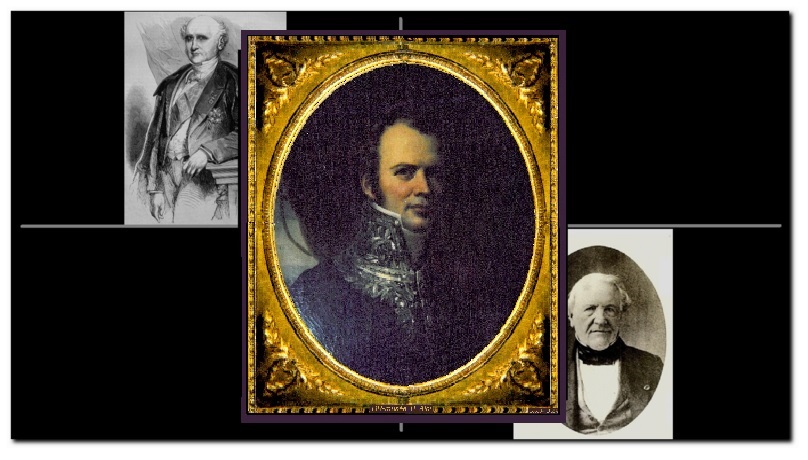
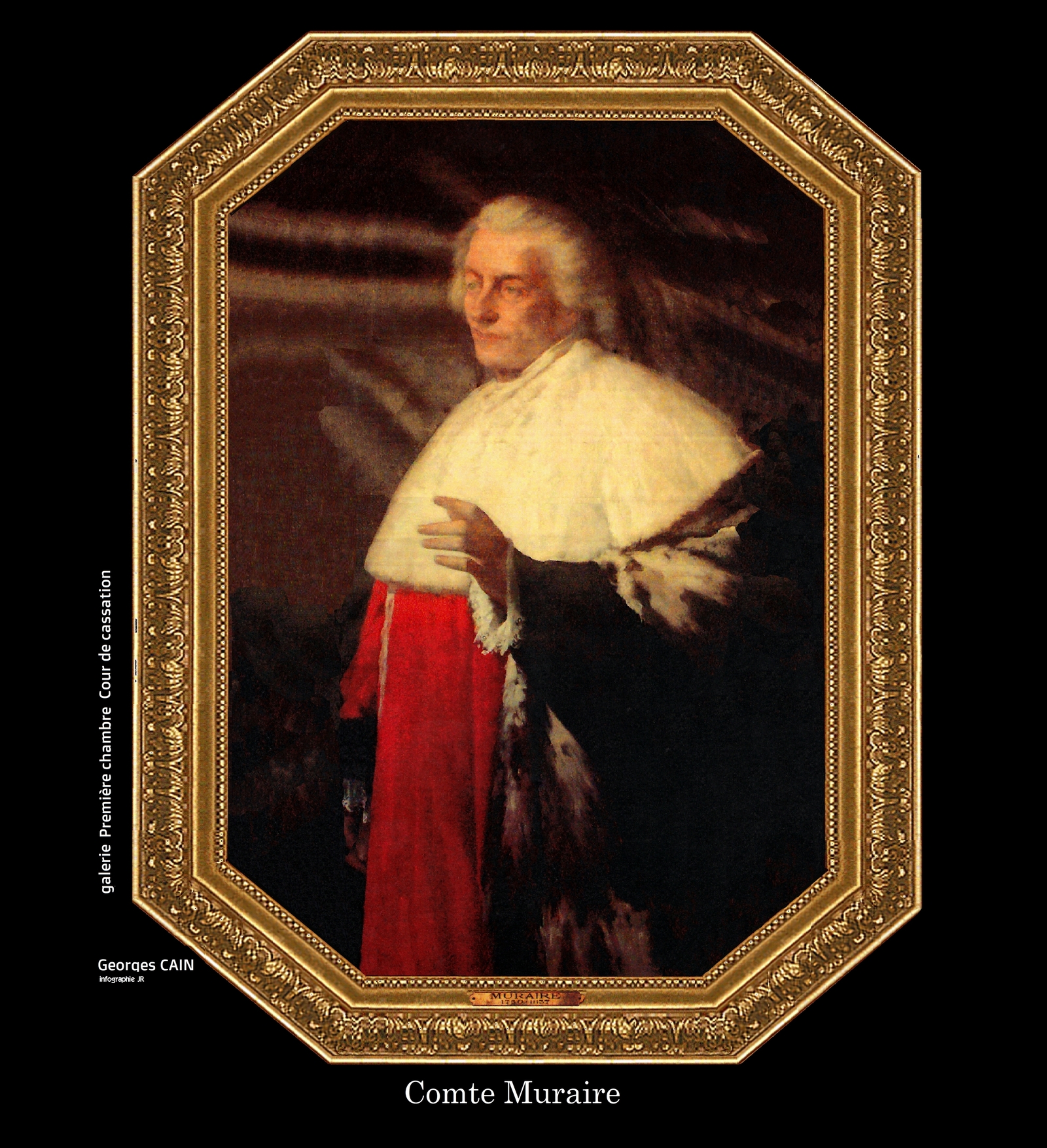
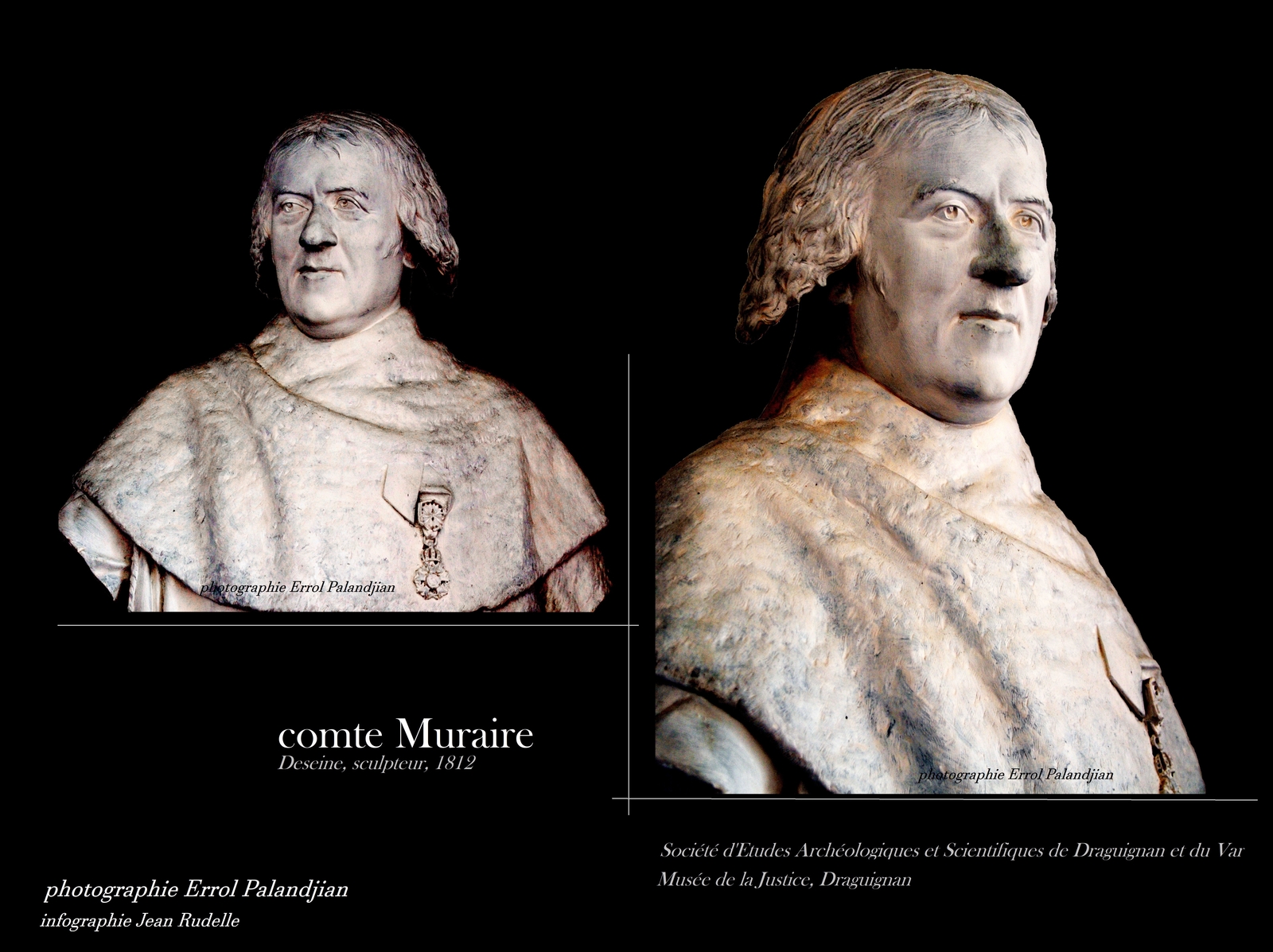
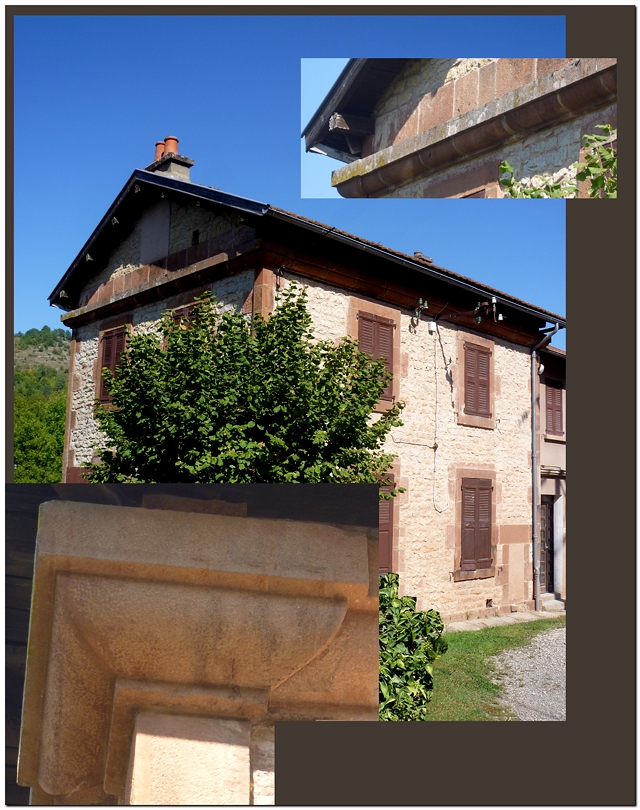 Les
Journées du Patrimoine sont souvent une occasion de mettre en
lumière des pépites architecturales. Il y a bien sûr de telles pépites
sur la Route du Fer. Voici par exemple un détail qui passe très
inaperçu. A quelques dizaines de mètres de la gare minière de
Marcillac, sur le site que les locaux connaissent sous le nom de plateau, ce qui montre bien l'usage
de dépôt qui fut le sien, on trouve cette maison. Rien de bien
particulier, et pourtant !
Les
Journées du Patrimoine sont souvent une occasion de mettre en
lumière des pépites architecturales. Il y a bien sûr de telles pépites
sur la Route du Fer. Voici par exemple un détail qui passe très
inaperçu. A quelques dizaines de mètres de la gare minière de
Marcillac, sur le site que les locaux connaissent sous le nom de plateau, ce qui montre bien l'usage
de dépôt qui fut le sien, on trouve cette maison. Rien de bien
particulier, et pourtant !