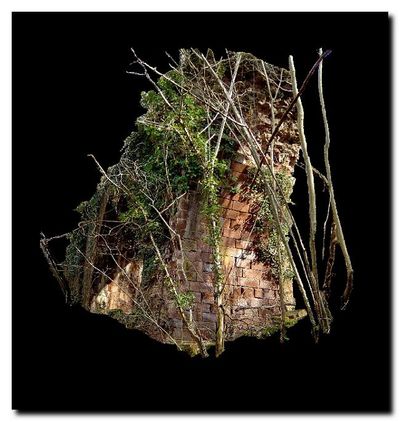 ◄
Malakoff
◄
Malakoffretour page menu
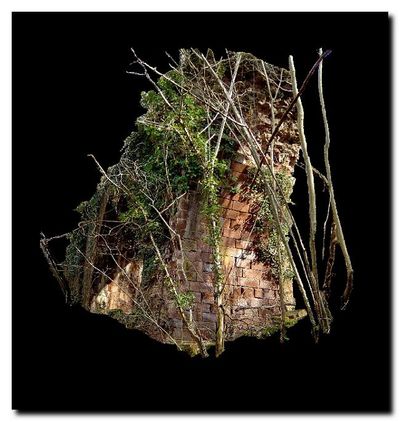 ◄
Malakoff
◄
Malakoff
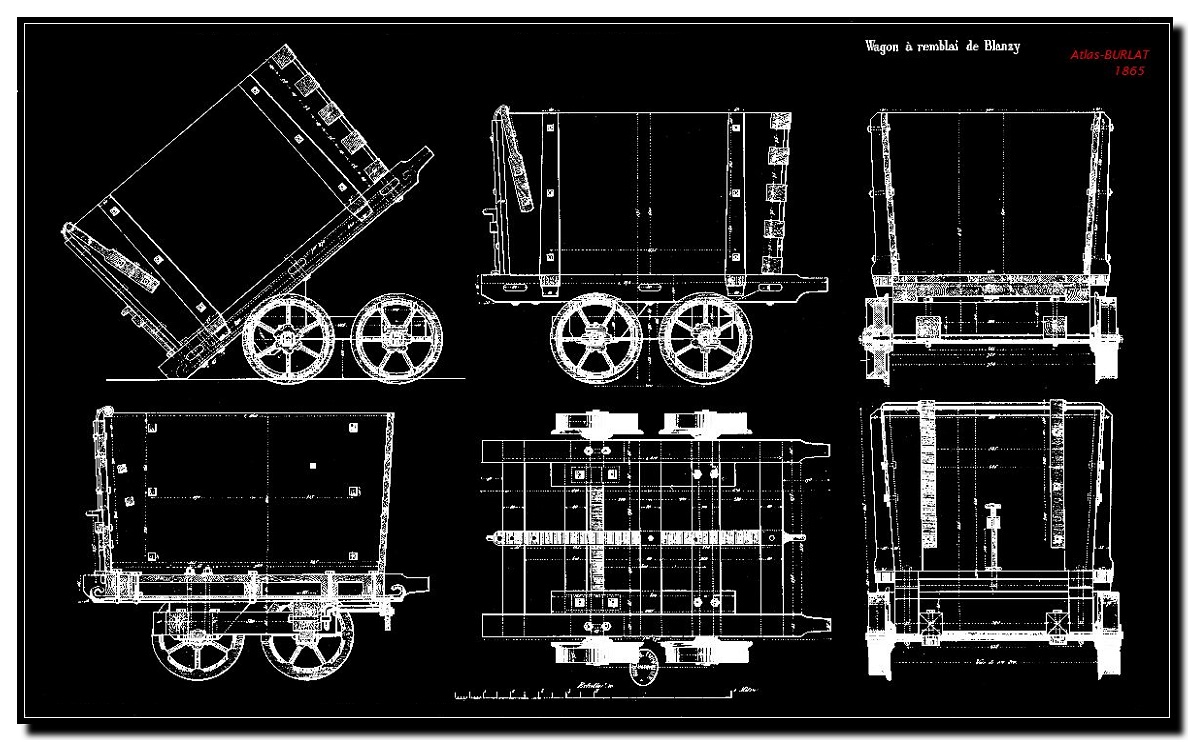
Ce chapitre vous propose de faire le point sur l’itinéraire Marcillac Firmy (orthographe de l’époque). C’est l’un des éléments essentiels de la Route du Fer, qui verra passer près de trois millions de tonnes de minerai de fer. Un élément de progrès également : les wagons vont donc remplacer à partir de 1856 les tombereaux sur les chemins et routes. Il n’y aura plus de conflits avec les autres utilisateurs, et l’entretien sera bien sûr plus aisé pour la collectivité. Si nous n’avons que peu de détails sur les premiers wagons, ceux de la fin du XIX ème siècle et des vingt premières années du suivant nous sont bien connus, par de nombreuses photos par exemple. Ils reprenaient une solution éprouvée dans les emprises minières. Les wagons spécialisés dans le transport de remblai avaient cette physionomie bien particulière. Un empattement très faible permet aux deux essieux très rapprochés de virer court, et d’être culbutés si besoin est sans trop de difficultés. Le dessin trapézoïdal de la caisse est à noter, ainsi que la porte arrière ouvrante. La planche de dessins date de 1854, Atlas des Houillères, par BURLAT. Nos wagons locaux avaient également un châssis robuste très semblable à celui de ces wagons. Un diaporama complète ce parcours, à voir chapitre 4. Des cartes sont présentées chapitre 8 et des compléments sont à retrouver chapitre 6. Le chapitre 10 présente des images virtuelles en relation avec ce chapitre et vous découvrirez en début du chapitre 13 tous les détails administratifs de la création de cette voie par François Cabrol.
un préambule : enquête de l'évêché de Rodez, 1860, réponses de l'abbé Cérès et du maire de Salles-la-Source. Ce sont des éléments très fragmentaires, mais ils témoignent de la situation de l'époque. On verra que le causse était ici très "industrialisé"...(communiqué par M. Falguières)
Une introduction : nous sommes voyageurs, à une époque que les moins de ......ans, et les autres, n'ont pas connue, en 1859.
En
1859, la ligne du Grand Central de Montauban au Lot, et ensuite du Lot
à St Christophe, puis, ultérieurement, de St Christophe à Rodez, vit
ses premières heures. Nous avons par ailleurs souligné son intérêt
d’aménagement du territoire, comme on ne le disait pas à cette
époque. Et à cette époque, parut un ouvrage de 300 pages,
dues à
un auteur anonyme ( ? ). Les auteurs semblent
être L. Oustry et C. Moins : Notice
historique et
descriptive du
chemin de fer de Montauban à Rodez, disponible sur Archive.org. On y trouvera avec
tous les détails souhaitables, l’histoire petite ou grande des lieux
traversés et la description technique de la ligne : pentes,
rampes, tunnels, ouvrages…Les ressources minières de Mondalazac sont
ainsi évoquées :
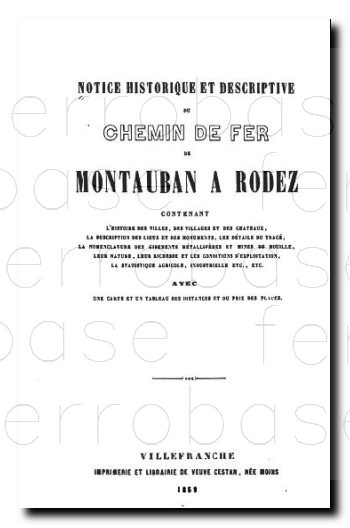
« A l'est d’Aubin se trouve le vaste plateau de formation jurassique, dit de Mondalazac. Il présente, presque à la surface une couche de minerais de fer à gangue calcaire dont la qualité est excellente. Le minerai de fer oolitique (orthographe originelle) de Mondalazac, dit Adolphe Boisse, forme une couche régulière exploitable sur une étendue d'au moins 8,000,000 de mètres carrés ; en prenant seulement 1 mètre pour l'épaisseur moyenne de la couche, en évaluant à 3,000 kilogrammes le poids du mètre cube de minerai, et à 20% son rendement, évaluation bien au-dessous de la vérité, on trouverait que la quantité de minerai comprise dans la portion de gîte connue n’est pas moindre de 24 000 000 000 de kilogrammes pouvant fournir 4 800 000 tonnes de fonte. »
La notice descriptive ne pouvait évidemment pas passer sous
silence la
voie de la compagnie de Decazeville reliant Firmy à Marcillac. C’est en
effet à St Christophe, que la voie minière pouvait le mieux être
aperçue depuis la voie normale, de l’autre coté de la vallée de l’Ady.
Voici cette description, assez succincte, mais un bon résumé de la
situation. Nous sommes dans le train, après Saint Christophe :
« la voie se tenant toujours sur la rive droite de la vallée, s’élève en rampe de 0,015, décrivant une série non interrompue de courbes, à cause des nombreux replis de l’escarpement. Depuis Saint-Christophe, au-dessous de la ligne sur laquelle nous voyageons, se développe parallèlement une voie ferrée construite par la Compagnie de Decazeville. Elle va de Marcillac à cette usine, en passant par Saint Christophe et Firmy. Sa longueur totale est de 21 kilomètres : savoir 5 de Marcillac à Saint Christophe, 12 de Saint Christophe à Firmy et 4 de Firmy à Decazeville. Elle sert à transporter à cette usine les minerais de Mondalazac et les autres matières premières qu’elle rencontre sur son parcours. Elle traverse 9 tunnels formant une longueur totale de 3 200 mètres ; celui de Marcillac en a 950 et celui de Riou Nègre 1 050. Elle a nécessité la construction de deux viaducs et d'un pont américain. Le premier viaduc placé à Marcillac est composé de 15 arches ; il a une longueur totale de 150 mètres. Le second est celui dit de Malakoff, que nous apercevons sur la gauche avant d'arriver à Marcillac. Les deux culées, construites en grès rouge affectent la forme de deux tours ; à l'intérieur règne un escalier qui permet de s'élever jusqu'à la plate-forme et qu’éclairent des meurtrières ; le sommet est couronné de mâchicoulis et de créneaux. L’arche principale a 44 mètres de longueur; elle repose sur deux immenses arcs de fer. Le tympan est en maçonnerie, affectant la forme d'ogives croisées qui donnent à l'ensemble un cachet féodal. La hauteur, au-dessus du torrent, est de 22 mètres. M. Cabrol, directeur de Decazeville, qui a donné les plans de ce viaduc, a voulu faire l'essai d'un nouveau mode de construction en combinant habilement le fer et la maçonnerie. Quant au nom, le peuple le lui a donné après la guerre de Crimée. La longueur totale du viaduc est de près de 150 mètres.
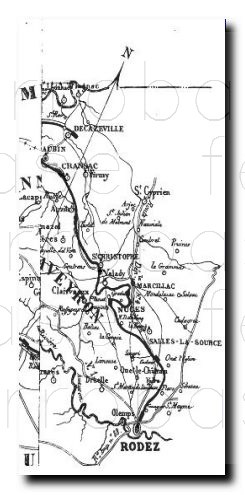
Près de Firmy, le chemin passe sur un pont américain composé de deux travées de 3 mètres. (Il est vraiment regrettable qu’une erreur d’impression surgisse ici ! Il s’agit vraisemblablement de 30 et non 3). La traction se fait au moyen de chevaux ; le maximum des rampes est de 0, 02 et le minimum des courbes de 100 mètres. »
L’ouvrage comporte une carte, malheureusement non dépliée lors de la numérisation. Mais fort heureusement c’est la partie très locale de Decazeville à Rodez qui est présentée. La voie normale est figurée jusqu’à Rodez : les trains n’allaient pas plus loin que Saint Christophe en 1859. La voie minière n’est pas représentée, et une erreur fait intervertir Mondalazac et Solsac. La voie de 1,10 m depuis la gare de Salles la Source vers Cadayrac n’est pas figurée.
Cette carte est présentée dans son intégralité, chapitre 8, sous le numéro 78.
Nous aurons bien sûr l’occasion de reprendre les principaux éléments de cette description. Pour compléter cet éclairage historique, il est essentiel d’avoir en tête le changement, pour ne pas dire le bouleversement industriel de cette époque. Il fallait encore, précise le voyageur anonyme, quatre heures de diligence en 1859 pour aller de Saint Christophe à Rodez !!! Un gros quart d’heure en 2008… C’est dire si le train était attendu : il divisera alors par quatre le temps de trajet.
En 1896, c'est à dire dans les années où les exploitations de Mondalazac et les transports via Marcillac vont s'intensifier, il fallait encore près d'une heure pour un trajet de St Christophe à Rodez, mais, c'est vrai, avec quelques arrêts. Extraits du Chaix d'octobre 1896, page 183 :
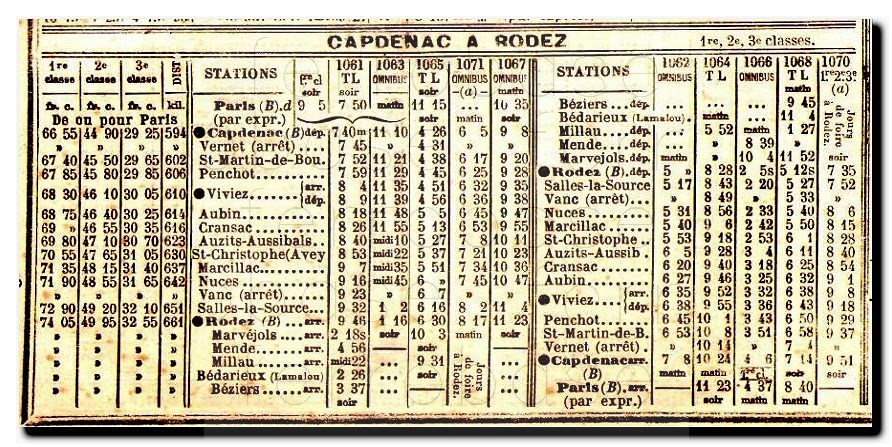
La construction des voies
ferrées atteint un rythme que nous trouverions ahurissant en 2008. Les
trois cartes du réseau national en 1850,1860 et 1870
témoignent
de cet effort : l’intérêt économique n’est pas le seul moteur
de
ces réalisations, mais la métamorphose du pays est en …voie !
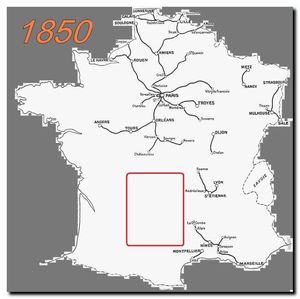
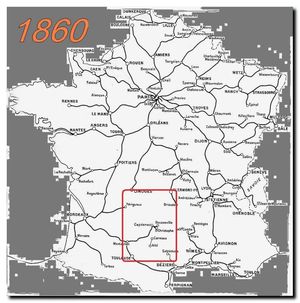
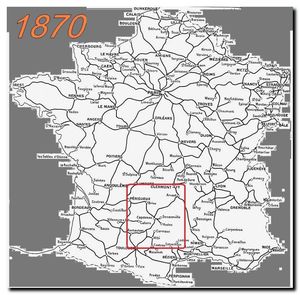
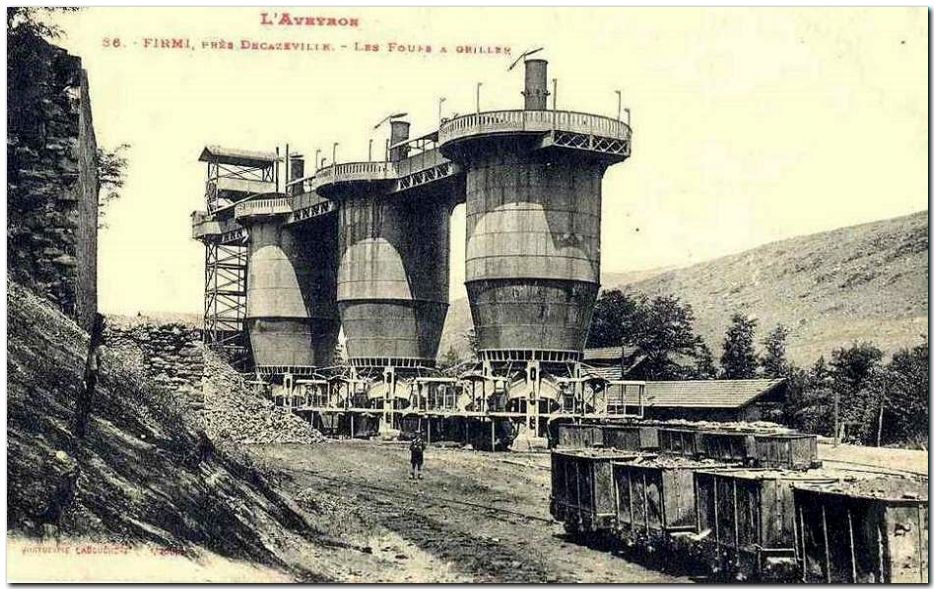
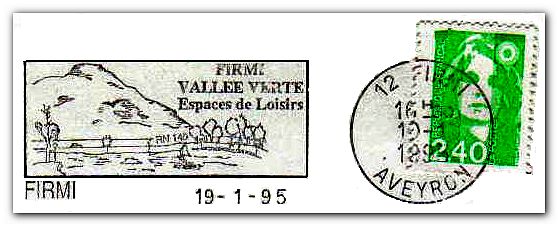
C’est dans les archives du Camt, sous les cotes 110 AQ, dossiers divers, 29 par exemple, que figurent l’essentiel des informations. Nous avons donné par ailleurs le texte de présentation de ces archives. Dans les données bibliographiques, nous mentionnons le texte d'Elie Cabrol, fils de François Cabrol. Ce texte, de 1894, présente essentiellement le viaduc de l’Ady, dit de Malakoff, et non l’ensemble de la voie ferrée de 66 cm qui reliait Firmy à Marcillac et plus tard à Mondalazac. Le parcours de Marcillac à Mondalazac, par la vallée du Cruou a été évoqué dans une autre page. Nous souhaitons ici donner quelques indications sur le parcours de Marcillac à Firmy, exclusivement. La justification de ce chemin ferré repose bien évidemment sur l’implantation des hauts fourneaux à Firmy et Decazeville. Rappelons que la première coulée date de 1828, à Noël, un évènement industriel et scientifique remarquable, juste après la messe de minuit : M. Cabrol et les habitants de Firmy furent conviés à cette première coulée… Ce fut le début de la fin pour les forges au bois, bois du Périgord en grande partie. En février 1829 le capital social de la Compagnie des Houillères et fonderies de l’Aveyron, créée en 1826, fut doublé par un doublement du nombre des actions : la foi était certaine dans l’avenir de l’entreprise. Les installations allaient très rapidement prendre de l’ampleur et La Salle devint en 1832 Decazeville, sur proposition de François Cabrol : le duc Decazes, initiateur du projet était bien sûr l’un des 24 membres actionnaires de la Compagnie, le plus illustre. Son parcours est décrit par ailleurs et nous n’y reviendrons pas. Le tiers des bénéfices de la Compagnie lui était réservé, en échange des nombreux apports qu'il faisait à la société. Il possédait 160 des 600 actions (voir ci dessous) primitives de la Compagnie, 27%, d'un nominal de 3000 fr chacune. En 1840, il en détiendra 849 sur 2400, étant l'actionnaire principal (près de 35%), avec 54 associés. Parmi eux, on trouvait un véritable "armorial" : noblesse, banque et armée. Il y avait par exemple le banquier Pillet-Will, actionnaire du premier groupe, qui sera vers 1840 à l'origine de la création de la compagnie du Paris Orléans. Ce sont des intérêts particuliers qui expliquent en partie le développement des activités industrielles et la présence du PO dans le cas présent.
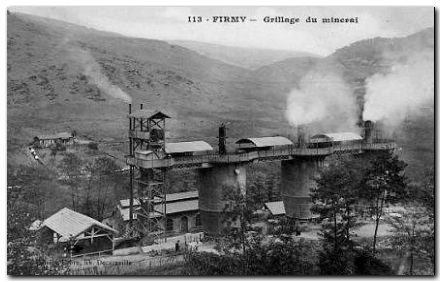
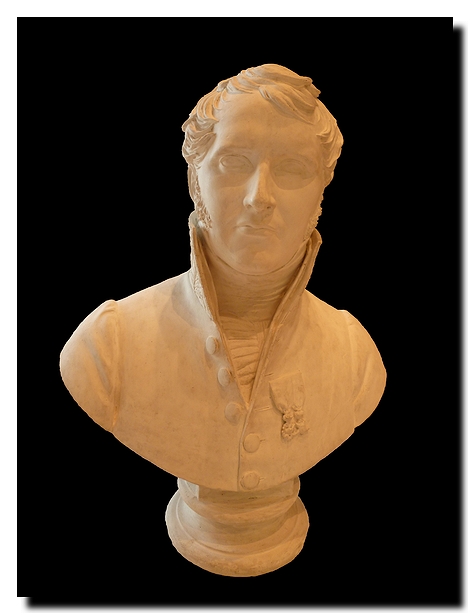
Il existe également deux, au moins deux, photographies "officielles" du duc, pratiquement jamais présentées...Le musée d'Orsay les présente. Faites par le photographe de renom Disdéri, elles montrent le même jour, le duc posant debout ou assis, canne et chapeau en main. A découvrir sur le web...
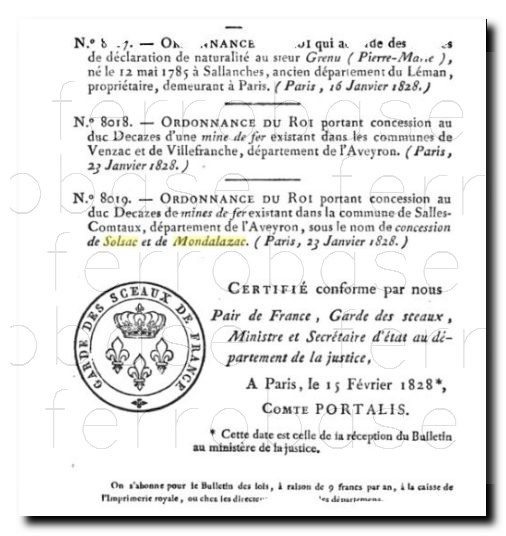
Bulletin
des Lois de 1828 : publication des mentions
des
concessions au duc Decazes des mines de fer de Veuzac, et
Villefranche, et pour celles qui nous concernent plus directement,
Solsac et Mondalazac, située sur la commune, précise le Bulletin,
de
Salles Comtaux. Salles Comtaux était la dénomination originelle de
Salles la Source.
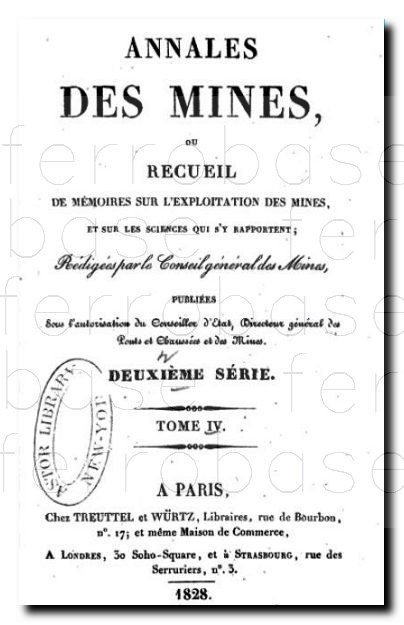
Les Annales des Mines de l'année 1828 donnaient également plusieurs autres concessions, quatre pour le mois de janvier 1828. Les en-têtes des textes sont donnés ci-après, ainsi que le texte complet de celle de Solzac (sic) et Mondalazac. On remarquera que les délimitations des concessions font appel à des éléments ....fragiles : angle de maison par exemple. Ordonnances du Roi, le Roi Charles à son cousin...
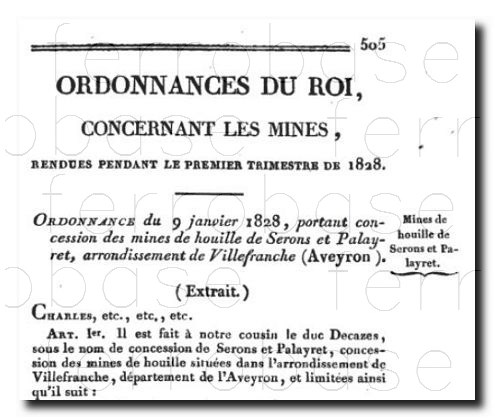
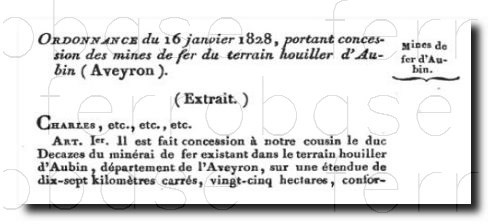
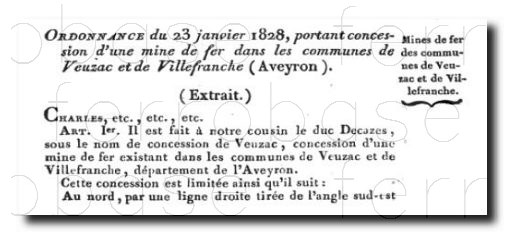
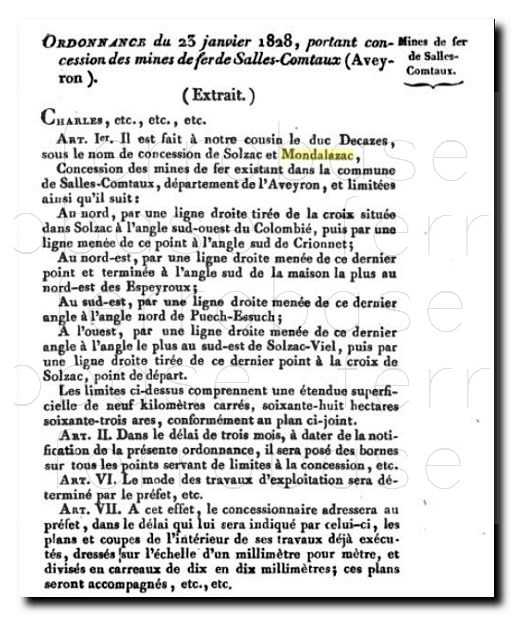
Et en février 1828, ce sera une nouvelle concession pour les mines du Kaymar, dont la ligne minière de Marcillac sera le débouché terminal avant Firmy, après un transport sur chemins.
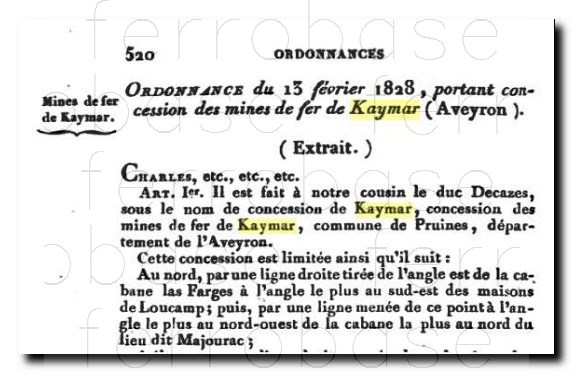
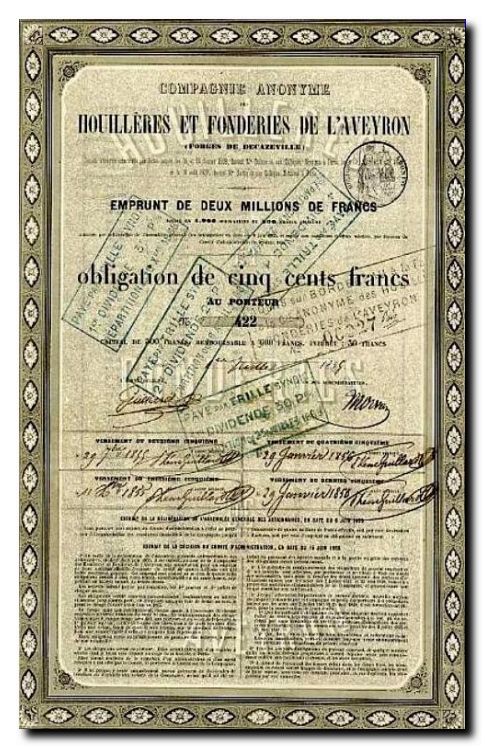
Sur cette ancienne carte postale, les deux grandes figures, Decazes en haut, Cabrol au dessous, fondateurs de Decazeville, sont réunies.
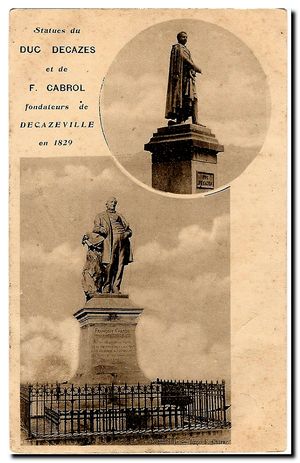
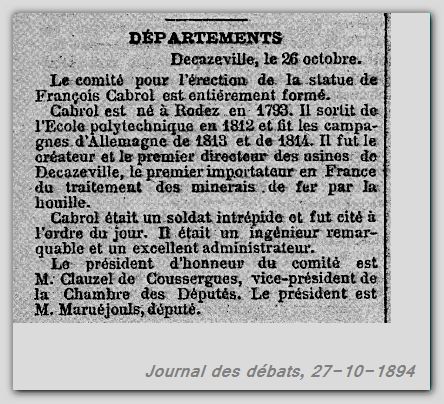
Sans commentaires supplémentaires, voici, publiée le
26 avril 1866, dans le journal La Presse, entre la vente
d'un grand hôtel et de ses écuries dans le
quartier des
Champs Elysées et celle de deux maisons à Passy, la
fin de la
première partie de cette histoire industrielle de Decazeville.
La
Société sera vendue. Aux enchères. Ce sera
une nouvelle page,
avec la societé nouvelle,
aux mains de Schneider du Creusot. Les
curieux auront noté le nom du directeur de la compagnie qui va
disparaître : Rouquayrol. Il a laissé son nom attaché au scaphandre
autonome développé avec un habitant d'Espalion, ville voisine,
Denayrouse.
Cela nous conduit tout droit au commandant Cousteau...Dans cette vente
figure évidemment la concession de Mondalazac et Solsac. Le terrain
de Bordeaux Bastide est situé sur les quais des Queyries,
dévolus à cette époque principalement aux charbons. Sur ces quais
existaient de nombreux transporteurs aériens de charbon...(voir page
carte)
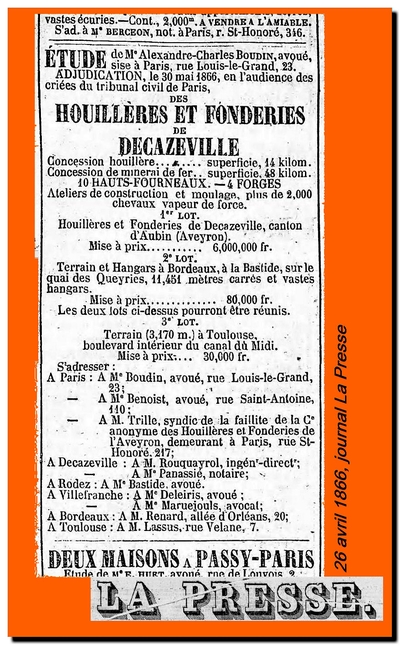
Une pause ! Prenez votre respiration et plongez en scaphandre autonome !
Nota : une page spéciale, consacrée à Benoît Rouquayrol est ICI
L’introduction
du minerai de Mondalazac dans les dosages des fontes
pour rails et son emploi pour la fabrication des fers de
qualité,
écrit Elie Cabrol, reconnu à ce point avantageux qu’on ait renoncé aux
fontes
et aux bois du Périgord, imposaient la nécessité de se le procurer en
grande
quantité et à bon marché. On ne le transportait
alors que par charrettes ; il fallait à tout prix
modifier
cette situation.
M.
Cabrol entreprit donc de construire un chemin
de fer à voie étroite, qui de Firmy irait d’abord jusqu’à
Marcillac et
plus tard monterait à Mondalazac.
Aussitôt
adopté, ce projet fut mis à exécution. Le coût total
de la
ligne sera de 2 037 656, 19 francs, et l'économie
réalisée pour la société est de l'ordre de 350 000 francs (in Levêque).
En quelques lignes et sans développements superflus, Elie Cabrol vient ainsi de justifier l’action de son père dans la genèse de ce chemin. Son utilité parait donc absolument évidente, et apparemment l’unanimité était réelle sur cet aménagement. En 1856, le viaduc de Malakoff, on y reviendra par la suite, et le pont Rouge à Marcillac étaient achevés. La voie du fer serait bientôt ouverte ; à nous de découvrir ce qu’il en reste, un peu plus de 150 ans après.

Avant de poursuivre, et pour situer ce chemin de fer
dans le contexte de Decazeville, nous vous proposons une lecture. Un
académicien s'est intéressé au bassin de
Decazeville, à l'Etablissement de Decazeville, comme il
est dit en 1875. C'est L.
Reynaud, économiste et membre de l'Institut. Le Journal des
Economistes publie en 1875 son rapport, fait à l'Académie
des Sciences
Morales et Politiques (lisible sur Gallica,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k378385.image.r=decazeville.f325.langFR,
pages 323 à 340). Au delà de la description minutieuse du
pays, faite
par L. Reynaud, la date nous semble être essentielle :
1875, après la reprise de la société fondatrice,
disparue on le sait par voie de justice, et après de le
décès du
nouveau repreneur M. Deseilligny, remplacé à cette date
par son frère.
Le rapport à l'Académie souligne les bases incertaines de
l'industrialisation dès 1828, mais se termine sur une vision
plus
positive de l'avenir en 1875.
Le
tracé
Pas trop de difficultés sur le tracé
de la voie. Cabrol conduisit le projet dans sa globalité, et la carte
IGN
actuelle, en 2008, au 1/25000 conserve l’intégralité de la trace. Il
s’agit des
coupures 2338 E et 2338O.
Nous n’avons pas la possibilité de présenter ici
gracieusement un
extrait de ces cartes. C’est évidemment préjudiciable à une bonne
illustration,
mais d’autres sources aussi fiables, mais un peu plus lointaines,
existent …Sur
les cartes actuelles, il n’y a aucune difficulté. Pour les curieux, on
peut par
exemple partir de St Christophe. Nous sommes
presque en milieu de parcours. Le
carrefour au centre du village sera le point de départ.
Coté Firmi,
l’alignement droit vers La Cayrède, au nord ouest ne laisse subsister
aucun
doute. A partir de ce point, il suffit de suivre le tracé ; il
traversera
la nationale 140, puis après une succession de tunnels, long ou petits,
parvient au Plateau d’Hymes. On continue tout droit, toujours Nord
Ouest, pour
ensuite descendre vers Firmi, par la rive droite de la vallée.
Repartons de St
Christophe vers Marcillac : cette fois, nous sommes direction
sud est et
le dessinateur a
parfaitement reporté
le tracé de la ligne et des remblais. Le passage au-dessus du ruisseau
de l’Ady
se fait par le viaduc, disparu, de l’Ady. On peut ensuite repérer sur
la carte
le tracé jusqu’au portail d’entrée du long tunnel qui mène à Marcillac. Ici, il faut repérer le
pont dit rouge sur
la D 901 vers Rodez. Ce pont est bien un des ouvrages de la voie. A sa
gauche
immédiate on distingue l’entrée du tunnel, et à droite, au pied de la
lettre M
de Marcillac, l’entrée
du dernier tunnel,
beaucoup plus court. Suivez l’alignement nord est
jusqu’à l’emplacement de la gare de déchargement des
wagonnets,
sur un chemin qui débouche sur la route D27, route
conduisant à Solsac. Vous êtes au terminus, ou au départ,
c’est
selon !
Au risque de se répéter et donc
à défaut de cartes IGN, nous vous proposons
la carte dite état major, celle déjà évoquée, type 1889. Le tracé que
nous
venons de décrire figure bien évidemment dans son intégralité. La carte
est à
l’échelle du 1/50000.
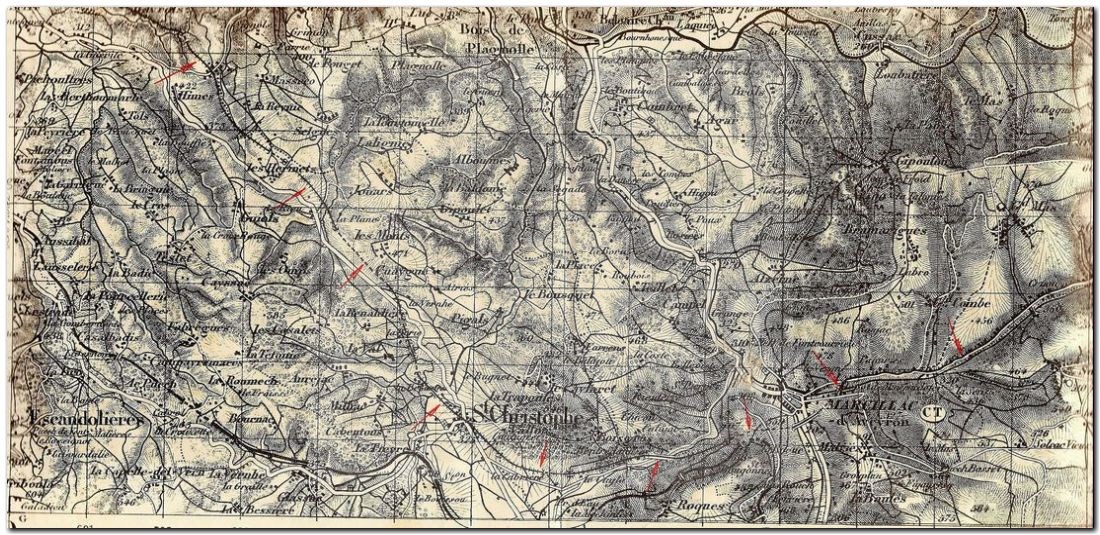
Dans
les
pages
relatives au chemin aérien, la continuation
du tracé au-delà de Marcillac, vers Mondalazac par la
vallée du Cruou, à
droite de la carte, a été évoquée.
Parmi les ouvrages d'art de la ligne figurent des tunnels. Voici les principaux. Les photographies sont accessibles dans les pages diaporamas. Les coordonnées des portails sont données en Lambert II étendu.
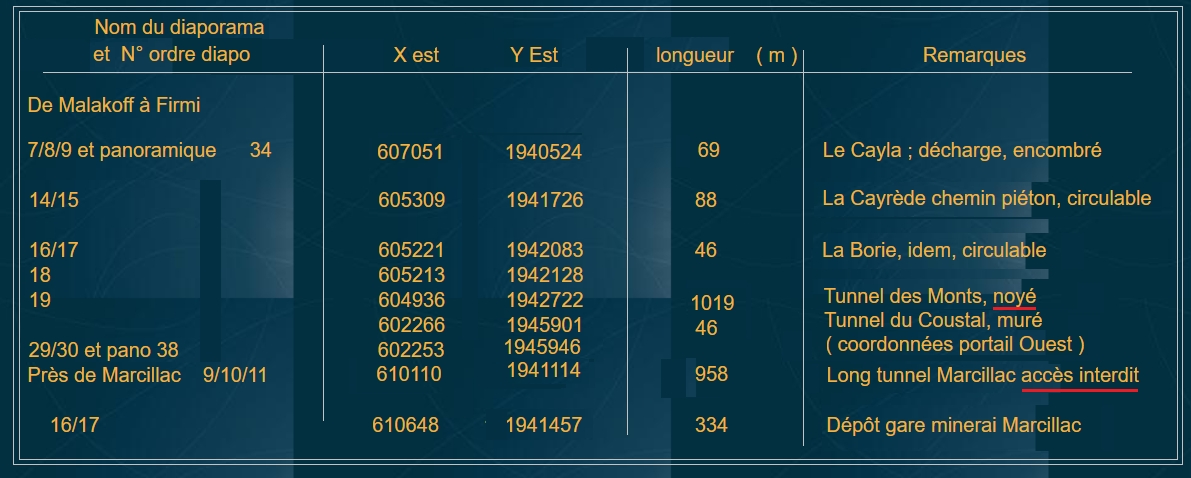
Remarques :
itinéraire piéton possible sur la presque totalité du
parcours,
mais passage dans propriétés privées
Carte IGN
2338 E 1/25000, et Geoportail IGN
Le
Cayla : pas circulable, décharge…
Les
Monts : complètement noyé, inaccessible
Long tunnel Marcillac : le bâti
en pierres n’existe qu’aux entrée et sortie ; le reste du tunnel
est d’un
gabarit plus étroit, à la limite des matériels roulants ;
accès
grillagé interdit portail est.
Dépôt gare de minerai ; les
portails sont dans
des propriétés privées ; seul le portail ouest, près du Pont
Rouge, est mis en
valeur.
Dans
l’ordre depuis Firmi : Coustal, les Hermets (non
photographié), Les Monts, La Borie, la Cayrède, Le Cayla, long
Marcillac, dépôt
minerai
Ces
données seront reprises et très enrichies dans les fiches spécialisées
du site ITFF, inventaire des
tunnels ferroviaires, qui consacre une page à cet
itinéraire: http://tunnels.free.fr/inventaire.htm
Pour mémoire, et surtout pour sa
richesse ( ! ) de détails,
à la
date de sa publication en 1954, la
carte de Us Army :
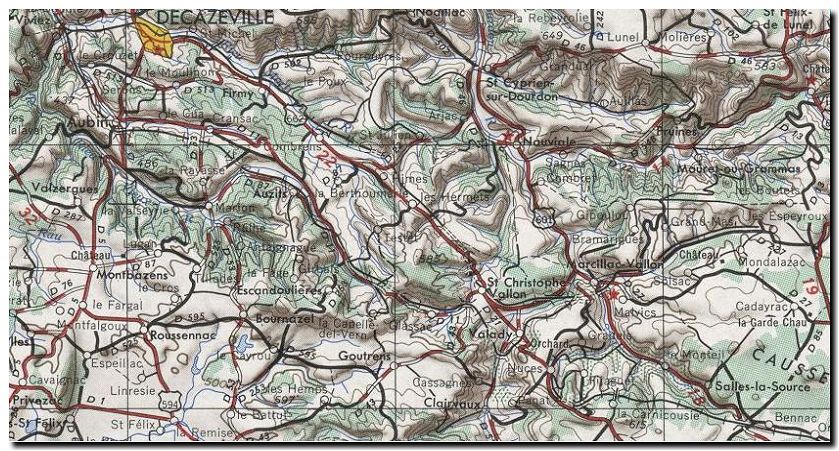
On
se reportera aux autres pages pour retrouver son analyse.
On peut également retrouver ce tracé sur des documents plus hexagonaux. La carte routière de Michelin, (voir page cartes) la toute première, n° 35, à l’échelle du 1/200 000, établie vers 1915 (1912 pour être précis) et vendue 1 Fr. :
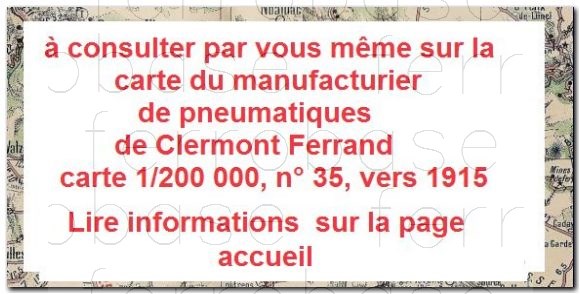
La couleur est évidemment un plus : l’embranchement de Viviez à Decazeville, à voie normale, précède le tronçon Decazeville, Firmi, avec son orthographe d’aujourd’hui où le i remplace le y final, St Christophe, le viaduc de Malakoff, bien répertorié, et Marcillac. Nous avons déjà examiné cette carte, pour le tracé du chemin aérien, tracé qui interpelle quelque peu sur la carte routière ….On constate également que le tronçon Marcillac Mondalazac, nom qui d’ailleurs ne figure pas, seule l’indication mines de fer est présente, n’est pas dessiné. Il ne s’agissait pas en effet d’un tramway sur route, car non accessible à des voyageurs, et seule catégorie qui existe dans la légende, avec les voies normales bien sûr, donc pas de tracé !
Les
points remarquables
Les ponts, viaduc et tunnels constituent les points remarquables de la ligne. On peut également évoquer la gare de Firmi, très repérable en bordure de route. Nous reviendrons à cet emplacement, pour une autre raison quelques lignes plus loin. En suivant le parcours Firmi Marcillac, il est possible de retrouver des passages hydrauliques sous remblais, des petits ponts. La route emprunte cet itinéraire. A la Briqueterie le pont de bois n’a laissé que des souvenirs à défaut de pouvoir en trouver une illustration, qui doit bien exister …Le tracé est parfaitement repérable sur Geoportail, en activant la couche carte IGN. A cet endroit, le raccord entre les deux cartes au 1/25000 semble des plus approximatifs. Après une petite courbe pour passer la vallée du riou vers La Coste, on arrive au Plateau d’Hymes. (doc ASPIBD)
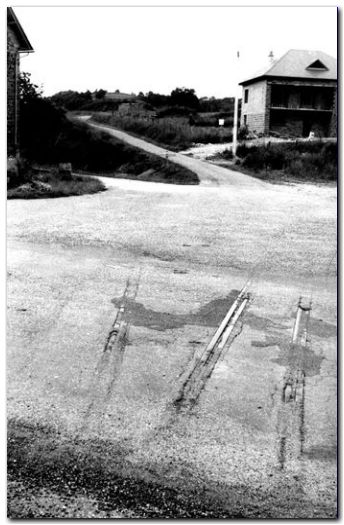
Et oui ! Il y avait quelques restes de voie, à la traversée de la D22, mais la cohabitation route fer était terminée depuis longtemps !
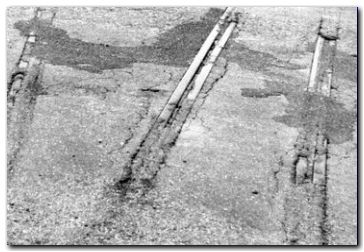
Vers St Christophe, il n’y a aucune difficulté, au moins sur la carte. Sur le terrain le passage des tunnels se fera en extérieur ! Un long tunnel débouche sur un secteur noyé, près du stade. La traversée de la nationale 140 permet ensuite un parcours plus évocateur vers St Christophe : succession de remblais, tunnels étroits, et remblais, le dernier à l’arrivée dans le village étant de belle taille.

Après
St Christophe, si le repérage ne pose toujours pas de difficultés sur
la carte,
le parcours in situ est plus délicat : succession de
propriétés
résidentielles, des tunnels quelquefois complètement murés et à
l’abandon, beaucoup de broussailles et autre verdure
en empruntant la vallée du ruisseau de l’Ady.
C’est là que se situait, presque en fond de vallée, un passage supérieur sur le ruisseau, par l’intermédiaire du viaduc de l’Ady, ou également dit viaduc de Malakoff ; les deux appellations perdurent, avec peut-être en 2008 une préférence pour l’évocation exotique. Cette appellation est donnée, dit-on, par l’architecture disons tourmentée que Cabrol donna au projet : les habitants venaient nombreux suivre les travaux, et comme on était dans les années 1855 et suivantes, et que la guerre de Crimée était d’actualité, la médiatisation forte de la prise de la Tour Malakoff conduisit les rouergats à faire la liaison…La guerre de Crimée et le nom de Malakoff sont en effet très liés : après environ un an de siège, le 8 septembre 1855, le général de Mac-Mahon s'empare, avec ses zouaves, de la tour Malakoff qui surplombe la citadelle de Sébastopol. Ce succès annonce la fin de la guerre. Les Russes se retirent de la citadelle, après l'avoir incendiée. Quelques mois plus tard, le tsar demande la paix. Le traité de Paris est signé le 30 mars 1856. On lira avec intérêt une analyse de cette présence du nom de Malakoff sur le site http://www.malakoff.fr/sites/web/fichier/prise_de_malakoff.pdf . Par exemple : Il y a des Malakoff ou des tours de Malakoff au fond de la France profonde, comme à Sivry - C o u rtry (Seine- et- Marne), à Toury- Lurcy (Nièvre), à Sermizelles (Yonne) et Saint-Amand-Montrond (Cher) ; mais aussi à Paris et Nantes, au Luxembourg, en Belgique à Dison et Hasard - Cheratte (près de Liège), en Allemagne à Cologne, Bochum et Hanovre, en Algérie à Oran et Alger, et – plus surprenant encore – au Brésil à Récif, en Australie à Moonee Valley et dans le Texas aux Etats-Unis d’Amérique ! Sans compter, bien sûr, l’originale : celle de Sébastopol en Russie. Et donc aussi, notre viaduc de François Cabrol.
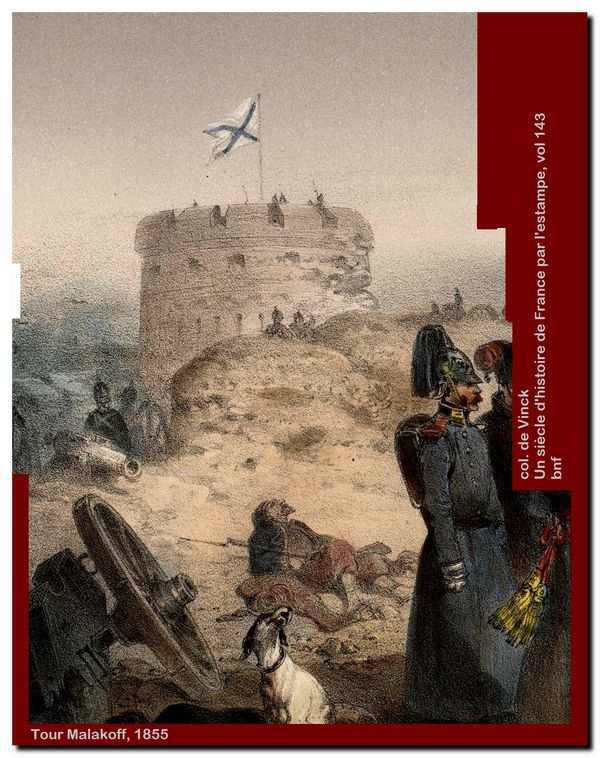
Largement médiatisée à l'époque, la tour Malakoff, du nom d'un militaire russe, impressionne, tout comme les piles du pont de François Cabrol. Alors, on lui donne le même nom, Malakoff. Pourtant la ressemblance n'est que lointaine. La gravure montre la vraie ( ? ) tour Malakoff, bien différente de l'ouvrage rouergat...Il est vrai que les dessins de l'époque, très nombreux sur l'épisode guerrier des zouaves, montrent très rarement pour ne pas dire presque jamais la tour elle même. Malakoff sera donc le nom populaire du pont, et ce sera plus tard le nom d'une commune...

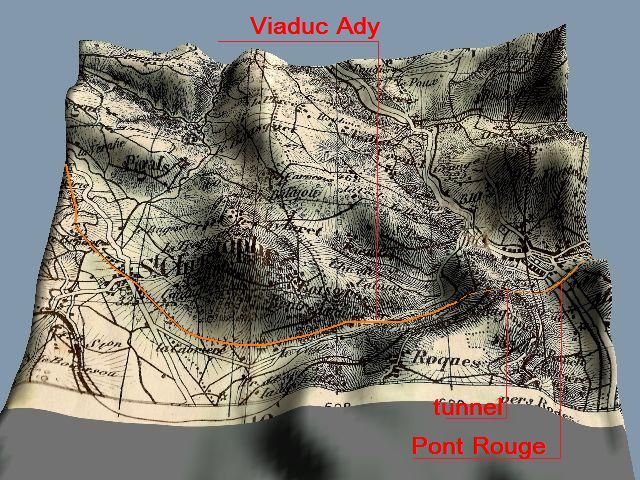

Beaucoup
a
été écrit et repris sur ce fameux ouvrage, et les sources d’information
sont
très accessibles. Dans cet ensemble, nous souhaitons seulement donner
la piste
peut-être pas la plus fiable, mais sûrement la plus concernée :
l’ouvrage que le
fils de François Cabrol, Elie
Cabrol,
publia en 1891, sous le titre Viaduc
de l’Ady, notice et description avec
une
belle héliogravure et des dessins dans le texte, Paris, imprimerie de
D.
Jouaust. Dans les pages à la une, on pourra trouver des
compléments d'information et autres illustrations de cet
ouvrage.
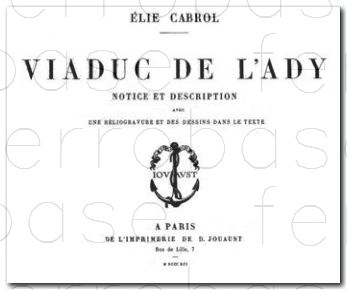
Ce document est librement
consultable sur
Cet ouvrage permet le franchissement du ruisseau de l'Ady et de la route Saint Christophe à Marcillac. Sur cet extrait de la carte de l'Atlas Cantonal de l'Aveyron (évoqué dans les pages relatives à la voie de 110), le site est en bas à gauche. La voie, qui partait de Firmi, avait à cette époque comme terminus le dépôt de minerai de Marcillac. La voie en accotement de route dans la vallée du Cruou ne viendra que plus tard.
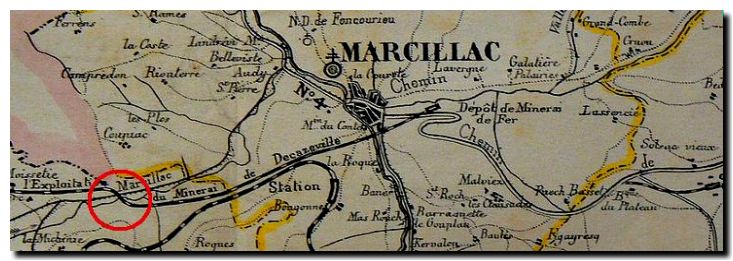
Ce viaduc est remarquable par son dessin, dû à F. Cabrol :
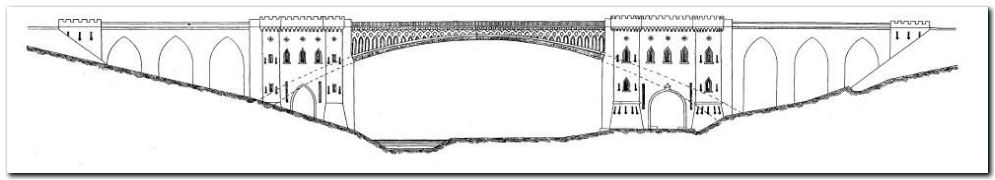
Les deux massifs ne sont pas identiques, et la route de la vallée passe bien sûr sous les tours de droite, rive gauche de l'Ady. On remarque la différence du nombre d'arches, rive droite, très étonnant pour un dessin attribué à François Cabrol ?? Pourquoi a-t-il envisagé cette architecture si peu en accord avec le site, les habitudes locales, le bassin houiller… ? La même interrogation est de mise pour les portails du long tunnel, près d’un kilomètre, qui suit vers Marcillac : ornementation identique, courbes et créneaux….Elie Cabrol ne fournit pas beaucoup d’explications, mais esquisse quelques raisons, qui nous semblent être davantage un soutien du fils au père :
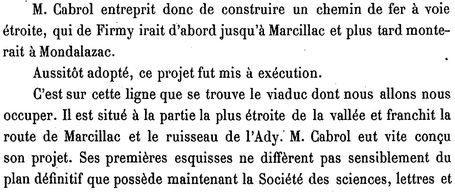
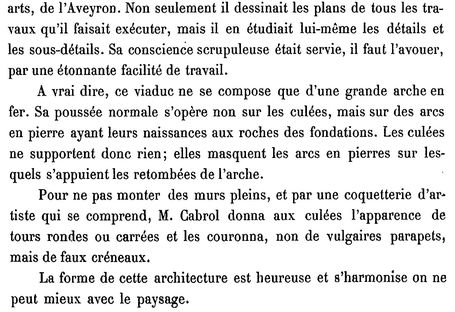
Laissons donc l’esthétique de coté, mais il semble bien que ce soit la raison du succès médiatique de l’ouvrage : rien n’est plus gracieux et original que cette légère construction de briques* et de pierres, précise même Elie…Soit !
*
non visibles
Les
solutions techniques de Cabrol sont très
originales : la poussée de l’arc central est transmise non aux
culées mais
aux arcs en pierre, masqués par l’élévation des tours ;
original et
élégant, mais aussi très réfléchi, car cette solution lui permet de
reporter
les efforts en dehors des zones sûrement moins porteuses proches du
ruisseau.
Moins de problèmes de fondations !
Une
deuxième
originalité repose sur l’arc central, métallique, et sur lequel repose
un
appareillage de
pierres : un
conflit en perspective, dilatation différentielle et autre. Cabrol
trouvera des
solutions. Il n’y a pas de dessins détaillés de l’arche dans le travail
de Elie
Cabrol. Seul le détail suivant de l’entretoise en fonte
figure :
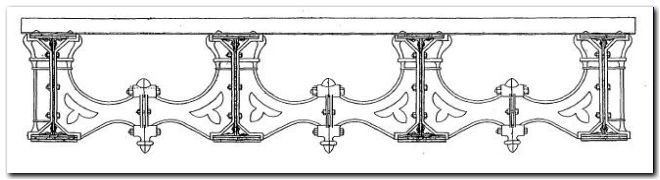
Une belle pièce et toujours un souci esthétique évident. Les arcs peuvent être détaillés sur les cartes postales anciennes.
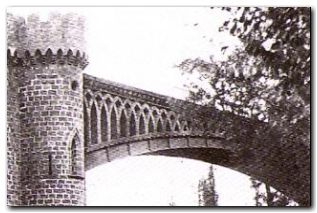
Moins courante, et prise, angle inhabituel, depuis l’aval, cet extrait :
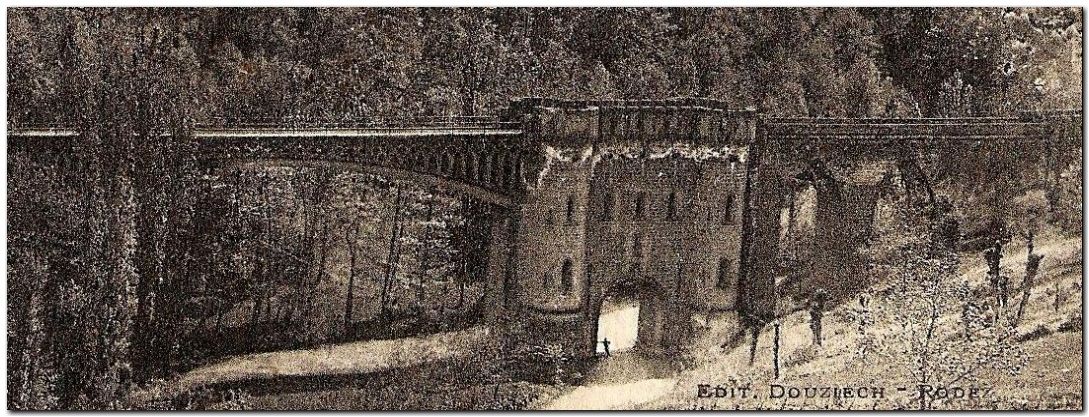
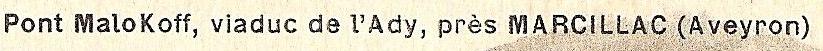
L’erreur d’impression est
d’origine.
Une autre image, une carte postale muette, sans les poses un peu trop marquées des cartes précédente ; elle donne également une vue au niveau du piéton que nous sommes, au moment de franchir l'ouvrage. Toute la majesté de Malakoff : l'arche, les ogives, les créneaux...
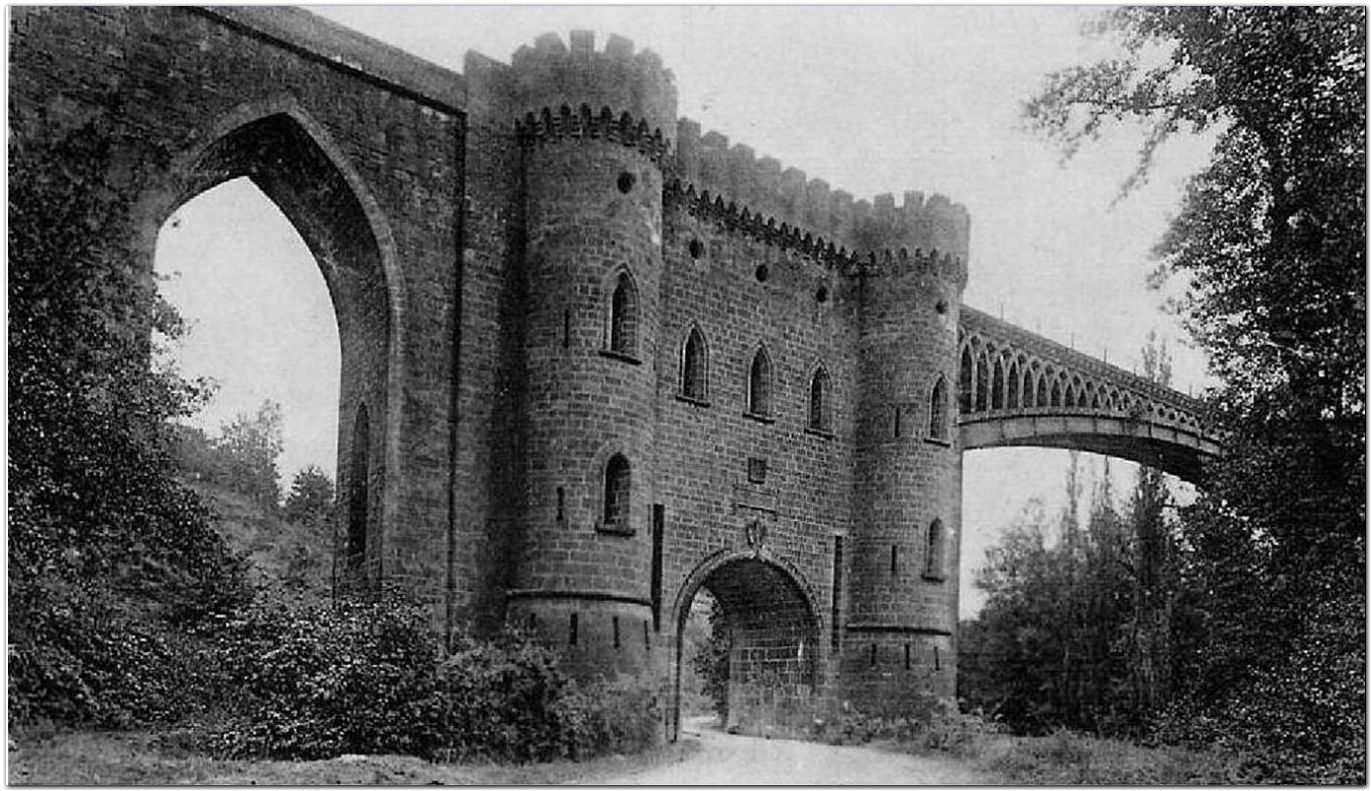

▲ Malakoff, photo Labouche, fraîcheur de la vallée, beauté des chapeaux...
▼ version colorisée par Intelligence artificielle (voir chapitre photos)
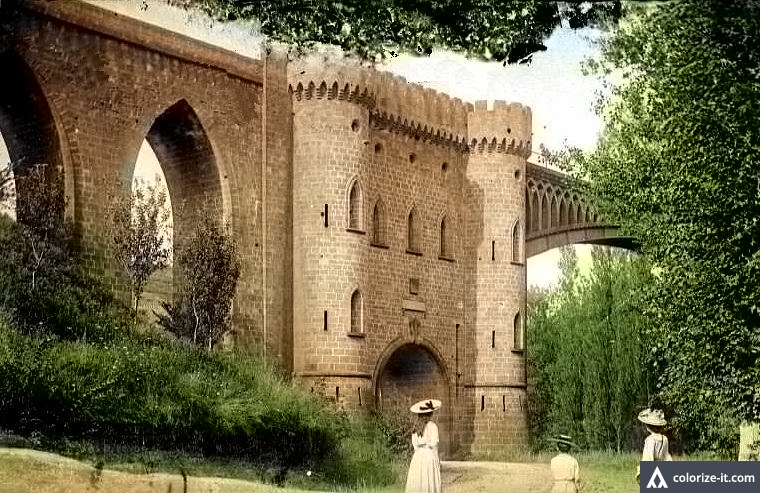
Parmi les caractéristiques remarquables de cet ouvrage, on peut donner quelques chiffres : 44 m de corde, précise Elie Cabrol, 62,37 m de rayon, 1,26 m de distance entre chacun des quatre arcs, 18 entretoises pour les relier. Autres chiffres : longueur totale de l’ouvrage, 155 m, et hauteur des rails, au-dessus du ruisseau, précise Elie : 21,75 m. Avec une précision assez illusoire, car on ne précise pas la saison, qui doit avoir son influence sur la hauteur des eaux du dit ruisseau…ou alors la hauteur est prise depuis le fond ? Elie Cabrol souligne également, mais est-ce pour répondre à des critiques ( ? ), que le parti choisi par son père amène à des économies indiscutables sur un ouvrage plus traditionnel, entièrement métallique par exemple …
Les premières études de Cabrol datent de 1852 ; le chantier est rentré dans sa phase active, les arcs, le 7 juin 1856, et le 20 juillet 1856, l’arche était en place .
Les activités de chantier ont été également remarquables. Les arcs n’ont pas été assemblés dans leur situation définitive, mais la totalité de l’arche, arcs et entretoises, fut assemblée au sol. C’est par montées successives par vérin et construction simultanée des appuis que le tout fut hissé en place. Le poids total à manipuler était d’un peu plus de 100 T, 100 581 Kilog précise Elie Cabrol. Cette façon de procéder était calquée sur la construction d’un pont anglais à Britannia, chantier que François Cabrol avait pu suivre en son temps. Il est sans doute instructif de s’attarder quelque peu sur cet ouvrage …
À l'origine, c'était un pont tubulaire uniquement ferroviaire, composé de travées en poutres fermées rectangulaires en fer forgé, construit en 1850 par Robert Stephenson, fils de George Stephenson, qu’on ne présente pas à des amateurs ferroviaires….
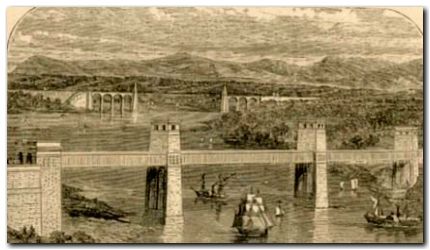
C’est
un ouvrage à
deux portées principales de 460 pieds,140 m, constituées de longs tubes
de fer
de section rectangulaire, chacun d'eux pesant jusqu'à 1500 tonnes.
Commencé
en 1846, le pont fut ouvert le 5 mars 1850. Pour son temps,
c'était un édifice d'une taille inusitée, et d'une singulière
nouveauté, sa
portée considérable laissant loin derrière lui les ponts contemporains
en
poutres de fonte ou en plaques de tôle. Innovant, il l'était aussi dans
sa
méthode de construction : les éléments du tube en fer forgé
étaient
assemblés à terre, puis mis sur des barges avant d'être hissés dans
leur
position définitive.
Le travail terminé, on put décorer le pont de quatre grands lions de style victorien, sculptés par John Thomas, un à chaque angle. Il est donc parfaitement compréhensible que Cabrol, technicien de formation, ait été sensible à la beauté de ce projet et calqué son mode de construction sur la technique anglaise. Et on peut peut-être risquer une remarque, qui concerne un autre ouvrage, le pont de Conway.
Deux
belles gravures, celle du pont de Conway, réalisé en 1848, et celle du
Britannia, en 1851 présentent des
analogies : réalisés tous deux par Stephenson, et tous deux
ponts
tubulaires. Cabrol ne pouvait l’ignorer .
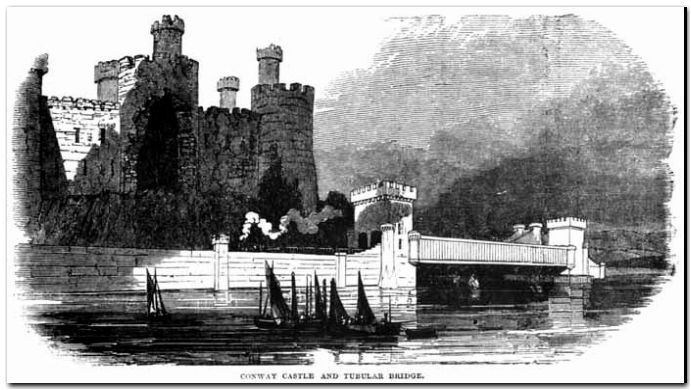
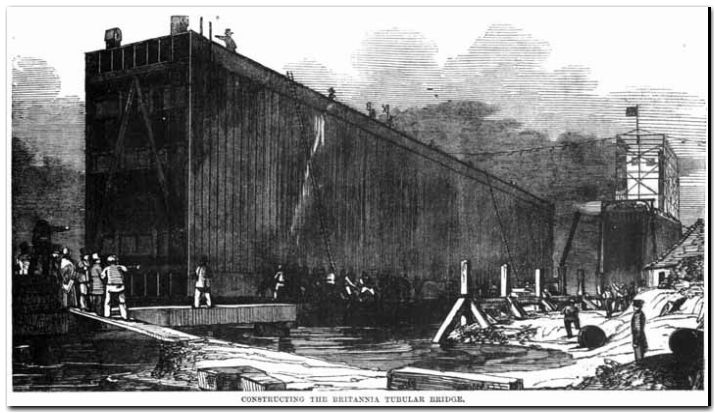
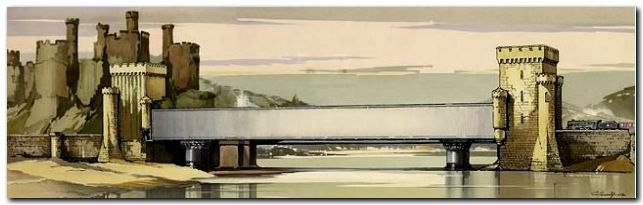
La première et la troisième de ces vues n’ont-elles pas inspiré François Cabrol dans son dessin de Malakoff ? Il n’est pas interdit de faire un rapprochement avec les tours et créneaux du pont de l’Ady …Nous, nous le faisons bien volontiers ! La seconde illustre bien le mode montage des travées, dont s’est inspiré Cabrol pour Malakoff. Le pont de Conway, situé à 25 km de celui de Britannia passe en tunnel sous le coteau où se situent les ruines du château de Conway. Ce sont ces ruines qui ont donné l'idée à Stephenson de réaliser les culées de type moyen âge de l'ouvrage. Et donc, M. Cabrol, qui connaissait Stephenson, connaissait le pont Britannia, et connaissait les nouveautés de génie civil de celui ci. Il ne pouvait donc ignorer l'existence de l'autre ouvrage, celui de Conway ; cet exercice architectural lui a (peut-être ? ) servi de modèle pour le pont de l'Ady. Une notice sur le pont tubulaire de Conway plus planches peut être consultée sur le site du CNUM, dans les mémoires des travaux de la Société des Ingénieurs Civils, volume 1, 1848, pages 67 et suivantes.
Afin d’être complet,
précisons que l'ouvrage
Britannia fut détruit par un incendie dans les années 1970 et
reconstruit : seules les piles sont restées d’origine. Le site
gutemberg.org est une bonne
introduction à la découverte de cet ancêtre. Pour ce qui est du pont
Malakoff,
faut-il enfin souligner sa fin peu glorieuse : détruit pendant
la dernière
guerre, plus rien ne subsiste des arches, arcs et entretoises, partis
dans des
fonderies…. Les maçonneries rive droite sont quasi inexistantes, et
seules
subsistent
donc les quelques arches ogivales rive gauche. Les massifs à
l’architecture si
médiévales ont terminé pour l’essentiel leur existence comme carrières
de pierres
dans les années 1960… Chargé de la démolition, l'entrepreneur propose
une carte postale, avec quelques précisions :
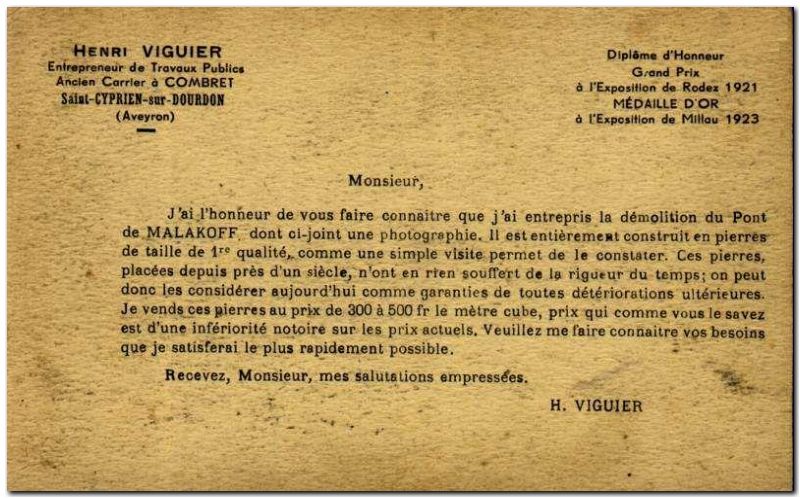
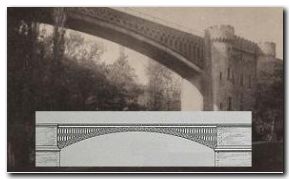
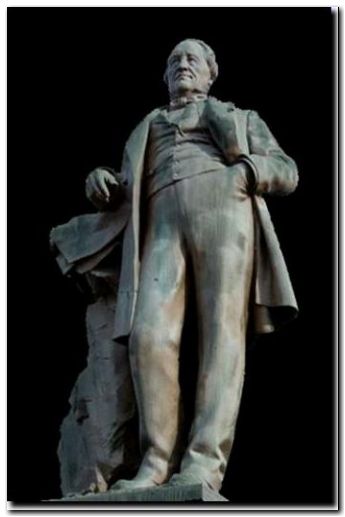
Mentionnons
enfin ce qu’il peut en être vu en 2008. Quelques
belles voûtes ogivales, comme dirait Elie, les ruines coté
Firmi :

Une
belle plaque
en
fonte nous reste, la plaque d’identité de l’ouvrage qui se trouvait
culée
sud coté sud au dessus du passage routier, voir
la carte postale ci-dessus. Cette plaque ne figurait pas à
l'origine sur l'ouvrage. Elle fut mise en place en 1897, donc
bien après la disparition de François Cabrol. Les deux
plaques du pont Rouge à Marcillac sont, sans trop de certitude, et sous
réserve de confirmation ou d'infirmation, de 1856...La
plaque de l'Ady, sur une initiative d'Elie Cabrol, voir ailleurs
sur ce site, voulait donner le nom de baptème Pont François
Cabrol à l'ouvrage...
Cette plaque imposante mériterait une mise en valeur plus efficace : elle se trouve un peu à l’écart dans un petit parc en bordure de l’axe routier, et à proximité de la gare de Firmi. De plus, les aménagements successifs font qu’elle tourne le dos au parc en question…( En mars 2010 la plaque n'est plus visible, suite à des travaux d'aménagement : à suivre ! ). Quand on vous dit que Cabrol avait un attrait irrésistible pour les châteaux du Moyen Age ! Et ci-dessous la plaque en situation sur l’ouvrage . Quant à la pierre gravée au dessus, c'est une énigme ???
Après avoir été déposée, cette plaque vient de trouver
son emplacement définitif,
juste devant l'entrée de la toute nouvelle médiathèque de Firmi. On
peut juste regretter que seuls ses usagers pourront en
bénéficier. Passants, quand vous roulez sur l'axe Decazeville Rodez,
vers Rodez, prenez le temps de tourner à droite au plan d'eau de la
Forézie, au giratoire. Tout droit et encore en face de vous un
peu à gauche, la rue de la Médiathèque, derrière la Mairie.
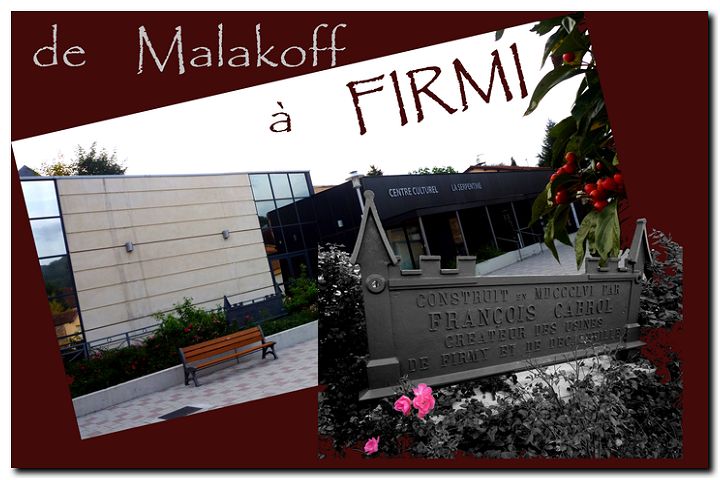
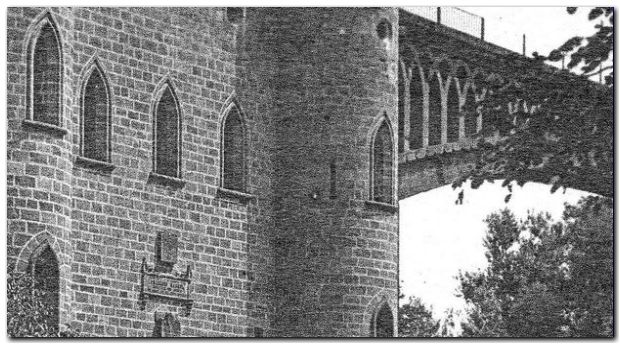
Toujours sur ce (fameux) viaduc, existe une hypothèse. On peut en effet rapprocher cette architecture quelque peu curieuse en ces lieux, avec les portails des tunnels. Ceux de Marcillac, les plus proches du pont rouge, peuvent rappeler le viaduc. Et si, donc, François Cabrol avait d'abord prévu de mettre ce viaduc ici, à Marcillac, et non vallée de l'Ady, un peu perdu ? L'ensemble portails et viaduc peut se concevoir. Possible....Mais simple hypothèse, car, et on peut le découvrir dans les pages des diaporamas, le portail du long tunnel de Marcillac, mais vallée de l'Ady est également très ouvragé : colonnes circulaires et margelles...et là, c'est vraiment en pays perdu, à la vue de personne ! Une déception de François Cabrol sur les résultats des élections en 1846 à Marcillac, mauvais pour lui, qui fut pourtant élu, pourrait expliquer la mise en place du (beau) viaduc vallée de l'Ady : hypothèse hasardeuse ?
Avant de poursuivre notre chemin vers Marcillac, une autre image de ce viaduc :
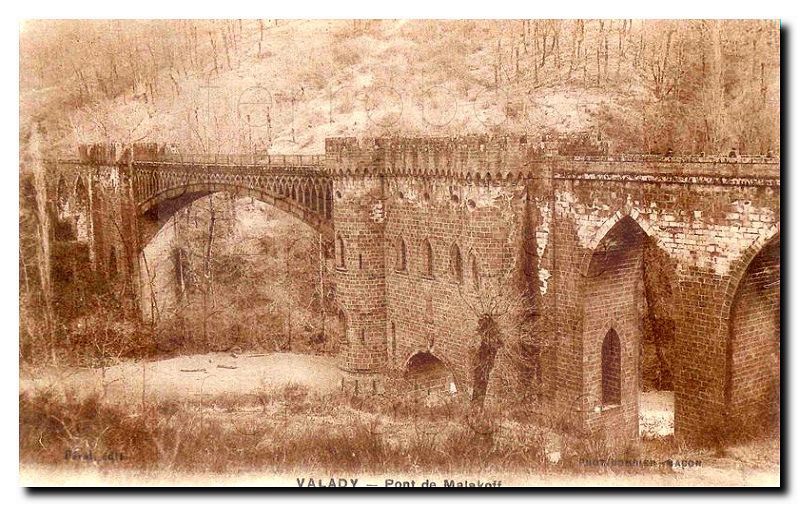
Le ton sépia est d'origine. Imprimée à Mâcon, par un des grands imprimeurs de cartes postales, la mention figure en bas à droite : PHOT. COMBIER-MACON. L' éditeur de la carte, c'est à dire celui qui a pris le risque financier de la réaliser, est Féral. Ce patronyme est en fait celui d'un tabac situé pès du viaduc, à Valady, tabac qui a également édité d'autres cartes régionales. La carte de Malakoff est remarquable. Par l'angle de prise de vue, inhabituel : nous sommes au dessus de la route, et coté Marcillac. L'Ady coule sur la gauche de l'image. Le plus remarquable est sans aucun doute l'étendue de la photo. Prise en hiver, c'est la seule image montrant la quasi totalité de l'ouvrage : les trois arches à gauche, la pile carrée, les arcs, la pile ronde et deux des trois arches de droite. Merci Monsieur le photographe, un beau cadrage ! L'image peut être datée vers 1925-1935 : les infiltrations sont importantes, et témoignent d'une absence d'entretien. La voie n'est plus en fonction. On distingue à droite quelques personnes, promeneurs ou utilisateurs habituels du passage ?
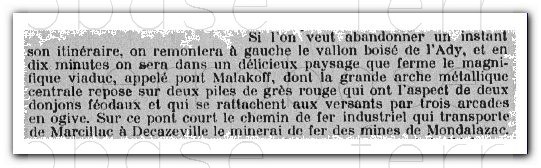

Les traces de cet itinéraire Firmi Marcillac peuvent être urbaines. C'est ainsi qu'à Valady, une bien modeste plaque évoque le pont, et non le viaduc. L'avenue fait suite à celle du pont de Tournemire, pont de la voie ferrée à écartement normal...
Du
Pays de Galles à l’Ady, en
passant par les Etats Unis. Ou, comment la géographie humaine peut
apporter une
solution à une question de génie civil !
La question est donc : pourquoi cette architecture tourmentée du viaduc de l’Ady ?
Nous avons déjà risqué un début de réponse : François Cabrol a trouvé son inspiration dans les vallées anglaises, précisément à l’occasion de la construction des viaducs de Conway et Britannia. C’est une hypothèse qui en vaudra sans doute bien d’autres. Elle a pour elle l’actualité : Britannia, Conway et Ady sont pratiquement contemporains…
La troisième hypothèse que nous allons vous proposer, repose, comme pour la première, sur quelques bases à notre avis plus objectives.
Anne Kelly Knowles est une géographe américaine, rencontrée virtuellement sur la planète internet par la lecture d’une de ses publications, Labor Race and Technology, in the Confederate Iron Industry (Technology and Culture, vol 42, n°1, 2001, pp 1-26, The John Hopkins University Press). Il s'agit de l’étude de la construction et du développement de l’industrie du fer aux Etats Unis vers 1840-1860, dans ses implications humaines et raciales. L’auteur souligne l’importance à cette époque du transfert technologique anglais, et plus particulièrement du savoir-faire gallois. Vers 1830, le sud du pays de Galles produisait 1/3 du fer anglais ; le centre de production était à Merthyr Tydfil. Les travailleurs gallois vont se déplacer un peu partout, et dans notre cas, aux Etats Unis, à Pittsburgh par exemple pour amener leur savoir et techniques. Il en avait été exactement de même à Decazeville. Les deux situations sont similaires. C’est cette similitude que A. Kelly Knowles évoque dans sa publication. Elle s’appuie sur les travaux de Donald Reid (Les Mineurs de Decazeville, 1985, dont la traduction française a été faite et publiée en 2009 par l’ASPIBD à Decazeville) et de Yves Randeynes concernant les naissances, mariages et décès des travailleurs gallois du bassin d’Aubin. Voici ce qu’écrit l’auteur américaine (extrait traduit),
« …Les travailleurs gallois étaient de la même manière impliqués dans le transfert de techniques comme le puddlage en France dans les années 1820. Une firme envoya un ingénieur François Cabrol à Merthyr Tydfill en 1826 ou 1827 pour observer les hauts fourneaux au coke et les techniques de puddlage dans les usines de Cyfarthfa, Dowlais et autres. En 1830, ingénieurs gallois, puddlers et autres spécialistes vivaient et travaillaient dans les « villages du fer » que la Compagnie de François Cabrol avaient créés à Decazeville, Aubin, Garchizy (*) et Firmy. Quelques uns de ces travailleurs immigrants sont retournés au Pays de Galles ou émigrèrent plus tard aux Etats Unis. D’autres se marièrent et se fixèrent sur place. Le cas des usines de fer de Decazeville montre que l’importation directe de cadres expérimentés et d’artisans satisfaisait deux buts : démarrer une activité rapidement dans de courts délais, et créer rapidement une culture industrielle dans des pays ordinairement étrangers à ces techniques. Le bureau des directeurs de Decazeville disait en 1830 : « c’est peut-être sans précédent en France qu’une telle entreprise soit conduite aussi rapidement ». Les ouvriers locaux peuvent avoir été bousculés par ces ouvriers cosmopolites travaillant chez eux, mais l’implantation rapide d’une force de travail efficace enchanta propriétaires des forges et investisseurs ».
Cette introduction fournie par la géographie humaine nous amène donc en Pays de Galles, vers Merthyr Tydfill où se rendit François Cabrol, tout jeune embauché par le duc Decazes. Il faut croire que les visites de Cabrol chez nos voisins marquent les esprits, car on retrouve une citation assez semblable à celle de la géographe dans un livret, le Guide Franco Californien du Centenaire : le Centenaire, par Jehanne Biétry Salinger, 1949, Pisani, San Francisco : « François Cabrol a été ingénieur dans une usine métallurgique d’Angleterre ». Evoque t-elle là un autre séjour de notre ingénieur que celui de 1826 ?
Il était donc tout naturel de faire la connaissance des usines galloises. Et on découvre que François Cabrol et le duc Decazes avaient particulièrement bien choisi leurs modèles !
Cyfarthfa, dont les usines sont nées vers 1765 (1828 pour la première coulée à Firmi, plus d’un demi-siècle plus tard) faisait vivre 1500 ouvriers en 1803. En 1819, 6 hauts fourneaux produisent 23.000 tonnes de fonte et vers 1830 ce sera la période de pleine activité. Celle-ci se terminera vers 1919, et il reste sur le site en 2010, plusieurs hauts fourneaux, et autres restes métallurgiques. Dowlais, ce n’est pas très loin. Les débuts datent de 1759, et en 1823 10 hauts fourneaux fournissent 22.287 tonnes de fonte. En 1840, il y aura 5000 ouvriers sur les sites de production. Ils seront 8800 en 1845 pour 18 hauts fourneaux. L’activité s’est maintenue jusqu’en 1987. Ces deux sites étaient donc vers 1825 les plus gros producteurs mondiaux de fonte. A Cyfarthfa, en 1824, le directeur, William Crawshay, fait appel à un architecte de renom pour construire un château. Celui-ci est en 2010 toujours debout. Et vous aurez sans doute deviné que c’est peut être là que François Cabrol aura puisé quelques sources d’inspiration pour dessiner le viaduc de l’Ady. La photo nous montre créneaux, mâchicoulis, tours cylindriques ou parallélépipédiques, toutes choses dessinées par Cabrol. Alors, dessinées, ou redessinées ? On ne peut à ce stade affirmer que cette hypothèse est la source de Malakoff, mais il se pourrait que notre ingénieur n’ait pas oublié vers 1855 cette visite de 1826 : il est plus que probable qu’il fut reçu dans ce château par son collègue directeur gallois. Entre directeurs, il est normal de se recevoir dans un château… Cela doit laisser place à quelques souvenirs, même trente ans plus tard !
On peut enfin souligner l’absolue identité des sites gallois de la vallée du Taff avec Decazeville, ce que soulignait la Science Illustrée, en 1894, tome 13, premier semestre : « …heureuse et remarquable coïncidence, se trouvent (ici) en abondance, minerai de fer, charbon de terre et calcaire ou fondant »… Seule différence, 30 ou 40 ans d’avance…

Château de Cyfarthfa, (wikipedia)

Une (deux, trois) hypothèse(s) (de plus) ?
Les archives de François Cabrol relatives à ce viaduc étant
pratiquement inexistantes, on peut donc se risquer à quelques
hypothèses sur les raisons de son architecture. Vous venez d'en
découvrir quelques unes. Une autre raison peut être le goût au milieu
de ce siècle pour le Moyen-âge, dans beaucoup de domaines.
L'architecture ne pouvait manquer de dessiner à nouveau des châteaux.
Et les concepteurs de voies ferrées emboitent évidemment le pas. Pour
beaucoup de tunnels, les ouvrages d'entrée ou de sortie, les portails,
prennent ainsi des figures connues : tours, machicoulis.....Un cas
particulier est à rapprocher du viaduc de l'Ady. Sur les bords du lac
du Bourget, à proximité d'Aix les Bains, les années 1855-1860 voient se
réaliser quelques tunnels. Et celui que nous vous proposons présente
vraiment plus que des analogies avec l'Ady : même époque de
construction, même aspect monumental, une tour ronde, ou une autre tour
mais carrée, un passage plein cintre, ou un autre en arc, des
ornementations, meurtrières et ouvertures...beaucoup d'éléments
que Malakoff semble avoir copiés, ou repris... Il faut également
préciser que des impératifs de défense militaire pouvaient justifier
ces architectures massives.
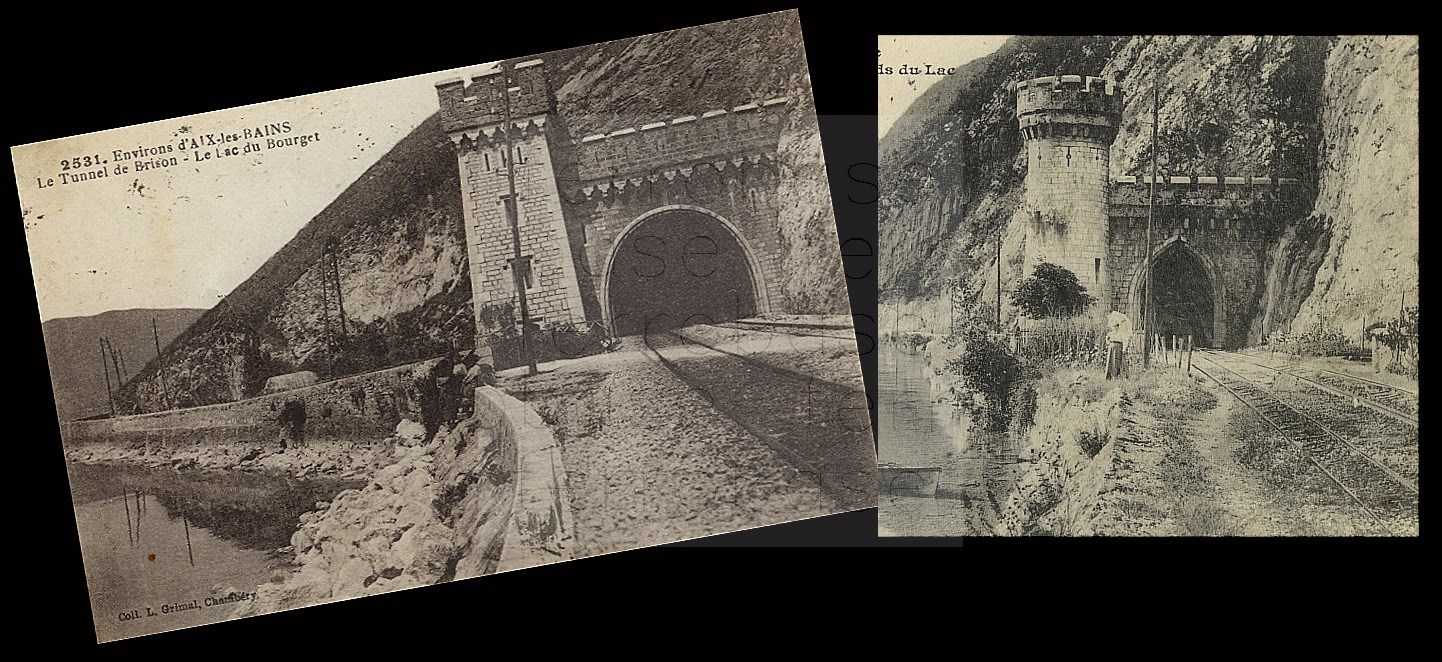
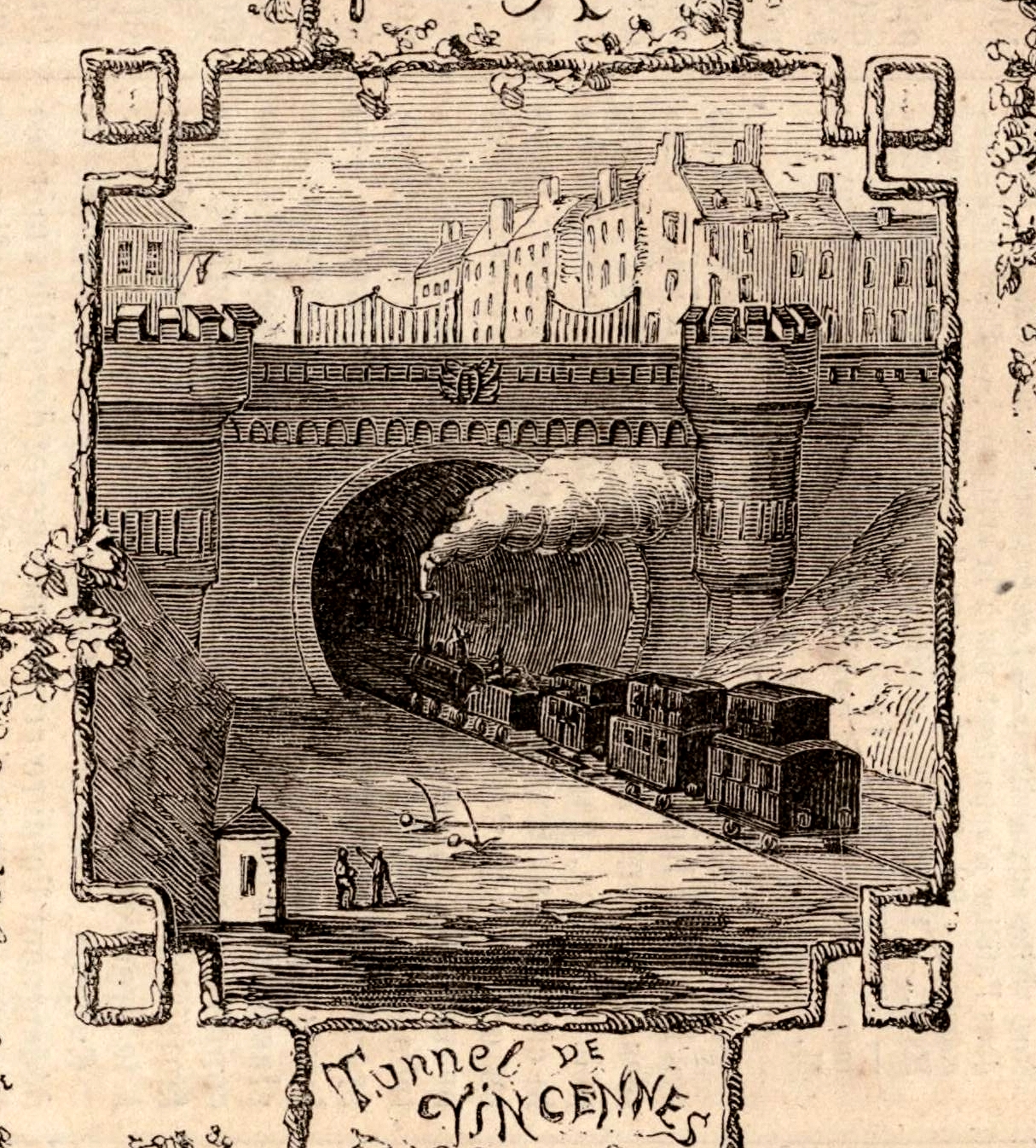
▲ Archives SNCF, clic pour agrandissement
L'image ci-dessus figure, très
furtivement, dans le
film La Bastille,
réalisé par André Perié, archives SNCF, exactement à 1'27". Le projet
de
la ligne de Vincennes date de 1854, à la même date que le
projet de l'Ady. La ressemblance des ouvrages est frappante !
L'ingénieur qui signe le projet pour la Compagnie de l'Est est M.
Bassompierre. Né en 1818, 25 ans après Cabrol, il est comme lui
ingénieur polytechnicien, et membre du Cercle des chemins de fer qui
compte beaucoup de relations de François Cabrol : Cibiel,
Calvet-Rogniat, duc Decazes (II)... Est-ce un élément de preuve ? Et ce projet était à
vocation urbaine comme
peut le signer la présence, au centre, d'un blason qui pourrait être
celui des armoiries de la Ville de Paris avec sa couronne à cinq tours
supérieure bien visible. Les dimensions très modestes de l'égout -une
largeur de l'ordre de 0,66 m- et surtout son profil, en font plutôt un
collecteur des eaux du tunnel qu'un égout urbain, dont le dessin est
habituellement assez différent.
Nota : la gravure du tunnel figure dans le Monde Illustré du 8 octobre 1859, et le texte qui accompagne l'article décrit cette architecture particulière. Le portail tel que dessiné a donc réellement existé...Souvent parisien, François Cabrol a très sûrement connu ce projet.
▲
Album pittoresque du voyageur, gravure de J. Blériot, tunnel
Ste-Catherine
Autre
ouvrage, sur la ligne de Rouen au Havre, ouverte en 1847, une petite
dizaine d'années avant l'apparition de celui de l'Ady. Au départ de
Rouen, le tunnel de Ste-Catherine présente ses deux portails. Beaucoup
de similitude avec l'Ady, dont la singularité d'un portail à tours
rondes, et un autre à tours carrées. Machicoulis,
meurtrières...permettent évidemment de jouer au jeu des ressemblances
avec Malakoff. L'Illustration
avait également consacré en son temps, 1847, un long article à
l'ouverture de la ligne, avec gravures évidemment. François Cabrol
connaissait-il donc cet ouvrage ?
Les pierres ?
Elles venaient d'où les pierres de Malakoff ? Et celles du Pont Rouge, son voisin de Marcillac ? Nous n'avons pas trop de certitudes, mais les carrières de grès rouge sont nombreuses à proximité : on cite au milieu du siècle, vers 1850, celles de Valady, St-Christophe, Clairvaux et Marcillac. Il y a aussi celles de Combret, un peu plus lointaines, qui avaient fourni autrefois des pierres pour Conques...
Plusieurs
pages de ce site évoquent le viaduc de l'Ady. Dans le chapitre 13, ici, nous
avons publié quelques esquisses et dessins retrouvés aux Archives
départementales de l'Aveyron, très probablement de la main de François
Cabrol. Voici quelques autres dessins, les originaux menant une vie
d'archives tranquilles dans les fonds de la Société des Lettres,
sciences et arts de l'Aveyron (SLSAA).
Elie Cabrol, dans son ouvrage Le viaduc de l'Ady, mentionne en préface son don à la SLSAA : un lavis et des dessins de détails. Ce lavis est présenté dans le diaporama de la page spéciale consacrée à l'exposition Cabrol, ici. Nous venons de retrouver les dessins. Ils étaient bien déposés à la Société, comme Elie l'avait écrit dans une lettre de septembre 1891:
Deux dessins réalisés par François Cabrol viennent apporter des précisions intéressantes sur la structure de l'ouvrage. Ces dessins étaient autrefois sous verre, encadrés par le même artisan que le lavis. Leur format est de 31*43 cm et 30,5*46,5 cm, joliment aquarellés.

Le sommet de la courbe
C'est le titre porté sur ce
dessin. Par courbe, il faut évidemment comprendre arc. Sur
l'infographie, à droite une vue, et à gauche deux coupes. Sur la vue,
on ne peut manquer de distinguer les rails Barlow, liés aux quatre
poutres des arcs et supportant les maçonneries. Ils débordent de 6 cm,
avec une longueur de 4,22 m, pour un ouvrage de 4,10 m de large.
Contrairement à ce que
peuvent laisser penser les nombreuses cartes postales de l'ouvrage, ils
ne sont pas jointifs ! Un plat de 25 cm les sépare. Et en faisant le
compte, les 81 rails et leurs séparations permettent d'ailleurs de
retrouver la portée de l'arc, 44 m. On notera que l'écartement permet
de positionner les pieds droits des ogives exactement à l'aplomb de
rails. Sur la coupe 2, Cabrol a dessiné l'évacuateur des eaux
d'infiltration de la plate-forme. La coupe 1 permet de se rendre compte
de l'importance des éléments de maçonnerie. Le garde-corps est tenu par
ses montants qui traversent la pierre de couronnement. L'écartement des
barreaux, 13,75 cm, est en rapport avec l'écartement initial des
Barlow, 55 cm. De toute évidence François Cabrol avait un réel sens de
l'harmonie ! C'est évidemment ce genre de détails qui donnait toute sa
beauté au pont.
les
ogives
Nous allons mettre la main dans le cambouis ! Et découvrir un élément caché. Elie Cabrol, dans son ouvrage, parle de pont de pierres et de briques : rien n'est plus gracieux et original que cette construction de briques et de pierres. Mais à la vue de toutes les photos connues, cartes postales ou photos de particuliers, personne n'a jamais montré la moindre brique ! Et pour cause ! Seuls les parements des ogives sont en pierres taillées, la brique étant utilisée à l'intérieur. Non visible, ou très difficilement depuis le sol, aucun photographe ne s'est intéressé à la chose. Voici donc ces briques, de plus roses comme il convient.
Nous ne résistons pas à vous faire part d'une belle lithographie. Elie Cabrol la met à la une de son ouvrage. On pourra bien sûr, une fois de plus, souligner la majesté du viaduc, avec une belle vue d'ensemble. Pour les détails, nous avons épinglé le sommet de l'arche : un passant est accoudé et pose pour l'éternité. Il en est de même pour ce monsieur qui se protège du soleil, sous l'arche. Vous l'avez reconnu ? Il pourrait bien être Elie Cabrol lui-même. Et à droite, à la sortie du fameux S de la route, le cocher est à son poste, attendant la fin de la pose...
Splendeur et décadence,
le viaduc Malakoff aurait-il pu être sauvé ? Récit d'une affaire ratée...
▲Malakoff, défiguré...La fin s'annonce (vers 1955) !
(archives ASPIBD)
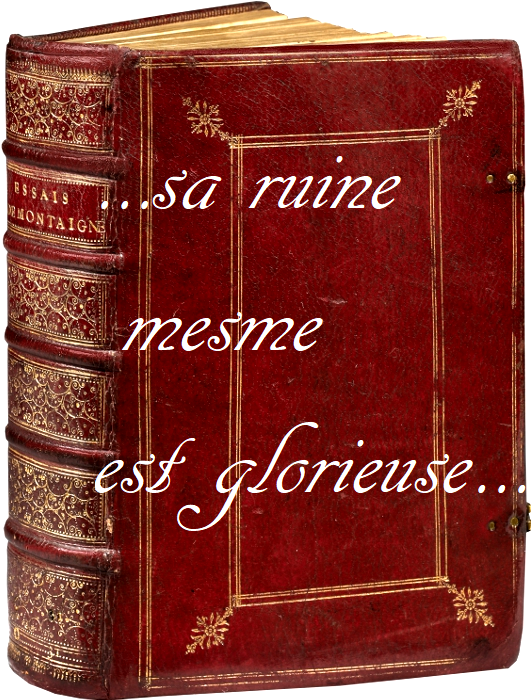
...sa
ruine mesme est glorieuse...
Montaigne, Essais, liv III, chap IX
Il n'évoquait pas Malakoff, mais
Rome.
Les mêmes mots s'appliquent pourtant bien ici au désastre apparent !
A défaut d'avoir vécu l'événement,
on va découvrir que la
sauvegarde de cet ouvrage s'est jouée dans des circonstances si
particulières, que ce sauvetage aurait très bien pu être d'actualité.
Nous sommes en 1940. Évidemment,
nous ne
mettons pas en parallèle le viaduc et la situation de
l'époque,
situation difficile, également pour le viaduc. Il n'a
plus d'utilité directe depuis bien longtemps, vingt ans, et
quelques
méchantes infiltrations perdurent, bien visibles sur les photos.
Pour se
situer : la déclaration de guerre, ce sera le 3 septembre 1939,
et l'armistice, le 22 juin 1940. Le colonel Marion prendra ses
fonctions de Préfet le 25 septembre 1940, en remplacement du
Préfet Destarac. Au Conseil Général, suspendu le 12
octobre 1940, se substitue la Commission Administrative du
Département de l'Aveyron, neuf personnes, qui tiendra sa
première séance le 13 février 1941, à 14 h précises. En étaient
membres, MM. Coucoureux, Lacroix, Monsservin, Clausel de Coussergues,
Cochy de Moncan, Guibert, Lagarde, Lalande et Singla. Et pour plus de
précisions, voici l'exacte composition officielle de la commission,
dans l'ordre de nomination, pensons nous.
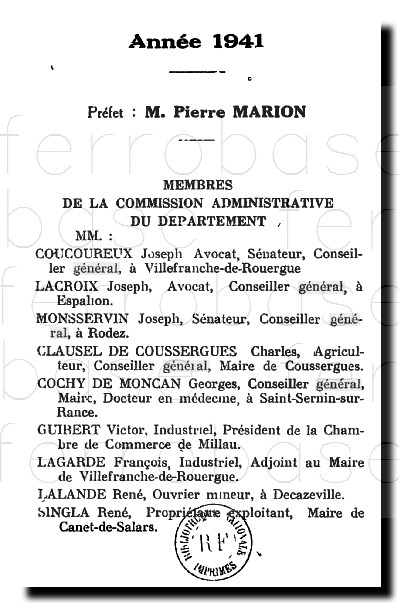
On relève la
présence de quatre membres du défunt Conseil Général, donc
sensibilisés au problème de Malakoff, deux industriels, qui sont à
priori plutôt favorables au monde industriel et à ses demandes, un
ouvrier mineur, à priori favorable à ce maintien, c'est notre avis
personnel, et un exploitant agricole, étranger au monde de la mine et
de l'industrie. En faisant les comptes, huit membres sur neuf
devraient soutenir Malakoff...Il n'en sera pourtant rien et c'est
dans ce cadre historique très tourmenté que le sort de Malakoff va être
scellé.
Premier
épisode
Lors de la
session du
Conseil Général encore en fonctions, session de 1940
ouverte le 6 juin, le Préfet Destarac fait part de l'information
suivante :
Offre
de cession gratuite au département,
par
la Société des Mines et Usines de Decazeville,
de
l'ouvrage dit « Pont de Malakoff »
qui
se trouve dans la vallée de l'Ady
"
J'ai l'honneur de déposer sur votre bureau, une lettre en date du 24
février 1940, par laquelle M. le Directeur de la Société des Mines et
Usines de Decazeville, offre de céder gratuitement au département de
l'Aveyron l'ouvrage dit « Pont de Malakoff » qui se trouve dans la
vallée de l'Ady.
J'annexe
à cette lettre, l'avis exprimé par M.
Boyer architecte départemental et architecte ordinaire des monuments
historiques.
Je
vous serais obligé de bien vouloir prendre une décision à ce sujet. "
(rapport
du Préfet session conseil général 1940).
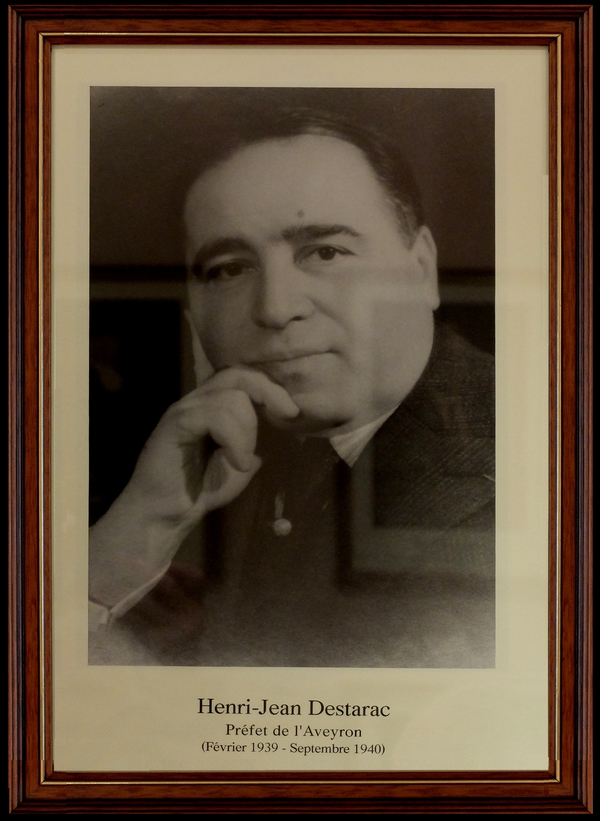 On peut le
constater, l'annonce est de pure forme, sans états
d'âme, et parfaitement formulée dans la
sécheresse administrative
qui est évidemment de droit. Cette demande du Préfet est
accompagnée,
on le remarque immédiatement, de l'avis de l'architecte
départemental.
On peut le
constater, l'annonce est de pure forme, sans états
d'âme, et parfaitement formulée dans la
sécheresse administrative
qui est évidemment de droit. Cette demande du Préfet est
accompagnée,
on le remarque immédiatement, de l'avis de l'architecte
départemental.
◄Le
préfet Destarac : son court séjour en Aveyron ne lui avait sans doute
pas permis de comprendre l'intérêt du viaduc dans le patrimoine
industriel aveyronnais. Il n'a pas particulièrement insisté pour sa
sauvegarde. Son successeur, le préfet Marion, ne fera d'ailleurs pas
mieux pour cette sauvegarde...
Lors de cette même session,
deux jours plus tard, le 8 juin 1940, le Conseil Général en débat,
suite au travail en commission. Nous vous proposons la relation
écrite suivante (rapport M. Lacroix, Conseil Général, 1940, commission
des Intérêts Généraux).
"
Offre
de cession gratuite au département,
par
la Société des Mines et Usines de Decazeville,
de
l'ouvrage dit « Pont de Malakoff »
qui
se trouve dans la vallée de l'Ady.
Votre Commission a examiné l' affaire dite du Pont de Malakoff
qui ne rappelle que de très loin la guerre de Crimée.
Cet ouvrage d'art fut construit en 1856, par l 'ingénieur Elie Cabrol,
pour servir d' assiette à un petit chemin de fer à voie étroite, pour
le transport du minerai de Firmy-Marcillac-Mondalazac.
Ce pont, qui est simplement un viaduc, se compose d'une grande arche de
fer dont la poussée s'effectue sur des arcs en pierre ayant leur
naissance aux roches de fondations. Cabrol donna aux culées, par
coquetterie autant que par économie l'apparence de tours rondes
couronnées de faux créneaux. Devant cette apparence de château-fort, le
populaire, encore sous l'impression des guerres de Crimée, le baptisa
du nom pompeux de pont de Malakoff.
C'est
ce viaduc qui nous
est aujourd'hui offert par la Société des mines et usines de
Decazeville : la cession serait purement gratuite et sans aucune
condition. Devons-nous accepter ce don ?
Notre
architecte départemental répond négativement, car, à son avis, le
viaduc ne présente aucun intérêt artistique ; il pourrait constituer
une
charge pour le département, en raison de son entretien.
Votre
Commission est d'autre parti, retenue par le caractère pittoresque de
cet ouvrage, qui semble faire partie du paysage et plaît aux touristes
nombreux qui visitent la vallée.
Y
a-t-il gros risques à
accepter ce don ? Nous ne le croyons pas. Ce viaduc est d'une solidité
à toute épreuve et, dans le cas où il paraîtrait utile de le réparer,
le département pourrait aisément s'en débarrasser en le vendant à des
entrepreneurs, qui y trouveraient de riches matériaux de constructions.
Votre
Commission croit, d'autre part, que la petite cité de Marcillac aurait
plaisir à conserver cet ouvrage, qui constitue pour elle un
attrait.
Nous
soumettons ces diverses considérations à votre
sagesse, étant donné la gratuité du don et l'absence complète de
risques qui pourraient entraîner pour le département la moindre dépense.
M.
le PRESIDENT. — Ce rapport sera renvoyé à la Commission des Travaux
Publics et M. l'Ingénieur en Chef nous dira ce qu'il en pense.
M.
RAMADIER. — C'est le premier pont métallique qui ait été construit en
France, car, contrairement à ce que M. Lacroix disait, il y a un
revêtement extérieur en pierre, mais le pont lui-même est en métal. Je
ne suis pas d'ailleurs absolument sûr qu'il soit complètement réussi,
mais, comme il n'y passe pas de chemin de fer, la résistance n'a plus
qu'une importance très réduite.
M.
le PRESIDENT. — On reprendra cette question à la
première réunion plénière du Conseil
général.
Il
en est ainsi décidé. "
 M.
Ramadier, membre du Conseil Général en 1938 (ph
Noyrigat)
M.
Ramadier, membre du Conseil Général en 1938 (ph
Noyrigat)C 'est la fin de ce premier épisode.
La
position, négative, de l'architecte départemental est
évidemment
regrettable. Monsieur Boyer, originaire d'Espalion, était un
aveyronnais averti. Ancien élève des Beaux Arts de
Paris,
architecte à Rodez, il avait été nommé
architecte départemental en
1909, en remplacement de Monsieur Pons, décédé (Journal Aveyron, 20
juin 1909). Son ancienneté, ses origines, sa connaissance
du pays auraient pu militer pour une position différente...
Nous retiendrons la lecture un peu rapide que fit M. Lacroix du
dossier. Elie Cabrol n 'est pour rien dans cet ouvrage, et vous
aurez rectifié, en pensant à son père François. L'architecte
départemental propose de dire non à la proposition de Decazeville.
Pourtant il semble bien que la commission ne soit pas de cet
avis. Le rapporteur souligne tous les arguments qui peuvent être
évoqués : le caractère pittoresque, sa place dans le paysage, l
'intérêt touristique, son état de solidité, sa possible revente, donc
avec bénéfice comme carrière, et enfin le plaisir que " le populaire "
( sic ! ) de Marcillac y trouverait. Qu'ajouter de plus ? Rien ! La
cause est presque entendue pour un oui franc et massif. Dernier appui
pour une décision favorable, la position de M. Ramadier. Sa voix compte
pour une voix bien sûr, mais l'importance morale dans le
Conseil Général est toute autre. M. Ramadier a été il y a peu deux fois
au gouvernement (aux mines dans le gouvernement Blum de 1936, puis aux
Travaux Publics dans le gouvernement Chautemps), comme
sous secrétaire d'Etat. Sa parole devait donc être écoutée avec un
peu plus d'attention. Sa charge de maire de Decazeville, depuis
1919, est évidemment un
plus. Enfin souvenons nous que nous sommes en guerre, et que la
décision n'est pas d'actualité. Aucune décision ne sera prise...
Juillet 1940 : bouleversement sur le plan politique, et
disparition provisoire
de M. Ramadier de la scène, ayant été l'un des 80 députés ne votant
pas le 10 juillet les pouvoirs constituants à Henri Philippe Pétain. Un
appui du viaduc vient de céder.
Le 12
octobre 1940, le vote portant suspension des Conseils
Généraux va miner très sérieusement le deuxième appui, pour conserver
une image de génie civil. Le rapport précédent de M. Lacroix disparaît.
Le
13 février 1941, la commission administrative du
département de l'Aveyron est donc mise en place. Les neufs sages
qui la composent auront
rapidement à connaître de Malakoff et de son avenir.
Le 5 avril 1941, le sujet sera évoqué .
"année 1941
Projet
de cession par la Société des Mines et Usines de
Decazeville du viaduc sur l'Ady, dit « Pont de Malakoff »
M.
LE PREFET rappelle que, dans sa réunion du 8 mai ( juin, il y a erreur
de
frappe)
1940, le Conseil
Général, examinant l'offre de cession gratuite au département par la
Société des Mines et Usines de Decazeville de l'ouvrage dit «Pont de
Malakoff », avait décidé de renvoyer cette question à sa prochaine
session et de faire procéder entre temps, par M. l'Ingénieur en Chef
des Ponts et Chaussées, à un nouvel examen de cette offre.
Il dépose sur le bureau le dossier de cette affaire, complété par un
rapport de M. l'Ingénieur en Chef, qui est d'avis de ne pas accepter la
cession proposée.
Après
examen et échange de vues, la Commission met l'affaire à l'étude. "
L'affaire, comme il est dit, de Malakoff, est donc à nouveau évoquée.
Et ce qu'un ingénieur avait réalisé, François Cabrol, un autre
ingénieur propose donc de le détruire, près d'un siècle plus
tard. Splendeur et décadence...et fragilité des oeuvres, d'art ou pas !
Nous n'avons aucun détail sur l'échange de vues évoqué. Mais il a dû
apparaître quelques difficultés pour entériner dès ce jour la
proposition de l'ingénieur en chef. Et, tout ne sera peut-être pas
perdu, l'affaire est donc
mise à l'étude.
Nous comprenons mal d'ailleurs quelles études cette cession
nécessiterait...mais la décision est donc repoussée à plus tard, et
l'espoir demeure.
Fin du deuxième épisode.
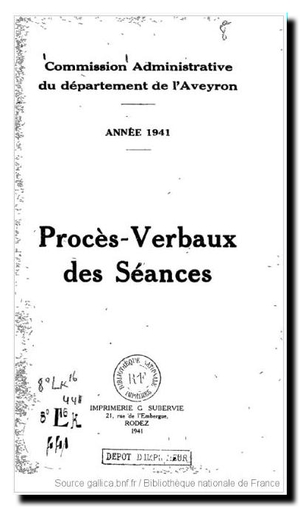
Réunion de la commission administrative du 17 mai 1941. Tous les
membres sont présents à 10 h pour cette réunion.
Il y a 11 points à l'ordre du jour officiel. Le septième
sera celui que nous suivons.
"1941 commission administrative
Projet
de cession par la Société des Mines et Usines de Decazeville
du
viaduc dit « Pont de Malakoff ».
M.
le Préfet rappelle à la Commission que dans sa séance du 5 avril
dernier elle avait mis à l'étude l'offre de cession au département, par
la Société des Mines et Usines de Decazeville, du viaduc lui
appartenant et connu sous l'appellation de Pont de Malakoff.
Il lui donne communication de la lettre qui lui a été adressée, à la
suite de cette décision, par ladite Société. Celle-ci déclare se
trouver au regret de retirer l'offre qu'elle avait faite, la
Commission n'ayant pas paru s'y intéresser.
Acte
est donné à M. le Préfet de sa communication. "
Fin
du dernier acte. L'affaire est donc entendue. Devant les
hésitations et reports successifs, Decazeville, sans doute
pressé d'en finir, préfère retirer son offre. Nous avons cherché en
vain dans les dossiers du Conseil Général ou de la Commission
Administrative qui lui succéda les rapports de l'architecte et de
l'ingénieur...
La
commission n'aura plus à revenir sur cette question, et le Conseil
Général futur non plus. C'est vraiment dommage, car à très peu de
choses près, l'issue aurait fort bien pu être toute autre.
On connaît la conclusion définitive : démantèlement des parties
métalliques, en 1943 pour un témoin oculaire que nous avons
rencontré et 1944 pour d'autres sources, et vente des maçonneries.
Mais l'évocation de cette démolition est un autre sujet et fait l'objet
d'une autre note à lire chapitre 6.
Les rapports du Conseil Général et de la commission administrative, pour la période qui nous intéresse, 1940 et 1941, sont publics et librement consultables. La Bibliothèque Nationale de France, par l'intermédiaire de Gallica sur internet, donne cette possibilité, pour des non aveyronais, par exemple.
Le viaduc de Malakoff est donc une véritable curiosité, et les représentations sont multiples. Voici, par exemple, celle figurant dans la salle des mariages de la mairie de Decazeville. Le peintre (voir origine ci-dessous) représente sur la surface totale d'un mur les usines de Decazeville, en bas, et au dessus, une vue du viaduc de l'Ady. La représentation est faite, dit une inscription, suite aux dessins originaux de Elie Cabrol. On peut penser que la peinture conservée à Rodez, de la main de François Cabrol, et présentée par ailleurs, chapitre 6, a donc servi de modèle. Mais seulement de modèle, car ici, c'est bien trois arches qui figurent à gauche. De cet ensemble monumental, six mètres environ de large, nous avons extrait la vue seule du viaduc. Très difficile à photographier, nous avons fait subir à nos clichés quelques retouches numériques pour présenter une vue frontale. Cela vous évitera de rester tête levée à admirer les détails ! Les couleurs sont agréables, sous un vernis apparemment généreux. Le peintre auteur, non le copiste, a quelque peu adoucit l'environnement de l'ouvrage. La réalité le montrerait plus encaissé, rives droite et gauche...Le rendu de la perspective ne nous semble pas parfait, l'ouvrage pouvant faussement paraître courbe. Mais la peinture est belle ! Cette galerie peut s'enrichir : si vous connaissez d'autres représentations, écrivez-nous !
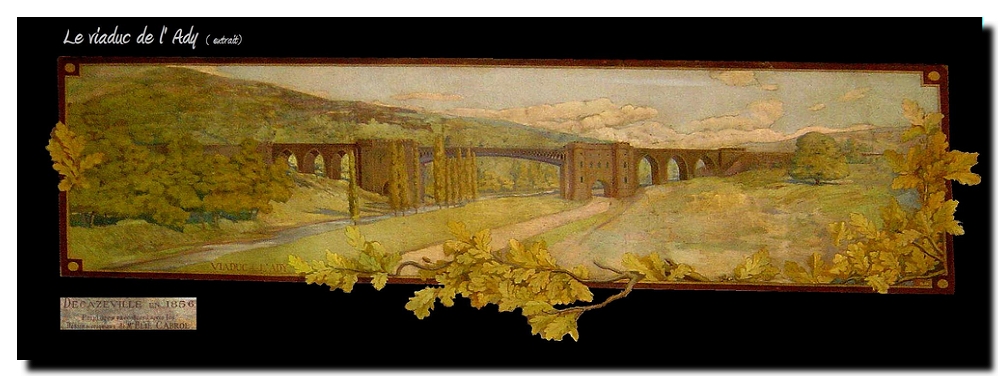
Il existe une autre version (Musée de la Mine Lucien Mazars, Aubin) de cette peinture, que nous vous proposons ci- dessous. Ce n'est pas le même peintre ! Offert par Elie Cabrol, le lavis aurait été réalisé par François Cabrol lui-même (voir Viaduc de l'Ady). L'angle de dessin, les dimensions, la place des arbres, le modelé du paysage, très adouci....sont identiques. Mais, car il y a un mais amusant, la saison n'est pas la même, les arbres ne sont pas identiques...C'est le jeu des erreurs ! Jouez donc!
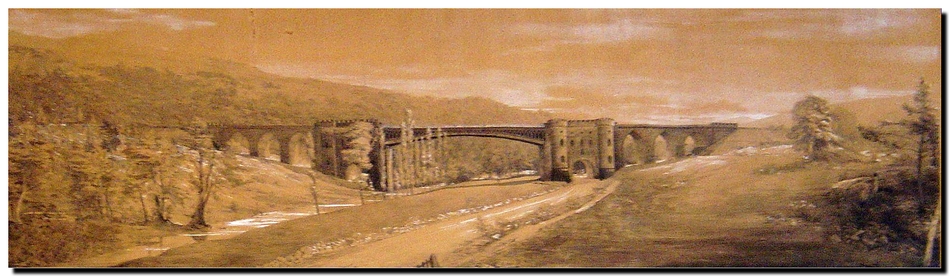
Les Procès verbaux des séances de la Société des Lettres des Sciences et des Arts de l'Aveyron, tome XXI, du 25-02-1906 au 29-12-1907 donnent l'information suivante, page 51, sous la rubrique dons divers:
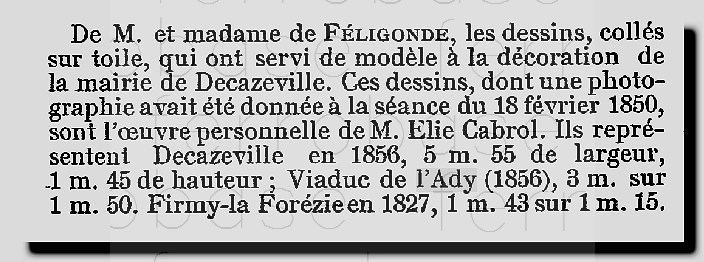
On peut donc conclure que la version mairie Decazeville est effectivement une copie, et que l'original pourrait être le tableau présenté au musée d'Aubin.


En période de basses eaux, l'Ady laisse voir quelques unes des pierres du viaduc, comme ici à droite...

.
Une nouvelle idée de page ? Sans doute pas, mais l'image que nous vous proposons mérite des développements futurs... Les images du viaduc en service, c'est à dire avec un train, doivent être rarissimes, nous n'en avons jamais rencontrées, à l'exception d'une carte postale, assez décevante d'ailleurs sur ce plan. Des images du viaduc sans rien, il y en a beaucoup, des connues et d'autres moins. Des images de sa démolition ? Rares, mais en voici deux !
Cette première image est très précisemment datée de 1942 par une mention manuscrite portée au dos. Effectivement c'est une démolition : les pierres sont récupérées, et deux modes de transport cohabitent ; les huit pattes tirant un chariot à chaines, et à l'arrière, le camion, équipé de son gazogène, ce qui permet d'avoir quelques certitudes sur la date proposée. La pile rive gauche est en place et on peut supposer qu'il en est de même pour l'autre pile, rive droite. En effet, les arcs sont en place et doivent donc nécessairement reposer sur les appuis. La végétation, les tenues vestimentaires laissent supposer une journée de printemps ou d'été, 1942 donc. Les pierres présentes sont des pierres taillées de parement et proviennent des massifs rive droite ; certaines sont chargées sur le camion. Au dessous de cette image historique, nous vous proposons un autre témoignage de cette démolition. L'image est d'origine inconnue, source et date, parue dans un journal ( ? ). Sa qualité laisse évidemment fort à désirer, mais son intérêt est de témoigner. Le long texte qui l'accompagnait n'apporte, hélas, aucune information complémentaire...Il s'agit cette fois de la démolition du massif rive gauche.
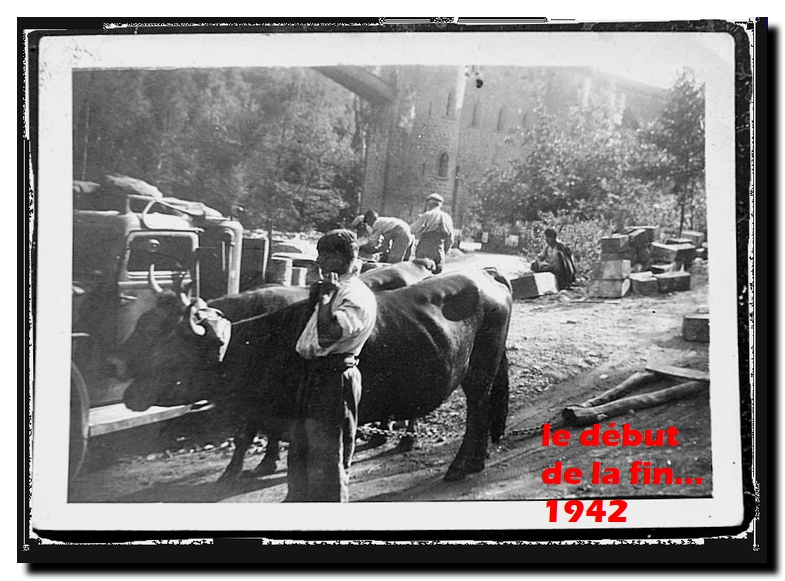
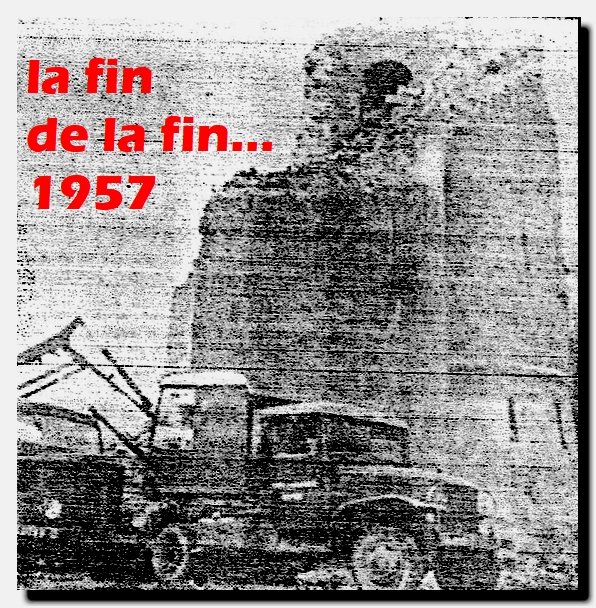
Après la réunion de mai 1941, où la
compagnie confirme son retrait
d'offre pour cause de non intérêt du Département, le démantèlement du
viaduc n'a donc pas tardé ! Voici une rareté (collection B.O.), datée
d'août 1941, et antérieure à la précédente : la qualité toute relative
de l'original permet toutefois de présenter cette image. L'arc
est
encore là, mais pas pour très longtemps, et les pierres taillées
sont parties vers d'autres ouvrages !
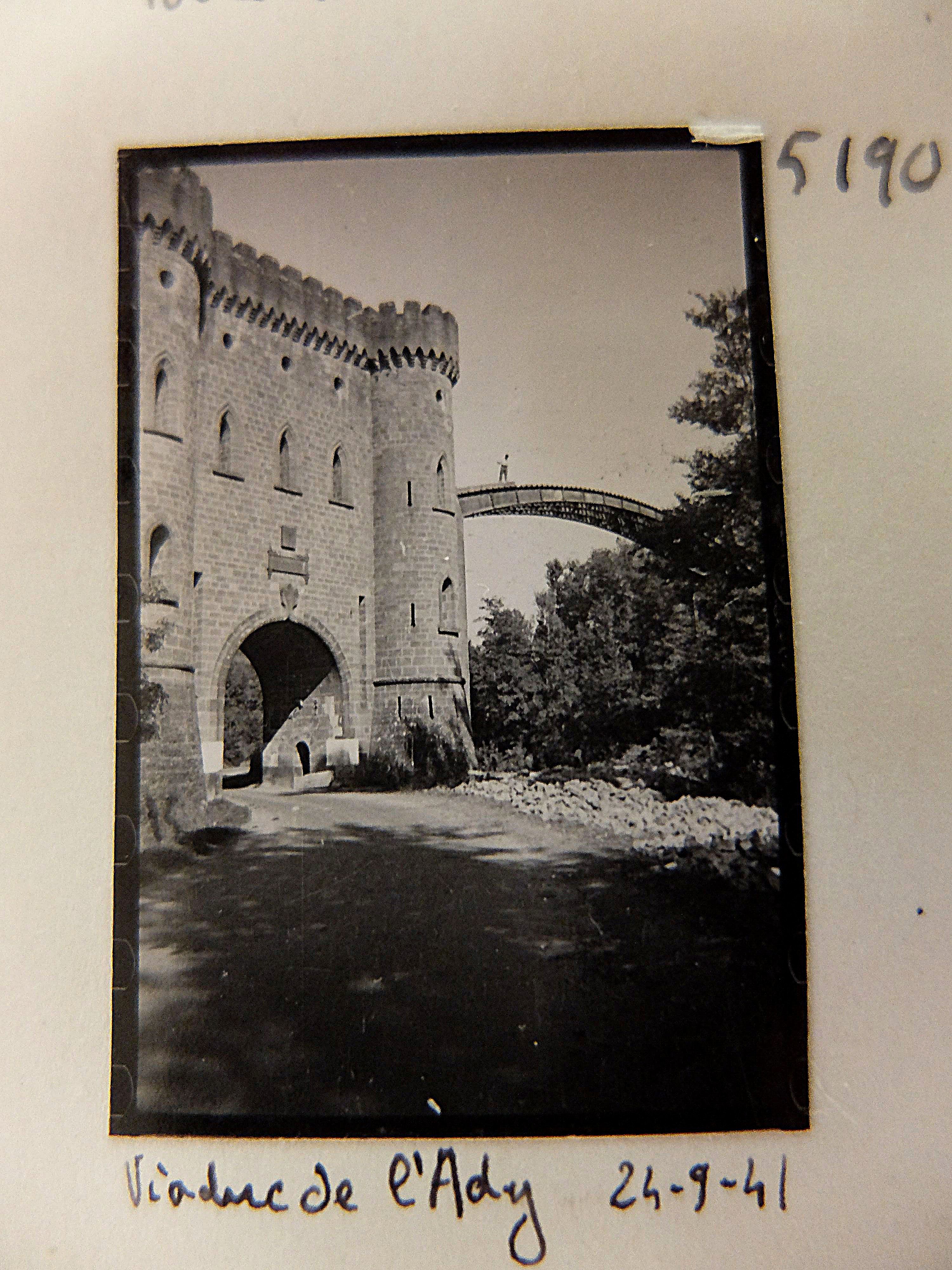 |
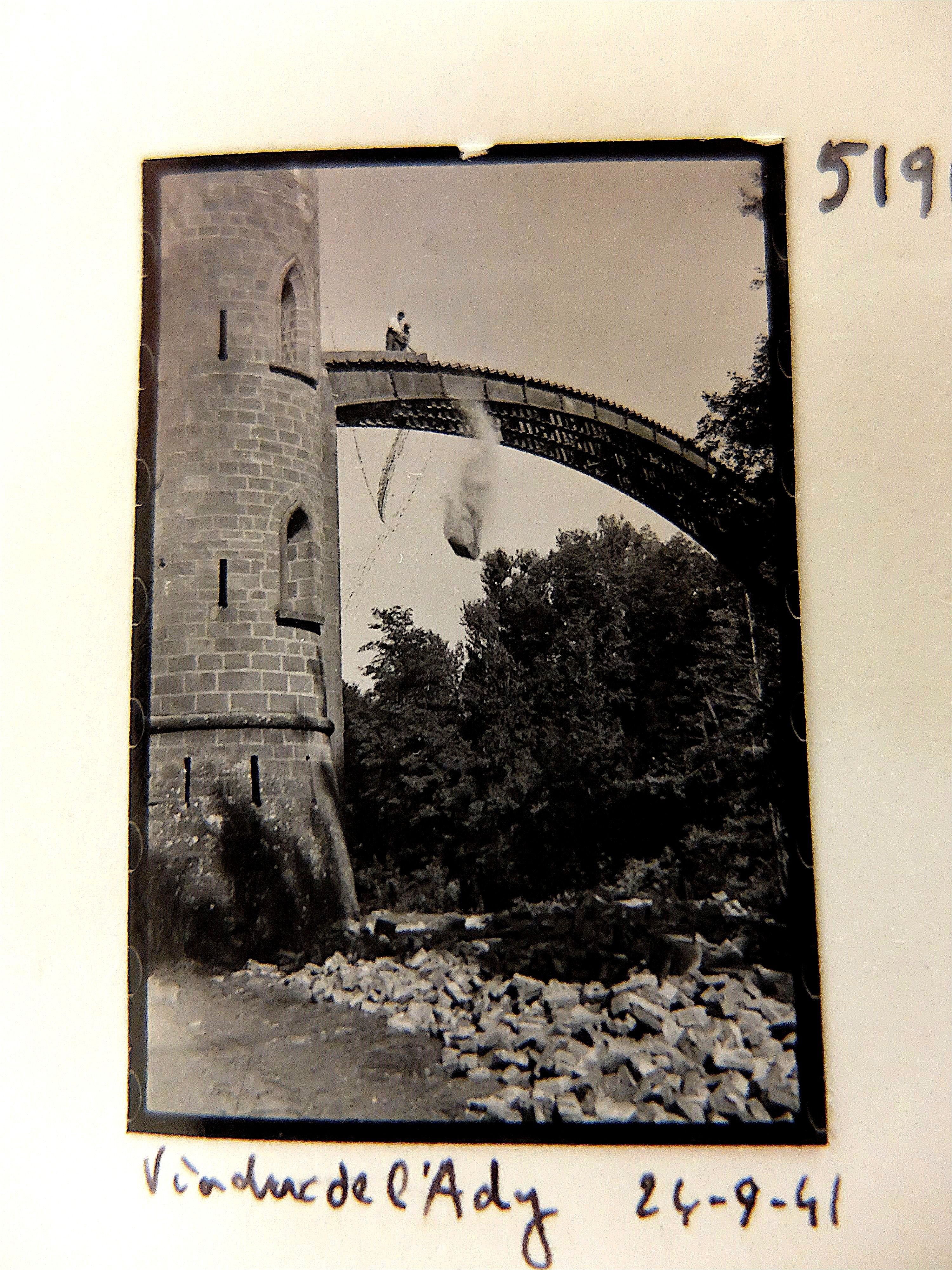 |
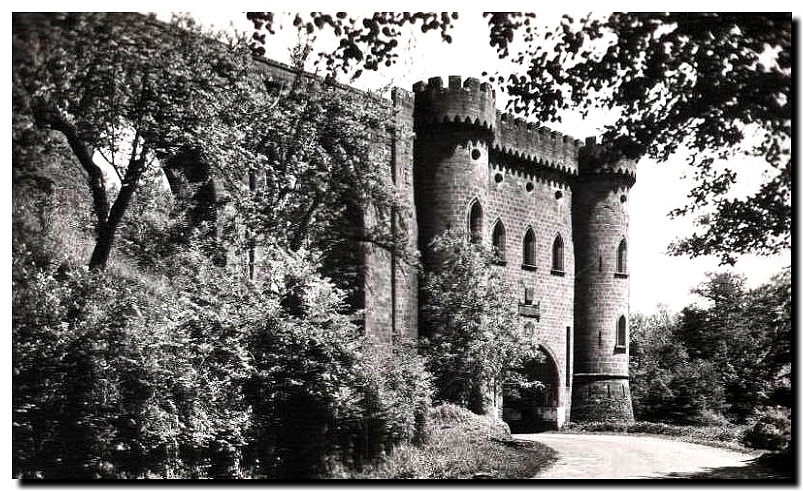
Ce beau viaduc, c'était celui de l'Ady (coll. ASPIBD), dans toute sa majesté...


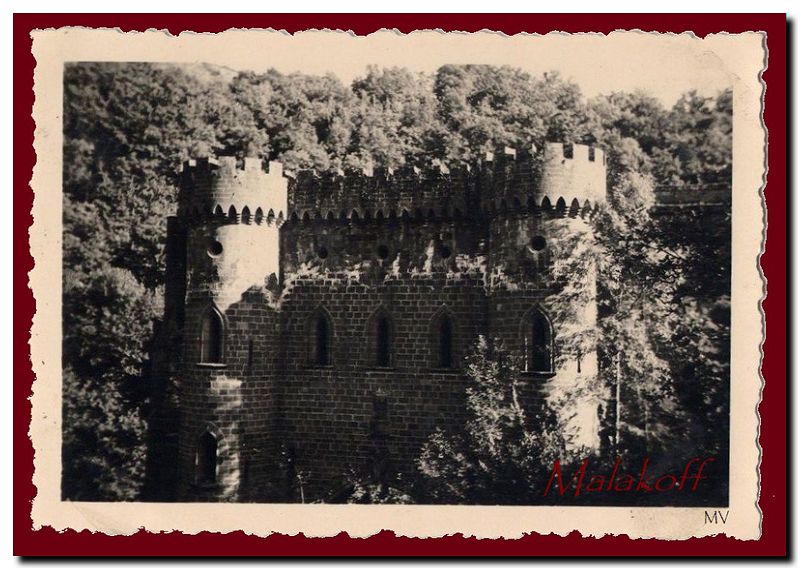
Au
fond du tiroir, (merci Madame V),
ces
deux belles images. La seconde montre l'arrière de la pile rive gauche,
photographie rarement faite. En l'observant de très près, on peut
constater que les pierres sculptées juste au dessus du porche de
passage ont disparu, proprement déposées...et nous l'espérons très
proprement reposées ailleurs ! La sculpture ressemblait à une tour de
jeu d'échec.
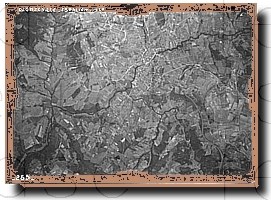 L’IGN,
Institut géographique National, met à disposition, une de
ses missions, ses ressources en photographies aériennes.
C’est ainsi que nous pouvons vous présenter plusieurs
états du viaduc de l’Ady ne
souffrant aucune contestation sur les dates des documents, ce qui peut
être le
cas pour certaines cartes postales.
L’IGN,
Institut géographique National, met à disposition, une de
ses missions, ses ressources en photographies aériennes.
C’est ainsi que nous pouvons vous présenter plusieurs
états du viaduc de l’Ady ne
souffrant aucune contestation sur les dates des documents, ce qui peut
être le
cas pour certaines cartes postales.
Ces documents sont une « information publique librement
utilisable »,
© IGN.
Les données techniques et analyses des missions présentées sont les suivantes :
Mission 1948 F, Decazeville Espalion, 2338-2438, échelle des originaux 1/25.000, clichés n° 255 et 256, (ce dernier le plus à l’ouest). Le survol a eu lieu le 4 juillet 1948.
Les deux images sont extraites de deux clichés successifs, 256 à gauche et 255 à droite. Le soleil est un peu plus haut sur l’horizon pour le cliché de gauche. Le viaduc résiste ! La pile rive gauche, celle sous laquelle la route serpente est encore debout ainsi que les arches. Par contre, l’arc est (évidemment à cette époque) totalement absent et rive droite de l’Ady, il semble que les activités de démolition soient très actives. Le chantier se remarque par la tache blanche. On peut imaginer au vu de la photo quelques dispositions du chantier : végétation maltraitée autour de la pile droite, chemin de circulation et aires de stockage et de reprise des pierres. La date semble de plus être propice au travaux, juillet étant pour le ruisseau Ady synonyme de basses eaux.


1956. Mission 2338 (2336 ?)-2638, 1/25.000, du 14 mai 1956. Les clichés utilisés portent les numéros 124 et 125. Sur la vue d’ensemble, on repère à droite, et en oblique, la voie ferrée à voie « normale » se dirigeant en haut vers Rodez. Le tunnel de Marcillac est tout proche. A gauche et sensiblement parallèle, la route de l’Ady : elle passe toujours, au bas de l'image, sous le viaduc, enfin ce qu’il en reste. La pile rive gauche avec ses tours cylindriques est parfaitement reconnaissable, l’agrandissement suivant montre bien sa géométrie. On peut suivre les belles courbes de la voie minière, la végétation en conserve parfaitement l’empreinte, depuis les quelques restes rive droite vers l’entrée du long tunnel qui menait au pont rouge, puis à la gare minière de Marcillac. La même végétation commence à rendre invisible les arches non démolies rive droite, arches toujours présentes en 2010…et à peu près totalement indiscernables.
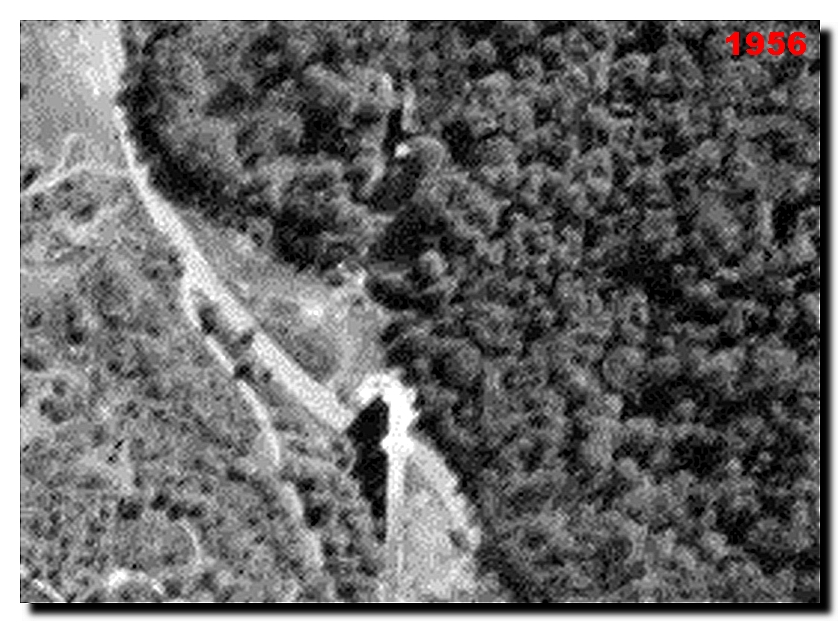
Autre image, extrait, la mission IGN de 1964. Pas de doute, on en parlera au passé ! La pile rive gauche n'est plus là le 17 juin 1964...
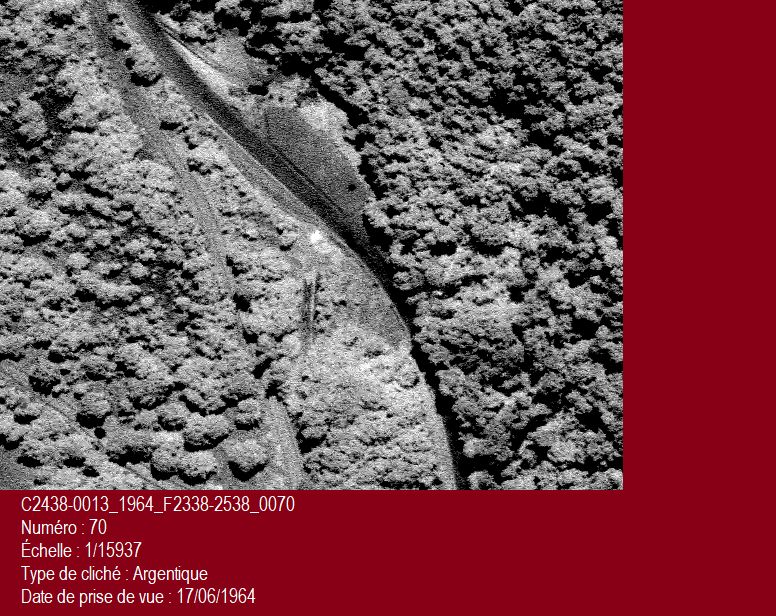
Il n'est pas facile de donner un nom à l'ouvrage. Pour François Cabrol, c'est pont -viaduc de l'Ady, si la plaque du tableau de la Société des Lettres est bien de sa main, ce qui n'est pas prouvé. Pour les photographes et éditeurs de cartes postales, on trouve quelques...variations, pour ne pas dire approximations, y compris sur la commune d'implantation. Voici le détail de cette implantation, (Geoportail IGN), sur la commune de Valady, sans aucune erreur possible, et quelques unes des légendes relevées sur des cartes, dont les erreurs portent sur le nom, l'implantation et l'orthographe : aucune ( ! ) de ces légendes n'est exacte.
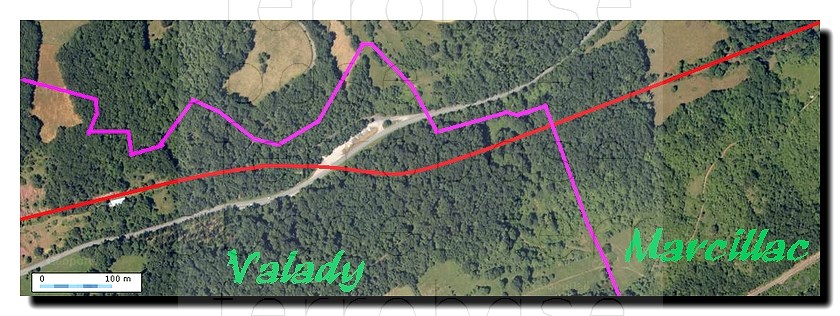
gement 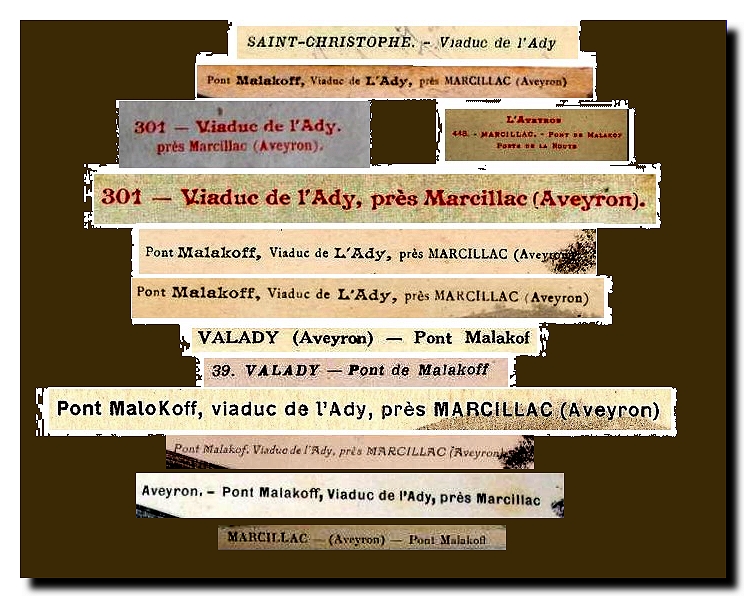
Après démolition, les pierres de l'Ady ont donc connu des destinations diverses. Voici l'une de ces destinations, un autre pont, ce qui est un moindre mal, sur le Lot, à Espalion.

Le fantôme du Vieux Pont, il y a peut-être du vrai…
Le
Vieux-Pont ou Pont-Vieux d’Espalion est une magnifique œuvre.
Incontournable
clin d’œil pour tous. Son aspect actuel n’a pas grand chose à voir
avec celui
de ses origines. Il n’avait pas cette allure semi-gothique,
et sur son tablier, on trouvait habitations et
échoppes, faisant de ce passage du Lot un passage fréquenté et habité.
Le péage
perçu, on pouvait donc franchir l’obstacle. Mais le péage, destiné dans
son
principe à être consacré aux travaux d’entretien fut assez
naturellement
détourné de cet objet. De nombreux conflits témoignent de ce laisser
aller,
profitable pour les uns, mais évidemment dommageable pour le pont.
Bref, il fut
souvent mal entretenu et soumis depuis
plusieurs siècles à de nombreuses reprises et transformations. La
dernière en
date des grandes interventions est très proche,
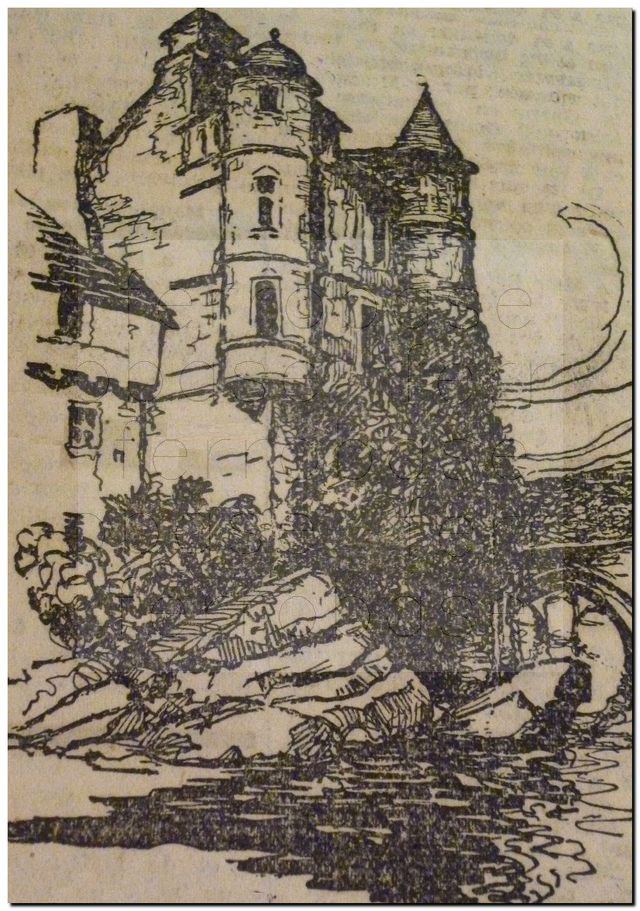 Le Rouergue Républicain (RR) nous apprend donc, sous la
vignette du Vieux Palais, autre beauté voisine, que le 1 février 1947, le Conseil Municipal d’Espalion proteste
contre la lenteur ou l’inertie apportée aux dits travaux. Le 21
juin, l’autorisation est donnée à la Commune de
procéder à la réfection des Piles du Vieux-Pont (RR). L’hiver 1947
ne va
pas ralentir les travaux : le 21 décembre, le RR compatit aux conditions de travail difficiles qui sont
celles des ouvriers (RR). De juin 1947 à fin 1948, ce sera pour le
pont le
temps du renouveau. Des batardeaux en palplanches métalliques sont
foncés
autour des deux piles en juin 1947. Les enceintes mises ainsi à sec par dragage et pompage, permettent la
réalisation de massifs en béton venant ceinturer les fondations. Les
vides,
très importants, plusieurs m3, découverts
à l’occasion de cette mise à sec
des appuis sont évidemment comblés. Fin 1948, après 16 mois d’activité,
les
travaux sont terminés, à l’exception des parapets qui seront réalisés
quelques
mois plus tard.
Le Rouergue Républicain (RR) nous apprend donc, sous la
vignette du Vieux Palais, autre beauté voisine, que le 1 février 1947, le Conseil Municipal d’Espalion proteste
contre la lenteur ou l’inertie apportée aux dits travaux. Le 21
juin, l’autorisation est donnée à la Commune de
procéder à la réfection des Piles du Vieux-Pont (RR). L’hiver 1947
ne va
pas ralentir les travaux : le 21 décembre, le RR compatit aux conditions de travail difficiles qui sont
celles des ouvriers (RR). De juin 1947 à fin 1948, ce sera pour le
pont le
temps du renouveau. Des batardeaux en palplanches métalliques sont
foncés
autour des deux piles en juin 1947. Les enceintes mises ainsi à sec par dragage et pompage, permettent la
réalisation de massifs en béton venant ceinturer les fondations. Les
vides,
très importants, plusieurs m3, découverts
à l’occasion de cette mise à sec
des appuis sont évidemment comblés. Fin 1948, après 16 mois d’activité,
les
travaux sont terminés, à l’exception des parapets qui seront réalisés
quelques
mois plus tard.
Ces travaux ont permis également de reprendre les faces visibles de l’ouvrage. De nombreuses pierres, rongées par les eaux et les intempéries, sont remplacées. Le Bulletin d’Espalion du 2 octobre 1948 précise que pour cet usage, sont utilisées des pierres provenant du pont, dit de Malakoff, situé près de Marcillac, dont les matériaux ont la même teinte que ceux de notre édifice. C’est ainsi qu’il y a bien un lien très fort entre le patrimoine minier et Espalion. A la fin des années quarante, un entrepreneur procédait à la démolition du viaduc de l’Ady, autre nom du pont Malakoff, et les pierres furent effectivement proposées pour d’autres constructions, comme ici à Espalion. En observant bien, certaines pierres se distinguent par leur texture, moins rongées, et leur couleur. On sait bien sûr que le pont Malakoff, dans la vallée de l’Ady, était un des grands ouvrages de la ligne minière qui verra passer de 1856 à 1920 de multiples trains de minerai de fer, minerai venant du causse Comtal. C’était sans doute l’ouvrage le plus connu de la Route du Fer.
On dit, faut-il le croire, que certains soirs, lorsque les eaux du Lot sont très calmes, il est même possible d’entendre le bruit d’un train sur le Vieux-Pont, un fantôme sûrement…mais les pierres de Malakoff sont elles bien présentes.
▲clic : à gauche dans un état "moyen", et
à droite après restauration
Eléments bibliographiques locaux :
Le Rouergue Républicain, 1948,1949
Le Bulletin d’Espalion, 1948
CARNUS M., Le Pont-Vieux d’Espalion, 1983
CARNUS M., Enquête sur les ponts et chemins de
l’Espalionnais, 1978
Notre parcours nous
conduit enfin à Marcillac. Auparavant il faudra passer le très long
tunnel
terminal, qui joint la vallée de l’Ady au pont rouge à Marcillac, un
petit
kilomètre plus loin. Le portail d’entrée du tunnel est aussi remarquable
que le viaduc
précédent !
Sa découverte se fera en pleine nature. L’accès est possible depuis la vallée de l’Ady ou depuis un chemin en venant de Marcillac, au départ de Bougonnes par exemple. Le portail est matérialisé sur la carte, ce dernier itinéraire est vraiment pentu…mais offre une très belle vue. Plus calme serait de prendre ce chemin dans l’autre sens, depuis Moulines.

et
tout au bout
du chemin, avec ses colonnes et son faîte
crénelé :
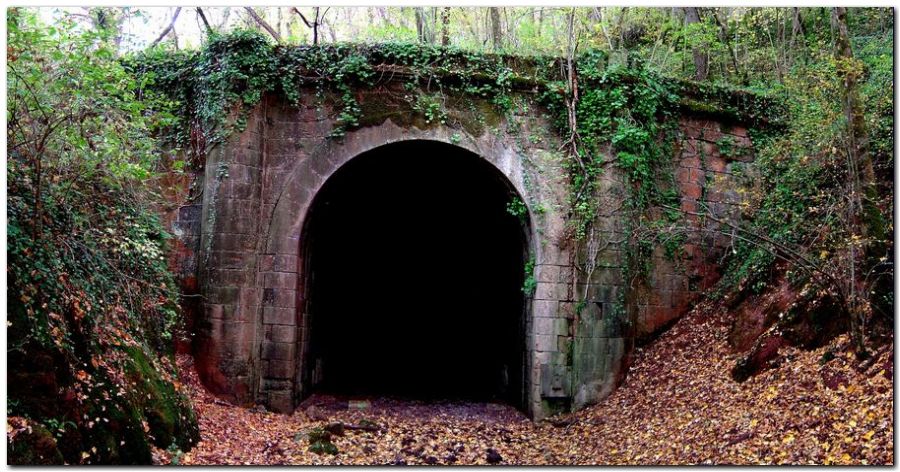
La
fin du parcours se fait
en zone quasi urbaine à Marcillac, le Pont Rouge, puis tunnel court
mais non
accessible, vers le site de la gare. Ce
dernier pont est également de la main de Cabrol, mais de facture plus
académique…

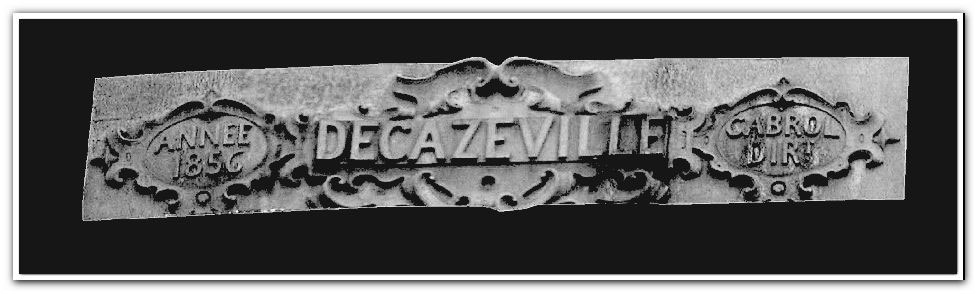
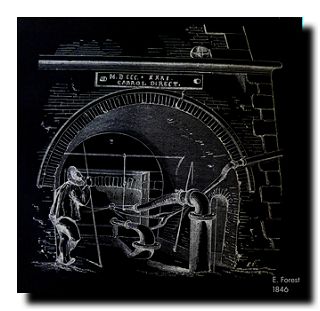 ages
et
documents.
ages
et
documents.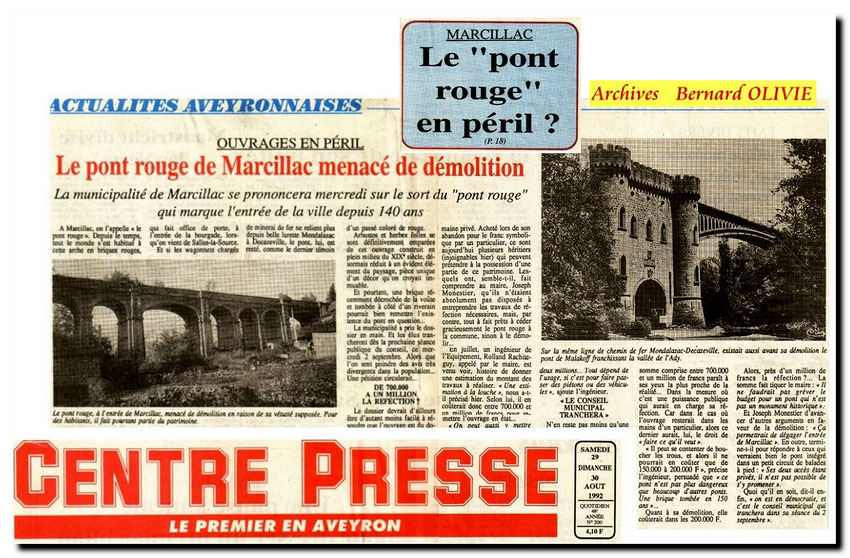
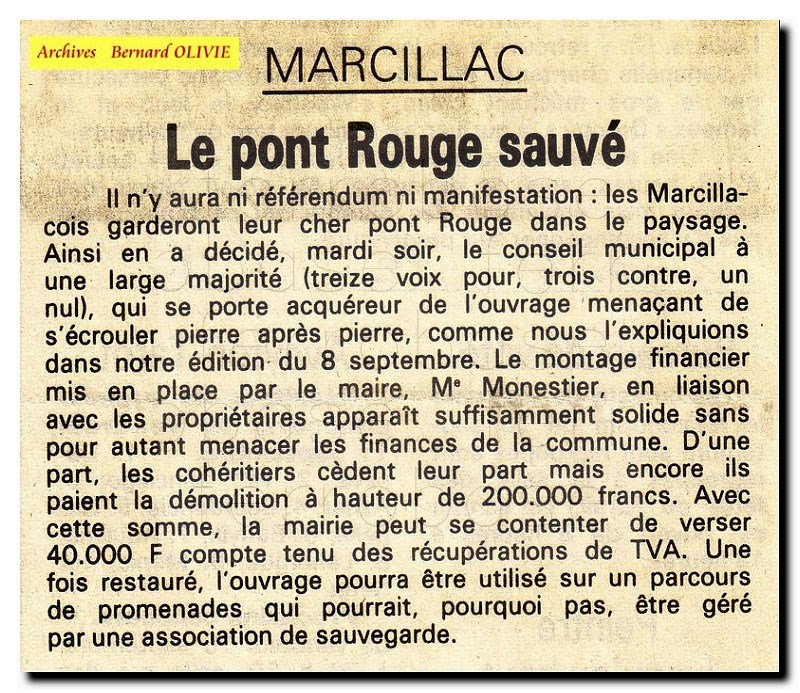
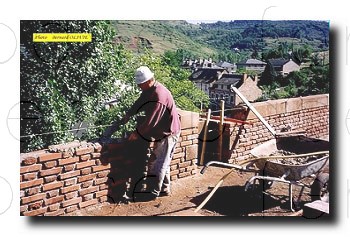 Suite à ce
sauvetage, des travaux furent réalisés pour lui redonner un
nouveau départ. Le parcours de promenades envisagé en 1992 se
fait un peu attendre, mais il n'est pas iréaliste de penser qu'une
Route du Fer pourrait
passer ici : Marcillac- St Christophe- Firmi, pourquoi pas ?
Suite à ce
sauvetage, des travaux furent réalisés pour lui redonner un
nouveau départ. Le parcours de promenades envisagé en 1992 se
fait un peu attendre, mais il n'est pas iréaliste de penser qu'une
Route du Fer pourrait
passer ici : Marcillac- St Christophe- Firmi, pourquoi pas ? 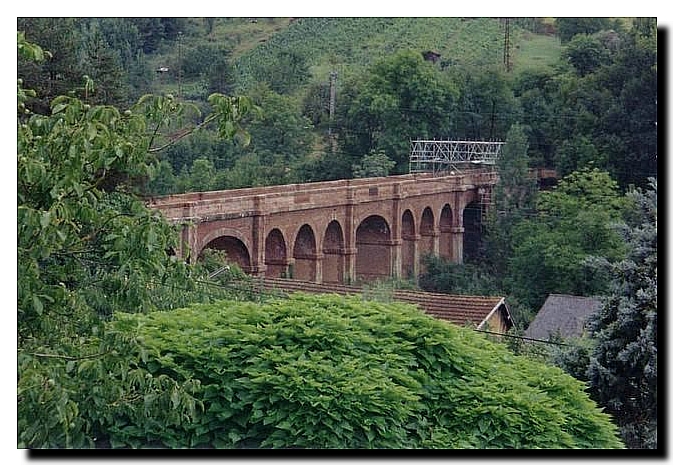
La suite de la revue de presse, archives B. Olivié, précise les conditions du sauvetage du pont.

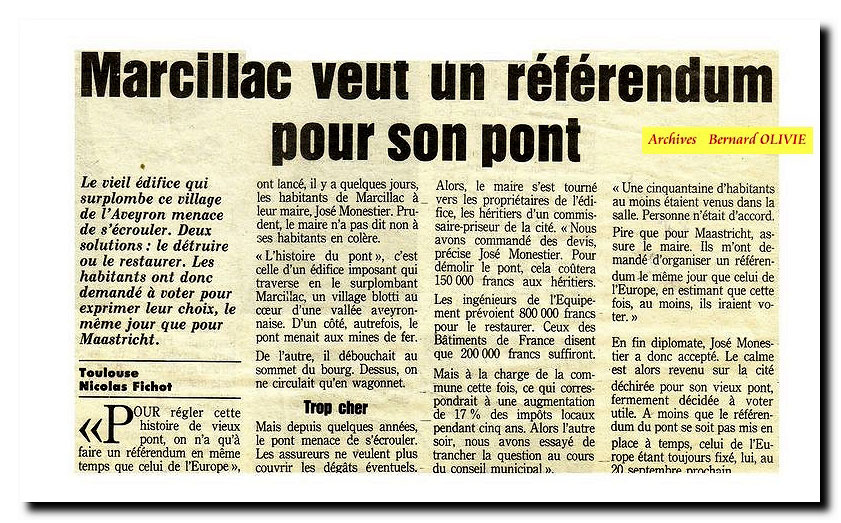
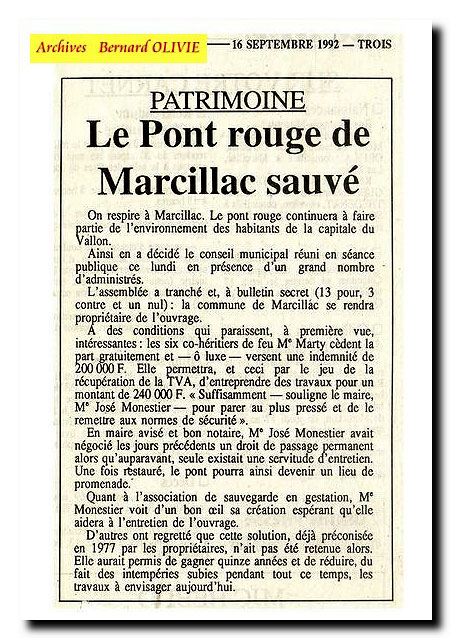
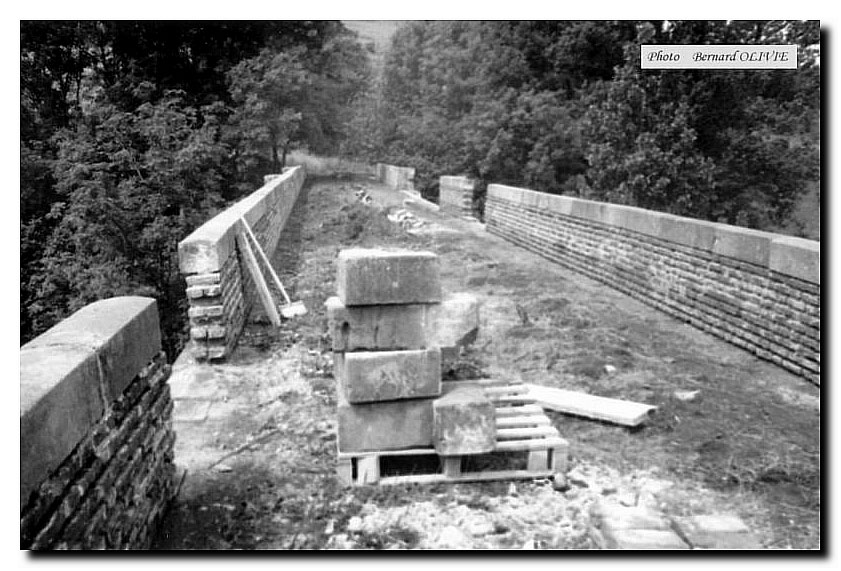
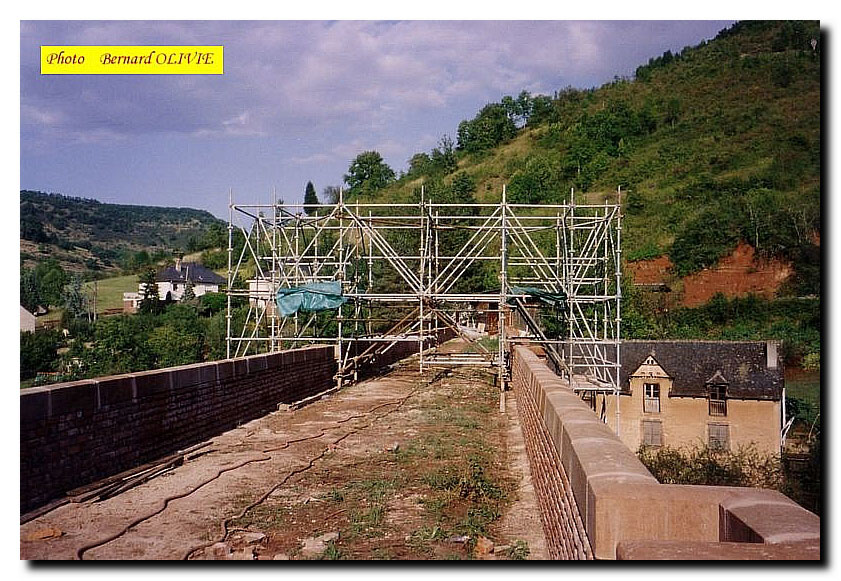
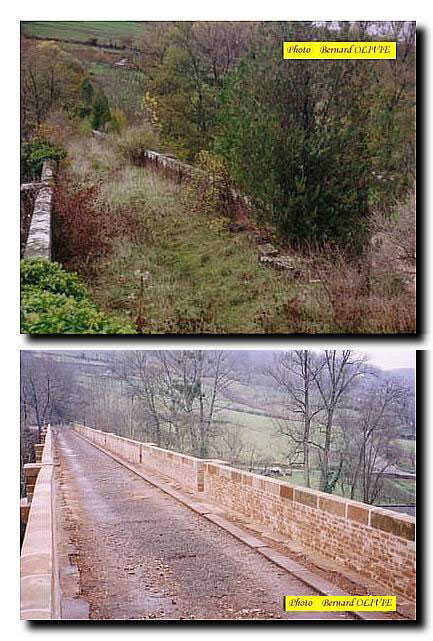
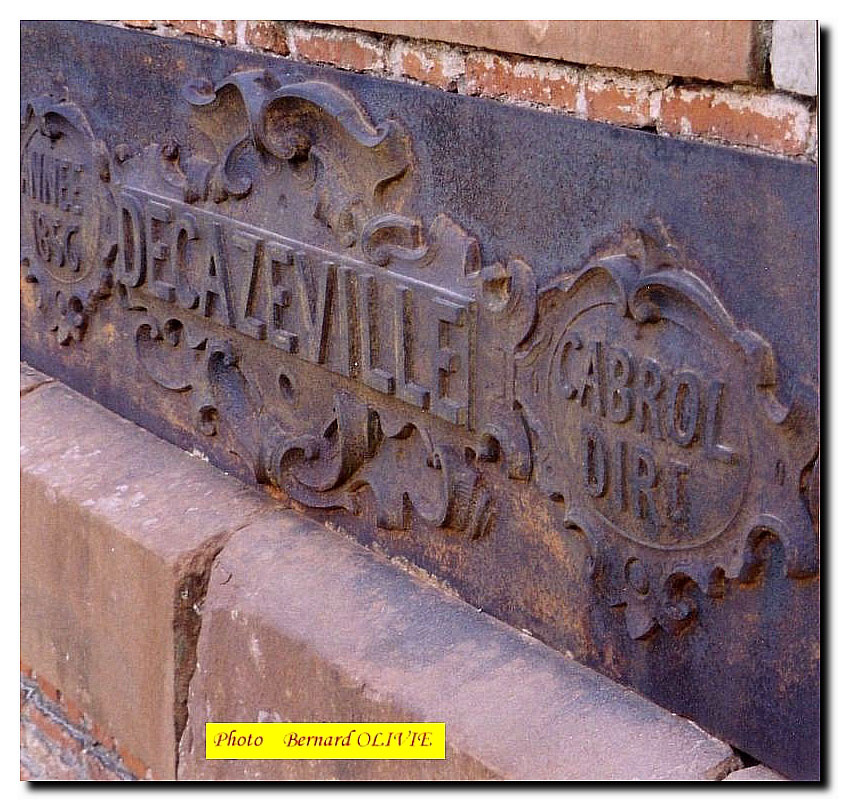
Il aurait été dommage de quitter le Pont Rouge sans rendre compte de son usage, voir passer des trains ! Et si beaucoup de cartes postales de Marcillac proposent une vue du Pont Rouge, aucune, oui aucune, (peut-être une, mais sans grande certitude), ne présente un train minier en situation. Les archives non dépouillées du fonds Labouche à Toulouse permettraient peut -être de faire des découvertes ? Aussi on va savourer l'agrandissement suivant du seul cliché que nous connaissons du pont avec train : de beaux panaches pour évoquer les circulations. La précision n'est pas de règle, mais peu importe, attention aux escarbilles! (coll. part., DR)

Il reste un dernier tunnel, relativement court, mais de très bonne facture, et ce sera le débouché sur le dépôt de minerai, la gare du chemin aérien de Marcillac.
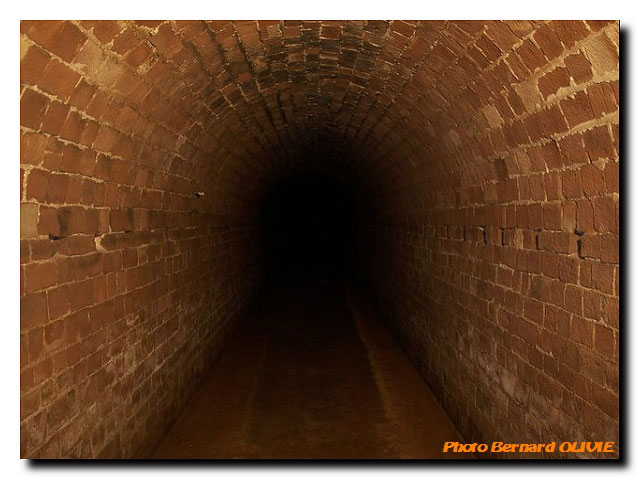
Les archives de l’ASPIBD à Decazeville nous ont permis de retrouver ces deux images :
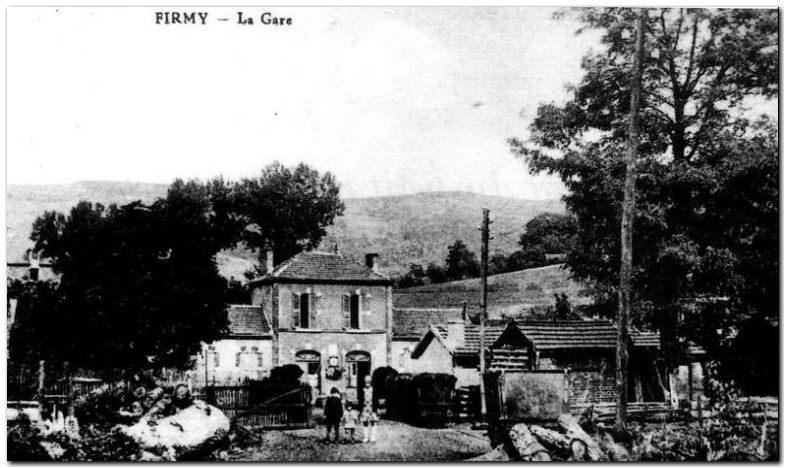
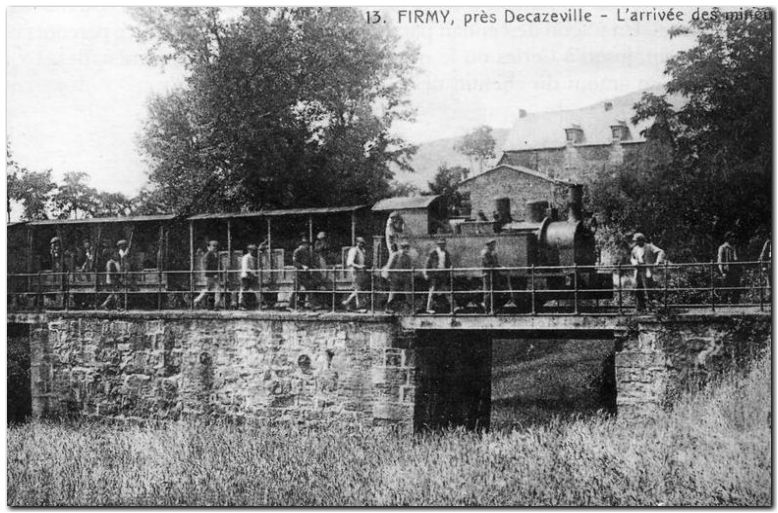
Les images suivantes sont
également extraites des archives de l'ASPIBD.
La
gare de Firmi, ou plus probablement, Firmy, car la photo semble
ancienne. Ancienne et comme le précisent les spécialistes, animée : pas
moins de 21 personnes posent, c'est le cas de le dire. Parmi ces
personnes, on distinguera quelques
"visiteurs", en habit et chapeau, au
premier plan, bien sûr ! Ils sont trois, peut-être des personnalités
locales, ou des responsables des hauts fourneaux ? Au second plan, les
"travailleurs" : casquette,
et habits de labeur, blouse et
pantalon. Certains sont juchés sur la locomotive qui devait servir aux
mouvements locaux de wagons, locomotive en action, avec sa fumée
blanche...
 Et
en arrière plan, les "civils",
aux approches même de la gare et devant
le bâtiment de gauche. Il y a également quelques femmes et enfants. Une
référence en bas à droite (2)3071, celle du photographe. On peut
risquer une interprétation : photographie très officielle de la
compagnie des mines probablement par cette mise en scène qui ne doit
rien au hasard, et où tout le monde, ou presque, regarde
l'opérateur. Sur le plan technique, il y a donc trois locomotives : une
en chauffe, et ça fume, attelée à quelques wagons chargés, à
droite (une 020T ? ). A l'extrême droite, une autre locomotive (030T
Couillet ?) est apparemment encore en charge d'une longue série de
wagons chargés, sur la quatrième voie à partir du premier plan. Elle
semble en chauffe, mais rien de très certain. A gauche de l'image, une
troisième locomotive, sur la voie trois, et tout à coté une
autre
"personnalité ", qui ne
regarde pas l'objectif ! Nous sommes en hiver,
et quelques arbres bien chétifs font de la figuration. C'est à notre
sens, et malgré son coté photo, un peu décevant, nous l'aurions
préférée
évidemment plus nette, contrastée,...et nous l'avons quelque peu remise
en forme pour la présenter, c'est donc un cliché remarquable par le
témoignage qu'il nous apporte, sur une époque, sur une activité, sur
des personnes et leur organisation sociale...La date ? Ah oui, ce sera
dit quelques lignes plus bas.
Et
en arrière plan, les "civils",
aux approches même de la gare et devant
le bâtiment de gauche. Il y a également quelques femmes et enfants. Une
référence en bas à droite (2)3071, celle du photographe. On peut
risquer une interprétation : photographie très officielle de la
compagnie des mines probablement par cette mise en scène qui ne doit
rien au hasard, et où tout le monde, ou presque, regarde
l'opérateur. Sur le plan technique, il y a donc trois locomotives : une
en chauffe, et ça fume, attelée à quelques wagons chargés, à
droite (une 020T ? ). A l'extrême droite, une autre locomotive (030T
Couillet ?) est apparemment encore en charge d'une longue série de
wagons chargés, sur la quatrième voie à partir du premier plan. Elle
semble en chauffe, mais rien de très certain. A gauche de l'image, une
troisième locomotive, sur la voie trois, et tout à coté une
autre
"personnalité ", qui ne
regarde pas l'objectif ! Nous sommes en hiver,
et quelques arbres bien chétifs font de la figuration. C'est à notre
sens, et malgré son coté photo, un peu décevant, nous l'aurions
préférée
évidemment plus nette, contrastée,...et nous l'avons quelque peu remise
en forme pour la présenter, c'est donc un cliché remarquable par le
témoignage qu'il nous apporte, sur une époque, sur une activité, sur
des personnes et leur organisation sociale...La date ? Ah oui, ce sera
dit quelques lignes plus bas.
Trois
autres images nous mettrons dans l'ambiance de ce chemin à voie de 66
vers Marcillac.
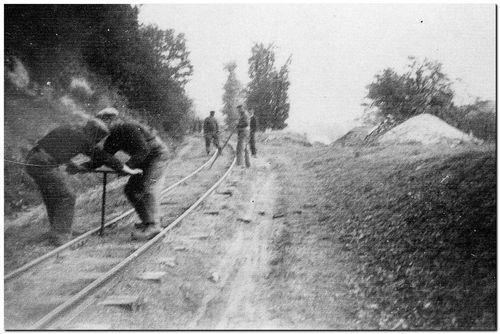
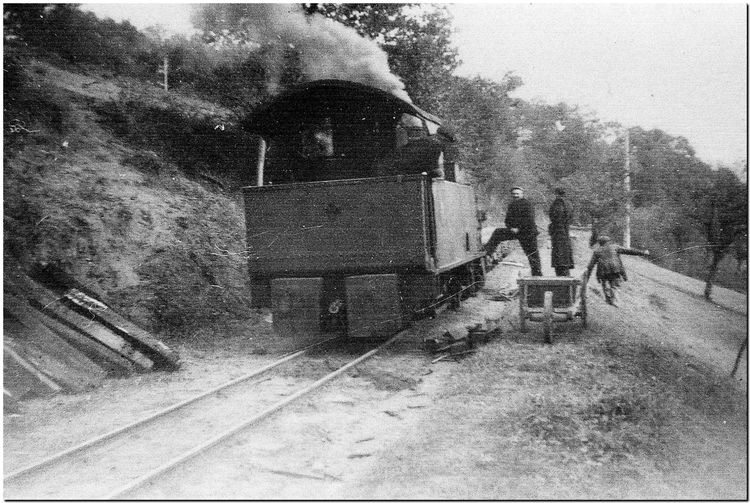
Nous sommes où exactement ? Pas facile à préciser, quelque part Firmi et Saint Christophe et avant le plateau d'Hymes à notre avis, donc des clichés plus proches de Firmi. Sur l'un, les équipes de la voie sont au travail : des gestes et des postures traditionnels dans le monde du chemin de fer. Sur l'autre image, un couple, et leur enfant qui risque une glissade dans le remblai, font un brin de causette avec le mécanicien ; nous sommes en rampe, donc dans la direction de St Christophe et Marcillac, et la voie a fait l'objet d'une rénovation lourde : les traverses usagées sont en tas sur le talus, le ballast est propre...
Autre cliché : celui d'un ouvrage d'art. Ces clichés sont rares : les ouvrages ont disparu depuis bien longtemps. Et ils n'avaient pas à priori le même intérêt pour un photographe que le pont de l'Ady, dit Malakoff, ou le pont rouge à Marcillac. Donc pas d'images...Enfin, pas ou peu, car il doit bien en exister quelques unes, des photos de ces obscurs mais incontournables éléments de la ligne. Celui qui est présenté ici est long, possède deux travées, est en alignement et sans doute en légère pente ; donc ....c'est probablement le pont dit américain quelquefois, mais pourquoi ? En raison vraisemblablement du treillis, type d'ouvrage fréquent outre océan à cette époque, dans le tronçon Hymes Firmi (pont du Claux, deux travées de 27,50 m, à 14 m de hauteur).
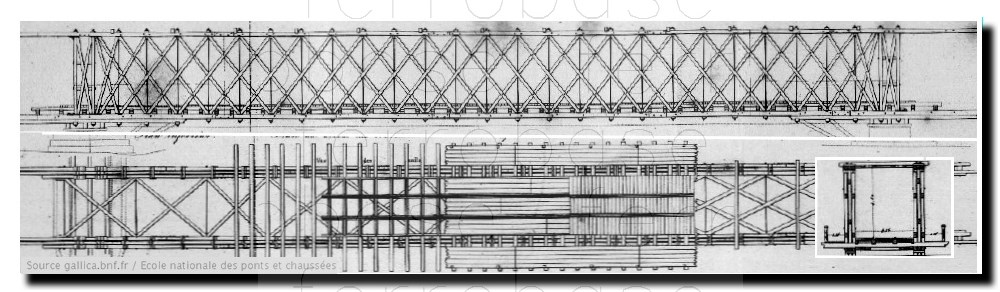
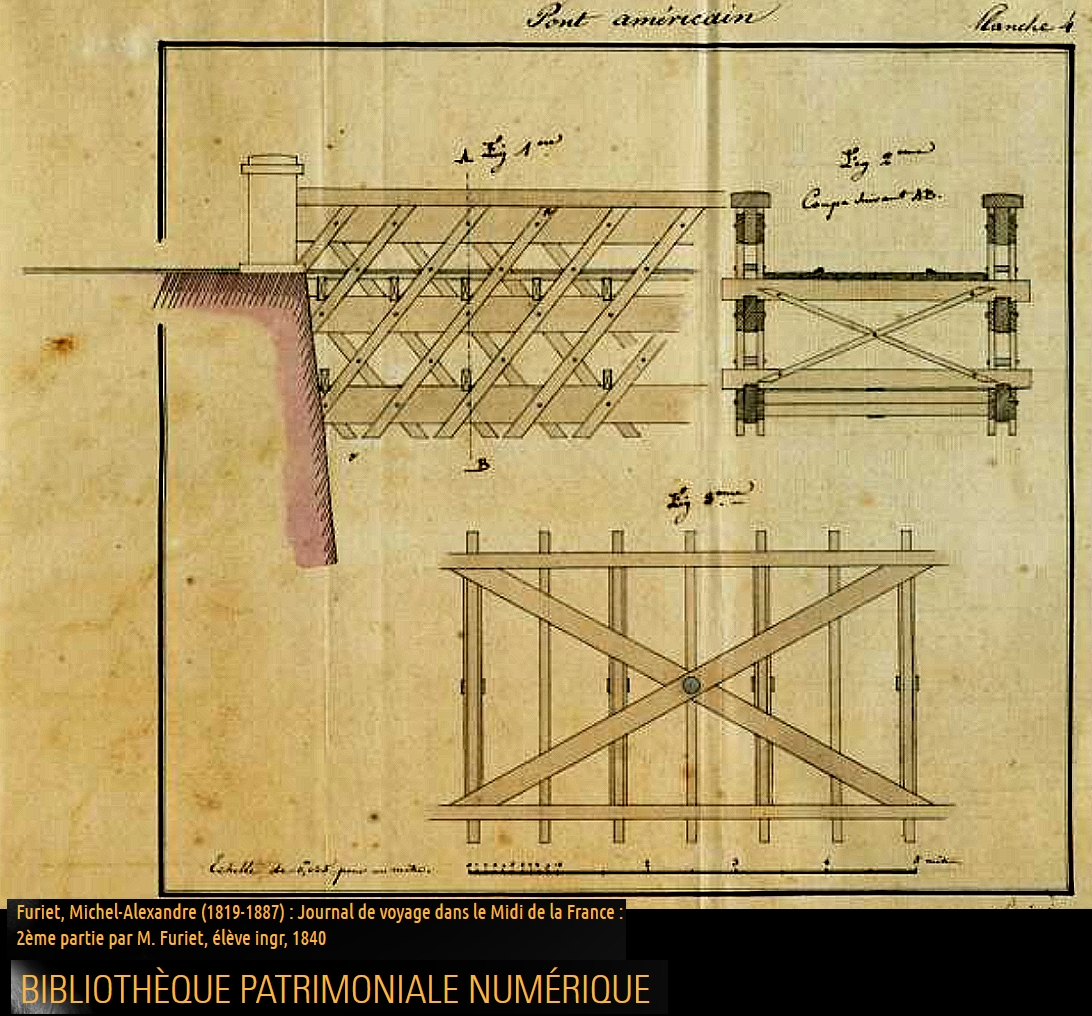
▲Pont américain, Journal de voyage, Furiet Michel, 1840.
Bibliothèque
numérique patrimoniale, Ecole Mines ParisTech
Une définition historique des ponts américains - au sens que l'on pouvait donner à cette expression vers 1850 - peut être trouvée dans La Nature (CNUM, La Nature, première année 1873, page 27) : ce sont des ponts tubulaires ou des ponts plats, en bois ou en fer, composés de pièces très courtes, assemblées au moyen de nombreux boulons. C’était courant aux Etats Unis dans les années 1840 à 1870 ; donc cela couvre la période de construction du pont évoqué, et avec ces précisions, nous vous laissons le soin d’imaginer la forme exacte de notre ouvrage….
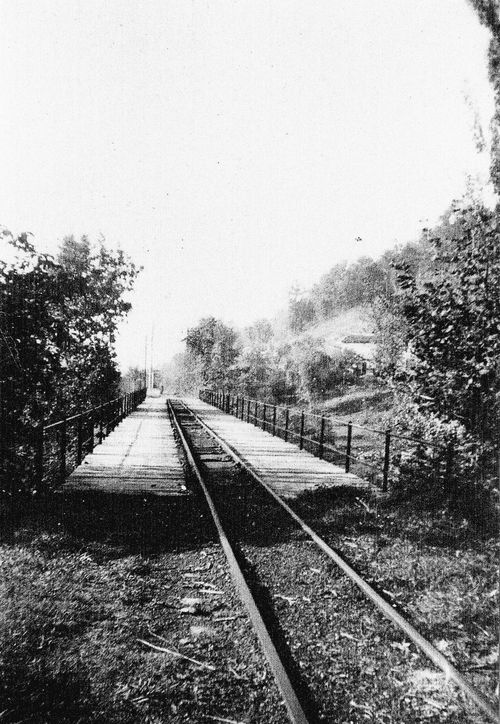
Notre parcours sur cette ligne va se terminer par ces évocations. Quelques chiffres avant de poursuivre ailleurs nos découvertes, chiffres et informations issus d'un mémoire de M. Bons sur la ligne de Firmy à Marcillac, mémoire en dépôt à l'Aspibd à Decazeville.
"C'est en 1827 et
1829 que l'autorisation d'exploitation de deux usines à fer est donnée
pour les sites de Firmy et Decazeville. Le minerai, celui de Mondalazac
bien sûr, appartenait à la Compagnie (des houillères et fonderies de
l'Aveyron) par ordonnance de février 1832. Dès 1852, les premiers rails
seront mis en place, près de Mondalazac, et ceux évoqués ici,
le
furent quelques années après. En 1856, fin des travaux de voie et le 1
janvier 1857, les rails reliaient Marcillac à Firmy : les
roulages
par chevaux allaient pouvoir commencer. Plus tard, la voie continua
vers Decazeville, que la Compagnie d'Orléans avait raccordée à son
réseau à voie normale en juillet 1858. L'équipement de la voie est en
rails type Vignole de 12 kg/m, avec un écartement
de
0,66 m (dit quelquefois voie de 60 par simplification abusive! mais
Decauville et la vraie voie de 60 bien connue des betteraviers et
autres militaires fera son apparition dans les années 1880 et
suivantes...). La traction était assurée par chevaux jusqu'en 1870. En
1874 les locomotives avaient pris le relais. De petites
machines
d'abord, puis après 1880, des locomotives 030 T Couillet de 9
t,
plus adaptées au trafic demandé.
M. Bons donne dans
son mémoire le
texte du règlement de la voie, en vigueur en 1880. Nous avons
noté que
la pression ne devra pas dépasser 8 atmosphères (art 2), que le
service peut commencer à 5 1/2 h du matin (art 1), et que bien
évidemment il est expressément défendu de laisser monter quelqu'un,
soit sur les machines, soit sur les wagons (art 6). L'article 13
demande aux garde-tunnels de visiter entièrement le tunnel confié à
leur surveillance avant le passage de chaque train. On en déduit donc
que ce métier là était fait pour des lève tôt ! Très tôt, même, car les
tunnels les plus longs faisaient un kilomètre ; donc l'aller
retour en faisait...deux, et pour être opérationnel aux
premières
heures, la vitesse des trains étant au maximum de 15 km/h, il pouvait
donc être là à 6 heures environ, et comme on n'habitait pas
obligatoirement tout à coté du dit tunnel, il fallait donc se
lever à quelle heure ? Vous dites... ??

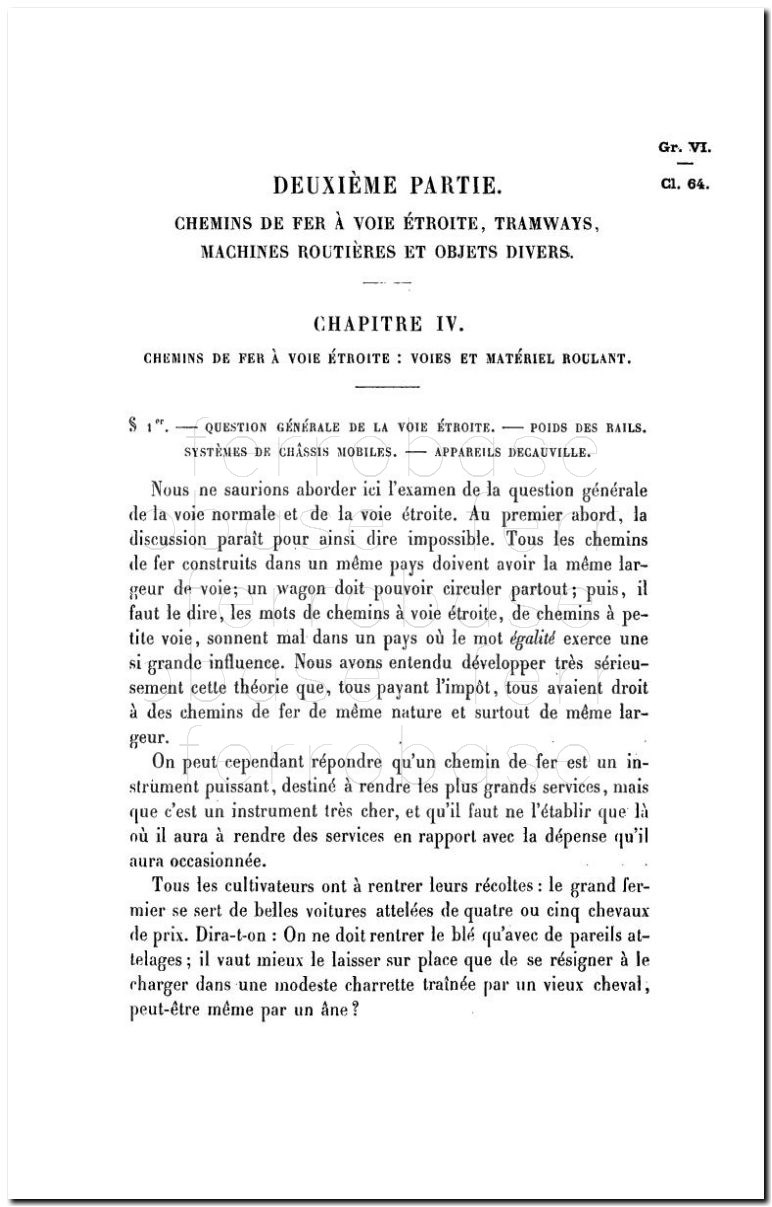
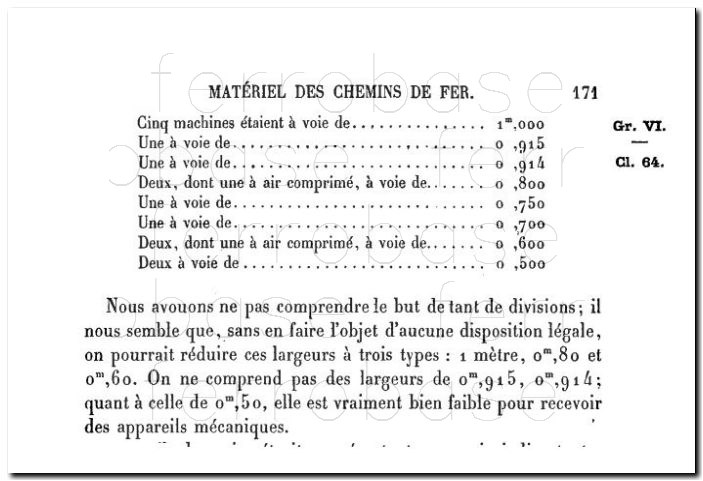
Les machines en charge des convois Decazeville Marcillac étaient d'origines diverses. C'est Eric Fresné (on pourra consulter sur un autre thème son site http://pagesperso-orange.fr/voiesdesoixante ) qui a recherché pour nous, la liste de ces machines à voies étroites. Il y a effectivement à Decazeville une majorité de machines Couillet (constructeur belge dans le Hainaut), à Decazeville donc, au sens large, et lesquelles exactement montaient à Marcillac ? Une question à résoudre...
Couillet :
030T N°442/1881
020T N°539/1881
030T N°584/1881
030T N°625/1883
030T N°717/1883 N°11
030T N°762/1884 N°12
030T N°780/1884 N°13
030T N°949/1889 N°14
030T N°1087/1893 N°15
030T N°1255/1898
030T N°1302/1900
030T N°1303/1900 N°19
030T N°1647/1911 N°21
Et après cette
première période, on peut noter :
Corpet-Louvet
:
020T N°1577/1919 livrée le 20 octobre 1919
Orenstein & Koppel
Quatre locotracteurs LD2 livrés le 30 octobre 1935, engins à
2 essieux, moteur diesel et transmission mécanique.
N°6329/1935
N°6330/1935
N°6331/1935
N°6332/1935
Deutz :
Reliquat
d'une commande du Reich allemand, locotracteur OMZ122F, moteur diesel
et transmission mécanique. Prévu à l'origine pour la voie de 60 et
passé à 660
N°46793/1944
Il est très vraisemblable que cet inventaire, nous a précisé Eric Fresné, n'est pas exhaustif. Et toujours sur ce sujet, nous lançons l'appel suivant de recherche:
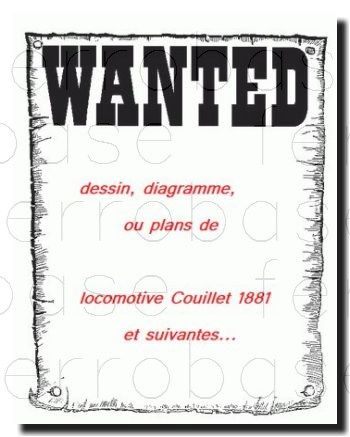
loc, loco, locomo, locomotives...
Marcillac,
numéro 909
Cail et Cie, Paris
année de la
fabrication : 1864
date de la demande
: 04/07/1863
date du rapport :
16/03/1864
date de
l'autorisation :18/04/1864
ligne :
Paris-Orléans
F/14/4228, dossier
: 3, année 1864
pièce(s) : 502-504
Cransac,
numéro 908
Cail et Cie, Paris
année de la
fabrication : 1864
date de la demande
: 04/07/1863
date du rapport :
04/01/1864
date de
l'autorisation :15/02/1864
ligne :
Paris-Orléans
F/14/4228, dossier
: 3, année 1864
pièce(s) : 469-471
Salles-la-Source,
numéro 910
Cail et Cie, Paris
année de la
fabrication : 1864
date de la demande
: 04/07/1863
date du rapport :
10/02/1864
date de
l'autorisation :10/03/1864
ligne :
Paris-Orléans
Une machine, enfin, est baptisée Decazeville :
Decazeville,
numéro
902
Cail et Cie, Paris
année de la fabrication : 1863
date de la demande : 04/07/1863
date du rapport : 31/07/1863
date de l'autorisation :20/08/1863
ligne : Paris-Orléans
F/14/4228, dossier : 2, année 1863
pièce(s) : 324
Et pour clôre, provisoirement, ces données matérielles, MM. Herranz et Pertus, dans Mines et Mineurs, ASPIBD, Decazeville, 2008, proposent un cliché d'une locomotive Couillet : la n° 10, baptisée Bourran, en chauffe, mais on ne sait où ! Aucun doute par contre sur le constructeur, même si la plaque, de forme très caractéristique des Couillet, est (très) difficilement lisible ! C'est bien une Couillet : ce n° 10 ne figurait pas dans l'inventaire ci-dessus...
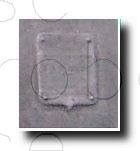
Quelques
éléments sur la période Commentry-Fourchambault et Decazeville
(CFD)
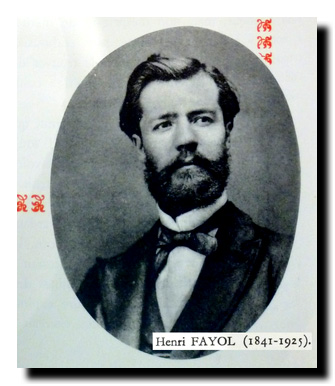
C'est en 1892 que CFD prend le contrôle de Decazeville. Le nom
de Decazeville sera ajouté peu après.
Henri Fayol préside alors aux destinées de l'entreprise. Directeur
général, il peut se représenter comme le "pionnier de la science dans
l'industrie minière". la Société lui rendra hommage dans La Société
Commentry-Fourchambault et Decazeville, 1854-1954, Paris
1954. Même hommage à L. Fayol par Louis Levêque, Directeur
à
Decazeville, qui publiera en 1916 son Histoire
des Forges de
Decazeville, 1826-1914, recueil des chroniques parues dans
le
Bulletin de la Société de l'Industrie Minérale, de janvier à juin
1916. Cet ouvrage a été (re)publié par l'ASPIBD à Decazeville en 2001.
Henri Fayol et Louis Levêque vont conduire le renouveau des
activités
de Decazeville. C'est par exemple la construction de l'aciérie
Thomas, plus adaptée au minerai de Mondalazac. L'investissement
sera
de 7.000.000 de francs en 1905 (de l'ordre de 1,5 milliard en francs
1954). Décidé par le Conseil de Commentry le 9 novembre
1905, l'aciérie Thomas connaîtra sa première
coulée le 15 mars 1909. Les
réglages industriels qui vont suivre donneront un outil de
qualité à
CFD. Cet outil est basé sur le minerai de Mondalazac et explique
les
investissements réalisés sur le causse : l'examen
des plans de
la mine avant et après cette période en témoignent
; il y aura également
la construction du chemin aérien vers Marcillac et son
exploitation effective à compter de 1911. En 1914 cette
rénovation est
achevée, la production est importante et de qualité
reconnue.
1914-1918,
Decazeville va se consacrer aux fabrications de guerre...
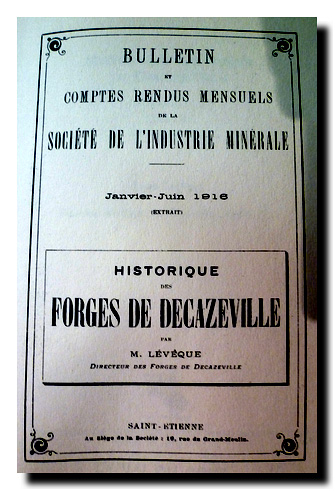 Il
en résultera en 1918 un ensemble métallurgique usé par les cadences, au
matériel vieilli. Ce sont deux des raisons qui vont amener l'arrêt
assez brutal de l'exploitation de Mondalazac, et donc du chemin
aérien et du chemin de fer de Marcillac.....
Il
en résultera en 1918 un ensemble métallurgique usé par les cadences, au
matériel vieilli. Ce sont deux des raisons qui vont amener l'arrêt
assez brutal de l'exploitation de Mondalazac, et donc du chemin
aérien et du chemin de fer de Marcillac.....
Il y a d'autres raisons à cet arrêt. La géologie d'abord. Le
minerai extrait est un calcaire ferrugineux à 20-25 % de richesse en
fer. Son utilisation nécessite un grillage préalable pour l'enrichir,
grillage qui était effectué à Mondalazac même on le sait au tout début,
puis Firmi. Après cette opération, la richesse reste bien loin des 32 %
et plus des minerais de l'Est (Levêque). C'est un argument très
défavorable pour poursuivre l'exploitation par Decazeville en
1919. Il y a aussi d'autres technologies que les convertisseurs
Thomas qui ne militent pas pour la rénovation après la guerre. Il y a
enfin pour la Société le paiement des "impôts
sur les bénéfices de
guerre ", correspondant à la production 1914-1918 : un impôt
très
critiqué par la Société.
La géologie, l'Histoire, le développement des techniques, trois
domaines qui tendent
chacun à condamner les mines de Mondalazac et ses wagonnets et trains
miniers. La situation presque un siècle plus tôt vers 1825 était
absolument contraire...
Quand des problèmes cette
fois sociaux surgissent en 1919, sous la forme d'une grève, la
Société CFD décide de mettre fin à l'aciérie Thomas et au train
réversible. Le Conseil de Commentry aura bien sûr à en connaître, et le
Journal de l'Aveyron s'en fera l'écho.
La Société analyse comme suit (op cit., 1954) cette période noire :
"...Après l'Armistice, la métallurgie
eut à retrouver son équilibre au
milieu des bouleversements que la guerre avait apportés dans les
conditions propres d'existence et dans la situation relative de
toutes les industries. L'usine de Decazeville se trouvait de nouveau
en libre concurrence, mais avec des salaires plus élevés, une durée de
travail et des rendements réduits, des approvisionnements plus chers,
une production diminuée, des prix de vente maxima imposés pendant
plusieurs mois. Les pertes que cette situation entraîna étaient telles
qu'à la suite de grèves qui ajoutèrent leurs perturbations aux
difficultés déjà considérables que l'usine rencontrait, la Société
dut arrêter l'aciérie Thomas et le train réversible". L'
avalanche des facteurs négatifs l'emportait donc de beaucoup
sur les espoirs de production qui avaient par exemple été évoqués par
Levêque, mais en 1916...Trois ans plus tard, l'histoire avait donc
fait son oeuvre.
" ...déjà l'on songe à
transformer les installations faites à l'arrivée de la Société de
Commentry-Fourchambault à Decazeville pour les remplacer par un
outillage plus moderne...." Les espoirs de M. Levêque ne vont
donc pas
être suivis d'effets.
Notre doyen des
journaux aveyronnais, Le Journal de l'Aveyron, évoque ainsi
sobrement cet arrêt en rendant compte de la Foire exposition des
industries et métiers de l'Aveyron, tenue à Rodez du 29 au 31 octobre
1921 :"...la Compagnie de
Commentry-Fourchambault et Decazeville
était là avec des échantillons de charbons, des fers marchands....Elle
trouve sur place le charbon qui lui est nécessaire, mais ses minerais,
tout au moins à l'heure actuelle, lui viennent d'Espagne, ceux du
pays (à Mondalazac, au Caymar, à Aubin), quoique exploités encore
pendant la guerre, n'étant pas assez riches pour rémunérer une
exploitation relativement coûteuse." (JA, 22/01/1922).
Louis Levêque décrit dans ses articles la
construction du chemin de fer Firmy Marcillac (p 64) :
" Le minerai de Marcillac prenant une
plus grande importance que par le
passé, on n'hésita pas, malgré l'époque peu favorable dans laquelle
on se trouvait, à adopter le projet d'un chemin de fer de 22 km, pour
vaincre les difficultés de transports que l'on rencontrait dans les
communications avec le gisement. L'adoption des voies ferrées entre
les différents points de l'exploitation à Decazeville avait amené une
diminution de 80 % dans les prix des transports ; on pensait obtenir
une
diminution du même ordre sur le parcours de Decazeville à Mondalazac.
....En 1848, le minerai de Mondalazac revenait à Decazeville à 10 fr
55, pour une production de 10 600 tonnes ; comme le prix d'extraction
était d'environ 1 fr 25 la tonne, les transports représentaient 88 %
du prix du minerai.
La première section du chemin
de fer, la plus facile à établir, de la
Forézie au Riou Nègre (14 km) fut livrée
à l'exploitation en décembre 1852.
La deuxième section, du Riou Nègre à Saint Christophe (2 km), coûta
50 % de plus que la première section, à cause d'un tunnel de 1 036 m
qu'il fallut percer ; elle fut terminée en novembre 1853.
La dernière section, de Saint Christophe à Marcillac (6
km), était de
beaucoup la plus difficile ; elle comprenait, entre autres travaux
d'art, deux tunnels de 360 et 930 m, et trois viaducs de plus de 100 m
de
long et de 12 à 20 m de hauteur.
Le viaduc
de Marcillac fut projeté en pierres et briques. Il mesure 120 m de
longueur et a 12 m de hauteur. Il se compose de quinze arches,
dont treize en plein cintre et deux en anse de panier plus larges pour
le passage de la rivière et de la route."
Sur la voie ferrée ne passait pas que le minerai de Mondalazac. Il y
eut aussi, celui de Lunel via Marcillac et surtout celui du Kaymar (ou
Caymar). " La minière de
Kaymar....a été arrêtée en 1903, peu de
temps après l'introduction des minerais des Pyrénées dans les
dosages, ces derniers étant plus avantageux comme prix que le minerai
de Kaymar. Cette mine est en effet située dans un pays éloigné,
difficile, et dépourvu de tout moyen économique de transport. Un fort
stock de minerai a été établi à Hymes, sur le trajet du chemin de fer à
voie étroite qui relie Decazeville à Marcillac, de façon à pouvoir y
puiser en cas de pénurie de minerais des Pyrénées, comme cela s'est
déjà produit il y a quelques années à la suite des grèves...."
Pour essayer de visualiser ce qu'était la période des débuts, vers 1840, voici deux gravures (in Louis Levêque, op cit, 1816) :

Ci-dessus, un haut fourneau à Decazeville en 1842, et les usines ci dessous à la même époque .
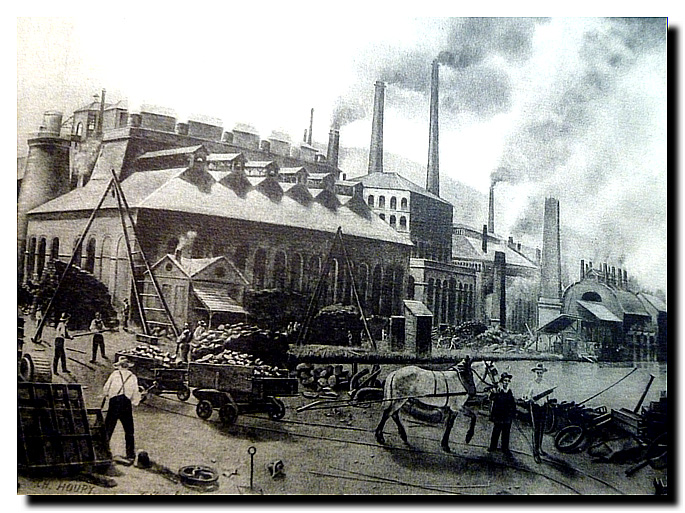
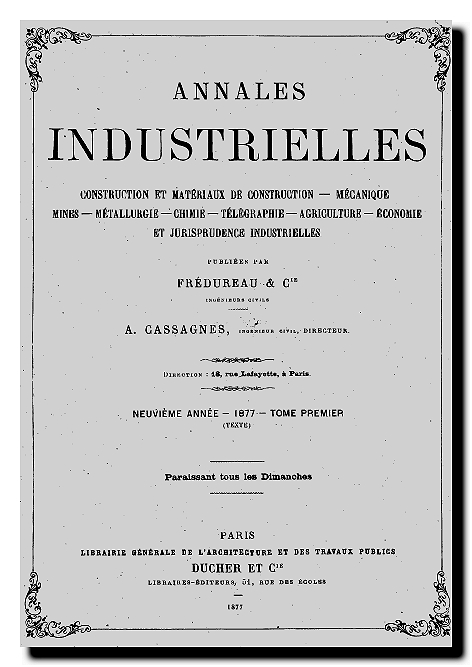 Les Annales
Industrielles
du 20 mai 1877 donnent un court article relatif à la voie
de 66 et ses matériels. Court, mais précieux par les nombreux
renseignements chiffrés pour certains inédits.
Les Annales
Industrielles
du 20 mai 1877 donnent un court article relatif à la voie
de 66 et ses matériels. Court, mais précieux par les nombreux
renseignements chiffrés pour certains inédits.
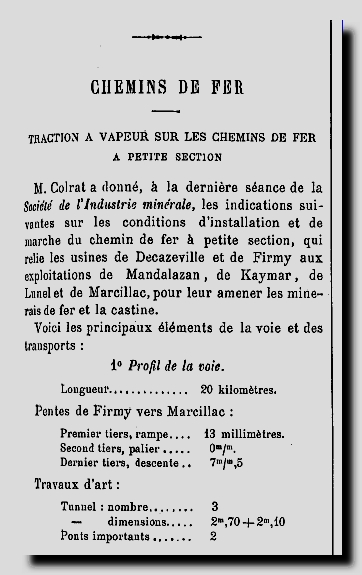
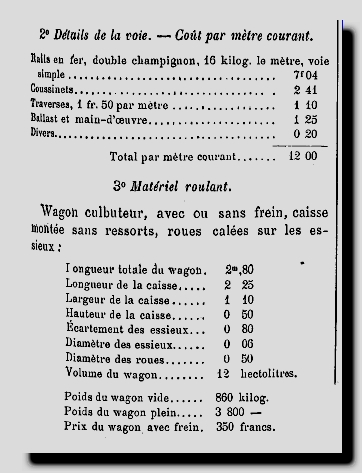
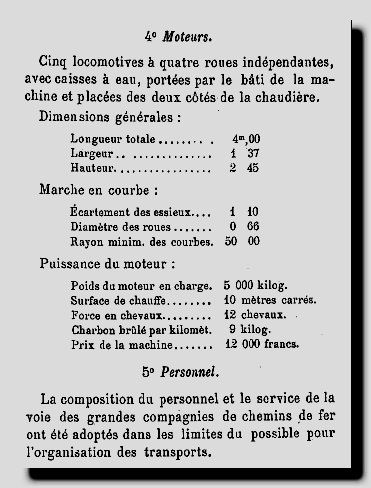
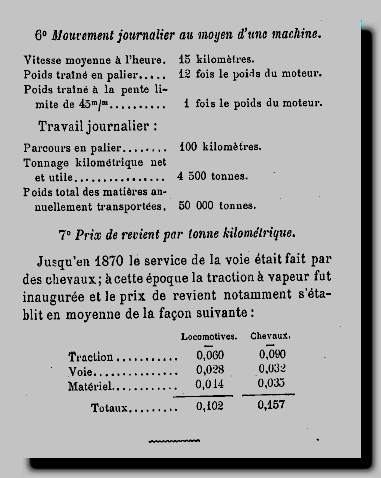
retour page menu
© 2026 Jean RUDELLE