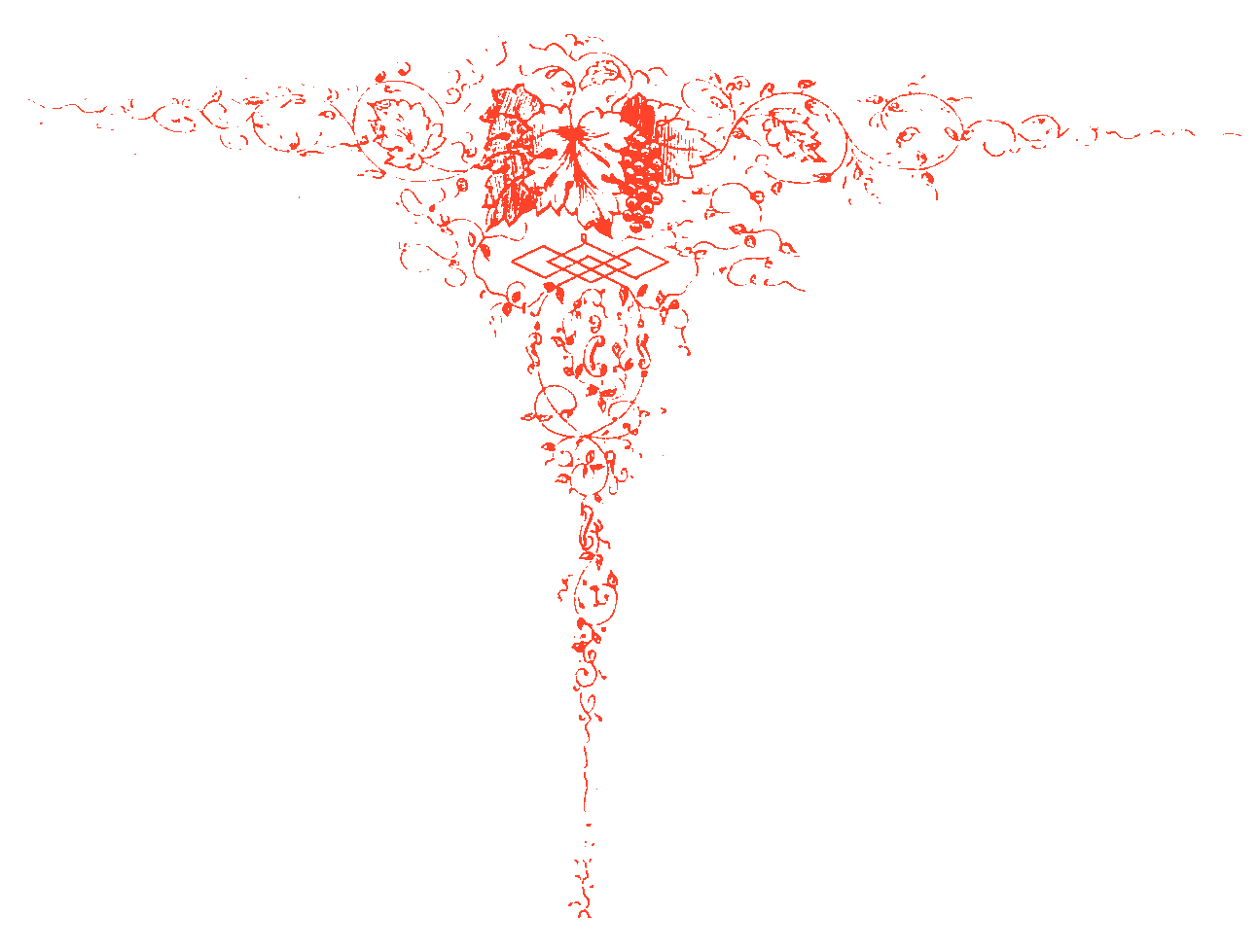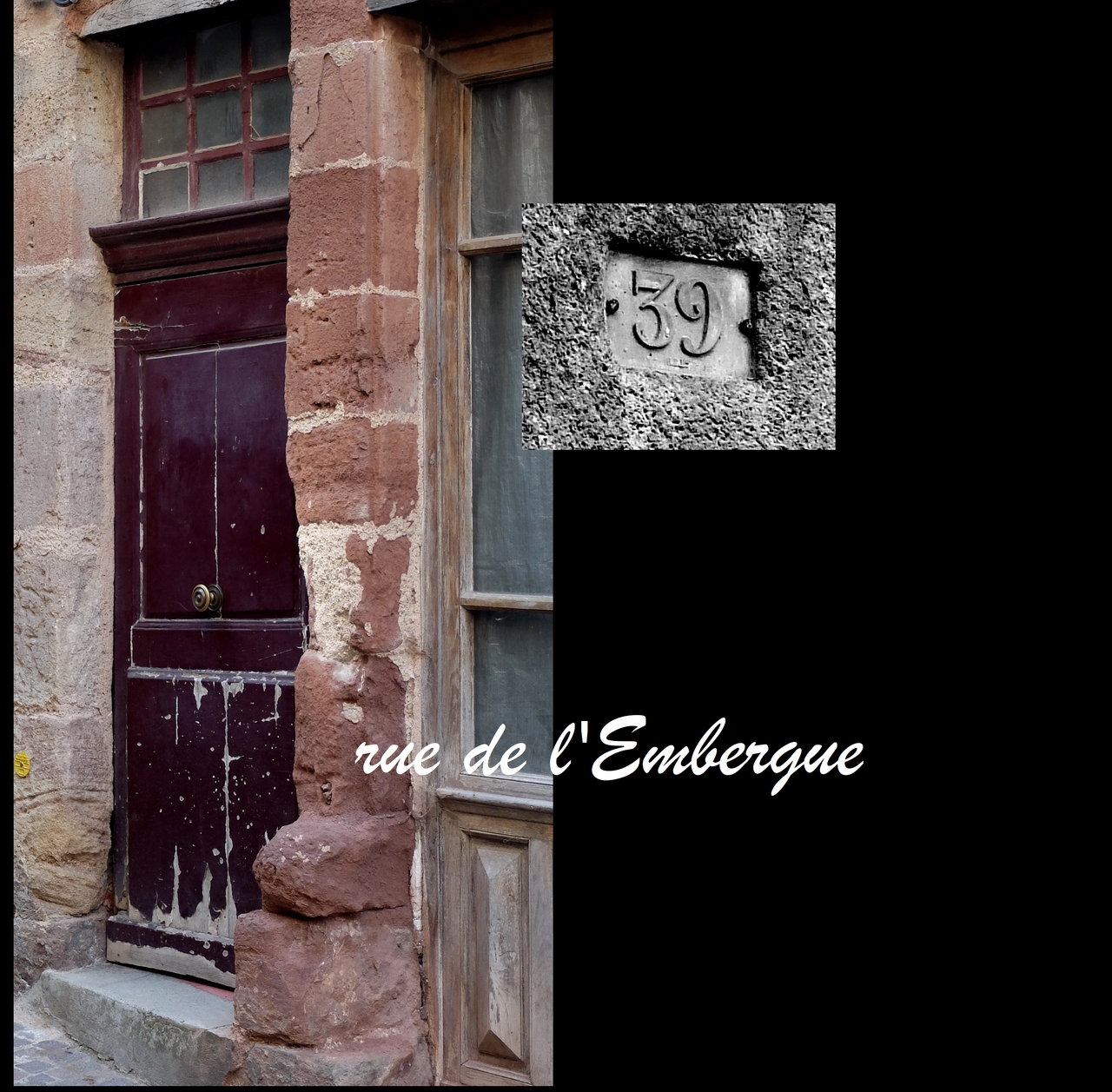 ◄
◄Baptiste Lacaze, auteur de l'Atlas, a séjourné au 39 rue de l'Embergue, à Rodez.
La porte se montre sns doute encore dans son aspect ancien
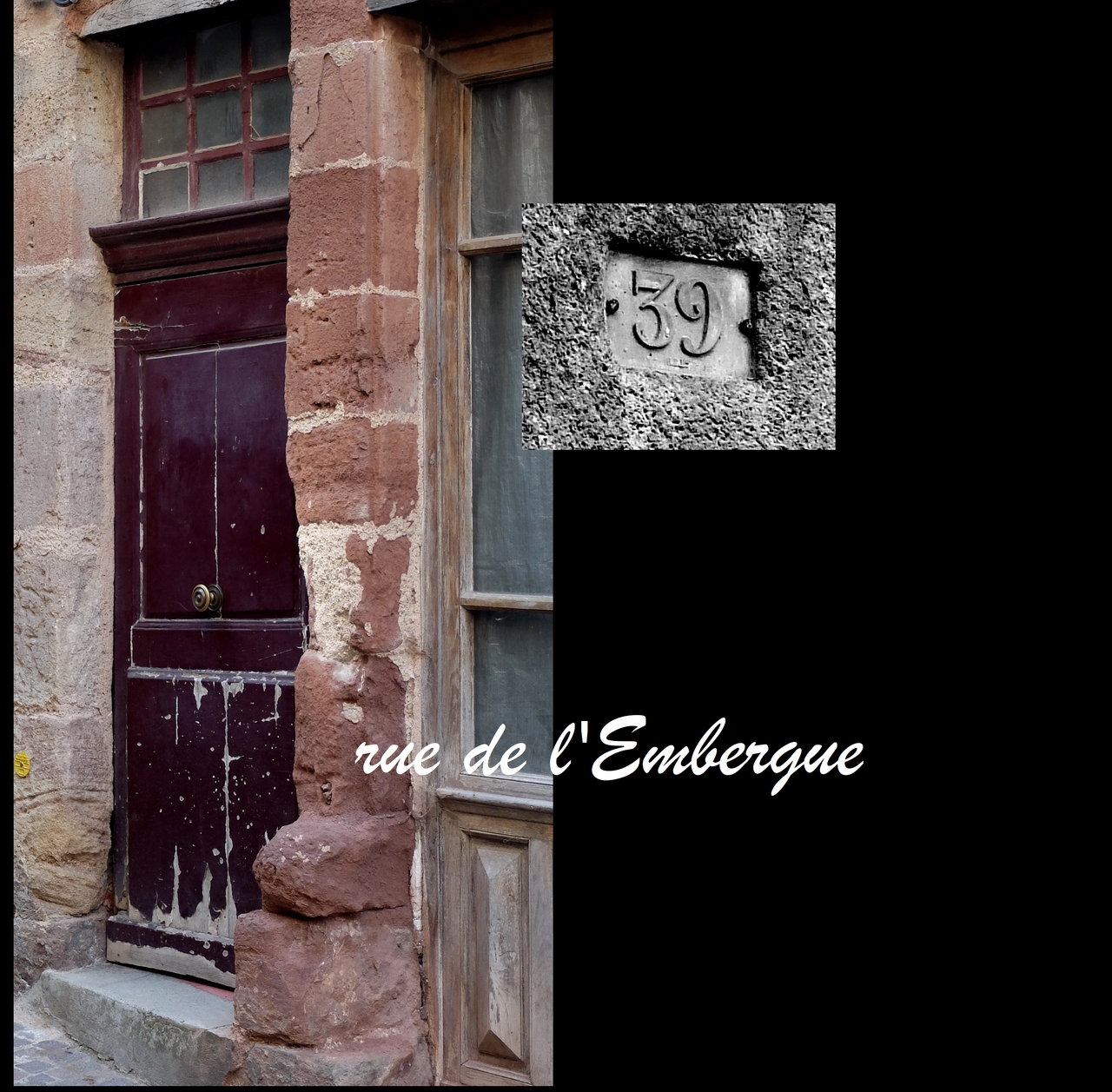 ◄
◄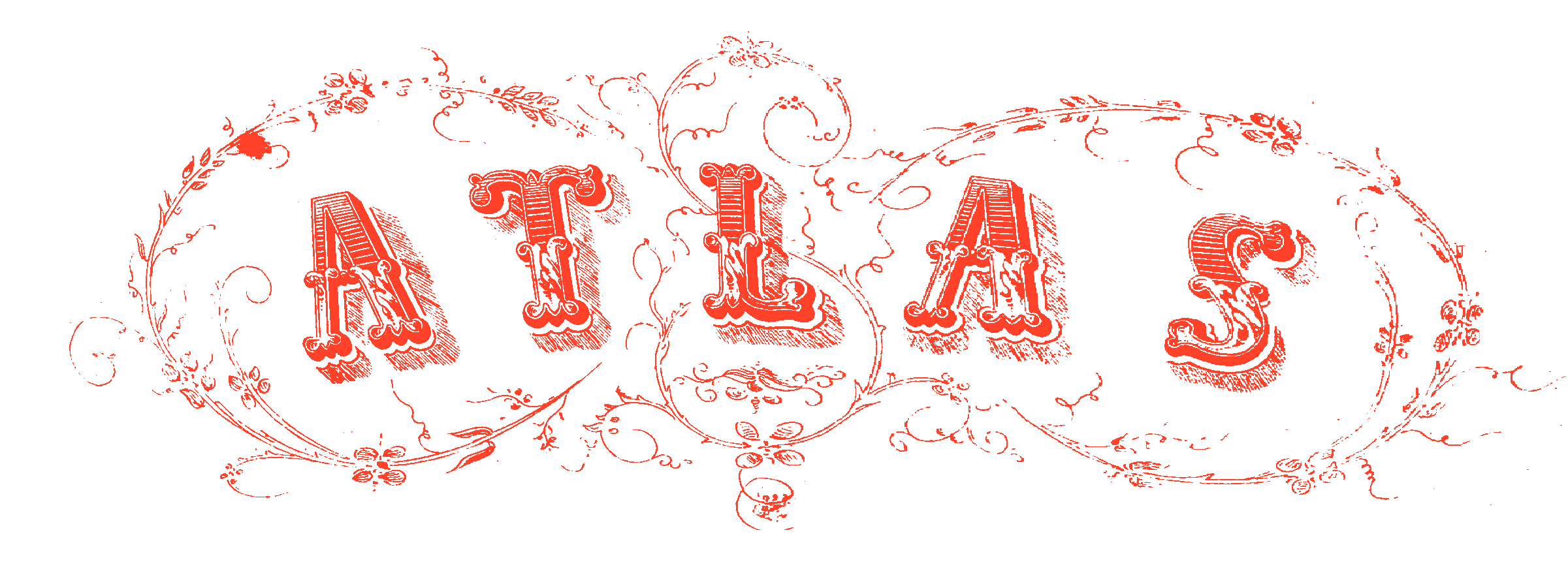
Jeux de cartes, l'Atlas Cantonnal (sic) de l'Aveyron
► L'Atlas dans son intégralité, page spéciale des 42 cartes , ICI

Une partie de plaisir ? Peut-être pas !
partie I ↓
→
partie II, ICI

Patience et longueur de temps...font des images en meilleure définition...
Un
commentaire, un
complément ? Ecrivez nous : jrudelle@ferrobase.fr
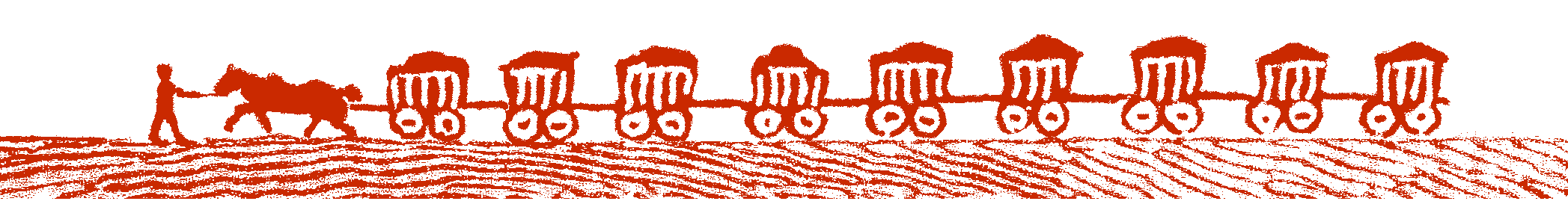
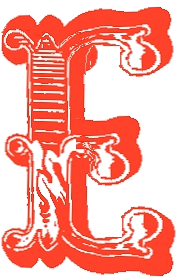 n 1856 le minerai du causse Comtal voyage
lentement, c'est le bon qualificatif. Il faut imaginer ce qu'étaient
les convois de chars, partis de Marcillac, à la gare minière, du
plateau,
ou du causse même, beaucoup plus haut, pour rejoindre les
hauts-fourneaux à Decazeville. Chemins détruits, difficultés
hivernales, entretien difficile et onéreux, conflits divers et
fréquents, sont pour la Compagnie quelques uns des motifs qui vont
décider François Cabrol à mettre en place une voie ferrée privée,
minière, de Decazeville à Marcillac. Opérationnelle en 1856, à
l'écartement de 66 cm, elle sera rejointe dans cette Route du
Fer par une autre voie,
mise en place par une autre compagnie, pour rejoindre une autre vallée
: la voie à l'écartement de 110
cm de la compagnie d'Aubin, propriété de la compagnie d'Orléans,
permettra aux premiers convois de circuler en 1860, menant le minerai
de Cadayrac à la gare
de Salles-la-Source pour transbordement.
n 1856 le minerai du causse Comtal voyage
lentement, c'est le bon qualificatif. Il faut imaginer ce qu'étaient
les convois de chars, partis de Marcillac, à la gare minière, du
plateau,
ou du causse même, beaucoup plus haut, pour rejoindre les
hauts-fourneaux à Decazeville. Chemins détruits, difficultés
hivernales, entretien difficile et onéreux, conflits divers et
fréquents, sont pour la Compagnie quelques uns des motifs qui vont
décider François Cabrol à mettre en place une voie ferrée privée,
minière, de Decazeville à Marcillac. Opérationnelle en 1856, à
l'écartement de 66 cm, elle sera rejointe dans cette Route du
Fer par une autre voie,
mise en place par une autre compagnie, pour rejoindre une autre vallée
: la voie à l'écartement de 110
cm de la compagnie d'Aubin, propriété de la compagnie d'Orléans,
permettra aux premiers convois de circuler en 1860, menant le minerai
de Cadayrac à la gare
de Salles-la-Source pour transbordement.
Le tracé de ces deux voies ferrées privées sur les cartes, au XIX ème siècle et au suivant, est souvent présent pour la voie de Decazeville, et souvent absent pour ne pas dire exceptionnellement présent pour la voie de Cadayrac ! Les deux séries de cartes qui vont faire l'objet de notre étude, les cartes de l'Atlas cantonal de Lacaze et les feuilles de la carte Romain, parues à la même époque, vers 1860, les mentionnent. Si pour Bernard Romain la conception de ses feuilles et la construction des voies sont deux évènements contemporains, il n'en est pas de même pour Baptiste Lacaze. Lorsqu'il entreprend l'Atlas, les voies ne sont même pas en chantier et sûrement pas évoquées. On lui doit donc l'excellente initiative d'avoir suivi l'actualité en reportant, après son dessin initial de l'Atlas, le tracé de ces deux voies. Pour la voie de 110, son travail est beaucoup plus exact que celui assez approximatif de Romain. Avant d'étudier quelques détails industriels de ces cartes et feuilles, nous vous proposons un arrêt sur image pour découvrir ce que sont les acteurs de ces cartes, et une immersion dans une histoire finalement assez mouvementée : un jeu de cartes, certes, mais pas obligatoirement toujours une partie de plaisir !
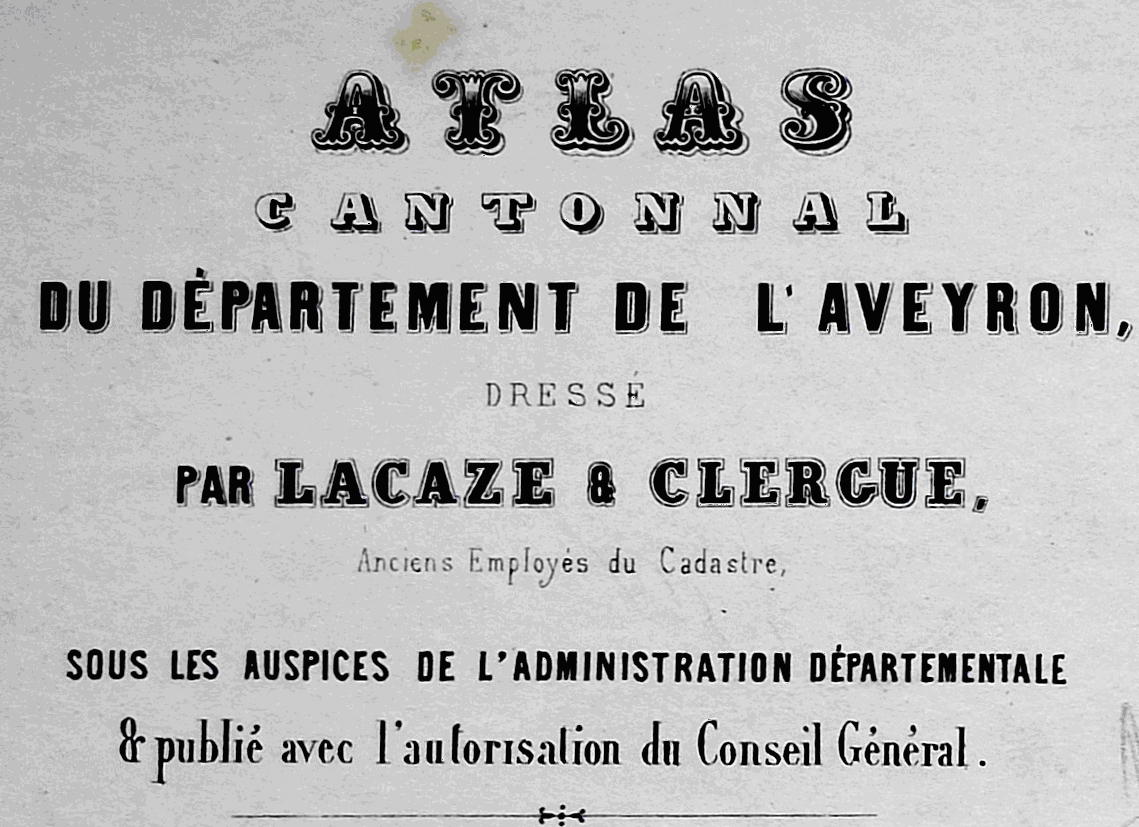
 les acteurs, auteurs,
imprimeurs, préfets
les acteurs, auteurs,
imprimeurs, préfets
 Quelques
éléments de chronologie
Quelques
éléments de chronologie
 Cartes et
représentations, une réalité ?
Cartes et
représentations, une réalité ?
 Diffusion
de l'Atlas cantonal, demi-succès ou demi-échec ?
Diffusion
de l'Atlas cantonal, demi-succès ou demi-échec ?

la suite , partie II
:
 Carte
Romain
Carte
Romain
 Litige Lacaze Romain,
action judiciaire
Litige Lacaze Romain,
action judiciaire
 L'Atlas cantonal à la
loupe
L'Atlas cantonal à la
loupe
Introduction
Les joueurs : ils sont quatre, Baptiste Lacaze, M. Clergue, M. Bernard Romain, M. Arribat
Le but : une carte départementale, cantonale, de l'Aveyron.
Au milieu de ce siècle, vers 1850 donc, le Département de l'Aveyron commence à réfléchir sur l'opportunité de publier une carte détaillée du département. Il y a bien évidemment celle de Cassini, et quelques autres, mais il manque pour les élus départementaux un travail cohérent et complet sur l'ensemble du territoire. L'Atlas Cantonnal (orthographe d'origine respectée), et la carte Romain vont ainsi apparaître à peu près à la même époque et vont constituer pour les décennies suivantes une excellente base. Voici donc quelques éléments sur ces travaux qui connaîtront, comme toute œuvre humaine des hauts et des bas….
Les
besoins de cartographier le département sont importants.
L'industrialisation le
nécessite tout comme les besoins en communication. Beaucoup de villages
n'ont
pas accès facilement aux centres importants comme Rodez, Millau ou
Villefranche. Pour le nord ou le sud Aveyron, la situation est pire !
Et pour
tracer des chemins, discuter les projets, renforcer 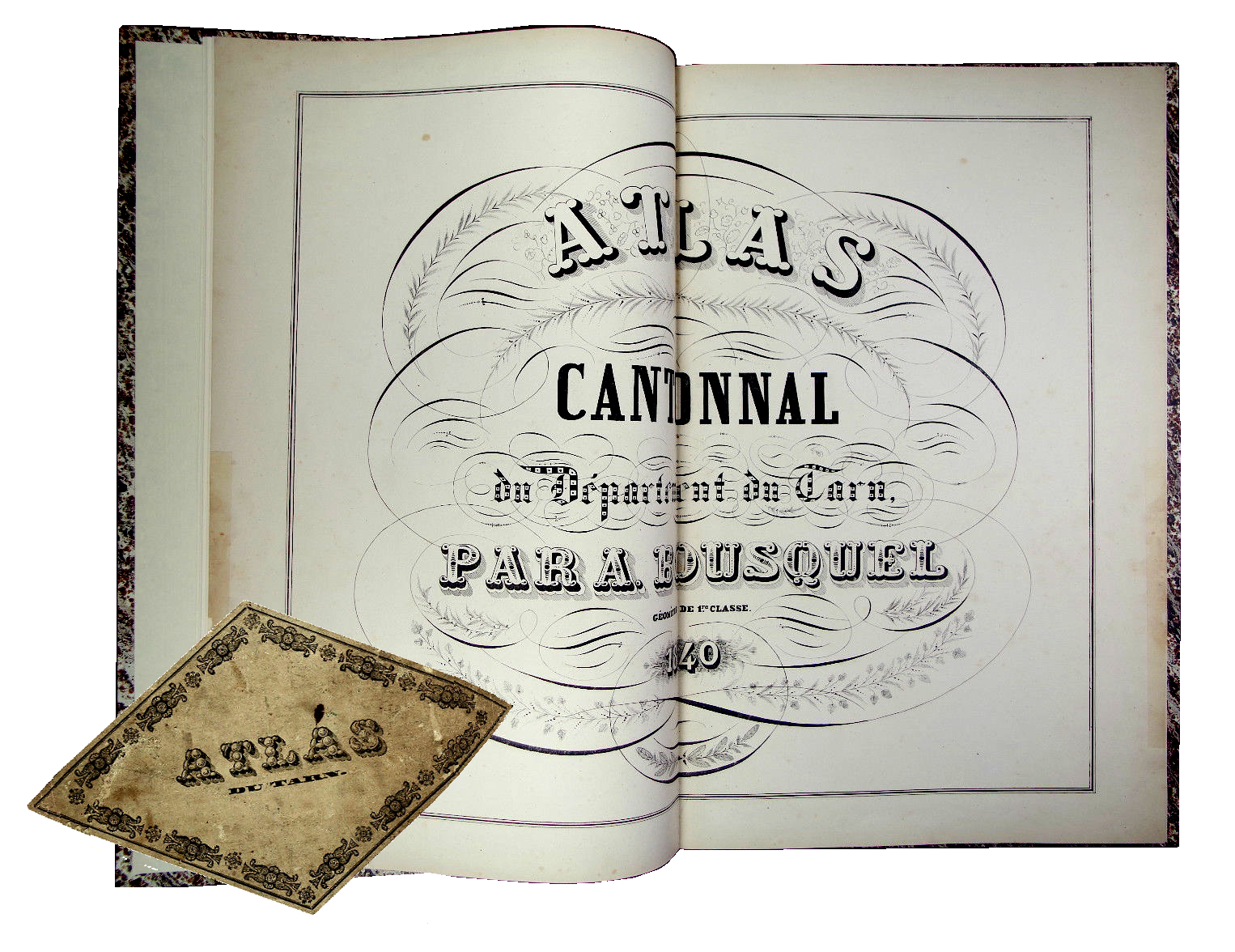 ceux
qui le
méritent, et
trouver les budgets, il n'y a rien de mieux qu'une carte. La
cartographie
cantonale apparaît ainsi comme un excellent moyen de mieux connaître
son
territoire. L'échelle du canton permet aussi de bien souligner les
solidarités
entre communes. L'Aveyron va donc se doter d'une telle cartographie. Si
le
département n'est pas précurseur, il n'est pas non plus en retard dans
cette
démarche. Le Tarn est doté de son Atlas depuis 1840, comme les
Hautes-Pyrénées,
le Lot aura le sien en 1873, le Lot-et-Garonne en 1883, la Loire en
ceux
qui le
méritent, et
trouver les budgets, il n'y a rien de mieux qu'une carte. La
cartographie
cantonale apparaît ainsi comme un excellent moyen de mieux connaître
son
territoire. L'échelle du canton permet aussi de bien souligner les
solidarités
entre communes. L'Aveyron va donc se doter d'une telle cartographie. Si
le
département n'est pas précurseur, il n'est pas non plus en retard dans
cette
démarche. Le Tarn est doté de son Atlas depuis 1840, comme les
Hautes-Pyrénées,
le Lot aura le sien en 1873, le Lot-et-Garonne en 1883, la Loire en
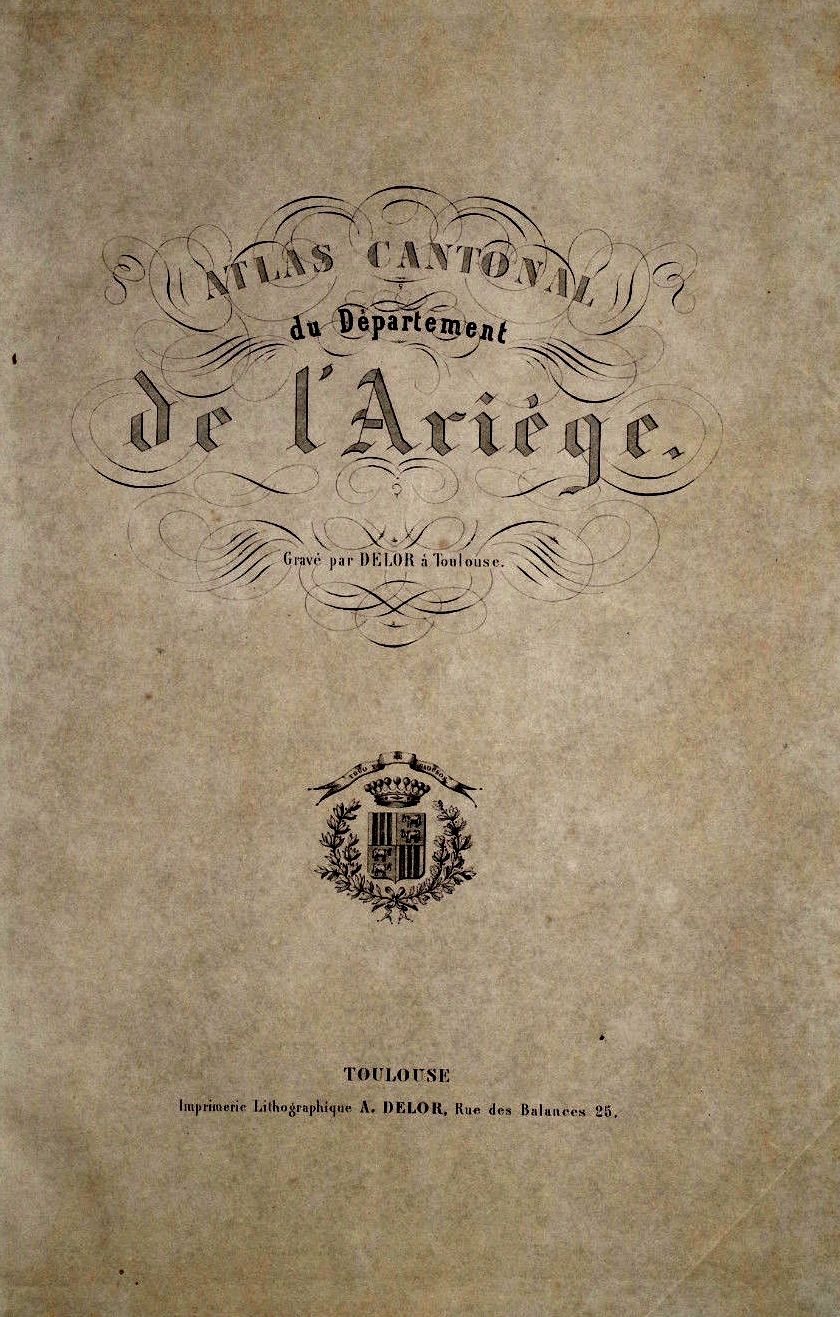 Ariège, 1864
Ariège, 1864
Les Atlas cantonaux viennent compléter dans les départements des documents comme les atlas communaux, avec lesquels ils n'ont pas de lien précis. Ces derniers établis par les géomètres des contributions directes, l'administration du cadastre, à laquelle Lacaze et Clergue appartiennent, répondent aux besoins précis d'établissement des contributions. Leur forme est codifiée et l'administration centrale parisienne veille à l'élaboration et à la conservation de ces documents. Le Bulletin des contributions directes, avec publication de nombreuses directives et circulaires, en 1838 par exemple, est ainsi un outil de codification efficace. Pour les cousins cantonaux, les Atlas cantonaux, l'échelle est différente et les commanditaires, les conseils généraux, définissent les contenus.
Les
Atlas se ressemblent beaucoup, avec une typographie artistique pour les
cartouches. On n'oublie pas évidemment de citer les préfets, qui, en
leur
qualité d'administrateurs, sont le plus souvent, mais pas
systématiquement, les
initiateurs des travaux. Les échelles sont voisines mais pas identiques
:
1/30.000 à 1/50.000 avec la variante à 1/40.000. Le format des Atlas
est donc
généralement important,
Cette diversité d'initiatives, d'auteurs, de commanditaires, les Conseils généraux, qui fait de chaque Atlas un travail unique, ressemblant au voisin, mais seulement ressemblant, est à opposer aux habitudes actuelles : les feuilles de la carte géologique, ou celles de la carte topographique pour ne prendre que deux exemples, répondent à notre époque aux mêmes contraintes, de couleur, de représentation, de contenus.
Acteurs,
auteurs
Baptiste
Lacaze
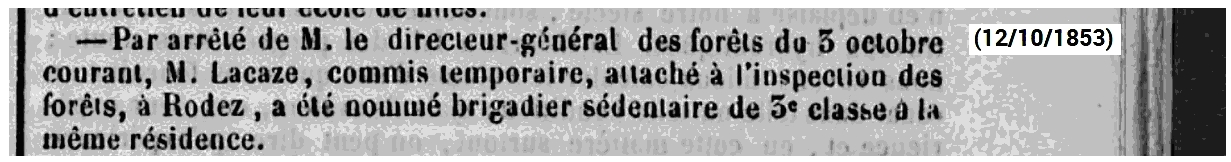
Journal de l'Aveyron
Monsieur Lacaze est né le 28 août 1819 à Rodez. Son père, Pierre Lacaze est travailleur habitant Rodez (acte état-civil), et nous n'en saurons pas plus sur ses origines, ni sur son adresse d'alors. Comme il le mentionne sur les cartes de l'Atlas, il sera employé au cadastre, un emploi assez précaire. C'est un peu précis, mais assez flou sur les activités réelles qui étaient les siennes : dessinateur comme nous le pensons, enquêteur ? ? Les fonctions au cadastre ne seront pas les seules : M. Lacaze quitte le service après 7 ans de présence pour l'inspection des forêts où il va passer 38 ans, dans l'Aveyron mais également en poste dans le Cantal.
▼ La maison Roustan jouxtait le numéro 23...
Il décède à 75 ans en 1894, le 30 mai à Rodez. Il habite alors la maison Roustan, rue Béteille, veuf de Pauline Canitrot. Son acte de décès précise sa dernière profession, brigadier forestier en retraite. Baptiste Lacaze a eu plusieurs adresses, comme celle du 39 rue Embergue-gauche. Il prendra sa retraite en 1882. Accessoirement, on le retrouve nommé juré suppléant aux assises le 23 novembre 1889 (JdA).
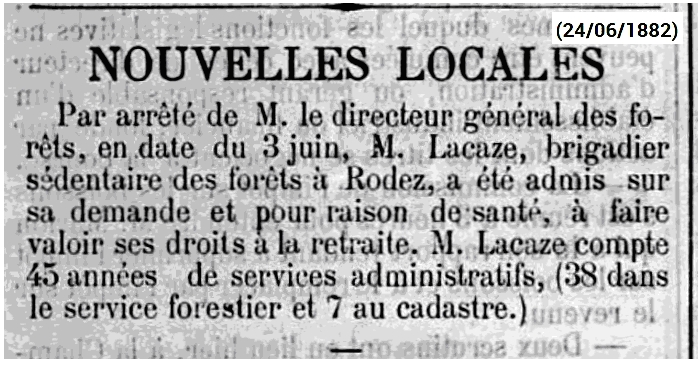
Journal de l'Aveyron
Lorsque
va paraître l'Atlas cantonal, la mention employé du cadastre est
indiquée ; elle
est
peut-être plus "accrocheuse" pour la vente de l'Atlas que brigadier
des forêts. Il est possible également qu'après

Monsieur
Clergue
Assez inconnu pour nous ! Son nom figure sur les cartes cantonales, mais pas sur celle du département dressée en 1861. Peut-on en conclure que Lacaze fut alors le seul dessinateur de celle-ci, et était-il donc probablement le dessinateur des 42 autres ? M. Clergue l'aurait alors secondé pour le travail de recherches…C'est notre conclusion actuelle.
Nous
n'avons que peu
d'informations
sur les origines, adresses et autres données le concernant. Tout au
plus, on peut mentionner Clergue comme nom de la mère de l'épouse de
Lacaze, née Jeanne Pauline Canitrot...Un cousin de celle-ci, Auguste
Clergue, était son témoin pour son mariage à Rodez avec Baptiste
Lacaze, le 26 février 1854. Auguste Clergue est alors déclaré sans
profession et Baptiste Lacaze brigadier forestier.

Bernard
Romain

L'auteur des cartes dites cartes Romain, Bernard Romain, était agent-voyer, c'est-à-dire ingénieur territorial dans la situation actuelle. Ses cartes de 1860 sont dédiées au préfet Demonts.
Alors en poste comme agent-voyer d'arrondissement à Espalion, il est nommé en 1851 à Rodez et cumule les fonctions d'agent-voyer en chef et celles d'agent-voyer de l'arrondissement de Rodez. Ce cumul durera jusqu'en 1858. Il habite Rodez, au 5 de la rue Béteille. On le suit ensuite à Saint-Etienne en 1862 et à Lille en 1869, toujours agent-voyer en chef. Il prendra sa retraite en septembre 1875 à Lille.
Il sera membre le 12 juin 1853 de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, membre correspondant en 1862, ayant alors quitté le département.
On notera également que l'imprimeur de l'Atlas Louis Loup était également membre de la SLSAA.

Urbain
Arribat
Agent-voyer à Espalion, c'est donc une connaissance ancienne de Romain et un professionnel de la voirie et de la topographie. Entré dans l'administration en 1852, Urbain Arribat fut le dessinateur de Romain pour le travail des cartes. Il quitte Espalion pour Saint-Affrique en 1861. Il sera agent-voyer d'arrondissement à Rodez et prend sa retraite en 1880. Monsieur Arribat a prêté son concours à d'autres, comme M. l'abbé Cérès pour ses plans de travaux archéologiques. C'est par exemple M. Arribat qui a dessiné les plans des fouilles de Cadayrac et fait figurer la voie ferrée minière de 110, faisant de ce plan, présenté en détails plus loin, une vraie pépite ! M. Arribat fera fonction d'agent-voyer en chef en fin de carrière. Ses talents de dessinateur sont certains : on lui doit, par exemple, cet essai de restitution de l'amphithéâtre de Rodez, en appui de la communication de Cérès.
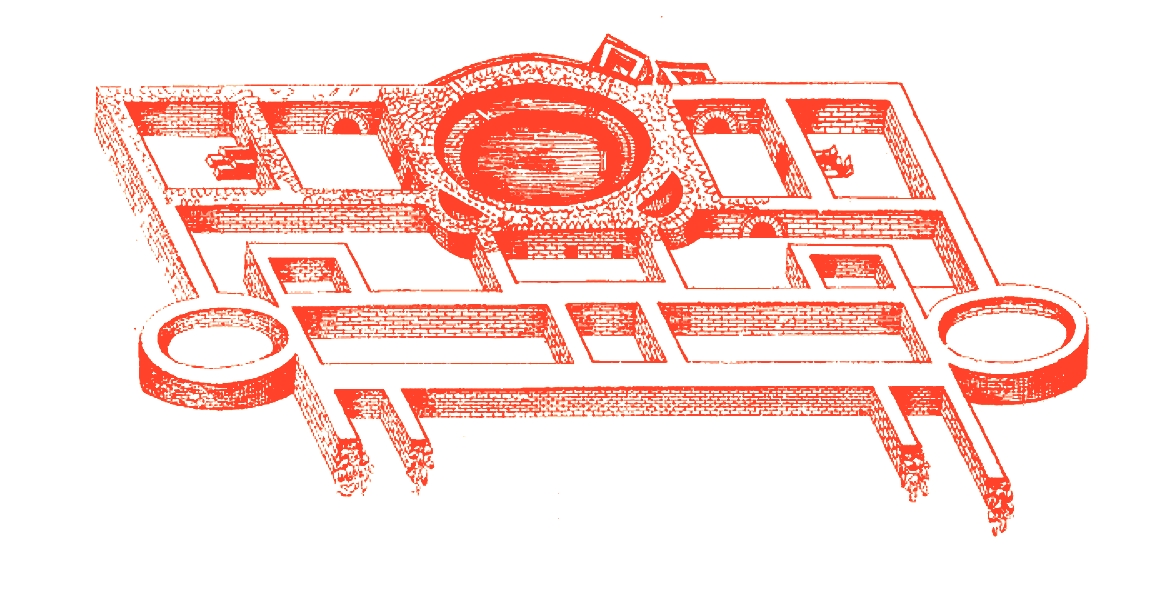
RAPPORT à la Société sur des thermes et un cimetière gallo-romains découverts à Rodez,
M. l’abbé CÉRÈS,
Mémoires SLSA
Aveyron, tome 11, 1874-1878- Dessin Arribat

Les
imprimeurs
Baptiste Lacaze fait appel aux ressources locales, Louis Loup imprimeur-lithographe à Rodez pour les cartes cantonales, et Rivière à Toulouse pour la carte d'assemblage départementale de 1862. Boisse, géologue connu de tous les aveyronnais, avait confié l'impression d'une de ses cartes, ci-dessous, à Loup.
B. Romain utilisera les services de Thierry Frères à Paris pour ses cartes. Cet imprimeur parisien est particulièrement important : médaille d'argent aux expositions de 1839, 1844 et 1849, il exploite 25 presses lithographiques, 20 presses en taille-douce et emploie 70 ouvriers. (in notice Ecole des Chartes)
L'impression est de qualité dans les deux cas, même si au premier regard, les cartes Lacaze semblent plus "artisanales".
Sur
cette carte de
Boisse, qui
accompagne un rapport de l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées
(janvier
1865) relatif à la création de routes agricoles, les deux voies ferrées
minières du causse sont bien visibles : à Mondalazac, il aurait
cependant été préférable -et plus exact-
de noter
Cadayrac, et d''utiliser un dessin nettement différent pour distinguer
voie normale et voie minière.
Le
dessin de la voie de Cadayrac, repris de la feuille Romain, est
symbolique, et fort éloigné de la réalité, mais cette carte n'a pas de
but ferroviaire !
La carte est très agréablement lithographiée par Louis Loup à Rodez.
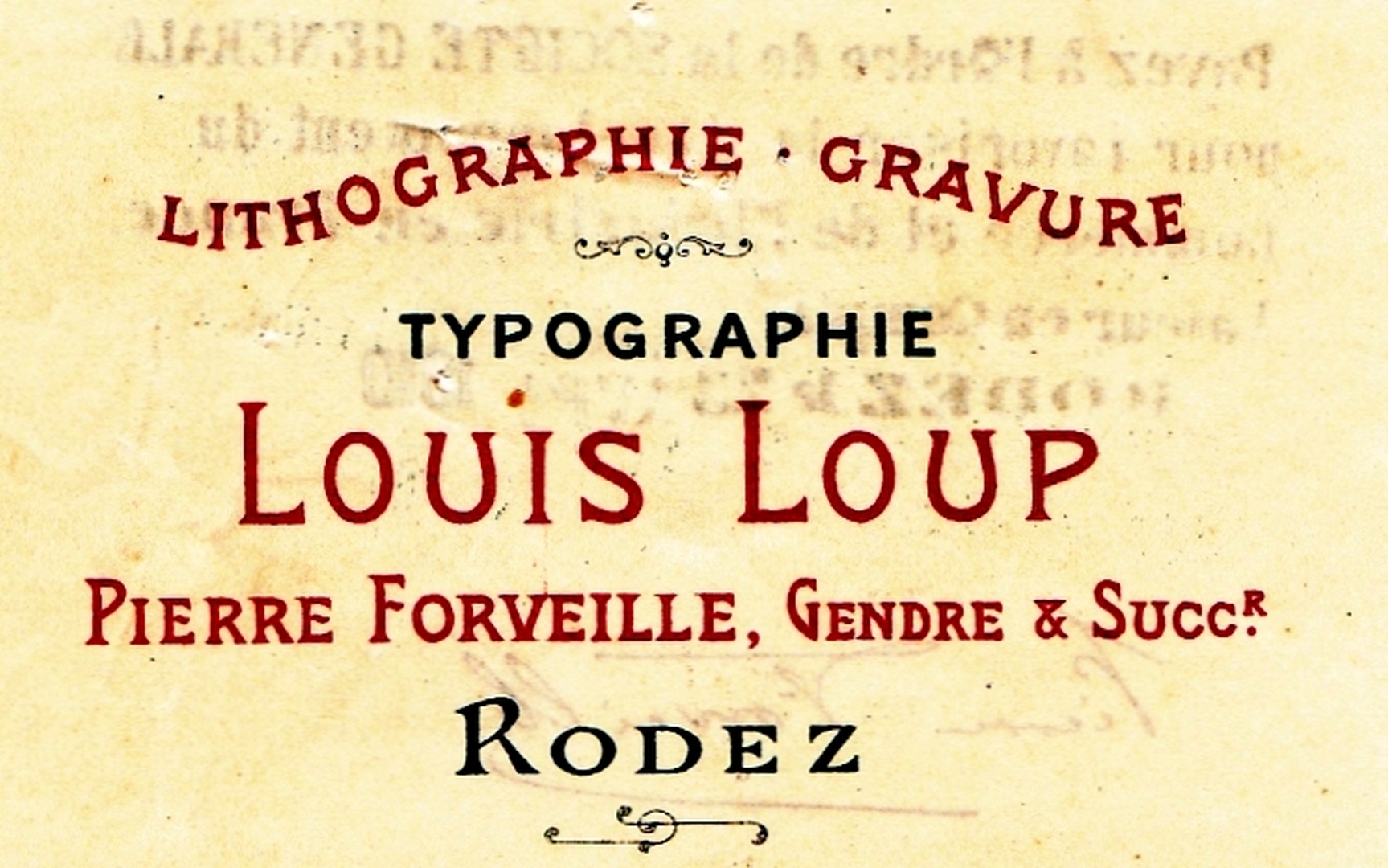

Les
Préfets
Si
la carte départementale de Lacaze est dédiée à Monsieur Boby de la
Chapelle
(Alphonse Charles), préfet, celui-ci n'est pas une pièce essentielle du
jeu. En
effet il fut nommé le 22 janvier 1862, donc à l'époque même de la
parution et
n'a pas eu un rôle majeur dans l'élaboration de ce travail.
Les
réflexions sur l'élaboration des cartes débutent en

Les objectifs de l'Atlas et de la grande carte et semble-t-il les moyens ne sont pas les mêmes, ces derniers étant apparemment plus modestes pour l'Atlas. Il est vrai que les formations des auteurs sont différentes. MM. Lacaze et Clergue ont été employés du cadastre. La mention portée sur les cartes, anciens employés du Cadastre est exacte : à l'époque de la création de l'Atlas, ils n'étaient plus dans le service. M. Romain était agent-voyer au service du Département, on dirait aujourd'hui ingénieur. Il est agent-voyer en chef en poste à Rodez, au moment de la publication de la carte. Les formations, fonctions et activité technique des auteurs expliquent sans doute les différences visibles dans le résultat cartographique. Le graphisme est également très différent. Le caractère de l'Atlas apparaît au premier abord un peu "dépouillé", alors que la carte Romain se montre parfois très copieuse, au risque d'être difficilement lisible.
L'Aveyron,
comme les autres départements, n'est pas dépourvu vers 1850 de
documents. Il y
a par exemple le cadastre, registre descriptif des terres et des
propriétés
bâties. La finalité du document est connue :
le
cadastre n'a donc plus d'autre but que d'arriver à la répartition du
contingent
communal entre les contribuables de la commune. Le cadastre consiste en
opérations d'art, géométriques et graphiques, qui servent à déterminer
la
contenance de chaque parcelle de propriétés et, en travaux d'expertise
qui ont
pour but d'évaluer le revenu imposable de chaque parcelle. (Dictionnaire général d'administration, A.
Blanche,
1844). Ces précisions permettent d'imaginer le travail
quotidien de MM
Lacaze
et Clergue, auteurs de l'Atlas, opérations d'art et travaux d'expertise
pour
l'établissement des cartes communales. En parallèle, à la même époque,
M.
Romain gérait des problèmes techniques d'aménagement du territoire et
de voirie,
au plus près des élus. Les préoccupations professionnelles des auteurs
sont
donc très différentes, mais chacun est au contact du terrain, soit pour
l'aménager et le gérer, soit pour en fixer le revenu.
Pour la suite de cette analyse, nous
n'évoquerons que M. Lacaze et M. Romain comme auteurs. Mais M. Clergue
ne
mérite évidemment aucun oubli, pas plus que M. Arribat qui fut le
dessinateur
de Romain.
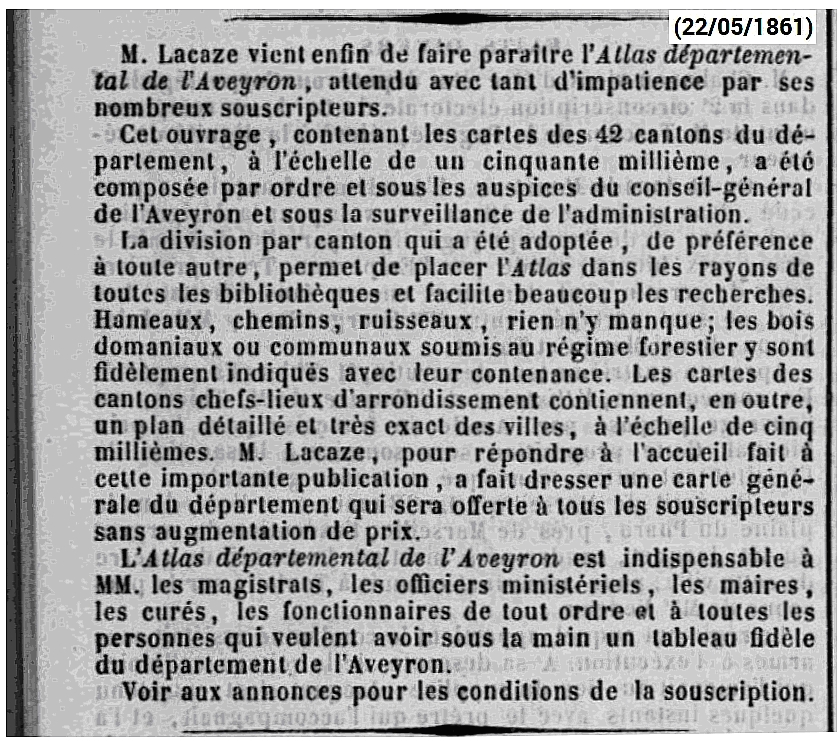
Journal de
l'Aveyron
Quelques
éléments de chronologie
En 1844, le Conseil Général de
l'Aveyron (CGA) constate qu'il reste 2,512 fr. 94 au compte 1843 du
budget
cadastral. Il autorise M. le Préfet à
l'appliquer à la confection d'un grand atlas départemental, contenant
la carte
du département, les cinq cartes d'arrondissement et les quarante-deux
cartes de
canton, et dont il serait fait trois exemplaires :
l'un pour être déposé aux archives, un
second pour le bureau des contributions, et un troisième pour le bureau
des
travaux publics…(RD, CGA, 1844); C'est la première apparition de
l'Atlas
dans les préoccupations des élus. En 1845 le CGA vote une dépense de
1,200 fr.
La dépense totale avait été estimée à 3,780 fr. En 1846, on constate
que
l'estimatif, suite à une erreur, est insuffisant. cependant, les
géomètres
chargés de la réalisation, MM Lacaze et Clergue, continuent
de s'en occuper avec le même soin. Dans son rapport le
Préfet propose de leur allouer, à titre
de gratification, une somme capable de les indemniser. Cette
demande
reprend la proposition du Directeur des Contributions. Il ajoute que
les
auteurs sont disposés, vu les chances
incertaines de l'entreprise, à renoncer à la faculté qui leur a été
accordée de
faire lithographier les cartes pour les livrer au commerce. (Rapport délibérations,
CGA 1846).
Dans sa réponse, le Président, en bon gestionnaire, demande d'attendre
que le travail soit complètement terminé…et
convenablement apprécié. Il ajoutera l'alternative entre cette
gratification ou un arrangement pour que
la reproduction des cartes leur assure un bénéfice suffisant.
En
1847, un nouveau crédit de 600 fr. est alloué pour le budget 1848. La
gratification est toujours évoquée, mais aucune décision n'est prise.
On attend
de voir !
Les prévisions budgétaires avaient fait l'objet du tableau suivant :
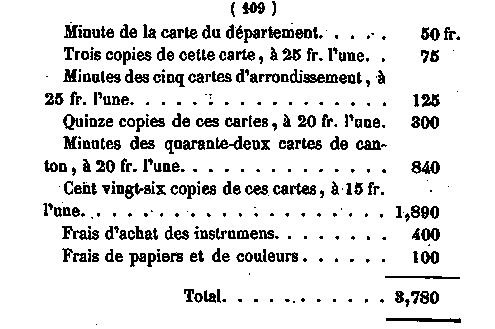
Rapport délibérations, Conseil Général Aveyron 1846
Concernant ces débuts de réflexion,
l'initiative de l'Atlas semble donc venir de l'administration, de la
direction
des contributions. Mais on ne peut exclure que Lacaze et Clergue,
employés de ce
même service, aient pris cette initiative, relayée ensuite au CGA pour
financement. On constate ensuite que le travail n'est pas réalisé dans
le cadre
normal administratif, mais certainement en dehors, au moins en partie,
de leurs
obligations de service. Dans le cas contraire, il serait difficile de
comprendre la proposition d'un bénéfice
suffisant pour les auteurs. C'est d'ailleurs ce que sous entend le
CGA
lorsqu'il répond au Préfet qu'il est d'accord de procurer
à ceux qui sont chargés de la confection de cet atlas une
rétribution proportionnée au temps qu'ils y auront employé et au degré
de
perfection qu'ils auront atteint. (RD CGA, 1847). Ces
premiers
éléments
seront plus tard sources de difficultés : qui est le véritable
propriétaire de
l'Atlas ? Le Département, au vu du financement ? Les auteurs avec la
possibilité de commercialiser eux-mêmes les cartes ? Dans tous les cas
il
faudra s'entendre !
Afin d'avoir un ordre de grandeur de
la relativité des sommes en jeu, précisons qu'un agent-voyer
d'arrondissement perçoit
un salaire annuel de 1700 francs en 1858.
En 1848, il y a des avancées
certaines. Le directeur des contributions
directes a remis à la préfecture la minute de la carte du département,
et les
trois copies des cartes d'arrondissement et de canton. Ce
fonctionnaire
souligne l'insuffisance de rémunération des auteurs suite au crédit
alloué de
3,780 fr., insuffisant. En séance, il met sous les yeux du CGA un
exemplaire
complet de l'Atlas et propose une gratification de 300 fr. (à se
partager ? ).
Il met quelques conditions à ce versement, comme la remise des trois
copies de
la carte du département, la mise en couleurs par des teintes spéciales,
des
bois domaniaux et communaux et la rectification des erreurs remarquées.
Il
ajoute enfin la condition qui sera demandée aux auteurs de renoncer
à l'autorisation de faire lithographier tout ou partie de ce
travail et de rendre au département la faculté de le reproduire par
cette voie.
Cette dernière remarque montre la prudence du fonctionnaire qui devine
peut-être les litiges à venir.
1849 sera l'année cruciale : l'Atlas
est prêt, mais qui finance la publication ? Le Conseil général ou les
auteurs ?
Un
Atlas de cartes géométriques par cantons et arrondissemens, pour le
département, est apporté devant le Conseil. Le rapporteur de la
commission
des finances propose l'acquisition de 50
exemplaires de ce beau travail.
Il y a un mais de taille : les 50 exemplaires sont payés 30 fr. l'un,
ce qui
donne 1500 fr, bien éloigné du coût estimé par les auteurs à
15,000 fr.
!
Le 30 novembre 1848 le CGA avait le
regret de ne pouvoir verser la gratification de 300 fr. aux auteurs,
par suite
de l'insuffisance des fonds. Un traité est projeté avec un imprimeur.
Mais on
constatera en 1849 que ce projet n'est plus d'actualité car les auteurs
ne
veulent pas renoncer à leur propriété et souhaitent eux-mêmes assurer
la
reproduction des cartes. Lacaze (sans doute) a même pris contact avec
un
imprimeur-lithographe aveyronnais, Carles, installé à Paris. Les 500
exemplaires reviendraient à 15,340 fr., soit 30fr. 68 c par exemplaire.
Il est
inutile de préciser que ni Lacaze, ni Clergue n'ont la possibilité
d'avancer
les fonds. La solution envisagée repose donc sur l'engagement du CGA
pour 50
exemplaires, et une souscription publique. Ce sera finalement Louis
Loup,
imprimeur-lithographe à Rodez qui fera l'impression.
En 1850 le Préfet
propose au CGA de
compléter l'engagement de 300 fr., la gratification, par un complément
de 220 fr.,
justifié par la difficulté du travail supplémentaire demandé par les
élus, le
coloriage.
L'année 1851 n'apporte rien de
nouveau, hors la mention d'un atlas au 1/20.000 des chemins de grande
communication et celui des chemins de moyenne communication, opération
distincte des travaux de Lacaze et Clergue.
Nous sautons quelques années pour
l'année 1860. Le rapport et les délibérations du CGA de cette année
1860 sont
précis. Le chapitre budgétaire Encouragements
et secours est concerné.
M.
Lacaze, auteur de l'atlas auquel vous avez, l'année dernière, accordé,
pour 50
exemplaires, une subvention de 2,000 fr. payable en quatre annuités de
500 fr.,
vous remet des exemplaires de son travail dont le mérite sera très
certainement
apprécié par vous….Il a enrichi son ouvrage en y traçant le plan des
chefs-lieux d'arrondissement et en y représentant, en dehors du
périmètre de
chaque feuille cantonnale, soit les routes et chemins de grande ou
moyenne
communication, soit les villes et principales localités qui se trouvent
dans le
voisinage. Ces ajouts de Lacaze sont effectivement bien perçus et
particulièrement
utiles.
Lacaze, sans rien réclamer…compte sur vos
sentiments de bienveillance pour
obtenir un dédommagement pour l'excédant de dépenses que lui cause le
perfectionnement…Ce rapport de 1860 précise que le total des
souscriptions
est voisin de 150. Il y a donc près de 200 exemplaires de l'Atlas
cantonal probablement
vendus en
Cette même année 1860, le CGA vote
également 800 fr. pour l'élaboration de la carte départementale, celle
de
Romain, agent-voyer.
Dans son rapport de la session de
1861, le Préfet se félicite de cette carte départementale de
l'agent-voyer en
chef. Elle rendra de grands services, comme l'Atlas cantonal
précise-t-il…
Comme M. Lacaze a tenu plus qu'il n'avait
promis, le préfet demande d'augmenter la contribution du
département à
3,000 fr. L'avis favorable de la commission des finances permet cette
augmentation. Pour sa part M. Romain reçoit une indemnité de 800 fr.
pour sa
carte départementale, montant d'une annuité. En
Cette étape de notre analyse marque
la fin de la genèse et de la fabrication de l'Atlas, de 1844 à
Une toute autre difficulté se fait jour en 1862 pour
M.
Lacaze, qui va devoir quitter son pantographe pour rencontrer son
avocat
! La
carte de Bernard Romain, la grande carte du département en feuilles
comme il est dit à
l'époque est
parue. Et Baptiste Lacaze va avoir matière à montrer plus que du
mécontentement
devant ce concurrent absolument pas prévu en
Cartes
et
représentations, une réalité ?
Actuellement la confiance dans les données cartographiques est totale. Mesurer par exemple une distance sur une carte ne pose aucun problème, et surtout pas celui de l'erreur possible. La question ne vient d'ailleurs pas spontanément à l'esprit : en deux clics de souris un chiffre apparaît, mais non l'incertitude sur le résultat… A l'occasion d'un travail sur la position exacte de Carentomagus, station gallo-romaine, E. Marre analyse très finement les données cartographiques de son temps. Il donne un exemple très imagé de la relativité des sources graphiques en comparant Cassini, Lacaze et Romain sur l'itinéraire de Rodez à Villefranche. Les différences ne sont pas particulièrement insignifiantes…Curieusement les distances mesurées sur la carte dite Etat-Major sont toujours systématiquement plus fortes…
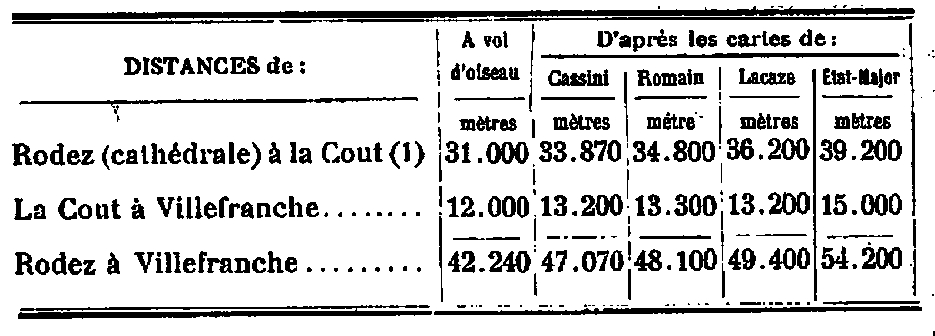
E. Marre, in Mémoires SLSA,
1912, tome
18, p. 559 sqq.
La
Carte administrative
du département de l'Aveyron - de
Romain- au 1/50.000 précise Marre, a été
établie par feuilles en 1860 d'après les travaux géodésiques exécutés
par les
officiers d'état-major. Mais la différence, assez inexplicable donc,
entre la
carte d'Etat-Major et Romain dépasse allègrement les 10 %...Pour sa
part
l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, consulté par l'auteur en
1912,
donnera la distance de
Diffusion
de l'Atlas cantonal, demi-succès ou demi-échec ?
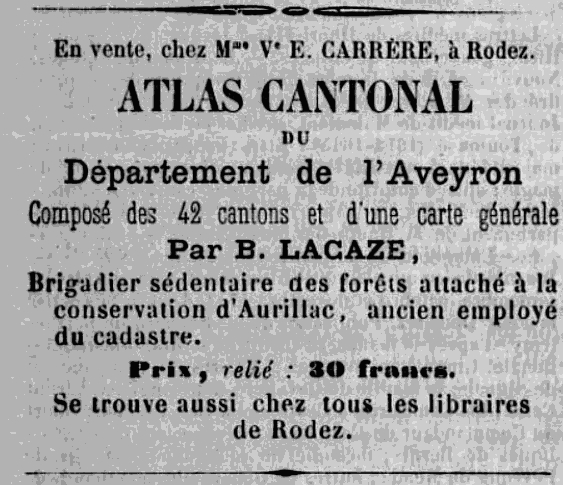
Journal
de l'Aveyron, 1875
Réaliser et dessiner
l'Atlas a été pour Baptiste Lacaze un travail important. Mais le plus
important est de le diffuser, souci constant chez tout auteur, et sans
doute essentiel ici pour l'impécunieux brigadier des forêts. Une fois
obtenue la diffusion par le Conseil Général des premiers exemplaires
auprès des cantons, Lacaze va se manifester auprès des élus, pour deux
éléments différents. Le premier, évoqué ci-dessous concerne la
propriété de l'Atlas, point important pour Lacaze qui en 1864 se
retrouve dans une action judiciaire contre Romain. Le deuxième concerne
les efforts de réduction de prix que Lacaze va consentir aux communes
pour écouler quelques centaines d'exemplaires, avec le soutien du
Conseil Général et sa subvention aux communes concernées.
En
1864, le rapporteur du CGA aux intérêts généraux présente
un
rapport très différent des précédents : Rapport
sur une demande en interprétation de délibérations du Conseil Général,
par le
sieur Baptiste Lacaze, auteur de l'Atlas départemental et cantonnal du
département de l'Aveyron. On devine un problème
de droit...
La question est simple : qui est propriétaire de l'Atlas, les dessinateurs ou le département ? Il est d'abord rappelé qu'en 1845 le traité intervenu entre le directeur des contributions directes et les géomètres concéda à ces employés la faculté de faire graver ou lithographier à leurs frais pour en livrer des exemplaires au commerce. Autorisés à publier, les auteurs n'ont pas par la suite abandonné cette disposition et le CGA a acquis pour son compte 50 exemplaires de l'ouvrage. Le CGA a donc pleinement reconnu le caractère privatif de l'Atlas.
En souscrivant ensuite en 1858 quatre-vingt exemplaires de la carte départementale de M. Romain avec un crédit de 4000 fr., payable en cinq annuités de 800 fr., le CGA n'a pas voulu méconnaître le droit conféré aux dessinateurs de l'Atlas. On apprend donc qu'une contestation existe entre MM. Lacaze et Romain sur des emprunts ou plagiats. Même si l'intervention du CGA dans une affaire privée en instance de jugement est délicate, position soutenue par plusieurs membres, le CGA adopte les conclusions du rapporteur suivant lesquelles le Conseil avait toujours entendu soutenir deux publications différentes, mais également utiles, et que, surtout, il n'avait jamais eu la pensée de méconnaître ou de révoquer le droit privatif concédé en 1845 aux dessinateurs de l'Atlas. La situation est donc pour M. Lacaze parfaitement claire, il est bien le propriétaire et l'auteur de l'Atlas. La diffusion lui appartient. Nous évoquerons plus loin le litige Lacaze-Romain.
En
En 1874, il reste 100 exemplaires disponibles chez M. Lacaze, qui diminue le prix pour les communes à 30 fr. En 1877 le CGA offre ainsi un exemplaire Aveyron à la Marne à titre d'échange. En 1878, le prix proposé aux communes par M. Lacaze est de 10 fr. ( ! ) : la généreuse intention sera portée au Recueil des actes administratifs pour encourager les communes. 70 vont profiter de l'offre, c'est-à-dire un Atlas de 30 fr. pour 10 fr. puisque le CGA verse ensuite 20 fr. à l'auteur. L'Atlas est utile : on le modifie régulièrement en ajoutant les travaux exécutés sur les routes et chemins vicinaux. Il en est de même pour la carte Romain. Ces documents modifiés sont présentés au CGA.
En 1880 le prix de l'Atlas pose problème : quelle somme le CGA doit-il voter depuis la réduction de prix de 1878 ? Quel chiffre convient-il de promettre aux communes ? 56 communes ont bénéficié du prix de 10 francs avec versement de 20 francs par le CGA à l'auteur. Le CGA prend acte de la situation, mais pour les nouvelles demandes décidera ultérieurement, s'il y a lieu, de faire bénéficier ces communes de l'allocation de 20 fr. , votée en 1865…
En 1883, suivant ces dispositions, M. Lacaze demande au CGA le paiement de 520 fr. pour la livraison à 25 communes de 26 exemplaires. Le CGA va alors rejeter la demande, en remarquant que M. Lacaze aurait dû attendre la décision préalable de consentement du Conseil. Les difficultés à équilibrer le budget sont également avancées.
La
fin de la partie sera sifflée en
En
1887, très obstiné, M. Lacaze demande à nouveau 300 fr. suite à la
fourniture de
quinze
exemplaires à des communes. Une discussion entre membres du Conseil
donne
l'occasion à la fois de rappeler les décisions précédentes dont celle
de 1880,
plus de fourniture, et la situation
précaire de M. Lacaze. Finalement il obtient gain de cause...Un
geste sympathique du Conseil.
L'Atlas
cantonal suit donc sa vie de publication avec finalement un certain
succès,
même si les chiffres de vente ne sont pas extraordinaires. En
1887 sera la dernière année d'évocation de l'Atlas cantonnal de MM. Lacaze et Clergue au Conseil Général de l'Aveyron. Quarante-trois ans au chevet de cet ouvrage que le CGA aura finalement soutenu avec beaucoup d'attention, et plus de 4,000 francs de crédits.

Le
10 janvier 1863, le Journal de Villefranche annonce la publication de
la carte départementale de l'Aveyron par Lacaze, complément de l'Atlas
cantonal. Le litige qui oppose Lacaze et Romain est alors dans
l'actualité aveyronnaise...