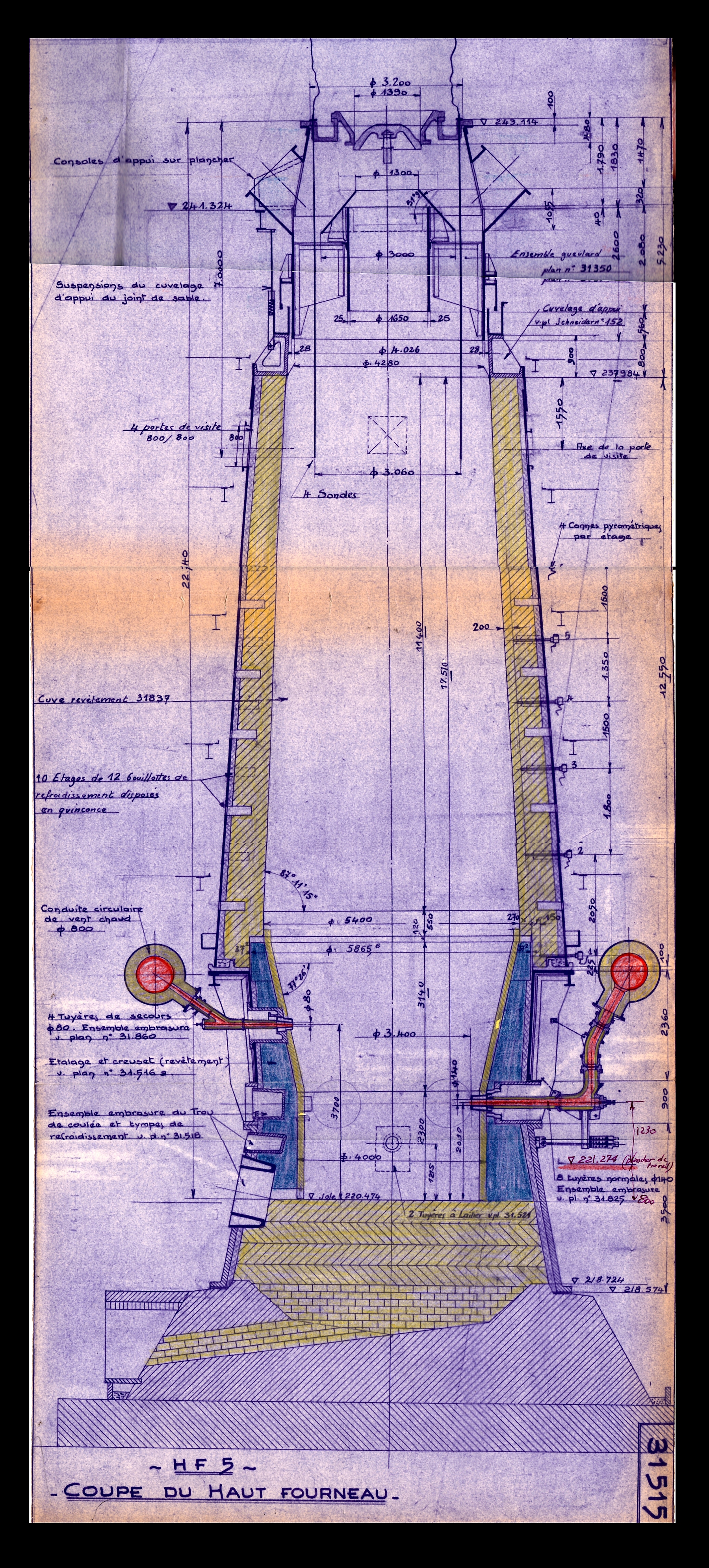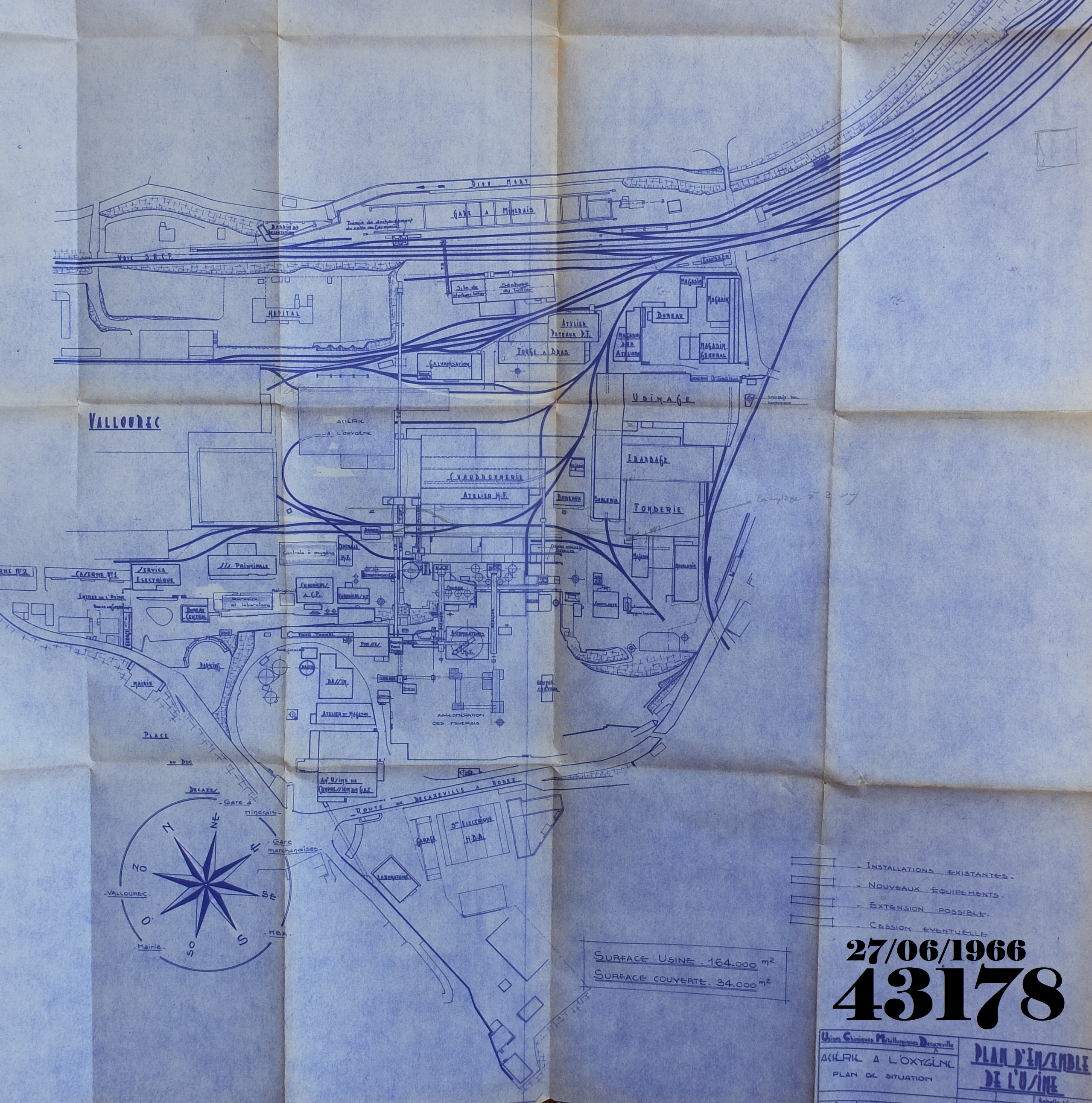Oui, essayer de mieux comprendre quelques aspects de cette histoire minière. Ce nouveau chapitre 13 est une suite : sous la forme de billets indépendants, nous reprenons la forme du chapitre 6, et allons poursuivre ici la chronique, des compléments et réponses aux questions que nous n'arrêtons pas de nous poser, des questions fondamentales, et quelques autres plus anecdotiques...
(clic sur la ligne pour accès direct)
 J 'y suis, j'y reste...
J 'y suis, j'y reste... Attention, un chemin
peut en cacher un autre !
Attention, un chemin
peut en cacher un autre !  Les affiches de
concession
Les affiches de
concession
 Le futur du passé,
l'avenir minier du causse
Le futur du passé,
l'avenir minier du causse
 Un(e) oolithe, qu'es
aquo ? Une histoire de
chocolat aux noisettes !
Un(e) oolithe, qu'es
aquo ? Une histoire de
chocolat aux noisettes !
 L'itinéraire
militaire de François Cabrol, des canons aux forges
L'itinéraire
militaire de François Cabrol, des canons aux forges
 En campagne,
Nicolas, François et quelques autres
En campagne,
Nicolas, François et quelques autres
 Les diamants blancs
de la Croisière Rouge
Les diamants blancs
de la Croisière Rouge
 Jogues, plaque
tournante du trafic
Jogues, plaque
tournante du trafic
 François Cabrol, les
débuts, de Firmy à la Salle
François Cabrol, les
débuts, de Firmy à la Salle
 Les
mines
lointaines de Cabrol et Cadiat à Bertholène
Les
mines
lointaines de Cabrol et Cadiat à Bertholène
 La
Salle
et Lassalle, deux noms, une famille
La
Salle
et Lassalle, deux noms, une famille
 Travers-banc
sur les concessions, un chemin tranquille ? Ou une partie de Monopoly
?
Travers-banc
sur les concessions, un chemin tranquille ? Ou une partie de Monopoly
?
 Rouge
et
verte, les couleurs de Decazeville, l'action !
Rouge
et
verte, les couleurs de Decazeville, l'action !
 Une
lettre du duc,
19 juin 1826, date importante !
Une
lettre du duc,
19 juin 1826, date importante !

C'est
donc un vrai paradoxe : Malakoff est un nom connu. Pourtant la guerre
de Crimée n'est plus dans nos mémoires. Et de plus, le nom
Malakoff qui fait d'abord allusion à une colline et pas
directement au patronyme d'un monsieur décédé plus de 15 ans avant
l'assaut, qu'il n'a donc pas connu, est absolument étranger au conflit
! Malakoff, écrit en français, anglais, italien et russe,
dessiné, peint, photographié, mangé, dégusté, mis en musique, joué au
théâtre, une commune, des avenues, boulevards, places...Malakoff est
dans toutes les têtes en 1855, mais la Crimée absente en 2016 !
L'explication de texte est vraiment nécessaire ! Voici non pas
l'histoire de Crimée, mais l'histoire de l'Histoire.
La page spéciale est ici, en cliquant sur le canon,
↓▼↓
 Attention,
un chemin peut en cacher un autre !
Attention,
un chemin peut en cacher un autre !
ou, comment François Cabrol a géré le projet de la voie de Firmi
à Marcillac.
Lorsque Elie Cabrol a écrit son mémoire sur le viaduc de l'Ady, il ne pouvait que donner une vision assez enjolivée de la réalité. Il ne cache pas d'ailleurs ce que le fils faisait pour le père. Nous nous en doutions depuis longtemps, et maintenant il y a quelques certitudes. Le projet ne fut pas dès l'origine, celui prévu : François Cabrol va trouver rapidement un appui dans la loi de 1810 sur les mines pour le modifier et se faciliter le travail. Il est d'ailleurs curieux qu'il n'y ait pas pensé auparavant... Il y aura ensuite quelques pavés sur ce chemin, et lorsque Elie souligne le aussitôt dit, aussitôt fait, nous allons montrer que l'unanimité ne fut pas la règle sur un projet de 20 km de longueur. Des modifications très substantielles sont apportées au projet, y compris pendant la phase travaux. Que ce soit dans la conduite administrative ou dans celle technique sur le terrain, François Cabrol se montre un partenaire décidé à obtenir rapidement ce que les intérêts de sa compagnie exigent. Il était un vrai Maître des Forges, n'en doutons pas !
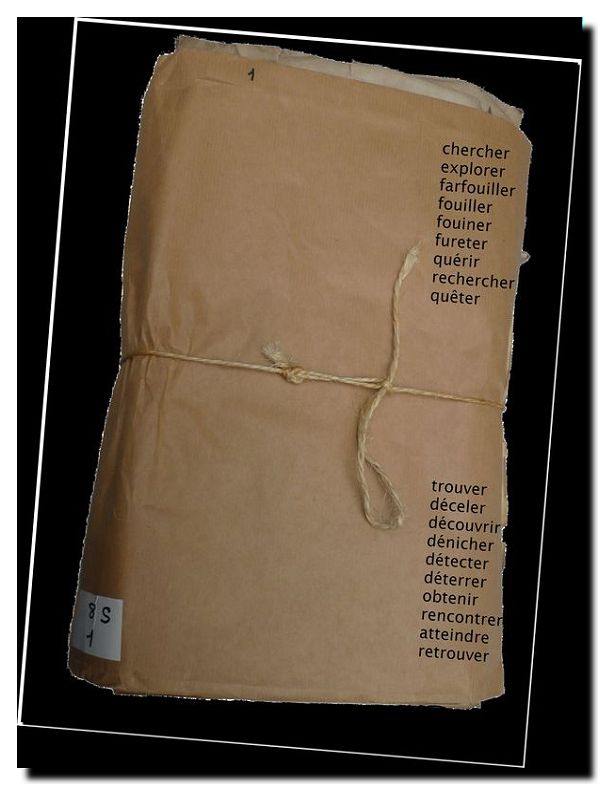 Le travail présenté sur les deux premiers articles repose sur une
recherche d'archives, menée en partie aux Archives Départementales de
l'Aveyron, A.D.A. Des liasses de papiers divers ont été parcourues.
Même si des lacunes subsistent, nous avons choisi de vous emmener sur
ce parcours en respectant la chronologie. C'est semble-t-il la
meilleure façon de découvrir ce beau projet. Parmi les cotes
essentielles concernées aux A.D.A, nous citons les sources 38S, 17S,
75S, 34S et 37W.
Le travail présenté sur les deux premiers articles repose sur une
recherche d'archives, menée en partie aux Archives Départementales de
l'Aveyron, A.D.A. Des liasses de papiers divers ont été parcourues.
Même si des lacunes subsistent, nous avons choisi de vous emmener sur
ce parcours en respectant la chronologie. C'est semble-t-il la
meilleure façon de découvrir ce beau projet. Parmi les cotes
essentielles concernées aux A.D.A, nous citons les sources 38S, 17S,
75S, 34S et 37W. (Photographies de l'auteur, droits réservés J. R,, 2013, autorisation A.D.A.)
Cette page du site peut être lue indépendamment des autres, mais pour une bonne compréhension, une lecture préalable des pages des chapitres 2, le parcours de Firmi à Marcillac, et 8, pour une vision des cartes, est préférable. Parmi les personnages connus de l'actuelle scène : Cabrol, Pers, les frères Decazes, Cibiel...
Propos…sur
l’établissement de la voie de Firmi à Marcillac
"...Monsieur Cabrol entreprit donc
de construire un chemin de fer à voie étroite, qui de Firmy irait
d’abord à Marcillac et plus tard monterait à Mondalazac…
Aussitôt adopté, ce projet fut mis
en exécution..."
Elie Cabrol, 1891, Le viaduc de l’Ady.
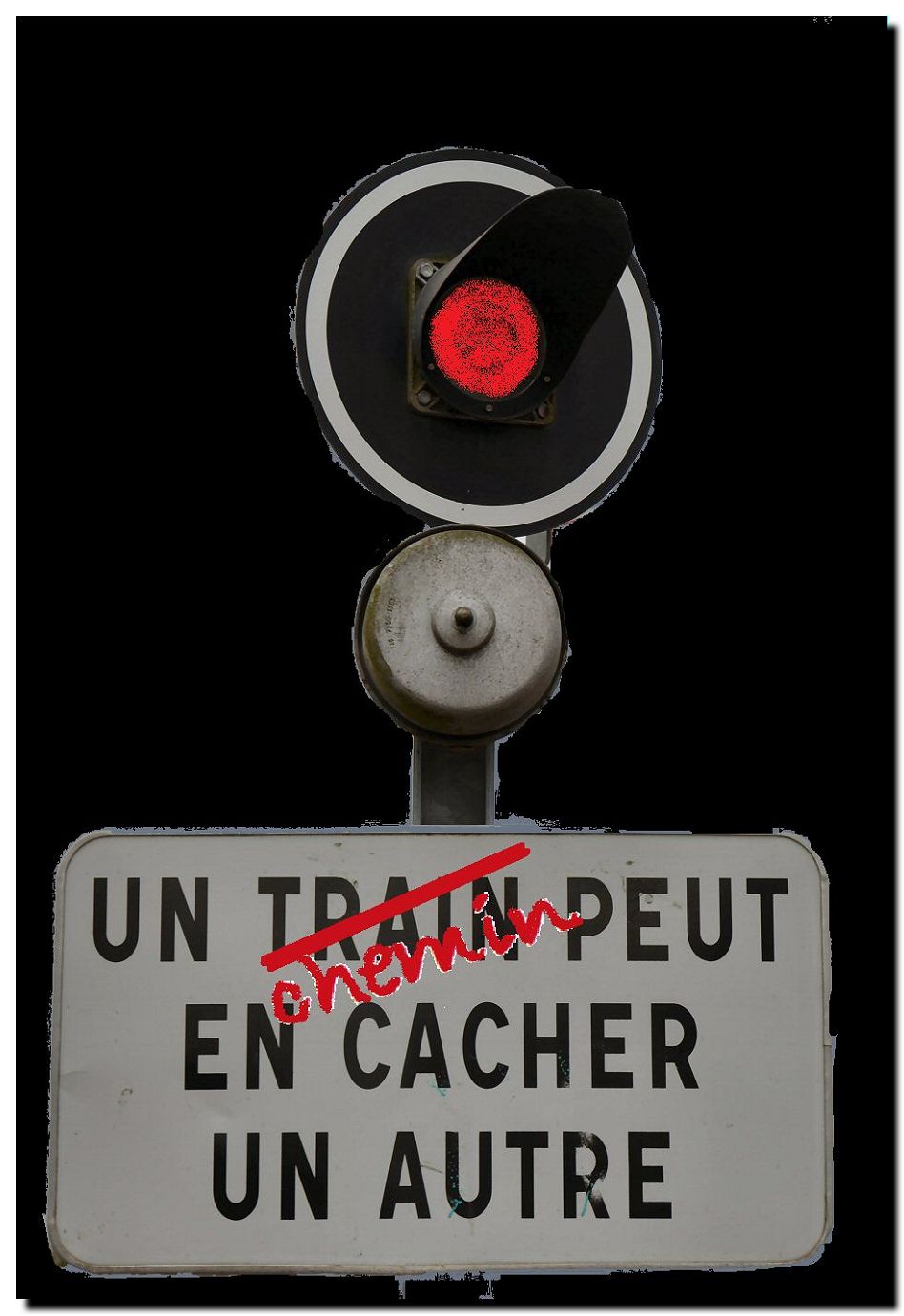
Quand Elie Cabrol, fils de François, l’Administrateur Directeur des Forges de Decazeville, écrit son ouvrage il ne donne en rien les clés du projet. Les raisons de construire la voie semblent faciles à cerner : ne plus dépendre des pouvoirs publics pour les transports de minerai, et faire des économies ; par contre la mise en place du projet n’est absolument pas le chemin facile trop rapidement suggéré par Elie. Adopté par le conseil de la Compagnie, il restait à le mettre en place, et ce ne fut pas malgré la stature du Directeur un projet sans soucis. Cette mise en exécution nécessitera une réflexion intéressante pour contourner les nécessités juridiques : créer non pas un chemin de fer, mais en premier lieu un chemin de charroi, et il y a plus qu’une nuance entre ces termes ! Il faudra ensuite traverser les propriétés. Il est d’usage de souligner que François Cabrol a pu acquérir sans difficultés les parcelles concernées. Est-ce la réalité ? François Cabrol n’avait, à priori, aucune obligation d’acheter les parcelles, la loi de 1810 lui permettant une occupation temporaire. De plus tous les propriétaires ne vont pas dans un enthousiasme collectif voir cette occupation très bénéfique pour eux. Il va y avoir des refus et des tentatives d’obtenir plus que ce que permettait la loi.
Janvier 1851
Le 10 janvier 1851, François Cabrol, en sa
qualité d’Administrateur Directeur de la Compagnie écrit au Préfet de
l’Aveyron. Il lui demande l’autorisation d’étudier
le tracé d’un chemin de fer de Riou Nègre au bas de la côte des
Hermets. Les motivations sont exposées. Ayant l’emploi
d’une grande quantité de minerai de Mondalazac, Cabrol évoque le prix du transport par roulage ordinaire, trop élevé.
C’est donc bien d’un chemin de fer qu’il s’agit :
la suite va montrer comment le Directeur négociera ce chemin.
L’occupation des terrains étant évidemment obligatoire pour ce projet,
la Compagnie offre de payer à dire d’experts le montant
des dommages d’étude. Dommages d'étude,
Très rapidement, le Préfet donne son autorisation à ce projet d’études, par un arrêté en date du 15 janvier 1851, soit cinq jours seulement après la demande.
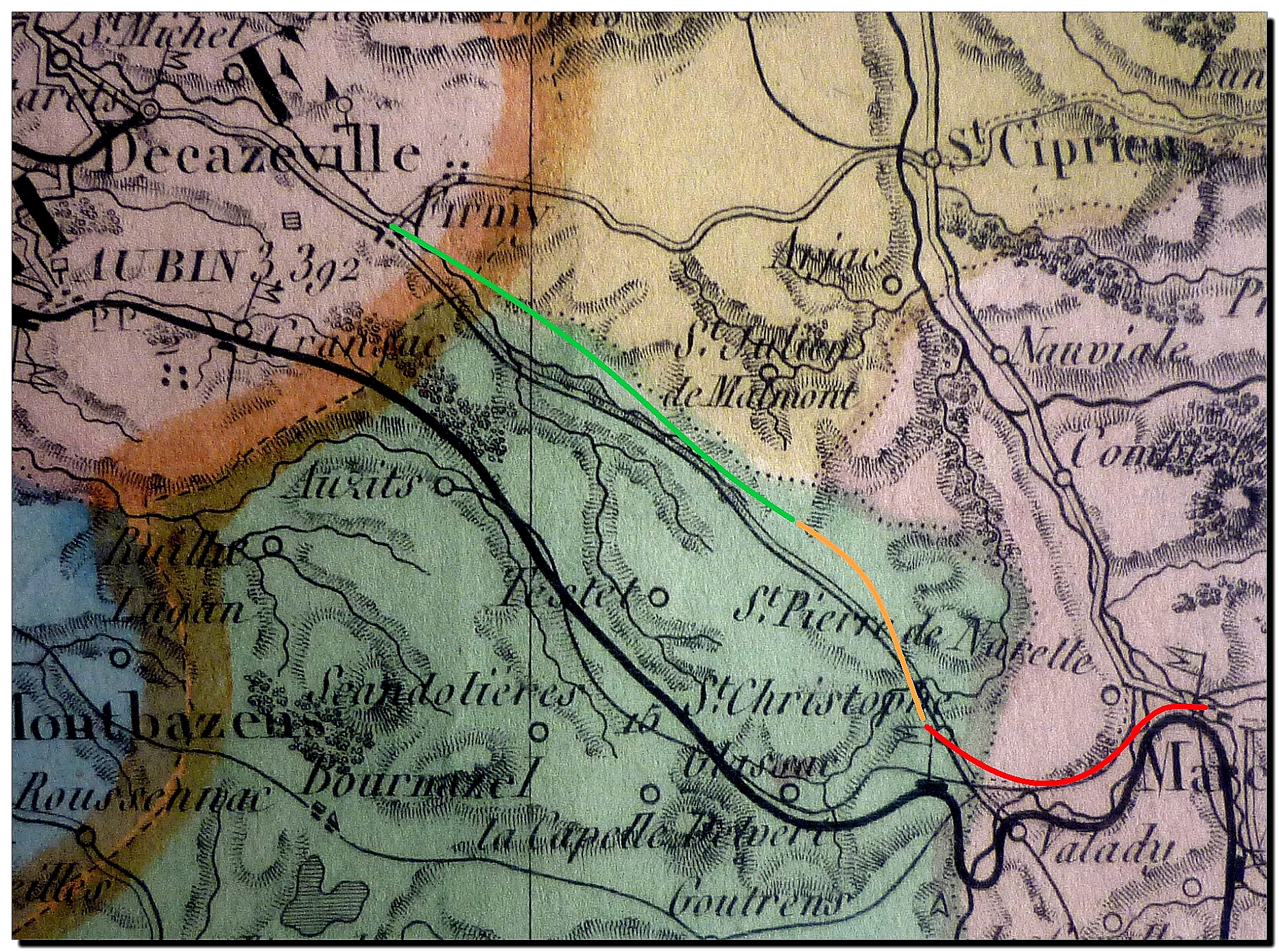 L’année 1851 est celle de l’étude, et les archives consultées ne
gardent pas de souvenir autre de ce projet. Il
concerne donc une partie du tracé de Firmi à Marcillac, partie qui
démarre à Riou Nègre. Il faut d’ailleurs lire entre les lignes :
Riou Nègre, c’est exactement au bas de la côte, à l'est du village des
Hermets. Que faut-il exactement comprendre dans la phrase de
Cabrol ? Car de Riou Nègre au bas de la côte, il y a peu... Dans les
faits, le chemin ira de Riou Nègre à Marcillac, pour sa partie Est.
L’autre partie ira donc de Riou Nègre à Firmi. Nous n'avons pas trouvé
trace de ce tronçon dans les archives de la compagnie, textes ou plans.
Notre plan de situation fait apparaître un tronçon vert, ici non
évoqué. Le tronçon beige démarre à Riou Nègre, se termine à la Brousse,
autre lieu évoqué dans les études. Le dernier tronçon rouge se termine
à Marcillac. Le chemin de charroi évoqué dans cette étude comprend donc
les deux tronçons beige et rouge.
L’année 1851 est celle de l’étude, et les archives consultées ne
gardent pas de souvenir autre de ce projet. Il
concerne donc une partie du tracé de Firmi à Marcillac, partie qui
démarre à Riou Nègre. Il faut d’ailleurs lire entre les lignes :
Riou Nègre, c’est exactement au bas de la côte, à l'est du village des
Hermets. Que faut-il exactement comprendre dans la phrase de
Cabrol ? Car de Riou Nègre au bas de la côte, il y a peu... Dans les
faits, le chemin ira de Riou Nègre à Marcillac, pour sa partie Est.
L’autre partie ira donc de Riou Nègre à Firmi. Nous n'avons pas trouvé
trace de ce tronçon dans les archives de la compagnie, textes ou plans.
Notre plan de situation fait apparaître un tronçon vert, ici non
évoqué. Le tronçon beige démarre à Riou Nègre, se termine à la Brousse,
autre lieu évoqué dans les études. Le dernier tronçon rouge se termine
à Marcillac. Le chemin de charroi évoqué dans cette étude comprend donc
les deux tronçons beige et rouge.
En passant...
L'écho
ci-dessus, paru dans L'Echo du Midi en janvier 1851 évoque le
projet de Cabrol et l'arrêté du préfet du 15 janvier. Le commentaire
précise un "en même temps"
bien insolite : en même temps que quoi ? Une interrogation qui laisse
une porte (entre)ouverte sur le projet de François Cabrol d'obtenir le
passage d'une voie vers Rodez sur ses terres minières ? Possible...
◄ Romain, agent-voyer en chef
...Il y aurait grand intérêt...à ce que l'encombrement des charrettes disparut...
Un appui administratif important avec cette lettre de Romain,
ADA, 38S1
2 juillet 1852
Le sous-directeur de Decazeville, de Clerck,
qui sera directeur plus tard, écrit en l’absence de Cabrol au préfet
pour présenter le projet de chemin. La Compagnie transporte
L’objet de la lettre est une demande au préfet afin qu’il déclare qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 80 de la loi du 21 avril 1810. Il y a urgence. (Voir cet article plus bas)
M. de Clerck précise évidemment qu’il offre l’indemnité et s’engage à acheter les parcelles si les propriétaires y consentent.
A cette lettre est joint un extrait des registres de la Compagnie pour attester les tonnages de minerai de Mondalazac transportés en ce début d’année 1852. Les chiffres suivants sont donnés en kilogrammes, et le second chiffre concerne le minerai de Lunel, du Kaymar, dont on sait par ailleurs qu’il fut effectivement un temps acheminé via Marcillac. L’état est daté du 22 juin 1852.
Janvier : 1 845 480 -- 312 170
février : 1 467 440 -- 40 330
mars : 2 868 080 – 445 230
avril : 3 923 870 – 713 060
mai : 4 722 420 – 1 021 040
Le total sur les cinq premiers mois s’établit à
En prenant l’exemple du mois de mai, 191 tonnes de minerai, une moyenne, parcourent les routes tous les jours. Sur la base de 3,5 tonnes par charrette, on peut donc en rencontrer près de 55 sur les chemins…
Un autre document, daté du 19 juin 1852, vient
appuyer les dires de Monsieur de Clerck. C’est une lettre de
l’agent-voyer en chef, M. Romain, l’auteur vers 1860 des cartes
départementales. Il certifie
que les chemins 1 et 21, de faible largeur supportent un roulage important non prévu. Il faudrait porter la
largeur de 4 à
Les travaux d’études de 1851 et de ce premier
semestre 1852 seront bénéfiques.
Août 1852
Le 9 août 1852, suite au projet présenté le mois précédent, l’Ingénieur en chef des Mines adresse au Préfet un projet d’arrêté permettant l’établissement d’un chemin de charroi. L’arrêté sera pris le 16 août. Ce projet lui avait été transmis le 9 juillet par l’ingénieur ordinaire. On note immédiatement la différence avec le souhait de l’étude de 1851 : il s’agit maintenant d’un chemin de charroi et non plus d’un chemin de fer. Comme tout texte de cette nature, un exposé des considérants précède le texte des articles. On souligne que les chemins 1, de Firmi à St Christophe, et 21 depuis Marcillac, sont insuffisants, un rapport de l’agent-voyer en chef venant appuyer le propos. La largeur des chemins et le montant trop faible des crédits d’entretien sont deux arguments cités. On sous entend donc qu’il n’est pas question d’augmenter les budgets. Les dits chemins sont déclarés souvent impraticables. Dans l’intérêt public, et au vu d’un certain nombre de textes législatifs, le chemin de charroi est donc autorisé par l’article 1 d’un arrêté en date du 16 août 1852. La Compagnie est invitée, article 2 à déposer dans le délai d’un mois un projet complet. L’article 3 précise les modalités de l’indemnité d’occupation, de gré à gré. Parmi les textes cités, il en est un essentiel, la loi du 21 avril 1810 sur les mines. Ce texte fondamental fut le premier du genre à avoir une certaine cohérence. Son article 80 est ici d’une utilité incontestable pour Cabrol.
art
80. Les impétrans sont aussi autorisés à établir des patouillets,
lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur
appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l’article
11 ; le tout à charge d’indemnités envers les propriétaires du
sol, et en les prévenant un mois d’avance.
L’article 11 pour sa part limite les permissions aux abords immédiats des habitations en exigeant au préalable dans ce cas l’autorisation des propriétaires.
Cet article 80, de bon sens,
permettait donc à un concessionnaire de pouvoir ouvrir des chemins
entre les différents sites de ses concessions. Ces chemins pouvaient
être situés hors concession. L’occupation des terrains qui ne peut donc
être refusée au concessionnaire pour une bonne exploitation de son
entreprise, est temporaire, c'est-à-dire... durera le temps de la
concession, à cette époque sans limite dans le temps...
Il est donc évident qu’au
lieu de demander la création d’un chemin de fer, procédure lourde, François Cabrol va s’appuyer sur cet article 80,
beaucoup plus intéressant : il est concessionnaire, n’a pas besoin
d’une longue procédure, l’autorisation préfectorale suffit, et il n’a
de plus aucune obligation d’acheter les parcelles occupées sur les
quelques
L’avis de l’ingénieur des Mines, six pages, en date du 29 juillet 1852, développe les arguments favorables du projet, en remarquant qu’en janvier 1852, 72 tonnes par jour ont pu être transportées, quantité très nettement insuffisante pour les usines. L’article 2 demande donc la fourniture sous un mois d’un projet complet, et des plans de détails qui devront être approuvés.
On ne peut que s'interroger sur la demande de F. Cabrol en janvier 1851, demande de créer une voie ferrée. Le Directeur connaissait parfaitement son droit. Se lancer dans un tel projet de voie ferrée allait sans doute mettre en oeuvre des dispositions juridiques lourdes. On souligne quelquefois qu'en l'absence de loi sur l'expropriation, François Cabrol avait usé de son autorité naturelle, comme de ses aptitudes en patois, pour négocier l'achat des parcelles. C'est faire preuve d'une certaine naïveté, et écrire une belle histoire : les textes législatifs sur l'expropriation existaient, loi de 1810, et surtout du 3 mai 1841. Le cadre juridique existe donc parfaitement. La procédure appelle l'action administrative et l'action judiciaire. Cette mixité procédurale ne devait pas satisfaire Cabrol. De plus, il semble que son projet échappe à la définition légale de petits travaux, pour émarger à la catégorie des grands travaux, par une longueur supérieure à la limite des 20 km. L'ensemble des procédures promettait une bataille longue : le capitaine choisit ainsi une autre tactique, le chemin de charroi, quitte à mettre des rails dessus...pour le transformer en chemin de fer !
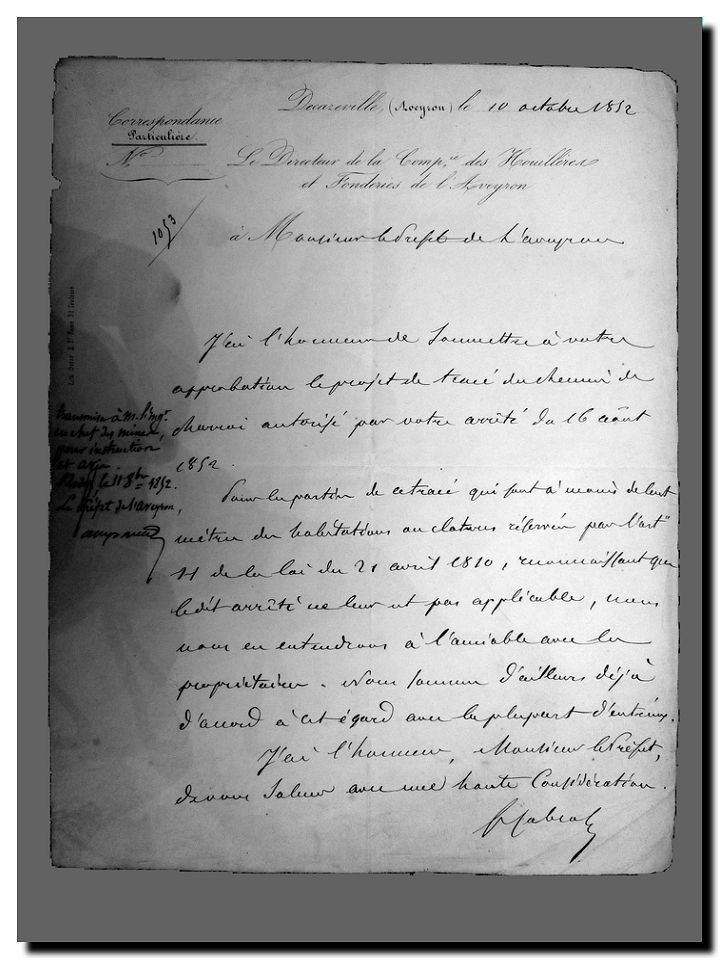
Ci-contre, lettre François Cabrol au Préfet, du 10 octobre 1852 : le projet de chemin de charroi est lancé...
Octobre 1852
Dans les délais, ou presque, Cabrol transmet donc le 10 octobre le projet du chemin de charroi. La seule remarque faite concerne le passage à moins de cent mètres des habitations. Ce passage n’est pas concerné par l’arrêté, et Cabrol précise au Préfet qu’il a demandé pour ces cas précis les autorisations voulues par l’article 11 de la loi de 1810 : nous nous entendrons à l’amiable. Nous sommes d’ailleurs déjà d’accord à cet égard avec la plupart d’entre eux. On note le prudent la plupart…, ce n'est donc pas l'unanimité.
Le Préfet transmet le dossier à l’ingénieur en chef des mines pour instruction et avis le 11 octobre 1852.
Novembre 1852
Le 14 novembre est donnée par arrêté une autorisation d’établir un chemin de charroi depuis le domaine de La Brousse à Marcillac, c'est-à-dire de Saint-Christophe à Marcillac. Il s’agit donc de la deuxième partie du chemin. Des modifications sont datées du 13 novembre, et donnent lieu à nouveau rapport.
4 décembre 1852
L’ingénieur en chef des mines adresse son rapport au préfet.
L’ingénieur ordinaire a rendu le sien le 14 novembre. On peut y lire,
au sujet de la Compagnie : pour construire le chemin de
fer elle a rencontré des difficultés et des oppositions de la part des
propriétaires ; c’est alors qu’elle s’est adressée à
l’administration ; mais comme cette dernière, d’après le texte de
la loi et les décisions du Conseil d’Etat ne peut autoriser que des
chemins de charroi et non des chemins de fer, la Compagnie a demandé à
construire un chemin de charroi du Riou Nègre à Marcillac.
Ainsi dit très simplement, on comprend donc parfaitement la genèse du projet : contourner les difficultés avec un chemin de charroi, ce qui va permettre de passer outre les oppositions.
Le rapport de présentation du projet d’arrêté
poursuit : depuis la Compagnie a pu s’arranger avec
les propriétaires depuis le Riou Nègre jusqu’au domaine de La Brousse
et par conséquent a établi un chemin de fer au lieu d’un chemin de
charroi, qu’est beaucoup moins économique…L’Administration ne peut
qu’applaudir à ce résultat…
Voilà, tout est dit ! Le chemin de charroi mène directement à la voie ferrée, avec les applaudissements de l’Administration ! François Cabrol devait être particulièrement satisfait de son projet...
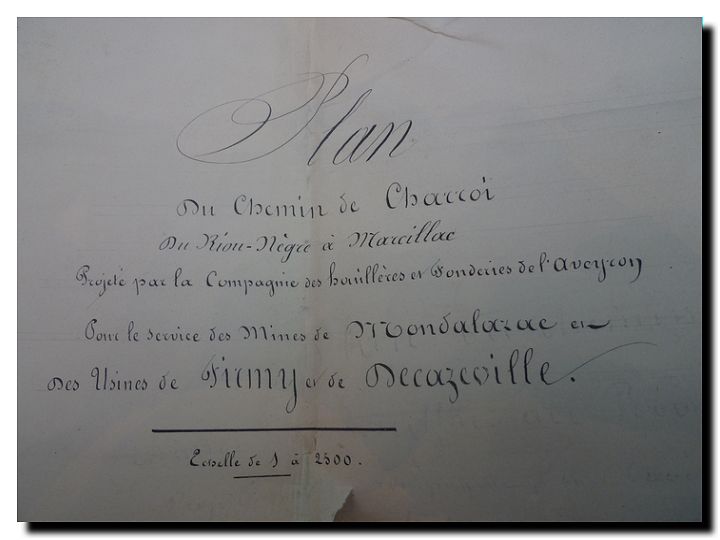 Le rapport énonce ensuite un certain nombre de particularités
techniques, comme le soin du tracé d’éviter les zones de
vigne et les terrains de grande valeur.
Le rapport énonce ensuite un certain nombre de particularités
techniques, comme le soin du tracé d’éviter les zones de
vigne et les terrains de grande valeur.
L'en tête du plan n'est pas aussi soigné que d'habitude....
Il y a ensuite sur ce tracé des passages plus délicats, qui concernent les traversées de route et chemins. La Compagnie (doit) s’entendre avec l’administration des agents voyers pour le passage sur les routes de grande communication n°1 et 21, avec celle des ponts et Chaussées pour traverser la route départementale n°4. Le chemin 1 est celui conduisant à Firmi, le 21 celui passant à Marcillac, la route 4 est celle qui passe à Marcillac. Le passage sera à niveau sur le chemin 1, à Saint-Christophe et avant le tunnel d'Hymes, par un viaduc, celui de l’Ady, pour le 21, et un pont, le pont Rouge pour la route 4. Mais le rapport ne précise pas ces détails.
Le 8 décembre 1852 l’arrêté du préfet est signé. Les visas évoquent l’arrêté du 16 août autorisant en principe le chemin de charroi, le projet et les plans fournis le 10 octobre et un modificatif du 13 novembre.
Considérant que le tracé du chemin
autorisé est convenablement choisi et qu’il remplit les conditions
nécessaires à un chemin de charroi….la construction du chemin est
autorisée du domaine de la Brousse à Marcillac (art 1).
C’est donc une première étape qui se termine fin 1852, première mais importante, permettant l’établissement du chemin de Firmi à Marcillac. Avec toutes ces autorisations administratives, Cabrol peut s’engager sur le terrain. On aura noté, pour conclure cette étape, la substitution de charroi à fer, mettant tout le monde d’accord, enfin Compagnie et Administration, à défaut des riverains, et l’extrême facilité qui est accordée pour la traversée des routes, une simple entente suffira. Il reste donc à parcourir le terrain, avec pelles et pioches…
Une interrogation ?
Ces pièces d’archives ne font aucune mention de la première partie du tracé, de Firmi à Riou Nègre ou au domaine de la Brousse près de Saint-Christophe. Ces parties semblent avoir été dissociées du projet que nous présentons. Est-ce pour contourner la limite légale des 20 km de voie ferrée ? Il est intéressant de noter que le projet global était assez incohérent, pour un observateur extérieur : mise en place d'un chemin à caractère privé car industriel, de charroi...pour éviter les nuisances...des charrois. Certains n'ont sans doute pas tout compris immédiatement. La première partie de ce chemin industriel était une voie ferrée, de Firmi à Riou Nègre. Il n'y a aucune espèce d'ambiguité, François Cabrol voulait un chemin de fer, et construisit un chemin de fer.
Avant d'évoquer quelques aspects particuliers, nous nous (re)reposons la question : la compagnie était-elle propriétaire de tout le terrain de son chemin ? La réponse ne figure pas exactement dans les documents consultés. En examinant attentivement le cadastre actuel, il est possible de suivre dans sa quasi totalité ce chemin industriel, ses parcelles étant de nos jours parfaitement identifiables. On peut conclure que l'achat était une généralité, car si l'occupation était du type temporaire, le cadastre aurait-il eu besoin -détail juridique à éclaircir- de faire figurer une parcelle distincte, en l'individualisant ? L'article 80 de la loi de 1810 n'apporte pas d'éléments sur ce point. Par contre, en cas d'achat, cette individualisation de la parcelle est évidemment faite.
La première étape était administrative, et on a compris que ce ne fut pas pour Cabrol une grande difficulté : l'administration centrale était acquise à sa cause, et l'administration locale devait pour sa part être très satisfaite de ne plus gérer les conflits de circulation de charrois sur les chemins locaux. La seconde étape, celle de la réalisation sera plus chaotique. Parmi les opposants, nous avons la trace de Monsieur Clerc, écrit quelquefois Clair, et ce dans les mêmes lettres…
Monsieur Clerc était propriétaire à Marcillac.
Et donc propriétaire de parcelles. La loi de 1810 et son article 80
permettent à la Compagnie de ne pas demander d’autorisation
d’occupation de parcelles. Par contre elle oblige le concessionnaire à
verser une indemnité annuelle pour cette occupation
temporaire, temporaire le temps que dure la concession…et à cette
époque les concessions sont…perpétuelles ! Dans le cas d’un
passage à moins de
1853
C’est donc un litige d’occupation de parcelle sans accord du propriétaire.
Cabrol avait fait une offre d’achat de 480 francs le 24 mai, refusée. Cette somme fut déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle était le double de la valeur estimée. Clerc évoque également des dégradations et des enclaves créées par ce chemin.
En novembre, le 15, le commissaire de police du canton de Marcillac s’adresse au Commissaire Départemental pour demander la conduite à tenir. Il vient d’être saisi d’une plainte de Clair : les ouvriers se sont emparés d’un terrain et l’avaient contraint d’en sortir. Il s’agit bien sûr des ouvriers de Decazeville ayant un peu brutalement occupé les lieux. Cette occupation avait eu lieu le 16 septembre, malgré donc le refus du propriétaire.
Le 21, Clerc ne conteste pas l’occupation, mais le montant de l’indemnité, une nuance.
Le 5 décembre 1853, le Préfet prend un arrêté pour nommer un expert, un ingénieur des mines, ce que refusait de faire Clerc. Cet expert devra avec le deuxième expert, M. Agar, maire de Marcillac, procéder à l’évaluation de l’indemnité. Un troisième expert était également prévu en cas de désaccord des deux nommés.
Le 21 décembre Clerc Jean-Antoine, cultivateur à Marcillac, s’adresse directement au ministre pour demander l’annulation des arrêtés du préfet. Ils sont entachés d’illégalité. C’est un père de famille, un homme sans fortune qui s’adresse à vous et qui ne peut assumer les frais ruineux d’un procès...
Le 31 décembre, le préfet écrit au
ministre. Il rédige un mémoire faisant le point de l’affaire. La
réclamation de Clerc concerne donc des arrêtés préfectoraux, qui sont
contestés, et dont la demande d’annulation est faite. Dans ses
arguments le préfet commence par reprendre les motivations du
projet : il existe un chemin de fer de Firmy à Riou
Nègre... Les chemins de grande communication 1 et 21 ne peuvent
supporter le passage de
On remarque au passage que
si le Préfet fait état de la voie
ferrée de Firmi au Riou Nègre, aucune pièce la concernant ne
figure dans le lot d'archives consulté...
1854
Le 5 janvier le procureur écrit au préfet. Le
litige commence donc à grossir pour arriver, étape supplémentaire,
devant le juge. Le procureur indique que Clerc a adressé
une plainte pour occupation sans que les formalités voulues par la loi
aient été préalablement remplies. Il ajoute que Clerc
a été menacé et injurié par Michel B…, chef d’atelier. Ces faits me
paraissent graves.
Avant d’intenter une action correctionnelle le procureur demande au préfet de lui adresser quelques renseignements sur la procédure suivie. Le procureur souligne donc la gravité des faits, ce qui semble démontrer la marche en avant un peu expéditive des gens de Decazeville.
Deux jours plus tard, le préfet fait part de sa
réponse. Il conclut : j’ai ouï dire que les experts
avaient procédé à l’accomplissement de leur mandat, mais j’ignore le
chiffre de l’indemnité qui a pu être fixé.
Nous n’entendrons plus parler de ce litige par la suite. On peut penser qu'un accord avait été trouvé, mais nous n'en connaissons pas, comme le préfet, les conditions.
Cette année là, 1854, l’occupation des parcelles sera effective, les travaux d’aqueduc sur la parcelle Clerc faits, ainsi que tous les terrassements. Les arbres sont coupés. Le passage en force des ouvriers de Decazeville est donc terminé. Cette seconde étape est donc celle de l’établissement de la voie.
Le plan général de cette partie du tracé, du domaine de la Brousse à Marcillac montre le passage de la route à Saint-Christophe. Le passage est à niveau et ne pose pas de difficultés particulières : en observant ce détail du plan, on constate en effet qu’il n’y a aucune habitation qui pourrait être en cause à cette date…Le village ne se développera sur ce versant que beaucoup plus tard, en enserrant la voie. Celle-ci fut même un temps en place au carrefour même dans la chaussée routière. Le domaine de La Brousse se situe à proximité et à l'ouest de Saint-Christophe.
Que reste-t-il à réaliser avant que le minerai puisse enfin suivre cette Route du Fer, de Marcillac à Firmy ? Les ouvrages, ceux de l’Ady et le pont Rouge de Marcillac, et sans doute quelques tunnels. Le tout sera achevé en 1856.
Avant de tourner cette page, quelques mots sur la situation près d'un siècle plus tard. Après 1920, Commentry, Fourchambault et Decazeville n'aura plus besoin de cette voie, puisque le minerai du causse sera définitivement exclu des usines, au profit en partie mais pas seulement du minerai lorrain, à nouveau disponible. Non utilisés, ouvrages et voie vont connaître le sort habituel en cette circonstance, inutile de préciser. Les parties de voie qui avaient fait l'objet d'un achat sont alors revendues, tout comme le viaduc de l'Ady. Des particuliers saisissent cette opportunité. Des collectivités également, comme la commune de Valady par exemple. L'achat dans ce cas précis fut même déclaré d'utilité publique en septembre 1944. Une souscription fut mise en place pour soulager les finances communales. Il est enfin intéressant de noter que la compagnie avait mis une clause particulière dans les actes de vente. Ainsi, les parties vendues à Monsieur.... et Monsieur .... doivent être laissées à l'état de voie publique. Telle est la mention portée dans l'acte notarié. Une autre version similaire se rencontre : les immeubles vendus sont destinés à constituer une voie publique ouverte à la circulation générale (in acte notarié 1945)...
Propos…sur le
viaduc de l’Ady, dit pont Malakoff, modifications de tracé routier
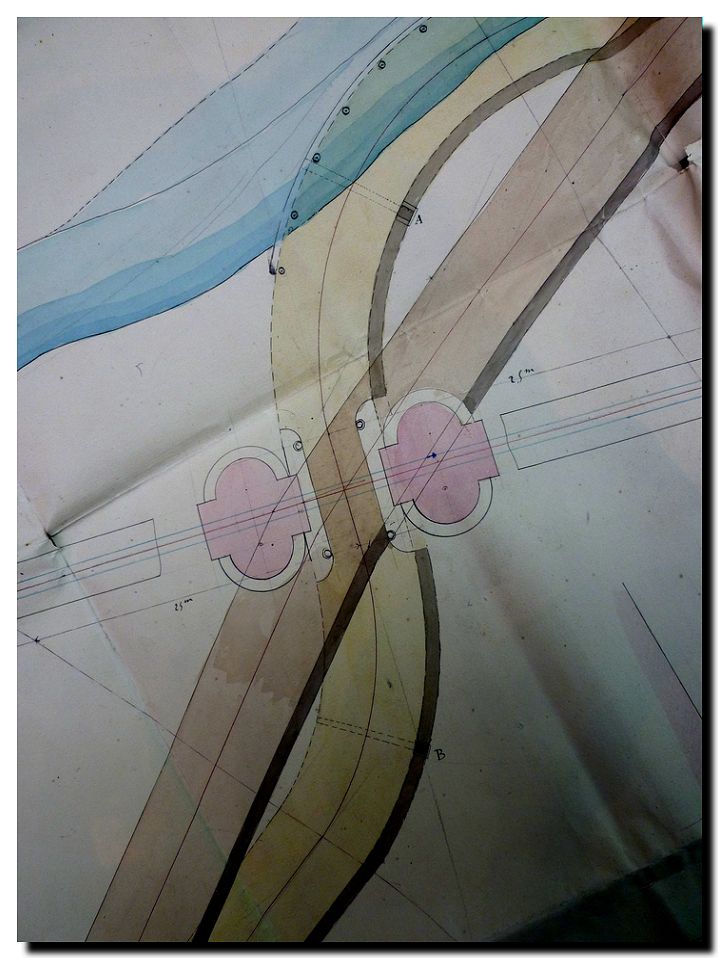
Plan de la modification routière : création du S de la route, permettant un passage plus convenable. Ce S sera un siècle plus tard l'une des raisons avancées pour la destruction du viaduc...Ce plan nous permet aussi de vérifier que dès le début François Cabrol avait prévu ici des tours cylindriques, une coquetterie dirait son fils Elie.
8 août 1854
M. Romain, agent-voyer en chef fait part au
préfet d’une demande de Decazeville concernant le passage de l’Ady et
du chemin de communication. A cet endroit la voie minière traverse en
biais vallée et route. Il n’y avait pas d’autre
possibilité : créer un passage perpendiculaire à la route et au
ruisseau auraient nécessité des courbes de la voie ferrée trop
importantes, au vu de l’étroitesse de la vallée. Cabrol propose alors
d’exécuter à ses frais une modification du tracé de la route pour la
faire passer perpendiculairement à l’axe de sa voie sous la culée. La
demande est évidemment une mesure de bon sens qui s’impose. Mais cela
va nécessiter de modifier le tracé de la route en créant un S avec
courbes serrées de la route. Romain propose donc des rayons minimaux de
Le plan de cette modification, réalisé et proposé par la Compagnie de Decazeville, est approuvé le 16 septembre 1854. En surcharge sur ce plan, et dessinée au crayon alors que le plan est joliment à l’encre et aquarellé, une élévation, celle du viaduc de l’Ady. Sa présence est assez curieuse sur ce plan, et pourrait ne pas être du tout liée au projet de déviation…Ou l'administration a-t-elle demandé une élevation de l'ouvrage, d'où ce dessin un peu à la va vite ?
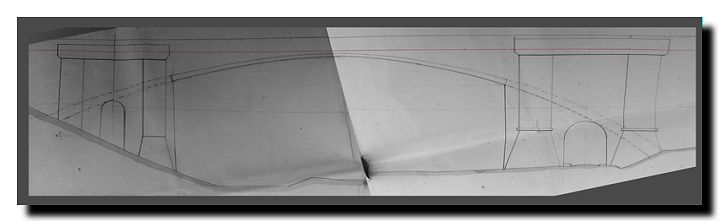
Son intérêt réside bien sûr dans le dessin de l’ouvrage. Y figurent presque toutes les options qui seront retenues pour sa construction. Le dessin fait bien apparaître l’arc métallique et ses deux courbes différentes, formant une poutre à inertie variable. Le report des efforts de part et d’autre sur les arcs en pierre est bien prévu. Pour cacher ces arcs,en pointillés, les constructions sont très massives. Rien ne laisse deviner la multitude d’ornementations qui sera réalisée : mâchicoulis, meurtrières, … Le dessin des passages sous culée montre une différence de traitement : le passage de la route rive gauche, à droite du dessin, se fait avec la largeur de six mètres prescrite, alors que le passage rive droite est plus étroit. Rien ne passe d’ailleurs ici ! Autre détail : le passage rive droite, à gauche donc du dessin, est plein cintre, alors qu’il sera réalisé avec des arcs brisés, une complication très (trop ?) gratuite…Les tours de chaque pile sont en place, mais le dessin ne permet pas d’imaginer les unes cylindriques, rive gauche, les autres prismatiques sur la pile rive droite. Seul le plan les montre cylindriques, pour celles de la culée rive gauche. Ce plan est réalisé sur un carton fort et parfaitement conservé. Le dessin du projet de déviation est à l'encre et aquarellé, celui de l'élévation du viaduc est au crayon et semble avoir été porté après coup...Est-il de la main de Cabrol, est-ce une première esquisse, dessinée sur ce plan, et demandée par l'administration ?
Propos…sur
Marcillac,
modification de tracé
L’année 1854 connaîtra également une
modification importante du tracé. En mars ou avril, la Compagnie va
demander une modification pour pouvoir prolonger d’environ
un kilomètre la voie. Cela doit permettre d’éviter les
encombrements et permettre le stationnement de voitures en dehors de
tout chemin public. La demande sera
acceptée et nous vaudra donc l’existence du dernier tunnel de la ligne,
sur
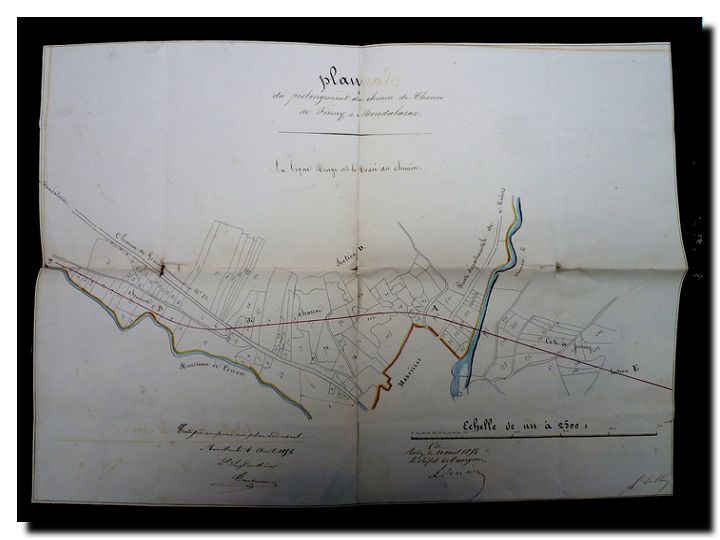
charrettes, chars, dépôts de minerai, animaux…Des observations et plaintes furent émises. Sagement donc, la Compagnie propose et obtient cette modification. Cela vaut aujourd’hui à deux propriétaires au moins la possession d’entrée de tunnels et un usage privatif valorisant !
Cette modification ne sera
pas la seule. Le plan approuvé par l’arrêté préfectoral montre depuis
le viaduc de l’Ady, un tracé suivant la vallée rive droite et par une
large boucle un retour vers Marcillac et le pont Rouge. Ce tracé,
souligné par nous en rouge, ne sera pas réalisé, puisqu’un tunnel, de
près d’un kilomètre va traverser la colline et permettre un tracé
pratiquement linéaire entre l’Ady et Marcillac. L’économie de longueur
est réelle :
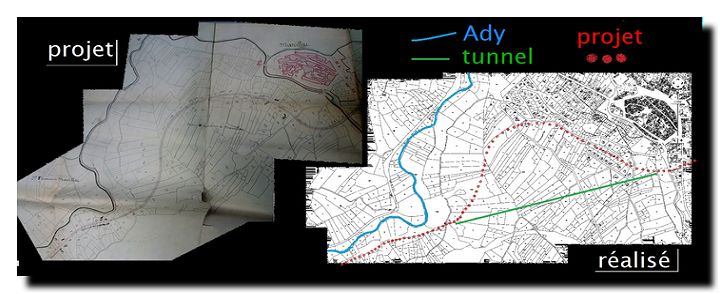
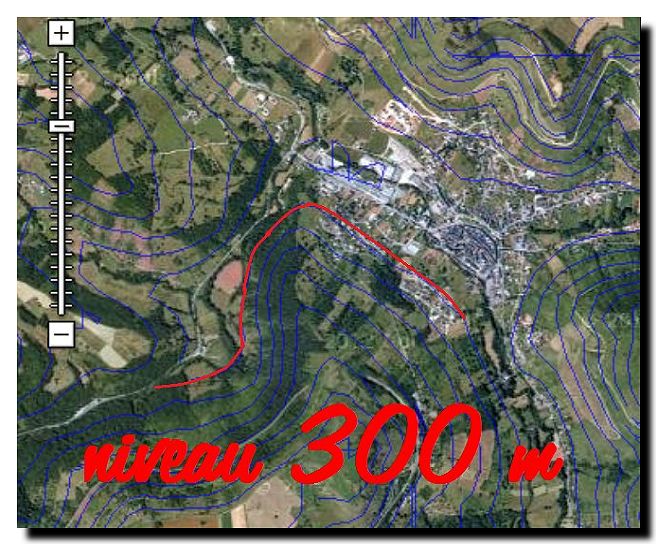
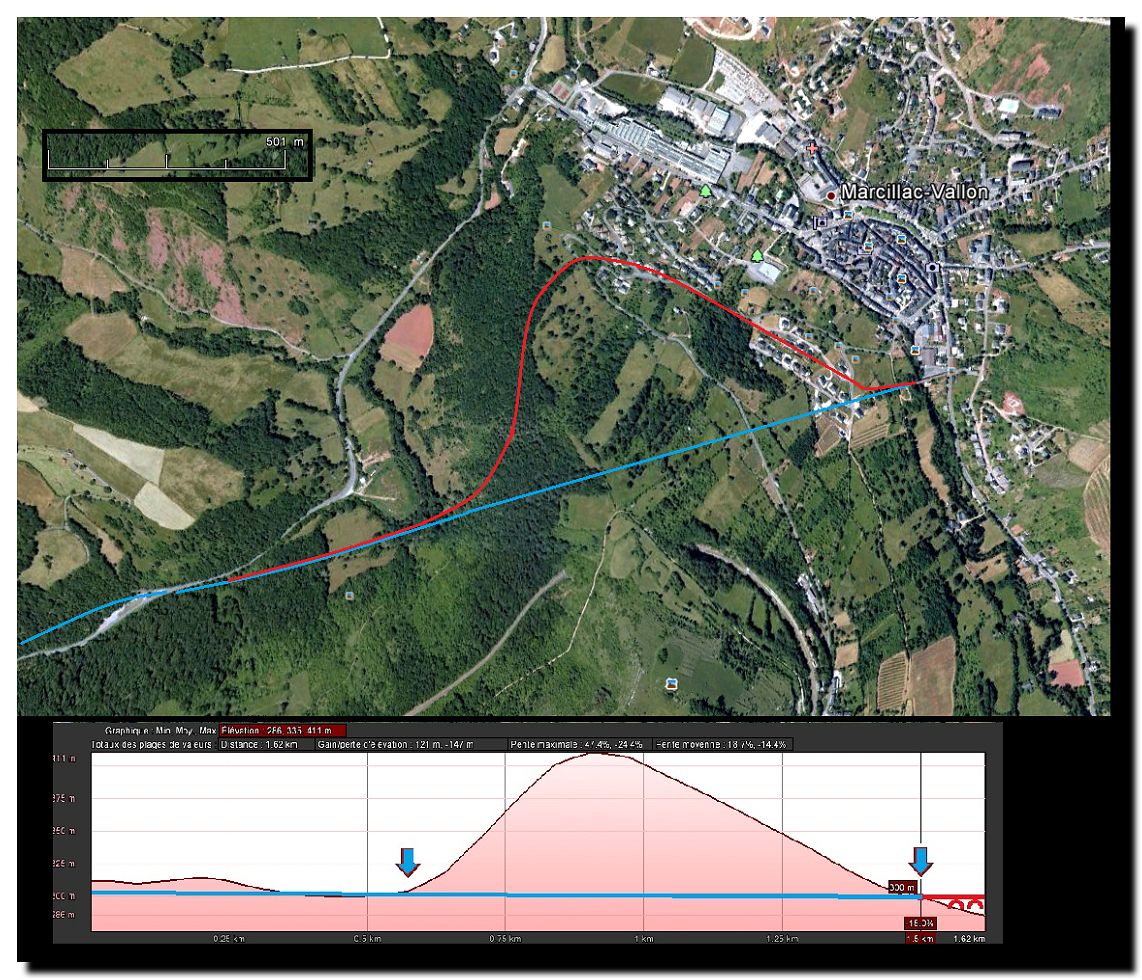
Propos…sur le
Pont Rouge, plainte
Monsieur
Clerc ne fut pas le seul à se plaindre. La construction du pont Rouge,
sous la direction écrit Elie Cabrol de Scudier, (Escudié ?), qui avait dirigé avec succès celle du viaduc de
l’Ady, nécessite l’emploi de chaux, pour des travaux indispensables à
terminer avant novembre 1855. Cabrol ira chercher cette chaux du côté
de Saint-Cyprien. Seulement il fallait aussi la fabriquer, et sans
aucune demande administrative, déclaration ou autre, la compagnie
mettra en place pour cela deux fours à chaux dans le village de
Saint-Cyprien même. Le problème se pose rapidement : ils sont très
proches, moins de dix mètres ( ! ) 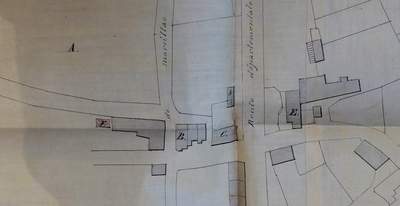 d’habitations : fumée et
odeur, insalubre et incommode, vont dire les plaignants.
L’ingénieur des mines, saisi, ne peut que constater que ces deux
fours n’ont jamais été autorisés et sont trop proches des habitations.
Il y a donc lieu de les démolir ou de les éteindre définitivement.
Pour se justifier, le 13 octobre, Cabrol invoque la nécessité. Les fours sont donc tolérés jusqu’à fin novembre.
d’habitations : fumée et
odeur, insalubre et incommode, vont dire les plaignants.
L’ingénieur des mines, saisi, ne peut que constater que ces deux
fours n’ont jamais été autorisés et sont trop proches des habitations.
Il y a donc lieu de les démolir ou de les éteindre définitivement.
Pour se justifier, le 13 octobre, Cabrol invoque la nécessité. Les fours sont donc tolérés jusqu’à fin novembre.
▲ vraiment proches ! repère F (ADA, 38S1)
Elie Cabrol évoque la fin des travaux avec des fêtes et manifestations diverses. Les débuts d’utilisation se feront donc en 1856.
Propos…sur un
tunnel instable
Quelques années plus tard, en 1862, nous allons encore rencontrer un conflit et quelques difficultés qui auraient bien pu être tragiques. Monsieur Pers est au centre du problème. Monsieur Pers n’est pas un inconnu pour nous. Nous l’avons rencontré il y a quelques années, lorsque il entra en conflit avec Cabrol sur une non observation de contrat. Monsieur Pers est entrepreneur de transport, roulier disait-on à cette époque. Son contrat avec Decazeville lui assurait un tonnage de minerai pour son activité. La Compagnie, pour des raisons diverses, transportait elle-même une partie de ce minerai, privant ainsi M. Pers de revenus. Le conflit, nous l’avons évoqué ailleurs, va se terminer devant le tribunal.
Le 7 avril 1862, le commissaire de police de Marcillac fait état d’une plainte : M. Pers, entrepreneur des transports de minerai résidant à Marcillac se plaint très haut du mauvais état du tunnel de Marcillac…Des blocs de pierres sont tombés sur des chevaux plusieurs fois… Le commissaire s’adresse donc au préfet. Pers dépose une plainte auprès du service de l’ingénieur des mines. Le 28 avril l’ingénieur des mines adresse à son supérieur un rapport dans lequel il évoque une inspection par le garde-mine d’Aubin, chargé des problèmes de sécurité : le tunnel ne présente pas toute la solidité désirable. La visite faite par celui-ci de 9h à 11h du matin, montre un tunnel muraillé en certains points, boisé en d’autres, et généralement nu… Sur ces parties nues, sur trois points différents, le ciel ne présente pas la solidité désirable. Monsieur Rouquayrol, ingénieur et présent à cette visite, a aussitôt donné ordre que les parties soient boisées dans le plus bref délai. Evidemment si le tunnel était l’objet d’instabilités de son ciel en 1862, il ne peut qu’en être le cas un siècle et demi plus tard…surtout pour des parties boisées.

Les concessions, conflit sur le causse, et autres concessions.
La présence des
deux concessions du causse, celle de Solsac et Mondalazac appartenant à
Decazeville, et celle de Muret propriété d’Aubin, va donner lieu, on le
sait, à de multiples conflits et péripéties diverses.
Un de ces litiges, le plus fameux, concerne l’initiative des gens d’Aubin d’exploiter à ciel ouvert une minière leur appartenant mais située dans le périmètre du concurrent. Cette situation juridique inédite a donné lieu à un retentissant dossier minier évoqué dans d’autres pages du site. Nous rappelons simplement que le Conseil d’Etat va annuler le 10 août 1850 la décision du ministre en date du 31 août 1848 qui confirmait la décision du préfet de l’Aveyron du 10 novembre 1846. C’est cette première décision autorisant Aubin à extraire le minerai qui avait très logiquement déclenché les hostilités entre les deux Compagnies. Les archives de Decazeville conservent la trace du mémoire de François Cabrol adressé au ministre le 6 janvier 1848 : 50 pages ! Donc difficile à résumer ici…Mais cette simple information montre assez l’importance que ce problème avait pour les deux Compagnies et aussi pour l’administration et les spécialistes du droit minier. Cette exploitation à ciel ouvert près du village des Espeyroux deviendra ainsi très célèbre.
Quelques jours après ce 10 août 1850, un nouveau litige, quelque peu cocasse sur ses motivations va naître. En effet dix jours après l’arrêt du Conseil d’Etat, la compagnie d’Aubin demande très officiellement le 21 août 1850 au préfet d’intervenir pour que la compagnie concurrente lui livre 1000 tonnes de minerai par mois de sa concession de Mondalazac. Cette demande peut évidemment à première vue sembler incongrue. Elle l'est, au vu des relations entre Compagnies. Pourtant elle a une base juridique. La loi de 1810 sur les mines permet à un concessionnaire de demander à un concessionnaire voisin de lui livrer du minerai si ses propres possibilités d’exploitation sont compromises, pour permettre une continuation d’exploitation d’usines. C’était le cas d’espèce avancé pour motiver la demande, qui sera acceptée le 8 mars 1851 par le préfet...six mois plus tard. Nous l'avons connu beaucoup plus réactif ! Il écrira que Decazeville …doit livrer provisoirement à la compagnie Riant…1000 tonnes de minerai par mois. Le préfet s’appuie ainsi sur l’article 49 de la loi du 21 avril 1810. Aubin soulignait dans sa demande un besoin urgent de minerai et les possibilités de livraison par son concurrent et voisin.
On se doute bien de la rapidité très lente de Decazeville à réagir ! Le 27 mars 1851, Riant demande au préfet une intervention pour appliquer cette décision. Ce courrier nous apprend d’ailleurs que l’exploitation de Cadayrac est noyée.
Deux jours auparavant, le 25 mars 1851 François Cabrol réagit et s’adresse au ministre des travaux publics compétent en la matière. Son mémoire de quatre pages explique qu’Aubin n’a pas besoin de minerai. Il fait part de l’existence d’un acte extra-judicaire où l’on trouve que la compagnie d’Aubin offre de délivrer en nature à la compagnie de Decazeville dans le délai moral qui sera arbitré par le tribunal la quantité de douze mille sept cents cinquante neuf tonnes de minerai... C’est, écrit Cabrol, 12 fois ce qu’elle nous demande !
Le 14 juillet 1851 le ministre donne suite en écrivant au préfet qu’Aubin a offert de fournir à Decazeville 12759 tonnes de minerai et n’a donc pas besoin de celui de Mondalazac. L’autorisation donnée cessera le 14 novembre 1851, Aubin ayant alors d’autres sources d’approvisionnement sur le causse. Fin de l’épisode !
Concession de Lavergne, et autres d'Aubin. Les affiches de concession
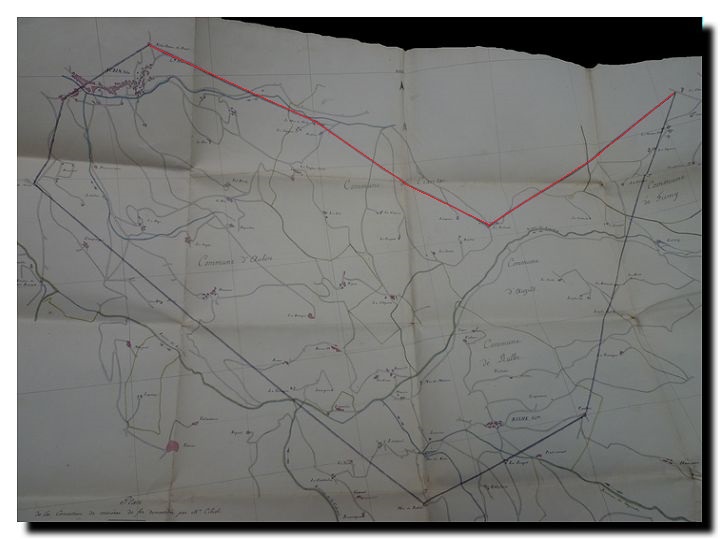
détail : concessions à Aubin et Decazeville. Le trait marque les limites de la concession de fer (à Aubin) de Lavergne, ordonnance du 5 février 1831, attribuée à Cibiel. D'une surface importante de 15 km2, 13 ha, 26 ares, elle ne doit pas être confondue avec la concession de houille du même Cibiel, dans les mêmes lieux, qui passe quelques mois plus tard dans les mains de Joseph Decazes. Les limites supérieures, en rouge, formant un V, touchent aux concessions du frère, le duc...
5 février 1831
Nous avons déjà développé comment Joseph Decazes, vicomte et frère du duc, était entré en possession de la concession des mines de houille de Lavergne, achetée à M. Louis Cibiel, qui semble bien avoir joué un rôle de prête-nom dans cette affaire. Cette concession attribuée le 28 février 1831 ne fut pas l’objet d’une exploitation très intense…Et, garant de l’intérêt public, la Direction Générale des Mines va alerter le Préfet de l’Aveyron sur cette non-exploitation, avec le risque pour le concessionnaire de tout perdre. Officiellement, Joseph Decazes n’apparaît pas, l’achat étant de nature privé. Seul M. Cibiel est montré du doigt.
La concession de fer, dite
de Lavergne et Marion, est attribuée le 5 février 1831. Cette
concession ne doit pas être confondue avec la précédente, du 28
février, de houille. Le plan de la concession de fer signé par Cibiel,
montre une étendue, considérable, de 15
km2,
M. Cibiel était également impliqué par d’autres concessions, fer et houille, certaines dans le même périmètre géographique, ce qui ne simplifie pas l’analyse… En décembre 1832, le 28, il précise au sous-préfet de Villefranche que la concession de fer de Lavergne doit aller avec celle de houille de Firmi et Lassale. On peut au passage se demander pourquoi elle ne va donc pas avec celle de houille de Lavergne ???
Le 1er août 1833, la Direction demande donc au Préfet où en est M. Cibiel sur la concession de Lavergne. Le 24 août le Préfet répond que M. Cibiel fait ouvrir dans la concession houillère de Lavergne des travaux encore forts insignifiants. Un an plus tard, le 15 juin 1834, il est précisé au Préfet que M. Cibiel, concessionnaire des mines de fer carbonaté de Lavergne n’a fait que des travaux insignifiants. Un rapport est demandé. Houille et fer ne semblent pas avoir été essentiels pour M. Cibiel...
Ces informations semblent bien être en accord avec le propos du comte de Seraincourt, qui dira en 1848 exactement la même chose sur ce non investissement, en s’opposant à Joseph Decazes.
Aubin…à Lunel
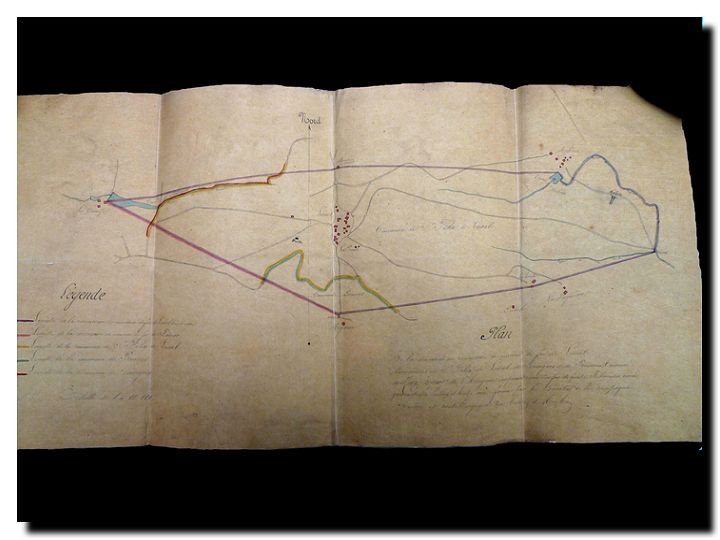 Les intérêts et la présence d’Aubin sont bien connus à Cadayrac.
Beaucoup moins un peu plus loin, à Lunel. Le 20 avril 1855, la
compagnie d’Aubin avait demandé une concession de minerai de fer à
Lunel, sur une étendue de 4 km2
Les intérêts et la présence d’Aubin sont bien connus à Cadayrac.
Beaucoup moins un peu plus loin, à Lunel. Le 20 avril 1855, la
compagnie d’Aubin avait demandé une concession de minerai de fer à
Lunel, sur une étendue de 4 km2
Les affiches…publicité légale
Leur format est imposant, de l’ordre de
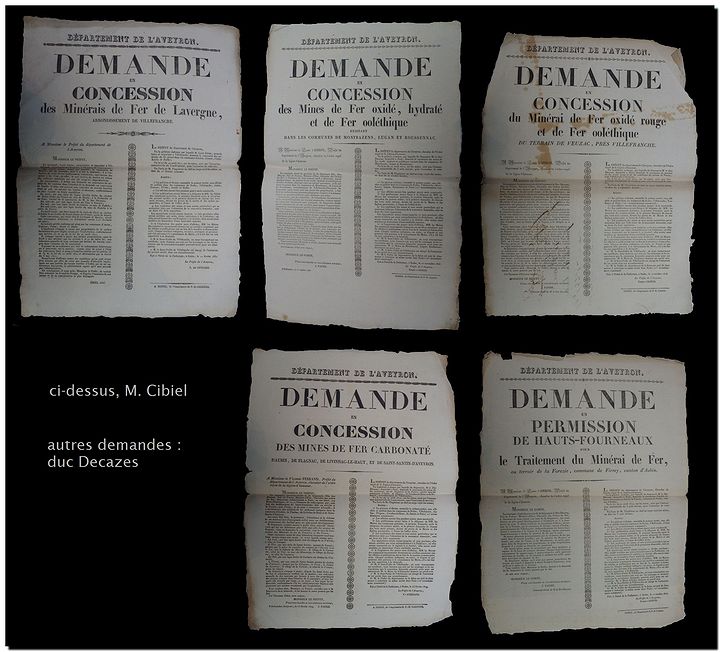
Le fer est quelquefois oxidé ou ooléthique...Nous conservons pour ce chapitre, comme pour d'autres, les orthographes d'origine.
Permission de hauts-fourneaux, 10 octobre 1826.
Il s’agit de la demande faite par le fondé de pouvoir du duc Decazes, M. Faure, d’établir à la Forézie, commune de Firmi, quatre nouveaux hauts fourneaux en complément des deux à construire à la Buègne et à la Vaysse, destinés à fondre le minerai de fer par le coak. La demande est adressée au Comte d’Arros, Préfet.
Concession des mines de fer oxidé rouge et de fer ooléthique, Veuzac, 10 octobre 1826
Présentée à la même date par M. Faure, son étendue est de deux kilomètres et demi environ. Le duc précise qu’il a découvert du minerai de fer ooléthique en couche qui alterne avec le calcaire secondaire….le minerai est destiné aux usines du Bastié, la Vaysse, la Buègne et Firmy.
Concession des mines de fer oxidé, hydraté et de fer ooléthique, Montbazens, Lugan, Roussenac, 10 novembre 1826
Sur une étendue de
Concession en minerai de fer carbonaté, Aubin, Flagnac, Livinhac, Saint-Santin, 23 février 1829
Adressée au vicomte Ferrand, Préfet, le
procureur-fondé Faure demande la concession dite de Trépalou et du
Fraux. Il mentionne les dernières découvertes de minerai,
infiniment plus utile que le minerai du Kaymar. L’étendue est d’un
peu plus de
Concession de minerai de fer de Lavergne, 10 février 1831
Propriétaire et négociant à Villefranche de
Rouergue, Cibiel aîné fait sa demande en soulignant
son caractère complémentaire à sa demande de houille, en partie sur le
même périmètre. Ici elle concerne 15 km2,
Il est enfin parfaitement impossible de deviner que derrière M. Cibiel, Joseph Decazes veillait…et se rendrait acquéreur quelques mois plus tard de la concession de houille de M. Cibiel.
Ces affiches sont évidemment des passages administratifs obligatoires. Il pouvait cependant exister quelques différents qui allongent la procédure. En février1830, le duc Decazes écrira au Préfet pour le prier d’accélérer une mesure de vérification, qui retarde la mise en place d’une concession. Il lui précise avec une belle écriture qu’il serait préférable de faire part à M. Cabrol des remarques au lieu de les lui adresser à Paris. Et, ajoute-t-il, si un ingénieur des mines est absent, celui des ponts et chaussées est tout à fait apte à se rendre sur place pour les vérifications. Est-ce l’ancien Ministre qui écrit aussi fermement au Préfet, se permettant au passage de proposer la marche à suivre ? C’est le seul manuscrit du duc Elie Decazes présent dans cet ensemble d'archives.
La multiplication des demandes de concession, et leur obtention par des estrangers au pays ont pu quelquefois être considérées comme contraires aux intérêts locaux. La crainte était bien réelle de voir des habitudes remises en cause. La demande de concession faite le 13 février 1829 par le maire d’Aubin, François Louis Brassat Saint-Parthem témoigne de cette crainte. Associé à cinq autres personnes, il demande une concession de mines de houille, soulignant qu’ils sont propriétaires de houillères, exploitées avant la loi de 1810. La loi de 1791 reconnaissait leurs droits, précise-t-il. Rappelons nous que le maire d’Aubin est à cette époque, en 1829, maire …de Decazeville, ville et commune qui n’existent pas…C’est bien le duc Decazes, non cité, qui justifie la motivation suivante.
En faisant cette demande d’une concession de
houillères qui ne sont ni riches ni propres au traitement des minerais,
l’exposant ne nuit aux intérêts de personne, et il obéit aux vœux de
ses concitoyens qui, tous d’accord avec lui, désirent voir des
exploitations spécialement affectées à l’approvisionnement du chauffage
dont ils ont craint d’être privés, et dont le prix ne doit pas suivre
des spéculations qui le mettraient hors de proportion avec les moyens
du pays.
Une longue phrase, mais parfaitement écrite et qui contient l’essentiel. Il est difficile de mieux résumer les craintes et de dénoncer l’industrialisation naissante, ce que certains nomment économie de prédation, expression bien représentative. L’exposant offre également une indemnité égale à 20 centimes par hectare.
Cette contestation des gens d’Aubin n’est pas sans ressemblance avec
celle de leurs ancêtres vers
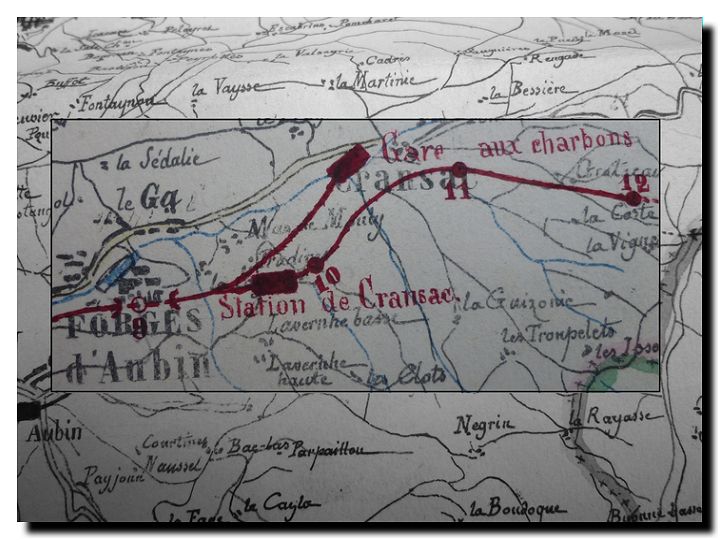
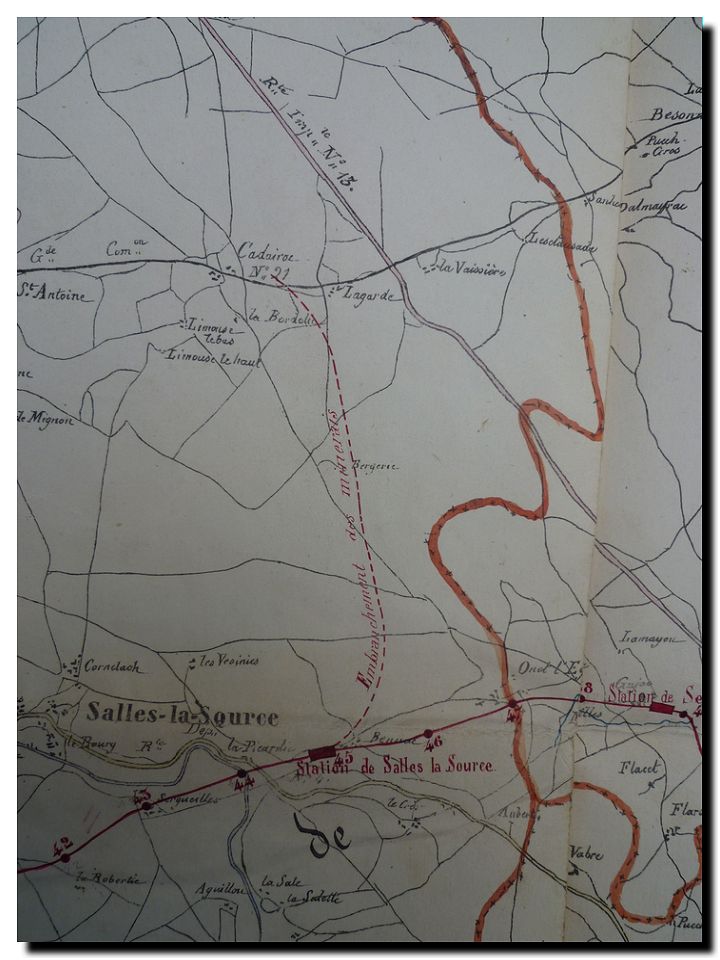
 Le futur du passé,
l’avenir minier du causse ?
Le futur du passé,
l’avenir minier du causse ?
Notre site se consacre à l’évocation du passé minier du causse Comtal. De nombreux chemins de traverse ont été empruntés. Il est temps maintenant de faire de ce passé minier un élément de prospective : existe-t-il encore du minerai ? Cette question qui nous est souvent posée mérite une réponse documentée. Sur ce nouveau chemin, il y aura des chiffres, des précisions, et quelques (gros) mots techniques, un minimum…C’est donc une promenade sur et sous le causse Comtal qui va nous donner les réponses.
A la fin des années cinquante, vers 1958, la question de l’avenir minier du causse est très sérieusement étudiée. Il y a au moins trois rapports du BRGGM (Bureau de Recherches Géologiques Géophysiques et Minières) qui envisagent ce problème, publiés en 1955,1957 et 1958. Cet organisme devait par la suite devenir le BRGM actuel.
Les industriels du bassin (UCMD) exploitent à cette époque un haut fourneau. Un haut fourneau nouveau, le futur n°5, est prévu et sera opérationnel en 1959. Il traitera des cendres de pyrite mélangées à du minerai de Batère. Une fois grillées et agglomérées, les cendres de pyrite donnaient des briquettes à 60% de fer environ. Pour ces besoins, et devant des risques d’épuisement de ressources, les UCMD demandent donc au BRGGM d’étudier les ressources en minerai proche, une centaine de km autour de Decazeville. Le cahier des charges demande une teneur en fer de 50 %, et limite les teneurs en impuretés, comme le soufre, phosphore ou manganèse. La première étude, en 1955, est une étude historique, basée sur un dépouillement sommaire de données écrites. Celles de 1957 et 1958 complètent les informations par des visites de terrain et une analyse plus fine.
Dans cet espace de cent kilomètres, 23 gisements fer sont identifiés, en filons, couches oolithiques et dépôts superficiels tertiaires. Seront ainsi passés à la loupe, et au microscope, des minerais du causse, les plus à l’est, ceux de la région de Fumel, les plus à l’ouest, et ceux d’Alban et du Fraysse, près d’Albi, au sud de la zone. Ils ne sont pas tous de même nature. Après analyse, les rapporteurs vont écarter les minerais du Kaymar et certains du Quercy. Ceux de Fumel pourraient convenir. Pour ceux du causse Comtal, les opinions divergent : des sondages et essais complémentaires seraient à réaliser.
« Tel quel il ne convient pas, et comme on ne
peut économiquement envisager un traitement l’amenant aux teneurs
admissibles, il faut également abandonner comme gisement possible cette
grande masse de minerai qui se trouve à proximité de
Decazeville ». (R. Houdaille, J. Lougnon, 1955).
Cette opinion tranchée sera contredite par le dernier rapporteur qui, à la suite d’essais d’enrichissement, n’élimine pas à priori les ressources locales. Ces études, qui n’aboutiront pas à une remise en exploitation, permettent en revanche de préciser le contexte minier du causse Comtal (A. Lefavrais, O. Horon, 1957, et O. Horon, 1958).
Pour bien comprendre ce contexte minier, il n’est pas inutile de faire un petit effort de compréhension de l’organisation du causse. Essayons donc de faire simple ! Il y a donc 170 millions d’années, à quelques jours près, naissait l’Aalénien…
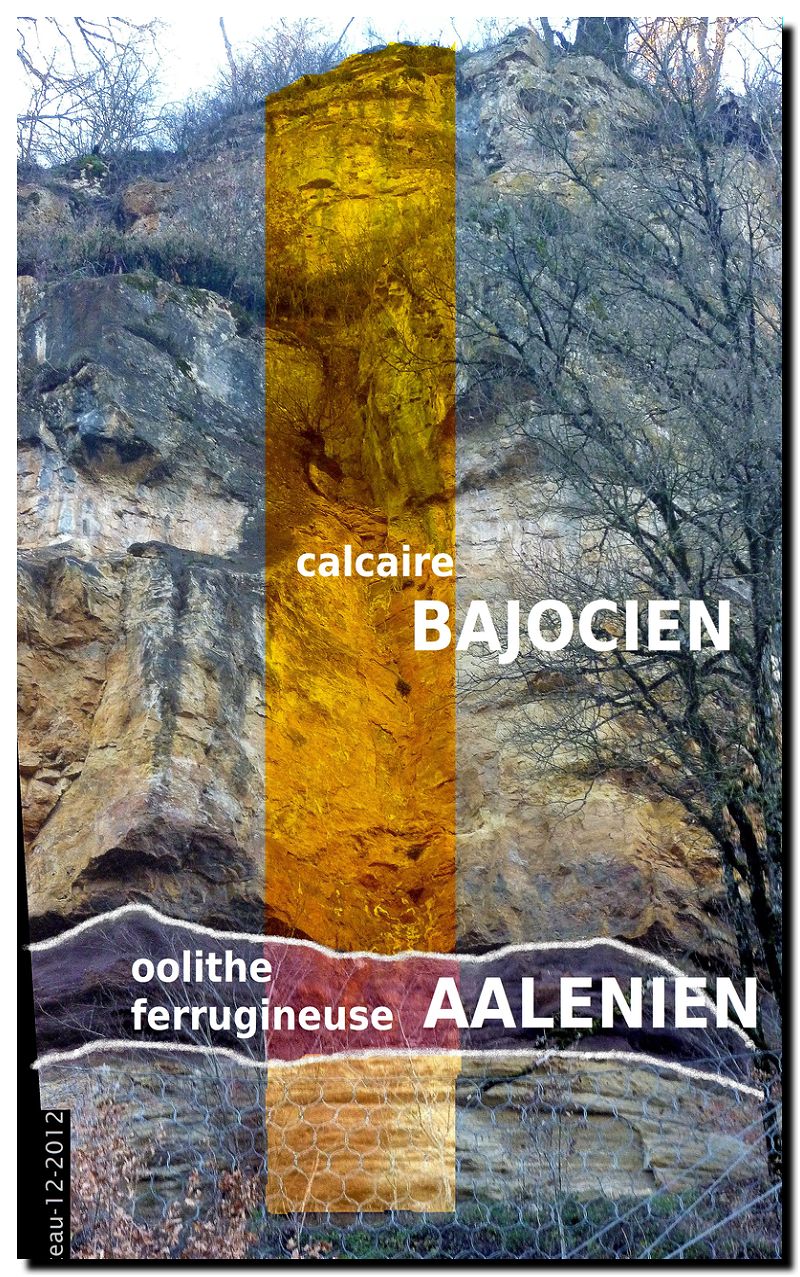
Le contexte géologique particulier du causse est connu dans ses grandes lignes. Sur une étendue de l’ordre de 120 km2, la série sédimentaire fait apparaître les formations suivantes, dépôts stéphaniens, Permien,Trias et Lias. Le Bajocien, calcaire supérieur, recouvre la plus grande partie du causse. Les couches présentent un pendage (inclinaison) vers le sud de 5 à 15°. C’est dans le lias supérieur (Toarcien, Aalénien) que le minerai de fer oolithique sera recherché.
Cet ensemble solide est fracturé et nous n’insisterons pas ici sur l’origine de ces failles. Leur orientation est généralement est ouest, et les compartiments sud ainsi créés sont relevés, avec des rejets parfois très importants, amenant donc à la surface les couches profondes.
La faille d’Onet, à la limite sud du causse, s’étend sur près de
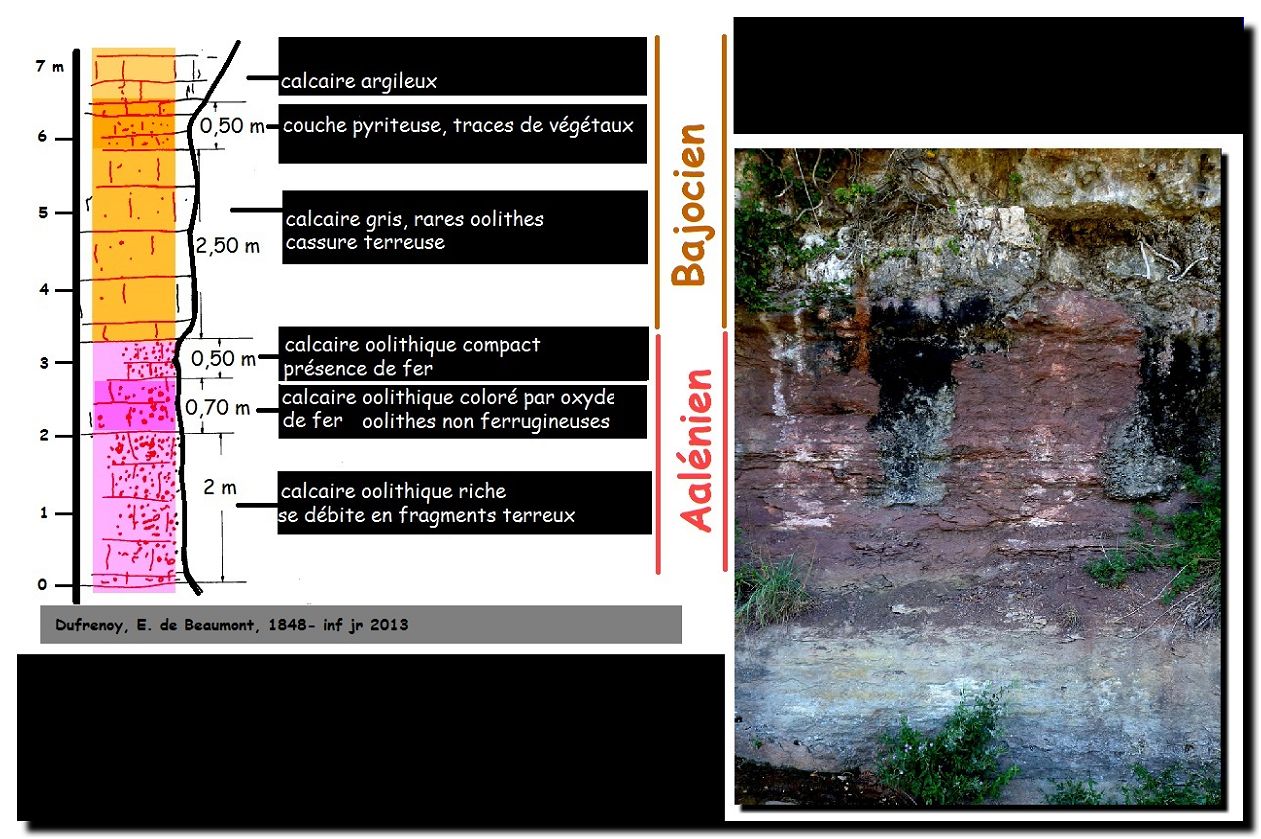
La couche minéralisée offrant le fer est immédiatement sous le Bajocien calcaire supérieur, la couche visible du causse. Les géologues évoquent sa position exacte au dessus des marnes du Toarcien, dans l’Aalénien. Le pendage des couches est nord sud. C’est donc au Nord du causse que nous allons trouver cet Aalénien en affleurement, et en bordure de la faille centrale. Le parcours vers Muret le Château est une leçon de géologie à ciel ouvert : ne pas voir la couche rouge surmontant des marnes claires, et sous le calcaire clair n’est pas possible ! Cette couche particulière est très visible le long de la route, qui la recoupe sur quelques dizaines de mètres dans la falaise, à mi-pente.
Aujourd'hui ?
Août
2023. Génie civil et patrimoine peuvent souvent se contredire, le
premier accusé de destruction abusive et le second de conservatisme
exagéré...Mais pour une fois, ici, à Muret, le premier permet au second
d'être à la une. Une belle leçon de géologie à ciel ouvert, c'est
exceptionnel pour notre sujet de patrimoine minier. La route qui mène
du causse à Muret, RD904, nous fait passer de 520 m d'altitude à 420 m
: à
droite en descendant, la reculée de Muret, une entaille profonde du
causse, et à
gauche donc la falaise. Les travaux routiers de 2022 et 2023 ont permis
de donner à ce passage étroit un peu plus de largeur. Pour cela pics et
pioches sont à la manoeuvre. Le résultat est une belle falaise "toute
neuve" dans laquelle vous lirez sans peine l'histoire géologique,
Bajocien, Aalénien. Voici huit vues de ce passage : la couche de
minerai ne peut évidemment s'ignorer. Les cassures du causse sont
également bien présentes.
 |
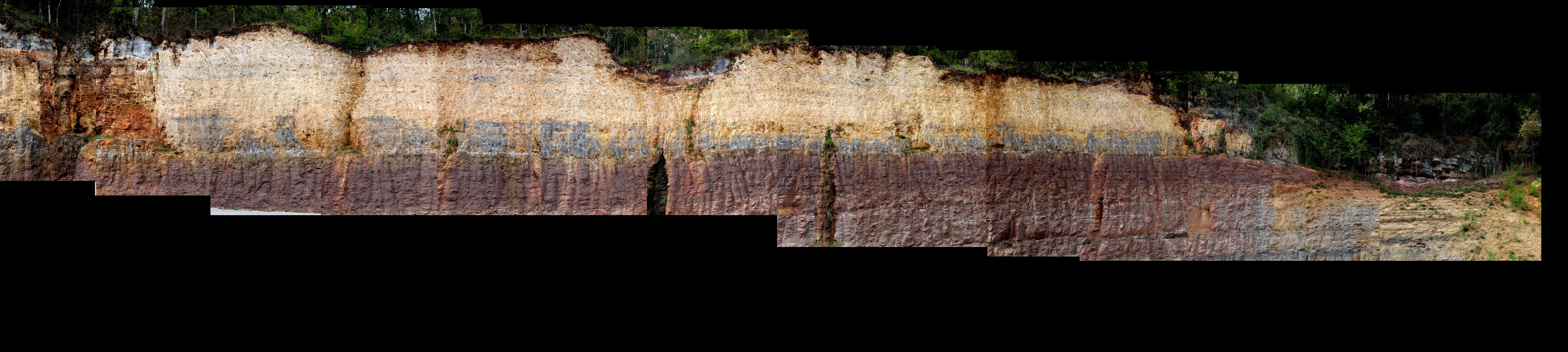 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Typiquement la situation est (presque) simple. En 1846, à l’occasion d’une coupe faite près de Mondalazac, on trouve donc sous le Bajocien calcaire, dans l’Aalénien la succession suivante : calcaire oolithique compact avec fer au contact du Bajocien, puis en dessous même couche mais stérile, puis au dessous même couche de l’Aalénien, mais plus riche en fer (de Beaumont, Dufrenoy, 1848). Cette dernière couche est moins compacte que la couche supérieure, et se débite en fragments terreux. Cette remarque est importante et peut expliquer la relative aisance de nos mineurs à exploiter la couche, à l’aide du seul pic au tout début. On va donc généralement trouver dans le causse non pas une couche avec du fer, mais un sandwich, le fer étant présent dans les deux tranches de pain, et l’aliment médian étant ici sans importance. C’est ce schéma bi-couches qui est généralement reconnu et retenu. Bien sûr les épaisseurs des différentes tartines sont variables, de quelques dizaines de cm à quelques mètres. Pour compliquer le travail du mineur, la richesse du minerai, teneur en fer, est également variable, de 20% à 40 % pour résumer.
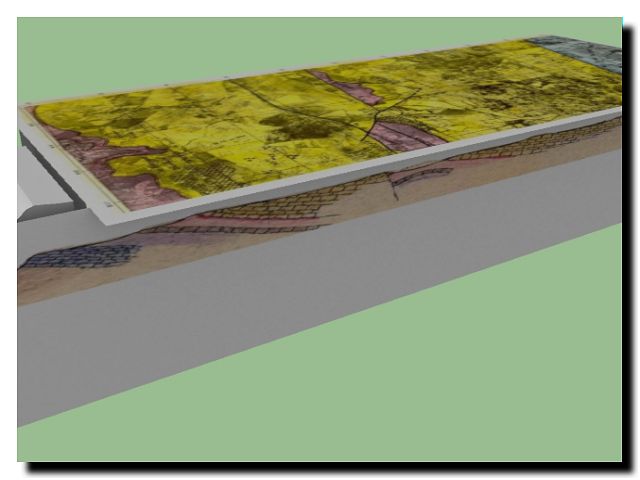 La répartition spatiale de cette richesse minière montre qu’elle
est présente en partie centrale du causse, du nord au sud, et
latéralement entre les méridiens 616 et 618 de la carte :
l’épaisseur et la richesse deviennent sans
intérêt économique plus à l’est, et au sud, vers Salles la Source. Les
affleurements montrent ici des puissances centimétriques…
La répartition spatiale de cette richesse minière montre qu’elle
est présente en partie centrale du causse, du nord au sud, et
latéralement entre les méridiens 616 et 618 de la carte :
l’épaisseur et la richesse deviennent sans
intérêt économique plus à l’est, et au sud, vers Salles la Source. Les
affleurements montrent ici des puissances centimétriques…
Le schéma structural du causse nous montre une inclinaison vers le sud, et la présence des failles et rejets. Le bienfait de ces rejets est évident : la couche minéralisée, le sandwich revient à la surface. Géographiquement le secteur des deux concessions est donc bien le secteur le plus intéressant. Les géologues miniers du début du dix-neuvième siècle avaient parfaitement identifié la ressource.
Dans la zone de Solsac, il faut descendre entre 30 et
 En période intensive d’exploitation, vers 1916, une analyse
fournit pour les Espeyroux les éléments suivants : Fe 25%, SiO2
10%, Mn absent, P 0,5%, Al2O3 6,3%, MgO 7,8% et H2O 5%. Le fer n’est
donc pas seul, et l’intrus principal est le phosphore, qui va donner du
mal aux usines pour obtenir une fonte de qualité, tout au moins dans
une grosse moitié du 19 ème siècle. La relative mauvaise réputation des
fers de Decazeville est due à ce phosphore…
En période intensive d’exploitation, vers 1916, une analyse
fournit pour les Espeyroux les éléments suivants : Fe 25%, SiO2
10%, Mn absent, P 0,5%, Al2O3 6,3%, MgO 7,8% et H2O 5%. Le fer n’est
donc pas seul, et l’intrus principal est le phosphore, qui va donner du
mal aux usines pour obtenir une fonte de qualité, tout au moins dans
une grosse moitié du 19 ème siècle. La relative mauvaise réputation des
fers de Decazeville est due à ce phosphore…
En 1958, un essai d’enrichissement par séparation magnétique après broyage est proposé. Les expériences allemandes montrent une certaine efficacité du procédé. Au dix neuvième siècle, cet enrichissement était fait par grillage : aux Espeyroux, des fours sont présents en 1887, puis transférés en 1901 à la Forézie près de Firmi. Le grillage avait pour but d’enlever l’eau, le CO2 et les autres impuretés volatiles.
Les rapports consultés du BRGGM avaient pour but de faire un point zéro, de préciser l’état des ressources, et de chiffrer les réserves. Pour la partie historique les auteurs ont travaillé sur les archives disponibles à cette époque (vers 1955) des houillères des HBA à Decazeville, celles de la société métallurgique d’Imphy et celles du service régional des mines à Toulouse. Ce riche travail nous permet de retenir quelques chiffres significatifs, avec une certaine certitude de fiabilité…
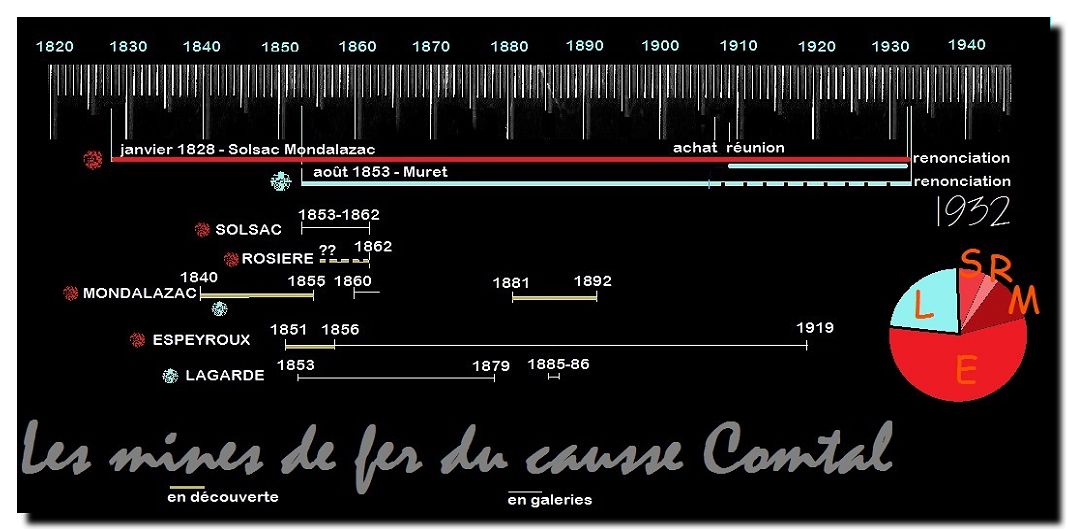
Solsac
En activité en 1853-1854, toujours en souterrain, cette mine sera la plus importante du causse en 1860. Elle sera arrêtée en 1862, à l’exception de la partie est, encore active un an plus tard. Le minerai était pauvre en fer, 23,5 %. Le tonnage total extrait est de 220.000 tonnes, et 75 mineurs étaient ici au travail. Le pendage des couches est fort, 30°.
La Rosière
Quelquefois citée Rougière, sûrement en rapport avec le fer, cet
affleurement est à l’est de la mine de Solsac. Exploité jusqu’en 1862 à
ciel ouvert, et très peu en galeries, ce petit site montrait des
couches de 2 à
Mondalazac
Il s’agit ici du village même. En 1840, deux exploitations en découverte concurrentes sont présentes, à l’ouest et à l’est du village. On connaît le conflit qui opposera un peu plus tard Cabrol à ses confrères d’Aubin sur ces minières. Jusqu’en 1855, l’exploitation se fera ainsi à l’est du village. Le minerai titrait 25,5 %. En 1860 des travaux souterrains sont amorcés, au sud est du village, et très vite interrompus, suite à la concentration des efforts aux Espeyroux. En 1881 une remise en exploitation en découverte est faite à l’ouest du village : le minerai est excellent, 40 % de teneur !
Arrêtée totalement en 1892, Mondalazac a fourni 350.000 tonnes
de minerai. Le panneau exploité est d’environ
Les Espeyroux
ou Ferals, pour se repérer plus exactement. L’exploitation est à
ciel ouvert sur les affleurements nord en 1851. Les travaux souterrains
démarrent en 1856 et vont rapidement prendre de l’ampleur. De très
longs plans inclinés sont ouverts, et l’exploitation se développe vers
l’est, vers les Espeyroux. A l’ouest en effet l’épaisseur de la couche
devient peu rentable,
La présence de faille est évidemment une difficulté, même si
celles-ci peuvent jouer un rôle de drain naturel. La galerie d’exhaure
de
Lagarde
On dirait aujourd’hui plutôt Cadayrac, en prenant le nom du
village voisin. Démarrée en 1853, l’exploitation sera très perturbée.
La présence de failles, le pendage très important et les difficultés
d’épuisement des eaux sont quelques unes des difficultés rencontrées.
Propriété d’Aubin en 1853, et donc concurrente de toutes les autres
exploitations ici citées appartenant à Decazeville, l’activité s’arrête
en 1879, puis reprend en 1885 pour se terminer en
Salles la Source : une demande de concession est faite en 1911, mais sera sans suite.
La production totale sur un siècle environ d’activités, est donc de 3.235.000 tonnes de minerai, exploitations en découvertes et galeries confondues.
Quel est donc l’avenir minier du causse en 1958 ?
Les ressources existent et sont assez exactement attestées. Les
sondages existants à cette époque sont quasiment tous concentrés entre
Solsac et les Espeyroux, au nord de la faille principale médiane. Il
est donc proposé de compléter au nord et au sud ces sondages par des
sondages carottés permettant une analyse fine. Une réflexion sur
l’enrichissement, par voie chimique, broyage et attaque à l’acide, ou
magnétique est envisagée. La zone minéralisée exploitable
économiquement est limitée par les affleurements au nord du causse, par
la bordure sud de celui-ci et s’étend latéralement entre les méridiens
615 à l’ouest et 618 à l’est, mais les variations latérales sont
brutales et mal connues. Sur cet espace de
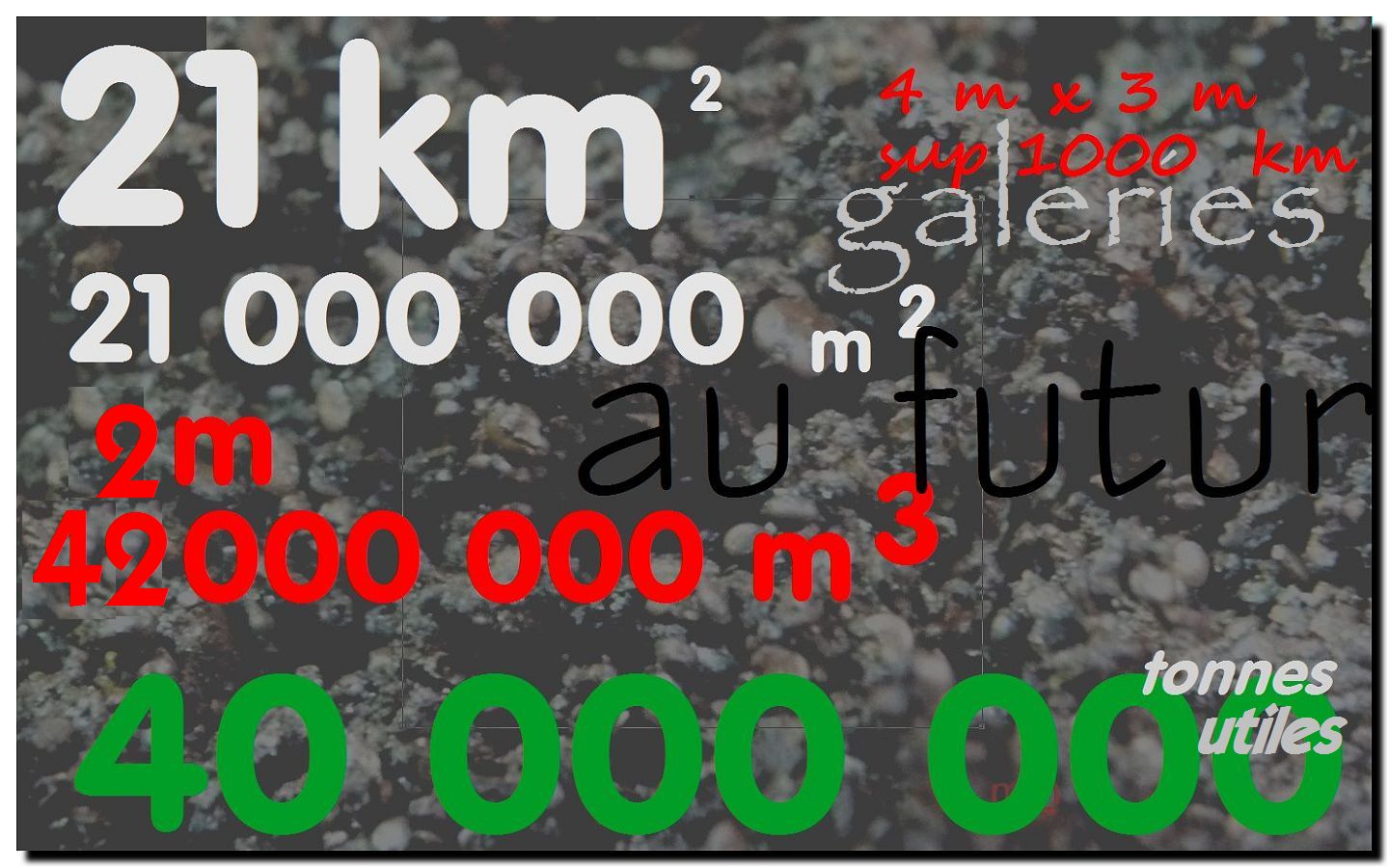
Le causse minier virtuel en chiffres, ordres de grandeur
 Les oolithes,
qu’es aquo ? Ce sont les noisettes du
chocolat !
Les oolithes,
qu’es aquo ? Ce sont les noisettes du
chocolat !
Il est temps de préciser la forme et les origines de ce fameux minerai de fer du causse, le minerai oolithique. Qu’est ce donc qu’une oolithe ? (ou un oolithe, la doctrine semble floue...)
Dans le mot, il y a œuf, au début, et pierre à la fin. C’est donc très simplement un œuf en pierre ? Presque, mais pas tout à fait !
AVIS !! Oolite ou oncoÏde ? Vraie ou fausse oolite ? Ne nous jetez pas de pierres ! Les lignes qui suivent n'ont pas vocation à vous transformer en géologue, qui plus est spécialiste des dépôts sédimentaires et il semble bien qu'au 19 ème siècle, période souvent abordée sur ce site, la distinction n'était pas de mise. Depuis la science a fait des progrès et il existe donc une réelle différence entre oolite et oncoïde, différence non faite ci-dessous. Le terme minerai en grains peut donc désigner avec bonheur et justesse ces noisettes ! Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en encroûtements sédimentaires, ce lien est fait pour vous par des spécialistes belges :
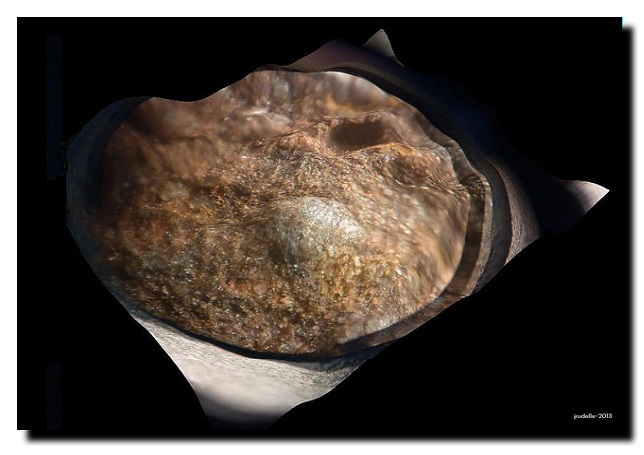
au microscope, et après traitement de l'image, une oolithe, et une absente dont on devine l'emplacement !
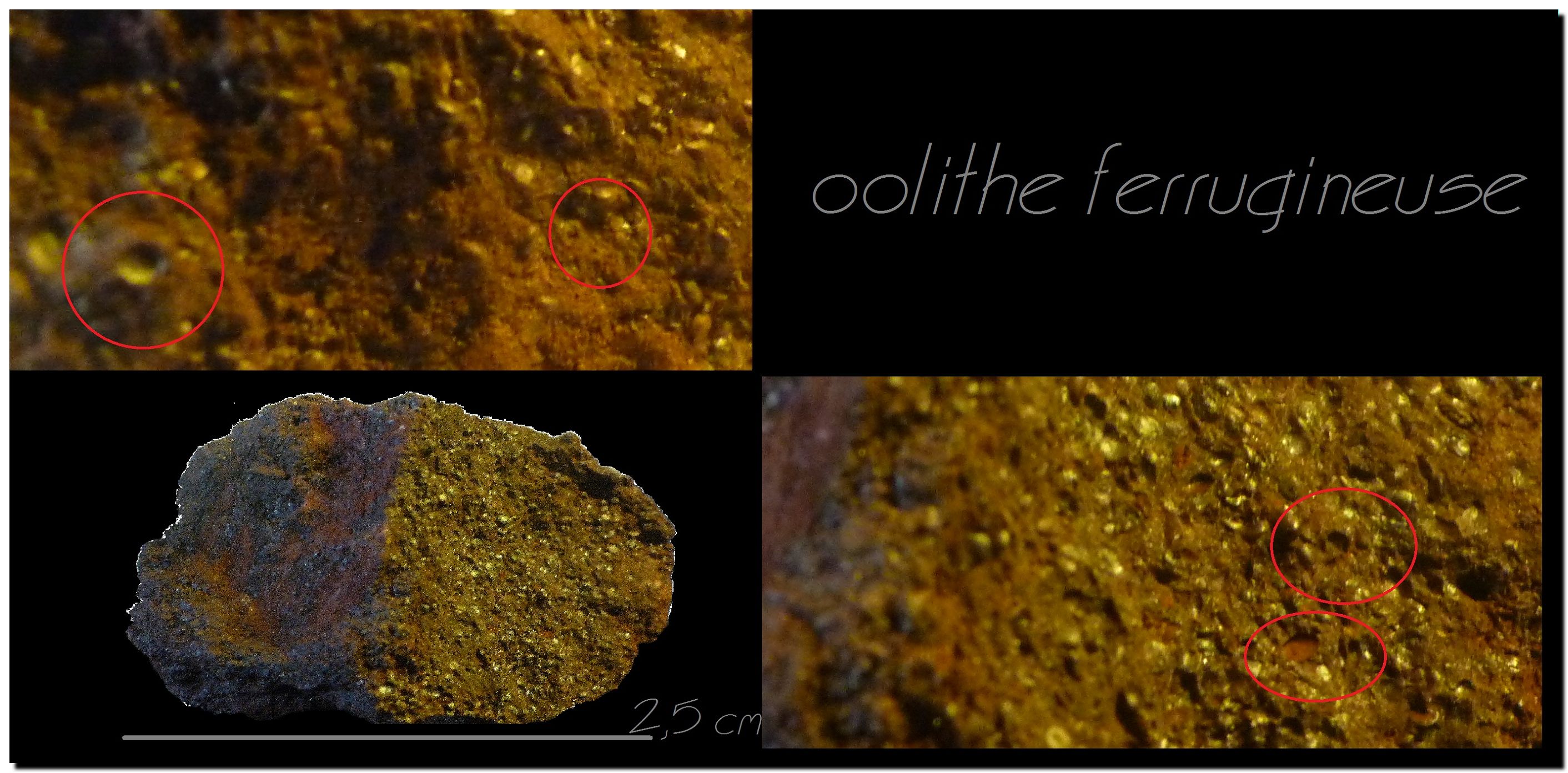

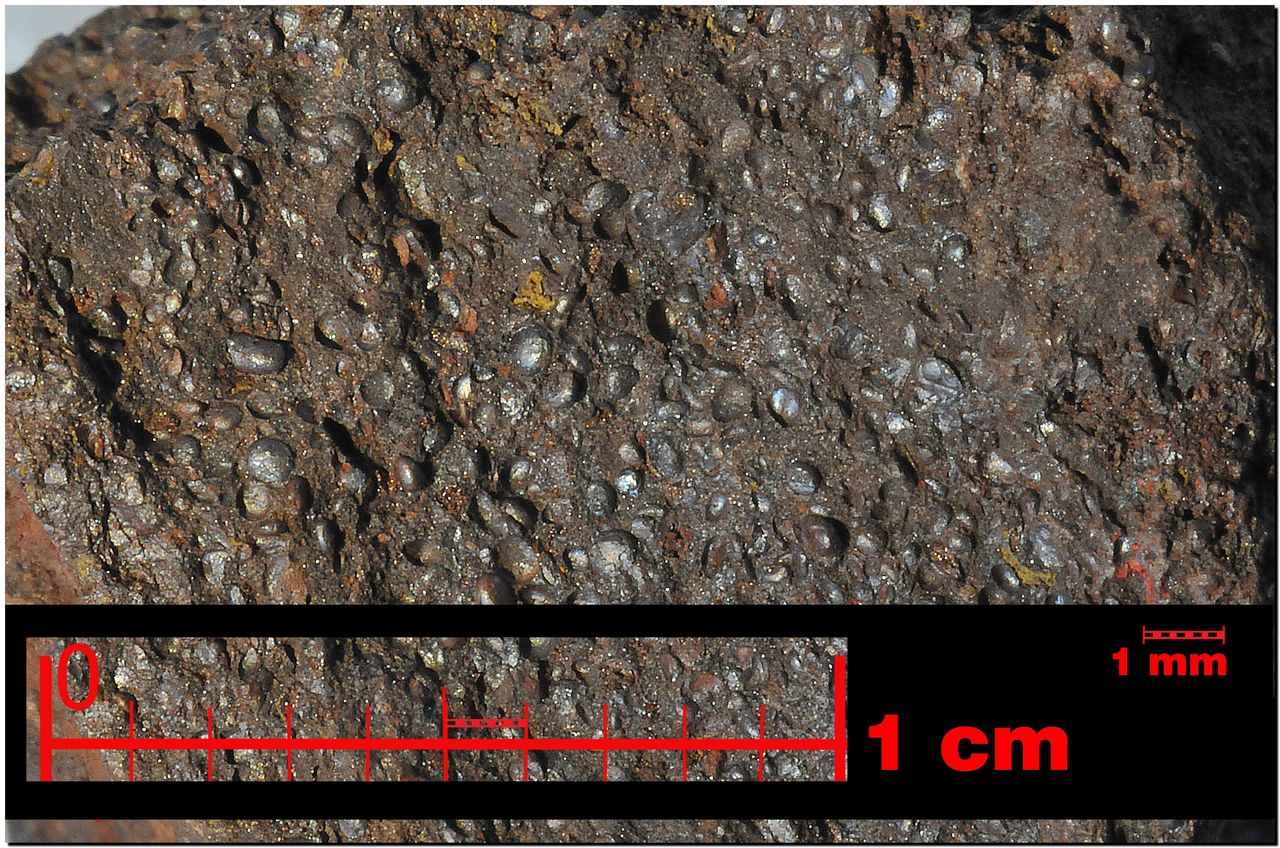 macrophotographie
C Rudelle
macrophotographie
C Rudelle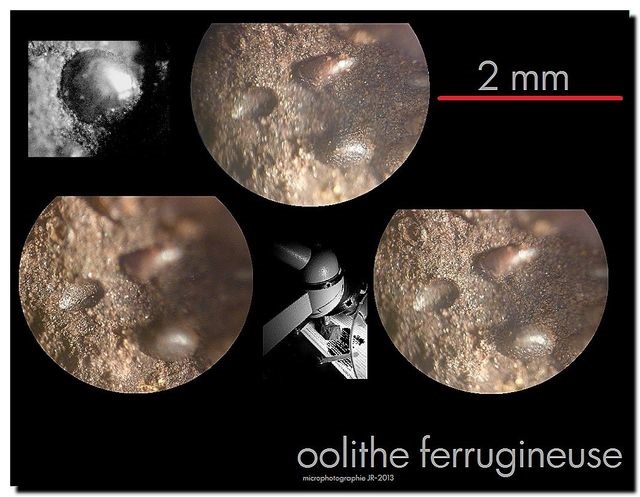
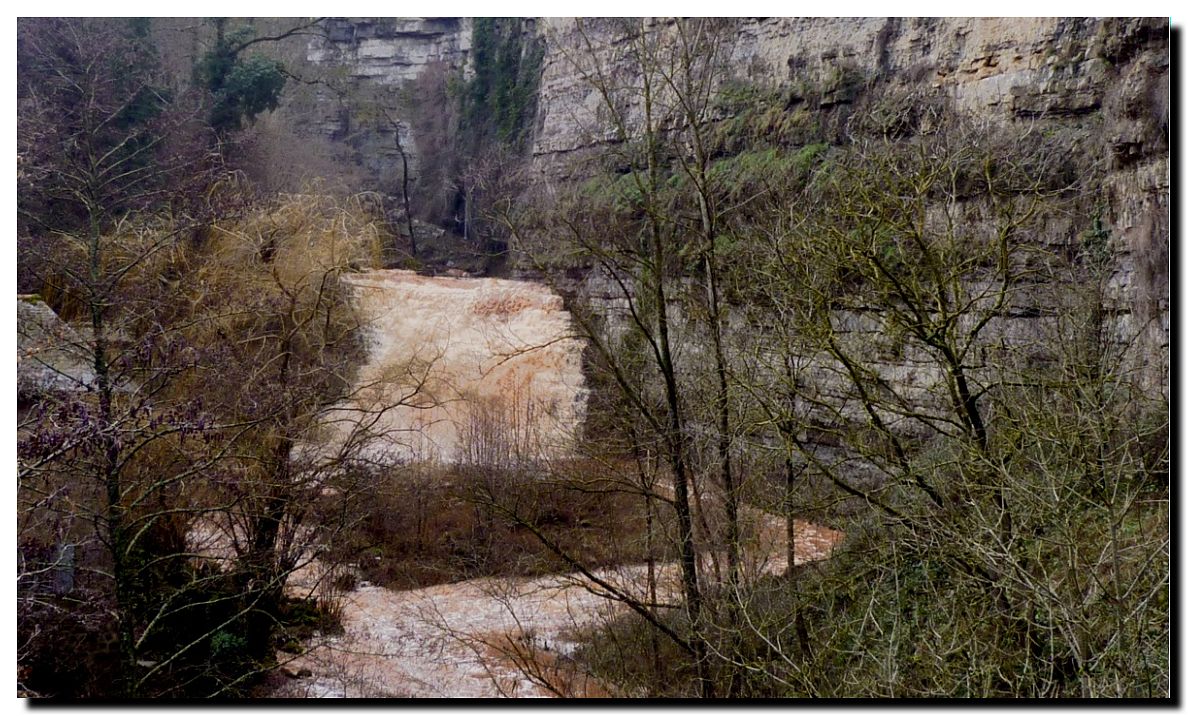
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 L'itinéraire
militaire de François Cabrol
L'itinéraire
militaire de François CabrolAvait-il la vocation ? Petit, jouait-il au soldat dans les ruelles du quartier Saint-Amans de Rodez, ou passait-il son temps à casser les cailloux de la place du Bourg pour en extraire du fer ? Les preuves nous manquent sur la passion de l’enfant, mais un retour sur ses premières années professionnelles peut-il nous éclairer ? Militaire par goût de l’uniforme, ou forgeron dans l’âme ? Voici quelques éléments de réponse même si cette première analyse n’est que partielle, les années d’activité avant 1819 étant peu documentées.
Une Route du Fer, ou une mine, c’est d’abord un ensemble de galeries, chacune menant à des richesses, réelles ou supposées. Ici, il s’agit de l’éternelle question, sans réelle réponse assurée, concernant la venue de François Cabrol aux forges. La même question se pose d’ailleurs pour Elie Decazes et sa venue en Rouergue, avec les éléments du chapitre 7 par exemple. Nous allons donc dérouler la carrière militaire du Maître des forges, espérant y trouver quelques indices.
La carrière militaire de François Cabrol, qui se terminera administrativement en 1838, débute en 1812. Admis en 1810, à 17 ans, à l’école polytechnique (167 admis et 363 candidats cette année là), et après son passage en première division en 1811 (rang 114 ème), il est ingénieur-élève de l’école d’application de l’artillerie à Metz en 1812, admis avec le (bon) rang de 24 ème. Ce passage à Metz lui a-t-il permis de rencontrer alors la métallurgie et les forges ? Cette question n’a sans doute pas de réponse simple, mais la métallurgie et les forges étaient au programme des artilleurs. Parmi quelques autres pistes de recherche, il y a le receveur général du département de l’Aveyron, Costes, beau-père de François, et de son frère Robert qui épousa le même jour une sœur, le 10 février 1823. Le beau-père exploite une mine d’alun en 1811, près d’Aubin. Ce n’est pas de la houille ni du fer, mais c’est une activité industrielle dans le bassin, activité sans grand succès, qui amènera d’ailleurs les intervenants en justice ; la faillite de Costes dans ses fonctions de receveur général, avec un litige important sur un déficit de plus de 100.000 francs du receveur de Millau, date de la même époque…
Revenons à la carrière militaire de François Cabrol, pour essayer de saisir le passage des armes aux forges.
Il est nommé lieutenant le 18 février 1812. Cette date est très particulière. Lors de l’entrée à l’Ecole Polytechnique, les élèves devaient formuler leur choix d’écoles d’application : Artillerie, Génie militaire, Ponts et Chaussées, Génie maritime et Mines : ce choix était irrévocable et engageait donc le futur ingénieur. En 1811, le choix Artillerie fut supprimé et devient, pour deux ans seulement, l’apanage des seules écoles militaires (Saint-Cyr). (Histoire de l’Ecole Polytechnique, Fourcy, 1828). Napoléon cependant, au vu des besoins de son Artillerie, passera outre à son décret, et par exemple, place soixante élèves, à priori volontaires, comme élèves lieutenants dans le corps par un décret du 18 février 1812. Que conclure ? Que ce choix était celui de F. Cabrol en 1810, à son entrée ? Probablement oui, ce qui ne ferait donc pas de lui un ingénieur particulièrement attiré par l’industrie à cette époque. Mais il n’a alors que dix-sept ans ! Le Répertoire de l’Ecole impériale polytechnique de C.P. Marielle, paru en 1855, présente bien François Cabrol comme capitaine, réformé en 1828, et dans la liste de ceux ayant choisi ce corps d’artillerie. Son frère Robert, dont on sait qu’il était à la même Ecole, entré en 1809, avait lui formulé le choix des Ponts et Chaussées (18 ème sur 32), et Joseph Decazes le même choix (2ème sur 22 en novembre 1805).
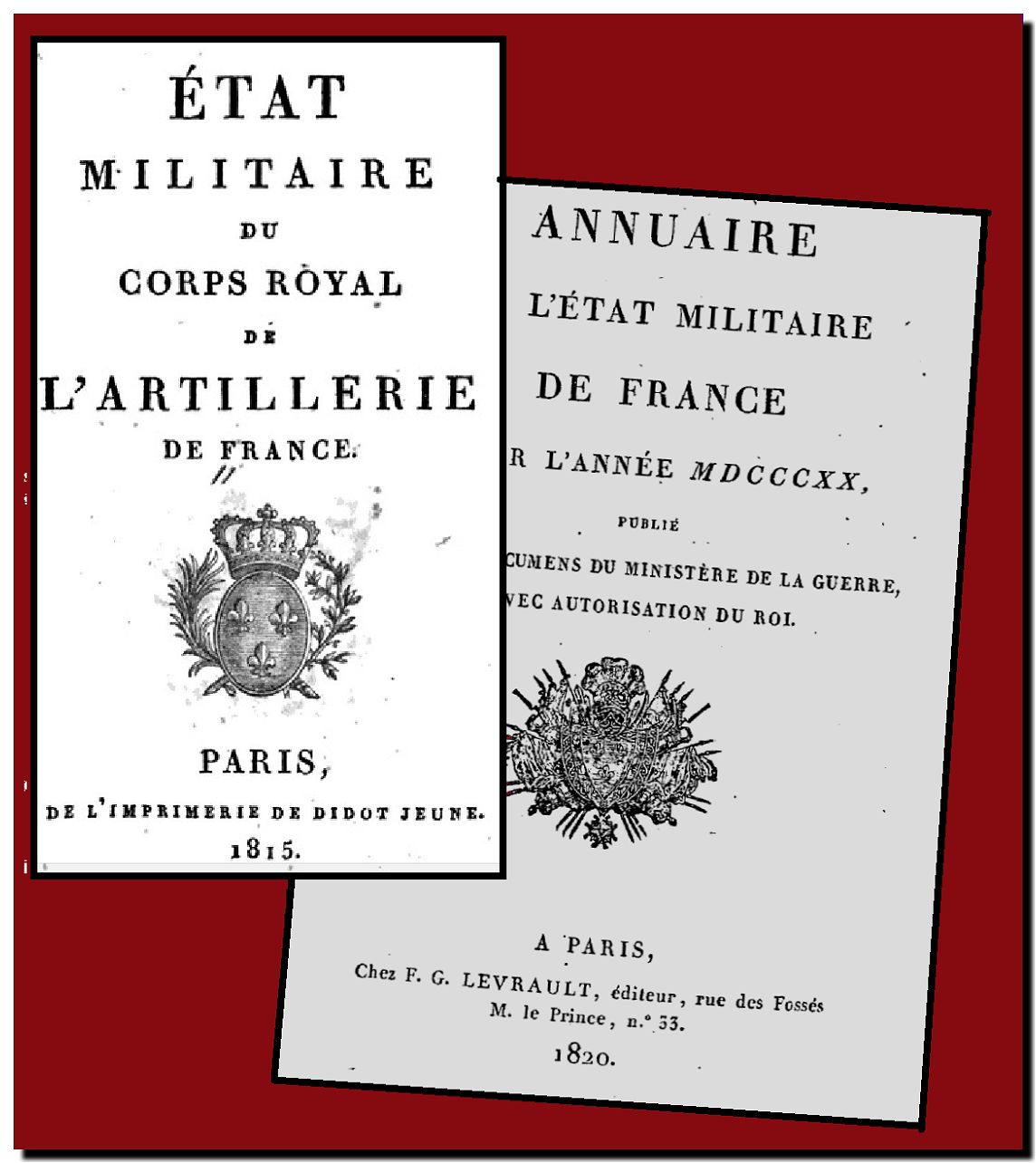 Promu
capitaine le 9 décembre 1813, et affecté au 1er régiment à
cheval, il est mentionné deux ans plus tard comme officier en non activité dans l’Etat militaire du corps
royal de l’artillerie, Paris, 1815. Les changements politiques de
l’époque expliquent évidemment cette mise en retraite. Il avait entre
temps été au 1 er corps de Davout (Russie). En 1814, il sera dans le
département français des Bouches de l’Elbe, à Wilhelmsburg, dans le
nord de l’Allemagne. Le suivre ensuite s’avère difficile, avec des
périodes militaires et de mise en congé…sans l’habit militaire bleu et
écarlate des artilleurs à cheval, d’après Moltzheim, dans Uniforme
du génie, de l’artillerie et du train des équipages,E. Fort,1938,
Gallica. Les Tableaux des
Officiers tués et blessés de Martinien, qui présentent les états
militaires de 1805 à 1815 mentionnent une blessure du lieutenant, le 17
août 1813 près de Lowenberg, et une autre le 9 février 1814, pour cette
fois le capitaine à Willembourg (Hambourg). Selon ces sources
militaires, François Cabrol n'a donc pas été blessé à Waterloo, comme
il est très souvent rapporté, sûrement par erreur...On ne prête qu'aux riches dit-on !
De 1815 à 1818, son itinéraire nous est parfaitement inconnu...
Promu
capitaine le 9 décembre 1813, et affecté au 1er régiment à
cheval, il est mentionné deux ans plus tard comme officier en non activité dans l’Etat militaire du corps
royal de l’artillerie, Paris, 1815. Les changements politiques de
l’époque expliquent évidemment cette mise en retraite. Il avait entre
temps été au 1 er corps de Davout (Russie). En 1814, il sera dans le
département français des Bouches de l’Elbe, à Wilhelmsburg, dans le
nord de l’Allemagne. Le suivre ensuite s’avère difficile, avec des
périodes militaires et de mise en congé…sans l’habit militaire bleu et
écarlate des artilleurs à cheval, d’après Moltzheim, dans Uniforme
du génie, de l’artillerie et du train des équipages,E. Fort,1938,
Gallica. Les Tableaux des
Officiers tués et blessés de Martinien, qui présentent les états
militaires de 1805 à 1815 mentionnent une blessure du lieutenant, le 17
août 1813 près de Lowenberg, et une autre le 9 février 1814, pour cette
fois le capitaine à Willembourg (Hambourg). Selon ces sources
militaires, François Cabrol n'a donc pas été blessé à Waterloo, comme
il est très souvent rapporté, sûrement par erreur...On ne prête qu'aux riches dit-on !
De 1815 à 1818, son itinéraire nous est parfaitement inconnu...
Nous le retrouvons, militaire à temps plein cette fois, et avec quelque certitude, de 1819 à 1828, sans interruption, dans les volumes annuels de l’Annuaire de l’état militaire de la France, publié par Levrault à Strasbourg. Les renseignements publiés, de source militaire, nous apprennent donc, que François Cabrol est :
-en 1819, capitaine en 2ème, au régiment de Rennes à Toulouse, artillerie à cheval
-en 1820, même position et affectation
-en 1821, idem, avec un rang de 105 sur 255 capitaines d’artillerie (le rang d’ancienneté conditionne l’avancement)
-en 1822, idem, avec un rang de 82 sur 240.
-en 1823, idem, avec le rang de 54 sur 246. Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur le 17 août (il sera officier le 28 avril 1841)
-en 1824, il apparaît dans la liste des capitaines en 1er avec le titre de capitaine en 2ème, au 2ème régiment à cheval, avec un rang de 279 sur 289.
-en 1825, il est capitaine au 2ème régiment de Rennes à Metz
-en 1826, promu capitaine en 1er au 3ème régiment à cheval de Strasbourg à Toulouse, 224 sur 308
-en 1827, capitaine en 1er, 3ème régiment à cheval, 207 sur 312. Cette année là, son prénom devient François-Gracchus.
-en 1828, idem, avec un rang de 193 sur 309, donc un espoir très mince de gravir un échelon…
Son nom disparaît des états à partir de 1829.
Cette chronologie militaire montre donc un capitaine, promu certes, mais dont la carrière est quelque peu en demi-teinte. Il y a quelques curiosités dans ces données. François Cabrol fut nommé directeur des forges le 1er mai 1827, mais il n’est pas mentionné en 1828 comme mis en disponibilité ou détaché, rubriques pourtant existantes de l’Annuaire. J.M. Tisseyre (Revue du Rouergue, 26, 1991) évoque sa position de détaché à la fonderie de canons de Toulouse en 1819-1820 et 1824-1825, mais l’Annuaire ne précise pas ce fait, bien que des détachements divers soient mentionnés pour d’autres capitaines. Le détachement était-il de trop courte durée pour être significatif pour l’administration militaire ? Un propos de Levêque, Historique des forges de Decazeville, 1916, propos souvent repris, fait état d’un voyage métallurgique de Cabrol, ancien officier d’artillerie, en Angleterre en 1826 et un autre voyage pour le compte de la compagnie des forges en 1826-1827. L’ancien officier est pourtant toujours militaire en activité dans les Annuaires de ces années…Enfin, pour J.M. Tisseyre, François Cabrol sera rayé des cadres militaires le 25 juillet 1828, ce qui doit donc se lire des cadres actifs. Il faut enfin retenir de cette courte évocation qu’aucun volume de l’Annuaire ne fait mention d’une activité autre que celle de capitaine, ce qui est finalement assez vague, alors que pour d’autres capitaines, une mention d’activité technique, par exemple affecté aux fonderies de…, est mentionnée. On aura enfin noté que l’essentiel de cette deuxième partie de carrière a eu pour cadre les garnisons de Toulouse.
François Cabrol était-il donc né pour l’artillerie ou la métallurgie ? La galerie est encore à creuser...
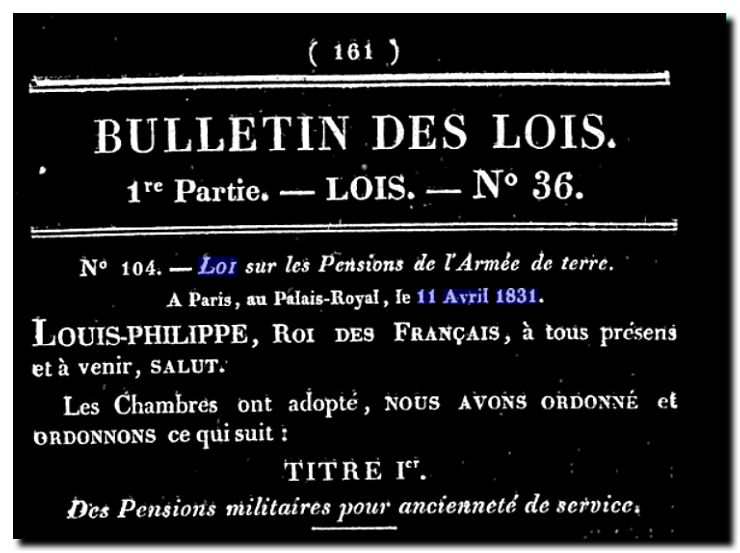 Si le nom de François Cabrol
disparait en 1829 des états militaires, il n'en reste pas moins
militaire, mais en position de réforme. Cette position d'officier sans
emploi permet à notre capitaine de percevoir un traitement parfaitement
compatible avec son activité civile. La loi du 11 avril 1831
(Bulletin 36, loi 104) règle l'essentiel de la position suivante, celle
de pensionné. C'est ce qui explique que ce ne sera qu'en 1838 que
François Cabrol sera admis à percevoir sa pension. A cette date, il
peut justifier de 30 ans de service effectif. Si vous avez suivi les
paragraphes précédents, vous devez avoir quelques difficultés à trouver
ces 30 ans de service effectif ! Il faut en effet tenir compte de
quelques ajouts, comme le temps de réforme, compté comme service
effectif, les majorations pour campagne, et les quatre ans pour études
préliminaires attribués à tout élève de Polytechnique. Et donc
l'ordonnance du 10 mai 1838, publiée dans le Bulletin des Lois 367,
nous apprend la position administrative de François, admis à faire
valoir ses droits à pension. Le tarif
(sic ! ), c'est à dire le montant est de 1200 fr pour un
capitaine. Une majoration de 20 fr par an est acquise pour les années
postérieures aux trente ans. Et sur ce montant (1200 + 4*20=1280 fr) va
s'ajouter une majoration du 1/5 pour tenir compte des plus de 12 ans
passés comme capitaine. Cela nous donne donc un montant de 1280
+(1/5)*1280 soit 1536 fr, ce qui est le chiffre porté dans le tableau
de l'ordonnance. En complément de cette pension, nous avons indiqué
ailleurs sur ce site que François Cabrol percevait un traitement de
10000 fr (+ 5 % sur les bénéfices) comme Directeur des usines.
Si le nom de François Cabrol
disparait en 1829 des états militaires, il n'en reste pas moins
militaire, mais en position de réforme. Cette position d'officier sans
emploi permet à notre capitaine de percevoir un traitement parfaitement
compatible avec son activité civile. La loi du 11 avril 1831
(Bulletin 36, loi 104) règle l'essentiel de la position suivante, celle
de pensionné. C'est ce qui explique que ce ne sera qu'en 1838 que
François Cabrol sera admis à percevoir sa pension. A cette date, il
peut justifier de 30 ans de service effectif. Si vous avez suivi les
paragraphes précédents, vous devez avoir quelques difficultés à trouver
ces 30 ans de service effectif ! Il faut en effet tenir compte de
quelques ajouts, comme le temps de réforme, compté comme service
effectif, les majorations pour campagne, et les quatre ans pour études
préliminaires attribués à tout élève de Polytechnique. Et donc
l'ordonnance du 10 mai 1838, publiée dans le Bulletin des Lois 367,
nous apprend la position administrative de François, admis à faire
valoir ses droits à pension. Le tarif
(sic ! ), c'est à dire le montant est de 1200 fr pour un
capitaine. Une majoration de 20 fr par an est acquise pour les années
postérieures aux trente ans. Et sur ce montant (1200 + 4*20=1280 fr) va
s'ajouter une majoration du 1/5 pour tenir compte des plus de 12 ans
passés comme capitaine. Cela nous donne donc un montant de 1280
+(1/5)*1280 soit 1536 fr, ce qui est le chiffre porté dans le tableau
de l'ordonnance. En complément de cette pension, nous avons indiqué
ailleurs sur ce site que François Cabrol percevait un traitement de
10000 fr (+ 5 % sur les bénéfices) comme Directeur des usines.
Bulletin des Lois, 367, ordonnance du 10 mai 1838
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nicolas, François et d’autres, en campagne…
(toute ressemblance avec des évènements actuels est évidemment fortuite...)
(parmi les sources,
Médiathèque Rodez et Arch. Dép. Aveyron)
Campagne civile ou militaire, quelques unes des illustres figures de notre histoire minière ont eu à en mener, et François Cabrol connaîtra les deux. Il y a eu des succès, mais aussi des défaites. Nous allons rappeler ici quelques unes des élections qui mettront en avant diverses personalités rencontrées sur cette Route du Fer. Les chiffres de compte rendu électoral sont par nature assez indigestes ; nous avons volontairement limité leur indication à ceux strictement nécessaires à une bonne compréhension des faits.
1828
Le 5 ème collège électoral de l’Aveyron, à Villefranche de Rouergue, comme le premier, celui de Rodez, ont donc permis à quelques personnalités illustres de la Route du Fer de s’essayer localement à l’action politique. Ce fut le cas par exemple de Humann, le premier président de la société des forges, qui se trouva élu par le 5 ème, alors qu’il avait quelques difficultés de (ré) élection dans son pays d’origine, en Alsace. Le 23 mai 1828, à la faveur d’une élection partielle, le président obtient 73 voix sur les 137 exprimés (53%). Apparemment les aveyronnais firent confiance à l’industriel qui ne s’était pas beaucoup investi localement, hors les forges, et ce assez récemment (1826). M. Humann va siéger à gauche de l’Assemblée. Il ne semble pas qu’il ait beaucoup fréquenté le Rouergue…
1831
En octobre 1831, Joseph Decazes, qui vient de se libérer de ses fonctions préfectorales à Albi, est candidat à Villefranche. Il faut pourvoir le siège de M. Humann, qui a été également élu en juillet à Schelestadt, et qui choisit ce dernier arrondissement. Le Bulletin de l’Aveyron (BA) du 3 septembre 1831 évoque une liste de candidats probables à la succession de l’honorable Humann reprenant la rumeur publique ; on cite ainsi le général Tarayre, Joseph Decazes, et l’avocat général à la cour royale de Nimes Lobinhes.
Trois tours de scrutin seront nécessaires pour cette élection, les 2 octobre et jours suivants. Au premier tour, 7 candidats se partagent les 135 voix exprimées (257 inscrits) : Labinhes 54, le général Tarayre 41, Joseph Decazes 35 voix. Les quatre autres candidats figurent simplement avec 2 ou une voix chacun. Ce premier tour place donc nettement Decazes en 3 ème position, avec 25,9 % des voix, une place pas à priori enviable. Le second tour lui est plus favorable : 173 votants, Labinhes 65 (38%), et Decazes 60 (35%) voix. Le général Tarayre vient en troisième position avec 45 voix.
Ce résultat est un peu surprenant. En effet Tarayre est une personnalité locale, née à Solsac, lieu de mines de fer sur le causse Comtal. Ses implications républicaines sont connues, ayant été déjà élu en Charente Inférieure en 1820 ; est connue également son activité remarquable sur le causse en agriculture, à Billorgues. Dans ce 5ème collège réputé à gauche, le général, « qui avait applaudi à la révolution de 1830 », avait donc atteint ses limites électorales. Au troisième et dernier tour, le choix se fera entre l’avocat général de Nimes Labinhes, et l’ex préfet du Tarn Decazes, en l’absence donc de candidat local. Joseph Decazes obtient 102 voix (56%) et Labinhes 79 (44%). Les voix de gauche de Tarayre se sont majoritairement portées sur le préfet… On peut penser évidemment que l’implication industrielle bien visible des frères Decazes dans cet arrondissement prend le pas sur l’étiquette politique. En juillet 1831, Humann avait obtenu au troisième tour 57% des suffrages. Joseph Decazes ne fit donc que continuer, ni plus, ni moins l’itinéraire de Humann. On notera au passage que le duc Elie Decazes, son frère, était en Aveyron quelques jours dans ses belles usines de Lassale et Firmy en juin 1831, (BA du 18 juin 1831). La proximité des élections de juillet est à rapprocher de cette visite qui ne pouvait que rendre plus visible la candidature de son président de société, bien absent sur le terrain…

Joseph Decazes venait donc en octobre de battre un concurrent, le général Tarayre, républicain, qu’il connaissait bien. Le général fut de 1806 à 1810 en Hollande, auprès du roi Louis. A la même époque Joseph était ingénieur des ponts et chaussées dans ce département extérieur, et son frère Elie, le futur duc, présent comme conseiller du roi de Hollande. Tous trois au même moment donc. Le vicomte Decazes fera son entrée officielle à la Chambre le 17 octobre 1831.
1846
Quelques années plus tard, François Cabrol, en qualité de Maître des Forges, apparaît politiquement à Rodez, dans le premier collège électoral. Le 27 janvier 1845, au second tour, Michel Chevalier avait été élu : 241 voix s’étaient portées sur son nom, contre 136 pour Adrien de Séguret, (385 votants et 491 inscrits). Plus de 60% des suffrages pour un étranger, né à Limoges, et militant convaincu du libre échange. Une anomalie en Aveyron ! En août 1846, ce député sortant aura face à lui le maître des forges, qui voit bien sûr dans cette doctrine du libre échange une condamnation sans appel de ses forges : les fers anglais reviennent ainsi une fois livrés à Bordeaux moins chers que les siens ! Malgré les efforts de Cabrol, en 1860, le traité franco-anglais sera celui de Chevalier.
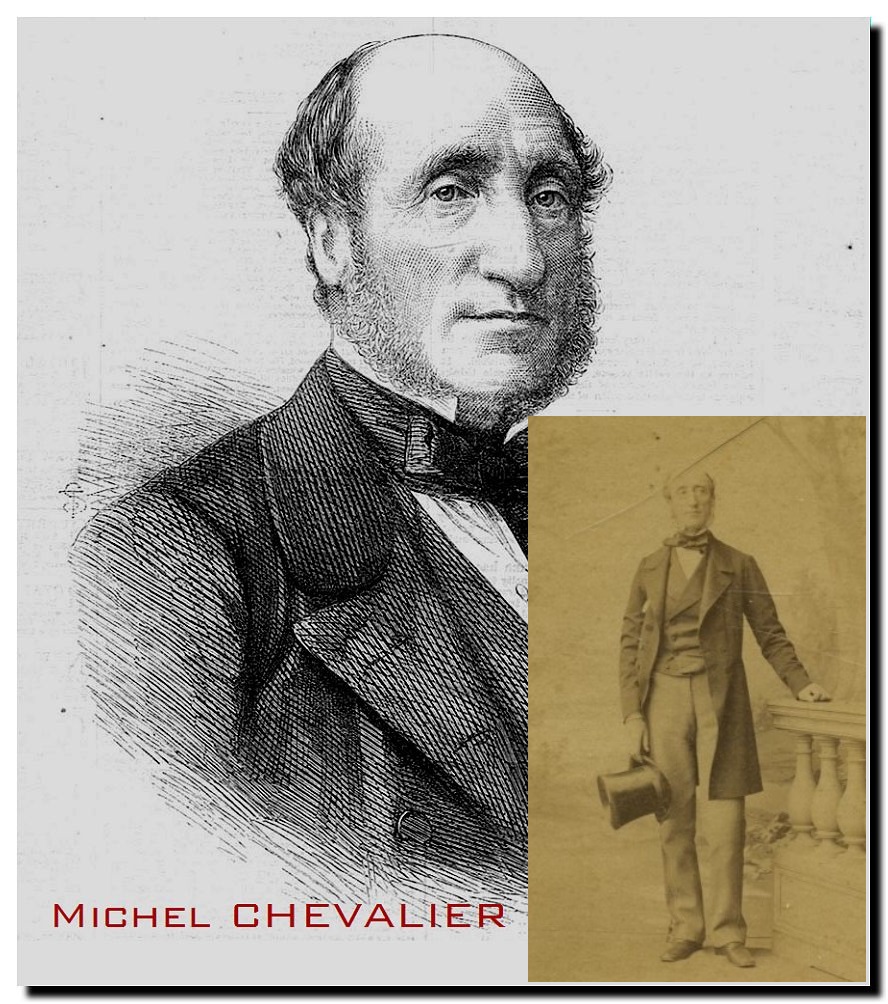 Le premier tour, le 2 août 1846, donne les résultats
suivants : votants 425, Chevalier
181, Cabrol 161, de Barreau 68, Durand de Gros 9, Carcenac 1, Fabry 1,
nuls 4. Au deuxième tour, 424 votants, et Cabrol 238 voix, Chevalier
194, Fabry 1, et un nul. Le score de 56 % de François Cabrol est un
vrai succès, après une campagne agitée, dans laquelle les échanges
écrits n’ont pas manqué. François Cabrol va ainsi publier plusieurs
appels aux électeurs, en agitant le spectre de la catastrophe certaine
si l’on suit les idées de son adversaire,
grand admirateur des « brocanteurs de
concessions ». Les deux ingénieurs polytechniciens
s’affronteront dans les pages des journaux locaux. L’aspect alors assez
théorique des idées de Chevalier ne sera pas suffisant pour le faire
réélire. François Cabrol avait également brocardé cet adversaire en
ironisant sur ses projets locaux de forges, ou de canalisation de
l’Aveyron, de Villefranche à Rodez, une lumineuse idée
( ! ). Le premier employeur industriel du département s’était imposé et
sera donc député.
Le premier tour, le 2 août 1846, donne les résultats
suivants : votants 425, Chevalier
181, Cabrol 161, de Barreau 68, Durand de Gros 9, Carcenac 1, Fabry 1,
nuls 4. Au deuxième tour, 424 votants, et Cabrol 238 voix, Chevalier
194, Fabry 1, et un nul. Le score de 56 % de François Cabrol est un
vrai succès, après une campagne agitée, dans laquelle les échanges
écrits n’ont pas manqué. François Cabrol va ainsi publier plusieurs
appels aux électeurs, en agitant le spectre de la catastrophe certaine
si l’on suit les idées de son adversaire,
grand admirateur des « brocanteurs de
concessions ». Les deux ingénieurs polytechniciens
s’affronteront dans les pages des journaux locaux. L’aspect alors assez
théorique des idées de Chevalier ne sera pas suffisant pour le faire
réélire. François Cabrol avait également brocardé cet adversaire en
ironisant sur ses projets locaux de forges, ou de canalisation de
l’Aveyron, de Villefranche à Rodez, une lumineuse idée
( ! ). Le premier employeur industriel du département s’était imposé et
sera donc député.
1848
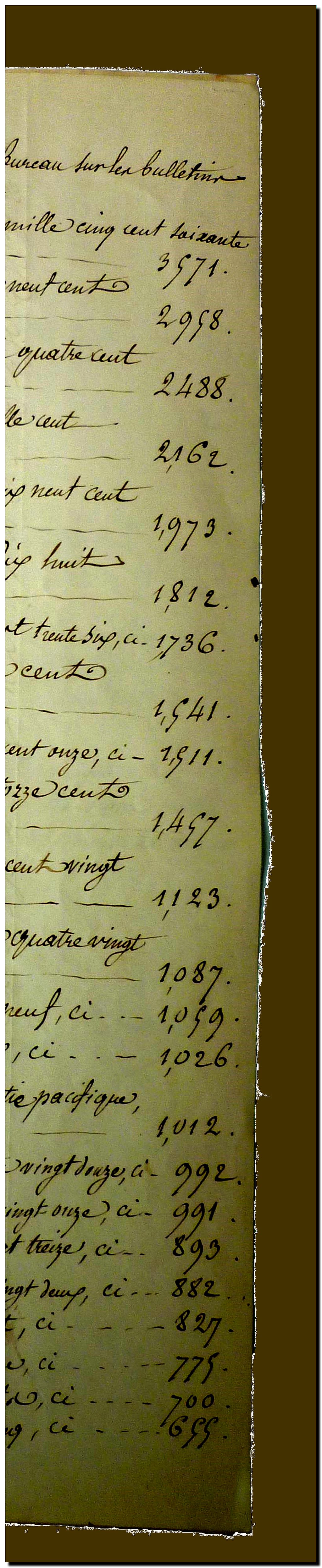 La révolution de février 1848 amène la seconde République.
Beaucoup de changements, dont le mode scrutin, devenant universel
direct, enfin masculin seulement ! Il y aura ainsi en Aveyron
105448 électeurs inscrits et 90119 s’exprimeront lors du scrutin du 23
avril, plus de 85 % de votants. Le
département doit désigner ses dix représentants à l’Assemblée Nationale
Constituante. Il y a également foule de candidats.
La révolution de février 1848 amène la seconde République.
Beaucoup de changements, dont le mode scrutin, devenant universel
direct, enfin masculin seulement ! Il y aura ainsi en Aveyron
105448 électeurs inscrits et 90119 s’exprimeront lors du scrutin du 23
avril, plus de 85 % de votants. Le
département doit désigner ses dix représentants à l’Assemblée Nationale
Constituante. Il y a également foule de candidats.
Le 5 mars 1848, la République est proclamée à Decazeville. Dans la salle d’école, devant les ouvriers réunis, Nicolas Cadiat, l’ingénieur de la Compagnie, demande à ce que chacun, selon ses facultés, concoure à l’œuvre nouvelle. Son appel est intégralement repris dans le Journal de l’Aveyron (JdA) du 11 mars. Les jours suivants vont voir le Journal se consacrer presque exclusivement aux élections annoncées, avec une multitude d’appel aux électeurs et de déclarations. Le 18 on s’interroge : ne doit-on choisir que des républicains de la veille ? Le 22, Cabrol devra intervenir pour calmer quelques agitateurs dans ses forges. Le 5 avril, Riant, candidat, maître de forges à Aubin s’explique : je suis Républicain du lendemain, mais franchement Républicain parce que je demande l’ordre et le travail…Le 8 avril le JdA publie une liste « officielle » de dix noms proposée par le Comité électoral de l’Aveyron qui a recherché les candidats qui pourraient représenter dignement le département de l’Aveyron : 9 en fait sont donnés, le dernier viendra un peu plus tard. Et le sortant, Cabrol ne figure pas. L’explication de texte est donnée par le Comité : Il en est une (candidature) qui, si elle se fut produite, eût été accueillie dans tous les cantons, celle de M. Cabrol. Quelques lignes plus loin, le Comité souligne que le maître des forges sera plus utile au département en restant à Decazeville…Signe de prudence ? Cabrol candidat ou pas ? Un échec probable ? Le député sortant ne se représentera donc pas.
Le Procès verbal du Bureau central et départemental présente comme premier élu Grandet, de Rodez, 69490 voix, le dixième et dernier élu étant Médal avec 30111 voix. Derrière eux….beaucoup de monde, dont le général Tarayre, Riant, le maître des forges d’Aubin, 11124 voix, et Cadiat, 191 voix. François Cabrol était cependant présent. Ces deux non élus donc, sont même voisins sur le tableau récapitulatif du procès verbal particulier de Rodez, où sur 4583 électeurs inscrits 3916 vont voter (85,4%). Ils étaient aussi voisins ailleurs : Nicolas Cadiat, républicain convaincu, était ingénieur en chef à Decazeville, comme rappelé plus haut. Cette candidature ne devait évidemment pas plaire du tout à son maître des forges. Cadiat va ainsi quitter Decazeville pour Paris, limogé probablement par Cabrol. Le score départemental de Cadiat est de 191 voix, et celui de Cabrol ne nous est pas connu. Mais à Rodez, 67 noms figurent au PV, avec 41 voix pour l’ingénieur et…10 pour Cabrol. De façon très curieuse, après avoir lu, relu et re-relu le procès verbal départemental, le nom de Cabrol ne figure pas sur le document… Il y a 79 noms sur cette liste, adoptée sans observation ni réclamation. Le dernier de la liste a 28 voix. Est-ce à dire que Cabrol avait fait un score départemental inférieur ? De toute évidence les bons résultats du scrutin censitaire sont à mettre au passé. Dans le canton de Villeneuve, seul canton avec Rodez dont on possède apparemment le détail (les autres PV ont été transmis à Paris), Riant obtient 7 voix, et Cabrol 5 : l’industriel n’est plus le sauveur. Le premier de la liste dans ce canton, Cluzel obtiendra 2144 voix.

En détournant ce qu’André Citroën réalisa, en jaune et noir, et évidemment à une toute autre échelle, ce billet va évoquer quelques unes des découvertes faites à Muret-le-Château. Parmi elles, de véritables pépites ! Même si elles ne sont pas à chenilles, comme cette C4.
Pour ceux qui ont parcouru l’ensemble de ce site, Muret n’est pas inconnu. Ils ont pu par exemple comprendre pourquoi la métallurgie rouergate est sûrement née ici ; la présence du minerai de fer, et la proximité de la houille de Sensac avaient motivé MM. Passelac et Blavier dès 1804. Les forges utilisaient évidemment les ressources du ruisseau dit des Douze pour les martinets.
Bien plus tard, nous retrouverons à Muret des mineurs de
Decazeville : les liste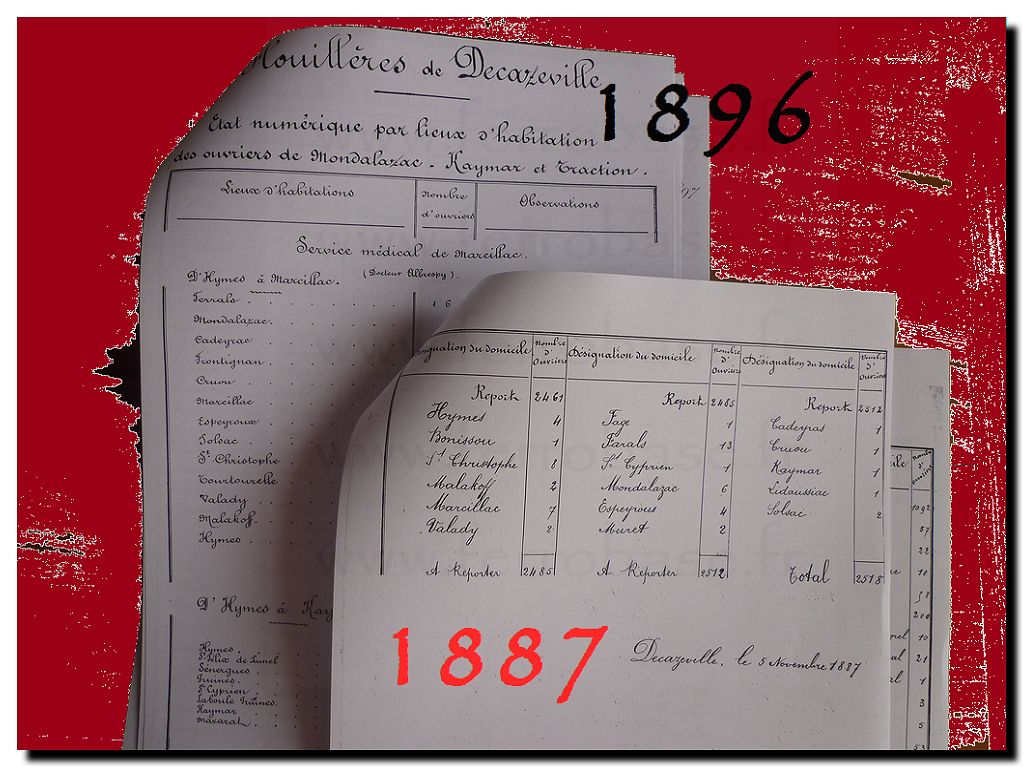 s
d’employés de la compagnie gardent la trace de ces mineurs du causse.
Très soigneusement, le service médical de Decazeville tenait
à jour ses statistiques et données, comme les effectifs de mineurs et
ouvriers par commune et lieu de domicile. En 1887, 13 à Ferals, 6 à
Mondalazac, 4 aux Espeyroux et 2 à Muret. En 1896, 16 à Ferals, 8 à
Mondalazac, 2 aux Espeyroux, aucun à Muret, et 2 à Malakoff ou 1 à
Frontignan, pour donner quelques exemples.
s
d’employés de la compagnie gardent la trace de ces mineurs du causse.
Très soigneusement, le service médical de Decazeville tenait
à jour ses statistiques et données, comme les effectifs de mineurs et
ouvriers par commune et lieu de domicile. En 1887, 13 à Ferals, 6 à
Mondalazac, 4 aux Espeyroux et 2 à Muret. En 1896, 16 à Ferals, 8 à
Mondalazac, 2 aux Espeyroux, aucun à Muret, et 2 à Malakoff ou 1 à
Frontignan, pour donner quelques exemples.

Un habitat de mineur vers 1900 : le cantou
Des mineurs logeaient aux casernes de Ferals, et d’autres…ailleurs. Comme ici. Cette modeste pièce, au sol de terre battue à l'époque, fut un temps louée à un mineur. La cheminée que vous découvrez lui permit, n’en doutons pas, de réchauffer un intérieur spartiate. Ne manque aujourd’hui sur le feu qui pourrait reprendre que le toupinou !
◄ Plusieurs accidents ont marqué ces travaux de mines, comme ici en 1898...La mine de fer, avec les failles du causse, les infiltrations, est toujours dangereuse.
Journal de l'Aveyron
Il y a donc quelques pépites à Muret et dans les environs proches. La première que nous vous présentons renvoie au titre du billet. Après fermeture de la mine, des activités diverses vont occuper certaines galeries et bâtiments de surface. Les champignons figurent dans la liste. La température des galeries est constante, de l’ordre de douze degrés. En régulant avec des ventilateurs le taux d’humidité, les conditions de pousse de ce diamant blanc qu’est le champignon dit de couche sont réunies. Il y a donc eu ici une champignonnière.
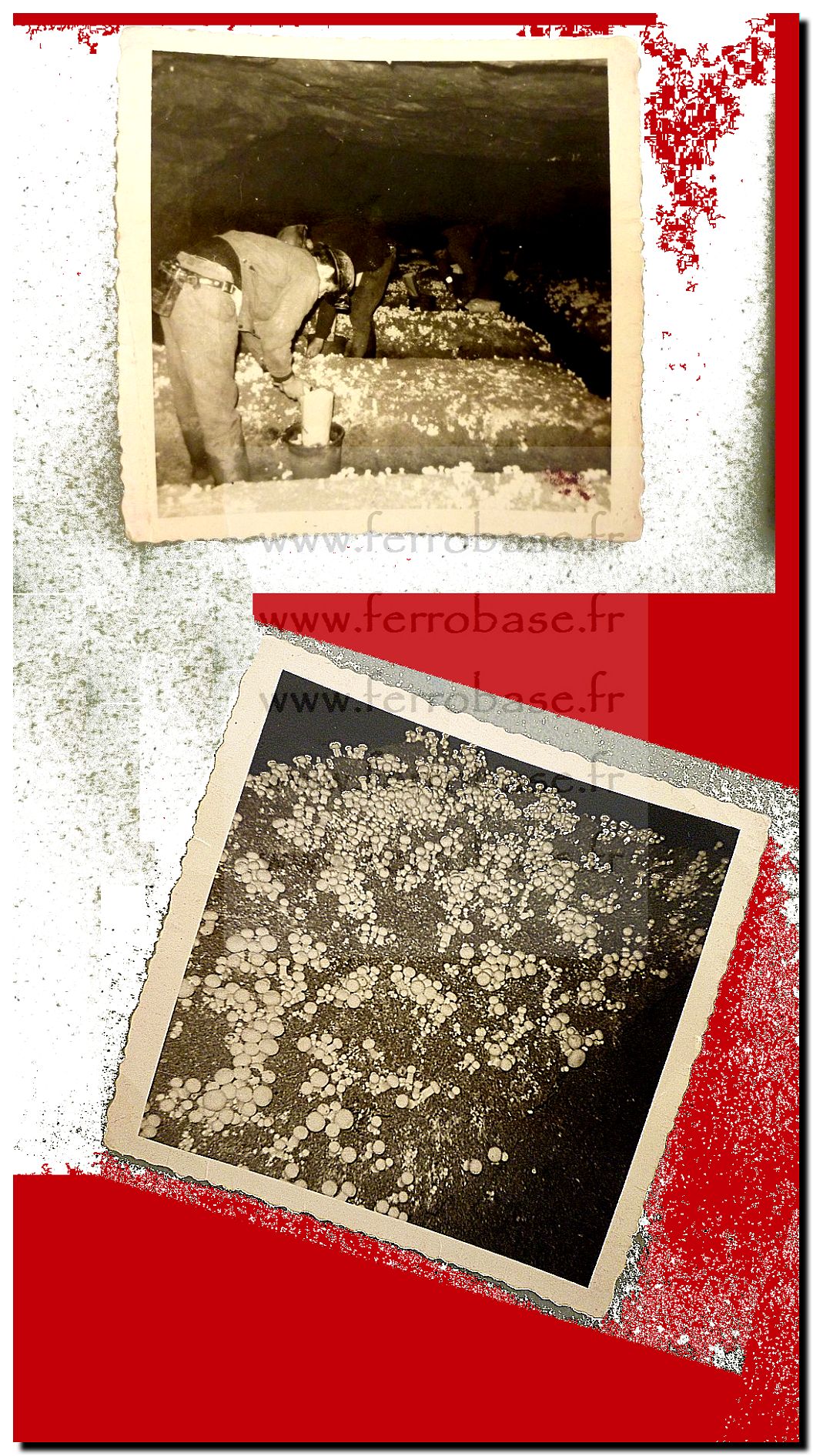
La pousse se faisait sur des volumes enrichis de fumier de cheval. Une couche superficielle de sable permettait d’obtenir des produits propres à la vente. Ces Champignons du Rouergue, estampillés Marcillac, furent l’objet dans la deuxième moitié du XX ème siècle d’une activité soutenue. Les transports souterrains mirent en œuvre des moyens divers. Et parmi eux, cette C4 Citroën, présentée plus haut. Scalpée ( ! ) pour les besoins, et surtout pour pouvoir passer plus facilement on s’en doute, elle va transporter à l’intérieur de la mine tout ce dont on a besoin, son chargement en témoigne, et quelquefois dans des conditions dignes des croisières Citroën. Son chauffeur nous a même précisé que le volant frôlait parfois le toit de la galerie : on imagine évidemment sa position disons acrobatique ! Cette belle image familiale permet de construire une véritable épopée, avec champignons, sacs, sable…Une histoire donc de diamants blancs du causse…
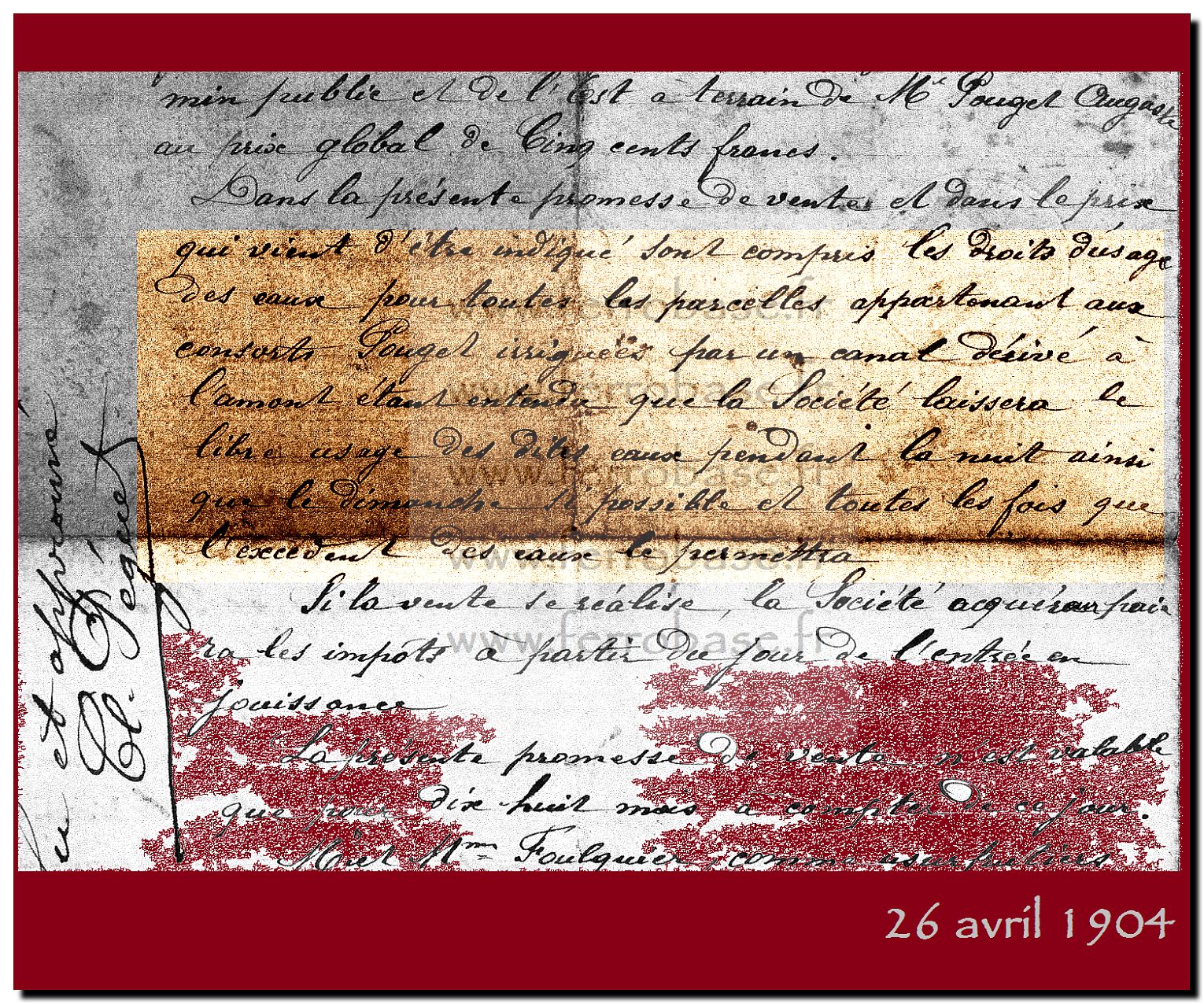
Une autre pépite tout aussi passionnante, dans un tout autre domaine. Nous avons rapidement rappelé la présence en 1804 d’une société de forges à Muret, en bas de la cascade. Un siècle plus tard, le 26 avril 1904 donc, la compagnie Commentry-Fourchambault et Decazeville, propriétaire comme on sait de la mine voisine de Ferals, la plus exploitée du causse, va s’engager par une promesse d’achat, à acquérir une parcelle, section E, n° 304, à Muret. A priori, rien de bien particulier. Mais, en y regardant donc de plus près, cette parcelle se situe tout en bas de Muret, contigüe à la grande cascade. Quelles étaient les intentions de l’industriel ? Sûrement pas l’établissement d’un haut fourneau et la création d’une forge, comme d’autres en 1804. Mais l’intention pouvait être d’utiliser la force motrice de la cascade pour une production électrique destinée à la mine ? Cette hypothèse nous parait la plus plausible, en l’absence d’autres détails. A l’appui de notre raisonnement, les conditions de la promesse précisent que « la Société laissera le libre usage des dites eaux pendant la nuit ainsi que le dimanche ». On peut en déduire que le jour, la Société se réservait donc cet usage…pour une production électrique ?
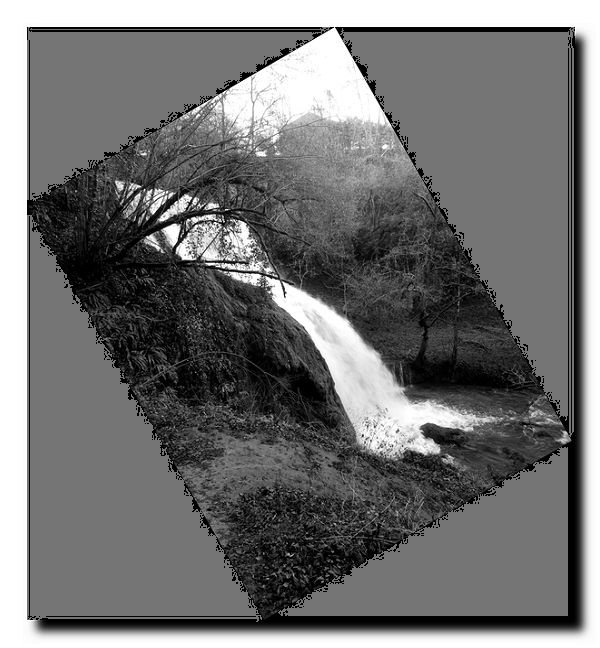
La cascade de Muret : force motrice indiscutable. Son équipement fut envisagé en 1904
Tout
le
monde connaît maintenant, et dans tous ses détails, comme la page cinéma l’évoque, l’existence et le
pourquoi du transporteur aérien du causse, le chemin de fer aérien. On
sait donc qu’à Jogues, sur le causse, une station d’angle existait
permettant aux câbles de changer de direction. Les vestiges actuels ne
permettent pas de connaître l’architecture exacte du bâtiment, au vu
des restes de murs. On va pouvoir maintenant en savoir un peu plus.
Donc, deux longs murs, hauts de 5 ou  dernier
détail est réel. En effet, il existe en 2013 un toit rouge, un peu seul
dans un univers d’ardoises et de lauzes du causse. Dans un hameau tout
près de Jogues, ce toit rouge couvre un hangar. Et la charpente et
couverture de ce hangar ne sont autres que des fragments de
l’installation de Jogues. Vendus après 1920 pour trente francs. Aucun
doute n’est permis, à la vue des profils, cornières poutres et rivets.
Même si les re-constructeurs ont boulonné et non riveté les éléments du
hangar, aucune nécessité de rivets dans cette seconde vie. Et si un
doute persiste, la tuile peut le balayer : le joli motif de lance
qui existe sur la tuile, est parfaitement identique à celui que nous
avions rencontré à Marcillac, à la gare aérienne : tuile
lancéolée, fabriquée par Lacabane à Figeac vers 1910 donc. On leur
souhaite longue vie…Sous cette couverture, la charpente métallique
robuste soutenait les poulies, câbles et rails de circulation des
wagonnets aériens. A très peu de choses près, cela devait ressembler à
cette vue d’une autre station de ropeway, bien loin d’ici.
dernier
détail est réel. En effet, il existe en 2013 un toit rouge, un peu seul
dans un univers d’ardoises et de lauzes du causse. Dans un hameau tout
près de Jogues, ce toit rouge couvre un hangar. Et la charpente et
couverture de ce hangar ne sont autres que des fragments de
l’installation de Jogues. Vendus après 1920 pour trente francs. Aucun
doute n’est permis, à la vue des profils, cornières poutres et rivets.
Même si les re-constructeurs ont boulonné et non riveté les éléments du
hangar, aucune nécessité de rivets dans cette seconde vie. Et si un
doute persiste, la tuile peut le balayer : le joli motif de lance
qui existe sur la tuile, est parfaitement identique à celui que nous
avions rencontré à Marcillac, à la gare aérienne : tuile
lancéolée, fabriquée par Lacabane à Figeac vers 1910 donc. On leur
souhaite longue vie…Sous cette couverture, la charpente métallique
robuste soutenait les poulies, câbles et rails de circulation des
wagonnets aériens. A très peu de choses près, cela devait ressembler à
cette vue d’une autre station de ropeway, bien loin d’ici.
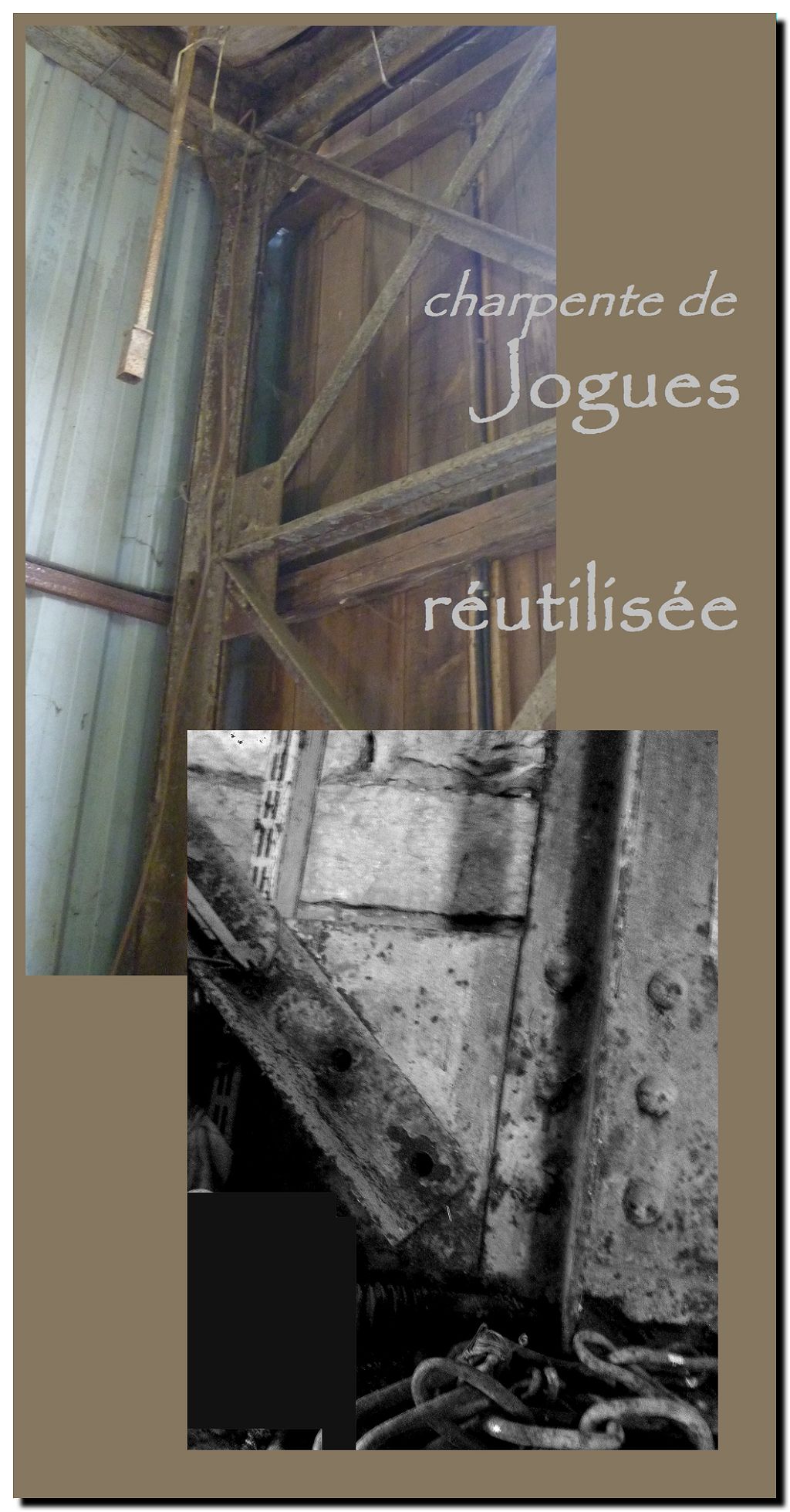

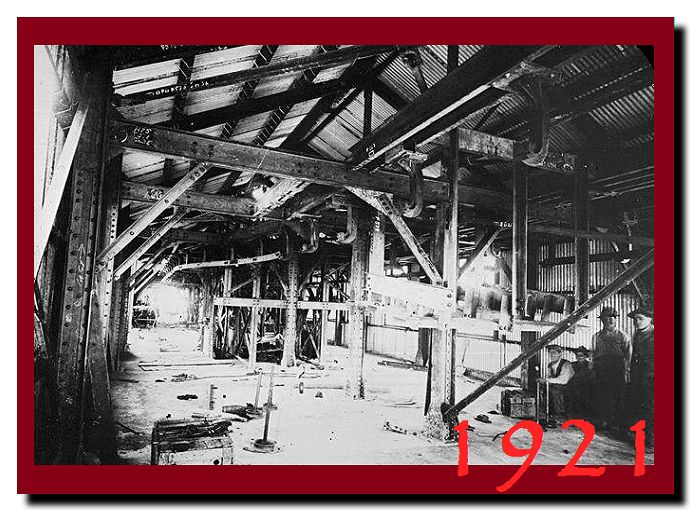
Parmi les découvertes archéologiques de cette Croisière, deux wagonnets de l'aérien. En état correct, toujours utilisé, ou plus abimé et délaissé, ils sont les derniers témoins du causse.


Pour refermer (provisoirement) cette page, cette communication d'une image des casernes de Cadayrac, disparues de nos jours. Lecteur attentif de nos pages, vous savez certainement que c'était le nom donné aux bâtiments de mineurs. Habitations ?
En quelle année ? 1925 ? 1930 ?
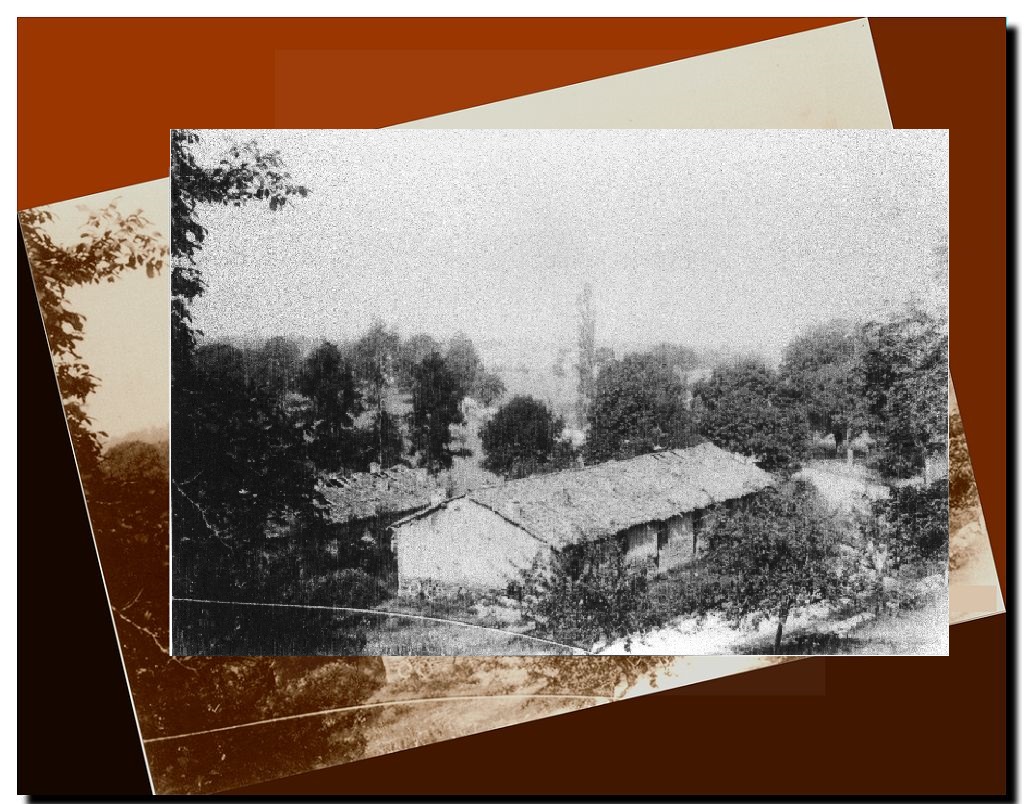
La Croisière Rouge se termine ici sur le causse. On croise des mineurs, la nature et la technologie, belle balade non ?
Cette Croisière doit beaucoup à ceux qui nous ont très aimablement mis sur la route. Un remerciement particulier à MM. Bruvier, Cazes, Depitre, Falguières, Méjane.


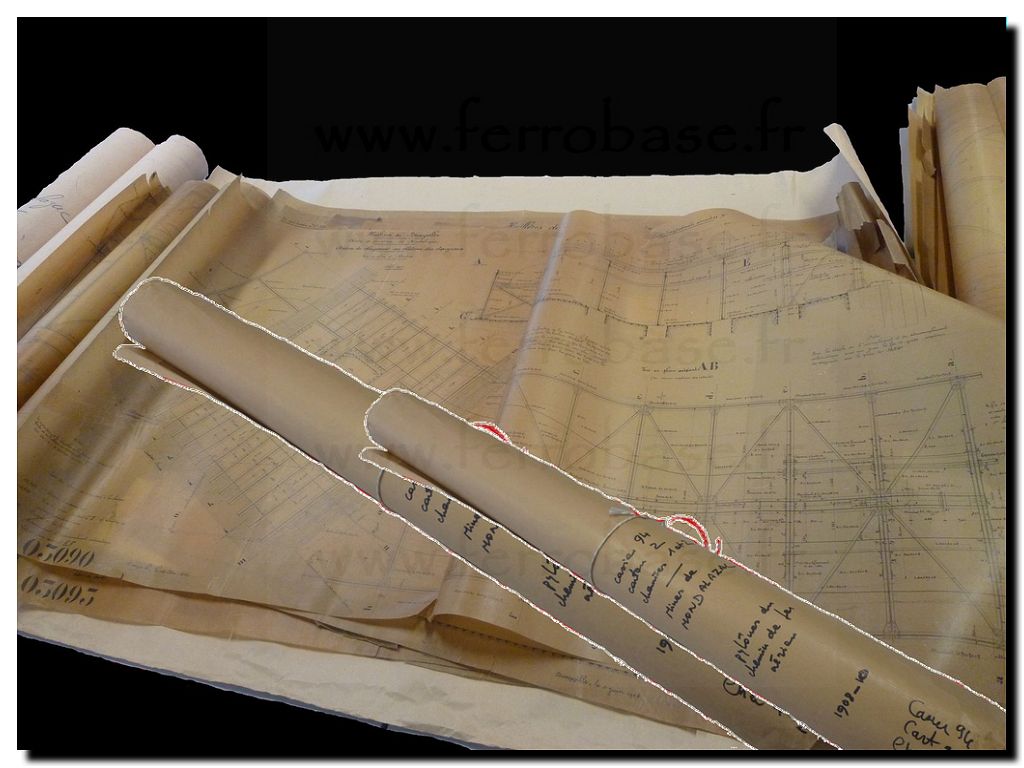
Inattendu non ? Jogues est bien une plaque tournante, au sens propre. Le trafic est celui du minerai de fer, mais pas uniquement, et ici il change de direction, 43° exactement. Nous avons les preuves de ce trafic, une bonne centaine de plans ! Voici quelques résultats de cette enquête.
Le transporteur aérien du causse a été présenté dans la troisième partie du chapitre 1 de ce site, et chapitre 6, pour ses caractéristiques principales. Nous allons approfondir certains aspects de l’attraction touristique qu’il était, de 1910 à 1920. Le bureau d’ingénieur parisien Richard, successeur de Mourraille pour l’exploitation des brevets Pohlig a fourni les bennes et autres machineries indispensables. Mais les infrastructures ont fait l’objet d’un travail important d’études, calculs et dessins des dessinateurs et ingénieurs de Decazeville. La totalité des plans de cette découverte porte exclusivement la signature « Decazeville, le…. », et les dates vont de 1908 à 1914 pour l’essentiel : plans papier, carton, et papier calque qui commencent bien sûr à montrer des signes certains d’âge avancé…

Le principe de fonctionnement est bien
connu : un câble tracteur mobile entraîne les bennes aériennes qui
roulent sur un câble fixe. Il y a donc trois types de câbles : le
câble tracteur, le câble porteur côté des bennes pleines, le plus
chargé et le plus important, et le câble porteur côté des vides, moins
sollicité. Les diamètres vont de 30 à un peu moins de
 La
poulie de la station de Jogues est très particulière : deux mètres
de diamètre,
La
poulie de la station de Jogues est très particulière : deux mètres
de diamètre,
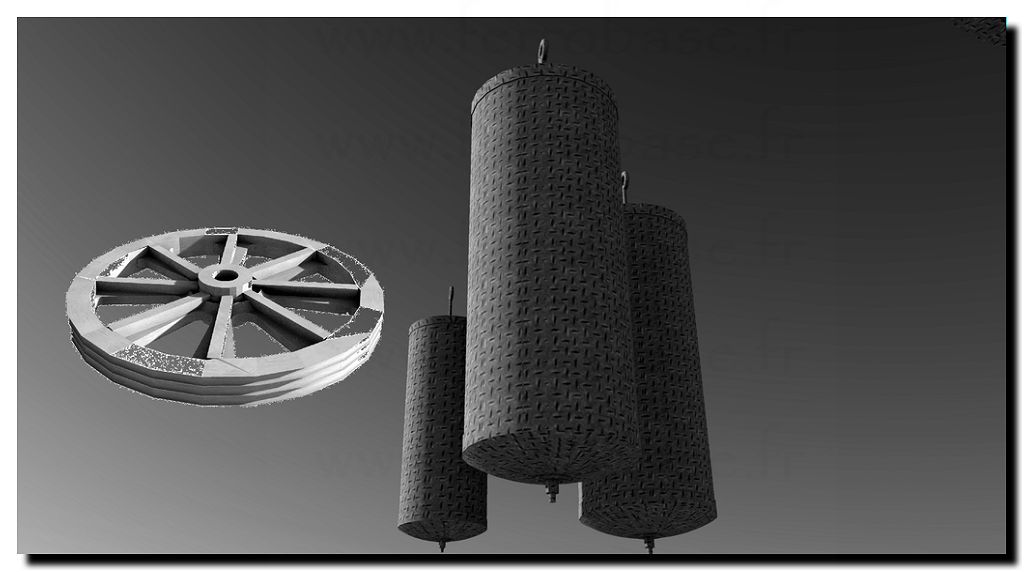
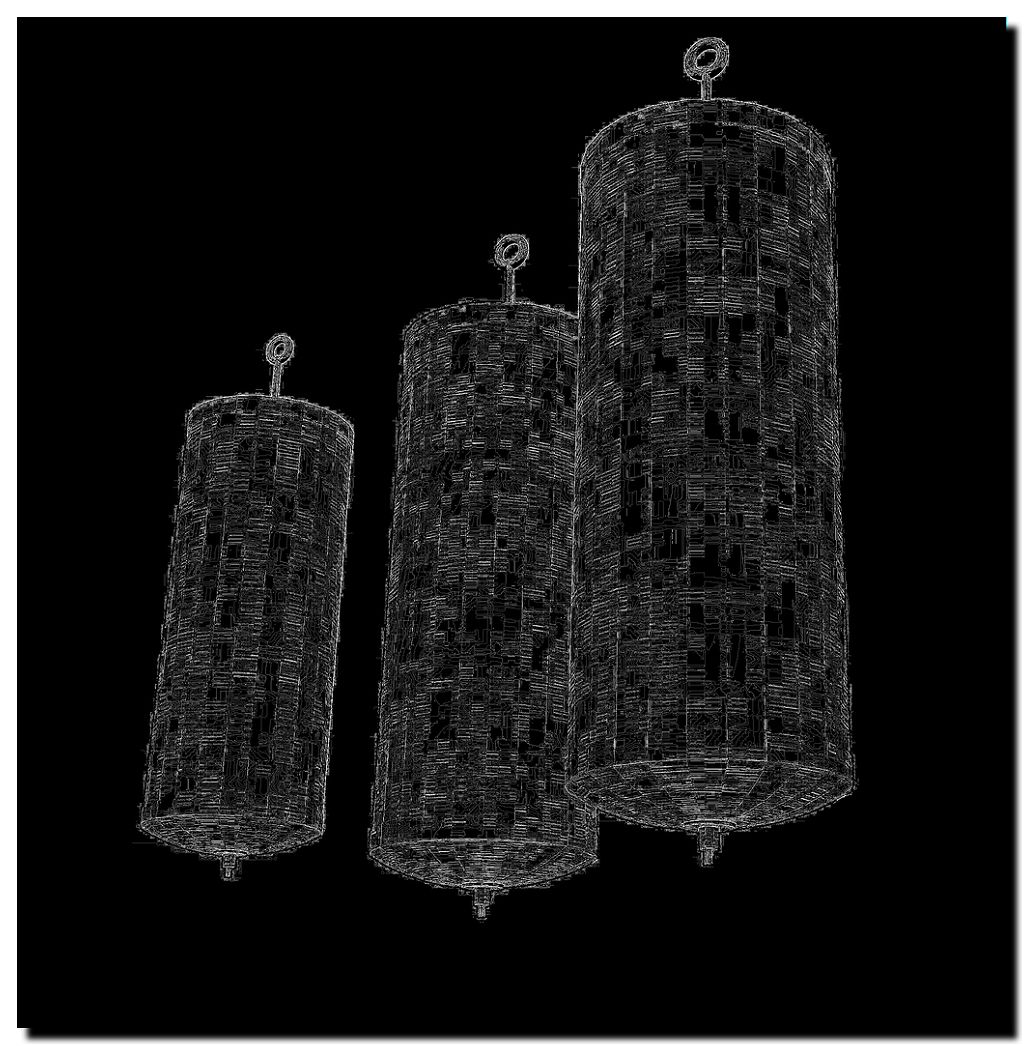
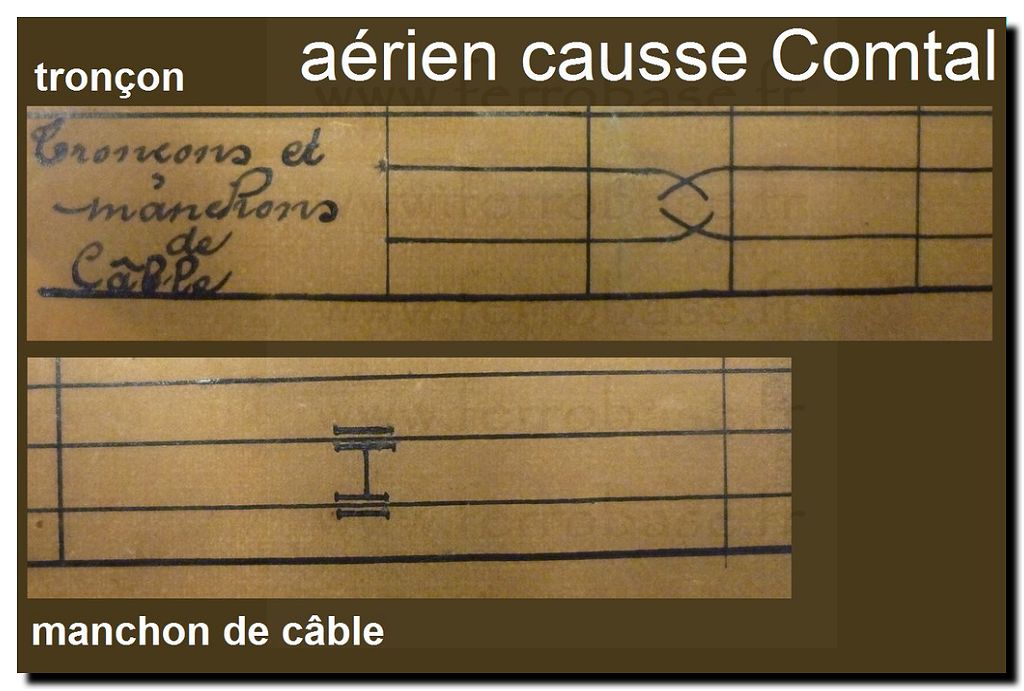
Les câbles porteurs, que nous allons appeler
vide ou plein suivant leur destination, n’étaient pas d’une seule pièce
on s’en doute. Il y avait un manchon de raccordement, sous la forme
d’une grosse olive tous les
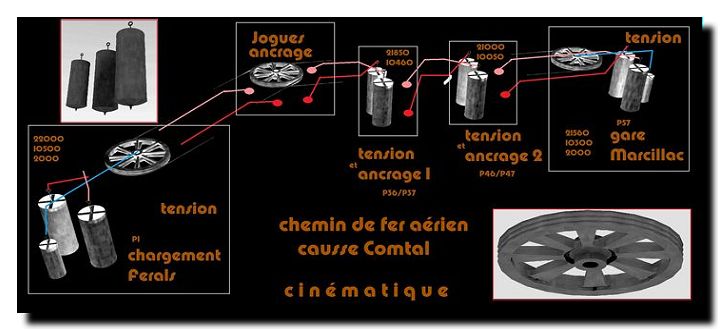
En partant de Jogues vers la mine de Ferals, le porteur plein
est ancré à Jogues dans les structures de la station. Un peu plus d’un
kilomètre et demi plus loin, à la mine, il est tendu par son attache à
un lest contrepoids de l’ordre de 22 tonnes. C’est cette sorte de bidon
qui est bien visible sur les photos publiées sur ce site. Par
exemple : cylindre de deux mètres de hauteur et
A Marcillac, siège de la gare minière, la situation est très
semblable : trois lests, respectivement de 21560, 10300 et
A Jogues les câbles porteurs ancrés se croisent : le câble porteur plein va s’ancrer sur sa gauche en arrivant, et le câble des vides part à droite. Pourquoi ? Nous n’avons pas d’explication très assurée…un équilibre de forces ? La même situation de croisement existe à l’arrivée à Ferals et à Marcillac. Nous l’avons bien figurée sur nos restitutions, comme ci-dessus, à Ferals et Marcillac. Pour un schéma plus lisible, il n'y a pas de croisement dessiné à Jogues.
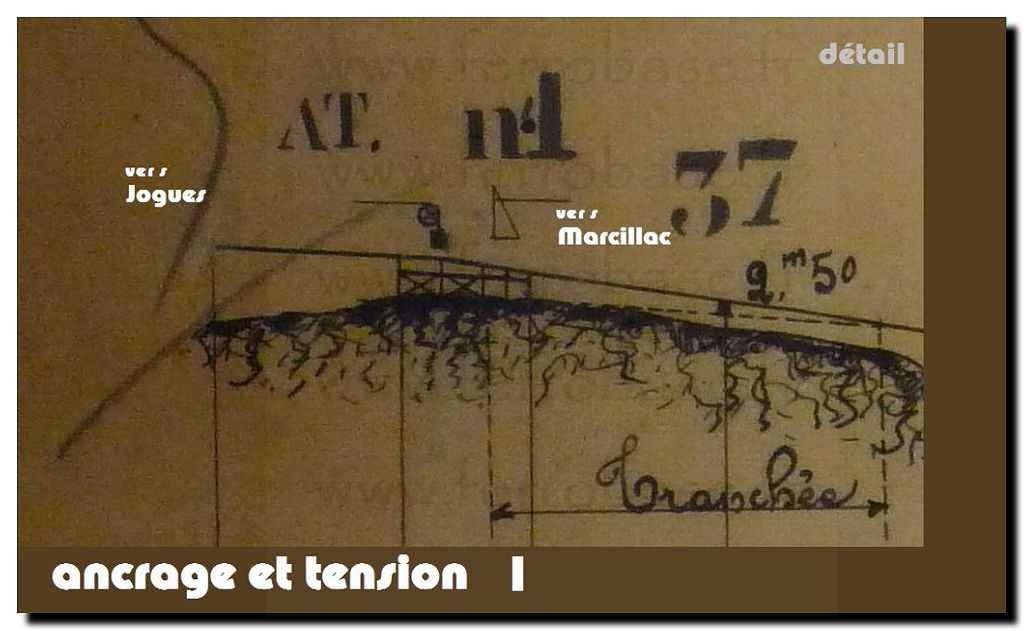
C’est entre Marcillac et Jogues que la situation se complique.
La distance est de l’ordre de
Il y avait donc quatre tronçons de câbles porteurs sur le trajet du transporteur aérien, et chaque tronçon a une longueur de l’ordre du kilomètre et demi. Si vous avez bien suivi, il y avait donc également 10 contrepoids : 3 à Ferals, 3 à Marcillac, deux à la tension-ancrage N°1 et deux à la station tension-ancrage N°2. Nous n’avons pas retrouvé de plans de ces deux stations 1 et 2. Seul un schéma les indique sur un plan de profil en long. Les structures semblent être minimalistes…
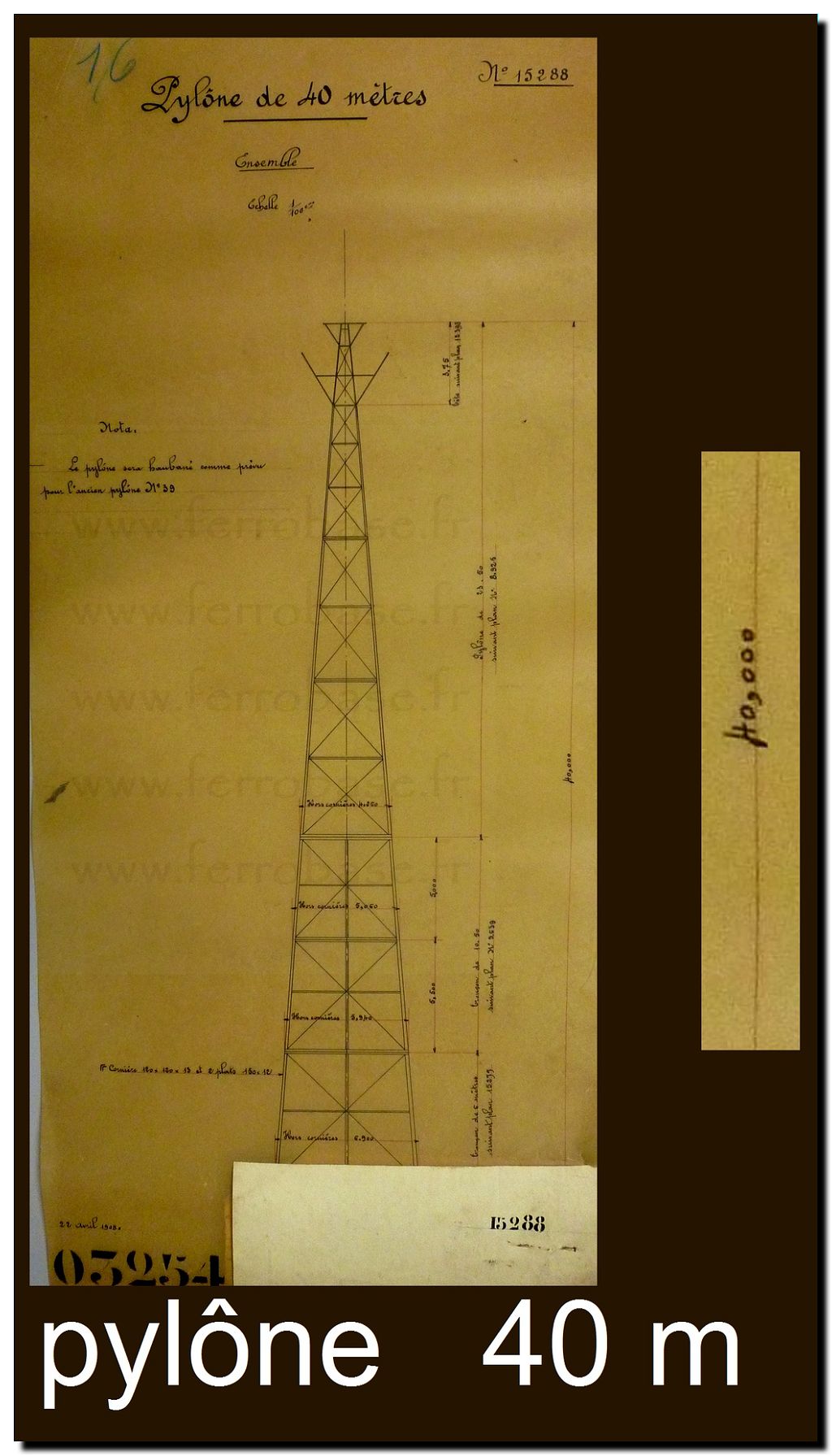
Evidemment, l'écran est tout juste grand pour l'afficher ! Le pylône de 40 m, le plus haut des 57 mentionnés dans les tableaux et plans.
Comme quelques uns, il était haubanné.
Ci-dessous, images de synthèse : les rails de roulement principaux sont figurés. Quelques élements de charpente ont été dessinés sur la deuxième image.
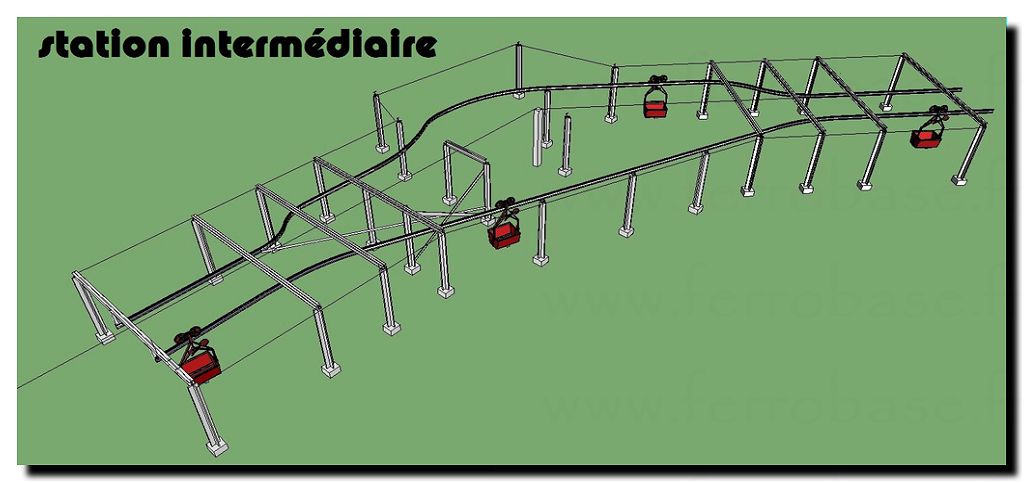
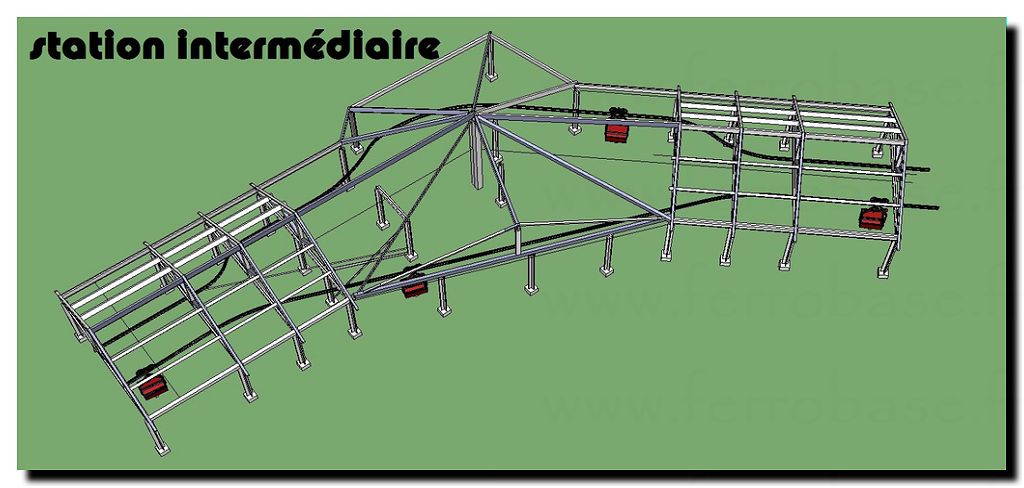

Les plans de la station de Jogues montrent
une installation relativement vaste, construite au sol, en charpente
métallique bien sûr :
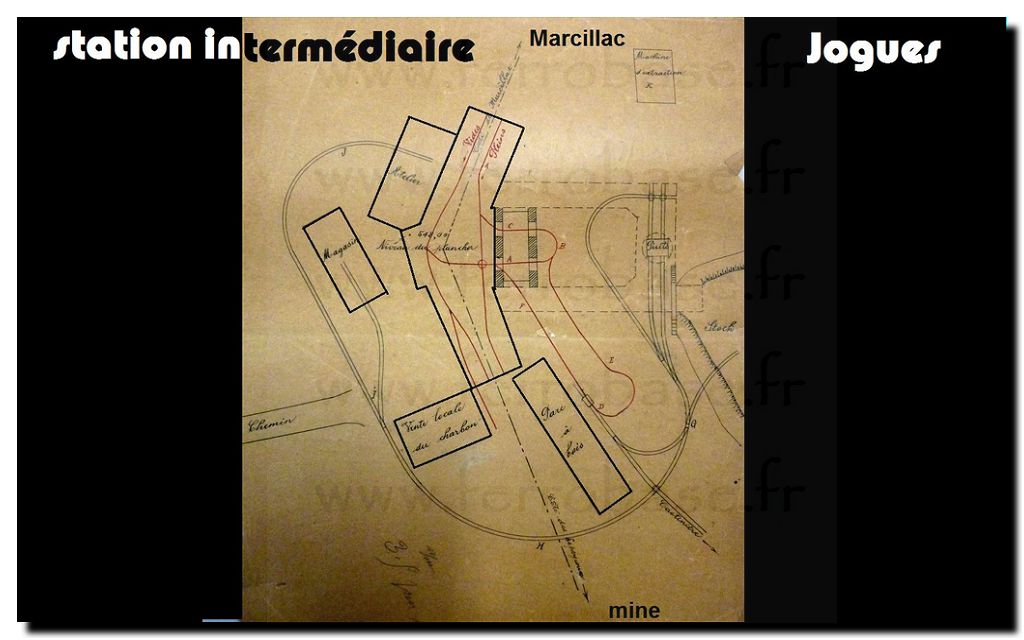 Il s’agit d’abord de rails
de stockage, en rouge sur ce plan. Nous avons en effet découvert sur
plans un parc à charbon, contigu à l’installation, et destiné est-il
écrit à la vente locale de charbon (en bas, à
gauche). Les wagonnets montaient donc du charbon depuis Marcillac.
L’installation de chargement de ce charbon à Marcillac fait l’objet de
plusieurs documents, tous aussi instructifs les uns que les autres.
Mais comme cette installation de noria n’a visiblement pas été
réalisée, car elle n’est absolument pas visible sur les cartes postales
par exemple, nous n’avons donc pas figuré sur nos restitutions ces
rails annexes à Jogues, projet sans doute non réalisé.
Il s’agit d’abord de rails
de stockage, en rouge sur ce plan. Nous avons en effet découvert sur
plans un parc à charbon, contigu à l’installation, et destiné est-il
écrit à la vente locale de charbon (en bas, à
gauche). Les wagonnets montaient donc du charbon depuis Marcillac.
L’installation de chargement de ce charbon à Marcillac fait l’objet de
plusieurs documents, tous aussi instructifs les uns que les autres.
Mais comme cette installation de noria n’a visiblement pas été
réalisée, car elle n’est absolument pas visible sur les cartes postales
par exemple, nous n’avons donc pas figuré sur nos restitutions ces
rails annexes à Jogues, projet sans doute non réalisé.
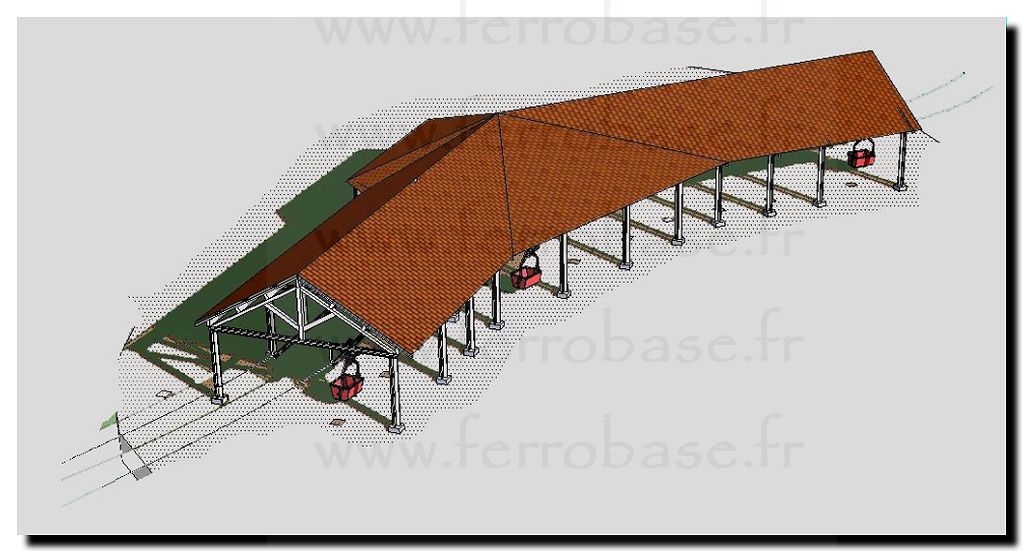
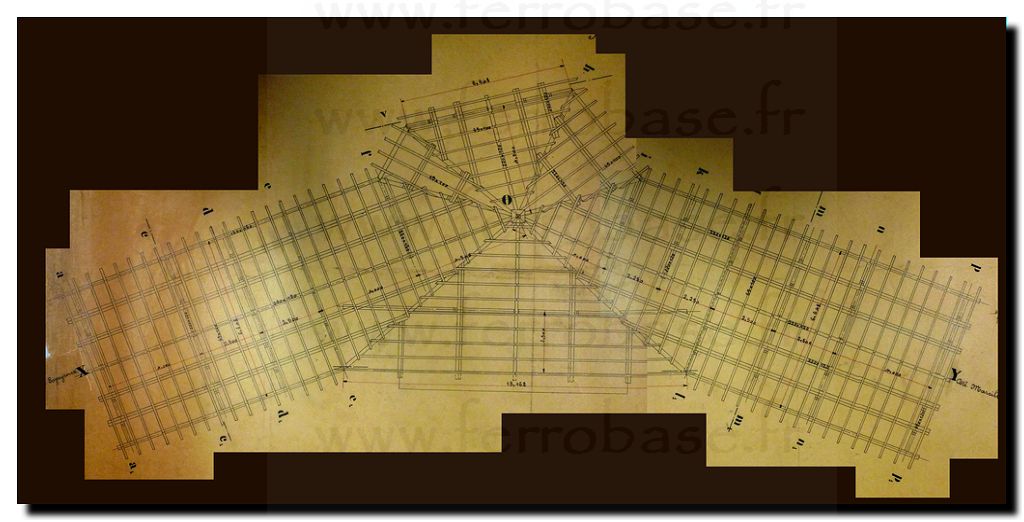
Plus complexe à saisir est maintenant la situation à l’opposé de ce parc à charbon assez virtuel.
Il faut auparavant revenir à la géologie locale. Vous savez
qu’une exploitation, en surface, puis en souterrain, fut un moment en
activité à Mondalazac, au village, et très près des habitations…La
couche exploitée s’enfonce très régulièrement dans le causse, vers le
sud, jusqu’à rencontrer la faille
centrale, celle là même qui va relever le compartiment suivant et
ramener notre fer plus près de la surface, comme à Cadayrac. Un projet
de galeries d’exploitation de minerai est développé : des galeries
partent de Mondalazac, et, très linéairement, se dirigent vers Jogues.
L’épaisseur de la couche utile justifie le projet. A Jogues, nous
sommes alors à 70-
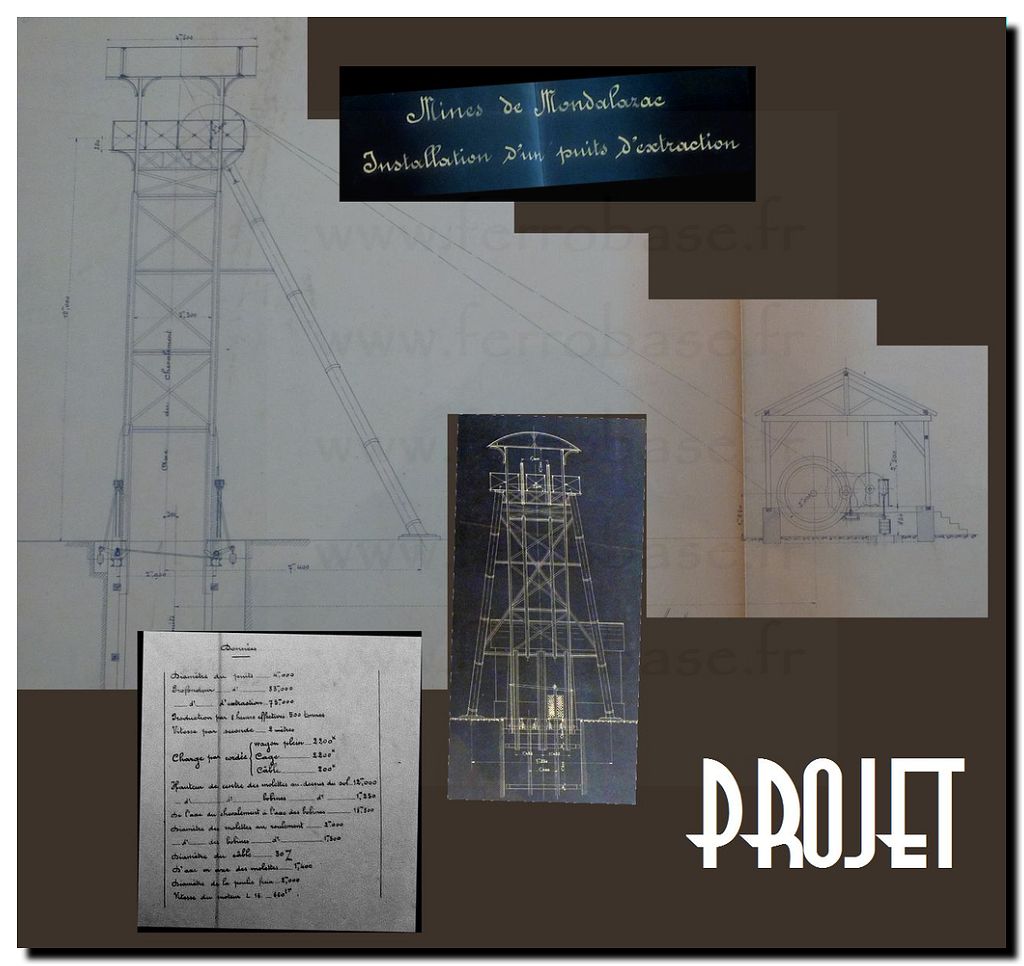 Les
bureaux d’étude de Decazeville ont ainsi étudié ce projet
d’exploitation. Il comprend les études de la partie souterraine et les
détails des infrastructures de surface, la recette
d’extraction de jour, en termes miniers. C’est ainsi que figure
le projet (daté du 10 janvier 1912) d’un puits d’exploitation de
Les
bureaux d’étude de Decazeville ont ainsi étudié ce projet
d’exploitation. Il comprend les études de la partie souterraine et les
détails des infrastructures de surface, la recette
d’extraction de jour, en termes miniers. C’est ainsi que figure
le projet (daté du 10 janvier 1912) d’un puits d’exploitation de
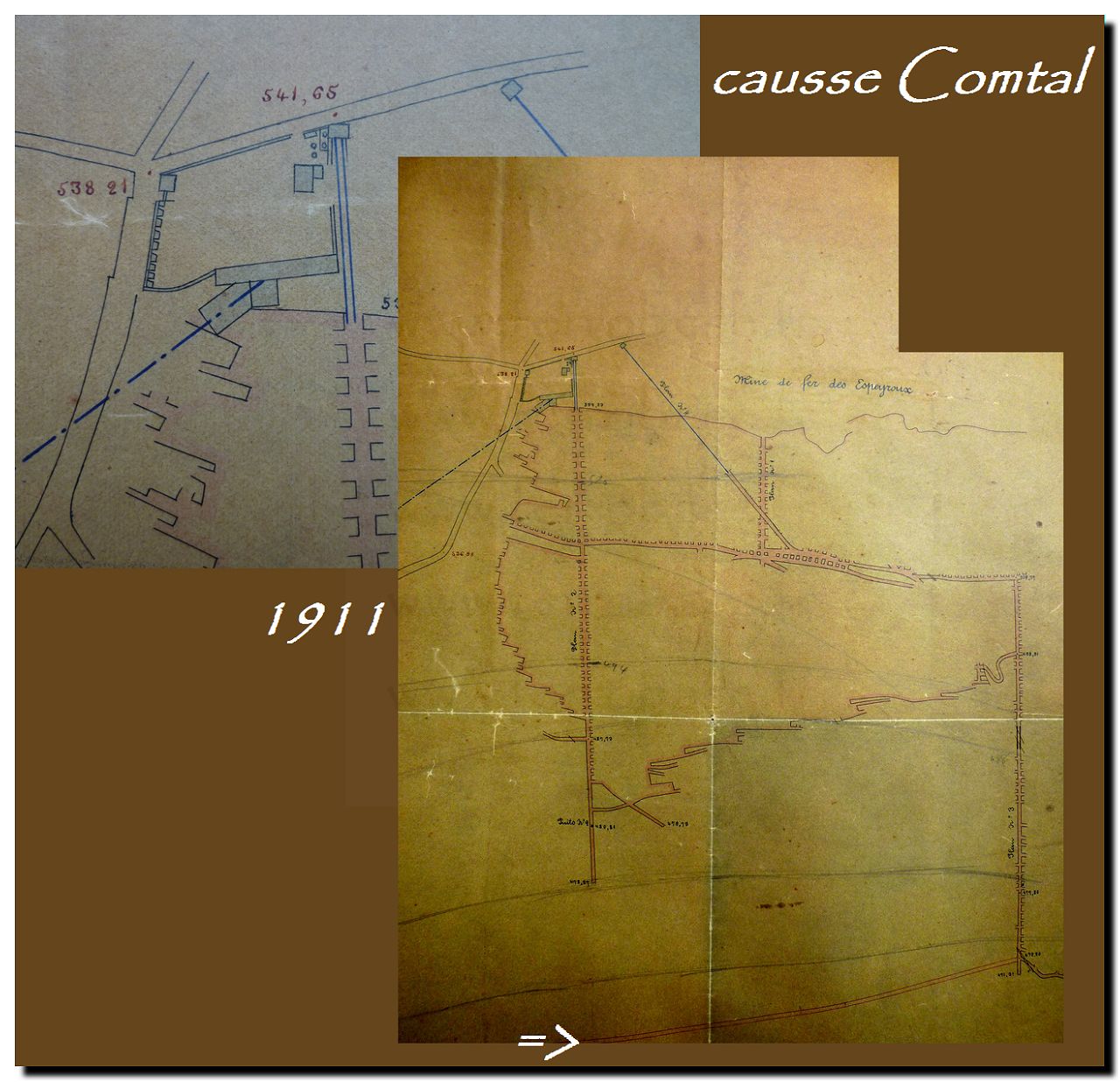
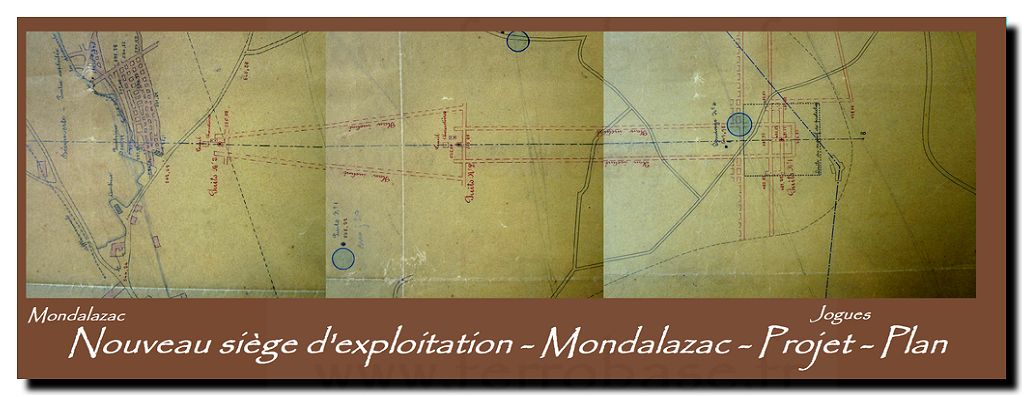
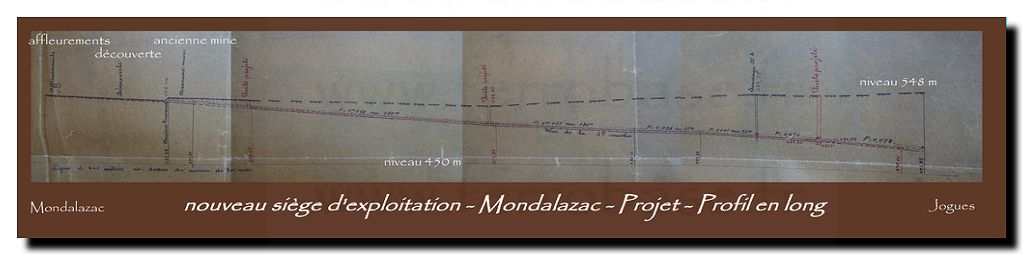
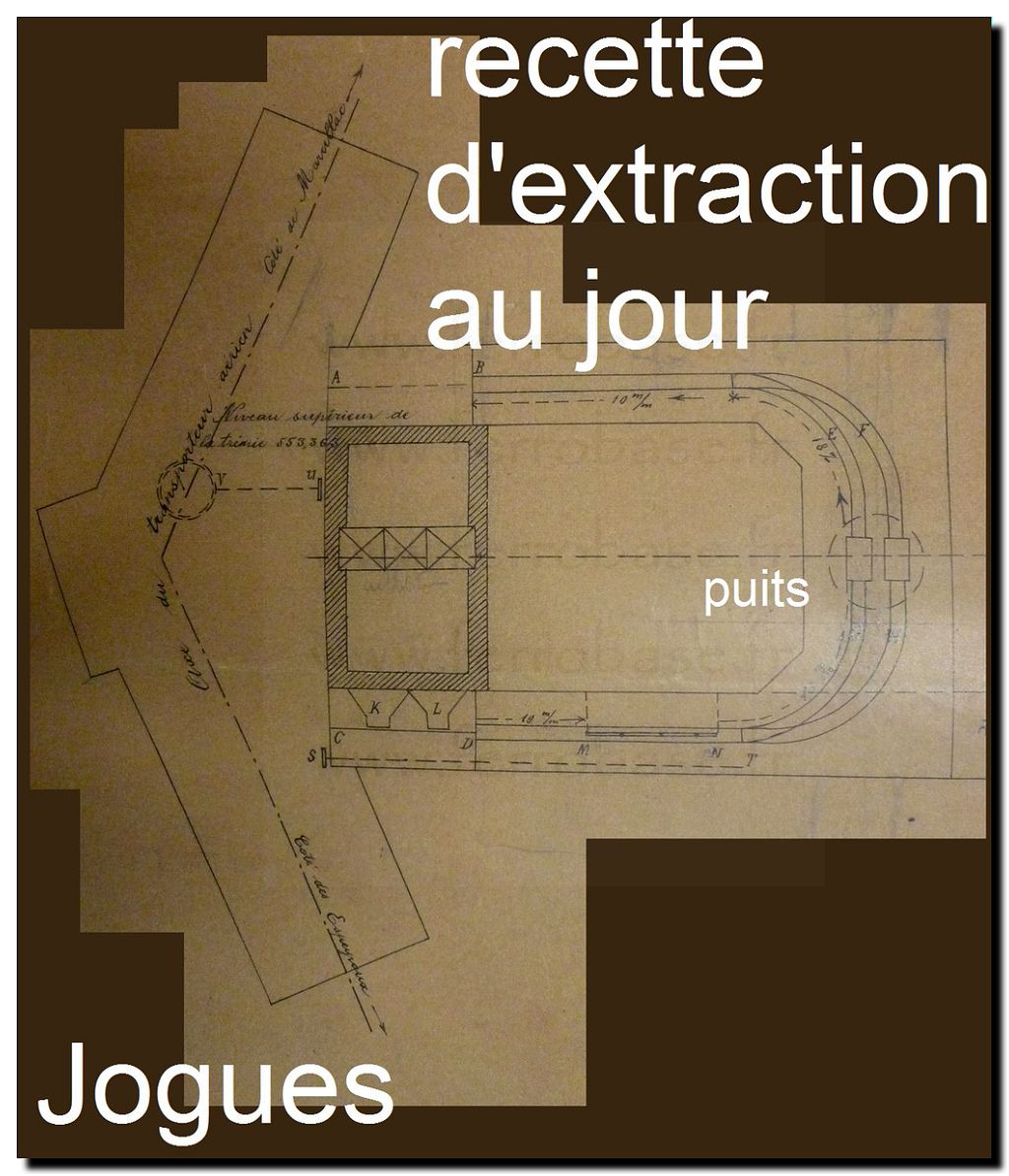
Sur le causse, à Ferals :
détail de l'arrivée du transporteur aérien à la mine des Espeyroux
et
projet de galerie d'exhaure (=>) du
nouveau siège d'exploitation. Ce plan ne montre que les quatre
plans inclinés de la mine.
projet de puits de 83 m
projet non réalisé
La géologie et la métallurgie se conjuguent : pour le haut fourneau de Decazeville le minerai de fer est évidemment un ingrédient absolument nécessaire, mais pas suffisant ! Le coke doit être présent, ainsi que la castine (dolomie). Ce dernier ingrédient, calcaire particulier se retrouve sur le causse, comme ici à Jogues. Et la compagnie avait donc prévue une exploitation de carrière de castine. Et cette fois, ce ne fut pas que du virtuel en projet. Il y a bien eu une telle exploitation, les photos aériennes de maintenant gardent le souvenir et montrent ces cicatrices sur le causse. Quelques rails complètent le tableau : une véritable petite exploitation, avec wagons et déversoirs dans les bennes de l’aérien. Jogues était donc une vraie plaque tournante de ce trafic de minerai ! Les ruines actuelles de Jogues, celles visibles, car la végétation masque totalement le plan de fondation, ne laissent apparaître que deux murs, imposants, parallèles, mais énigmatiques : ce sont en fait les murs de cette installation annexe. La station de changement de direction était donc accolée à ces murs. Comme la totalité de la structure de cette dernière était métallique, il ne reste évidemment plus de trace des poteaux, poutres et autres éléments, comme la poulie. C’est une (relativement grande) partie de cette charpente que nous avons retrouvée près de là, sur le causse, et présentée plus haut dans le billet relatif à Muret.

Quelques images de synthèse pour mieux faire connaissance.

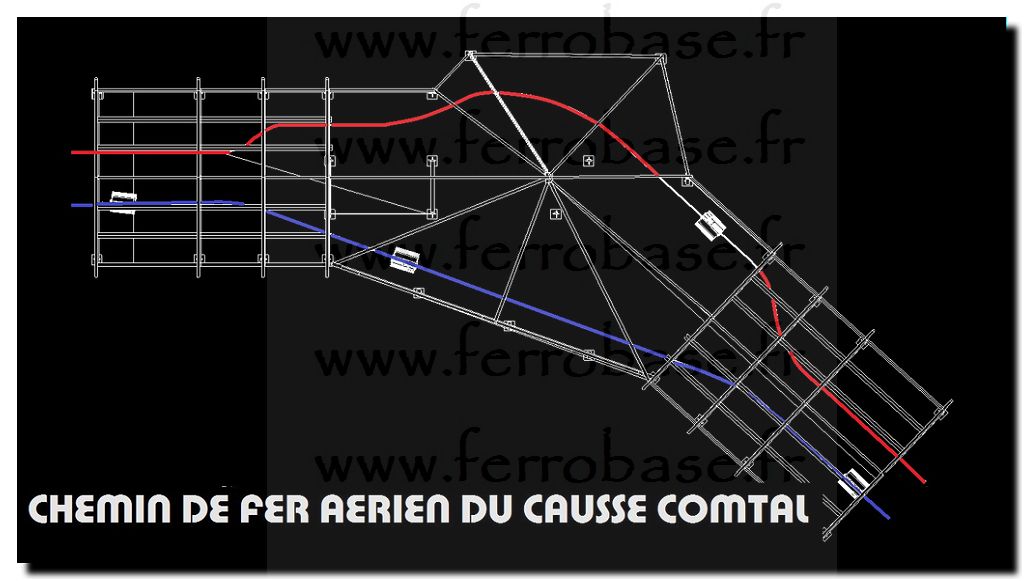
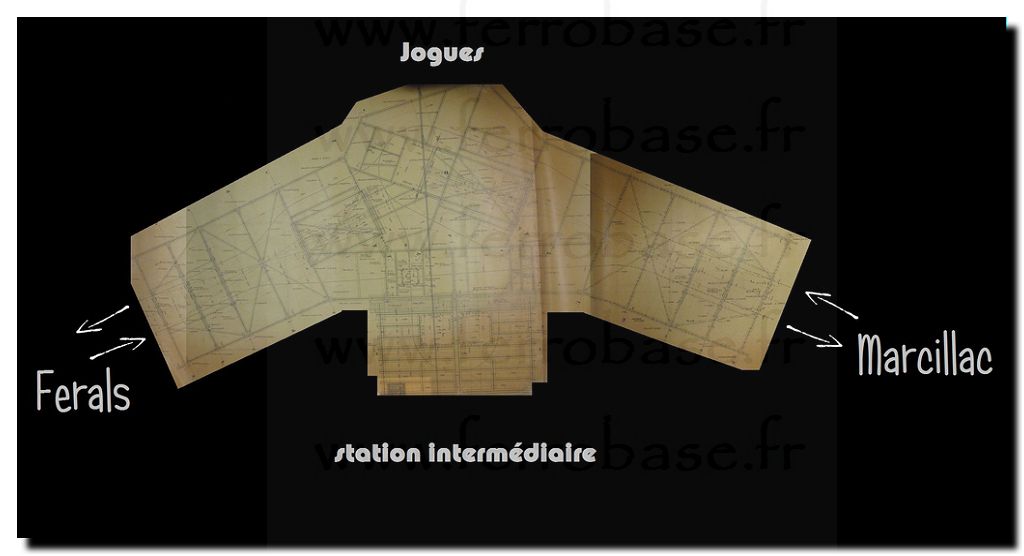
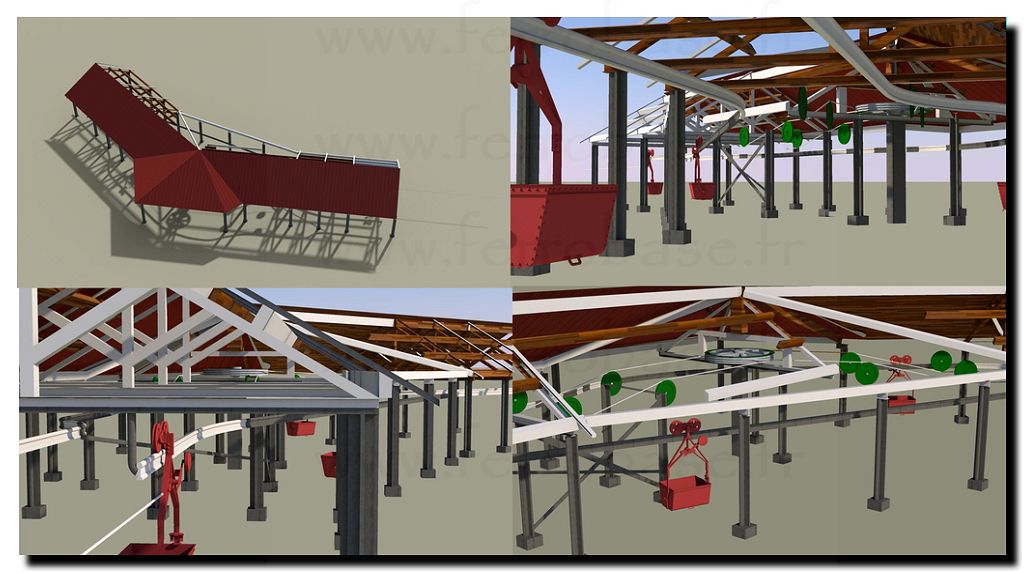
Ferals et Marcillac, deux têtes pensantes du trafic
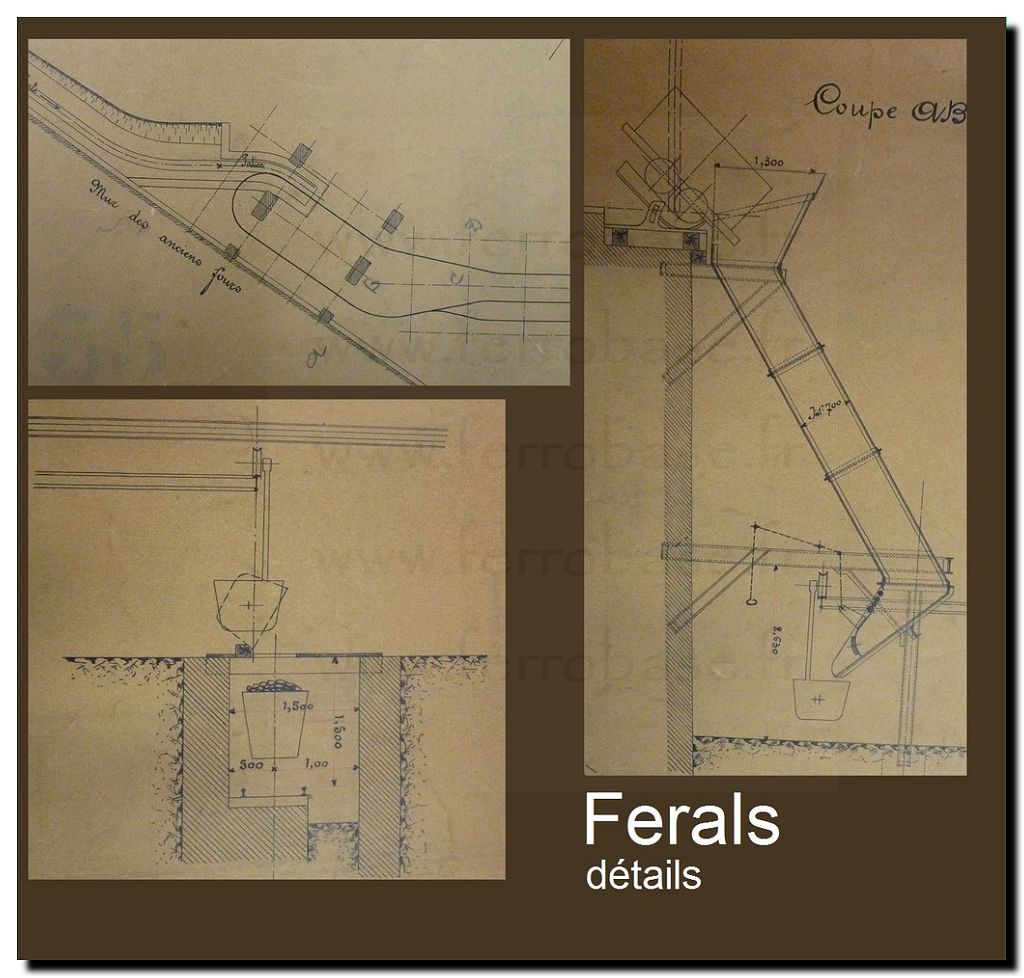
A Ferals, les plans analysés avec beaucoup d’attention, ajoutent des détails instructifs, comme la position réelle de l’installation de chargement, l’emplacement des anciens fours à griller, et les différentes goulottes de chargement dans les wagons et dans les bennes. Il y a aussi les détails d’installation d’un treuil à vapeur pour un des quatre plans inclinés de la mine des Espeyroux. Il y eut aussi un treuil électrique Pinette.

Marcillac se distingue, non par des détails de gare minière, mais par le projet, non réalisé, mais intéressant à connaître, de noria de chargement de charbon. Les wagons de charbon venant de Decazeville, à la faveur d’une plaque tournante à l’entrée de la gare, sont dirigés sur une voie spéciale et ensuite culbutés, pour verser leur contenu dans une fosse. De là, un plan incliné charge le charbon et le dirige vers la gare minière où il est versé dans les bennes de l’aérien. Il part ensuite vers le parc de vente sur le causse à Jogues. Enfin, il aurait dû partir, car ce projet, très soigneusement étudié et dessiné, n’a jamais été réalisé…Il est daté du 28 avril 1911, c'est-à-dire juste au moment où l’aérien commence ses figures de ballet, son et image, pour les dix ans qui suivent...
Sans le son, mais avec des images, pour vous immerger totalement dans cette station de Jogues, voici un film d'animation : noir et blanc, pellicule d'époque, avec rayures, poussière et cheveu !
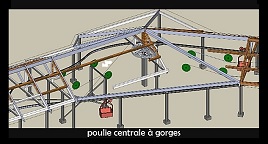 Et
ici, en couleurs, sans rayures ni poussière ou cheveu, une minute et 21
secondes pour voir tourner la poulie et observer le mouvement des
wagonnets, très pédagogique... Clic sur la vignette !
Et
ici, en couleurs, sans rayures ni poussière ou cheveu, une minute et 21
secondes pour voir tourner la poulie et observer le mouvement des
wagonnets, très pédagogique... Clic sur la vignette !
(orthographe d'origine pour les citations. Sources Archives Départementales Aveyron, ASPIBD Decazeville 2014, et autres citées)
Lorsque Elie Decazes met en œuvre son entreprise, il s'entoure bien sûr d'avis techniques. Nous avons déjà par exemple souligné l'implication de Ours Armand Dufrénoy. L'ingénieur, qui vient en 1826 de réaliser un voyage métallurgique en Angleterre était évidemment bien placé pour conseiller à la même époque le duc et les actionnaires sur l'obtention de la fonte à la houille. Le même ingénieur sera également mis à contribution pour accélérer autant qu'il est permis l'attribution de concession : il se déplacera même à Toulouse, venant d'Albi, où, comme on le sait, le préfet en place n'est autre que Joseph, frère d'Elie, pour expliciter le projet auprès de l'ingénieur des Mines. C'est en 1826 qu'un autre ingénieur fait son apparition dans le cercle des conseillers, François Cabrol. Le rapport dont nous allons présenter l'essentiel de sa dense matière, va nous permettre, au-delà du contenu technique proprement dit, de rencontrer un ingénieur très motivé, soucieux des détails comme de l'essentiel. Il apparaît également, au travers de quelques rapides phrases, des éléments qui éclairent et nous renseignent sur la personnalité de celui qui sera beaucoup plus tard, vers 1845, un Maître de forges parfaitement reconnu et accepté nationalement. Un seul croquis illustre le rapport, celui d'un haut-fourneau. Il sera analysé en fin de texte.
En 1826 François Cabrol comprend que sa carrière militaire va se terminer au grade de capitaine en premier. Même si le capitaine apparaît dans les états militaires comme en poste à Toulouse, y compris pour l'année 1828, ses préoccupations semblent toutes autres. Dans une lettre au duc Decazes et M. Humann, administrateurs de la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron, écrite le 25 mai 1826, François Cabrol fait part de son intention d'être compté au nombre des premiers actionnaires de la compagnie. "Je recevrai dix actions avec reconnaissance…" précise-t-il. Dans ce même courrier il déclare sa "confiance dans l'entreprise dont vous avez bien voulu me confier la direction". Le souhait de Cabrol ne va pas se réaliser ; il ne sera pas dans le premier cercle des 14 actionnaires de 1826 et devra attendre la prochaine augmentation de capital pour apparaître. Est-ce un souci financier ? Le cautionnement en immeubles proposé par Cabrol n'a-t-il pas pu se réaliser ? C'est probable. Mais ce courrier, qui précède de quelques semaines la création officielle de la compagnie, confirme la position de Directeur de François Cabrol, premier directeur donc de l'entreprise.
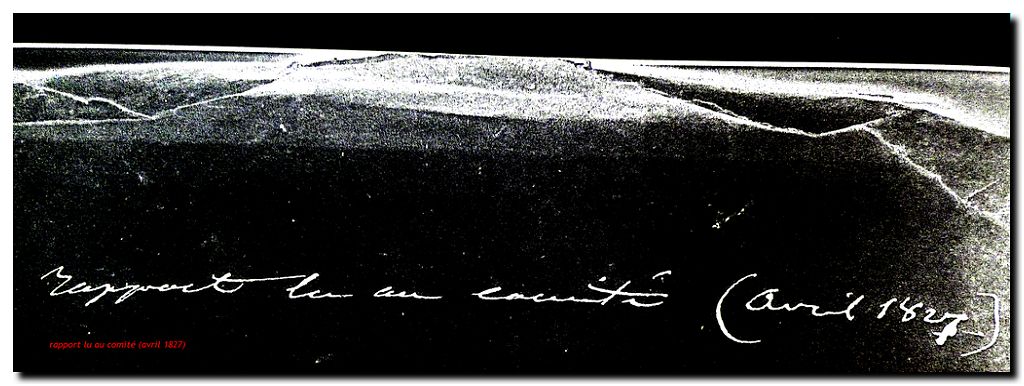
Presque un an plus tard, en avril 1827, le comité d'administration aura au menu un rapport de son directeur, rapport copieux, 31 pages. (L'original porte avril 1826, avec une surcharge très nette, un 7 au lieu du 6 initial). François Cabrol fait œuvre d'ingénieur, en soumettant ses vues sur des points très techniques : comment construire un haut fourneau, comment obtenir de la fonte, comment mettre en place des fondations solides et un muraillement efficace. Il évoque également quelques questions plus globales, comme le logement des ouvriers, ou la nécessité de nommer un ingénieur. Ce sont ces points que nous allons rapidement reprendre.
Il s'adresse aux membres du comité, indistinctement, sauf à une occasion où il évoque M. Humann, pour obtenir son appui pour la rédaction du règlement de la compagnie. Son rapport se divise en 9 parties :
1° la détermination des dimensions de la cuve de vos hauts
fourneaux
2° la précaution à prendre pour leur solidité
3° l'achat des briques réfractaires
4° l'achat des pierres pour l'ouvrage
5° l'achat des fontes et du fer qui doivent être employés
cette campagne
6° le choix d'un régulateur
7° les commandes des porte vents
8° la création de l'emploi d'ingénieur de
9° l'organisation ou règlement pour le service intérieur
Le préambule de François Cabrol souligne l'importance de la
compagnie, et les bénéfices futurs à attendre. Mais il ne
faut pas se dissimuler que nous sommes encore dans l'enfance pour le
traitement des minerais de fer par le coke. Lorsqu'une industrie prend
naissance, elle ne peut avoir d'abord toute la maturité que le temps
seul peut lui donner.
L'ingénieur directeur aborde très rapidement les questions techniques, sans cacher que les difficultés sont plus à venir que déjà vaincues. Le point positif développé alors est l'action des Anglais, nos maitres en sidérurgie. Ce qu'ont fait les Anglais dans les débuts, nous n'aurons pas à le refaire. Il faut tout simplement accepter leurs idées et savoir-faire, en profitant gratuitement de l'expérience acquise par nos voisins après de nombreux essais et des sacrifices pécuniaires énormes.
La fonte n'est pas un but, mais un moyen d'obtenir du fer, après
l'opération de puddlage. A cette époque, il faut évidemment comprendre
le terme fer comme acier…Cabrol soulignera pour les actionnaires la
position heureuse des anglais : houille, minerai et fondant présents en
un même lieu. En Aveyron, il en sera un peu différent. Un chiffre est
avancé : nécessité d'employer
12 à 15 mille kilog de matériaux pour obtenir une tonne de fer.
Quoique l'expérience des Anglais ne puisse
s'appliquer identiquement à notre position, nous devons cependant dire
que leurs travaux ont été et seront encore pour nous d'un grand
secours, et qu'ils nous ont mis à même d'entrer dans une carrière où
nous pourrons marcher, si non d'un pas assuré, du moins encouragés par
leurs succès et éclairés par l'analogie.
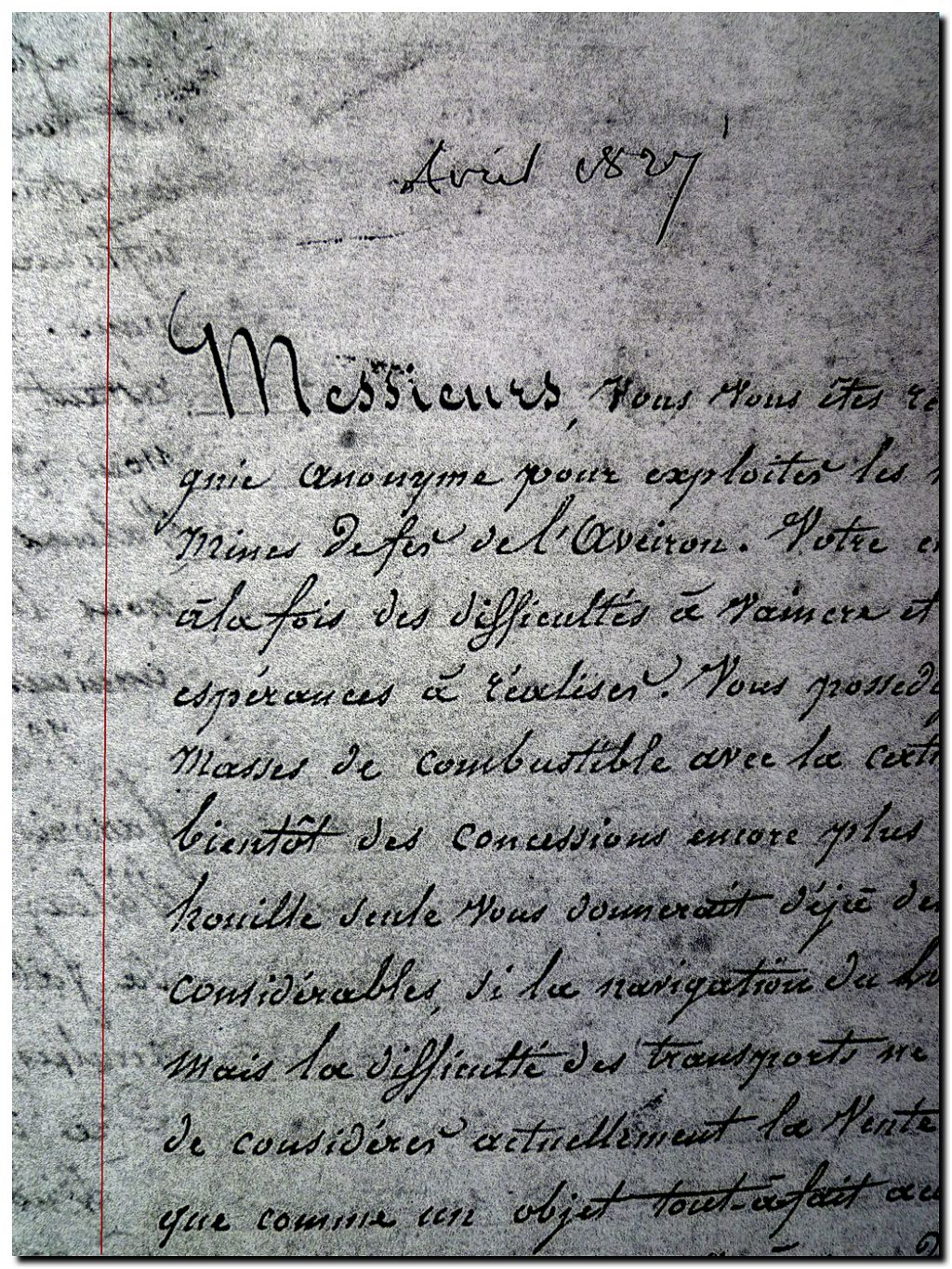 Pour autant, Cabrol n'ignore pas les précédents français : il ne faut pas non plus dédaigner les exemples puisés dans
notre pays ; quoiqu'ils soient peu nombreux ils nous apprendront à
éviter quelques écueils et nous convaincront sans doute de cette
vérité, d'ailleurs si bien démontrée, que toujours et particulièrement
au commencement d'une entreprise l'économie la plus sévère doit être
observée, que des bâtiments inutiles, ou le luxe des constructions
employant en pure perte les capitaux au détriment de l'industrie
produisent nécessairement des pertes considérables et entrainent
souvent la ruine des fondateurs. Ces dernières assertions visent
directement les établissements du Creusot, cités pour souligner qu'il
ne faudra pas suivre l'exemple…Il précisera même, certain d'être
compris par les actionnaires, que si les capitaux au lieu
d'être employés en tas de pierres improductifs avaient servi à la
recherche active des minerais de fer, aux fouilles du terrain houiller,
aux transports des minerais de
Pour autant, Cabrol n'ignore pas les précédents français : il ne faut pas non plus dédaigner les exemples puisés dans
notre pays ; quoiqu'ils soient peu nombreux ils nous apprendront à
éviter quelques écueils et nous convaincront sans doute de cette
vérité, d'ailleurs si bien démontrée, que toujours et particulièrement
au commencement d'une entreprise l'économie la plus sévère doit être
observée, que des bâtiments inutiles, ou le luxe des constructions
employant en pure perte les capitaux au détriment de l'industrie
produisent nécessairement des pertes considérables et entrainent
souvent la ruine des fondateurs. Ces dernières assertions visent
directement les établissements du Creusot, cités pour souligner qu'il
ne faudra pas suivre l'exemple…Il précisera même, certain d'être
compris par les actionnaires, que si les capitaux au lieu
d'être employés en tas de pierres improductifs avaient servi à la
recherche active des minerais de fer, aux fouilles du terrain houiller,
aux transports des minerais de
Après cet exemple somptuaire, Cabrol évoque le cas de
Ces deux exemples ne sont évidemment pas à suivre, et François Cabrol se lance alors dans une longue suite de chiffres pour prouver qu'avec peu, mais quand même quelques moyens, il sera profitable d'exploiter les gisements de l'Aveyron.
En ce point de son rapport, à l'attention de ceux qui
ne se sont jamais occupés de l'art des forges, François Cabrol va
développer par le détail ce qu'est une fonte, comment on l'obtient, ses
diverses qualités et utilisations. On ne peut ici que souligner à
nouveau la confiance de ces investisseurs, confiants dans les paroles
du duc et de ses experts. Passons donc rapidement sur ce cours de
métallurgie, sauf à retenir que le
Coke de Firmi relativement à la chaleur qu'il est susceptible de
développer est classé parmi les qualités moyennes du
Stasforsshire.
Et le directeur s'applique avec beaucoup de précautions
oratoires à justifier l'entreprise : Quant aux minerais je
suis convaincu qu'avec les variétés dont vous êtes possesseurs, nous
parviendrons à composer un dosage d'une richesse analogue aux minerais
Anglais et qui probablement produisent du meilleur fer ; les gangues de
différente nature et particulièrement celles des minerais calcaires
nous permettront de compter avec une petite addition d'un flux
convenable sur des fondants naturels portés par les minerais eux-mêmes.
Dans l'opinion que j'énonce ici, je me base sur deux faits qui me
paraissent bien constatés ; le 1 er que le fer est réellement de
meilleure qualité lorsqu'il provient de minerais divers fondus ensemble
; le 2ème que plus un mélange contient de qualités de terres plus il
est fusible. Je ne puis pas vous dire maintenant comment seront
composés nos dosages ; ce sera l'objet d'un travail spécial ; mais
quand on possède les minerais quartzeux, calcaires, argileux et qu'on
peut les combiner ensemble en diverses proportions, on doit espérer
d'heureux résultats.
Le rapport rentre ensuite dans les détails, et il est évident que le directeur est bien l'homme de la situation. Sa connaissance du haut fourneau, tant la conduite que la construction ou les dimensions est remarquable. Sans doute trop, car il va y avoir des pages entières pour expliquer ce qu'un administrateur de 1826 doit savoir : où trouver les briques réfractaires, quelles dimensions diamètres et hauteurs, comment couper les pierres…Nous n'avons bien sûr aucune idée de la manière dont le rapport fut reçu et écouté…et compris ! L'exemplaire analysé, manuscrit bien sûr, ne semble pas de la main de Cabrol. Il peut avoir été mis en forme et présenté au comité par un autre que son auteur ? Cela est fort possible, la comparaison des écritures de Cabrol et du rapport semble le confirmer. Nous espérons seulement que le lecteur du comité, quel qu'il ait été, avait un talent d'animation certain. Sur la forme, on notera que les unités avancées par Cabrol sont le pied et le pouce : le système décimal aurait dû prévaloir ; son caractère obligatoire remonte au 1 er juillet 1794…
La situation géographique pour implanter ce premier haut
fourneau est précisée : Firmy. Comme le dit François,
je
n'ai pas à m'occuper de l'emplacement de l'usine, ce projet est déjà
réglé. Dans ce choix on s'est sans doute basé sur l'influence majeure
des transports. On a aussi exécuté une partie des terrassements mais
les fondations qui sont un objet fort important ne sont pas encore
commencées. J'espère que dans le terrain de
On notera avec intérêt que l'implantation à
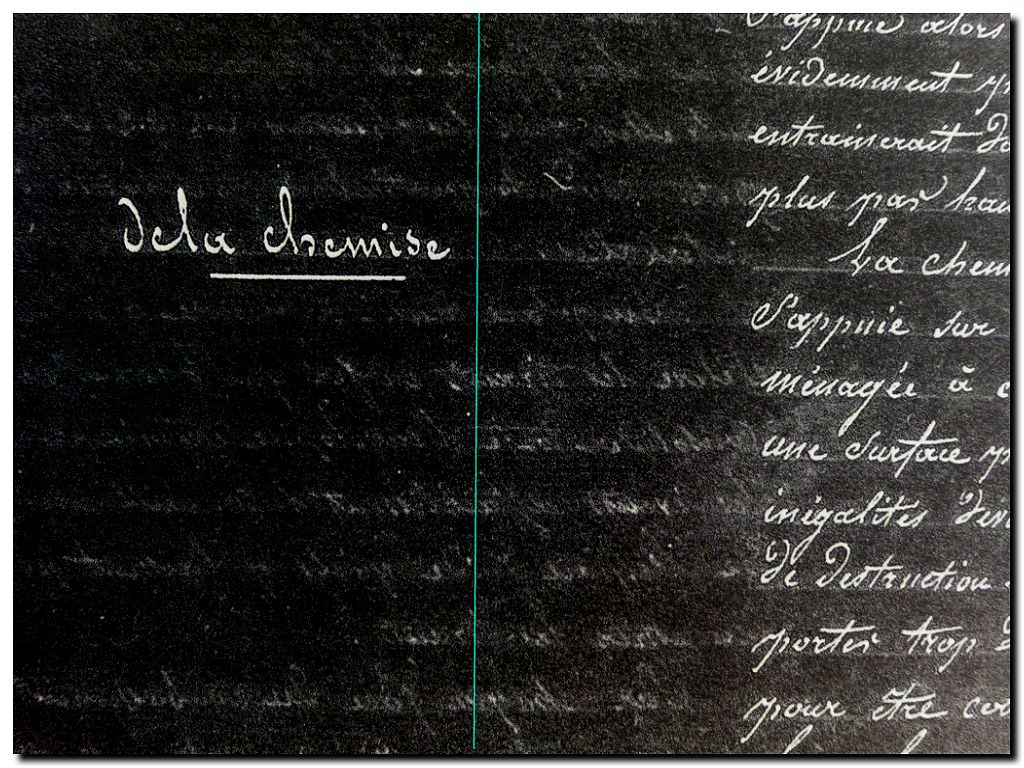
Après ce long développement, François Cabrol explicite le rôle des porte-vents et du régulateur, deux éléments non compris dans le projet, à tort souligne-t-il.
Avant de terminer, il me resterait à vous parler,
Messieurs, des batimens accessoires, tels que fonderie, halle de
chargement, fours à griller, appentis pour les minerais grillés, maison
pour les ouvriers et les employés, etc, etc. Je pense, qu'à ce sujet,
on ne doit construire que ce qui sera jugé absolument indispensable.
Ces points ne peuvent vous offrir aujourd'hui l'intérêt que par
l'économie qui doit présider à leur construction ; elle me guidera
toujours dans les projets, plans et devis que j'aurai l'honneur de vous
soumettre le plutôt possible et qui ne seront arrêtés qu'après les
décisions prises sur les lieux par Messieurs les membres de
Si la construction de ce haut-fourneau est l'objet principal du
comité d'administration, il faut penser au futur. Le futur, c'est
l'usage que l'on fera de la fonte. Vous avez pris la sage
résolution de ne construire une forge que lorsque le produit des hauts
fourneaux serait constaté ; j'ai donc tout le temps d'étudier le
terrain pour proposer l'emplacement le plus convenable pour cette
usine. Avant la mise à feu du premier fourneau, tout devra être prévu
et combiné de manière à nous tenir prêts à construire aussitôt que vous
aurez pris une décision à ce sujet.
On sait bien sûr que l'usine, c'est-à-dire principalement la
forge, sera construite non pas à Firmy, mais à
Le rapport se termine par une précision importante : permettez
moi, Messieurs, de vous dire un mot sur le personnel de votre
administration. Vous avez déjà nommé votre régisseur caissier ; mais il
est un autre emploi, qui n'est pas prévu dans vos statuts et qui
cependant mérite votre attention. L'étendue de vos houilles et de vos
mines de fer qui se trouvent disséminées sur une assez grande surface
de terrain, exigent beaucoup de temps pour les parcourir. La
surveillance active de leur exploitation peut occuper tous les instants
d'un homme zélé. J'ai l'honneur de vous proposer de créer à cet effet
l'emploi d'ingénieur. Les services de M. Guillemain, son activité et
ses connaissances que vous avez été à même d'apprécier depuis huit mois
qu'il est avec vous, militent en sa faveur. Vous feriez cesser le
provisoire dans lequel il se trouve en le nommant ingénieur de
Le directeur ne pouvait conclure, en ancien capitaine d'artillerie, sans évoquer l'administration du site. C'est très fermement écrit, et on ne doute pas de l'approbation des administrateurs : L'unité, l'ordre et l'ensemble sont les colonnes d'un établissement. Les forges d'Audincourt, modèle de bonne administration nous offrent un bel exemple à imiter. Je ne crains pas de solliciter en vain l'intervention de M. Humann, pour la rédaction de notre règlement. Quant à la conduite à tenir avec les opposans aux concessions du terrain houiller et généralement pour toutes les relations avec les habitans du pays je me conformerai aux instructions qui ont déjà été données à ce sujet par Monsieur le Duc de Cazes jusqu'à ce que vous jugiez convenable de les étendre ou de les modifier.
Dessin
du haut-fourneau
Réalisé au crayon, il est coté, en pieds et pouces. Des annotations difficilement lisibles sont portées. Nous avons rapproché ce dessin de celui, aquarellé, qui présente ce même haut-fourneau dans l'ordonnance royale de création et d'autorisation de 1829. Ils sont très semblables en tout, forme et dimensions.
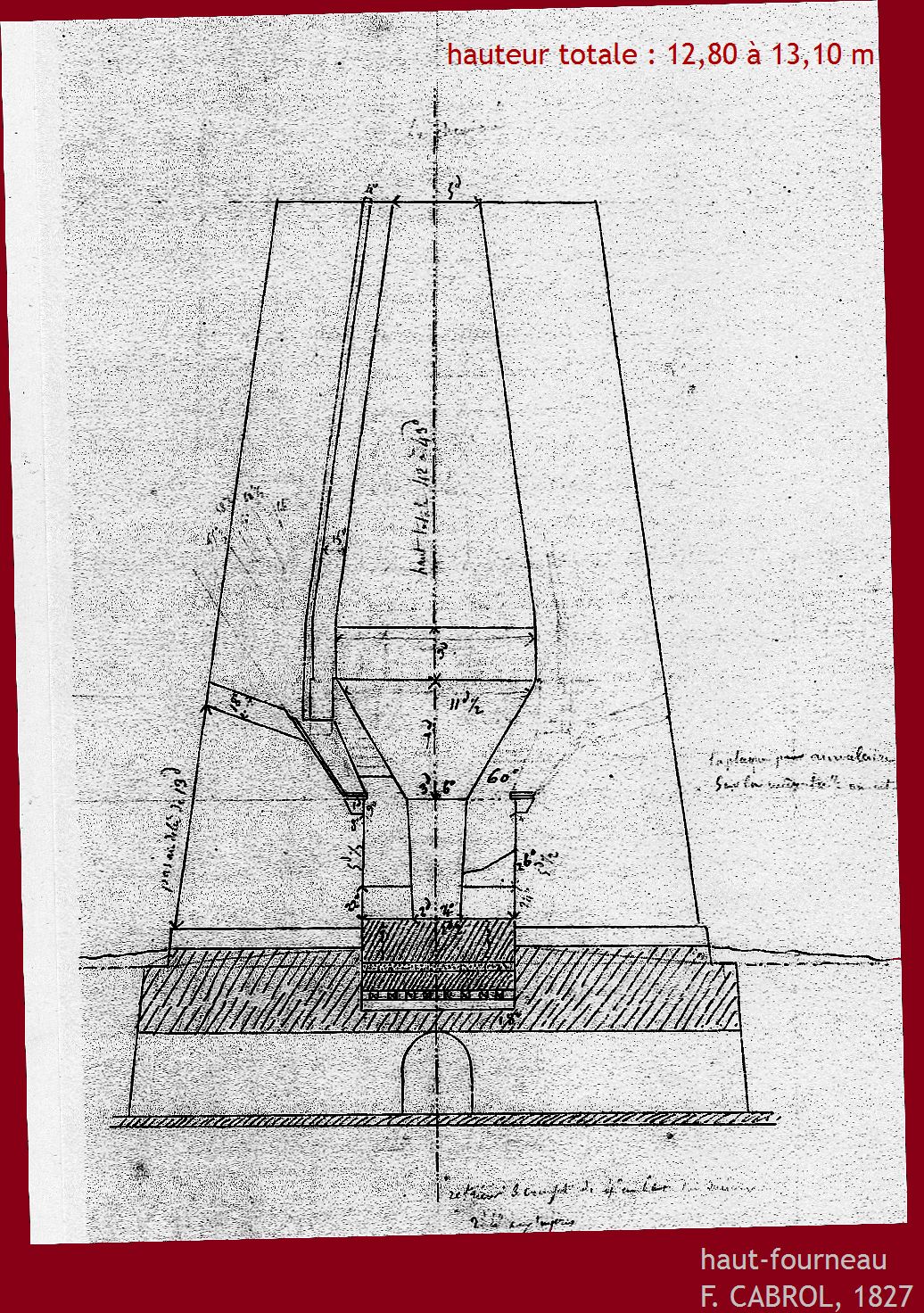
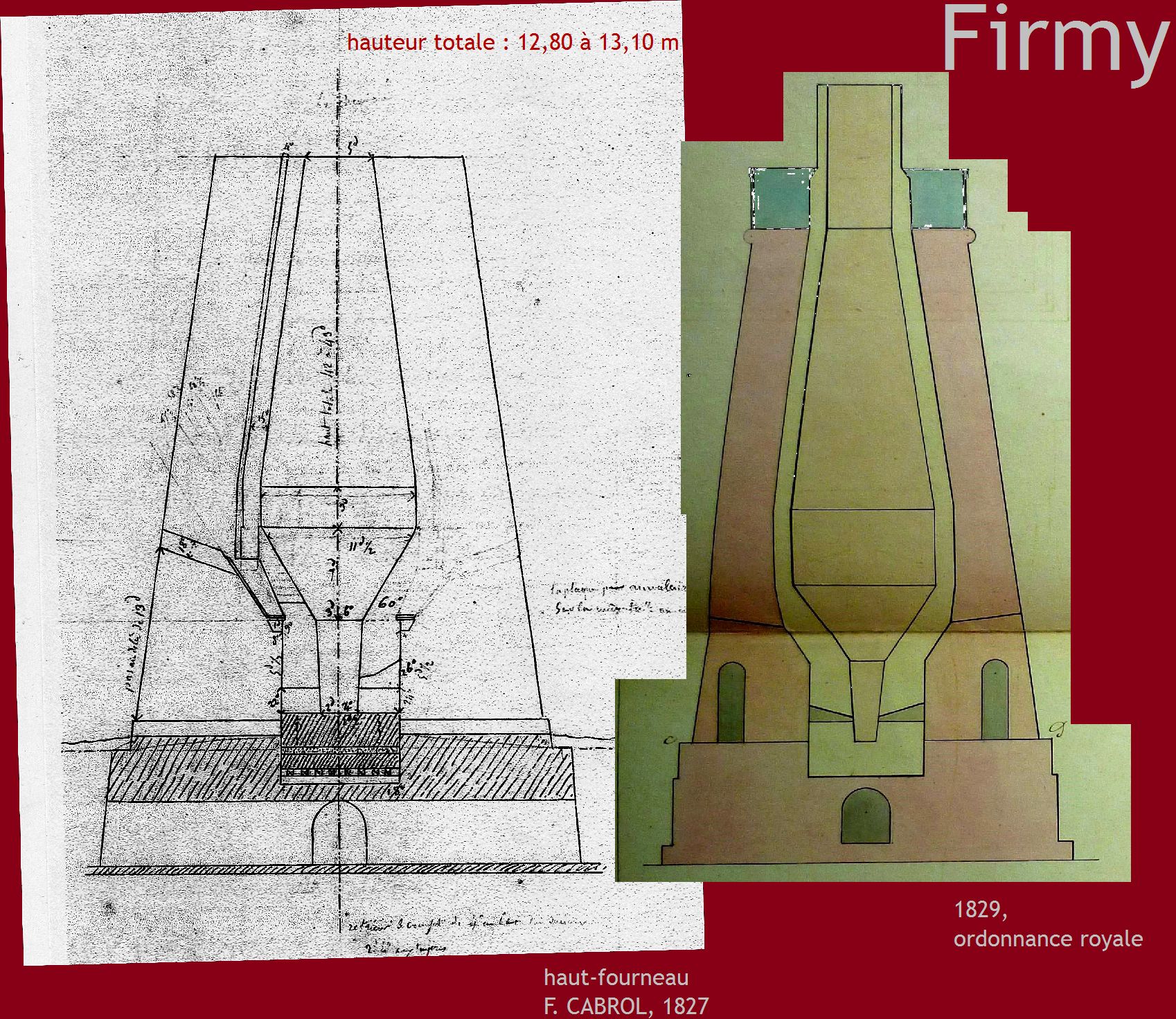
1827-1840, naissance d'une comptabilité industrielle...
Les premières années de l'histoire industrielle de Decazes-ville ont été l'occasion pour les fondateurs, dont François Cabrol évidemment, de mettre en oeuvre des solutions techniques aussi satisfaisantes que possible et une organisation administrative que l'on sonhaitait tout autant efficace. Il y avait deux centres de décision : Paris, où le comité d'Administration siégeait, et l'Aveyron, avec les sites des exploitations et usines. A Paris, ce fut très rapidement le banquier Pillet-Will, évoqué dans un autre chapitre, qui prend une importance particulière. On se souvient qu'il viendra en Aveyron pour un audit très soigneux, si soigneux d'ailleurs que François Cabrol, en opposition, quittera la compagnie le 14 juin 1833, pour ne revenir que le 11 janvier 1840. L'existence de ces deux centres de décision va rendre difficile la gestion des sites.
On lira avec profit la thèse de Marc Nikitin, La naissance de la comptabilité industrielle en France, Paris Dauphine, décembre 1992, pour comprendre les difficultés de gestion considérables de ces fondateurs : mettre en place une comptabilité permettant de cerner au plus près les coûts, dont les prix de revient de la fonte, est très difficile car les doctrines sont balbutiantes ou inexistantes, et les comparaisons avec d'autres forges délicates. La navigation à vue verra donc souvent dans ces premières années s'opposer François Cabrol, ingénieur porté vers l'expérimentation, et le banquier Pillet-Will, soucieux d'un rendement important et immédiat, pour lequel les expérimentations sont sources de retards et de frais...
Pour son travail universitaire, Marc Nikitin a dépouillé, entre autres sources, pour le site rouergat le fonds 84AQ des Archives Nationales. Malgré l'erreur (plus que commune ! ) qui nous apprend que le duc de Cazes (ainsi écrit) décède en Aveyron à Decazeville, une cinquantaine de pages (243-296) sont consacrées à la mise en place de cette comptabilité industrielle. En poste de Directeur, on l'a vu précédemment en 1827, François Cabrol percevait un traitement de 10000 francs annuel, ainsi qu'un intéressement de 5% sur les bénéfices. A la même époque, en 1830, le préfet Joseph Decazes, quittait ses fonctions à Albi avec un traitement de l'ordre de 20000 francs. L'ingénieur anglais du site de Decazes-ville percevait 6000 francs, et son collègue du site de la Forézie 4000 francs. Lorsque Cabrol quitte ses fonctions, son successeur Coste touchera 1200 francs par mois et 2 à 3 % des bénéfices. Le Comité d'Administration parisien s'était réparti les fonctions en cinq sections :
- haute surveillance....: Humann, Pillet-Will
- budget...:André et de Villeneuve
- acquisition, exploitation...: de Cazes et Germiny
- production, ventes...: Milleret et Villegontier
- comptabilité...:Argout et du Taillis
On remarque que les banquiers (Pillet-Will, André, Milleret) sont évidemment à leur place. Les responsabilités propres du duc sont assez vagues et pour l'auteur de la thèse, c'est Pillet-Will qui apparait comme le pivot de la compagnie vers 1832-1833. A cette époque le duc va se consacrer à ses activités parisiennes de pair de France : mes forges se portent bien écrira-t-il...
Dans son rapport de 1827 nous avons vu que Cabrol évoque le régisseur-caissier de la compagnie, déjà en poste quand le directeur arrive. Ce premier régisseur fut M. Levaillant. Le poste était essentiel pour les écritures et la transmission des informations vers Paris. Il fut révoqué (pour quelles raisons ? ) le 23 avril 1828 et remplacé par M. Van Brienen. Nous avons déjà rencontré ce monsieur, comme directeur par intérim, sûrement après Coste... Nikitin cite le chiffre de 45 employés sur les sites aveyronnais en 1832.